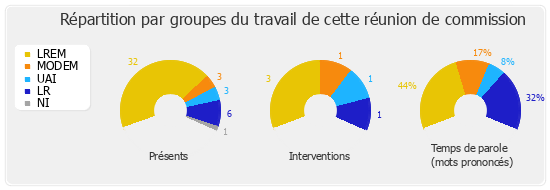Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Réunion du mercredi 18 juillet 2018 à 10h15
Résumé de la réunion
La réunion

Notre troisième table ronde thématique porte sur l'évolution de l'État stratège et les privatisations. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Elie Cohen, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), et M. Julien Dubertret, inspecteur général des finances, qui vient d'achever – avec d'autres – un rapport de l'inspection générale des finances sur la rationalisation des aides à l'innovation. Je vous remercie, au nom de l'ensemble des membres de la commission spéciale, de votre disponibilité et de votre réactivité.
Comme à l'accoutumée, je vous propose, en ouverture, de nous présenter dans un propos introductif d'une dizaine de minutes ce qui vous apparaît comme les points saillants du projet, ses avancées et le cas échéant ses limites ou ses points d'alerte. Je me permettrai ensuite de vous poser brièvement une question, très certainement suivie d'une autre du rapporteur général. Nous ferons ensuite un tour de table des représentants des groupes, qui disposeront chacun de deux à trois minutes pour poser leurs questions, afin de vous laisser le temps de répondre. Je n'en dis pas plus et je propose à M. Cohen de commencer.
Je vous remercie pour votre invitation, qui m'a permis de prendre connaissance de ce texte particulièrement riche et touffu, allant dans des directions très variées. Il m'a été demandé de focaliser mon intervention sur le problème des privatisations. Mon intervention pourrait durer trente secondes : s'il s'agit de vendre la Française des jeux pour abonder un fonds d'innovation de rupture, je signe des deux mains ! En revanche, le problème commence à partir du moment où l'on s'interroge sur le sens des privatisations dans le cadre du débat plus large, et sempiternel, sur le caractère stratégique ou pas de telle ou telle participation, sur la logique d'arbitrage entre les participations et sur la multiplicité des organes qui portent les participations publiques.
Je partirai d'abord de ce qu'étaient les objectifs affichés des nationalisations dans le passé et de l'existence d'un secteur public aujourd'hui. J'en identifie quatre, au regard desquels les décisions prises doivent être jugées. Le premier consiste à peser sur la spécialisation industrielle et économique du pays. On ne le dit pas assez, pourtant c'est une constante en France depuis la Libération. Nous sommes un pays qui considère que le mécanisme de spécialisation économique ou industrielle ne relève pas de décisions ou d'arbitrages individuels, donc de constats ex-post. Nous considérons que l'État a un rôle à jouer dans la spécialisation. Depuis 1945, ce premier objectif a pour toile de fond l'Allemagne. Nous rêvons, depuis 1945 et même 1870, d'émuler le modèle industriel allemand. Aussi avons-nous passé notre temps à vouloir être des grands de la machine-outil – en échouant régulièrement, bien entendu !
Le deuxième objectif affiché vise à préserver les actifs stratégiques. Nous considérons que l'industrie est une partie de la souveraineté et que nous devons donc contrôler un certain nombre de ces industries. Certes, cette notion a beaucoup évolué dans le temps. Mais elle a directement inspiré un certain nombre de politiques, à commencer par les politiques de spécialisation dans les télécoms ou dans l'industrie aéronautique civile et militaire – tout ce qui relève du modèle de grand projet et que j'ai appelé, dans une vie antérieure, le « colbertisme high-tech ». Cela renvoie tout à fait à l'idée que l'industrie est l'un des attributs de la puissance et que, par conséquent, l'État doit veiller à préserver ces actifs stratégiques. Toute la question consiste à savoir ce qu'est un actif stratégique aujourd'hui.
Le troisième objectif affiché est l'intervention de l'État, via le secteur public, pour aider les entreprises françaises à répondre aux défis de l'européanisation et de la mondialisation, donc à se projeter à l'extérieur – si nous en avons le temps, je vous raconterai les mille et une turpitudes de l'État pour aider certaines entreprises à réussir sur des marchés étrangers en appliquant des méthodes que la morale réprouve… Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui ! En tout cas, l'État a bel et bien cette volonté d'aider nos champions nationaux à réussir dans la mondialisation.
Enfin, le quatrième grand objectif affiché vise à contrôler les réseaux d'infrastructures des fournisseurs de services publics. Il convient de se souvenir, à ce sujet, que la première tutelle des postes, télégraphes et téléphones (PTT) était le ministère de l'intérieur… Il en est resté l'idée que, d'une manière ou d'une autre, l'État doit contrôler les grands réseaux.
Voilà pour les objectifs affichés. Je laisse de côté les objectifs politiques des nationalisations et des privatisations. Je défends depuis longtemps, dans de nombreux ouvrages, la thèse selon laquelle elles sont une même politique, avec deux outils différents. L'on ne peut d'ailleurs qu'être troublé de constater que ce sont les mêmes équipes, avec les mêmes idées, qui ont fait les nationalisations de 1980 puis les privatisations de 1985-1986.
J'en viens aux objectifs réels du maintien des nationalisations et de la méthode des privatisations avec des noyaux durs. Le premier vise à combler ou compenser les faiblesses du capitalisme autochtone, conformément à l'idée selon laquelle notre capitalisme ne saurait pas tenir sur ses propres jambes. L'État agit alors comme sa béquille, pour l'aider à résister aux différentes formes de contrôle extérieur. J'ouvre ici une simple parenthèse : lors des privations de 1986, entre la moitié et les deux tiers des actions des entreprises privatisées ont été rachetés par des investisseurs extérieurs, ce qui a fait porter le taux de contrôle des grandes entreprises françaises par des capitaux étrangers à 45 %. Ce qui est, bien entendu, l'un des effets de l'absence de structures financières adéquates pour la détention d'actions – nous n'allons pas rouvrir ici le dossier des fonds de pensions.
Le deuxième objectif réel de ces nationalisations et privatisations est celui de rationalisation, de restructuration et de recapitalisation. Les entreprises qui ont été nationalisées en 1981 ont ainsi connu entre 1982 et 1985 tout un processus de rationalisation, restructuration, recapitalisation et concentration, selon des logiques qui ont permis qu'un grand champion des télécoms apparaisse ou qu'un grand acteur du verre et des matériaux de construction soit débarrassé d'une activité informatique.
Trente ans après, quels sont les résultats de cette grande vague de nationalisationsprivatisations ? Alors même que nous sommes le pays qui parle le plus d'industrie, de politique industrielle, de stratégie industrielle et d'État stratège, nous sommes celui qui, en Europe, a connu la désindustrialisation la plus accélérée ! Je n'ai pas besoin de revenir sur ce point. Nous devons simplement rendre hommage à Louis Gallois, puisque ce que nous avions tous dit durant trente ou quarante ans était tombé dans l'oreille d'un sourd, tandis qu'il a suffi qu'il rende son rapport pour que s'installe l'idée selon laquelle la France avait la plus mauvaise performance d'Europe en matière industrielle. Seuls deux pays faisaient pire que nous, Chypre et Malte.
Détrompez-vous, ce pays fait mieux que la France en matière industrielle. Il a connu un mouvement de réindustrialisation en acquérant d'importantes positions, notamment dans le secteur automobile. Je vous renvoie à mon dernier ouvrage, qui consacre un chapitre à ce sujet.
Outre la désindustrialisation accélérée du pays, un autre résultat massif, dont on ne parle pas suffisamment, renvoie à l'écologie des entreprises en France. Il s'agit d'une surreprésentation des grandes firmes dans le Top 500 et d'une faiblesse notoire dans le secteur des entreprises de taille intermédiaire (ETI). La France est un pays dont le mode de développement et de structuration économique industrielle repose essentiellement sur les grandes entreprises. Cela nourrit une polarité entre d'un côté des petites et moyennes entreprises (PME) qui ne parviennent pas à croître et, de l'autre côté, des grandes entreprises qui avalent très tôt les entreprises émergentes qui commencent à se développer. Ce capitalisme est très différent de celui à l'italienne ou à l'allemande.
Un autre élément de ce bilan trente ans après est une forte pénétration du capital étranger dans le capital de nos champions nationaux. Elle a commencé par des prises de capital passives, suivies par la disparition pure et simple de nombre de grands champions industriels nationaux, avec comme fait emblématique la disparition de la Compagnie générale d'électricité, champion industriel des années Pompidou. Et je ne parle pas des Pechiney-Ugine-Kuhlmann et autres… Nous avons assisté à un véritable phénomène de concentrationpolarisation, puis à une disparition progressive. Tout cela n'est pas très engageant !
Que s'est-il passé ? Pourquoi a-t-on abouti à un résultat aussi négatif ? Nous avions mis en place après-guerre un système qui a remarquablement fonctionné jusqu'au milieu des années 1970 : le système colbertiste. Mais – et c'est très frappant – il s'est effondré sans qu'on n'en tire les conclusions. Longtemps, l'idée est restée que l'on pouvait conserver les outils disponibles dans le cadre de ce colbertisme, alors même que les vecteurs d'intervention n'existaient plus. C'est parce que nous avons été incapables de tirer la conclusion de cette mue formidable que nous avons assisté, les bras croisés, à l'effondrement de ce système. Le colbertisme, je vous le rappelle, était un système totalement intégré, sous la coupe de l'État qui finançait et développait de la recherche publique dans des laboratoires publics, avant de la transférer à des champions nationaux à qui il assurait des marchés grâce à la commande publique dans le cadre de grands programmes d'investissements, qu'il protégeait des concurrents avec une stratégie de protectionnisme offensif, qu'il accompagnait dans leur développement extérieur et dont il finançait même les investissements à travers des modalités spécifiques de financement. Tout ce système s'est effondré dès lors que nous avons fait le choix de l'intégration européenne et que l'on a décidé que l'on ne pouvait plus utiliser les armes de ce protectionnisme conquérant pour armer et aider nos grandes entreprises. C'est le premier grand tournant que nous n'avons pas pris. L'autre grand tournant que nous n'avons pas pris est celui de l'évolution de notre politique macroéconomique avec le passage à l'euro. Nous n'avons pas compris que nous ne pouvions pas continuer à maintenir les systèmes de déséquilibre financier caractérisés par le fameux cercle vicieux que nous connaissons, dans lequel en situation de ralentissement conjoncturel l'État faisait de la relance en finançant du déficit, qu'il fallait combler en augmentant les impôts, à commencer par ceux qui pesaient sur les entreprises – dont on détériorait, ce faisant, la compétitivité, réduisant leur capacité à répondre aux défis de l'investissement et du développement. C'est ainsi que, la compétitivité coût se dégradant, la compétitivité hors coût se dégradait aussi, et que l'on a développé cette « machine », avec parfois des réveils douloureux et une pénurie de finances publiques, sans moyen de faire face et d'accompagner les entreprises. On réunissait alors une grande commission pour conduire une grande réflexion, et l'on repartait de l'avant. Bien entendu, l'État étant multi-casquettes, poursuivant plusieurs objectifs simultanément et disposant de plusieurs vecteurs d'intervention, il a privilégié, dans le secteur public, le micro-management à court terme pour répondre dans l'urgence en intimant l'ordre à des entreprises publiques de faire telle ou telle chose. De ce fait, nous avons vu émerger l'idée très étonnante d'une absence d'orientation stratégique pour les entreprises publiques, d'une multiplication du micro-management, y compris avec des mesures d'intervention sur les processus de nomination, et d'une dé-légitimation profonde de l'intervention de l'État dans le secteur.
Ainsi, il me semble tout à fait bienvenu que l'on fasse aujourd'hui le ménage dans le portefeuille de participations et que l'État se retire des secteurs dans lesquels il n'a pas fait la preuve de sa contribution décisive. À l'inverse, il faut continuer à protéger les secteurs stratégiques au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux qui relèvent de la défense, du contrôle stratégique – comme les réseaux – et de l'investissement d'avenir – d'où l'importance du fonds d'investissement dans les technologies de rupture. Si l'on a raté le coche par le passé, il conviendrait de ne pas le rater à nouveau pour l'avenir.

Merci. Monsieur Dubertret, vous avez la parole sur le sujet des aides à l'innovation, de leur ampleur et de leur efficience.
Le rapport qui nous a été demandé, à moi-même et à trois autres personnalités qualifiées, prenait le financement comme une donnée. Mon intervention portera sur la nature des moyens à apporter. Je ne parlerai donc pas de privatisation. Comme je l'ai dit, nous sommes quatre à avoir rédigé ce rapport. Nos profils étant complémentaires, je vous invite à auditionner aussi Jacques Lewiner, Ronan Stéphan et Stéphane Distinguin. Vous en tirerez le plus grand bénéfice et cela sera une bonne manière de rendre justice à la richesse du rapport. Par ailleurs, le hasard du calendrier fait que je m'exprime ici quelques heures avant le ministre de l'économie et des finances. Il en est d'accord et cela ne pose pas de problème. Je crois d'ailleurs que nous ne traiterons pas tout à fait des mêmes sujets. Lui vous parlera, je crois, du projet de loi PACTE dans le cadre d'une discussion générale. Pour ma part, je vous présenterai notre rapport – qui a quelques liens avec le texte, puisqu'un certain nombre des mesures que nous préconisons a manifestement nourri ce projet de loi. J'essaierai de vous apporter un éclairage général sur le paysage que pense dessiner ce rapport.
De manière générale, j'attire votre attention quant au fait que, dans toutes les économies développées, l'État a mis en place des dispositifs de soutien à l'innovation, c'est-à-dire de soutien au processus qui transforme le produit de la recherche en création de valeur économique, dans le but de « dé-risquer » les entrepreneurs. Et pour cause ; le processus d'innovation est toujours long, difficile, marqué par des échecs extrêmement fréquents et des réussites remarquables mais rares, a fortiori lorsqu'elles présentent des externalités fortes. Cela oblige à gérer un certain nombre de paradoxes. D'abord, le besoin de soutien public est réel mais, en même temps, l'orientation des efforts publics devrait plutôt être décidée par les entrepreneurs eux-mêmes que par la puissance publique, parce qu'ils sont les mieux à même de savoir où diriger les efforts. Ensuite, les entrepreneurs et les start-uppers doivent travailler dans des écosystèmes très libres et peu dirigés, mais cela ne doit pas exclure le fait que la puissance publique fixe ponctuellement de grands objectifs pour créer de l'innovation de rupture. Enfin, l'innovation est de la science qui devient un objet commercial, mais il peut aussi s'agir d'une innovation d'usage.
Le premier constat émis par notre rapport est que le niveau de financement public est probablement satisfaisant s'agissant des soutiens à l'innovation, avec quelques réserves que j'évoquerai. Il convient de noter la continuité de cet effort depuis les années 2000, quels que soient les gouvernements, avec la mise en place et le renouvellement des programmes d'investissement d'avenir (PIA), un soutien constant au budget de la recherche et développement – tant du côté du ministère de l'économie et des finances que de celui de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation – ou encore une non-remise en cause de la réforme du crédit d'impôt recherche (CIR) en 2007, avec ses premiers effets en 2008. C'est assez remarquable et cela fait de la politique d'innovation une politique publique bénéficiant d'un soutien transpartisan. C'est assez rare pour être remarqué.
J'en viens aux moyens de notre politique d'innovation, en France. Tous moyens de financement compris, il s'agit de 9 à 10 milliards d'euros d'engagement chaque année. Pour la partie budgétaire, c'est-à-dire en excluant les dispositifs fiscaux, ils représentent environ 2,5 milliards d'euros par an – de façon constante. L'intensité du soutien public à la recherche et développement (R&D) est assez élevée, en France. En réalité, l'on s'aperçoit que la dépense intérieure de recherche et développement des administrations (DIRDA) est assez similaire dans les différentes économies développées. La nôtre représente environ 0,7 % du PIB. C'est très peu différent de ce qui se constate ailleurs. En revanche, un défaut est observé du côté de la dépense intérieure de recherche et développement des entreprises (DIRDE), si bien que l'intensité du soutien étatique est très élevée. Il représente ainsi 27 %, contre 22 % au Royaume-Uni et beaucoup moins dans d'autres pays comme les États-Unis, l'Allemagne ou Israël où il est inférieur à 10 %. Cela montre qu'il existe une difficulté à faire émerger une dépense de R&D des entreprises.
Je vais quand même nuancer et tenter d'expliciter ce constat de semi-échec. En France, la DIRDE représente 1,5 % du PIB. C'est moins que les 2 % constatés aux États-Unis et en Allemagne, les 2,5 % du Japon et les plus de 3 % de la Corée du Sud. Néanmoins, ce taux est en hausse marquée depuis la mise en place du CIR. Il était, auparavant, compris entre 1,2 % et 1,3 %. Il est passé à 1,5 % et continue d'augmenter. Un autre élément de nuance, qui me paraît extrêmement important, rejoint les propos de M. Cohen. Si l'on corrige ce chiffre de la DIRDE, qui ne semble pas très bon, de la structure de l'économie française, on constate qu'en fait nos entreprises sont très intenses en R&D pour celles qui en font. Cela signifie que nous avons une structure économique marquée par la désindustrialisation, avec à la fois un positionnement très haut de gamme et très intense en technologie pour des entreprises qui ne sont pas si nombreuses que cela même si elles sont très remarquables, et un positionnement global très moyen de gamme, qui correspond assez peu au créneau des entreprises qui font de la recherche et développement. La performance des entreprises qui font de la R&D en France n'est donc pas si mauvaise. Elle est même plutôt très bonne. Ces entreprises consentent de réels efforts. Cela étant, elles sont trop peu nombreuses à être positionnées sur ces créneaux. Dès lors, pour augmenter la performance de R&D des entreprises, il convient d'organiser une mutation du tissu industriel lui-même. C'est par la réindustrialisation que l'on obtiendra une hausse de la R&D dans notre pays.
J'en viens à la thématique du financement. Le rapport porte une attention particulière aux PIA. Ces outils assez remarquables devaient être exceptionnels, pour permettre la sortie de crise, mais ils sont devenus récurrents puisqu'un nouveau PIA sort désormais tous les trois ou quatre ans. Nous en avons conclu qu'ils étaient devenus un levier récurrent de financement de la recherche et de l'innovation en France. Au contraire d'une dotation budgétaire qui a tendance à s'enferrer dans la routine en dépit du processus d'évaluation, cet outil est remis en jeu tous les trois ou quatre ans avec une discussion systématique sur ce qui sera financé, en fonction de l'évaluation des résultats de la précédente vague. Il existe une vraie culture de l'évaluation associée aux PIA, beaucoup plus importante que celle que l'on peut trouver ailleurs, ainsi qu'une logique d'excellence et de compétition. Les PIA sont des guichets qui mettent en compétition autour de défis, avec un niveau d'exigence élevée. Ils constituent ainsi un excellent vecteur de transformation publique et privée. Ils sont portés par un acteur central, le Secrétariat général pour l'investissement (SGPI), placé auprès du Premier ministre. C'est un ciment de coopération interministérielle absolument indispensable entre ces deux pôles majeurs que sont le ministère de l'économie et des finances et le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'industrie. Ce trio se stimule, même s'il s'agace un peu aussi. Il a la propriété de pousser toujours plus avant l'ambition dans le domaine de l'innovation.
Quelques lacunes avérées ont été identifiées en matière de financement de l'innovation. Elles ne sont pas toutes des lacunes publiques. La première concerne le financement de l'innovation très technique, dite Deep Tech. Cette technologie très dure au stade amont vaut en partie pour le domaine de la santé, dans lequel l'innovation est très lourde et le chemin vers un produit commercialisable, très long. Il peut y avoir énormément de valeur créée, mais le « dé-risquage » n'est pas suffisant. Aussi le rapport propose-t-il de faire un effort dans ce domaine et de soutenir un peu plus au stade amont les projets de technologie très lourde et très intense – par opposition à d'autres projets qu'il faut soutenir également, mais qui trouvent plus aisément des financeurs au stade amont. C'est notamment le cas du numérique.
Une deuxième lacune concerne le financement des tours de table importants, avec des tickets de 10 millions d'euros ou plus. Il s'agit de capital-croissance ou de capital-risque. Cette lacune vient, cette fois, du secteur privé et non public. Elle s'explique par un manque de fonds et de compétences. Pendant longtemps, il n'y a pas eu d'équipe capable d'appréhender, de conduire et de suivre des projets très complexes dans lesquels les investisseurs plaçaient des sommes importantes. Un changement s'opère, mais cela reste un point de vigilance car la situation est encore fragile. Qui plus est, l'on constate aussi que l'empreinte des business angels, ces personnes privées qui interviennent à un stade extrêmement amont, reste encore faible en France. Même si une première génération de start-uppers intervient à titre personnel de façon très positive pour stimuler et aider des jeunes qui ont de nouveaux projets et si un vrai écosystème se met en place, nous restons dans un rapport de 10 à 15 avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis ou le Japon.
J'aimerais encore délivrer un message important quant au besoin de stabilité dans cette politique de soutien financier. Ce besoin est élevé et se manifeste à plusieurs niveaux. Il est déjà en partie constaté, d'autant que la forte continuité dans le soutien politique à l'innovation et le soutien budgétaire n'empêche que nous sommes dans un paysage complexe, avec la création de nombreux guichets et dispositifs nouveaux. Le temps de la consolidation est venu, pour faire vivre du mieux possible ce qui a été créé, avec des enjeux de lisibilité et de compréhension par les acteurs de l'innovation. Attention, par ailleurs, à ne pas créer d'à-coups. C'est un ancien directeur du budget qui vous le dit – je me fais donc un peu violence, mais j'y crois profondément ! Dans l'écosystème fragile de la politique de soutien continu, un à-coup budgétaire entraîne nécessairement de la casse. L'économie est alors sans rapport avec la perte de valeur qui peut être induite. La stabilité est très importante en matière de fiscalité également. Nous avons connu une période de forte instabilité de la fiscalité des entrepreneurs. Le moment est venu d'assurer une stabilité de la fiscalité des entrepreneurs innovants et des instruments comme les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), les bons de souscription d'actions (BSA) et les attributions gratuites d'actions. Nous avons également besoin de préciser et stabiliser la doctrine administrative sur la fiscalité des holdings animatrices.
En matière de paysage institutionnel, l'on parle toujours et beaucoup de simplification. J'identifie toutefois deux points d'attention. Si l'on remet de l'instabilité dans le paysage, l'on crée du désordre et de l'incompréhension. J'invite vraiment à garantir une réelle stabilité dans ce domaine, en ne cédant pas aux sirènes d'une simplification abusive. Le paysage est nécessairement compliqué. L'écosystème de Grenoble n'est pas celui de Nantes, qui n'est pas celui de Paris – lequel en compte d'ailleurs plusieurs. Ces écosystèmes sont tous un peu différents les uns des autres pour de très bonnes raisons. L'écosystème de Harvard n'est d'ailleurs pas celui de Stanford – et pour de bonnes raisons. Vouloir faire un jardin à la française serait une catastrophe.
Enfin, nous avons été frappés au cours de nos travaux par le fait qu'au sein de Bercy, la fonction de pilotage des politiques d'innovation, qui est une fonction microéconomique avec une vision de long terme, est très largement étouffée par les approches macroéconomiques et de court terme. Je ne me prononce pas en termes de structuration des administrations, mais en termes de portage des fonctions. Ce constat est maintenant ancien, et nous semble devoir faire l'objet d'une attention particulière de la part du Gouvernement. Cette suggestion figure dans le rapport. Au-delà, un certain nombre de mesures proposées ont été reprises dans le projet de loi, notamment sur le parcours du chercheur.

Merci beaucoup. Je vais vous poser une question très directe, même si je ne suis pas certaine que l'on puisse y répondre. J'entends ce que vous dites sur le financement. Par le passé, je me suis intéressée au parcours de l'innovation, et principalement l'accès au marché. En France, nous avons une propension, dans certains domaines, à calquer le modèle de l'innovation ancienne ou incrémentale sur ceux de l'innovation dite d'usage. Or le temps de l'innovation d'usage n'est pas celui des innovations d'hier. Prenons l'exemple de la Health Tech et de la dynamique de santé et d'intelligence artificielle (IA). Comment, au-delà du financement, faire en sorte que nos entreprises parviennent à mettre sur le marché des dispositifs, des applications et des produits qui ne soient pas flanqués sur le temps d'hier mais sur celui d'aujourd'hui ? Nous sommes en train de perdre des entreprises qui ne parviennent pas à passer la barre du marché, là où elles le font aux États-Unis ou en Angleterre. Si je devais être encore plus précise, je demanderais s'il ne serait pas intéressant de disposer d'un organe d'évaluation des innovations qui ne se réfère pas aux administrations d'hier, mais au temps de l'innovation d'aujourd'hui. C'est une source d'inquiétude réelle pour les entreprises d'innovation en France.
Je passe immédiatement la parole au rapporteur général. Nous écouterons ensuite les porte-parole des groupes.

Je serai très bref. Je sortirai un peu du cadre du projet de loi, mais je pense que nous y reviendrons de toute façon. M. Cohen l'a rappelé, l'une des principales disruptions des trente dernières années est la mise en place de l'euro, dont nous n'avons peut-être pas tiré toutes les conséquences. Je voudrais entendre nos deux invités sur les perspectives européennes de leurs préconisations. Pouvons-nous faire de l'innovation de rupture seuls en France, ou devons-nous montrer l'exemple en espérant emmener nos collègues européennes, là où nous nous retrouvons en compétition face à des zones économiques – États-Unis, Chine, Inde – de plus en plus grandes ? De la même manière, pouvons-nous avoir une stratégie industrielle franco-française ou doit-elle s'inscrire dans une réflexion européenne – et si oui, laquelle ?

Ma question s'adresse plutôt à M. Dubertret puisqu'elle porte sur l'évaluation des dispositifs d'aide à l'innovation et leur articulation. Je rebondirai également sur la question posée par Mme Grégoire. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018, j'ai fait un rapport pour avis sur les PIA. J'ai alors rencontré des difficultés à obtenir des éléments concrets concernant l'évaluation, au-delà des données comptables que vous avez évoquées au cours de votre intervention. Il est prévu de mettre en place un nouveau fonds – pour l'innovation de rupture. Quelles seraient vos propositions concernant les critères et mécanismes indispensables à la bonne évaluation d'un tel fonds ?
Par ailleurs, nous avons proposé de conduire une évaluation à dix ans pour les PIA. Je pense que ce serait intéressant, mais j'ai le sentiment que cette durée serait peut-être un peu trop longue. Peut-être pourrions-nous prévoir un réajustement et une réorientation du fonds si l'on s'apercevait, à mi-parcours, qu'il ne correspond pas nécessairement aux bons acteurs. Aussi, quelle serait votre préconisation sur les échéances ?
Enfin, le dernier point de ma question concerne l'articulation des futurs dispositifs – PIA, fonds pour l'innovation de rupture, pôles de compétitivité et autres. Comment les articuler de manière pertinente pour avoir la politique d'innovation la plus efficace possible ?
La question du temps est absolument cruciale. Il est frappant de constater que, très fréquemment, des entrepreneurs innovants ou des chercheurs-entrepreneurs se plaignent d'avoir affaire à des interlocuteurs publics qui n'ont pas conscience de l'urgence. Si l'on a une idée que l'on entend transformer en quelque chose qui a de la valeur, il faut aller vite. On ne peut pas attendre deux ou trois ans la réponse d'un laboratoire ou d'un institut de recherche public. D'une part, l'envie de faire quelque chose sera passée. D'autre part, l'opportunité de marché se sera écartée. Il faut donc des réponses rapides. De ce point de vue, le rapport formule un certain nombre de recommandations dont vous trouvez plus que la trace dans certains articles du projet de loi. Nous proposons notamment une série de mesures qui visent à accélérer le parcours pour le chercheur-entrepreneur. Cela ne paraît pas grand-chose, mais en termes de création de valeur, cela cherche à éviter des catastrophes que l'on a pu constater par le passé. Les établissements publics prennent de plus en plus conscience de l'importance d'aller vite.
Concernant l'innovation technologique – Deep Tech ou santé –, le temps de maturation est extrêmement long et coûteux. Il faut donc un soutien long – durant dix ou douze ans. C'est la raison pour laquelle le rapport recommande un léger allongement du dispositif de jeune entreprise innovante (JEI). Pour l'innovation d'usage, très centrée sur la Net économie et les outils technologiques numériques, le temps est différent. La course contre la montre vise à faire fonctionner le plus vite possible quelque chose qui ne représente pas un gros défi technologique, mais un défi en termes de captation de part de marché et de création de valeur. Si l'on ne croît pas extrêmement vite durant très longtemps, en l'occurrence plusieurs années consécutives, l'on deviendra un acteur secondaire du marché et l'on finira au mieux par être racheté, voire par disparaître purement et simplement. Vous avez tous en tête des exemples d'innovation d'usage, au travers d'applications que vous utilisez au quotidien sur votre smartphone. Il importe de comprendre que le soutien à ce type d'innovation doit être un soutien à la captation de parts de marché.
Concernant l'accès au marché, la difficulté liée à la taille et à la compétence des fonds d'investissement, français et européens, est en train d'évoluer. Faire de la gestion de patrimoine familial « à la grand-papa » n'est pas la même chose que suivre un portefeuille d'entreprises en croissance rapide et de start-up extrêmement compliquées, ce qui peut requérir de sauter dans un avion pour un conseil d'administration improvisé entre Noël et le jour de l'An. Il s'agit de gérer des ennuis en se disant que l'on participe à la création de valeur. Ce métier est beaucoup plus ambitieux et requiert des personnes qui ont envie de se battre. En l'occurrence, la situation évolue et des équipes compétentes se mettent en place sur le marché français. J'ai bon espoir, en la matière – même si, en cas de crise financière, ce secteur souffrira. De ce point de vue, loin de se fermer, l'accès au marché est plutôt en train de se rouvrir. C'est une bonne chose.
Une autre question incontournable est celle de la taille du marché. Il est plus facile de se financer lorsque l'on a accès au marché américain, qui est très grand et relativement unifié, que sur le marché européen qui est très fractionné. C'est la raison pour laquelle plus l'on pourra continuer à défractionner le marché européen, mieux cela vaudra. Les institutions européennes doivent clairement faire porter leurs efforts de ce côté-là.
Concernant l'évaluation, celle de la sphère publique est plus développée dans le domaine de l'innovation qu'ailleurs. Je suis étonné d'entendre que vous avez rencontré des difficultés à obtenir des informations sur l'évaluation des PIA. Pour ma part, ma perception a plutôt été que l'évaluation est très développée dans ce domaine, à mi-parcours, ex post à l'issue des programmes mais aussi ex ante à travers les comités d'engagement interministériels, avec le regard croisé du SGPI. C'est inconfortable pour tout le monde – les ministères s'en plaignent –, mais c'est plutôt bon signe. Cela veut dire que l'on place sous la loupe les projets présentés. Je pense que cela donne d'assez bons résultats. Une amélioration est certes toujours possible, peut-être notamment en termes de transparence vis-à-vis du Parlement, mais j'aimerais plutôt voir une diffusion de cette culture de l'évaluation vers le reste de la sphère publique. Je sors peut-être de mon rôle en vous suggérant d'auditionner le SGPI sur ce sujet. En tout cas, l'un des grands points forts de ce dispositif est l'évaluation.
Pour évaluer une innovation, il convient d'étudier la création de valeur – ce que l'on ne fait pas suffisamment. Lorsqu'on s'intéresse à la performance d'évaluation des projets portés par une institution publique qui héberge des chercheurs publics, par exemple, il faut regarder le nombre de coopérations avec les entreprises, l'existence de laboratoires communs ou d'instituts Carnot, le nombre de start-up créées en totalité et le nombre de celles qui survivent au-delà d'une année, si certaines accèdent à la cote et quelle est la valeur créée. Ces indicateurs économiques ont tout leur sens dans une politique d'innovation. Mais ils ne sont sans doute pas encore suffisamment suivis. Même s'il commence à y avoir des prises de conscience sur ce sujet, il y a encore des progrès à faire.
Concernant l'Europe et le pilotage de l'innovation, la question est très ouverte. Je crois avoir répondu sur les aspects de marché, lequel reste encore trop fractionné. Si l'on veut que la puissance publique apporte de l'aide à une innovation très disruptive créatrice de valeur, il faut accepter des grosses prises de risque, un regard extérieur, une très grande agilité – notamment être capable de constater, un an après, que le projet ne vaut rien et qu'il faut en lancer un autre. Cela nécessite une mobilité qui n'est pas spontanément acquise à une administration qui, pour des raisons valables pour certaines d'entre elles, travaille de façon plus lente et moins agile. Ce que je viens de décrire, ce sont un peu les caractéristiques de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

Je vous remercie pour ces détails. Je pense qu'il revient à la commission des Finances, dont le président est présent ce matin, de nous en reparler.
Je voulais simplement préciser que cette agilité, qui est nécessaire, est difficile à acquérir pour une administration nationale, et plus difficile encore pour l'administration de l'Union européenne. Je n'ai pas de réponse, mais je vous invite juste à considérer qu'il n'existe pas de solution évidente et naturelle dans le fait d'aller au niveau européen. Il peut y avoir des avantages à le faire, mais des questions d'agilité peuvent aussi se poser – et elles sont clés.

Il existe aussi, au plan européen, un problème de « lunettes », puisque nous avons tendance à regarder les innovations d'aujourd'hui avec les lunettes qui ne sont pas les mieux adaptées. C'est un sujet passionnant.
Concernant les politiques d'innovation, j'ai été assez surpris d'entendre ce qui a été dit sur le PIA.
Premièrement, ce n'était pas du tout un instrument de sortie de crise, bien au contraire. Face au constat que, par le passé, les décisions budgétaires conduisaient à sabrer ce qui était le plus facile, en l'occurrence les dépenses de recherche, d'innovation et d'avenir. L'idée essentielle qui a présidé à la constitution du PIA, au départ de la mission Rocard-Juppé, est qu'il s'agissait de trouver un véhicule adéquat pour cantonner les dépenses du futur. Certes, l'on n'avait pas prévu au départ qu'il y aurait un PIA 1, un PIA 2 et un PIA 3, ou des extensions successives. Mais l'idée était de cantonner les dépenses d'avenir. De ce point de vue, le PIA a été un succès.
Deuxièmement, il s'agissait de rompre avec la pratique qui consistait à accorder sur le mode de l'abonnement des subventions de recherche à un certain nombre d'institutions et d'entreprises, en procédant par des appels d'offres ouverts, des concours internationaux et un suivi des projets particulièrement exigeant. De ce point de vue, le PIA a également été un succès. En effet, vous vous souvenez que lors de la première vague, un certain nombre d'institutions qui avaient toutes les médailles et tous les titres à faire valoir avaient été rejetées par ces jurys internationaux.
Troisièmement, il existait des évaluations ex ante, en cours, ex post. J'ai donc moi aussi été surpris d'entendre les difficultés que vous avez rencontrées en la matière. Les laboratoires se plaignent plutôt de la multiplication et de la lourdeur des évaluations que de leur absence. Quant au défaut de communication des résultats d'évaluation, j'ai fait partie de la commission Rocard-Juppé, puis de celle qui a géré le PIA et ensuite encore de celle en charge de l'évaluation. En l'occurrence, je me souviens plutôt d'avoir croulé sous les données d'évaluation par projet, par secteur, par filière, par région... L'abondance de biens était absolument considérable ! Les décisions prises ont conduit à remettre en cause certaines initiatives d'excellence (IDEX) et certains programmes, ou encore à fermer certains programmes et affecter l'argent à d'autres. J'ai donc le sentiment que ce dispositif a été plutôt réussi. Si l'on pense que cela n'a pas été le cas, il faut alors vraiment pousser la réflexion. Je considère que la réflexion conduite en amont de la création du PIA avait permis de bien identifier les axes de transformation aussi bien verticaux qu'horizontaux. Je continue à penser que le PIA est un bel outil. Si l'un des résultats de vos travaux consiste à considérer que l'on a raté certains objectifs, il faut identifier précisément ce qui s'est passé. J'avais le sentiment que, dans ce domaine, il était nécessaire de laisser le temps aux processus et aux outils créés – comme les instituts de recherche technologique (IRT) ou les instituts hospitalo-universitaires (IHU) – de produire leurs résultats, puis de les évaluer et d'éventuellement les sanctionner, plutôt que les remettre en cause. Je partage d'ailleurs pleinement l'idée selon laquelle, dans ces domaines, nous avons avant tout besoin de continuité. Voilà le premier point sur lequel je souhaitais insister. J'ai eu le sentiment que nous avions créé quelque chose d'intéressant avec la mission Rocard-Juppé, et qu'il fallait attendre d'en voir les résultats avant de tenter un nouveau bouleversement.
Concernant le niveau européen de coopération, nous autres Français avons longtemps pensé que nous ferions à l'Europe le don du « colbertisme high tech » Nous étions tellement contents de ce qui avait formidablement réussi chez nous que nous voulions le faire au niveau européen. Bien entendu, cela ne s'est pas passé ainsi, parce que nous étions à peu près les seuls à défendre cette idée ! Mais je vous signale tout de même que c'est ce que font largement les Chinois pour constituer leurs propres bases : une stratégie de protectionnisme offensif, une stratégie de la commande publique, une stratégie du transfert des résultats de la recherche publique vers des acteurs privés ou encore des grands programmes d'équipement menés sur le long terme. Un remarquable ouvrage sur l'industrie des télécoms chinoise montre comment ces méthodes ont fonctionné, par exemple l'idée-même de créer sa propre norme pour essayer de disposer d'avantages compétitifs par rapport à une norme dominante qui arrive avec ses industriels et ses pratiques. Bref, nous avons essayé de dupliquer notre colbertisme au niveau européen sans y parvenir. Faut-il, pour autant, abandonner ? Non, je crois qu'il faut trouver des dispositifs plus adéquats. Je pense que les projets européens communs actuels, notamment en matière d'industrie de défense, sont de très bonnes pratiques. Je pense également qu'il faudrait coordonner des expérimentations au niveau européen – pour le véhicule autonome, en intelligence artificielle – sur des bases ad hoc et en renonçant à la vision cartésienne à laquelle nous tenons beaucoup. Il faut essayer des dispositifs plus pragmatiques et des accords ad hoc. Bien entendu, la dimension européenne est la bonne. Plaidons pour l'idée qu'il est aussi important de développer en commun des technologies que des usages innovants. Favorisons des expérimentations au niveau européen. Cela vaut la peine ! Mais parler dans ce sens aujourd'hui au niveau européen, c'est faire preuve d'un optimisme débridé quand on sait l'état de déliquescence et de décomposition de toutes les politiques communes européennes.
Je ne pensais pas assister un jour à la remise en cause de la politique commerciale commune, qui est une compétence exclusive de la Commission. Mais je remarque qu'avec la crise automobile créée par M. Trump, même l'Allemagne est prête à discuter sur une base de pays à pays avec les États-Unis. C'est le coeur du marché commun qui est remis en cause, ce que je pensais ne jamais voir. Il faut être très courageux et optimiste pour tracer des plans pour l'avenir. Mais, précisément, il faut tenter !

Je voudrais reprendre le titre de notre table ronde, « L'État stratège » et poser deux questions. L'une sur ce qui est stratégique, l'autre sur les outils de l'État stratège au-delà de l'actionnariat.
Sur l'État stratège, l'on entend souvent des personnalités affirmer que telle entreprise est un fleuron stratégique, que tel secteur est stratégique, que telle technologie est stratégique. Souvent, ces expressions sous-entendent que pour être stratège, pour peser sur la marche de l'entreprise, l'État doit en être actionnaire – c'est-à-dire rester au capital ou nationaliser. Si l'on demandait à tous les députés la définition d'une entreprise stratégique ou ce qui est stratégique dans notre économie, je pense que la somme de leurs réponses couvrirait la totalité de notre économie. Or si tout est stratégique, c'est que rien n'est stratégique. Parler d'État stratège suppose donc de faire des choix, de sélectionner ce qui relève réellement de la stratégie essentielle versus ce qui relève du non-stratégique. En l'occurrence, quels sont les cas d'usage pour lesquels vous considérez que l'État doit être stratège – au sens de « prendre sa part à l'actionnariat » ? Je pense notamment à trois critères évoqués par M. David Azéma dans une note de l'Institut Montaigne intitulée « L'impossible État actionnaire » : des entreprises qui produisent des services publics, des entreprises qui sont l'objet d'interventions permanentes du politique affectant leur gestion et leurs finances, et des entreprises dont les ressources proviennent du contribuable et non du client.
Sur les outils de l'État stratège, l'on entend là encore souvent dire que pour être stratège, l'État doit être actionnaire – en considérant que l'actionnariat public est le nec plus ultra du contrôle de l'État sur la marche d'une entreprise. Or cette affirmation est fausse. D'une part parce qu'il existe des entreprises qui touchent à la sécurité nationale sans que l'État en soit actionnaire. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, l'État n'est pas au capital de ses fournisseurs militaires, par exemple. D'autre part parce qu'il existe une multitude d'outils bien plus puissants que l'actionnariat pour que l'État pèse sur la marche de l'entreprise – je pense notamment à la commande publique, à la régulation ou à la réglementation –, outils autrement plus puissants que le fait de posséder 1 %, 2 % ou 3 % du capital d'une entreprise. Ma question est donc la suivante. Quels sont pour vous les outils de contrôle, de régulation et de réglementation les plus puissants et pertinents pour que l'État continue de faire valoir ses intérêts stratégiques, notamment dans le cadre des privations prévues dans le projet de loi PACTE ?

S'agissant de l'État stratège, on peut imaginer tous les outils que l'on veut. Encore faut-il s'en servir. Je me souviens de l'affaire Alstom dans laquelle, malheureusement, l'État, le Président de la République et le Premier ministre de l'époque n'ont pas utilisé les outils qu'ils avaient à leur disposition. Cela a conduit au désastre que l'on connaît. Alstom Énergie est tombé sous la coupe de General Electric. Ce n'était absolument pas un mariage entre égaux. Alstom Énergie a été petit à petit absorbé par ce géant américain. Par ailleurs, les promesses qui avaient été faites en termes de création d'emplois et de localisation de centres stratégiques en Europe ou en France n'ont pas été tenues. Ensuite, on a fragilisé Alstom Transport et on a perdu le TGV qui maintenant, tombe sous la coupe de Siemens. Donc, c'est bien de faire de grands discours sur les outils ou, comme dans le projet de loi PACTE, de renforcer ces outils. Mais si l'on ne s'en sert pas, tout cela ne sert à rien. Les mots et les discours doivent être suivis d'actes concrets.
Je partage pleinement ce qui a été dit à propos de l'État stratège ; il faut aussi une Europe stratège. Dès lors, quid de la question du droit de la concurrence ? L'État stratège est aussi celui qui permet l'émergence de champions nationaux ou européens. Or à l'échelle européenne, il manque une vraie volonté de permettre l'émergence de champions mondiaux. L'on a empêché, parfois, des fusions-acquisitions au nom de la préservation d'une situation de concurrence sur le territoire européen, alors que le vrai sujet est désormais celui d'une concurrence au plan mondial. Avez-vous un avis à ce sujet ?
Vous avez évoqué les pôles de compétitivité. Ils fonctionnent plutôt bien. Évidemment, l'on ne peut pas les répandre et les multiplier. L'on se souvient des tensions qu'a engendrées leur création. La décision qui a été prise est sage : il existe quelques grands pôles de compétitivité autour desquels il faut centrer les efforts. Il n'empêche qu'il peut y avoir, à côté, des rassemblements ou des forces économiques de recherche en matière de formation. Je considère que nous n'y sommes pas suffisamment attentifs, dans notre pays. L'Éducation nationale a lancé le programme Campus. C'est un très bon dispositif, qui peut constituer un point d'appui. Deux programmes Campus sont en cours dans ma circonscription, dans le domaine du tourisme et dans celui de la santé. Ne pourrait-on pas favoriser davantage l'émergence de ces mini-écosystèmes ? Parfois, sans que nous ne nous en rendions compte, nous avons déjà tout ce qu'il faut sur place. Dans ma circonscription, à Berck-sur-Mer, il existe des personnes extrêmement compétentes dans le domaine de la santé, dans les hôpitaux, d'autres dans les entreprises – nous comptons notamment un leader mondial dans le secteur des instruments chirurgicaux. Et pourtant, elles ne travaillent pas ensemble. Des formations pourraient aussi être intégrées dans cet écosystème.
Enfin, quid du lien entre la recherche publique et la recherche privée ? Je suis moi-même universitaire, et je m'aperçois malheureusement que les universités peinent encore à travailler avec les entreprises, et inversement. De nombreux tabous pourraient être dépassés. Des instruments avaient été mis en place, notamment dans le cadre de la politique qu'avait entreprise Valérie Pécresse. Où en est-on ? Que pourrait-on faire, concrètement, pour renforcer la coopération entre recherche publique et recherche privée ?

Cette audition intervient dans le cadre de l'examen du projet de loi PACTE, avec deux volets : le désengagement de l'État – j'évite d'employer le terme de « privatisation », qui déplaît à M. Le Maire – et le financement de ressources pour la recherche.
Le projet de loi prévoit trois désengagements de l'État, d'Aéroports de Paris, de la Française des jeux et d'Engie. La densité du texte concernant le désengagement d'Aéroports de Paris montre bien que l'on n'est pas très à l'aise quant à cette stratégie. J'aimerais connaître la position de M. Cohen sur ce point. Ce désengagement n'est-il pas plus mauvais que le fait de conserver une participation pertinente dans cette société, au regard des enjeux stratégiques en termes de maîtrise de l'emprise foncière ?
Par ailleurs, concernant la recherche, il me semble que la loi a tendance à favoriser les start-up et les nouvelles entreprises. Je pense qu'il est tout aussi important d'inciter à l'innovation les entreprises existantes. Il est bien beau de faire du nouveau, avec des business plans sans aucun chiffre d'affaires et en allant chercher le développement uniquement en faisant appel à des augmentations de capitaux. C'est un vrai sujet. Mais je pense qu'il faut que l'on s'intéresse aussi à l'entreprise existante, notamment la PME-PMI qui, est à mon sens, une caractéristique française. Vous évoquiez les ETI. La France est-elle formatée pour ce type de structure ? N'existe-t-il pas un vrai modèle économique, pertinent, pour les petites et les moyennes entreprises qui ne sont pas des ETI ? Ne faudrait-il pas conduire une réflexion sur ce point, notamment par la collaboration interentreprises ?
Enfin, sur la recherche fondamentale, que pensez-vous de la loi Allègre de 1999 sur le statut des chercheurs, et notamment la difficulté pour ces derniers de pouvoir créer et diriger des entreprises de type SAS ? Votre réflexion favorise-t-elle l'union entre la recherche fondamentale et le monde de l'entreprise ?

Je poserai deux questions à M. Cohen, et deux autres à M. Dubertret.
Monsieur Cohen, le choix d'Aéroports de Paris, de la Française des jeux et d'Engie vous semble-t-il judicieux, à partir du moment où l'on s'est fixé un objectif d'une dizaine de milliards d'euros de recettes ? Par ailleurs, ne pensez-vous pas que l'une des faiblesses de la situation française est la perméabilité des élites administratives avec les directions des entreprises publiques et privées ? Ne s'agit-il pas là d'un handicap hérité du colbertisme. Le colbertisme est mort, mais ce système existe toujours.
Monsieur Dubertret, le fonds de 10 milliards d'euros pour l'innovation de rupture produira en fait entre 250 et 300 millions d'euros par an. Une telle somme vous semble-t-elle significative pour permettre l'apparition d'un certain nombre d'innovations de rupture ? Par ailleurs, ne faudrait-il pas réformer le statut des chercheurs publics pour mieux récompenser les « trouveurs », voire les développeurs ?
Vous avez inauguré la série de questions en posant à nouveau celle de la distinction entre ce qui est stratégique et ce qui ne l'est pas, et celle des outils à mettre en place pour ce que l'on considère comme stratégique. Permettez-moi d'abord un mot pour rire. Le président Trump a décidé de taxer les importations d'aluminium et d'acier en déclarant qu'il s'agissait de biens stratégiques et que, par conséquent, il prenait cette décision en ayant en tête les intérêts majeurs de la défense nationale américaine. Cela fait rire tout le monde, bien entendu. Mais, au début du siècle, l'on aurait trouvé un accord général pour estimer que l'acier et l'aluminium faisaient partie des secteurs stratégiques. Lorsque j'écrivais mes premiers livres sur la politique industrielle, j'affirmais que la filière électronique était tout à fait stratégique, pour ce qui était des composants électroniques du moins, et que l'on ne pouvait pas accepter de dépendre complètement du Japon puis de Taïwan – et, aujourd'hui, de la Chine – pour l'approvisionnement. Désormais, 90 à 95 % des fonderies de composants se situent entre Taïwan, la Chine et le Japon. La Planète a ainsi décidé de renoncer au contrôle de cette composante stratégique majeure de tous les développements dans les secteurs de l'électronique, de l'informatique, du numérique, des télécommunications, etc. Or dans cette concentration formidable, un pays concentre encore plus que les autres : Taïwan, lequel connaît des problèmes de sismologie. Il pourrait donc y avoir un péril majeur lié à la disparation des plus grandes fonderies de composants simplement en raison d'un accident « naturel ». Quand bien même l'on se mettrait d'accord ensemble pour estimer que tel secteur ou tel élément est absolument stratégique, il faudrait le mettre en balance avec le coût économique de sa préservation. Les États-Unis ont accepté de progressivement fermer leurs usines de composants. L'Europe y a elle aussi progressivement renoncé. Nous sommes donc, de ce fait, dans une situation de concentration mondiale. Mon premier élément de réponse est donc qu'il ne suffit pas de dire que quelque chose est stratégique pour qu'il le soit effectivement.
Je vais maintenant passer du plus général au plus particulier. En France, lorsque Pepsi a failli acheter Danone, on a dit que l'on touchait aux cathédrales de Strasbourg, et le yaourt était soudainement devenu formidablement stratégique ! Chaque fois qu'il y a eu un problème avec les Chantiers de l'Atlantique, on a dit qu'ils étaient tout à fait stratégiques. De la même façon, chaque fois qu'il y a eu un problème dans le plan de charge de Belfort, on a considéré qu'il était stratégique. Cela signifie que l'action de l'État n'est pas du tout guidée par une réflexion sur ce qui est stratégique ou pas, mais beaucoup plus par les contraintes de l'actualité politique et sociale, par les risques de désertification ou encore les risques de mise en cause de la paix civile. Les interventions de l'État sont largement guidées par ce principe d'opportunité. C'est la raison pour laquelle je suis assez surpris par votre rappel des thèses de David Azéma, monsieur Kasbarian. Il me semblait qu'il s'exprimait davantage en forme de boutade qu'en forme de principe édicté. Il décrivait la pratique, mais ce n'était pas ce qu'il promouvait. Et pour cause, il ne saurait promouvoir l'idée que lorsqu'il y a intervention de l'État, c'est nécessairement stratégique. Mais l'on constate ex-post que l'État peint des couleurs de la stratégie nombre d'interventions qui n'ont pas grand-chose à voir avec elle.
Pour répondre à votre question, je pense que ce qui est vraiment stratégique est ce qui relève de la défense nationale et des technologies duales qui permettent de produire les biens qui relèvent d'elles, et qu'il n'est pas nécessaire que, même dans ces domaines, les entreprises soient publiques. En effet, il existe de nombreux moyens de s'assurer que ces entreprises sont « compliantes », ne serait-ce qu'au regard des desiderata de leur principal client. Et si cela ne suffisait pas, il existe des pratiques comme la golden share. Et si cela ne suffisait toujours pas, il existe des participations minoritaires. Toute une série de techniques permet de protéger fondamentalement les secteurs considérés comme véritablement stratégiques.
À partir de là, quand bien même l'on considère que c'est stratégique et que l'État doit intervenir sous une forme ou sous une autre, quel est l'État qui doit intervenir ? La bonne dimension n'est-elle pas l'Europe ? Fait-il encore sens d'intervenir au niveau national pour essayer de protéger un secteur ou une entreprise ? Là encore, l'on se mettrait assez facilement d'accord pour dire que l'Europe, si elle existait comme une entité politique, si elle avait une stratégie et des instruments d'intervention communs, serait le bon instrument compte tenu de sa taille et du sens que cela ferait d'intervenir à ce niveau. Mais, comme je l'indiquais tout à l'heure, la forme qui a été trouvée jusqu'à présent est plutôt un mode coopératif. Au fond, les projets qui ont été développés en commun, sous la forme de groupements d'intérêt économique (GIE) assez lâches au début dans le domaine de l'aéronautique puis sous la forme d'une entreprise intégrée, sont des solutions ad hoc. C'est quand même comme cela que l'on va développer les armes de prochaine génération.
Mais, ayant dit tout cela, je n'ai pas dit un mot de toutes ces entreprises émergentes, ces start-up et ces laboratoires qui, avant même de croître et de se développer, sont rachetés et disparaissent. Je crois que c'est là qu'il faut avoir une réflexion pour une détection puis une intervention en amont qui trouve des formes adéquates. J'ai été très frappé de constater par exemple, lorsque je participais au groupe de travail sur le PIA, qu'il n'avait pas été possible de trouver une solution satisfaisante sur le partage de la propriété intellectuelle dans les projets développés par des intervenants publics et privés. Je me souviens en particulier de projets qui avaient été développés avec un cloud souverain. J'ai remarqué que les contraintes que l'on introduisait dans le système sous forme de partage de la propriété intellectuelle et des produits permettant de la générer ont conduit un certain nombre d'acteurs privés à considérer que le fait de les engager dans des processus avec des intervenants et des contrôles multiples était simplement contraire à leur manière de considérer le développement et le transfert de la recherche vers l'innovation. Ils se sont donc retirés. C'est ainsi que Dassault Systèmes s'est retiré de projets initialement conçus comme coopératifs. Les exigences légitimes de contrôle de la dépense publique, avec les procédures qui y sont liées, peuvent conduire un certain nombre d'acteurs privés, dans des secteurs technologiques avancés, à ne même pas vouloir envisager la coopération. Il faut donc intégrer cet élément.
Concernant le choix des trois entreprises du portefeuille de l'État, la question de la pertinence se pose pour Engie. En effet, à côté des secteurs stratégiques définis par la défense nationale, s'ajoute celui du contrôle des réseaux d'infrastructures pour les services publics. En l'occurrence, le réseau de transport et le stockage du gaz sont stratégiques. La solution qui consiste à maintenir une participation de l'État est justifiée, et le fait qu'on diminue cette participation en tombant en dessous du seuil de 33 % me semble plus adapté. Pour ce qui est d'Aéroports de Paris et de la Française des jeux, je n'ai pas franchement d'objection.
Si l'on avait le temps, on entrerait dans le détail des interventions de l'État dans tel ou tel secteur. Je ne prendrai qu'un exemple. Dans le secteur automobile, j'ai été très frappé de constater ex-post que l'État avait laissé passer l'essentiel de la stratégie de Renault, qui consistait à délocaliser ses activités et à reconstituer des écosystèmes industriels hors de France, mais a mené une bataille sans fin sur la rémunération de son président, remettant en cause les modalités de l'accord dans le cadre de l'Alliance. C'est typiquement le type de micro-intervention de l'État qui pollue les processus industriels. Je pourrais également évoquer les interventions de l'État pour faire en sorte que M. Forgeard soit président d'EADS. La question est celle de savoir dans quoi investir sa puissance lorsque l'on veut être un État stratège. Est-ce dans le sauvetage de quelques emplois ici ou là, ou dans la promotion d'un candidat pour un poste de PDG ?
Sur la circulation des élites, je crois quand même que nous avons fait quelques progrès de ce point de vue. Le cas de Carlos Ghosn en est un bon exemple. L'un des effets de la volonté de mainmise de l'État sera peut-être d'accoucher d'une nouvelle gouvernance dans le domaine de l'Alliance – et ce que vous craignez sera bien plus difficile à réaliser.
Pour répondre à votre question sur le statut du chercheur, je considère qu'il n'y a pas lieu de le modifier, mais de mettre en oeuvre les mesures qui existent. Je pense par exemple aux primes associées au dépôt de brevet. Il faut les verser. Or tous les organismes ne le font pas. De la même façon, il est possible de faciliter l'investissement d'un chercheur dans une entreprise. Tous les organismes ne le font pas. Mais tout est là pour le permettre. L'article 41 du projet de loi devrait y aider. Dans la relation entre le chercheur et son réseau, il faut arrêter de pratiquer le principe de redevance idiote vis-à-vis d'entreprises qui ne génèrent pas encore de cash. En revanche, soutenir et prendre une participation à la plus-value le jour où elle se manifeste, si elle se manifeste, est une bien meilleure idée. Nous faisons des recommandations dans ce domaine. Il faut aussi valoriser les mises à disposition de chercheurs auprès des IRT dans leur carrière. Ce n'est pas parce que l'on travaille dans le privé que l'on doit être « tricard » pour le reste de sa vie, au contraire.
Sur le portage de la propriété intellectuelle, la question n'est pas celle des règles de l'État, mais de la mentalité des organismes de recherche, qui n'ont pas encore tous compris qu'un brevet en tant que tel n'est pas synonyme de valeur. Il est donc inutile de se battre sur quelques pourcents de propriété intellectuelle si cela retarde un projet. Il faut être suffisamment mûr pour comprendre qu'il existe des limites de participation revendiquées, et considérer que l'avenir produira ou non quelque chose dont on bénéficiera.
De manière générale, une importante évolution des mentalités est à réaliser. Il est rassurant d'observer que tel a déjà été le cas. Je pense notamment aux universités françaises. En l'espace de sept à dix ans, certaines d'entre elles ont évolué de façon spectaculaire en s'ouvrant vers la recherche privée.
Concernant le fonds d'investissement pour l'innovation, je considère que 250 à 300 millions d'euros par rapport à 2,5 milliards d'euros de moyens budgétaires sont significatifs. Nous faisons des recommandations d'usage, pour en dédier une partie aux innovations de rupture et une autre à l'agence pour l'innovation pour des défis.
Par ailleurs, le rapport entre public et privé est absolument clé pour créer de la valeur. Tous les moyens sont bons pour instaurer le dialogue entre le privé et le public. Ils existent largement, y compris pour les PME-PMI. Il faut qu'elles les mobilisent. Il s'agit notamment des conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE), de l'Apcom, des Instituts Carnot ou des IRT. Le soutien existe. L'argent est là. Si un projet a de la valeur, il peut être soutenu.
Enfin, sur l'État stratège et la définition des entreprises stratégiques, je propose une définition en trois parties : une entreprise de croissance, les meilleures des start-up de demain ; des entreprises matures avec une technologie clé ; des entreprises matures tellement gigantesques qu'elles ont un effet de structuration sur un pan entier de l'économie. L'on peut en avoir d'autres. En tout cas, une entreprise stratégique ne saurait être un « canard boiteux » ou une entreprise en difficulté. Ce qui est absolument vital, c'est d'avoir une idée claire de ce qu'est une entreprise stratégique, avant d'en tirer des conclusions en termes de recensement et de ce qui a vraiment de l'importance, et d'être capable de réagir avec des outils qui existent et qui ne sont pas en priorité des prises de participation publique.
Regardez ce qui se passe du côté des États-Unis : ils ont un régime de protection très efficace. Cela suppose de renforcer la fonction économique de l'État stratège, qui pense la compétitivité de demain, qui pense l'avenir des filières avec elles et qui anticipe les grandes évolutions pour être capable de les soutenir à bon escient. Or, je le disais au début de mon propos, cette fonction me paraît un petit peu étouffée par des logiques financières très court-termistes.
Membres présents ou excusés
Réunion du mercredi 18 juillet 2018 à 10 heures 15
Présents. - M. Patrice Anato, M. Jean-Noël Barrot, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Bruno Bonnell, Mme Anne-France Brunet, M. Philippe Chassaing, M. Charles de Courson, Mme Michèle Crouzet, Mme Coralie Dubost, M. M'jid El Guerrab, M. Daniel Fasquelle, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Éric Girardin, Mme Olga Givernet, M. Stanislas Guerini, M. François Jolivet, M. Guillaume Kasbarian, Mme Fadila Khattabi, M. Mohamed Laqhila, Mme Laure de La Raudière, M. Michel Lauzzana, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, M. Roland Lescure, M. Emmanuel Maquet, M. Jean-Paul Mattei, M. Patrice Perrot, M. Laurent Pietraszewski, M. Laurent Saint-Martin, M. Jacques Savatier, M. Denis Sommer, M. Adrien Taquet, M. Jean-Charles Taugourdeau, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Éric Woerth, M. Jean-Marc Zulesi
Excusés. - M. Thierry Benoit, Mme Célia de Lavergne, M. Dominique Potier, M. Arnaud Viala
Assistaient également à la réunion. - M. Jacques Cattin, Mme Christine Hennion, Mme Frédérique Lardet, M. Gaël Le Bohec, M. Gilles Le Gendre, M. Éric Pauget, M. Buon Tan, M. Jean-Luc Warsmann