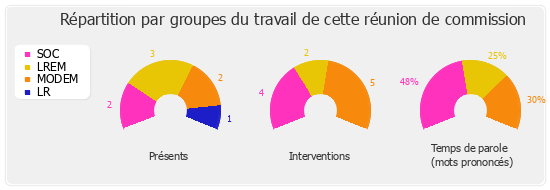Commission d'enquête sur l'impact économique, sanitaire et environnemental de l'utilisation du chlordécone et du paraquat comme insecticides agricoles dans les territoires de guadeloupe et de martinique, sur les responsabilités publiques et privées dans la prolongation de leur autorisation et évaluant la nécessité et les modalités d'une indemnisation des préjudices des victimes et de ces territoires
Réunion du lundi 1er juillet 2019 à 14h05
Résumé de la réunion
La réunion
Lundi 1er juillet 2019
La séance est ouverte à quatorze heures cinq.
Présidence de M. Serge Letchimy, président de la commission d'enquête
————
La commission d'enquête sur l'impact économique, sanitaire et environnemental de l'utilisation du chlordécone et du paraquat, procède à l'audition M. Jacques Rosine, responsable de la délégation de Santé publique France aux Antilles, et de Mme Mounia El Yamani, préfiguratrice adjointe au directeur – direction santé, environnement et travail –, de Santé publique France.

Mes chers collègues, je souhaite la bienvenue à M. Jacques Rosine, responsable de la délégation de Santé publique France aux Antilles. Il est accompagné de Mme Mounia El Yamani, préfiguratrice adjointe au directeur de la direction santé, environnement et travail.
Je vous rappelle que nous avons décidé de rendre publiques nos auditions et que celles-ci sont par conséquent ouvertes à la presse. Elles seront disponibles sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale, et la commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie des comptes rendus qui en seront établis.
Je dois, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, vous demander de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
M. Jacques Rosine et Mme Mounia El Yamani prêtent successivement serment.

Monsieur Rosine, vous avez la parole pour un exposé liminaire. Vous pourrez ensuite répondre aux questions des membres de la commission d'enquête.
Santé publique France est chargée de la surveillance de l'état de santé de la population et de l'évaluation des risques à laquelle cette population est exposée, évaluation qui porte à la fois sur les agents infectieux et chimiques et sur les pathologies. C'est dans ce cadre qu'a travaillé la cellule d'intervention en région (Cire) Antilles-Guyane, créée en 1997, aujourd'hui cellule régionale de Santé publique France aux Antilles.
En vertu de sa mission de surveillance, la cellule s'est penchée sur le cas de l'exposition à la chlordécone dès 2000-2001, la contamination de certains aliments et de l'eau ayant été avérée à la fin des années quatre-vingt-dix et au début des années deux mille. Des études ont ainsi été menées en 2003-2004 pour estimer l'exposition indirecte, via l'alimentation, de la population à ce pesticide ; il s'agit de l'étude sur la santé et les comportements alimentaires (ESCAL) en Martinique et de l'étude sur les comportements alimentaires dans le sud Basse-Terre (CALBAS) en Guadeloupe. Ces travaux ont été complétés par les enquêtes dites Reso entre 2005 et 2007 qui ont mesuré le niveau de contamination d'un échantillonnage d'aliments issus de la terre et de la mer et collectés à la fois sur les marchés et sur des sites plus informels. C'est sur la base de ces différentes études et avec l'appui de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) que nous avons pu établir les premières valeurs toxicologiques de référence.
En 2009, avec la mise en place du premier plan chlordécone, l'Institut de veille sanitaire (InVS) – l'agence Santé publique France n'avait alors pas encore été créée – a été chargé du secrétariat du conseil scientifique constitué dans le cadre d'une des actions du plan. Pendant plus d'une année et demie, nous avons travaillé en lien avec ce conseil sur l'expertise en termes de surveillance sanitaire et sur les recherches complémentaires à mettre en oeuvre. C'est à partir des recommandations de ce conseil scientifique qu'un certain nombre d'actions complémentaires ont été décidées pour évaluer le risque d'exposition de la population. Ont notamment été créés le registre des cancers de Guadeloupe – le registre des cancers de Martinique existait depuis 1983 – pour disposer de données sur l'incidence et la prévalence de cette pathologie, le registre de malformations congénitales et un centre de toxicovigilance initialement installé au centre hospitalier de Basse-Terre.
Plus récemment, l'enquête Kannari, que nous avons menée avec plusieurs partenaires – l'ANSES, les agences régionales de santé (ARS) et les observatoires régionaux de santé (ORS) – a permis de déterminer pour la première fois l'imprégnation à la chlordécone de la population générale, et non plus seulement de populations spécifiques, comme dans les études de Luc Multigner et de son équipe. Les résultats, publiés récemment, ont montré que plus de 90 % de la population en Guadeloupe et en Martinique présentait une imprégnation à la chlordécone avec une moyenne des niveaux d'imprégnation de l'ordre de 0,13 microgrammes par litre, 5 % de la population présentant par ailleurs des niveaux relativement élevés. Je vais laisser la parole à ma collègue sur le sujet des travailleurs de la banane.
En parallèle des travaux portant sur la population générale et relatifs à la santé et à l'environnement, des travaux ont été menés par l'agence sur la santé des travailleurs. Dans le cadre du plan chlordécone II, à l'issue d'une étude de faisabilité, la cohorte de l'ensemble des travailleurs de la banane ayant exercé entre 1973 et 1993, période d'utilisation du pesticide, a été reconstituée. Près de 14 800 personnes ont été retrouvées à ce jour.
Nous sommes à présent dans la phase d'analyse, en particulier en termes de mortalité. Les premiers résultats que nous avons exposés au colloque scientifique et d'information sur la pollution par la chlordécone en octobre dernier aux Antilles, qui concernent la période de 2000 à 2017, ont montré qu'il n'y avait pas de surmortalité toutes causes, notamment pour le cancer de la prostate, qui est un réel sujet de préoccupation dans cette partie du territoire français. Ces résultats sont toutefois très préliminaires car ils ne concernent pas la période précédant l'an 2000 et parce que les données n'ont pas été croisées avec les taux d'exposition. Ce travail a été réalisé dans le cadre du plan chlordécone III au moyen de la matrice culture-exposition Matphyto : nous avons reconstitué l'exposition à tous les pesticides réglementaires des travailleurs de la banane de 1960 à nos jours en précisant la fréquence et l'intensité d'utilisation des produits. Les résultats ont également été transmis au cours du colloque.

Vous avez précisé que la cohorte avait été reconstituée pour la période de 1973 à 1993, puis évoqué des résultats relatifs au cancer de la prostate dans les années 2000. Pouvez-vous m'expliquer le lien entre ces deux périodes ?
Comme je viens de le préciser, les résultats sont très préliminaires : pour les maladies chroniques telles que le cancer, le postulat est que l'exposition survient des années avant la pathologie. C'est pourquoi nous mesurons habituellement la prévalence d'une maladie dix ou vingt ans après la période d'exposition.
Les résultats relatifs à la cohorte seront très riches mais ne sont pas encore disponibles. Nous aurons notamment des indications sur la mortalité toutes causes et par cause spécifique sur les années antérieures à 2000, pour lesquelles nous disposons de données. Nous examinerons en outre la mortalité en fonction de l'exposition, afin de déterminer si les travailleurs les plus exposés ont un taux de mortalité supérieur, et en fonction de l'appartenance sociale, selon qu'on est travailleur sous contrat ou exploitant. Ces travaux seront réalisés d'ici à 2020. Une autre série de travaux portera sur la morbidité, en rapportant les données de la cohorte à celles du système national des données de santé (SNDS). Ce sont pour l'heure les moyens humains qui font défaut. Dans toute étude épidémiologique, on examine la mortalité avant de s'intéresser à la morbidité.

L'agence Santé publique France a été créée en 2016, mais elle succède à l'Institut de veille sanitaire (InVS), à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) et à l'Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS). Quand les agences précitées et les pouvoirs publics ont-ils pris conscience que la pollution à la chlordécone représentait un enjeu de santé publique ? Quelles sont les raisons du délai entre la mise en place de plans à partir de 2008 et l'interdiction du produit en 1990, d'ailleurs utilisé jusqu'en 1993 ?
Le premier plan chlordécone a en effet été validé en 2008, mais les premiers dispositifs visant à mieux comprendre la problématique chlordécone ont été mis en oeuvre dès les années 2000-2002. Nous avons commencé, au sein de ce qui était alors l'InVS, à y travailler dès 2000-2001 grâce aux travaux des directions de la santé et du développement social (DSDS) de Martinique et de Guadeloupe – aujourd'hui les ARS – menées en 1999 sur la contamination alimentaire, et c'est ainsi qu'a débuté l'évaluation des risques. Un premier rapport de 1976 a permis de mettre en évidence la contamination des sols par des pesticides, dont la chlordécone, dans certaines zones de Guadeloupe, mais l'exposition du fait de la contamination de certains produits n'a été découverte qu'à la fin des années quatre-vingt-dix. C'est à partir de ce moment que nous avons lancé les premières enquêtes, dès 2002 pour les phases de terrain, et jusqu'en 2006, avant même la mise en oeuvre du premier plan. Par la suite, avec les recommandations du conseil scientifique, d'autres travaux ont été menés au travers du premier plan chlordécone.
Oui, mais auparavant, entre 2000 et 2002, des travaux avaient été menés pour essayer de comprendre le problème.

Plusieurs initiatives isolées ont vu le jour avant 2008, notamment par rapport aux problèmes posés par le captage d'eau, mais le premier plan global date de 2008.
C'est exact.

Comment expliquer alors qu'il soit intervenu aussi tardivement ? Le produit a été interdit par les Américains dès 1976, après la fermeture de l'usine de production de Virginie, et le rapport Snegaroff sur les résidus d'insecticides organochlorés dans les sols et les rivières de la région bananière de Guadeloupe, issu d'une mission de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), date de 1977. Le rapport Kermarrec souligne quant à lui en 1980 la bioaccumulation des substances organochlorés dans les sols et les milieux aquatiques. Comment expliquer qu'un dispositif global de prise en charge du problème ait été mis en place aussi tardivement par les pouvoirs publics en dépit de toutes ces alertes ? L'interdiction définitive de l'utilisation de chlordécone remonte à 1993, bien que, en pratique, une tonne et demie de patates douces en provenance des Antilles contaminées par la chlordécone a été saisie en 2002 dans le port de Dunkerque et que 9,5 tonnes de chlordécone ont été découvertes dans un hangar à bananes en Martinique en 2003. Quinze ans se sont donc écoulés entre la décision d'interdiction et la mise en oeuvre du premier plan !
Si nous travaillons avec tous les organismes concernés à la mise en oeuvre des plans chlordécone, nous n'en sommes pas responsables. Certes, le premier plan date de 2008, alors que l'interdiction a été décidée en 1993, mais c'est à la suite des travaux menés par les DSDS en 1999 que nous avons commencé à mesurer l'exposition de la population générale au pesticide par le niveau de contamination des aliments et de l'eau de consommation. Nous avons donc réagi dès que nous avons été alertés.

Entre 1980 et 1990, dix ans se sont écoulés. Entre 1977 et 1990, treize ans se sont écoulés. Ma question porte non pas sur l'aspect administratif de la mise en place du plan, mais sur votre appréciation en tant que responsable au sein d'une agence de l'État quant à ce délai invraisemblable entre la détection du drame et la mise en oeuvre du plan. Pensez-vous que ce soit normal ?
Pas du tout !
Certainement pas ! Si l'on se réfère à des éléments scientifiques pour essayer de comprendre ce retard, que je ne trouve absolument pas normal, il faut revenir au drame américain. On a pris conscience de la dangerosité de la chlordécone parce qu'on a montré que la production et le déversement de ce produit aux abords d'une usine de fabrication avait eu des effets aigus sur les travailleurs de l'unité.
Oui, très exactement, monsieur le président. À la suite de cet accident, il a été jugé que le danger principal de la chlordécone résidait dans ces effets aigus neurotoxiques. Ce n'est que dans un second temps, après l'arrêt de son utilisation, qu'on s'est aperçu de la persistance de la molécule dans les milieux naturels, notamment les eaux et les sols. À nouveau, je ne justifie rien, j'essaie simplement d'expliquer la succession des événements, mais il me semble que le retard est dû à cette erreur d'appréciation.
En effet.

Nous y reviendrons sans doute, mais la question des responsabilités se pose également relativement aux autorisations et à leurs modalités de délivrance. Une première autorisation, provisoire, a été donnée en 1972 en France, et alors que l'usine de Virginie avait fermé en 1976, cette autorisation s'est prolongée jusqu'en 1981, date à laquelle le produit a été homologué. Le retrait n'est intervenu qu'en 1990, mais l'utilisation a été prolongée pendant deux ans. Je vous remercie donc de nous avoir répondu sincèrement, monsieur Rosine, madame El Yamani, sur le caractère anormal du délai de mise en place d'un dispositif d'ordre général pour la prise en charge d'un tel drame.
Je le répète : le problème avait été identifié scientifiquement.

Vous l'avez rappelé, des enquêtes ont été menées de 2002 à 2006 avant que ne soit présenté en 2008 le premier plan chlordécone. Quel est le rôle de Santé publique France dans la conception et la mise en oeuvre des plans chlordécone ?
Comme je l'ai précisé, notre participation au premier plan chlordécone a concerné l'évaluation des risques, c'est-à-dire l'étude de l'exposition à la molécule, notamment pour les produits de la pêche et de l'agriculture. Ces travaux ont été menés en 2008-2009 en coordination avec le conseil scientifique, comité international regroupant un certain nombre de d'experts, qui a formulé des avis sur les publications existantes, étudié le contexte local et formulé des propositions de recherches complémentaires pour avoir une meilleure connaissance du problème. Notre rôle a été à la fois d'accompagner le conseil dans les questionnements et de mettre en place les travaux nécessaires à une meilleure compréhension du contexte et de l'exposition.

J'ai bien écouté vos propos sur le volet santé des travailleurs et sur la cohorte de 14 800 travailleurs que vous étudiez. Vous indiquez qu'il est de coutume de commencer par la mortalité, et que la morbidité sera examinée ensuite, mais le cancer de la prostate, qui est le plus fréquent en cas de contamination à la chlordécone, tue très peu, il est silencieux. C'est sans doute ce qui explique qu'il n'y ait pas de surmortalité significative.
Il est regrettable que les études sur la morbidité, à nos yeux les plus importantes, n'aient pas déjà commencé. Vous affirmez que c'est la conséquence d'un manque de moyens humains, alors permettez-moi de vous interroger à ce sujet. Pensez-vous avoir disposé des moyens nécessaires pour remplir vos missions, pas uniquement sur la chlordécone, mais pour la surveillance épidémiologique en général en Outre-mer ? Pourriez-vous nous dire quelle part de votre budget est consacrée aux Outre-mer ?
Santé publique France est chargée de la surveillance non seulement de l'environnement et des milieux, mais aussi des maladies infectieuses, notamment les arboviroses. Notre cellule est la mieux dotée au sein de l'agence par rapport à celles des autres régions. Santé publique France est d'ailleurs la seule agence de sécurité sanitaire à disposer de cellules en région, c'est-à-dire au plus près des populations. Concernant les travaux sur la chlordécone, nous avons pu bénéficier de renforts : des contrats à durée déterminée (CDD) ont été créés durant plusieurs années pour les enquêtes Kannari ou pour le volet santé des travailleurs. Nous avons donc toujours eu l'oreille de la direction générale et obtenu les financements nécessaires au travers des plans chlordécone successifs, grâce à la DGS et aux crédits du programme des interventions territoriales de l'État (PITE). Pour des études de grande ampleur comme Kannari, étude multi-partenariale menée avec l'ANSES, les ORS et les ARS, le budget était de plus de 2 millions d'euros, ce qui est une somme importante, une partie financée par les collectivités territoriales de Martinique et de Guadeloupe.
Avec les dotations allouées par la direction générale de la santé (DGS), nous finançons le registre des malformations congénitales à hauteur de près de 140 000 euros par an. Je ne connais que les lignes budgétaires relatives aux études de surveillance que nous menons, mais nous pourrons, si vous le souhaitez, prendre l'attache des services financiers de l'agence pour vous transmettre des informations sur son budget général.

Il serait intéressant de pouvoir disposer d'un document récapitulant, année par année, l'évolution des moyens alloués aux études sur la chlordécone depuis la mise à l'agenda du premier plan.
Un tableau de suivi des études et dispositifs de surveillance pourra vous être transmis à la fin de l'audition.

Je souhaiterais avoir quelques précisions sur le contexte international. On aurait commencé de s'interroger sur la dangerosité du pesticide après le déversement accidentel sur le site de production américain, dites-vous. Le délai de réaction a donc été assez long. Pourriez-vous établir une chronologie des événements à l'international entre la catastrophe aux États-Unis et la publication des premiers travaux, non pas en France, donc, où l'on a pu constater un petit décalage, mais à l'étranger, afin que nous ayons une vision plus large du problème ? Comment collaborez-vous à l'heure actuelle avec les agences qui sont vos homologues à l'étranger, en Europe ou ailleurs, et qui ont d'autres terrains d'investigation et travaillent sur d'autres populations, d'autres cas caractéristiques ?
Je ne suis pas certaine d'avoir les réponses à toutes vos questions. La chlordécone est particulièrement efficace sur le charançon de la banane, une culture implantée plutôt dans les zones tropicales, dans des pays où les publications scientifiques sont moins nombreuses qu'ailleurs. En outre, si l'utilisation de chlordécone a pu être massive à une période donnée aux Antilles, elle a été moins importante au même moment dans les îles proches productrices de banane en raison du prix de ce pesticide. Du fait de l'accident qui a eu lieu aux États-Unis, la littérature scientifique d'alors s'est concentrée sur les effets aigus observés à la suite du déversement, et il a fallu attendre un certain temps avant la prise en compte des effets à long terme de l'utilisation de la molécule.

J'aimerais que vous nous rappeliez en des termes simples les résultats de l'étude Kannari : de combien de personnes était constitué l'échantillon ? Sur quelle durée et quelles années a porté l'étude ? Et, surtout, quel est le pourcentage de Martiniquais et de Guadeloupéens imprégnés par la chlordécone, tous taux confondus ? Nous entrerons ensuite dans le détail.
L'étude Kannari a été menée en Martinique et en Guadeloupe entre 2013 et 2014. Elle comportait quatre volets : un volet santé piloté par les observatoires régionaux de la santé et visant à récolter des informations sur l'état de santé général de la population en mesurant notamment le diabète, le surpoids et l'obésité, des volets imprégnation et nutrition pilotés par Santé publique France, et un volet exposition alimentaire piloté par l'ANSES. Initialement, les échantillons étaient de 2 000 personnes, enfants et adultes, par département. Pour des raisons réglementaires, le volet imprégnation, qui consistait en un suivi du niveau biologique de chlordécone de la population générale, n'a pu concerner à l'époque que des individus de 16 ans et plus. Notre objectif, qui était d'effectuer 900 prélèvements par département, n'a pas pu être atteint parce que certaines des personnes qui avaient participé aux volets santé et nutrition ont refusé de prendre part au volet imprégnation du fait des contraintes de prélèvement. Près de 400 personnes ont été prélevées en Martinique, près de 300 en Guadeloupe.
La concentration moyenne mesurée est de 0,12 microgrammes par litre ; 0,14 microgrammes par litre en Martinique, 0,13 en Guadeloupe. Toutefois, 5 % de la population présente un taux dix fois plus élevé, c'est-à-dire supérieur à 1,4 microgramme par litre. On a pu caractériser cette partie de la population en croisant les résultats du volet imprégnation et ceux des volets exposition alimentaire et nutrition, qui permettaient de connaître le type d'aliments, la quantité et la fréquence de consommation, ainsi que les zones d'approvisionnement. Il a ainsi été démontré que les personnes résidant dans les zones dites contaminées, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, ou consommant des produits de la pêche issus principalement de réseaux d'approvisionnement informels étaient celles qui présentaient les taux de contamination les plus élevés.
Cette première étude en population générale s'est heurtée à des limites, mais nous avons prévu dans la feuille de route 2019-2020 du plan chlordécone III de mener une nouvelle étude Kannari avec un nombre de prélèvements plus élevé en ciblant les populations résidant dans les zones contaminées, les agriculteurs, les pêcheurs professionnels et amateurs. Nous envisageons également d'intégrer dans l'échantillon les femmes enceintes ou du moins en âge de procréer et les populations qui ont pu bénéficier du programme jardins familiaux (JAFA) depuis plus d'une quinzaine d'années. Ce dernier vise à proposer aux individus qui vivent dans des zones contaminées des alternatives aux produits issus de leurs jardins et permet une prise en charge des diagnostics des sols. Nous pourrons ainsi mesurer, en nous appuyant par ailleurs sur une enquête qualitative ad hoc, si les actions préventives menées dans le cadre de ce programme ont porté leurs fruits. L'évaluation des programmes mis en oeuvre est en effet incontournable dans notre métier. L'enquête Kannari 2 permettra également de connaître les habitudes alimentaires des populations aux taux les moins élevés.

L'étude Kannari évalue le taux d'imprégnation de l'ensemble des populations guadeloupéennes et martiniquaises à partir de l'échantillon que vous avez décrit. Pourriez-vous nous rappeler les résultats que vous avez obtenus et qui figurent dans votre publication ?
Le taux d'imprégnation est de 95 % en Martinique et de 93 % en Guadeloupe.

C'est bien ce que j'ai lu. Avec un taux de 92 % pour les deux territoires confondus, soit une population de 800 000 personnes, combien d'individus sont-ils touchés ?
À peu près 700 000.

Nous reviendrons ensuite sur le détail des zones où l'imprégnation est la plus forte. Les résultats de l'étude Kannari 2 seront très attendus. Vous ajoutez dans votre rapport que les niveaux d'imprégnation sont contrastés au sein de la population étudiée et dix fois supérieurs à la moyenne chez les individus les plus exposés.
Nous avons travaillé sur un échantillon représentatif, mais les concentrations mesurées sont très variables, et parfois infinitésimales.

Monsieur Rosine, les parlementaires ici présents ont beaucoup étudié le sujet. Nous souhaitons simplement avoir des réponses à nos questions pour que la commission, que l'État soient éclairés. Il ne s'agit pas de faire des polémiques. La première étude montre donc que 95 % des Guadeloupéens et 93 % des Martiniquais sont exposés à la chlordécone. Étant martiniquais moi-même, j'ai peut-être une concentration inférieure à 0,01 microgramme par litre dans le corps. Vous précisez que l'imprégnation peut être extrêmement élevée dans les zones fortement contaminées ; est-ce exact ?
Oui, c'est exact. L'augmentation du niveau d'imprégnation en zones contaminées peut s'expliquer par la consommation de produits du jardin ou de la pêche issus de ces zones.
Je précise que la molécule ayant une demi-vie de l'ordre de 120 à 160 jours selon les études, soit quatre à cinq mois, on peut se décontaminer sous réserve de ne pas consommer de produits contaminés pendant une à deux années. Les résultats de cette étude caractérisent donc une exposition relativement récente, ayant eu lieu une à deux années avant le prélèvement, voir la semaine précédant celui-ci.

Autre question : quel écart y a-t-il entre le nombre de personnes contaminées par le chlordécone en raison de leur profession et celui des personnes touchées pour des raisons alimentaires ? Je m'explique : l'imprégnation par le chlordécone peut être liée à l'activité professionnelle, comme c'est le cas des travailleurs agricoles, mais aussi à la consommation d'un aliment contenant cette substance. Quel écart numérique existe-t-il entre ces deux catégories de personnes ?
L'étude Kannari 1 portait sur un échantillon représentatif de la population générale. Nous n'avons pas pu mener d'étude permettant d'établir que l'imprégnation à la chlordécone provient du travail. Suite à cette étude, qui était une photographie à l'instant t, nous proposons, dans le cadre du plan national chlordécone IV, de conduire une action ciblant les agriculteurs du secteur de la banane en lien avec la médecine du travail afin d'étudier l'imprégnation de cette population – non seulement à la chlordécone mais à tous les autres pesticides utilisés pour cultiver la banane.
Selon l'étude que nous avons réalisée sur l'exposition des travailleurs de la banane, leur nombre a fortement diminué et s'établit à environ 5 000 personnes.

Exactement : entre 5 000 et 6 000 en Martinique et autant en Guadeloupe, soit quelque 12 000 personnes en tout. Pensez-vous qu'il faille adopter la même approche pour 12 000 personnes et pour les 750 000 personnes touchées, qu'il s'agisse des analyses à effectuer ou des mesures à prendre à court terme ?
Dans les deux îles, les travailleurs de la banane peuvent être exposés à la chlordécone mais seulement dans une hypothèse précise : lorsque les sols sont imbibés de chlordécone, les travailleurs sont susceptibles d'inhaler des particules nanométriques qui expliqueraient la persistance de la contamination en raison de leur activité. À mon sens, les travailleurs de la banane sont concernés par d'autres pesticides. L'étude nous permettra d'établir ou d'exclure leur surimprégnation à la chlordécone par rapport à la population générale : peut-être leur imprégnation est-elle de même niveau que la population générale et que les problèmes qui les touchent sont liés aux autres pesticides utilisés dans la culture de la banane.

Les travailleurs de la banane sont-ils selon vous les seuls concernés ? Nous nous interrogeons sur la modification des tableaux professionnels en vue d'une éventuelle indemnisation : les petits agriculteurs ne travaillent-ils pas eux aussi sur des terres chlordéconées ?
En effet, nous avons également étudié la culture de la canne à sucre et le maraîchage en Martinique. Il se peut que ces cultures se pratiquent sur des terres qui ne sont pas actuellement utilisées pour cultiver des bananes mais qui l'ont été il y a quelques années. En dépit du changement de culture, l'imprégnation de ces agriculteurs n'est pas exclue, la terre étant très imbibée.
C'est un établissement public de l'État.

Quelle valeur donnez-vous au chiffre de 750 000 personnes imprégnées ? Est-ce une alerte ou une banalité sans importance ? Le fait que 95 % des habitants soient imprégnés de chlordécone a du sens. Quelle serait la réaction, en France hexagonale, si 95 % des habitants étaient touchés ? Il se produirait sans doute plus qu'une émeute. En tant que responsables d'un établissement public de l'État, que vous dit ce chiffre ?
Il va de soi que cette part de 95 % est extrêmement élevée. Il correspond au résultat d'une étude réalisée à un instant t ; nous allons conduire une autre étude pour constater son évolution, en espérant qu'il a diminué. Quoi qu'il en soit, le fait qu'une population soit touchée à 95 % par un polluant signifie que l'exposition au sein des départements concernés est généralisée. De mon point de vue, la priorité doit consister à limiter cette exposition, grâce aux recommandations déjà formulées par Santé publique France, l'ANSES et les ARS.

Faut-il tester le taux d'imprégnation de l'ensemble de la population ? Cette donnée aurait-elle un intérêt médical pour les personnes ? Aurait-elle un intérêt épidémiologique ?
La question de l'imprégnation – ou, dans notre jargon, de la chlordéconémie – est complexe. L'ARS de Guadeloupe conduit depuis le début de l'année des travaux en lien avec plusieurs partenaires – chercheurs, scientifiques, représentants des élus et des usagers – et a abouti à un certain consensus. Je peux dire ceci : d'un point de vue épidémiologique, il est difficile d'interpréter un dosage systématique dans la population générale. En effet, les personnes dépistées ne seraient pas forcément représentatives de la population générale, comme l'a montré l'enquête Kannari 1 : bien que le dépistage ait été proposé gratuitement et que des infirmières se soient rendues disponibles pour effectuer le test à domicile, une part non négligeable de l'échantillon a refusé les prélèvements. Autrement dit, les personnes qui acceptent le prélèvement se caractérisent sans doute par des différences d'ordre sociodémographique par rapport à la population générale et les résultats de telles analyses ne sauraient être extrapolés.
Sur le plan individuel, la difficulté tient au fait qu'il n'existe pas encore de valeur sanitaire de référence, malgré les travaux initiaux de l'ANSES sur ce sujet. En Martinique, des biologistes qui réalisent actuellement des dosages de chlordécone ne savent pas comment interpréter les résultats lorsqu'ils sont communiqués aux patients. La mesure de la chlordécone dans le sang, quelle qu'en soit la concentration, ne suffit pas à établir avec certitude qu'une maladie adviendra. En l'absence de valeur sanitaire de référence, les médecins eux-mêmes – et nous partageons ce point de vue – estiment qu'il n'est pas opportun de rendre des résultats établissant une concentration élevée de chlordécone sans message sanitaire ni indications, hormis les modifications alimentaires à apporter. En revanche, certaines populations sont potentiellement plus exposées au risque : c'est le cas des travailleurs agricoles, qui font l'objet, comme l'a indiqué Mme El Yamani, d'un travail spécifique en lien avec la médecine du travail. Autre problématique : les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer. M. Multigner, que vous allez rencontrer, vous présentera les résultats de ses enquêtes, notamment sur la cohorte Timoun. Ces études peuvent avoir un intérêt s'agissant de certaines catégories ciblées. Un gynécologue de Guadeloupe nous a néanmoins alertés sur le fait que mesurer la chlordéconémie d'une femme enceinte pourrait entraîner des effets psychologiques assez forts jusqu'à aboutir à des extrémités non souhaitables.
Il faut donc procéder avec prudence. La demande sociale est forte et nous en sommes conscients. Les capacités techniques n'existent pas encore aux Antilles mais plusieurs laboratoires sont en mesure – même si leurs techniques n'ont pas encore toutes été validées – de mesurer la chlordécone. Reste à définir l'objectif : d'un point de vue épidémiologique, ce sont les études portant sur des échantillons tirés au sort selon une méthodologie adaptée qui, seules, sont représentatives à l'échelle du département. Le chiffre de 95 % que nous avons évoqué ne peut être obtenu que par cette méthode.

Entre 1972 et 1998, un autre établissement sanitaire était-il chargé d'effectuer des études et des analyses épidémiologiques ou toxicologiques ?
Santé publique France a été créé en 2016 par la fusion de l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), qui travaillait sur le volet relatif à la prévention, avec l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) pour le volet relatif à la réserve sanitaire, et l'institut de veille sanitaire (InVS), créé en 1998 pour assurer des missions de veille sanitaire. L'InVS avait été précédé par le réseau national de santé publique (RNSP).

Est-ce que Santé publique France travaille avec le groupe d'orientation et de suivi scientifique (GOSS), un réseau de recherche sur la chlordécone créé en 2016 ?
Le directeur scientifique de Santé publique France en est membre et y présente la politique de l'établissement.

Quelles propositions de prise en charge sanitaire pourriez-vous formuler à partir des conclusions de l'enquête Kannari ? Avez-vous déjà, compte tenu de l'ampleur de la situation, adressé des suggestions à l'État qu'il n'aurait pas suivies ?
Toutes les propositions que nous avons formulées dans le cadre du conseil scientifique – études épidémiologiques, création d'un registre des cancers, d'un registre des malformations congénitales ou encore d'un centre de toxicovigilance – ont été prises en considération. La conduite de certaines études s'est avérée plus complexe tant pour des raisons administratives – tenant notamment aux règles de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) – que pour des raisons financières.
Malgré ces difficultés, nous sommes parvenus à obtenir auprès des services de l'État et des collectivités concernées les financements nécessaires pour l'enquête Kannari 1 – et je suis persuadé qu'il en sera de même pour Kannari 2 – à hauteur de 2 millions d'euros. Autrement dit, Santé publique France n'a pas eu de problème à conduire les travaux souhaités.
Ce projet ne relève pas de Santé publique France mais de l'équipe de M. Multigner à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Il était le fruit de discussions entre l'INSERM et l'Institut national du cancer (INCa).
N'ayant pas participé aux discussions à l'époque, je ne peux pas me prononcer sur ce sujet.

Soit. Compte tenu des conclusions de l'étude Kannari, quelles propositions de santé publique générale avez-vous formulées ?
Nous avons établi que les expositions sont plus fortes et beaucoup trop élevées dans certaines catégories de population. Il est donc nécessaire de renforcer les mesures de communication et d'information de la population. Depuis quinze ans, tous les organismes compétents ont produit d'innombrables travaux et études et ont accumulé une masse de connaissances scientifiques validées. Il faut désormais privilégier ce que nous appelons la literacy, c'est-à-dire rendre ces informations scientifiques accessibles à tous. C'est l'un des axes des propositions que nous avons formulées concernant la période 2019-2020 du plan chlordécone en cours et le plan chlordécone IV. En effet, certaines informations plus ou moins erronées continuent de circuler. Je ne suis pas sûr que la population générale soit consciente que la culture de certains types de fruits reste possible sans aucun risque sur des sols peu contaminés. Il faut également faire passer des informations concernant les produits qui seraient plus contaminés que d'autres. En clair, il faut renforcer la communication d'informations destinées à la population, en ne se contentant pas d'outils informatiques, même si les réseaux sociaux sont très en vogue. Les personnes âgées ne doivent pas être oubliées, car elles sont potentiellement les plus exposées dans certaines zones et n'ont pas toujours accès aux outils en question. L'information de proximité utilisée dans le cadre du programme des jardins familiaux (JAFA) présente le grand intérêt de changer d'échelle : au lieu d'en faire bénéficier 400 ou 500 foyers chaque année, on s'est appuyé sur des relais dans les collectivités territoriales, en particulier les mairies comme cela s'est fait dans le cadre de la prévention de la dengue, pour rendre visite aux personnes les plus exposées afin de présenter le programme JAFA, même si cela suppose l'acquisition préalable de connaissances spécifiques.
En effet, il faut faire comprendre à la population qu'il est possible d'échapper à la fatalité de l'imprégnation à la chlordécone en raison de sa demi-vie. Cette information ne parvient pas sur le terrain. La découverte de chlordécone dans le sol à un instant t ne signifie pas une contamination à vie. Il faut sensibiliser aux changements d'habitudes, notamment alimentaires, susceptibles de changer la donne du tout au tout. Or, ce message n'est pas encore parvenu à la population.

Puisque l'information ne parvient pas à la population, que pensez-vous des actions d'information prévues par le plan chlordécone ? Faut-il envisager un suivi sanitaire spécifique en Guadeloupe et en Martinique ?
Santé publique France a déjà déployé des dispositifs de surveillance spécifiques avec le registre des cancers, le registre des malformations congénitales et centre de toxicovigilance. Nous avons la chance de disposer d'un registre des cancers en Guadeloupe et d'un autre en Martinique, pour une quinzaine en tout sur le plan national. Rares sont donc les régions qui possèdent leur registre propre ; nous disposons donc aux Antilles de données de suivi exhaustives.
Le suivi sanitaire relève de la mission de Santé publique France qui, par ses cellules régionales, est chargé d'assurer la surveillance constante de l'état de santé de la population en menant des études spécifiques à tel et tel moment. S'agissant plus particulièrement de la chlordécone, nous assurons le suivi de l'imprégnation grâce à des études de type Kannari.
Les différents plans mis en oeuvre ont eu pour objectif de dresser un état des lieux et d'enrichir les connaissances épidémiologiques et scientifiques pour pouvoir agir. Désormais, nous savons ; il est donc possible d'agir en diffusant des messages susceptibles d'influencer les comportements à l'échelle locale afin de diminuer l'imprégnation à la chlordécone. À mon sens, cette action demeure insuffisante.

Autrement dit, au moins l'un des objectifs des différents plans chlordécone n'a pas été atteint, n'est-ce pas ?
Il était indispensable d'établir des connaissances scientifiques et de dresser un état des lieux : on ne peut pas agir si l'on ignore tout de la situation de départ. Les plans chlordécone I et II ont permis d'apporter ces connaissances car, auparavant, nous ignorions que 95 % des personnes vivant aux Antilles étaient imprégnées – ou alors n'était-ce qu'un postulat. Nous nous fondons désormais sur des faits scientifiquement établis : il devient alors possible d'agir.
Même si elles ne relèvent pas de notre compétence, les actions 1 et 2 du plan chlordécone I, qui portaient sur la communication, ont notamment débouché sur la création du site Chlordécone Info qui regroupe l'ensemble des informations disponibles et qui est régulièrement mis à jour. Dans le cadre du programme JAFA, des actions de communication ont été entreprises à l'intention de plusieurs catégories de population. Il faut désormais utiliser les dernières connaissances acquises et les communiquer sous forme d'un message compréhensible par la population générale.

Selon vous, les moyens humains, financiers et territoriaux déployés dans le cadre des différents plans chlordécone sont-ils suffisants ? Comment se fait-il, par exemple, que l'on ne connaisse que depuis l'an dernier l'importance des surfaces foncières imbibées de chlordécone ? Les financements actuels et les outils scientifiques locaux sont insuffisants pour conduire les tests nécessaires sur les terrains. L'État a-t-il selon vous déployé des moyens suffisants pour répondre à un problème aussi grave ?
Je vous remercie, madame El Yamani, d'avoir l'honnêteté d'affirmer qu'au-delà de l'identification des problèmes, il faut désormais passer à l'action, notamment en matière d'information et de communication de proximité pour éviter que les personnes continuent de consommer des produits imbibés. Ces différents exemples font apparaître une insuffisance certaine. Pensez-vous que les moyens consacrés aux plans chlordécone sont-ils adaptés ?
Étant donné le taux d'imprégnation constaté il y a encore deux ou trois ans, on peut considérer qu'il faut faire davantage. Si le taux de la population imprégnée reste de 95 %, c'est qu'il existe un problème, et qu'il est divers. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler mais sans doute faut-il consentir davantage d'efforts en matière de communication et d'information. Les moyens financiers relèvent des préfets qui, avec les programmes des interventions territoriales de l'État (PITE), font avec ce qu'ils ont. Nous n'avons pas connaissance de l'ensemble des moyens alloués dans le cadre des plans de financement mais les moyens dont nous disposons nous ont permis de conduire certains travaux. Cela étant, le taux d'imprégnation étant encore de 95 %, on peut encore faire plus et mieux.

La Guadeloupe comme la Martinique se heurtent au problème des analyses. Pouvez-vous faire le point sur les laboratoires qui sont en mesure d'effectuer les analyses, dans l'eau et dans les aliments, sachant que les délais séparant le prélèvement de la communication des résultats peuvent dépasser trois mois ? C'est particulièrement problématique dans le cas de l'eau potable, car il faut pouvoir réagir très vite, notamment en installant des filtres à charbon actif. Autre problème : le poisson. Après le prélèvement effectué chez le pêcheur, le poisson est consommé rapidement et les résultats ne sont obtenus que bien longtemps après. Quelles sont les perspectives d'établissement en Guadeloupe et en Martinique de laboratoires susceptibles de réaliser ces analyses ?
L'institut Pasteur de Guadeloupe a réalisé des analyses de sol pour le compte de l'ARS mais ne le fait plus. C'est toutefois un partenaire avec lequel nous souhaitons travailler dans le cadre de l'enquête Kannari 2. Lors de l'enquête Kannari 1, nous avons dû envoyer les prélèvements au laboratoire CART à Liège, en Belgique, qui était alors le seul à avoir développé des techniques reproductibles et scientifiquement validées afin de réaliser ces analyses. Notre objectif est d'importer cette technique aux Antilles. Pour ce faire, nous travaillerons dans le cadre de l'étude Kannari 2 avec l'institut Pasteur de Guadeloupe afin qu'il acquière le matériel nécessaire, que les personnels se forment et que la technique puisse être développée localement. Cela permettra de disposer sur place, aux Antilles, d'un laboratoire agréé et capable de réaliser ces analyses.
Aucun laboratoire de ville ne pratique ces analyses, et c'est bien normal : s'agissant des fluides humains, tous les biologistes – dont M. Multigner, sans doute – diront que la technique est très complexe, qu'elle n'a rien de routinier et qu'elle suppose une certaine maîtrise. Il n'est donc pas à ce stade prévu que les laboratoires de ville s'équipent de cette technique, d'autant plus qu'il leur faudrait, s'ils s'en dotaient, s'assurer qu'il y aura bien des prélèvements à réaliser. Pour l'instant, les prélèvements sont envoyés en hexagone, au laboratoire de Grenoble.

Que dites-vous des analyses qui établissent un lien étroit entre le cancer de la prostate et la chlordécone ?
En effet, les taux de cancer de la prostate observés en Martinique et en Guadeloupe sont parmi les plus élevés au monde, de l'ordre de 162 ou 163 pour 100 000 habitants contre 98 pour 100 000 en France hexagonale. D'autre part, les travaux de M. Multigner et de l'INSERM ont fait apparaître un lien statistique potentiel entre les cancers de la prostate de certaines personnes et une concentration élevée de chlordécone.
On ne peut donc pas dire qu'il n'existe aucun lien puisque des études l'établissent. Cependant, il faut pouvoir démontrer la part de ces cancers attribuable à la chlordécone : sur les 500 nouveaux cancers déclarés chaque année en Martinique et en Guadeloupe, combien peuvent être attribués à l'exposition à la chlordécone ? C'est ce travail complémentaire de mesure de la part attribuable qu'il faudra mener en lien avec les chercheurs de l'INSERM et de l'INCa.

En clair, la détection d'un cancer de la prostate ne donne pas systématiquement lieu à une enquête par l'équipe médicale chargée du patient, tant pour établir son taux d'imprégnation que pour déterminer son parcours et sa potentielle exposition ? La question vaut pour les malformations foetales : lorsqu'elles en détectent, les équipes hospitalières conduisent-elles ce travail d'enquête, au-delà des études plus générales que mène Santé publique France ?
À ma connaissance, la découverte d'un cancer de la prostate ne donne pas lieu à une recherche systématique. Peut-être une part de ces cancers est-elle attribuable à la molécule de chlordécone mais d'autres facteurs, notamment génétiques, entrent en jeu. Les études auxquelles vous faites référence se pratiquent davantage sur des cohortes, dans lesquelles nous mesurons l'évolution de la contamination et observons l'apparition éventuelle de pathologies. Encore une fois, l'enquête n'est pas systématique pour chaque patient atteint d'un cancer de la prostate. Des travaux sont en cours, néanmoins : un appel à projets a été lancé sur la question précise des cancers de la prostate, car il s'agit d'une question importante au niveau local et national.
En ce qui concerne les registres des malformations congénitales, il conviendrait d'interroger le directeur de leur fédération, M. Schaub. À ce stade, les analyses n'établissent pas de surincidence aux Antilles par rapport à la métropole des pathologies recherchées en lien avec une exposition aux pesticides.

Un établissement de l'État – l'INSERM – conclut, par la voix du professeur Multigner, que le taux de récidive du cancer de la prostate est trois fois supérieur dans les zones exposées à la chlordécone, et l'indique à un autre établissement de l'État, Santé publique France. En tenez-vous compte ? L'État parle à l'État : comment réagissez-vous face à l'affirmation selon laquelle il n'existerait aucun lien entre le cancer de la prostate et la chlordécone ? N'y a-t-il pas là une ambiguïté entre les différents services de l'État ?
Non : les récents travaux du professeur Multigner, publiés au premier trimestre, ont en effet montré que les patients ayant subi une prostatectomie et présentant une concentration de chlordécone connaissent en effet des taux de récidive de leur cancer plus importants. À ma connaissance, Santé publique France n'a pas prétendu le contraire. S'agissant d'une surincidence des cancers en lien avec une potentielle exposition au chlordécone, nous avons conduit depuis le début des années 2000 des études épidémiologiques. Dans le nord de la Martinique, par exemple, nous avons recherché le nombre de cancers – prostate et autres – dans une zone d'habitation donnée. Cette étude, qui pourrait être renouvelée dans le cadre de la nouvelle feuille de route, ne montre pas de surincidence des cancers de la prostate par rapport à la zone géographique. En revanche, elle a établi une surincidence des myélomes jusqu'à il y a une dizaine d'années environ, sans pouvoir établir de lien de causalité. Les études de ce type, en effet, ne recherchent pas les liens de causalité mais constatent des écarts et formulent une alerte ; c'est ensuite aux travaux complémentaires de recherche comme ceux de l'INSERM qu'il appartient de confirmer ou d'infirmer une hypothèse de recherche.
En l'occurrence, l'hypothèse de recherche des travaux récents de l'équipe du professeur Multigner était la suivante : le chlordécone a-t-il un impact sur les taux de récidive ? La réponse est oui.
L'agence Santé publique France assure la surveillance de l'ensemble des cancers, notamment aux Antilles. Notre action consiste à publier les statistiques consolidées de l'incidence et de la prévalence des cancers. Les travaux de recherche, en revanche, relèvent de la compétence de l'institution de recherche et non de Santé publique France, qui fait de la surveillance épidémiologique. Les résultats sont ensuite confrontés à ceux des travaux de recherche et, en l'espèce, ils ne sont pas contradictoires.
Nous avons publié en janvier 2019 le bilan de l'incidence de l'ensemble des cancers aux Antilles. Globalement, l'incidence est nettement moins élevée que la moyenne nationale mais, pour certains types de cancer dont celui de la prostate, elle l'est nettement plus.

Permettez-moi de parler avec franchise pour éviter tout malentendu : vous nous dites que les chercheurs de l'INSERM font leur travail de leur côté et que Santé publique France conduit son action de surveillance sanitaire du sien. M. Multigner, qui ne travaille pas pour son corps en lui-même, pour employer un créolisme, mais pour l'institution d'État qu'est l'INSERM, tire des conclusions que nul ne conteste, ni les scientifiques ni personne d'autre. Selon ces conclusions, le risque de récidive du cancer de la prostate est trois fois plus élevé dans les zones imbibées de chlordécone. C'est un taux très important ! Il me semble très inquiétant d'estimer que cela n'importe pas dans l'analyse à conduire – ce n'est pas ce que vous avez dit, mais c'est ce que je ressens.
Ce statut de champion du monde des Antilles pourrait, dites-vous, être lié à la chlordécone. Oui, nous sommes champions du monde du cancer de la prostate, même si nous aurions préféré l'être d'autre chose ! C'est un fait incontesté. Peut-être est-ce dû à notre pigmentation différente, mais la différence n'enrichit-elle pas tout ? Dans ce cas, néanmoins, pourquoi l'Afrique n'est-elle pas elle aussi championne du monde en la matière ? Quid des autres pays touchés par la chlordécone ? C'est tout de même un point préoccupant. Sans doute s'explique-t-il pour partie par des raisons d'ordre génétique, mais nous ne saurions être de tels champions du monde qu'en raison d'une différence de pigmentation ! Pensez donc au jour où le lien entre chlordécone et récidive sera définitivement confirmé : que dira-t-on, en France, d'avoir soulevé un problème redondant pendant quarante-huit ans ?
Vous ne semblez pas favorable à un suivi sanitaire spécifique puisqu'il existe déjà, selon vous. En effet, il s'est très lentement mis en place au fil de ces quarante-huit années. Seriez-vous néanmoins favorable à un plan de prise en charge des effets sanitaires désastreux – s'ils sont finalement établis – de la chlordécone parmi les agriculteurs, les pêcheurs et la population générale de la Guadeloupe et de la Martinique ?
Le paysage français compte d'innombrables agences sanitaires : Santé publique France s'occupe de la surveillance, l'ANSES évalue les risques chimiques, l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) est chargée des médicaments. La Haute Autorité de santé, quant à elle, formule des recommandations de suivi particulier de certaines pathologies dans certaines populations. Pour avoir une réponse à la question de l'opportunité d'un suivi sanitaire spécifique de la population, mieux vaut donc saisir la Haute Autorité, car Santé publique France n'est pas en mesure de l'apporter. Le champ des agences sanitaires françaises est ainsi fait : il appartient à chacune d'entre elles de répondre à la question qui lui est posée.
Sans langue de bois aucune, en effet, il n'est pas de notre compétence de répondre à cette question.

C'est la réponse que j'attendais, avec tout le respect que j'ai pour votre travail. Santé publique France s'acquitte très bien de sa mission, de même que l'INSERM et l'ANSES. Où est cependant la transversalité qui permettrait de coordonner un travail prospectif de prise en charge, notamment lorsqu'il se produit un tel drame. Nous en prenons acte.
Permettez-moi une question plus personnelle qui s'adresse non seulement aux responsables de Santé publique France mais aussi aux spécialistes que vous êtes. Nous avons intégré le drame, dans la douleur et les blessures. Seriez-vous donc favorables à une prise en charge sanitaire spécifique ? Je dis bien prise en charge et non surveillance : nous avons déjà été assez surveillés !
Admettons par exemple que je sois chlordéconé. J'aurai les moyens, et la rapporteure aussi, de payer le test, qui coûte 68 euros en Guadeloupe et en Martinique, mais certaines personnes ne peuvent même pas payer 10 euros ! Ne peut-on pas envisager la prise en charge de ces tests, qui ne devrait pas coûter grand-chose ? Il faut certes éviter de susciter une psychose. Quelle est votre position ?
Autre exemple en matière économique : certains agriculteurs n'ont pas de difficulté à payer par leurs propres moyens les tests pour vérifier l'imprégnation des sols ; d'autres ne le peuvent pas. Les subventions octroyées à ces fins par l'État et les collectivités ne sont pas toujours versées. À titre personnel, monsieur Rosine – et en tant que Martiniquais, comme semble l'indiquer votre patronyme –, seriez-vous favorable à un plan de prise en charge spécifique, dont le contenu resterait à définir ?
Je pense avoir répondu à cette question en indiquant plus tôt l'intérêt que présente la chlordéconémie sur le plan épidémiologique mais aussi individuel. La mise en place d'un plan de prise en charge devrait se fonder sur un risque potentiel, mais comment le mesurer ? Par une chlordéconémie ? À ce stade, personne ne sait l'interpréter. Si des tests sont proposés dans le cadre d'une prise en charge du diagnostic, ils doivent pouvoir s'accompagner d'une réponse médicale. Nous serions dans le flou en annonçant à des personnes qu'elles ont telle ou telle concentration de chlordécone dans l'organisme sans pouvoir attester qu'elles présenteront une pathologie. Nous ne recommandons donc pas cette prise en charge systématique de la population générale.

La concentration de chlordécone, nous avez-vous dit, disparaît au terme de six mois sans consommation de produits imbibés, comme le montrent des tests réalisés sur des bovins. Le test pourrait permettre non seulement d'établir le caractère infime de la concentration chez telle ou telle personne, mais aussi de formuler des recommandations concernant les lieux de provenance des produits à ne pas consommer, et ainsi de suite. N'êtes-vous pas favorable à un accompagnement dynamique de la population ?
Nous sommes favorables à l'accompagnement de la population ; il a commencé et doit se poursuivre. En l'occurrence, il s'agit d'un accompagnement financier sous la forme d'un remboursement du test de dosage. Nous l'avons dit : la population est imprégnée à 95 %. On sait désormais – et cette connaissance s'affine avec le temps – quelles sont les mesures à prendre pour éviter la contamination et pour réduire l'imprégnation. Appliquons déjà ces mesures avant d'agir sur le test de dosage qui, plutôt que d'éclairer les patients, risquera de les perturber. Appliquons également les recommandations alimentaires : il est avéré que certains produits sont plus à risque que d'autres et, pourtant, les populations continuent de les consommer. Tâchons de comprendre la dimension sociologique des comportements de personnes très exposées qui, sciemment, continuent de prendre des risques. C'est en travaillant sur ces points que nous améliorerons la prise en charge de la population. En revanche, la prise en charge financière et du remboursement d'une chlordéconémie ne relève pas de notre compétence et je ne peux répondre sur ce sujet. Il faut à mon sens privilégier l'amélioration des connaissances et l'application de pratiques limitant l'exposition.
Le paraquat est un herbicide qui a été fortement utilisé aux Antilles jusqu'en 2007, date de son interdiction. En raison de son caractère organochloré et de sa rémanence dans les sols, cette molécule pourrait présenter un risque potentiel pour la santé. L'exposition directe et aiguë présente un risque direct avéré, par inhalation ou contact cutané. Est-ce qu'à l'image du chlordécone, le paraquat passe dans la chaîne alimentaire et se retrouve dans nos assiettes ? Les premiers travaux consistant en une cinquantaine de prélèvements réalisés en Martinique et en Guadeloupe n'ont pas permis de détecter cette molécule dans les eaux. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle n'y est pas présente ; qui ne cherche pas ne trouve pas. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de l'étude Kannari 2 pour laquelle nous espérons obtenir un financement, nous ne chercherons pas, en lien avec l'ANSES, à établir la présence du seul chlordécone mais aussi d'autres molécules contenues dans des pesticides utilisés au cours des dernières années. Le paraquat pourrait en faire partie, sous réserve que les techniques biologiques soient assez efficaces pour en détecter la présence en doses infimes.

Ce travail sur ce que l'on appelle l'effet « cocktail » est une excellente nouvelle. Nous vous remercions pour la clarté, la précision et la franchise de vos propos, dans un contexte pourtant difficile.
La réunion s'achève à quinze heures quarante.
————
Membres présents ou excusés
Réunion du lundi 1er juillet 2019 à 14 h 05
Présents. – Mme Justine Benin, M. Raphaël Gérard, Mme Claire Guion-Firmin, M. Serge Letchimy, M. Didier Martin, Mme Maud Petit, Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon