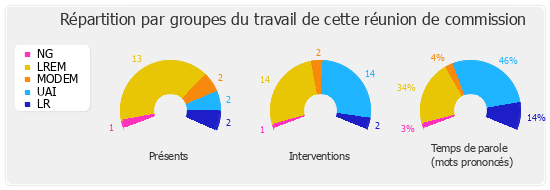Commission d'enquête sur l'égal accès aux soins des français sur l'ensemble du territoire et sur l'efficacité des politiques publiques mises en œuvre pour lutter contre la désertification médicale en milieux rural et urbain
Réunion du jeudi 19 avril 2018 à 8h30
Résumé de la réunion
La réunion
Jeudi 19 avril 2018
La séance est ouverte à huit heures trente.
Présidence de M. Alexandre Freschi, président de la commission d'enquête
————
La commission d'enquête reçoit en audition commune les ordres médicaux : M. François Arnault, délégué général aux relations externes du Conseil national de l'Ordre des médecins, et M. François Simon, président de la section exercice professionnel ; Mme Myriam Garnier, secrétaire générale et présidente de la commission de démographie du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; Mme Anne-Marie Curat, présidente du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes, Mme Sylvaine Coponat, trésorière, et M. Jean-Marc Delahaye, responsable des relations institutionnelles et des affaires européennes ; Mme Carine Wolf-Thal, présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, et M. Alain Delgutte, président du conseil central des pharmaciens titulaires d'officine.

Notre commission s'est constituée le 29 mars dernier et elle commence ses auditions en recevant les représentants du Conseil national de l'Ordre des médecins, du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes et du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, auxquels je souhaite la bienvenue.
Je précise que cette audition est ouverte à la presse.
Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les personnes entendues déposent sous serment. Je vous demande donc de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Les personnes auditionnées prêtent successivement serment.
Je donne la parole à un représentant de chaque Ordre pour une intervention liminaire, avant de passer aux échanges avec les parlementaires.
Vous avez reçu hier, avec un retard dont je vous prie de nous excuser, un document qui sert de trame à mon intervention.
Nous avons mené en 2015 une grande consultation sur les attentes et réflexions des médecins, à laquelle 35 000 d'entre eux ont répondu. Sur cette base, l'Ordre a fait, en janvier 2017, des propositions pour « construire l'avenir à partir des territoires », parmi lesquelles sa troisième priorité est « ouvrir et professionnaliser la formation des médecins ». Vous pouvez consulter ce document sur notre site.
En effet, le modèle actuel de sélection et de formation des futurs médecins ne répond manifestement plus aux besoins des territoires. À l'évidence, un jeune praticien s'installe rarement dans un territoire qu'il ne connaît pas ; aussi faut-il tout mettre en oeuvre pour que le parcours de formation soit étroitement lié aux territoires et non plus centré sur l'hôpital.
Dès le lycée, il convient d'informer et d'inciter les jeunes des territoires en difficulté à s'orienter vers les études de médecine. Or ils subissent un handicap par rapport à ceux qui habitent près d'une faculté.
La première année commune aux études de santé (PACES) doit être réformée afin de modifier le mode de sélection. Les stages de découverte en premier cycle doivent débuter très tôt et les stages du second cycle doivent être professionnalisants et permettre de découvrir le travail en équipes et toutes les formes d'exercice. Ils doivent se passer sur des territoires, et ceux-ci pouvant être éloignés de l'université, il faudra réorganiser le temps universitaire pour permettre que ces stages soient plus longs. S'il est possible d'être à l'hôpital le matin et à l'université l'après-midi dans une ville universitaire, ce ne l'est pas ailleurs. Il faudra aussi trouver des solutions pour financer les déplacements et l'hébergement des stagiaires. On a évoqué des internats ruraux, mais des internats urbains aussi sont envisageables.
À la suite de l'internat, on pourrait mettre en oeuvre très rapidement un post-diplôme d'études spécialisées (DES), sur le type de l'assistanat hospitalier, sous forme d'assistants dans les zones déficitaires.
S'agissant de l'exercice, on sait que les médecins ne veulent plus exercer seuls. Ils privilégient l'exercice regroupé, si possible en équipe. Ces regroupements, qu'ils soient physiques, sur un site ou plusieurs, permettent de mutualiser les moyens, le personnel d'accueil, la gestion administrative du cabinet. Ils facilitent l'organisation de la continuité des soins, qui n'est pas assurée, et qui permet d'éviter des hospitalisations qui n'étaient pas nécessaires. Toutes les formes de regroupement doivent être encouragées, non seulement sous la forme matérielle de maisons de santé, mais aussi des regroupements virtuels et multisites. Les outils informatiques, les moyens juridiques, techniques, réglementaires, sont disponibles pour autoriser ces échanges. Contrairement à une idée reçue, l'Ordre refuse très peu d'ouvertures de sites secondaires dans le cadre du multisites. C'est d'ailleurs moins compliqué qu'on ne le dit et nous avons engagé des travaux pour simplifier encore les démarches.
Mais cet exercice sur le territoire ne peut se faire que si le praticien a un accès facile aux plateaux techniques – biologie et radiologie, bien sûr – et à des spécialistes de second recours – cardiologues, oto-rhino-laryngologistes (ORL) – ainsi que l'appui d'un centre hospitalier ouvert.
Il faut encourager toutes les solutions innovantes. François Arnault a répertorié toutes celles qui fonctionnent bien. En général, elles sont proposées et mises en oeuvre par des leaders. Aussi vaut-il la peine de réfléchir à intégrer dans le cursus des médecins une formation au leadership à la fois dans une équipe médicale, mais aussi s'agissant de la réflexion sur le système de santé, ce que nous pratiquons moins que ne le font les Anglo-Saxons.
Il faut aussi évidemment décloisonner le secteur public et le secteur privé dans les territoires et les faire travailler en synergie. Ils ne sont pas concurrents mais complémentaires.
Enfin, n'oublions pas que si la désertification concerne les zones rurales, bien des zones urbaines connaissent aussi de grandes difficultés.
Comme vous le voyez, cette introduction a été centrée sur la formation. À nos yeux, c'est le pont capital.
Je m'occupe de la démographie des chirurgiens-dentistes depuis 2007 et je dois avouer que depuis cette date, j'ai constaté très peu d'évolutions.
Nous sommes environ 43 000 chirurgiens-dentistes en exercice, avec une densité de 65 pour 100 000 habitants, qui évolue de façon positive, contrairement à une prévision de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère de la santé de 2007, qui projetait une densité de 27 chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants en 2030. La moyenne d'âge est de 44 ans pour les femmes et de 55 ans pour les hommes, et la profession se féminise énormément, comme celle des médecins. Une préoccupation est l'arrivée massive de chirurgiens-dentistes, européens et français, à diplôme européen. Depuis quatre ans, 37 % des primo-inscrits sont dans ce cas, ce qui bouscule le numerus clausus. C'est en quelque sorte une promotion entière qui se forme hors de notre territoire.
Notre principal souci est donc plutôt le maillage territorial et la répartition des cabinets. Je mentionne d'abord ce qui fonctionne. Depuis dix ans, nous avons créé dix unités odontologues dans des régions dépourvues de faculté de chirurgie dentaire. Il s'est avéré que les étudiants, malgré leur désir initial de rester près d'un centre urbain, finissent par s'expatrier. Nous avons commencé par une unité à Dijon en 2008. Il apparaît que 30 % à 40 % des étudiants restent et font leur vie sur place. On a donc réussi à la délocaliser. Deux projets sont en cours, au Mans et à Tours. Les doyens des facultés laissent partir leurs étudiants, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Nous souhaitons aussi un renforcement de la coordination entre le centre hospitalier universitaire (CHU) et les cabinets de ville, pour mieux prendre en charge des pathologies bucco-dentaires spécifiques et mieux réguler l'accès aux soins. Nous sommes aussi très favorables à la création des maisons de santé pluriprofessionnelles car actuellement, l'exercice isolé devient impossible pour le chirurgien-dentiste étant donné le plateau technique nécessaire. C'est donc là un mode d'exercice d'avenir.
Nous avons été très satisfaits de récupérer en 2013 les contrats d'engagement de service public (CESP) créés par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST). Nous avons attribué tous nos contrats, soit une centaine de bourses d'étude et tous semblent avoir été respectés.
Nous avons également proposé d'intégrer plus vite nos étudiants de sixième année dans la profession par un stage actif de 250 heures – voire de 600 heures – dans un cabinet dentaire. Nous aimerions aussi que la mise en place du service sanitaire de trois mois dont on a parlé récemment permette à nos étudiants de faire de la prévention et de connaître le terrain. Depuis cinq ou six ans, nous demandons aussi la création d'un tutorat d'un an dans des zones peu denses, pour permettre l'exercice d'un junior sous la supervision d'un senior.
Nous envisageons d'instaurer une inscription provisoire au tableau, qui pourrait être liée au tutorat, pour tout nouvel arrivant, afin de déceler les situations d'insuffisance professionnelle préjudiciables et permettre d'effectuer les stages obligatoires liés à l'obtention d'une autorisation ministérielle.
Nous attachons aussi une grande importance au développement des soins en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), où les soins bucco-dentaires sont un souci majeur.
Enfin, nous commençons seulement à travailler au développement de la télémédecine et des objets non connectés.
La profession de sage-femme est une profession médicale à compétence définie et cette compétence, ciblée sur la grossesse a été élargie par la loi HPST au suivi gynécologique de prévention pour les femmes en bonne santé. Le ministère avait voulu, par cette mesure, anticiper sur la désertification médicale que nous constatons. Par leur formation initiale, leur connaissance de la physiologie féminine, l'enseignement théorique qu'elles reçoivent en gynécologie, sur la contraception et l'interruption volontaire de grossesse (IVG), soit plus de 240 heures, les sages-femmes étaient bien désignées pour ce rôle. Leur formation en stage comprend aussi 420 heures de prise en charge gynécologique. Depuis 2009, il y a eu effectivement une hausse de la prise en charge de la santé gynécologique par les sages-femmes, notamment les sages-femmes libérales.
À ce propos je rappelle que nous avons 29 000 inscrits à l'Ordre et 23 000 sages-femmes en activité, et que la profession connaît une évolution importante vers l'exercice libéral, soit 30 % désormais, contre 51 % de personnel des hôpitaux et cliniques. Selon les derniers chiffres de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), il y a eu une montée en charge de l'activité gynécologique de prévention. Cependant, le zonage établi il y a quelques années à la demande des syndicats se révèle un frein, car il avait été établi sur le seul nombre des naissances et non sur la demande de soins des femmes. Or la sage-femme ne fait pas seulement des suivis de grossesse, mais aussi une activité de suivi, de contraception, de dépistage et de vaccination. Nos syndicats professionnels négocient actuellement avec la CNAMTS pour revoir ce zonage devenu obsolète. Cela permettrait d'élargir l'offre de soins pour répondre à la demande.
Dans ce même esprit, de réponse à la demande, la loi de santé de 2016 a élargi les compétences des sages-femmes en ce qui concerne la prise en charge de l'IVG médicamenteuse. Mais beaucoup de sages-femmes en libéral nous disent avoir des difficultés à exercer cette compétence, car elles doivent pour cela signer une convention de partenariat avec les centres hospitaliers à proximité et beaucoup de centres refusent. Les sages-femmes seraient également d'accord pour que leur compétence soit étendue à l'IVG instrumentale afin de pouvoir répondre plus rapidement à la demande des femmes. Globalement, cette extension de compétences éviterait à certaines de perdre la possibilité d'obtenir ce qu'elles demandent.
Si je résume nos demandes, par rapport à la densité médicale, il est important que la CNAMTS révise le zonage pour permettre des installations ; nous demandons que les sages-femmes qui s'installeront dans les zones en voie de désertification obtiennent des aides comme celles qui ont été accordées aux médecins. Pour améliorer l'offre de soins, il est aussi fondamental de renforcer la coopération interprofessionnelle, améliorer l'articulation entre médecine de ville et hôpital et l'information des patients sur le rôle de chaque professionnel de santé. Beaucoup de femmes ne connaissent pas les compétences de la sage-femme pour assurer le suivi gynécologique tout au long de leur vie. Bien entendu, la sage-femme exerce une profession médicale à compétence définie, donc dès qu'il y a une pathologie, elle oriente la personne vers le médecin. Or il arrive que dans des zones où une consultation médicale est difficile, des personnes présentant une pathologie s'adressent directement à une sage-femme. Celle-ci se trouve en difficulté car sa compétence propre lui interdit de prendre en charge cette personne et il n'y a pas de médecin vers qui la réorienter : il importe donc de favoriser la communication en santé pour que les compétences de chacun soient bien connues.
Les sages-femmes demandent aussi de pouvoir prescrire aux couples, par exemple pour la surveillance des infections sexuellement transmissibles (IST), le suivi tabacologique, la surveillance vaccinale. La loi de 2016 a donné compétence aux sages-femmes pour vacciner aussi l'entourage de la personne prise en charge. Mais il faudrait améliorer ses possibilités de prise en charge complète du couple.
Pour ma part, je vous donnerai plutôt une bonne nouvelle : il n'y a globalement pas de problème d'accès aux pharmacies dans notre pays, grâce à leur répartition homogène, même si certaines officines sont fragilisées, notamment par le départ ou le transfert d'un médecin. Grâce à ce maillage territorial harmonieux, les pharmaciens contribuent à l'accès égal aux soins pour tous les Français. Ce maillage homogène est le résultat de règles d'établissement des officines qui ont fait leurs preuves et qui ont récemment été révisées sur certains points afin de l'optimiser dans les zones fragiles. Rappelons aussi que tous les pharmaciens sont approvisionnés en médicaments en moins de 24 heures grâce à un système de répartiteurs organisé sur tout le territoire. Sur les 8 200 communes ayant une ou plusieurs pharmacies, 419 n'ont pas de médecin. Le pharmacien y assure donc un rôle de premier plan dans l'accès aux soins, qui serait plus important encore en cas d'élargissement de ses missions. Il joue déjà un rôle social d'orientation dans le parcours de soins. Quatre millions de Français franchissent chaque jour la porte d'une pharmacie, qui est souvent leur seul point d'accès aux soins.
Nous nous posons cependant une question à propos des maisons de santé, que le gouvernement veut favoriser. C'est une bonne chose pour l'accès aux médecins, mais leur regroupement dans les bourgs peut fragiliser des officines de certains villages. Nous demandons donc aux directeurs d'agences régionales de santé (ARS) de manifester une certaine vigilance et d'impliquer les pharmaciens dans la création de ces pôles.
L'Ordre couvre l'ensemble des pharmaciens, pas seulement l'officine. Pour les biologistes, avec la financiarisation de la biologie médicale, il pourrait y avoir un risque quant à la présence d'un laboratoire dans certains sites et donc d'accès aux analyses. Pour les soins non programmés, la nécessité éventuelle d'obtenir une analyse biologique en moins d'une heure serait compliquée si le plateau technique est éloigné.
Les pharmaciens représentent donc une force, et ils sont en mesure de faire des propositions pour améliorer l'accès aux soins : la possibilité de renouveler certaines prescriptions ; la prise en charge de pathologies bénignes, avec information et validation du médecin ; les cabines de téléconsultation dans les pharmacies ; la vaccination, à laquelle les pharmaciens commencent à contribuer par une expérimentation en Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine et dont la ministre a annoncé l'extension dès 2019.

Je vous remercie de votre contribution aux travaux de notre commission. Nous avons souhaité vous entendre ensemble au nom de l'interdisciplinarité – vous avez d'ailleurs parlé de mise en réseau. Mais je ne vous ai pas beaucoup entendus, les uns et les autres, parler d'urgence. Or le sujet est devenu brûlant pour les parlementaires, dont une trentaine sont venus vous entendre. Elle l'est aussi pour la société, car les questions s'accumulent.
Volontiers. L'urgence, c'est d'une part la garde, soit une mission de service public selon une réglementation qui définit un créneau horaire, de 20 heures le soir à 8 heures le matin. Mais je pense que vous parlez plutôt de l'accès, dans la journée, aux soins.

Quelles sont les mesures à prendre à court terme, alors qu'on constate que le problème de l'accès aux soins s'aggrave ? Pour ce qui est de la garde, on y viendra peut-être dans les questions.
La question est compliquée : en fonction de la démographie médicale, de l'organisation des cabinets, du fait que les médecins reçoivent pour la plupart sur rendez-vous, comment dégager des créneaux horaires pour s'occuper de soins non programmés ? Il s'agit donc de ce que nous appelons la continuité des soins. Nous avons été interrogés sur le sujet par une commission récemment, nous travaillons sur le sujet. Il faudra probablement des incitations, une contractualisation peut-être comme dans le cadre des maisons de santé. Il n'y a pas de remède miracle. On peut penser à un assistanat pour étoffer l'offre.

Vous pensez à des internes de troisième année qui pourraient s'installer auprès de médecins ?
En effet, la situation dans les territoires est assez grave et il faut certainement prendre des mesures d'urgence. Nous en avons proposé une, qui figure de façon peut-être trop discrète dans la note que nous vous avons communiquée. Il s'agit des postes d'assistants de territoire, libéraux, en parallèle avec les postes d'assistants de spécialité de médecine générale des hôpitaux proposés plutôt à de jeunes médecins qui ont la thèse et en post-DES. Cette mesure est relativement facile à mettre en place. Notre proposition s'assortit d'un volontariat. Ce n'est pas à nous d'aller plus loin, et nous n'avons pas senti vraiment un agrément chez nos jeunes confrères. C'est une mesure d'urgence facile à mettre en place dans des territoires où des patients ne trouvent pas de médecin. De plus, cela peut ancrer des médecins qui ont terminé leurs études dans le territoire où ils ont suivi leur formation et accélérer leur installation.
Oui.
Non, mais cela serait facile en mettre en oeuvre. Qu'il s'agisse d'un médecin ou d'un assistant de territoire, le financement par l'assurance-maladie est tout à fait possible.
Quel peut-être le rôle des pharmaciens dans l'urgence ? Écartons la véritable urgence qui doit être dirigée vers l'hôpital. Mais il y a des soins non programmés, le patient ressentant l'urgence d'avoir un avis médical. Certains patients viennent dans les officines puis, car ils n'ont pas la gratuité des soins, se rendent aux urgences, contribuant à leur engorgement. Il y a là un aspect économique. Le pharmacien pourrait jouer un rôle de tri, en orientant vers les urgences, vers une consultation, ou même une téléconsultation comme c'est le cas en Suisse avec le dispositif netcare : avec cet encadrement par des médecins si nécessaire, le pharmacien peut prendre en charge des pathologies bénignes. D'autre part, le système de garde pour les pharmaciens, c'est sept jours sur sept, 24 heures sur 24, sur tout le territoire.

La présidente de l'Ordre des pharmaciens a dit que leur maillage était cohérent, grâce à la réglementation des installations, et en tant que maire d'une commune rurale, je peux en attester. Il n'y a pas de problème pour les pharmacies. Pourquoi ne pas utiliser le même dispositif pour les médecins ? Cela vaut aussi pour d'autres professions, comme les infirmières, dont il est dommage qu'elles ne soient pas représentées aujourd'hui.
Nous ne sommes pas surpris par votre question. Étant aussi maire d'une commune rurale, je parle les deux langues. Il est vrai que la question de la répartition des pharmacies sur le territoire est réglée. Quant à exercer une incitation forte, voire une coercition, pour envoyer les jeunes médecins dans les campagnes, nous ne sommes pas convaincus qu'ils entreront par la porte qui leur sera montrée.
C'est qu'ils ont d'autres choix, si on leur ferme l'installation en cabinet. Les hôpitaux sont de gros recruteurs de médecins généralistes. Si on leur refuse une installation en libéral là où ils le souhaitent au motif que l'offre est déjà suffisante, il n'est pas sûr qu'ils aillent pour autant là où elle ne l'est pas. Les portes des hôpitaux leur sont grandes ouvertes.

En effet, on oublie trop qu'aujourd'hui, 52 % des médecins exercent à l'hôpital et 48 % en ville. L'hôpital est donc le principal concurrent de la médecine de ville. Croire que plus on exercera de pressions sur les étudiants en médecine, moins ils s'installeront en ville, c'est une fausse bonne idée.
Monsieur le président Simon, je vous ai lu et écouté avec attention. Vous n'avez pas évoqué le statut du médecin et la possibilité d'exercer à la fois en libéral et en salarié à l'hôpital ou dans un centre de santé, ce qui procurerait beaucoup de souplesse. Vous n'avez rien dit non plus du statut social du médecin libéral, par exemple les problèmes que connaît une jeune femme médecin – aujourd'hui, 70 % des jeunes diplômés dans ce secteur sont des femmes – étant donné les conditions de prise en charge de la maternité. Vous n'avez pas non plus évoqué la prise en charge des soins, avec un délai de carence de 90 jours pour un médecin libéral qui s'installe – quand, dans la fonction publique, on débat d'un jour de carence… Vous avez évoqué les maisons pluridisciplinaires. Elles font l'objet d'un effet de mode. Madame la ministre de la santé envisage d'en doubler le nombre. Elles valent « un million pièce ». Dans mon département, il y en treize, et une seule a réussi à attirer de nouveaux praticiens. Elles offrent certes des conditions d'exercice plus confortables aux praticiens, mais pour ce qui est d'attirer de nouveaux professionnels de santé, le résultat n'est pas évident. Quel est votre avis ?
Enfin, si l'essentiel est la formation, elle prend du temps. Comment, en attendant, envisagez-vous le partenariat avec les sages-femmes, les pharmaciens et des paramédicaux comme les infirmiers de pratiques avancées ?
Sur le statut mixte du praticien, à la fois libéral et salarié, la réglementation n'est pas un obstacle, à cette réserve près que le praticien hospitalier est théoriquement à plein temps, sauf dérogation. En tout cas, il n'y a pas de problème du côté de l'Ordre.
Sur la couverture sociale, par exemple sur la maternité, des progrès ont été faits, mais il faudra en faire d'autres. Nous parlions par exemple d'un statut de l'assistant de territoire, qui peut être un élément de transition.
En ce qui concerne les maisons de santé, nous avons soutenu l'idée et la mise en place des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA). Mais nous avons toujours dit que ce n'était pas une panacée. Nous sommes très favorables à l'exercice regroupé, physique ou virtuel. Bien sûr, les maires veulent toujours avoir leur médecin dans la commune, mais des médecins isolés, il n'y en aura plus, il faut le savoir. Nous promouvons cette idée, car c'est la seule manière d'assurer une continuité des soins non programmés.
Nous nous parlons, avec les paramédicaux. Pendant un an, j'ai participé au comité de pilotage mis sur pied par la direction générale de l'offre de soins (DGOS), qui devrait aboutir rapidement à un décret sur les pratiques avancées pour les infirmières. Mais il ne faut pas rêver : les pratiques avancées concerneront, d'ici quelques années, 3 000 à 4 000 personnes, dont les deux tiers à l'hôpital. C'était une aspiration des infirmiers, un besoin pour les patients et les médecins, mais pas une solution pour demain matin. Nous rencontrons aussi les sages-femmes. Quant aux pharmaciens, nous avons entrepris, avec la nouvelle présidente, un travail sur notre coopération.

Monsieur le président Simon, vous avez parlé de la complémentarité entre le public et le privé. Mais quels seraient les secteurs gagnants, et s'agissant du secteur hospitalier, comment cela se ferait-il de façon équitable ?
Je prends deux exemples de réorganisation et d'amélioration de l'offre sanitaire. À Belle-Île, il ne restait que trois médecins généralistes. La création d'un hôpital local a permis qu'un généraliste, qui avait cessé d'exercer sur le continent, installe un cabinet communiquant avec l'hôpital, où il exerce des fonctions hospitalières et d'urgence tout en ayant sa clientèle privée. Depuis, l'île est passée à dix médecins généralistes, surtout des jeunes des facultés de Rennes et de Nantes, encouragés par l'amélioration des conditions locales et par une organisation des horaires lisible. Ce système, qui implique les collectivités, pourrait être repris ailleurs.
À Nogent-le-Rotrou, un hôpital public qui avait perdu son plateau technique de chirurgie a réussi, sous l'impulsion d'un leader – c'est toujours le cas – à rouvrir dans ses locaux un service de chirurgie ambulatoire exercé par des praticiens libéraux qui viennent du Mans et de Chartres…
Je veux bien, je vous fais entièrement confiance. Ce que je relate ici, c'est ce que le docteur Champeau m'a encore dit hier au téléphone, à savoir que des praticiens libéraux viennent du Mans et même de Paris. Il n'y avait plus de chirurgie, et il a réussi à récréer, avec vous, une offre de soins avec des spécialités comme la cardiologie et d'autres. Je reprendrai contact avec lui.
Il y a d'autres exemples. Sur le site de l'Ordre, sous l'encart « initiatives réussies », vous trouverez une liste, non exhaustive, de ces cas où des médecins ont réussi à maintenir, et le plus souvent améliorer l'offre de soins sur des territoires en difficulté. Il s'agit de jeunes médecins et dans ces expériences, les stages professionnalisants ont été un levier de fixation très important.

Un médecin généraliste maître de stage a plus de chances de trouver un remplaçant et peut-être même un successeur. Quel est le pourcentage de généralistes qui le sont, et avez-vous des pistes pour lever les obstacles qui en empêchent un plus grand nombre de le devenir ?
Je ne peux vous donner le nombre, mais nous le demanderons à notre service chargé de la démographie. C'est assez compliqué à répertorier, nous avons du mal à l'obtenir des facultés. C'est bien évident, on ne s'installe pas par hasard. Disposer d'un maillage départemental de maîtres de stage est donc fondamental. Certaines facultés sont mieux organisées que d'autres pour cela. C'est important pour les généralistes, mais aussi pour les médecins de second recours, les spécialistes. Beaucoup a été fait, mais il faut aller plus loin, car c'est un passage obligé. Dans nos propositions, nous demandons que le stage commence beaucoup plus tôt. Vous mentionnez ici du stage pour les internes, mais il faut que le second cycle, qu'on est en train de réformer, soit plus professionnalisant. Un problème, que nous allons voir avec les doyens, est celui du séquençage : pour être à 200 kilomètres de la faculté il faut par exemple un rythme de quelques jours, régulièrement, à la faculté. Et sur place, il faut se soucier de l'hébergement, du loyer. Il y a une réflexion générale à avoir avec les élus. On a parlé de prise en charge des transports, d'internats ruraux car le problème de l'accès aux territoires concerne aussi les dentistes, les pharmaciens.
Les solutions d'hébergement viendront des territoires eux-mêmes. Tous leurs responsables doivent y travailler.

Le numerus clausus pour 2018 est de 8 205 nouveaux médecins. Or il semble qu'entre le quart et le tiers des médecins diplômés n'exercent pas, soit au moins 2 000 entre eux sur la promotion 2018. C'est un vrai problème. Le type de sélection qui conduit aux études de médecine n'est-il donc plus approprié, pour qu'on en arrive à cette déperdition ?
Là encore, vous trouverez des éléments dans les résultats de la grande consultation que nous avons organisée, à laquelle 35 000 médecins ont répondu. Il y a en effet un problème de recrutement. La PACES, qu'on suit juste après le bac, est discutable et n'a pas les bons critères de sélection garantissant que, quelques années plus tard, les diplômés choisissent une carrière dans le soin, ce qui explique aussi une certaine perte. Une réflexion expérimentale est en cours à Angers et à Brest – où elle sera mise en place à la rentrée prochaine – sur un nouveau type de sélection qui offrira une seule possibilité d'admission au premier concours, le tiers des étudiants qui restent étant orientés vers des études plus larges, mais pouvant réintégrer ultérieurement le cursus, sur dossier. On pourrait peut-être par ce moyen laisser entrer des gens qui n'entraient pas par le concours classique mais ont peut-être plus d'aptitudes, de manière à éviter le problème que vous soulevez, qui est réel.

Je reviens sur l'urgence. Dans ma circonscription, très urbaine, de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, le manque de médecins est aussi fort qu'en zone rurale. Or le territoire est jugé attractif. Vous avez évoqué la possibilité de trouver des étudiants en post-DES, auxquels il faudrait trouver un statut, mais sur la base du volontariat. Je m'interroge sur ce dernier critère. J'ai cru déceler dans vos propos que peut-être les maisons de santé n'étaient pas la solution, mais qu'il fallait des regroupements, toujours sur cette base du volontariat. Or nous sommes en situation d'urgence. Que faire, maintenant, pour trouver des médecins, en zone rurale mais aussi en zone dense attractive ?
Je précise : je n'ai pas dit que les maisons de santé n'étaient pas la bonne solution, mais que ce n'était pas la seule solution.
En effet, le problème existe aussi dans certaines zones urbaines, et parfois de façon plus grave. En effet, les populations y sont plus défavorisées qu'en zone rurale, et l'accès aux soins y est gravement mis en cause. La mesure d'urgence, c'est de dire aux étudiants en médecine qui ont soutenu leur thèse qu'il faut exercer pour aider la population. Les doyens ont abouti à la même solution que nous, sous la forme d'un service civil. Les médecins ayant soutenu leur thèse ne peuvent pas être insensibles au fait que des patients restent sans soins, et il faut les inciter à apporter leur contribution, pendant un certain temps. C'est la solution la plus rapide. Ensuite, tout ce qui porte sur la modification des études s'inscrit dans le temps plus long.

Il se trouve qu'à Versailles-Saint-Quentin, nous avons beaucoup d'avantages, dont une université, ce qui simplifie le problème des stages. Et pourtant, nous ne trouvons pas plus de solutions qu'ailleurs. Est-ce que, dans l'urgence, il ne va pas falloir en venir à une certaine contrainte ?
Sur la contrainte, je n'ai pas de commentaire à faire.

Le constat, c'est qu'on s'attend à une diminution de 25 % du nombre de généralistes d'ici 2025, et cela fait quinze à vingt ans que nous – j'étais généraliste – tirons la sonnette d'alarme. Mais quelle image ont les étudiants du médecin généraliste, en faculté ? Elle est plutôt délétère. L'hypersélection par les maths a peu à voir avec la vocation. Avec le numerus clausus, on ne forme pas assez de médecins. Et à force de charger la barque, les confrères en ont assez, ils veulent aussi s'arrêter à heure fixe pour s'occuper de leur famille. Quant aux urgences, où l'on est passé en dix ans de dix à vingt millions de patients, ce n'est pas seulement une question économique : les gens vont travailler de plus en plus loin, quand ils rentrent à 19 heures il n'y a plus de cabinet ouvert, ils vont aux urgences, plutôt que de perdre leur journée du lendemain. C'est donc aussi un problème d'offre de soins. Ne devrait-on pas mettre des généralistes aux urgences ? Il y a un problème de génération, les jeunes ne veulent plus faire soixante à soixante-dix heures par semaine comme nous le faisions, ils veulent être salariés et avoir un temps médical défini. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre, comme, devant l'inflation de maladies chroniques, le recours aux infirmiers avec le système ASALEE – acronyme d'« action de santé libérale en équipe » – et aux pharmaciens.
Bien sûr, toutes les initiatives sont bonnes à prendre et c'est par l'exercice regroupé sur le terrain qu'on va pouvoir s'organiser. Nous devons le faire tous ensemble, il faut que tout le monde s'implique. Nous avons par exemple lancé l'idée de bassin de proximité de santé. La solution ne tombera pas de Paris, et les médecins qui manquent, nous ne les avons pas dans la poche. Personne n'a de solution immédiate pour en envoyer comme cela, dès demain.

Je me félicite de cette initiative car le Périgord vert, où je suis élu, est dans un état très grave, en pré-coma. Par exemple, des personnes qui étaient venues se fixer à Nontron sont reparties faute de trouver un médecin référent. Il faut agir vite. Les maisons de santé ne sont pas le seul outil pour cela, mais surtout il ne faut pas les réduire à un dossier immobilier, il faut que l'initiative parte des médecins. Chaque fois qu'on a fait une maison de santé sans impliquer les professionnels et paramédicaux, cela a été un échec.
Je vous remercie de dire ce que nous disons depuis le début. Une maison de santé, c'est d'abord un projet, pas seulement des médecins, mais des professionnels qui veulent travailler ensemble. Le médecin n'en est pas forcément l'initiateur, celui qui va assumer le « leadership managérial » selon le terme qu'utilisent les infirmiers.

Vous dites qu'il faut s'organiser sur le terrain, j'en suis convaincue. Dans ma région, des professionnels le font dans le cadre de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Comment le Conseil de l'Ordre pense-t-il inciter à la diffusion de ces expérimentations, qui sont efficaces, et quelle responsabilité pourraient prendre les médecins sur leur territoire ?
Les médecins, comme les autres professionnels, ont leur part de responsabilité dans la prise en charge des populations. Il faut le transmettre pendant la formation, et, de façon urgente, assurer cette formation sur les territoires, pas seulement autour des universités. Dans le Finistère, deux tiers des étudiants viennent des environs de la faculté. Comme il y a aussi des maîtres de stage, cela ne se passe pas trop mal, mais les jeunes diplômés connaissent mal le territoire au-delà. Nous soutenons donc les CPTS, et l'Ordre reçoit la DGOS la semaine prochaine à ce sujet. La solution CPTS ne partira que du terrain.

Monsieur Simon, il est très bien de vouloir développer les stages pour les étudiants en médecine. Mais comment obliger, ou du moins convaincre les médecins en exercice de devenir maîtres de stage ? Il y en a trop peu et beaucoup, qui ont déjà assez de travail, n'y sont pas prêts.
Madame Garnier, vous avez évoqué le recours à la télémédecine pour les chirurgiens-dentistes. En quoi cela consisterait-il ?
Comment convaincre ? Excellente question. Il se trouve qu'il y a beaucoup de maîtres de stage dans certaines régions et peu dans d'autres. Cette situation est difficile à analyser : il y a un tissu local, des traditions, un mode d'organisation, là où l'exercice est déjà regroupé. Il y a une cinquantaine d'années, il y a déjà eu un maillage du territoire par ce qu'on appelait la médecine de groupe. L'explosion de la démographie médicale après 1968 a arrêté ce mouvement : de nombreuses communes d'un millier d'habitants qui n'avaient jamais eu de cabinet ont vu arriver un médecin isolé – ce sont ceux-là mêmes qui partent à la retraite aujourd'hui. Les départements où la médecine de groupe était en avance ont moins de problèmes aujourd'hui pour avoir une continuité des soins, des remplaçants et même des repreneurs, et des maîtres de stage, ce qui est plus facile que dans un cabinet isolé. Ensuite se pose le problème de l'hébergement des étudiants. La démographie médicale de l'Aveyron, par exemple, n'était pas meilleure que celle de ses voisins, mais les collectivités locales se sont organisées pour organiser l'hébergement, la faculté de Toulouse a promu des maîtres de stage, et cela a fonctionné pour compenser le déficit.
Sur la télémédecine, notre réflexion est embryonnaire. Il s'agit surtout de prévention et de consultation. Il existe déjà des cabinets équipés en caméras intrabuccales connectées à un professionnel compétent qui oriente vers un professionnel en fonction de la pathologie bucco-dentaire. Il faut le développer pour la répartition des soins et face à l'urgence dentaire.
Si les sages-femmes étaient reconnues comme professionnels de premier recours, par exemple pour la contraception, la pose de stérilet, le suivi gynécologique, cela libérerait du temps médical pour les généralistes. On pourrait cartographier cette complémentarité. Nous demandons cette reconnaissance.

Je m'interrogeais justement sur les pratiques avancées. Nos échanges ont porté sur le manque de médecins. Mais, en 2016, le Parlement a voté un texte qui offre à d'autres professionnels de santé la possibilité d'étendre leur exercice. Peut-être d'ailleurs notre commission recevra-t-elle l'Ordre des infirmiers, qui n'est pas présent aujourd'hui. N'est-ce pas là une piste pour répondre rapidement aux besoins et, même, en allant plus loin, établir des passerelles et former à la médecine des professionnels qui ont déjà fait des études médicales ?
C'est ce qu'apporterait une augmentation de compétence des sages-femmes. Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, elles pourraient avoir une compétence pour la vaccination, chez le nourrisson mais aussi pour le suivi chez l'enfant mais aussi toute personne. Il en va de même pour l'IVG instrumentale et la prescription, dans toute la population, de dépistage des IST.
La loi a prévu que les professionnels « auxiliaires » médicaux peuvent suivre une formation aux pratiques avancées de leur profession. Dans un premier temps, pour des raisons de proximité, ces pratiques avancées ne concernent que les infirmières. Un comité de pilotage a fait des auditions et défini le périmètre de ces pratiques. L'objectif est bien de soulager le médecin de certains suivis, par exemple pour des pathologies chroniques stabilisées. Pour les diabètes de type 2 par exemple, avec contrôle tous les trois mois et d'autres examens, il y a la possibilité de soulager le médecin de cette tâche chronophage, ce qui lui laissera plus de temps médical pour les soins non programmés. Le décret est en cours d'élaboration. Mais ce ne sera pas une solution pour demain, plutôt après-demain, dans quatre ou six ans. Par exemple, il existe deux formations, à Aix-Marseille et Saint-Quentin-en-Yvelines, mais tout reste à construire.

S'agira-t-il d'infirmiers liés à des médecins, ou auront-ils une certaine autonomie dans des territoires où il n'y a pas de médecin ?
Ces infirmiers feront obligatoirement partie d'une équipe de soins coordonnée par un médecin, ou dans un établissement médical ou médicosocial ou en assistance d'un médecin spécialiste. La demande est d'abord venue des services hospitaliers d'oncologie, pour les chimiothérapies ; le deuxième secteur est la néphrologie pour les insuffisances rénales ; ensuite il y a le gros contingent des maladies chroniques stabilisées. Un autre secteur en demande est la psychiatrie, mais cela pose d'autres problèmes, sur lesquels la réflexion est en cours.
On pourrait gagner très vite du temps médical, en se reposant sur l'expertise des pharmaciens en matière de médicament. En ce qui concerne les patients chroniques, on peut renouveler des ordonnances, ajuster les doses ; on peut renouveler, sur des pathologies aigues comme les rhinites allergiques que nous voyons en ce moment, renouveler le traitement prescrit l'année précédente. Et il y a les pathologies bénignes : le pharmacien a la compétence et fait déjà de la « bobologie ». Mais cela devrait être mieux encadré, en se mettant d'accord avec les médecins sur des arbres décisionnels permettant d'aller plus loin dans la prise en charge. Les compétences existent, il n'y a pas besoin de formation, mais de textes législatifs et réglementaires pour encadrer ces pratiques.
Le large champ de la prévention ne relève pas de l'urgence, mais comme je l'ai évoqué, le pharmacien a été formé dans le cadre de l'expérimentation de la vaccination contre la grippe et pourrait vacciner contre la rougeole, dont il y a une épidémie actuellement. Ces pistes peuvent être activées immédiatement. C'est au législateur d'ouvrir le champ des possibles. Et pour un avenir moins proche, des expérimentations de téléconsultation dans des pharmacies sont en cours dans le Roannais et dans le nord-ouest de la Vendée, qu'on pourrait facilement accélérer.

Nous n'avons pas abordé la question de l'intérim médical. A-t-il, selon vous, des conséquences sur la non-installation ? La pénurie fait que les vacations sont bien plus élevées dans les hôpitaux que les salaires des personnels en poste. Est-ce que cela joue ? Je préside le conseil d'administration d'un centre hospitalier rural et nous avons eu beaucoup de difficultés. La situation est stabilisée, mais les médecins en poste doivent s'investir énormément. Venir faire des remplacements demande moins de responsabilité et présente moins « d'inconvénients » que de s'installer, pour des spécialistes comme pour les généralistes.
Vous faites allusion, si je comprends bien, à cette catégorie de médecins que les hôpitaux embauchent comme « mercenaires »…
Une transition est en cours. Il est vrai que des hôpitaux dépensaient des sommes faramineuses pour faire venir des médecins, avec des sommets en radiologie et en anesthésie, en fonction de l'activité fournie, parfois dérisoire. Un plafond réglementaire vient d'être fixé et il faut réfléchir à une graduation des prises en charge dans certains services.
Concernant les généralistes, la situation est moins compliquée, mais elle justifie nos réserves sur des mesures coercitives. Les niveaux de salaire sont connus et pas vraiment en cause. Par exemple, pour être coordonnateur d'EHPAD, il y a une base de salaire. Mais l'offre de ces postes, ces dernières années, a provoqué une saignée dans l'effectif des généralistes dont certains ont opté pour un temps partiel, d'autres pour un temps plein. Mais pendant ce temps-là, ils n'assurent plus de soins. Une offre existe, on ouvre une porte, on s'y précipite, et cela dégarnit un peu les rangs.

Il existe des no man's lands médicaux, et cela pèse plus lourdement encore sur les personnes pour lesquelles a été votée la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Chacun de vous peut-il me dire, pour son ordre, ce qui est mis en place en France pour les personnes handicapées, notamment en exercice libéral ?
Nous avons beaucoup travaillé avec les associations. L'accès au cabinet est élémentaire, mais aussi l'adaptation du matériel. Il y a eu des situations tendues, nous avons essayé d'être médiateurs, d'accompagner, de promouvoir aussi des solutions. Évidemment, les choses avancent moins vite qu'il ne faudrait, mais nous essayons de poursuivre.
Nous venons de publier un rapport, consultable sur notre site, sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Nous avons dressé un inventaire national et nous avons eu la bonne surprise de constater que chaque département a son réseau pour l'accès aux soins.
Il y a l'accès au cabinet, comme pour les médecins, et les sages-femmes prennent en charge et suivent les femmes handicapées tout à fait comme les autres. Au moment de l'accouchement, elles s'adaptent. Il y a un service spécialisé à Paris. Mais nous sommes surtout dans la prévention et le dépistage.
Je vous remercie de cette question. Le fait même qu'il m'a fallu quelques instants pour trouver des réponses – elles existent – me laisse penser que nous ne faisons peut-être pas assez, en ce qui concerne l'Ordre. Je vais faire en sorte que nos efforts soient plus visibles sur notre site. Mais les réponses sont classiques : accès de l'officine, fourniture de matériels, déplacements à domicile.

Mme Wolf-Thal m'a répondu sur les officines de premier recours, mais je crois qu'il n'y a pas d'expérimentation en cours.
Madame Garnier, vous dites que 38 % des jeunes chirurgiens-dentistes installés ont un diplôme étranger. A-t-on ouvert le numerus clausus ou compte-t-on le faire ?
Nous maintenons le numerus clausus à 1 200 depuis trois ou quatre ans. Auparavant, les étudiants suivaient la voie classique de la PACES. Avec la directive européenne 2005-36 sur la reconnaissance automatique des diplômes, nos étudiants ont eu la possibilité de partir en Espagne et en Roumanie, deux pays où il n'y a pas de numerus clausus, puis en Belgique et au Portugal. Ils reviennent, plus nombreux que prévu, et c'est pour cela que nous n'augmentons pas le numerus clausus. Vont-ils dans les zones sous-dotées ? Ils se comportent comme les étudiants à diplôme français, sauf les praticiens de nationalité roumaine pour lesquels aller s'installer dans les zones sous-dotées, avec les aides qu'on accorde, c'est un peu l'eldorado. Dans quelques années, 40 % des nouveaux installés auront un diplôme européen. En tout cas, il y a de plus en plus de chirurgiens-dentistes pour répondre à la demande et la répartition est meilleure.
La formation qui leur a été dispensée pose problème. Une étude faite l'an dernier par un étudiant de Rennes montre que 10 % de ces diplômés n'ont pas eu de formation clinique. Il y a là une insuffisance professionnelle. Nous inscrivons les Français à diplôme européen, en revanche nous n'inscrivons pas forcément les étrangers s'ils ne maîtrisent pas la langue. Mais nous n'avons pas vraiment de critère pour discerner l'insuffisance professionnelle.
Pour ce qui est du pharmacien comme professionnel de premier recours, c'est déjà le cas dans le quotidien. Il y a aussi des protocoles de coopération avec les maisons pluridisciplinaires de santé, par exemple dans le cadre d'un SIDA. Les pharmaciens souhaitent aller dans ce sens et par exemple, nous voulons mettre en place des expérimentations sur la prise en charge des pathologies bénignes dans le cadre de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui clarifie les règles de prise en charge et de financement des soins.

Je vous remercie pour la qualité et la franchise de ces propos. Je reviens sur les pratiques avancées. Actuellement, des infirmières, bien formées, créent leur cabinet, après être passées dans des services hospitaliers importants par exemple. Ne peut-on prendre en compte une validation des acquis de l'expérience, pour mettre en place plus vite des pratiques avancées ?
Il y aura une validation des acquis quand les pratiques avancées seront installées. Il faut commencer par bien définir avec des conseils de spécialité, des référentiels d'activités, de compétences, afin de déboucher sur un référentiel de formation. Les infirmières participant à l'expérimentation ASALEE, par exemple, pour le diabète, pourront prétendre à devenir des infirmières à pratique avancée par validation.

Le sujet central est l'urgence de la prise en charge. Je le dis au Conseil de l'Ordre des médecins, on ne peut pas travailler à moyen terme et à long terme. Vous êtes des responsables. L'accès aux soins est-il garanti sur tout le territoire ? Non, il ne l'est plus. Le témoignage du député de Versailles est édifiant : l'accès n'est plus garanti, comme il ne l'est plus dans le 20e arrondissement ni dans le rural profond. On ne peut pas se contenter de poser un emplâtre sur une jambe de bois. Il faut faire des propositions fortes, sinon on en reste à dire qu'on verra, dans cinq ans ou dans dix ans. Or la situation est gravissime. En outre, personne n'en a parlé, il y a à évaluer les politiques publiques et tout l'argent qui a été mis sur la table. À ce propos le rapport de la Cour des comptes est édifiant.
Alors, êtes-vous prêts à ouvrir complètement le numerus clausus ou non ? Cela vous concerne tous, puisqu'il s'agit de la PACES. J'ai même lu des propositions de médecins pour la supprimer. On a dit que les dentistes formés en Roumanie, en Espagne, en Belgique sont de moins bon niveau que ceux formés en France. Est-ce à dire que l'on laisse une sous-médecine s'installer ou fait-on en sorte que plus de jeunes puissent être formés chez nous pour l'ensemble des professions médicales ?
Former plus de jeunes professionnels n'influe pas sur leur répartition géographique.

L'offre et la demande vont tout de même jouer. Il faudra bien aller chercher une clientèle là où elle se trouve.
Sans doute, mais tel n'est pas l'état d'esprit des jeunes praticiens qui vont s'installer.

Ce n'est pas un problème d'état d'esprit des jeunes. Êtes-vous décidés à former plus de jeunes ? En France, la formation est presque gratuite ; en Roumanie, c'est 5 000 à 10 000 euros par an. Laisserons-nous ce système se perpétuer, alors que nous avons des manques, notamment en orthodontie. Vous êtes tous attachés à la qualité des soins. Laisse-t-on une sous-médecine s'installer ?
Il est clair que le numerus clausus n'a plus de sens. Il ne joue pas son rôle, et même il crée des inégalités chez nos jeunes dans l'accès aux professions de santé. Aller se former en Roumanie parce qu'on a raté la PACES, ce n'est pas donné à tout le monde.

Seriez-vous d'accord pour régionaliser la formation ? Cela créerait des filières locales. Les dentistes ont fait des propositions.
Si le numerus clausus n'a plus de sens, il y a quand même un problème de capacité de formation dans les universités, sur le plan financier comme sur celui des locaux – les amphis sont pleins à craquer. Il faut un système de régulation à l'entrée des professions, certainement au niveau des territoires.

Le contrat d'engagement du service public, le CESP permet à des étudiants d'être payés contre l'engagement d' exercer quelques années dans la région. Est-ce vous y êtes favorables ? J'ai constaté que les dentistes se plaignaient de ne pas en avoir assez et demandaient à récupérer les CESP non utilisés par les médecins.
Le CESP fonctionne pour les étudiants en dentaire, pas forcément pour la médecine. D'ailleurs, ils ne sont pas tous pourvus.

Le CESP n'est peut-être pas proposé partout avec la même force. À Tours, il y a dix CESP. À d'autres étudiants, on n'explique peut-être pas le détail des choses.
Le succès est modeste, et variable d'une faculté à l'autre. Un problème est que l'étudiant de deuxième année de médecine ne sait pas encore ce qu'il veut faire, or les objectifs de ces contrats sont ciblés sur des spécialités.

On a évoqué des cabines de télémédecine dans les officines. Qu'en pensez-vous ? Comment rémunère-t-on le pharmacien, qui paye l'installation, comment établit-on la nomenclature des actes ?
Vous l'avez dit, on a consenti des financements énormes qui n'ont abouti à rien. Il faut donc éviter d'investir de nouveau dans de fausses bonnes idées. L'expérience a fait ses preuves en Suisse et au Québec, il serait dommage de ne pas s'en inspirer.

L'Ordre des médecins serait-il d'accord pour valider l'ensemble des diplômes des médecins étrangers qui exercent dans nos centres hospitaliers ? Il y a des mercenaires cher payés et dont la qualité des diplômes n'est pas reconnue, voire simplement pas vérifiée.
Les mercenaires, c'est autre chose. Ceux auxquels vous faites allusion, ce sont des médecins étrangers que les hôpitaux accueillent pour certaines missions et qui ne peuvent pas travailler en autonomie faute de diplôme français. D'énormes efforts ont été faits depuis les lois Kouchner pour les intégrer. Il y en avait alors 10 000 à 12 000 – le ministère de la santé ne pouvait pas donner de chiffre. Un bon nombre ont été intégrés avec beaucoup de tolérance.
Peut-être, mais pas seulement, nous n'allons pas polémiquer. Il y a eu des commissions pour les intégrer. Pour notre part, ces médecins, nous ne les connaissons pas.

Vous ne les connaissez pas, mais quand je vois avec quelle vigueur les ordres s'impliquent dans le fonctionnement de la santé au quotidien… Par exemple, j'ai des courriers indiquant que, dans tel SISA, l'Ordre des médecins refuse la présence d'un paramédical, pour des raisons complexes de non-conformité. Et à côté de cela, on ne vérifie pas les diplômes de médecins étrangers.
Si vous disposez de tels courriers, communiquez-les-moi, je serais heureux de les avoir.
En ce qui concerne l'homologation des diplômes de ces milliers de médecins…
Vous avez les chiffres, pas moi. Je pensais que c'était nettement moins. Je ne suis pas sûr que vous ayez raison. Par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers (CNG), qui organise des concours, nous le saurons. Mais pensez-vous qu'on puisse dire aujourd'hui – nous, nous ne le pensons pas – que des médecins qui travaillent dans un hôpital sous l'autorité de quelqu'un dans un domaine particulier puissent avoir, du jour au lendemain, l'autorisation d'exercer sur le territoire en dehors de ce cadre ? Aujourd'hui c'est non, sauf à travers des procédures qui existent déjà.
Ou j'ai mal compris, ou on nous parle de valider les 22 000 professionnels concernés et de les inscrire à l'Ordre. Dans les compétences de l'Ordre figure la vérification de la compétence professionnelle et il existe un décret sur l'insuffisance professionnelle que nous appliquons. Il y a aujourd'hui une procédure simple et très tolérante pour entrer dans l'exercice de la profession, c'est la procédure d'autorisation d'exercer (PAE), et elle fonctionne. Pensez-vous qu'on puisse changer du jour au lendemain sans le moindre moyen de contrôle sur les aptitudes des gens ?

Monsieur Simon, si je me permets de vous dire cela, c'est que chacun connaît la situation, mais chacun ferme les yeux. Or elle appelle une réflexion des ordres et des responsables des politiques de santé. C'est que le trou est abyssal et le cumul de travail plus grand qu'on ne le dit. Pour prendre l'exemple que je connais, celui de l'Eure-et-Loir, des médecins travaillent à l'hôpital de Chartres pour 35 à 40 heures – ils n'ont pas droit de travailler plus de quatorze heures par jour, sinon cela ouvre droit à récupération – et ils vont aussi faire dans des hôpitaux des astreintes, qui sont payées comme des temps de garde. Au bout d'un certain temps, ils deviennent dangereux, ils coûtent très cher aux pouvoirs publics, en plus de tous ces médecins qui sont en situation irrégulière. Quand on constate cela, on ne peut pas rester les bras ballants. Il ne s'agit pas de dire qu'on régularise ces gens-là, mais de savoir si nous sommes capables d'apporter à 65 millions de Français une offre de soins de qualité, qui passe par l'attractivité. Mais nous n'avons pas entendu parler d'argent, de revalorisation des consultations – je ne sais pas si c'est un problème. L'Ordre des sages-femmes a indiqué que des centres hospitaliers bloquent sur la signature de conventions. Nous le ferons remonter au ministère, c'est notre travail. Pour les délégations, nous aimerions que vous vous mettiez d'accord entre ordres pour savoir exactement ce qu'on peut faire. Est-ce que le pharmacien ne peut pas s'occuper d'un suivi de traitement anticoagulant ? Ne peut-on généraliser les expérimentations réussies sur la primovaccination ? Celle des nouveaux nés ne peut-elle pas se faire par délégation sous le contrôle des pédiatres ? Et cela, sur le court terme. On ne peut pas nier la gravité de la situation, sinon nous ne ferions ni vous ni nous notre travail.
Merci de tous ces messages, nous connaissons les problématiques et, croyez-nous, si elles n'étaient pas compliquées, elles auraient été résolues depuis longtemps. Pour les délégations, nous sommes au début d'une réflexion avec l'Ordre des pharmaciens. Pour le reste, nous sommes plus perplexes et il semble y avoir une certaine confusion sur les médecins hospitaliers. Nous allons éclaircir cela et nous vous tiendrons au courant.

La délégation des tâches et l'équipe pluridisciplinaire sont de très bonnes choses. Mais le frein n'est-il pas de savoir qui aura la responsabilité pénale en cas de problème ? Si un infirmier fait un acte, que le pharmacien délivre un médicament qui cause un problème, est-ce le praticien qui est responsable ?
Excellente question. Je l'avais traitée dans les prérequis pour les pratiques avancées. On ne semble pas avoir conscience, même au plus haut niveau, qu'une équipe de soins n'a aucune responsabilité par elle-même. C'est chaque membre de l'équipe qui a sa responsabilité propre dans son domaine de compétence. Il y a deux domaines où le médecin a seul la responsabilité : la démarche de diagnostic et le choix thérapeutique. Si quelque chose se déroule mal, l'assurance du patient s'adressera à celle de l'hôpital. Mais dans une équipe de soins primaire, il n'y a pas de responsabilité de l'équipe.

Ce qui se négocie comme statut sur les pratiques avancées, c'est simplement l'officialisation de ce qui se passe déjà dans les hôpitaux. On n'avancera pas sur les territoires, si l'on ne va pas plus loin, notamment par la formation des paramédicaux et l'intégration de la formation des infirmiers dans le dispositif licence-maîtrise-doctorat (LMD) pour leur ouvrir la possibilité d'une spécialisation.
Aujourd'hui, pour améliorer l'accès à la médecine de ville, il faut que les étudiants fassent des stages, et le plus tôt possible. Mais il manque 15 000 maîtres de stage. Leur rémunération n'est-elle pas le problème ? Ne pourrait-on l'intégrer dans la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) ?
D'autre part, de jeunes praticiens prennent l'habitude d'enchaîner des remplacements de généralistes sur une très longue durée. N'est-ce pas là une déviance et ne serait-il pas judicieux d'encadrer cette possibilité dans le temps ?
La pratique avancée s'inscrit bien dans l'esprit du LMD. Elle est souvent hospitalière, mais il faudrait l'exporter en ville en clarifiant bien les deux domaines.
Le remplacement de longue durée est limité à trois mois renouvelables. Mais il est vrai que, dans des départements, on fait preuve de souplesse dans l'intérêt des patients. Nous avons proposé un statut un peu bâtard de médecin adjoint, l'adjuvat, c'est-à-dire la possibilité pour un jeune médecin de travailler avec un autre comme dans des endroits où il y a des afflux de population, comme les stations balnéaires en été ou la montagne en hiver. C'est une solution qui a un certain succès. Nous en avions d'autres, comme l'assistance des médecins qui ont soutenu leur thèse. Ce n'est pas négligeable et rester un an ou un an et demi près d'un médecin aide à préparer l'installation.
Oui, il faut favoriser les maîtres de stage, amplifier la formation, et pourquoi ne pas déplafonner le numerus clausus, qui est totalement contourné. Mais comment assurer la formation ensuite ? S'il manque déjà 15 000 maîtres de stage et qu'on ajoute encore 5 000 étudiants à encadrer ? C'est ce que font valoir les doyens. Les capacités de formation sont saturées.

De plus en plus de collectivités, communes et départements, recrutent des médecins salariés. Quelle est votre position à ce sujet ?
Nous y sommes tout à fait favorables et l'Ordre encourage ces initiatives, qui ont un certain succès.

Je vous remercie de vous être soumis à nos questions pressantes.
On vient de dire qu'il n'y avait pas assez de maîtres de stage. J'ai été surpris qu'on n'évoque pas, comme souvent, la suradministration et la nécessité de simplifier. De même, on n'a pas parlé de l'attractivité de la carrière. Mme la présidente de l'Ordre des pharmaciens a dressé un tableau satisfaisant, mais il y a pourtant un certain nombre de pharmacies qui ferment chaque année.
J'ai bien retenu que vous étiez prêts à augmenter le numerus clausus et à régionaliser des formations. M. Simon a parlé de médecins adjoints, non « thésés », qui pourraient s'installer. Quelle complexité ! Êtes-vous d'accord pour que l'on généralise la formule ? La thèse se prépare désormais au long des six années, ce qui est très bien car c'est un exercice convenu.
Sur le statut de remplaçant, je constate en effet que, pour des jeunes autour de la trentaine, enchaîner les remplacements pendant très longtemps est un mode de vie. Les limiter, c'est quand même une forme de coercition. Si l'on ne veut pas avoir d'un côté dans des zones très denses – de plus en plus rares – des médecins qui posent leur plaque mais ne font pas bénéficier les patients du remboursement de la Sécurité sociale, on pratique une régulation cartographiée, ce que les pharmaciens, les sages-femmes, les kinésithérapeutes ont accepté. Seuls les médecins n'ont accepté aucune modalité de régulation.
Enfin, j'ai rencontré il y a peu les syndicats d'interne. Ils demandent que leur formation de médecine générale soit allongée d'une année. En 2000, former un médecin généraliste prenait sept ans ; en 2020, ce serait onze ans. Est-ce que la formation est devenue moins bonne alors que le niveau aurait dû s'élever ? Je ne comprends pas.
Je n'ai pas dit que j'avais réussi avec les remplacements, mais que l'Ordre avait accepté d'être tolérant dans l'intérêt de la population. La question des remplacements a fait polémique chez nous, mais veut-on que des gens se détournent de l'exercice ? C'est une offre de soins qui est offerte.
S'agissant d'introduire une quatrième année de médecine générale, il semble que ce soit la volonté d'harmoniser la médecine générale avec les autres spécialités. Les discussions à ce sujet se mènent dans la profession elle-même plutôt qu'au niveau de l'Ordre qui est un peu en retrait sur ces questions.

Je vous remercie. D'autres questions auraient pu être évoquées, en particulier sur le conventionnement. Nous nous permettrons de vous les faire parvenir.
L'audition se termine à dix heures trente.
————
Membres présents ou excusés
Réunion du jeudi 19 avril 2018 à 8 h 30
Présents. – M. Didier Baichère, Mme Gisèle Biémouret, M. Jean-Pierre Cubertafon, M. Marc Delatte, Mme Jacqueline Dubois, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Jean-Carles Grelier, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Jean-Michel Jacques, M. Christophe Lejeune, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, M. Vincent Rolland, Mme Nicole Trisse
Excusé. – M. Jean-Louis Touraine