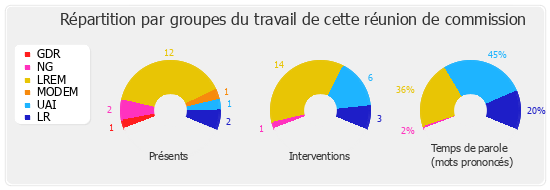Commission d'enquête sur l'égal accès aux soins des français sur l'ensemble du territoire et sur l'efficacité des politiques publiques mises en œuvre pour lutter contre la désertification médicale en milieux rural et urbain
Réunion du jeudi 24 mai 2018 à 8h30
Résumé de la réunion
La réunion
— Fédération nationale des infirmiers (FNI) – M. Daniel Guillerm, vice-président
— Convergence infirmière (CI) – Mme Ghislaine Sicre, présidente
— Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux (SNIIL) – Mme Catherine Kirnidis, présidente
Jeudi 24 mai 2018
La séance est ouverte à huit heures trente.
Présidence de M. Alexandre Freschi, président de la commission d'enquête
————
La commission d'enquête procède à l'audition commune des syndicats d'infirmiers : M. Daniel Guillerm, vice-président de la Fédération nationale des infirmiers (FNI), Mme Ghislaine Sicre, présidente de Convergence infirmière (CI), Mme Catherine Kirnidis, présidente du Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux (SNIIL), Mme Élisabeth Maylié, présidente de l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux (ONSIL), et Mme Françoise Pacchioli, présidente ONSIL Rhône-Alpes.

Mes chers collègues, nous débutons aujourd'hui nos travaux par l'audition commune des représentants de syndicats d'infirmiers, auxquels je souhaite la bienvenue.
Mesdames et monsieur, je vous rappelle que l'article 16 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relatif au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Je vous invite à lever la main droite et à dire « Je le jure ».
M. Daniel Guillerm, Mme Ghislaine Sicre, Mme Catherine Kirnidis, Mme Élisabeth Maylié et Mme Françoise Pacchioli prêtent successivement serment.
La problématique des déserts médicaux revient de façon récurrente, y compris dans les médias. Nous avons quelques idées à vous soumettre. La FNI n'a pas produit de contribution écrite, mais vous en fera parvenir une à l'issue de cette audition.
Aujourd'hui, en tout cas en France, il n'y a jamais eu autant de médecins. Les numerus clausus ont augmenté, et l'effet s'en fera sentir dans les années qui viennent. Pour ce qui nous concerne en tout cas, le phénomène des déserts médicaux ne tient pas au nombre des médecins, mais à leur répartition.
Les infirmières libérales l'avaient anticipé en s'organisant, et en signant, par le biais de leur convention, un avenant de régulation démographique. Certes, des oppositions se sont exprimées contre l'application de ces mesures au niveau de la médecine générale. Maintenant, y a-t-il d'autres solutions ? À notre sens, il peut y en avoir, par exemple en élargissant le champ de compétences des infirmières.
Vous allez sans doute nous parler des métiers intermédiaires, notamment des infirmières de pratiques avancées (IPA). Il se trouve que le projet de décret concernant les IPA n'a pas été validé la semaine dernière par le Haut conseil des professions paramédicales (HCPP). Le décret paraîtra peut-être et en l'état, mais à notre sens, il ne résoudra absolument rien au problème qui se dessine. Mais j'aurais l'occasion d'y revenir.
Une des solutions consisterait peut-être à modifier les conditions de passage en deuxième année de médecine. Il faut réfléchir au profil de recrutement. Aujourd'hui, les étudiants en médecine sont recrutés sur des critères quasi uniquement scientifiques. Or la médecine générale requiert d'autres compétences, notamment en sciences humaines et en sciences sociales. Cela susciterait peut-être des vocations et de nouvelles installations de médecins dans des territoires ruraux, qui sont aujourd'hui désertés.
Par ailleurs, ne faudrait-il pas commencer à réfléchir à la possibilité de faire accéder, par validation des acquis de l'expérience (VAE) et sous certaines conditions, des professionnels de santé au statut de médecin généraliste ? C'est une question qui se pose dans certains secteurs, une forme de compagnonnage pourrait remédier, dans des champs de compétences précis, aux problèmes posés par les déserts médicaux.
Pour Convergence infirmière, le nombre de médecins formés n'est pas vraiment la cause de la pénurie. Quand on est sur le terrain, on remarque que certains médecins ferment leur cabinet à dix-sept heures, que souvent ils ne travaillent plus le mercredi après-midi, et qu'ils arrêtent le vendredi soir à seize heures, ce qui pose tout de même problème. Et je ne parle pas de déserts où il n'y a plus du tout de médecins, mais d'endroits où il y en a…
Je peux vous parler d'un cas qui s'est produit pendant les vacances de Noël, période difficile où il n'y a pas de médecins, sauf des remplaçants, qui ne répondaient pas au téléphone. Car voilà ce qui se passe dans un désert médical : personne ne répond et les patients se rendent aux urgences, alors que cela ne devrait pas se faire.
S'agissant des infirmières, le maillage territorial est relativement équilibré. Il n'y a pas de zone désertique. Même si les infirmières sont surchargées dans certains territoires, elles assurent les soins et, surtout, la continuité des soins, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et 365 jours sur 365. Elles prennent en charge 1,5 million de personnes par jour, ce qui n'est pas rien !
Elles sont les seules, parmi les professionnels de santé, à assurer la continuité des soins auprès des patients puisqu'elles se déplacent, dans 80 et 90 % des cas, à domicile, ce que les médecins ne font quasiment plus aujourd'hui. Il faudrait regarder les chiffres ; j'ai vu passer ceux de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) lorsque j'ai préparé notre contribution, mais je n'ai pas fouillé la question par manque de temps.
Les infirmières sont capables de s'organiser pour prendre en charge les patients tout au long de ce cursus. Dès lors qu'elles peuvent être en lien avec un médecin, au moins par le biais de la télémédecine ou d'un outil digital, il leur est aisé de répondre aux besoins des patients dans les déserts médicaux, ou dans les endroits où les médecins ne répondent pas. À mon avis, il ne faut pas se focaliser sur le seul désert médical.
Les infirmières sont le véritable pivot entre le sanitaire et le social et elles peuvent apporter une réponse au discours social.
Pour des soins non programmés, elles peuvent répondre à l'appel d'un patient, à condition d'entrer en communication avec un médecin se trouvant à un autre endroit. Mais pour cela, il faut une bonne couverture réseau, ce qui n'est pas le cas partout en France. Même à côté de Montpellier où j'habite, on rencontre des difficultés.
Les infirmières pourraient assurer une pré-consultation, coordonnée via un outil digital, tel LEO – pour lien, échange, organisation – qui sera opérationnel en septembre. Par ce biais, on peut organiser une visioconférence sécurisée à domicile. Le médecin, à l'autre bout de la chaîne, est à même de voir le patient et de discuter avec lui.
Il existe aujourd'hui des objets connectés. Grâce à eux, on peut remonter au médecin un électrocardiogramme ou tout élément dont il a besoin. On peut assurer la surveillance clinique du patient : description des symptômes, de l'environnement – ce que connaît rarement le médecin s'il ne se déplace pas à domicile – et différents paramètres. On peut faire des photos, qui sont également sécurisées, surveiller l'index de pression systolique (IPS), évaluer la douleur, etc. et transmettre ces données.
On peut effectuer un bilan sanguin par le biais du laboratoire, et via une messagerie sécurisée, l'envoyer au médecin, même s'il est loin. Celui-ci peut envoyer une ordonnance virtuelle, toujours par messagerie sécurisée, à l'infirmière, au laboratoire et au pharmacien, qui peut livrer des médicaments au patient, même s'il est éloigné de ce médecin.
Nous avons imaginé d'organiser une équipe d'infirmières libérales pour assurer les astreintes, avec un paiement par l'Agence régionale de santé (ARS) pour répondre aux besoins. Ces infirmières disposeraient d'une mallette d'urgence, seraient formées aux gestes d'urgence et interviendraient, si nécessaire, en appui des pompiers, par exemple dans le cadre de l'urgence, notamment dans les déserts médicaux. Dans des villes où il y a des médecins, en principe tout est organisé – services d'urgence, pompiers, etc.
Pour assurer le suivi des patients, les infirmières pourraient mettre leur cabinet à disposition : elles l'utilisent peu puisqu'elles effectuent 80 à 90 % de leur activité au domicile des patients. Autant optimiser les dépenses.
Elles pourraient également faire une consultation physique une fois par semaine, pour assurer, notamment, le suivi des pathologies chroniques ; elles seraient assistées, par exemple en visioconférence, par exemple par une infirmière de pratique avancée (IPA), qui jouirait de beaucoup plus d'autonomie qu'il n'est prévu dans le texte actuel, d'où le rejet du projet de décret.
La mairie pourrait aussi proposer un lieu de visioconférence pour permettre au médecin d'effectuer une consultation à distance avec l'infirmière libérale qui serait d'astreinte ; il y aurait une salle d'attente et les patients devraient prendre rendez-vous.
On pourrait également organiser une consultation avec un médecin, qui se déplacerait une fois par semaine, soit dans cette salle de mairie, soit dans le cabinet de l'infirmier. C'est tout à fait faisable.
Enfin, je reviendrai sur les IPA : ces infirmières, dans le cadre de prise en charge organisée ou de mise en place des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), pourraient renouveler des ordonnances chez les patients atteints de pathologie chronique stabilisée – comme il est écrit dans le texte – et prescrire des examens complémentaires.
La désertification médicale est en effet une préoccupation, s'agissant notamment des médecins. Mais il ne faut pas oublier qu'en fonction de ce que l'on va décider, le même phénomène peut se produire avec les autres professionnels de santé. Répondre à la désertification par l'augmentation du nombre de professionnels, par exemple en augmentant le numerus clausus, n'est pas forcément la seule solution.
Pour le SNIIL, c'est l'organisation qu'il faut améliorer. Nous devons chercher comment, entre eux, les professionnels de santé peuvent y contribuer. Car cela passera aussi par la coopération pluri-professionnelle – on a vu ce que cela pouvait donner avec les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) : ce n'est pas forcément la seule réponse, mais on voit bien que lorsque tous les professionnels de santé s'organisent et se coordonnent, l'accès aux soins de l'ensemble de la population s'en trouve facilité.
Mme Sicre a indiqué que 90 % de l'activité des infirmières se faisaient à domicile. Mais la difficulté de l'accès aux soins, c'est aussi celle que rencontrent certains professionnels à accéder à leurs patients, dans les centres hyper-ruraux, mais aussi dans les hyper-centres des villes très urbanisées. Aujourd'hui, dans les villes qui souhaitent favoriser les transports en communs, on multiplie les zones piétonnes. C'est un élément à prendre en compte : pour habiter et travailler en Avignon, je peux vous garantir que le Festival pendant les vacances, c'est quelque chose !
Les infirmiers libéraux sont les professionnels de santé les plus nombreux – avec plus de 116 000 infirmiers libéraux, entre conventionnés et remplaçants – et les mieux répartis dans l'ensemble du territoire, couvert quasiment à 100 %.
Nous sommes les plus proches du domicile des patients, et les plus accessibles, selon l'indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL). Une enquête a en effet été menée, dans le cadre des négociations conventionnelles, pour redéfinir les zonages démographiques des infirmières avec ce nouveau critère, qui prend en compte la proximité géographique et la disponibilité des professionnels de santé.
Surtout, nous sommes assujettis à la continuité des soins, c'est-à-dire disponibles sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Nous sommes conventionnés quasiment à 100 % – nous n'avons pas de secteur 1 ni de secteur 2. Enfin, quasiment la totalité de ces professionnels de santé acceptent le tiers payant, ce qui n'est pas négligeable quand on sait que certaines personnes renoncent aux soins parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer directement un médecin.
Nous intervenons en libéral, mais aussi dans le cadre de structures plus organisées. Il faudrait d'ailleurs revoir avec elles nos modalités d'intervention. Je pense notamment à nos relations avec l'hospitalisation à domicile (HAD) et avec les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD).
Dans le document que nous vous avons transmis, nous avons élaboré plusieurs pistes de réflexion.
Bien évidemment, il faudrait donner plus de temps médical au médecin en essayant de s'appuyer sur les compétences inexploitées des infirmiers, qui sont très larges, et en premier rang auprès de la population. Mais il faudrait aussi oser penser autrement que le « tout structure » - HAD, SSIAD, MSP. Ce sont des solutions qui ont apporté des réponses, mais elles ne sont pas les seules. Je pense que les professionnels de santé, s'ils s'organisaient différemment, pourraient répondre très largement aux besoins.
Les patients ont un médecin traitant. De la même façon, il pourrait y avoir des infirmières référentes ou des cabinets d'infirmières référents, qui permettraient d'identifier les infirmières des patients aussi bien à leur domicile que lorsqu'ils sont hospitalisés. L'intérêt serait d'assurer le partage de l'information entre les structures et la ville, et d'améliorer la prise en charge des patients. Nous sommes parfois un peu démunis lorsque nous devons soigner des patients qui sortent de l'hôpital ou qui sont hospitalisés, et que nous ne disposons pas des informations nécessaires. Tous les professionnels de santé, dont les infirmiers, doivent pouvoir accès à des informations coordonnées, complètes et accessibles.
Cela m'amène au dossier médical partagé (DMP), dont on parle beaucoup. C'est un outil utile, mais on le sait, les médecins se réservent certaines prérogatives en la matière. Il faudra donc faire en sorte que les infirmiers puissent avoir un large accès aux données de santé des patients via le DMP.
Les infirmiers assurent 100 % des soins sur 100 % du territoire, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Des expérimentations ont prouvé que lorsque les infirmiers étaient pris en compte dans l'offre de soins, il était possible de faire des choses intéressantes. Je vous renvoie à notre contribution, où vous pourrez trouver des exemples d'expérimentations – on peut citer, dans les Pyrénées-Orientales, l'équipe pluri-professionnelle libérale spécialisée dans la prise en charge des soins palliatifs, avec des infirmiers libéraux qui jouissent, sur protocole, des compétences pour intervenir sur appel du patient.
Les infirmiers n'ont jamais été considérés comme des professionnels de premier recours. Pourtant, quand les patients n'arrivent pas à joindre leur médecin le vendredi après dix-huit heures ou le week-end, comme le disait ma collègue, ils téléphonent à l'infirmier parce qu'ils savent qu'il répondra toujours. Si c'est un patient que l'on prend en charge, on intervient. Mais sachez qu'on le fait gratuitement parce qu'on ne peut être rémunéré par l'assurance maladie qu'avec la prescription d'un médecin. Donc, quand on se déplace après l'appel d'urgence d'un patient, c'est parce que l'on a le souci de nos patients. C'est très fréquent : au bout d'un moment, cela peut lasser.
Nous sommes appelés très régulièrement quand les patients n'arrivent pas à joindre leur médecin pour des réadaptations de zones de traitement à marge thérapeutique étroite. Par exemple, les anticoagulants nécessitent une surveillance avec un bilan sanguin ; et, selon le résultat, il peut être urgent d'intervenir pour modifier la dose. Dès lors que les patients ne sont pas en capacité de gérer eux-mêmes leur traitement, ils appellent leur infirmière qui se rend à leur domicile et modifie la dose, là encore gratuitement puisque c'est en dehors de la prescription du médecin qui nous permettrait de soumettre un remboursement à l'assurance maladie.
Tout cela prouve bien que les infirmières ont des compétences. Ce n'est peut-être qu'une anecdote, mais pendant les grèves de Mayotte, malgré les difficultés, les infirmiers ont été en mesure de prendre en charge la population.
L'accès aux soins c'est aussi, en termes de santé publique, pouvoir vacciner l'ensemble de la population. Il faudrait élargir le droit des infirmiers à vacciner, pas simplement dans le cadre de la vaccination antigrippale, mais de toutes les vaccinations.
Il faudrait élargir le droit des infirmiers à prescrire certains dispositifs médicaux. Savez-vous que quand nous allons faire un pansement chez un patient, si le médecin a oublié de prescrire l'antiseptique ou le sérum physiologique nécessaire à la réfection du pansement, nous n'avons pas le droit de le prescrire ? Nous devons donc renvoyer le patient chez son médecin pour cette prescription.
La télémédecine peut également être une solution, mais il faut absolument que les infirmiers y soient intégrés. Nous pourrions tout à fait répondre à des demandes : dans nos cabinets avec un équipement adapté – cela nous permettrait effectivement d'intervenir en première ligne pour désengorger, soit les consultations médicales, soit les urgences ; mais aussi au domicile du patient.
Enfin, nous revendiquons la sortie des soins infirmiers des forfaits SSIAD. En effet, lorsque les patients sont pris en charge par un SSIAD et que les soins deviennent lourds, les SSIAD ne peuvent plus les assurer, et ce peut-être un souci.
Intervenant en quatrième position, je ne répéterai pas tout ce qui a été dit avant moi. Mais je suis un peu gênée : j'ai entendu parler de « coordination ». Or, je pense que les infirmières en ont toujours fait, même si ce n'est pas reconnu. Sans coordination avec les autres professionnels, on ne pourrait d'ailleurs pas prendre correctement en charge nos patients. Il est donc inutile de dire que cela va aller mieux parce que l'on va faire de la coordination.
Je préférerais qu'on parle de « collaboration », et qu'on fasse en sorte que la relation entre le médecin et l'infirmière ne soit plus verticale, mais horizontale. Je pense que tous les problèmes seraient résolus si les médecins commençaient à accepter notre existence, à reconnaître nos compétences, et à admettre qu'on agisse en collaboration.
Nous exerçons sur tout le territoire, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Malgré tout, il est difficile de collaborer avec quelqu'un qui n'est pas là. Comme l'a fait remarquer ma collègue, les médecins partent à dix-sept heures, sont absents le samedi, le dimanche, les jours fériés, et renvoient les patients vers le numéro d'un confrère surchargé, qui fait des consultations – même pas de la télémédecine – au téléphone. Ce n'est pas bon non plus.
Les infirmiers pensent majoritairement qu'ils devront être à côté des patients lorsque la télémédecine aura été mise en place. Les patients n'ont pas le vocabulaire adapté, ils n'ont pas la connaissance clinique, ils mentent assez souvent…
Disons qu'ils ne disent pas toujours la vérité…
C'est une façon de s'exprimer. Je suis peut-être un peu trop violente dans mes propos…
On nous parle de télémédecine, mais si le médecin n'est pas là et qu'il n'a pas le temps de faire une consultation dans son cabinet ou d'aller voir le patient, est-ce qu'il en prendra pour ouvrir son ordinateur et parler avec le patient ? Et un patient de quatre-vingts ans, au fond de son lit, dans un coin perdu de la campagne ou en ville, est-il capable de lancer l'ordinateur et de se connecter ? Si nous sommes là et que nous avons tout ce qu'il faut pour faire l'observation clinique avec le médecin, à côté du patient, on pourra avancer.
Enfin, nous devrions changer de posture en demandant aux médecins de nous prendre en considération et de collaborer avec nous. Je pense qu'on résoudrait ainsi beaucoup de problèmes, et que l'on parviendrait à couvrir la demande en consultation, en diagnostic et au-delà.
Je rejoins tout ce qui a été dit, notamment par ma collègue Élisabeth Maylié. J'ajouterai simplement que je suis très attachée au parcours de soins et que, selon moi, la collaboration, la coordination et l'efficacité des prises en charge supposent que l'on donne tout son sens au « parcours de soins » - aujourd'hui, on en est encore un peu trop loin. Si tous les professionnels de santé prenaient vraiment en compte le patient, sans que chacun d'entre eux agisse de son côté, nous gagnerions sans doute du temps et nous économiserions des consultations inutiles.

Ma première question porte sur la démographie : depuis que la compétence a été donnée aux régions en 2004, la formation paramédicale a explosé. Y a-t-il des risques de tension à court terme, avec des risques induits d'inflation de prescriptions ? Comment voyez-vous l'évolution de la démographie des infirmiers à court, moyen et long terme ? Êtes-vous prêts, en cas de dérives, à prendre des mesures de régulation ?
S'agissant des délégations de tâches, j'ai bien aimé le mot « collaboration », que je relie aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Avez-vous établi une liste synthétique entre vous, puisque vous êtes plusieurs à représenter les infirmiers ? Seriez-vous capables de nous dire quelles sont les tâches que vous souhaitez vous voir confiées en responsabilité ?
Le décret sur les pratiques avancées a été rejeté par le Haut conseil. Que serait selon vous le décret idéal ?
Que penseriez-vous de la généralisation des CPTS ? Leur animation pose problème. Qui fait le travail ? Les CPTS ne sont-elles pas le moyen le plus efficace de la collaboration et de la mise en réseau ?
Avez-vous par ailleurs réfléchi à un dossier médical partagé de façon efficace ? Madame, vous disiez tout à l'heure qu'il était parfois difficile d'aller chercher son ordinateur. J'observe tout de même qu'avec le très haut débit, on pourra se connecter en quelques secondes, et que trente secondes de connexion permettent d'éviter des erreurs. Jusqu'où iriez-vous en matière de DMP ? Que penseriez-vous des cryptages gradués pour que chaque professionnel puisse y accéder, en responsabilité dans son domaine de compétences ? Cela existe déjà pour certaines spécialités médicales.
Quelle est votre vision des ARS ? On leur a confié une mission exceptionnelle en matière d'organisation des soins. Mais à l'heure actuelle, on s'aperçoit de leurs immenses difficultés, pour ne pas dire de leur échec.
Ne croyez-vous pas qu'on pourrait monter une instance de régulation unique, dans laquelle il pourrait y avoir de nouveaux métiers, comme des infirmières internistes régulatrices ? Cela éviterait d'avoir affaire à une hôtesse en intérim arrivée trois jours auparavant, et permettrait de compter sur des personnes ayant une compétence avérée par un certain nombre d'années d'études, et capables d'orienter un appel vers le bon service ou la bonne urgence.
Enfin, en ce qui concerne les systèmes de garde, seriez-vous prêts à accepter que l'on rapproche le public et le privé ? Il pourrait s'agir d'un généraliste ou d'une infirmière, qu'elle soit libérale ou du secteur hospitalier. Des passerelles seraient possibles. Doit-on inventer un nouveau système des gardes en France ?
Vous avez dit que les infirmiers étaient disponibles 24 heures par jour, et 365 jours par an. Dans les maisons de santé ou dans les hôpitaux, on pourrait prévoir des maisons de garde. Ainsi, tout le monde ne viendrait pas encombrer les urgences, mais en face, il y aurait au moins un médecin et une infirmière ou un infirmier de garde.
Vous vous êtes interrogé sur d'éventuelles tensions démographiques au sein de notre profession.
Si aujourd'hui, on revient en arrière sur la réorganisation et la transformation du système de santé, on peut s'attendre à une bascule hôpital-ville, avec une intensification de la diminution des durées moyennes de séjour (DMS) à l'hôpital, donc à un transfert de ses patients vers la ville.
Il y avait effectivement beaucoup de personnels dans les services hospitaliers quand les DMS étaient longues, et que la culture hospitalière était de garder, en tout cas de sécuriser au maximum le patient dans la structure de l'hôpital. Aujourd'hui, le paradigme a changé. On sait que les séjours hospitaliers sont source d'iatrogénie, et on veut les écourter.
On constate une fuite très importante des infirmières hospitalières vers le secteur de ville. Selon moi, cette fuite est liée aux conditions de travail à l'hôpital, mais aussi au fait que le système libéral infirmier en ville s'est organisé. Nous sommes en effet une des rares professions libérales à partager sa patientèle, ce qui n'est pas tout à fait le cas des médecins qui restent attachés au colloque singulier avec le patient. De ce fait, les cabinets s'organisent, notamment en termes de conditions de travail. Une infirmière qui appartient à un cabinet de six ou sept infirmiers ne travaille évidemment pas sept jours sur sept. Mais ce partage de patientèle permet la prise en charge de tous les patients, dans la mesure où l'on est soumis à une obligation de continuité des soins.
Cela étant précisé, aujourd'hui, on n'a pas le sentiment qu'il manque d'infirmières.
Et, à court et à moyen terme, cela dépendra de la manière dont vous réorganiserez le système, et des compétences que vous donnerez à ces professionnels.
Très clairement, si.
D'autant qu'on parle beaucoup du virage ambulatoire, et de la chirurgie ambulatoire. Les infirmiers actuellement en exercice vont participer à ce virage ambulatoire. Tout dépend donc ce qu'il sera.
Les infirmiers seront amenés à s'investir de plus en plus dans les prises en charge en ville. Il faudra alors veiller à ne pas négliger les soins qui relèvent du rôle propre des infirmiers, qui participent au maintien à domicile des personnes dépendantes ; ils sont même en première ligne.
Mais on parle d'égalité d'accès aux soins. Si on observe la démographie infirmière telle qu'elle est actuellement, on distingue des zones sur-dotées, et des zones sous-dotées ; par exemple, la région PACA est une zone sur-dotée, avec une pléthore d'infirmières libérales par rapport à d'autres zones. Selon les zones, les personnes prises en charge par les infirmières ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans les zones sur-dotées, les infirmières sont nombreuses et l'offre de soins permet de prendre davantage en charge la dépendance. Dans les zones où l'on manque d'infirmières, celles-ci vont se cantonner par nécessité aux actes dits techniques et prescrits par les médecins. De ce fait, on peut considérer qu'il y a inégalité d'accès aux soins. Lors de la canicule de 2003, dans les zones où il y avait beaucoup d'infirmières pour prendre en charge les patients dépendants, il y a eu beaucoup moins de décès.
Nous sommes la première profession qui se soit engagée dans la régulation démographique, et la seule qui l'ait fait de façon efficace. On est actuellement en négociations conventionnelles.
Aujourd'hui, on le juge positif, mais il ne faudrait pas qu'à terme, en fonction de ce que vous allez préconiser, on se trouve dans une situation tendue. À l'heure actuelle, il y a suffisamment d'infirmiers libéraux.
Je n'aime pas beaucoup l'expression.
Nous exerçons la même profession et nous travaillons avec d'autres professions de santé. Notre défi à tous, et celui de la société, est de faire face à l'explosion des maladies chroniques et à l'allongement de la durée de vie. Il va falloir effectivement à un moment donné, qu'il y ait la possibilité de faire des choses ensemble

Mais si on veut prendre des mesures à court terme, cela pourrait faire partie de l'arsenal ?
Nous avons quand même des compétences propres, qui sont inscrites dans notre nomenclature.
Toutes nos compétences ne figurent toutefois pas dans la nomenclature et nous ne pouvons donc pas les exercer de façon pleine et entière comme c'est le cas à l'hôpital. Ce pourrait être une ouverture. Mais à chaque fois que nous lui faisons des propositions, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS, les rejette.

Pourriez-vous nous mettre cela noir sur blanc ? Ainsi, dans l'arsenal de nos propositions, nous pourrions évoquer les idées partagées par les professionnels.
Sans que cela relève forcément de la délégation de tâches…
Les infirmières peuvent travailler sur protocole. Dès lors qu'elles en ont un, elles peuvent faire des bilans cliniques, etc. Sauf que ces actes ne sont pas « nomenclaturés » et qu'ils ne sont donc pas rémunérés, bien qu'il puisse s'agir d'une pré-consultation pour les médecins.
Le problème est qu'il n'y a pas aujourd'hui de reconnaissance de certains volets du décret de compétences dans notre nomenclature. Je pense qu'il faudrait effectivement commencer par introduire la notion de « consultation clinique infirmière ».
Mais dès que vous parlez de consultation devant le corps médical, des lobbies sont vent debout contre ce qui relève selon eux de la dialectique médicale, et refusent que le sujet soit débattu.

Il faudrait changer de vocabulaire : vous ne pouvez pas dire que vous souhaitez la collaboration et la coconstruction, et qualifier les autres de « lobbies »

Les personnes que nous auditionnons sont libres de leur parole : si elles veulent dire les choses de cette façon, nous devons leur laisser toute liberté d'expression.

J'entends bien. Mais ceux que l'on auditionne ont tout de même des remarques à formuler. Ils sont bloqués depuis plusieurs années dans leurs capacités de faire ; les blocages viennent bien de quelque part et il est bon que cela soit dit.

Je rappelle que tout est public, que tout est enregistré, et que chacun a la capacité de s'exprimer. Mais, si le dialogue ne s'installe pas, nous ne sommes là que pour écouter les personnes que nous recevons. Or, sans échange, on n'arrive à rien.

L'échange suppose la liberté d'expression. Allez-y, dites-nous d'où viennent ces lobbies ?
Lors de l'ouverture des négociations, nous avons défendu l'idée de la consultation de surveillance clinique infirmière, notamment de prévention – si on veut diminuer le nombre des pathologies chroniques il faut travailler sur la prévention. Or cela a été balayé par la CNAMTS, comme à chaque fois.
Nous sommes tout à fait à même d'assurer une consultation de surveillance clinique infirmière, où qu'elle soit positionnée – suivi des cancéreux, maladies chroniques, etc. Puisque les infirmières de l'hôpital le font, je ne vois pas pourquoi les infirmières libérales ne pourraient pas le faire. Il suffit que l'on travaille sur des outils, avec des fiches de coordination, des bilans – bilans nutritionnels, bilans d'évaluation de la douleur, etc.
Il serait tout à fait possible de faire une telle consultation dans une zone désertique, par exemple en utilisant un outil digital qui pourrait être transmis à un médecin. Mais en dehors même des déserts médicaux, ce suivi permettrait de dégager du « temps médical », qui ne l'est pas parce qu'aujourd'hui on est bloqué.
On a l'impression que « consultation » est un gros mot que nous ne devons surtout pas utiliser parce que nous sommes des infirmières et qu'il n'appartient qu'aux médecins.

Je rappelle aux membres de cette commission d'enquête que nous avons demandé à chacun des organismes que nous avons auditionnés de nous envoyer pour le 1er juin un petit document de synthèse de leurs souhaits. Je pense donc que la liberté d'expression est totale.

Je reviens sur la démographie de votre profession. Vous parliez de 116 000 infirmiers. Hier, j'ai auditionné le professeur Salomon, directeur général de la santé, en ma qualité de vice-présidente du groupe d'étude sur la maladie de Lyme. Il m'a dit qu'il y avait 600 000 infirmières et infirmiers recensés, et que 200 000 seulement travaillaient. Qu'en est-il ?
Il y a effectivement 116 000 infirmiers libéraux. Je ne connais pas le chiffre des infirmiers salariés ; il faudrait s'adresser au Conseil national de l'ordre ou à la DREES qui seraient plus à même de vous renseigner. Mais il est exact qu'il y a beaucoup plus d'infirmiers formés.
La durée de carrière d'une infirmière, qu'elle soit à l'hôpital ou qu'elle exerce en libéral, est courte. Les métiers sont fatigants, pénibles physiquement et moralement. Surtout, les infirmières acceptent de plus en plus mal le manque de reconnaissance. Le découragement, le burn out, est d'ailleurs davantage lié au manque de reconnaissance des compétences qu'aux conditions de travail.
Nous n'avons pas forcément besoin que des tâches nous soient déléguées, car nous en avons déjà beaucoup : notre décret de compétences est très riche. Si déjà, nous avions la possibilité, au domicile, d'exploiter l'ensemble des compétences figurant dans notre décret de compétences, bien des problèmes disparaîtraient.

C'est peut-être une question de responsabilité juridique. À l'hôpital, il y a une hiérarchie, et un médecin qui vous accompagne.
Dès lors que cela fait partie de nos compétences, ce n'est pas un problème.
Bien sûr !
Le rôle propre de l'infirmière n'est pas reconnu à domicile.
C'est un problème médico-économique.
Je vais vous donner un exemple : nous sommes aujourd'hui en négociations conventionnelles avec la CNAMTS et nous devions signer un avenant – numéro 6 – fin mars, mais nous ne l'avons pas fait. Au regard des ambitions affichées par la CNAMTS nous avions calculé qu'elle aurait dû mettre à peu près 180 millions d'euros au titre de cet avenant. Or, elle n'y consacrait que 60 millions ! Vous comprendrez que nous n'ayons pas voulu « charger la mule » et continuer à prendre en charge à moyens constants, sans pouvoir être rémunérés.
Aujourd'hui, certaines infirmières libérales accomplissent des actes qui ne sont pas rémunérés. On oppose les revenus moyens des professionnels libéraux à ceux des hospitaliers. Mais à un moment donné, si on veut agir sur le système, il faut prendre des mesures systémiques et pas cosmétiques. Notre sentiment est que l'on fait l'inverse.
Une des mesures systémiques consisterait à retranscrire dans notre nomenclature la totalité de notre décret de compétences.

Selon vous, pour améliorer l'accès aux soins, il faut renforcer la collaboration avec les médecins. Venant du milieu hospitalier, j'ai l'impression que la collaboration entre les aides-soignantes et les infirmières a faibli ces dernières années. Qu'en est-il en ville ? Cette collaboration est-elle suffisante ? Je pense plus particulièrement au maintien à domicile.
Il n'y a pas d'aides-soignantes libérales. Donc, quand je travaille avec une aide-soignante, je ne suis pas obligée de passer par une structure.
Je suis désolée, mais les structures ne savent parler que « structures » : encore une fois, on nous oublie ! C'est du grand n'importe quoi ! Il en est de même de l'HAD et des SSIAD. Et je vais être encore un peu violente, mais il y a du « copinage » entre les structures et ces services : pourquoi l'HAD ? Pourquoi le SSIAD ? Pourquoi pas l'infirmière ?
On n'y comprend plus rien, on ne sait pas qui on est, les rôles ne sont pas bien définis. Il suffirait pourtant que tous les actes de notre décret de compétences exercés à domicile soient reconnus, et tout irait mieux.
Vous parliez de responsabilité. Oui, nous faisons des actes et nous prenons des décisions. Nous n'avons pas de préconisations, nous changeons les dosages, par exemple pour les diabétiques. Nous le faisons parce qu'il faut bien le faire, parce la santé de nos patients passe avant tout. Si nous ne le faisions pas, cela entraînerait des coûts supplémentaires, auxquels nous pensons aussi, parce que nous sommes des professionnels de santé, mais aussi des citoyens. Bien sûr, s'il arrivait quelque chose, cela poserait problème.
Actuellement, la collaboration avec les aides-soignantes n'est possible que dans le cadre des SSIAD puisque les infirmières peuvent être appelées par les SSIAD pour intervenir pour des soins infirmiers. Mais ce sont des soins très ponctuels. Les forfaits de SSIAD étant de 35 euros par jour, il était impossible pour un SSIAD de prendre au long cours un patient avec des soins infirmiers techniques, donc importants. La solution, qui a été récemment trouvée, consiste à permettre au SSIAD de collaborer avec l'HAD, qui est beaucoup plus chère : le décret est sorti.
Il suffirait de sortir les soins techniques infirmiers des forfaits de SSIAD, qui seraient à nouveau pris en charge par l'assurance-maladie, pour que la collaboration infirmières-SSIAD se fasse dans un esprit de collaboration. Or, actuellement, dans certains secteurs, les infirmières considèrent les SSIAD comme des concurrents, alors que nous pourrions être complémentaires dans l'offre de soins.
Je n'ai pas connaissance de problèmes de maintien à domicile, qui est assuré dans toute la France, que ce soit par des SSIAD, effectivement en collaboration avec les infirmiers, mais dans le cadre de prises en charge simples et non complexes puisque le forfait est extrêmement bas. Cela étant, les honoraires des infirmiers ne sont pas non plus très élevés.

Je voudrais vous interroger sur les outils de régulation dont il a été question à l'instant. Pourquoi avez-vous participé à la mise en place de cette régulation d'installation ? Comment ? Quel a été votre rôle vis-à-vis des pouvoirs publics ? Quel bilan en tirez-vous aujourd'hui ?

Je ferai quelques observations rapides, inspirées par l'échec de la discussion sur le décret des IPA.
On ne sortira des difficultés d'accès aux soins dans l'ensemble du territoire que lorsque l'on aura donné à chaque professionnel de santé la reconnaissance à laquelle il a droit. Une infirmière, ce n'est pas seulement une dame gentille et souriante qui fait un pansement de temps en temps, c'est un professionnel de santé. Un pharmacien, ce n'est pas seulement un marchand de pilules, c'est un professionnel de santé. Un kinésithérapeute, ce n'est pas seulement quelqu'un qui positionne quelqu'un sur un vélo pendant deux heures, c'est un professionnel de santé.
Il faut impérativement que chacune de ces professions paramédicales bénéficie d'une vraie reconnaissance, et que l'on envisage de les positionner en amont des consultations médicales. C'est aussi par ce canal qu'on arrivera à traiter le problème de la démographie médicale.
Cela soulève une autre question, celle de la formation, sur laquelle je voudrais que l'on revienne. Il me semblerait intéressant de transférer la formation des paramédicaux à l'université, dans des instituts qui les amèneraient au même niveau que celui qu'ils ont aujourd'hui – une équivalence licence – et de prévoir des spécialisations jusqu'à un niveau bac plus 5, ce qui permettrait de remettre sur la table la question des IPA.
Comment ressentez-vous cette nécessité de formation, et cette nécessité de reconnaître le rôle et la place des professions paramédicales ? Le regard qu'on porte sur elles date beaucoup, il faut le faire changer.

Il faut toujours recentrer l'offre et la qualité de soins sur le patient, que l'on a parfois tendance à oublier.
Vous avez parlé de consultation avancée mais je pense aux médecins de Marly-Gomont, en Thiérache – dans l'hyper-ruralité, donc – qui m'ont livré leur témoignage : ils n'ont pas attendu l'implantation de maisons pluridisciplinaires de santé pour agir en groupe, et ils proposent précisément des consultations avancées, un jour par semaine par exemple, dans tel ou tel village. Les lieux de consultation – une école désaffectée ou autre – sont aisés à trouver et le médecin, au fond, n'a besoin que de sa trousse pour intervenir.
Selon vous, quelle doit être l'articulation entre le médecin et l'infirmier dans ce domaine ? La médecine évolue, les maladies chroniques se développent – plus de 80 % des diabètes sont suivis en médecine de ville – et vous jouez un rôle essentiel en matière de prévention primaire, car vous exercez dans une proximité beaucoup plus grande que les médecins qui, eux, n'ont pas le temps d'effectuer des visites à dix ou vingt kilomètres de leur lieu de consultation.

En amont du rapport de M. Vigier, qui paraîtra cet été, il se trouve qu'il y a deux jours j'ai rendu à la ministre un rapport sur l'accès aux soins qui aborde les CPTS et les soins coordonnés. J'y propose notamment de décloisonner et de reconnaître les compétences des pharmaciens, des kinésithérapeutes et des infirmiers. J'y aborde également les questions de la télémédecine, des visites à domicile, de la consultation sous protocole, et ainsi de suite. Quel sentiment vous inspirent ces propositions ?

À l'évidence, les infirmières ont besoin que leurs compétences soient reconnues. Nous avons évoqué les formations, parfois conséquentes, qui peuvent être dispensées. Ma question, cependant, est précise : pourquoi ne parvenez-vous pas à faire reconnaître vos compétences ? Je vous prierais de me répondre en nommant les choses – les lobbies par exemple.
La technostructure française est médicocentrée. Nous avons tendance à considérer que ce qui est bon pour les médecins l'est aussi pour l'ensemble des professions de santé. C'est aussi simple que cela !
Nous défendons un projet de réorganisation des soins sur les territoires, monsieur Mesnier, notamment les CPTS et les équipes de soins primaires. Je crains cependant que les CPTS, étant donné les modalités de leur mise en place, ne soient que des coquilles vides. L'objectif est de travailler ensemble pour éviter les redondances et améliorer la pertinence des soins, mais une gouvernance exercée par une multitude d'acteurs chargés de la coordination – comme cela s'est déjà vu avec les CLIC (centres locaux d'information et de coordination gérontologique), les MAIA (méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie) et autres – ne produira pas de résultats. Il faut partir du terrain, de sorte que les professionnels de santé se regroupent et travaillent ensemble, faute de quoi nous échouerons. Les professionnels libéraux ont l'habitude de travailler de manière cloisonnée et verticale plutôt qu'horizontale. Je défends des projets concrets consistant à créer d'abord des équipes de soins primaires puis, dans un deuxième temps, des équipes de second recours pour créer une CPTS. Pourtant, nous allons peut-être devoir procéder dans le sens inverse, car certains acteurs – les cliniques et les acteurs du second recours par exemple – se positionnent déjà pour entrer dans la médecine de ville ; ils ne connaissent pas les professionnels libéraux ! Cela ne marchera pas.
Nous sommes tout à fait favorables à la télémédecine, mais elle ne doit pas être redondante par rapport aux actes existants. Elle doit répondre à une nécessité, dans le seul but d'améliorer le temps médical. La télémédecine en soi ne résoudra aucun problème si un professionnel de santé compétent n'intervient pas derrière l'écran ; si le patient est seul, elle sera inutile.
S'agissant des infirmières, il faut mettre au point des bilans des prises en charge de tous types, y compris la prévention et l'éducation thérapeutique. Nous proposons justement d'utiliser à terme un outil numérique pour élaborer un programme d'éducation thérapeutique partagé. Toutes les informations relatives au parcours du patient qui seront nécessaires aux autres intervenants pourront ensuite être intégrées au DMP.
Selon moi, il faut commencer par traiter la question des équipes de soins primaires (ESP) avant celle des CPTS. Les professionnels de santé ont besoin de structures d'appui telles que des maisons ou des réseaux pour les aider à s'organiser en ESP, car c'est un travail d'organisation considérable et les professionnels sont déjà accaparés par leurs actes.
Permettez-moi de revenir sur les compétences de chacun : nous sommes tous complémentaires. Le dispositif Asalée (action de santé libérale en équipe) est très pertinent mais, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai une formation à l'éducation thérapeutique que je ne peux pourtant dispenser qu'à titre gracieux car elle n'est pas reconnue dans notre nomenclature. Certaines infirmières Asalée travaillent dans des cabinets médicaux mais je regrette que nous n'ayons aucun retour concernant ces consultations. Prenons l'exemple d'un patient diabétique : il est vu à domicile par une infirmière Asalée et ensemble, ils fixeront des objectifs et prendront des décisions – dont nous n'aurons pas connaissance ! Nous travaillons de manière cloisonnée.

Vous évoquez les ESP, mais l'objectif concernant la CPTS vise précisément à engager des moyens humains de coordination pour aider les professionnels à établir des réseaux. De ce point de vue, la CPTS me semble être l'échelon adapté pour aider les professionnels à s'acquitter des tâches administratives hélas très lourdes que nécessite leur mise en réseau.
La régulation démographique a été mise en place par la convention de 2007 à l'initiative de l'assurance maladie, qui entendait mieux contrôler les installations en raison des dépenses de santé qu'elles généraient par le jeu de l'offre et de la demande. Il est vrai que de très nombreuses infirmières quittent l'hôpital, pour des raisons diverses liées notamment aux conditions de travail et à la rémunération. En outre, les réorganisations en cours entraînent un phénomène de chômage des infirmières dans certains secteurs. De ce fait, lorsqu'une infirmière ne trouve pas de poste salarié, elle s'installe dans le secteur libéral.
La régulation a produit des effets positifs dans certaines zones et des effets moins positifs dans d'autres : de nombreuses infirmières n'ont pas eu d'autre choix que de s'installer dans des zones – notamment périphériques – sans besoins particuliers, un phénomène qu'il a été difficile de contrôler et qui se traduit par une situation pour le moins complexe et quelque peu déséquilibrée.
Le système doit être mis en oeuvre dans l'intérêt des patients. Les infirmiers s'installant dans tel ou tel secteur répondront-ils concrètement aux besoins des patients qui s'y trouvent ? Certains infirmiers n'ont guère de travail dans le secteur où ils sont installés.
Ajoutons que des biais sont possibles : les zones en situation de surdensité sont très bien régulées, mais les zones voisines, elles, ne le sont pas, ce qui permet à n'importe qui de s'y installer pour aller travailler dans les zones surdenses. Le système d'accessibilité potentielle localisée (APL) instaurera cependant un nouveau mode de régulation.
En 2007, lors de la mise en place de la régulation démographique, l'écart d'installation entre zones, notamment entre départements, était d'un à sept, à population égale. Il fallait donc agir pour éviter de créer des problèmes d'accès aux soins. Nous avons donc instauré un système en échelle de perroquet : d'abord un mécanisme très léger, à titre expérimental, puis, ses résultats étant probants, un système renforcé qui n'a cessé de gagner en efficacité. Aujourd'hui, nous négocions la mise en place d'un nouveau système, l'APL, qui permettra de lisser au mieux les biais qu'évoquait Mme Sicre en tenant compte des temps de déplacement des professionnels et des patients.
Ce système, que nous affinons, a fait ses preuves. On parle de déserts médicaux : pourquoi dès lors ne pas appliquer la régulation démographique à l'ensemble des professions de santé ?

Cette régulation a-t-elle été ressentie par les infirmiers comme une entrave à leur liberté ?
Absolument pas, bien au contraire : les infirmières en redemandent. Prenons l'exemple de la Guadeloupe qui, lors de l'entrée en vigueur de la régulation, était considérée comme une zone intermédiaire – ni surdotée, ni sous-dotée. Le très grand nombre d'installations qui s'y sont produites depuis a provoqué une situation de quasi-guerre civile professionnelle. Ce sont les professionnels eux-mêmes qui demandent la régulation !
Nous demandons une régulation démographique qui soit maîtrisée par les professionnels de santé, et non pas à la seule main de l'État, car cela susciterait des craintes concernant les structures. Les ARS, par exemple, prônent systématiquement le tout-structure.
La question de la porosité et de la collaboration des métiers est très intéressante. Chaque corps – médecins, infirmiers, pharmaciens – protège son propre champ de compétences. Les collègues avec qui il faudrait collaborer sont considérés comme des concurrents potentiels. Les infirmières ont peur que les aides-soignantes ne leur prennent des actes, mais les médecins nourrissent la même crainte au sujet des infirmières. Or, le parcours du patient crée nécessairement une porosité des métiers ; il faut l'encadrer.
J'ignore pourquoi, mais les acteurs du secteur libéral ne savent pas travailler ensemble. Je me suis installée en 1980 dans un regroupement pluridisciplinaire qui existait depuis 1975. Les quatre médecins de garde se sont associés pour alterner les gardes de nuit et de fin de semaine, et ont demandé aux personnels paramédicaux de travailler avec eux. Ce regroupement englobait donc un laboratoire d'analyses, un kinésithérapeute, un dentiste, des infirmiers, des spécialistes en cardiologie et en radiologie. Personnels médicaux, paramédicaux et spécialistes : nous travaillons tous ensemble et cela fonctionne très bien, dans le respect mutuel, la communication et la bonne entente. Le reproche de compérage ne nous a jamais été adressé ; chacun est à sa place.
Quant aux études, le syndicat que je représente rejette majoritairement la spécialisation des infirmières : nous prônons le niveau licence pour tout le monde. Ensuite, chacun est libre de choisir son secteur. La spécialisation créerait une strate supplémentaire parmi nous : outre les infirmières et les médecins, il y aurait une nouvelle catégorie de super-infirmières ? Pourquoi une spécialisation des infirmières ? Les adhérents de notre syndicat réprouvent cette option.
J'ai récemment créé une équipe de soins primaires composée de quinze professionnels de santé fondateurs, une quinzaine d'autres voulant y entrer, notamment un laboratoire. Nous ne nous connaissions pas tous ; c'est la preuve qu'il est possible de travailler et de se former ensemble, et de mettre au point des protocoles de prise en charge et de bilan. Nous allons aussi tâcher d'avancer sur la question plus délicate de l'accès aux soins du point de vue du médecin. Mon équipe de soins comprend de jeunes femmes médecins pour qui il est beaucoup plus difficile d'accepter une éventuelle ouverture d'horaires afin de prendre en charge les patients concernés. Quoi qu'il en soit, je le répète : ne pas se connaître n'empêche pas de parvenir à travailler ensemble.
D'autre part, nous connaissons avec l'hôpital un sérieux problème lié à l'absence totale de fiches de liaison. Il nous arrive de prendre en charge des patients qui sortent de l'hôpital sans savoir ce qu'ils ont, et ce n'est éventuellement qu'à la lecture de l'ordonnance que nous le découvrons. Parfois, le patient est capable de nous informer mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai déjà eu à prendre en charge un patient atteint du sida sans en avoir été informée. C'est à croire qu'il ne faudrait pas nous divulguer l'information – je trouve cette manière de faire lamentable. Nous sommes tout de même en 2018 !
Permettez-moi de revenir sur la question de la reconnaissance de la formation. Aujourd'hui, la formation des infirmières équivaut à un bac +3, c'est-à-dire une licence, alors que si l'on comparait le temps d'études des infirmières avec le temps universitaire, elles atteindraient plutôt le niveau bac +6. Cela étant, l'universitarisation est importante pour permettre aux infirmières d'évoluer dans leur filière. J'ajoute qu'en France, les infirmières ne font pas de recherche comme c'est le cas ailleurs : la recherche en sciences infirmières est le fait des médecins. Nous n'avons pas de docteur en sciences infirmières – alors qu'il s'agit bien de disciplines scientifiques propres.
Le Haut conseil des professions paramédicales (HCCP) a rejeté en bloc le projet de décret sur les IPA et nous l'avons refusé aussi au motif qu'il ne donne pas une autonomie suffisante à l'IPA, encore trop sous la coupe des médecins. Nous refusons d'être les petites mains des médecins. Ceux-ci attendent des assistantes, peut-être des secrétaires, mais nous sommes des infirmiers à part entière, et nous détenons des compétences – dont certaines sont complémentaires avec celles des médecins, d'autres uniques.
Il est vrai que la consultation avancée pose problème dans les zones désertes. Les infirmières pourraient y effectuer des pré-consultations dans les zones où l'accès aux urgences est difficile. Une expérimentation a été conduite en Normandie avec un hôpital et une clinique où les infirmières assurent des gardes. Leur rémunération est couverte par une enveloppe de l'ARS. Les infirmiers peuvent ainsi effectuer un tri préliminaire pour déterminer si l'intervention d'un médecin voire l'hospitalisation sont nécessaires.
Quant à votre rapport, monsieur Mesnier, j'estime que vous n'y parlez guère des infirmiers. Je l'ai lu avec beaucoup d'attention : nous avons certes eu droit à une petite phrase in extremis – il a fallu attendre la trente-huitième page pour voir apparaître quelque chose nous concernant.

Je me suis aperçu a posteriori que le texte ne les faisait peut-être pas assez ressortir. Vous aurez néanmoins constaté que je passe mon temps, surtout ces derniers jours, à parler des infirmiers !
La solution à l'engorgement des files actives dans les services d'urgence se trouve en amont. La prise en charge dans les déserts médicaux pose sans doute problème, mais entrez là où il y a de la lumière, c'est-à-dire dans les cabinets d'infirmiers libéraux qui ont l'obligation d'assurer la continuité des soins. Nous sommes la seule profession de ville accessible aux patients à tout moment, sept jours sur sept.

Nous devons à tout prix travailler en subsidiarité et de manière efficiente. Dans la maison médicale où j'exerçais jusqu'à récemment, les infirmières me disaient qu'il est plus « rentable » de faire une piqûre d'insuline qu'une toilette – car une toilette prend du temps. Lorsque le territoire d'intervention est vaste et les patients nombreux, le travail se fait en subsidiarité et nous sommes pris au piège d'une sorte de course à l'acte. À quel niveau doit selon vous être fixée la forfaitisation des actes concernant des patients souffrant de maladies chroniques, pour assurer une prévention plus efficiente ?

S'agissant de la démographie médicale, je crois qu'il y a erreur sur le nombre de médecins généralistes : selon l'INSEE, la France en comptait 136 600 en juin 2017.
Mon souci concerne votre proposition de permettre aux infirmiers d'intervenir en première ligne pour effectuer un tri initial afin d'orienter les patients vers les urgences ou les médecins traitants. J'ai le plus grand respect pour vos compétences et votre professionnalisme, mais nous savons tous combien la rapidité de la prise en charge de certains patients est importante. Que se passerait-il en cas d'erreur de pré-diagnostic lors du tri préalable effectué par un infirmier ?
Vous proposez également une notion nouvelle, celle d'infirmière référente, sur le modèle de celle du médecin traitant. Je m'interroge sur la possibilité que vous auriez d'enregistrer vos actes dans le dossier médical du patient. Question subsidiaire : la charge de travail supplémentaire ainsi induite entraînerait-elle une surtaxation de vos honoraires, dont vous avez indiqué qu'ils ne sont pas très élevés ?
Nous entretenons des contacts avec les ARS par l'intermédiaire des unions régionales des professions de santé (URPS), mais nous constatons qu'elles ont une vision structurocentrée du système. Elles ne retiennent de l'offre de soins que ce qui est visible et lisible de leur point de vue, notamment les structures – hospitalisation à domicile, services de soins infirmiers à domicile – à côté desquelles l'offre libérale n'existe pas. Une étude – qui date un peu, certes – démontre pourtant que 75 % des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans sont prises en charge par le secteur infirmier libéral.
Autrement dit, les ARS ne prennent en charge que 25 % de ces patients. Je prends cet exemple à dessein pour illustrer la logique des ARS.
D'autre part, les CPTS n'existeront selon moi que si elles ont un projet professionnel à l'échelle du territoire. Pas de projet, pas de CPTS. Il ne sert à rien de créer des coquilles vides.
L'infirmière référente n'aura pas à inscrire ses actes dans le dossier médical mais simplement à identifier les professionnels qui interviennent auprès d'un patient dans son parcours de soins, surtout en cas d'hospitalisation, afin d'éviter toute rupture du lien entre les intervenants et de préparer le retour au domicile, lequel se fait aujourd'hui dans le cadre du programme de retour à domicile (PRADO) – je peux en témoigner de première main – et est organisé par le personnel de la caisse d'assurance maladie. Si les professionnels autres que le médecin traitant étaient identifiés, ils pourraient aisément – l'infirmier, en particulier – se charger du retour à domicile des patients, d'où l'intérêt selon moi d'une infirmière référente.
Quant au rôle des infirmières dans la prise en charge par les urgences, il ne s'agit pas qu'elles fassent un diagnostic mais simplement une évaluation clinique qui permet d'orienter le patient. Certes, la prise en charge doit être rapide. Cependant, vous êtes élue d'une zone rurale, madame Michel : hormis les pompiers et le Samu, il est parfois difficile de faire venir des professionnels en urgence. Or, les pompiers et le Samu emmèneront les patients à l'hôpital le plus proche moyennant des distances allant parfois jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres. Les infirmières, elles, sont souvent appelées pour faire de la « bobologie », ce traitement des affections légères qui, autrement, engorge les urgences, surtout en soirée et en fin de semaine.
Les infirmiers libéraux et même la médecine libérale dans son ensemble n'apparaissent nulle part dans les projets régionaux de santé de deuxième génération : c'est vous dire combien les ARS nous considèrent !
Quant aux soins d'hygiène – et non la toilette, monsieur le député –, ils sont rémunérés par un forfait brut de 7,95 euros qui englobe la prise de sang, l'injection et les petits pansements. Une piqûre intramusculaire est rémunérée 4,35 euros bruts. En outre, les infirmières se déplacent sans cesse au domicile des patients – et ce sont les seules à le faire. Chaque déplacement est rémunéré 2,50 euros bruts ! Nous avons maintes fois sollicité le ministère de l'intérieur à ce sujet, car le prix du diesel a considérablement augmenté. Autant vous dire que les infirmières se heurtent à de graves difficultés lorsqu'elles passent à la pompe à essence, parce qu'elles ne sont pas rémunérées à leur juste valeur compte tenu de l'augmentation des carburants.
Autre point : les diagnostics. Les orthoptistes font désormais des pré-consultations consistant à travailler sur une fiche pour le compte de l'ophtalmologiste, ce qui prend du temps. On pourrait très bien imaginer que les infirmiers travaillent de la même manière en amont, le diagnostic restant confié au médecin. Nous ferons quant à nous des relevés de surveillance clinique infirmière à partir de l'observation de symptômes. Rappelons que les infirmières sont formées à l'observation globale d'un patient. Hélas, aucun acte ne correspond à cette prise en charge.
L'accès direct, enfin : les kinésithérapeutes le réclament pour prendre en charge des entorses, par exemple. Nous pouvons également prendre en charge des patients en accès direct, sans qu'ils aient à passer par le médecin. La compétence des infirmières en matière de pansements est avérée : c'est un cas où l'accès direct est parfaitement envisageable. Nous nous heurtons cependant au problème constant de la prescription : les infirmières ne sont pas habilitées à prescrire des antiseptiques, par exemple, ni aucun autre produit nécessaire à l'accès direct. Il faut débloquer toutes ces questions.
Mme la députée Michel a dit nous respecter pour, dans la foulée, craindre le risque que nous commettions des erreurs : pourquoi en commettrions-nous plus que d'autres – que les médecins, par exemple ? Si vous mettez nos compétences en question, il faut le faire pour tous les professionnels de santé, et même tous les professionnels quels qu'ils soient ! Le contraire n'est pas très sympathique.
Vous avez évoqué les maisons de garde et les médecins et infirmiers qui se chargent de ces gardes. Nous sommes tenus d'exercer en permanence, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept ; nous effectuons donc ces gardes, en quelque sorte. Lorsque les patients n'arrivent pas à accéder à un médecin, ils nous appellent, et nous sommes démunies. Si l'accès direct – ou le pré-tri, même si le terme n'est sûrement pas idéal – existait, nous pourrions résoudre d'innombrables problèmes. Nous sommes aussi des citoyens, nous avons des parents, nous sommes les vieux de demain, et c'est pourquoi nous voulons que l'accès aux soins puisse être égal pour tous sur tout le territoire, car les professionnels de santé citoyens que nous sommes constatent ces difficultés en permanence.
Je reviens à la préférence supposément donnée aux piqûres d'insuline par rapport aux « toilettes ». La tendance actuelle – qui est lourde – est à favoriser le forfait par rapport au paiement à l'acte. Le paiement à l'acte présente l'inconvénient de favoriser l'inflation, mais la forfaitisation conduit à la sélectivité des patients. Si tous les professionnels sont rémunérés au forfait, y compris les infirmières, la sélection des patients s'en trouvera renforcée et certains patients ne trouveront plus d'infirmières.
En effet, parce que les cas les moins complexes seront traités en priorité !
Le paiement à l'acte permet de décrire l'acte en question – une injection, par exemple – et de le rémunérer en conséquence. Les SSIAD créés en 1981 et forfaitisés constituaient initialement une alternative à l'hospitalisation. Au fil du temps, ils se sont transformés en services de maintien à domicile. Il ne s'agissait donc plus d'une alternative à l'hospitalisation, ce qui a nécessité la création des services d'hospitalisation à domicile. La forfaitisation induit la sélectivité des patients. Si la prise en charge des personnes dépendantes est forfaitisée, par exemple, les patients les moins contraignants pour les professionnels de santé seront pris en charge en priorité pour des raisons économiques – c'est naturel. On l'observe d'ailleurs tous les jours.
Pour corroborer les propos de M. Guillerm, je dirai que certains SSIAD prennent en effet en charge les patients les plus « légers » qui ne nécessitent pas des soins quotidiens mais trois à quatre déplacements par semaine seulement – alors que la rémunération correspond à des soins quotidiens.
Je reviens sur la question des compétences des infirmières en citant un exemple dont j'ai été témoin il y a une quinzaine de jours et encore la semaine dernière dans ma propre patientèle. Les infirmières sont en bout de chaîne. À chaque fois qu'un médecin prescrit un médicament et qu'il est délivré, l'infirmière a obligation de vérifier l'ordonnance, la date de péremption du médicament, sa posologie et d'autres données. À deux reprises, donc, notre cabinet d'infirmiers a évité de graves erreurs, notamment dans le cas d'un enfant à qui un médicament avait été prescrit à une dose dix fois supérieure à la dose adaptée – erreur que le pharmacien n'avait pas détectée. Chacun ses compétences, certes, mais la vigilance des infirmières qui, en bout de chaîne, sont chargées d'injecter les produits, est pleine et entière. La semaine dernière encore, un pharmacien n'a pas donné la posologie adéquate à l'un de mes patients à qui nous n'avons donc pas pu délivrer immédiatement le médicament ; il a fallu retourner chez le pharmacien – qui, accessoirement, était fermé le soir, mais je vous passe les détails.

Vous évoquiez la forfaitisation, qui suscite certes des abus, mais il me semble que le paiement à l'acte n'est pas non plus sans danger car il favorise une forme d'abattage et, par conséquent, le travail mal fait.
En effet : comme je vous le disais, c'est inflationniste !

Quelle que soit la solution retenue, un encadrement est nécessaire, car les abus existent partout.
Je m'interroge, madame Sicre : la rémunération de 2,50 euros pour les déplacements prend-elle la forme d'un forfait ou d'une indemnité kilométrique ?
C'est une indemnité forfaitaire de déplacement.

Soit. S'agissant de l'ARS, enfin, je conclus de vos propos qu'étant donné la feuille de route des plans régionaux de santé et la priorité accordée au maillage territorial, les infirmiers libéraux auraient été oubliés dans la concertation ; est-ce le cas ?
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que le logiciel des ARS privilégie les structures. Les directeurs d'ARS auront quelque difficulté à vous décrire les tâches d'une infirmière libérale ; demandez-leur en revanche en quoi consistent les missions d'un service de HAD et ils vous feront une réponse précise.
Nous voulons vous dire ceci : dans le cadre du virage ambulatoire, les ARS ne s'appuient pas assez sur les représentants régionaux des secteurs de ville, notamment les URPS, pour élaborer les plans régionaux de santé – même si elles le font tout de même un peu puisque les textes les y obligent. En pratique, cependant, tout indique que leur vision est structurocentrée : elles privilégient l'hôpital, les structures telles que les SSIAD et la HAD, mais quid du reste ?
Permettez-moi de revenir sur la question des gardes dans le secteur privé et le secteur public. Lorsque j'ai commencé d'exercer il y a trente ans, à Grenoble, les infirmières pouvaient s'inscrire sur une liste de garde volontaire : elles se rendaient au Samu du CHU où il leur était donné un boîtier – les portables n'existaient pas à l'époque – qu'elles utilisaient pour faire de véritables gardes de nuit, y compris en effectuant les injections prescrites. Ce type de garde n'existe plus – hors continuité des soins – puisque les infirmières sont déprescrites. Prenons l'exemple d'un patient rentrant à domicile pour une chimiothérapie de quarante-huit heures : je dors toujours à proximité de mon téléphone car, si la perfusion pose problème, je me déplace sur-le-champ.
Il est vrai que les ARS sont non seulement structurocentrées mais aussi médicocentrées. Tous les élus régionaux que nous sommes – je le suis dans la région PACA – ont constaté que la part des infirmières dans les plans régions de santé est quelque peu légère. D'autre part, il me semble que les responsables politiques méconnaissent notre métier et nos capacités. M. Grégory Emery et un responsable de l'ARS de la région PACA ont récemment fait une tournée à Mayotte en compagnie d'un infirmier libéral pour constater la réalité de la situation sur place. Leurs conclusions sont très instructives. Nous ne faisons pas de « toilettes », monsieur Delatte ; nous effectuons des soins d'hygiène et assurons une prise en charge globale du patient. La toilette, quant à elle, peut être faite par un conjoint ou toute autre personne. Il est heureux qu'il ne soit pas nécessaire de recourir à une infirmière pour faire une toilette en cas de problème de santé.
Nous prodiguons donc des soins d'hygiène, qui sont déjà forfaitisés à raison de 7,95 euros bruts par demi-heure. Autrement dit, le tarif des soins d'hygiène des infirmières est inférieur à celui d'une femme de ménage, hors le forfait de déplacement qui s'élève à 2,50 euros, puisque l'indemnité kilométrique ne vaut qu'en zone rurale ou montagneuse – ce qui pose un problème en zone urbaine où le temps passé dans les embouteillages est également rémunéré 2,50 euros. Or, les hypercentres des grandes métropoles commencent à peiner à trouver des professionnels de santé parce qu'il est impossible de s'y garer et d'y circuler pour 2,50 euros, et que le temps passé en voiture est souvent supérieur au temps passé à effectuer les soins.
Je reviens sur les gardes. En Nouvelle-Aquitaine, un pool d'infirmières libérales a mis en place un service de garde avec des pharmaciens, qui leur remettent des mallettes d'urgence. Leur astreinte est rémunérée par l'ARS et elles assurent des gardes de nuit pour toutes sortes de patients ; elles sont joignables à un numéro de téléphone communiqué par l'ARS.
Le stationnement, ensuite : c'est en effet un problème. J'ai plusieurs fois interpellé en vain le président de l'Association des maires de France et le ministère de l'intérieur. Nous avons adressé des courriers dans toutes les villes où des problèmes de stationnement existent. La carte de stationnement est très chère dans certaines villes et vous comprendrez qu'avec 2,50 euros, il est difficile d'y stationner, d'y circuler et de mettre du carburant dans les véhicules. Plusieurs villes comme Paris ont résolu le problème en accordant un macaron santé gratuit aux infirmiers dès lors qu'ils adressent leur numéro ordinal et leur cotisation à la mairie – ce qui est normal. Ailleurs, il est à mon sens probable que se créent des zones blanches sans infirmiers à cause de ce seul problème de stationnement. Les professionnels ne se déplaceront plus dans des endroits où les amendes sont aussi élevées et où la carte de stationnement coûte 300 euros.

Permettez-moi d'illustrer ce que je disais tout à l'heure sur le regard que l'on porte sur le monde de la santé et son organisation, qui est ancienne. Vous évoquiez l'incapacité à prescrire du sérum physiologique, qui est pourtant un produit vendu en grande surface : autrement dit, il est interdit à un professionnel de santé de prescrire un produit que le patient peut se procurer directement et sans prescription dans les rayons d'un grand magasin !
Permettez-moi également d'évoquer une dimension de la fonction des infirmières, notamment libérales, qui me paraît essentielle et illustrative de la nécessaire collaboration horizontale avec les autres professionnels de santé. Parce que vous passez beaucoup de temps au domicile des patients, vous êtes les seules à pouvoir faire de l'observance des traitements. Or, cette question est très problématique pour l'assurance maladie, parce qu'il arrive souvent que vous retrouviez dans un sachet délaissé des médicaments qui ne seront jamais pris, alors qu'ils ont un coût énorme.
En outre, votre rôle en matière d'observance des traitements permet aussi de prévenir le risque iatrogénique : souvent, dans ces petits sachets délaissés au bout de la table de la salle à manger, se trouvent aussi des médicaments qui sont mal pris. Le risque iatrogénique fait dix mille victimes chaque année en France. C'est la preuve que la collaboration entre les médecins, les infirmières, les pharmaciens et d'autres professionnels de santé est indispensable.
Nous sommes en cours de négociation conventionnelle avec la CNAMTS sur l'observance. Nous ne disposons pas encore d'acte nomenclaturé pour prendre en charge ces patients. La CNAMTS refuse d'y consacrer les fonds nécessaires et propose des actes très restrictifs. Au moins deux de nos organisations syndicales ont notamment demandé un bilan médicamenteux lors de la prise en charge de ces patients, mais la CNAMTS l'a occulté.
En ce qui concerne la transversalité, nous avons fait des propositions qui, là encore, ont été rejetées. C'est pourtant une nécessité : nous avons des armoires pleines de médicaments. C'est catastrophique, mais nos capacités d'observance ne sont pas prises en considération par l'État et par la CNAMTS – ou alors à moindre coût.

Je vais m'efforcer de conclure en évoquant quelques points que cette audition a mis en relief. J'ai notamment été très attentif à vos remarques sur les mesures de régulation. Il est utile de constater avec le recul du temps les résultats, positifs et négatifs, d'une expérimentation dans laquelle la profession s'est totalement impliquée.
J'en viens à la notion de coopération : c'est un véritable édifice, un jeu de Lego que nous bâtissons. Il faut reconnaître les compétences des professionnels de santé – je rechigne à distinguer entre les professionnels médicaux et paramédicaux, car tous sont des professionnels des soins ; ne jouons pas sur les mots. Chacun a ses compétences, sa formation, sa mission.
Ensuite, je suis favorable à la porosité, à la perméabilité entre les corps. L'expérience grenobloise que vous avez décrite, madame Pacchioli, est intéressante : pour accueillir les patients à leur sortie – toujours plus tôt – de l'hôpital, les premiers fantassins sont les infirmiers. J'ai moi aussi connu les gardes à l'ancienne, il y a trente ans : elles présentaient l'avantage de la prise en charge permanente. Il va bien falloir réfléchir à une nouvelle organisation des gardes.
S'agissant du dispositif Asalée, je vous demanderai de nous présenter un récapitulatif de la nomenclature des tâches à vous confier. Tout travail mérite rémunération. Nous avons certes des pistes en tête mais c'est de la confrontation des idées que naîtront les propositions les plus équilibrées.
D'autre part, ma question sur les plateaux de régulation est restée sans réponse. Je rebondissais sur une proposition de M. Mesnier : à multiplier les instances de régulation – le 15, le 112, le SMUR, SOS Médecins –, on finit par produire de la dérégulation. Selon vous, serait-ce une perspective d'ouverture professionnelle que de placer les infirmiers au coeur des plateaux de régulation – comme dans les métiers du numérique ? Nous avons eu cette conversation avec Pierre Simon, ancien président de la Société française de télémédecine. Si les interlocuteurs répondant sur les plateformes n'ont pas les compétences requises, alors ces plateformes sont vouées à échouer. Les nouveaux métiers me semblent donc receler de nouvelles possibilités.
Enfin, je crois à l'infirmière de 2020 dotée d'un micro-ordinateur, comme c'est déjà parfois le cas dans les hôpitaux et les EHPAD où, à condition d'utiliser des logiciels adéquats, elles peuvent faire apparaître sous leurs yeux toutes les incompatibilités médicamenteuses. Il me semble utile que les infirmières puissent noter dans les DMP différents actes comme des injections, par exemple. Loin d'être de la suradministration, cette précaution me semble participer d'une chaîne de soins et représenter un gage d'efficacité qui permettrait en outre d'apporter une solution mixte de rémunération – sans la réduire à la simple alternative entre la tâche et le parcours – qui s'appuierait sur la traçabilité. Je rappelle qu'une seule profession a accepté l'accréditation en médecine : les biologistes. Existe-t-il une traçabilité plus contrôlée des professions de santé, et vous agréerait-elle ?
Selon la Fédération nationale des infirmiers, le dispositif Asalée n'est pas un modèle adapté, car il consiste – comme ce à quoi les médecins sont parvenus avec le décret IPA – à vider le décret de sa substance pour produire des assistantes médicales. De fait, les infirmières Asalée sont aujourd'hui des assistantes médicales.
Nous sommes très favorables à l'instauration du DMP mais c'est une arlésienne dont on nous parle depuis plus de dix ans sans évoquer les outils. En ce qui nous concerne, nous sommes persuadés que la collaboration passe par le partage d'informations, et que le DMP le favorisera – à condition de ne pas noyer les professionnels de santé sous les informations. Il faut impérativement périmétrer le contenu des informations à intégrer dans le DMP pour que les professionnels concernés évitent de se perdre dans d'immenses bibliothèques où ils ne trouveraient jamais l'ouvrage recherché. À cette condition, tous les outils qui favorisent le partage d'informations amélioreront la coordination et, par conséquent, la prise en charge du patient. En clair : oui au DMP.
En ce qui concerne le DMP, la messagerie sécurisée SISRA a été mise en place dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, mais c'est un outil très lourd et donc très peu utilisé, dont il apparaît au fil de nos conversations avec les médecins qu'il n'est pas pratique. Mieux vaut un outil unique pour l'ensemble des patients et des territoires. Dans mon cas, par exemple, seuls deux médecins avec lesquels je travaille le plus utilisent cette messagerie ; je ne peux donc pas l'utiliser avec les autres. Il faudrait la généraliser et la rendre obligatoire pour garantir la traçabilité et la protection de toutes les informations transmises.
Je rejoins M. Guillerm sur le dispositif Asalée. Quant au plateau de régulation, il offre en effet des possibilités aux infirmières à condition qu'elles soient formées à la prise en charge de l'urgence, comme le sont certaines d'entre elles dans le cadre de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AGFSU).
Le DMP est un outil important dans lequel, à l'image d'une dropbox, nous pourrions déposer des fiches et des bilans concernant un patient pour servir aux autres professionnels de santé. Néanmoins, je sais par expérience de la coordination permanente de la prise en charge des patients que le DMP ne convient pas ; il faut un autre outil. Nous prônons la création d'un outil sécurisé comportant des indicateurs de suivi du patient et d'amélioration de la prise en charge, l'essentiel étant qu'il soit axé sur le patient. De cet outil, nous pourrons extraire des fiches à inclure dans le DMP, qu'il est impossible de rendre accessible en permanence à tous les acteurs qui interviennent autour du patient – au risque de disposer d'une bibliothèque gigantesque dont nul ne saurait se servir, et qui présenterait des risques importants d'erreurs de référencement des dossiers et des informations. Cela étant dit, nous sommes favorables au DMP – même si c'est en effet une arlésienne.
Le DMP serait en effet un bel outil s'il était périmétré, facile d'accès et compatible avec les logiciels métiers, qui varient selon les fournisseurs. Il faudra donc adapter les différents logiciels et leurs versions.
Le dispositif Asalée n'est certes pas la seule solution mais elle est intéressante : les infirmières qui travaillent sous ce régime en sont plutôt satisfaites. C'est un mode d'organisation parmi d'autres, qui produit des résultats et qui permet aux infirmières d'exercer des compétences qu'elles ne pourraient pas exercer autrement, en particulier en matière de prévention et d'éducation thérapeutique.
Toujours sous la tutelle du médecin !

Au cas où ce fait avait échappé à la sagacité légendaire du rapporteur, l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) vient de publier cette semaine une excellente enquête-bilan sur Asalée qui s'appuie sur des entretiens avec de très nombreux acteurs – médecins, infirmières et autres. Éclairante et nuancée, elle confirme que c'est en fonction de la qualité des relations sur le terrain entre médecins et infirmiers que le dispositif fonctionne ou non. Peut-être notre rapporteur voudra-t-il y faire référence.
Dans ce cas, il faut aussi préciser qu'était à l'origine de l'expérimentation Asalée Yann Bourgueil, directeur de l'IRDES. La précision me semble importante.
M. Vigier nous a demandé de nous mettre d'accord sur les tâches qui pourraient nous être déléguées. Soit ; je veux bien m'asseoir autour de la table pour en discuter à condition que l'on ne parle pas de « tâches » – le terme me choque. Je ne fais pas des tâches mais des actes ; j'ai des compétences. Nous avons demandé x fois de supprimer ce terme – comme celui de « toilette » – du vocabulaire qui nous concerne, mais en vain. Je vous le dis franchement : s'il s'agit de me déléguer des « tâches », ce sera non.

Nous attendons donc vos contributions écrites sur les délégations d'actes – et non pas de tâches...
L'audition s'achève à dix heures trente.
————
Membres présents ou excusés
Réunion du jeudi 24 mai 2018 à 8 h 30
Présents. – M. Didier Baichère, Mme Gisèle Biémouret, M. Marc Delatte, Mme Jacqueline Dubois, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Alexandre Freschi, M. Guillaume Garot, M. Éric Girardin, M. Jean-Carles Grelier, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Jean-Michel Jacques, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Bernard Perrut, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, M. Jean-Louis Touraine, Mme Nicole Trisse, M. Philippe Vigier
Excusé. - M. Jean-Pierre Cubertafon