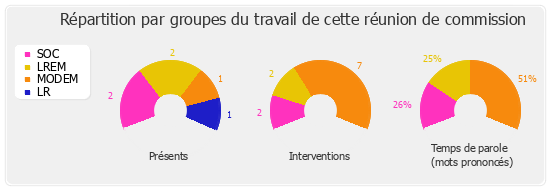Commission d'enquête sur l'impact économique, sanitaire et environnemental de l'utilisation du chlordécone et du paraquat comme insecticides agricoles dans les territoires de guadeloupe et de martinique, sur les responsabilités publiques et privées dans la prolongation de leur autorisation et évaluant la nécessité et les modalités d'une indemnisation des préjudices des victimes et de ces territoires
Réunion du jeudi 4 juillet 2019 à 14h10
Résumé de la réunion
La réunion
Jeudi 4 juillet 2019
La séance est ouverte à quatorze heures dix.
Présidence de M. Serge Letchimy, président de la commission d'enquête
————
La commission d'enquête sur l'impact économique, sanitaire et environnemental de l'utilisation du chlordécone et du paraquat, procède à l'audition de Mme Nathalie Dörfliger, directrice du programme scientifique concernant les eaux souterraines au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), et de Mme Pascale Michel, correspondante « environnement » pour l'appui aux politiques publiques de la direction Eau, environnement et écotechnologies.

Après les échanges assez longs et importants que nous avons eus ce matin, nous recevons Madame Nathalie Dörfliger, directrice du programme scientifique concernant les eaux souterraines au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), accompagnée de Madame Pascale Michel, correspondante « environnement » pour l'appui aux politiques publiques de la direction Eau, environnement et écotechnologies. Je vous souhaite, Mesdames, la bienvenue.
Je rappelle que nous avons décidé de rendre publiques nos auditions. Celles-ci sont donc ouvertes à la presse et diffusées en direct sur un canal de télévision interne, puis consultables sous la forme de vidéos sur le site internet de l'Assemblée nationale.
Je vais vous donner la parole pour 5 ou 10 minutes, afin que vous puissiez vous présenter et nous faire part de vos premiers sentiments, puis nous vous poserons des questions.
L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».
Mme Nathalie Dörfliger et Mme Pascale Michel prêtent successivement serment.
Nous avons préparé un petit dossier que nous allons vous remettre.
Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), qui est placé sous la tutelle des ministères de la recherche, de l'environnement et de l'industrie, et qui compte plus de 1 000 salariés travaillant sur la compréhension des phénomènes géologiques et des risques qui y associés, dans le sol et le sous-sol. Notre activité est organisée autour de plusieurs missions et enjeux, dont la gestion des eaux souterraines, les risques et l'aménagement du territoire, qui ont un lien avec l'objet de votre commission d'enquête. La structuration du BRGM correspond à six enjeux qui sont couverts par des programmes scientifiques, dont celui sur les eaux souterraines dont j'ai la responsabilité au sein de la direction générale.
Les activités menées à l'heure actuelle par le BRGM au sujet du chlordécone concernent l'appui aux politiques publiques, l'expertise et la recherche, en particulier sur le transfert de la pollution des sols, à l'échelle des bassins versants, vers les eaux souterraines et les eaux de surface. Nous réalisons des travaux à la fois en matière de cartographie de la contamination des sols et de remédiation des sols à la suite d'une contamination au chlordécone.
Nous avons examiné la question du transfert du chlordécone dans l'environnement en partenariat avec d'autres organismes, en particulier le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) et l'Institut de recherche pour le développement (IRD), mais aussi avec l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, et désormais avec l'Agence française pour la biodiversité (AFB). L'objectif était de comprendre, dans le cadre d'observatoires, quel était le processus de transfert de ce contaminant et de ses produits dérivés du sol jusque dans l'eau.
Cela nous a amenées à sélectionner deux sites, l'un en Guadeloupe et l'autre en Martinique, qui sont représentatifs du contexte des îles – à savoir des formations volcaniques. Il s'agit du bassin versant Pérou-Pères, en Guadeloupe, et de celui du Galion, en Martinique, qui s'étendent respectivement sur 15 et 40 kilomètres carrés, et vont de 0 à 1 400 mètres NGF (nivellement général de la France) dans le premier cas, et de 0 à 700 mètres NGF dans le second cas. Les sols y sont différents. Leur rôle et celui des formations géologiques sont importants en matière de transfert. Les andosols sont, en particulier, le résultat d'altérations des formations andésitiques, volcaniques, qui sont plus ou moins anciennes – les altérations sont donc plus ou moins importantes. C'est là où il existe beaucoup de sols de ce type qu'il y a le plus fort taux d'absorption, avec les risques les plus élevés, car l'eau qui s'infiltre dans ces sols va transporter des éléments dans le sous-sol, puis dans les eaux de surface.
Nous continuons à travailler sur ce sujet dans le cadre de l'Observatoire des pollutions agricoles aux Antilles (OPALE). Il y a un suivi des eaux météoriques, de surface et souterraines, mais aussi au niveau des sols, avec différents partenaires. On a étudié les temps de résidence du chlordécone dans le sol et dans le sous-sol afin de travailler sur les transferts. On a vu qu'il peut y avoir des contaminations plus importantes dans les eaux souterraines que dans celles de surface, ce qui peut avoir des conséquences sur le cycle de l'eau et sur ce que l'on retrouve en aval. Il y a des échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraines, ces dernières alimentant les cours d'eaux, notamment en période d'étiage – quand il n'y a plus du tout de ruissellement lié aux précipitations, pendant des périodes allant de 20 à 80 jours selon les bassins versants, ce qui peut représenter entre 50 et 90 % du total des cours d'eaux. Cela explique que l'on puisse trouver dans certains endroits, situés en aval des bassins versants, de l'eau qui a transité par le sous-sol et qui a transporté du chlordécone ou des produits dérivés, comme le chlordécone 5b-hydro.
Les temps de transfert et de résidence peuvent aller de quelques années à plusieurs décennies. Il peut exister un stock de chlordécone important de pollution dans le sol. On a effectué des mesures sur les 30 premiers centimètres, mais il peut y avoir des paléosols et un transfert dans les eaux souterraines. On observe une contamination des sols en surface et en profondeur, avec un transport par les eaux d'infiltration et une concentration plus élevée dans les eaux souterraines. Il y a évidemment des variations en fonction des cycles hydrologiques.
Une première cartographie des sols a été réalisée par le BRGM en 2004 sur les risques sanitaires liés aux pesticides organochlorés dans les sols en Martinique, puis nous avons réalisé d'autres exercices en Martinique et en Guadeloupe, y compris dans des zones périurbaines, dans le cadre de plans d'action interministériels ou d'autres programmes portant sur le chlordécone. On a constitué des bases de données acquises par différents acteurs – les agences régionales de santé (ARS), les préfectures, les chambres d'agriculture et des personnes ou des bureaux d'études mandatés dans le cadre d'appels à projets. Le BRGM a également réalisé des prélèvements, selon un protocole élaboré avec le CIRAD et appliqué par tous les acteurs. Il y a eu ensuite des restitutions à l'échelle parcellaire ou régionale dans les deux territoires concernés. Des mises à jour régulières des cartographies ont lieu – il y en a une qui est en cours en 2019. Les derniers rapports datent d'octobre 2018, avec des mises à jour de données de 2017 et 2018. Des mises en ligne sont effectuées sur les différents sites, pour la Martinique comme pour la Guadeloupe.
Les pages 16 et 17 du document que nous avons préparé synthétisent les analyses menées sur un certain nombre d'échantillons dans des surfaces ayant un historique bananier mais aussi dans des zones périurbaines, en Guadeloupe et en Martinique, selon que le seuil de détection est franchi ou non.
En Guadeloupe, sur les 792 échantillons prélevés dans des zones périurbaines stratégiques, notamment compte tenu des plans locaux d'urbanisme (PLU), 172 avaient une teneur en chlordécone supérieure au seuil de détection, à savoir 0,0005 mgkg. À l'échelle de l'ensemble du territoire, environ 54 % des plus de 5 000 analyses réalisées au 1er juin 2018 avaient un résultat positif, majoritairement dans le cas de prélèvements issus de zones agricoles impactées. Ces analyses couvrent environ 2 % du territoire. On voit que certaines communes ayant un historique bananier peu marqué ou nul subissent aussi une contamination significative au chlordécone.
Il y a davantage de données en ce qui concerne la Martinique : un peu plus de 12 000 analyses y ont été réalisées, dont environ 9 % ont montré une forte contamination, supérieure à 1 mgkg. Par ailleurs, environ 1,3 % des 774 analyses réalisées dans des zones périurbaines ont permis de détecter une forte contamination.
En ce qui concerne la remédiation pour les sols contaminés, il faut d'abord souligner que les recommandations relatives aux usages, qui visent à limiter l'exposition de la population, sont naturellement indispensables mais qu'elles ne résolvent pas le problème de la contamination des milieux, étant entendu que le sol est le principal réservoir de chlordécone. La mise en jachère n'est pas une solution de remédiation : cela permet seulement de limiter l'exposition par voie alimentaire en évitant qu'il y ait des cultures vivrières sur des sols contaminés.
Différentes options existent en matière de remédiation. Il y a des traitements de différents types, biologiques ou physico-chimiques, qui sont à différents stades de maturité et présentent, chacun, des avantages et des inconvénients spécifiques. Nous avons travaillé, au BRGM, sur une technique, l'ISCR (In situ chemical reduction), qui est basée sur un principe physico-chimique et pour laquelle des travaux de recherche et développement (R&D) ont été lancés dès 2010. Nous sommes allés jusqu'au bout de l'exercice, avec une validation sur le terrain.
Nous avons réalisé un tableau présentant les différentes solutions qui existent, notamment en fonction de leurs avantages et de leurs inconvénients, afin que vous puissiez avoir une vision aussi exhaustive que possible. Si vous le voulez, nous pouvons vous en faire une présentation détaillée.
Nous avons également abordé la question des perspectives dans notre document, en revenant sur les trois points principaux – le suivi des bassins versants, la cartographie des sols et la remédiation.
En ce qui concerne la connaissance des transferts des contaminants au niveau des bassins versants, il y a encore des éléments que l'on pourrait mieux comprendre et il faudrait peut-être réaliser des suivis plus continus. On peut aussi explorer des techniques faisant appel à des échantillonneurs passifs afin d'arriver à avoir des informations pertinentes.
Pour ce qui est de la cartographie des sols, il serait important d'augmenter ou de poursuivre les analyses au fur et à mesure et de compléter les bases de données en effectuant des mises à jour.
S'agissant de la remédiation, on pourrait travailler sur la biodégradation par des bactéries dans le cadre d'essais sur sols réels, qui sont nécessaires, avec une quantification de l'efficacité et un protocole de stimulation in situ. On pourrait rechercher des procédés moins coûteux que ceux qui ont été testés ou proposés jusqu'à présent. Dans tous les cas, il est nécessaire de mener une étude sur le comportement des dérivés en matière de toxicité et d'écotoxicité, de leur devenir dans l'environnement et de leur bioaccumulation.

Je sais que le BRGM est très bien implanté en Guadeloupe et en Martinique. Vous avez longtemps travaillé dans le cadre des différents schémas directeurs pour l'eau potable et l'assainissement : vous avez donc une connaissance assez fine et approfondie de ces deux territoires.
Si j'ai bien compris, vous êtes à l'origine de la première cartographie qui a été réalisée, en 2004. Est-ce exact ?
Nous avons réalisé en 2004 une cartographie des risques en Martinique – c'était un de nos premiers rapports – mais nous ne sommes pas à l'origine de cet exercice.

J'aimerais savoir qui effectue les cartographies à l'heure actuelle. Vous avez parlé d'appels à projets, et je souhaiterais que vous nous donniez quelques explications sur ce sujet.
Le BRGM mène des projets en Martinique et en Guadeloupe, qui font l'objet de rapports dont les références sont indiquées dans notre document.
S'agissant de la mise à jour du système d'information géographique (SIG) et de la base de données, qui est alimentée par les différents acteurs que j'ai cités, nous faisons les mises à jour en matière de cartographie – c'est Monsieur Jean-Francois Desprats qui s'en occupe, à Montpellier, en collaboration avec nos collègues de la Martinique et de la Guadeloupe.
En parallèle, nous avons mené des projets qui se sont achevés en 2018, ou même en 2017, pour le compte de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), sur les terrains périurbains. Des appels d'offres ont été lancés pour sélectionner des laboratoires d'analyses et d'autres prestataires afin de réaliser l'échantillonnage selon le protocole « Jardins familiaux » (JAFA), qui a été utilisé par tous les acteurs. Les prélèvements ont été réalisés par le BRGM, mais aussi par ANC Concept Guadeloupe ou par la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDON).

Pourriez-vous être plus précise en ce qui concerne la méthodologie et les échantillons ? Vous vous basez sur un SIG qui est mis à jour pour établir une cartographie de la concentration en chlordécone dans les sols. Quelle est la méthode que vous utilisez ? Sur quels échantillons travaillez-vous ? Est-ce que ce sont la FREDON, les chambres d'agriculture, le CIRAD, le BRGM, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) et l'ARS qui fournissent les échantillons ? De quelle manière ces derniers sont-ils demandés et prélevés ? C'est une première question très technique. Je vais, en effet, dans le même sens que ma collègue : nous souhaitons avoir plus de précisions au sujet de la méthodologie.
La manière de prélever a été établie dès le début. Le schéma qui figure à la page 12 vous donne quelques explications : on définit 4 zones dans un périmètre donné, où l'on prélève à chaque fois 5 carottes, ce qui en fait 20 au total.
La superficie est de l'ordre d'un hectare. On va regarder la question plus en détail. La profondeur investiguée est de 30 centimètres. On prélève selon un angle droit, à une distance similaire, et toujours selon la même méthode.
Les analyses ont été confiées au laboratoire CARSO, qui a été sélectionné dans le cadre d'un appel d'offres et qui est accrédité par le Comité français d'accréditation (Cofrac). Le BRGM a réalisé des tests de qualité pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problèmes. Des « blancs » et des échantillons « témoins » ont été fournis. Nous avions réalisé des travaux de recherche sur la manière dont on peut détecter analytiquement la chlordécone et les autres molécules, et nous avons ensuite fourni des échantillons, ayant des concentrations connues, pour garantir qu'il n'y ait pas d'incertitudes dans la procédure analytique. Un contrôle de qualité a été réalisé systématiquement au fur et à mesure des campagnes.

À moins que je n'aie pas bien compris, je crois que vous n'avez pas répondu à la totalité de la question. Par ailleurs, quels sont vos liens avec la DAAF dans les territoires concernés ?
Le BRGM est un établissement public industriel et commercial (EPIC) : nous sommes un client et un partenaire. Nous travaillons dans le cadre de projets définis selon certains objectifs et comportant des financements.
Nous utilisons des données complémentaires, acquises par différents acteurs. Nous avons réalisé nous-mêmes des prélèvements dans des zones périurbaines, mais il y avait également d'autres opérateurs parce que nous ne pouvions pas nécessairement tout faire.
En ce qui concerne la cartographie de l'ensemble des données collectées depuis le milieu des années 2000, nous avons développé la base de données. Le BRGM n'a pas réalisé lui-même les 12 000 analyses qui ont eu lieu en Martinique, mais elles ont fait l'objet d'un même protocole et nous collectons les résultats dans la base de données.

J'ai bien compris : vous faites de la saisie de données et vous mettez en phase tout ce qui relève de l'analyse afin que les opérateurs puissent travailler. Initialement, est-ce la DAAF qui a demandé la réalisation d'une cartographie ? Nous avons auditionné la direction générale de l'alimentation, du ministère de l'agriculture, qui a évoqué, à propos de la cartographie, des demandes faites par les différentes DAAF, en lien avec le BRGM.
Je ne sais pas si j'ai le rapport de 2004 dans mon ordinateur pour répondre à votre question, mais je peux retrouver cette information et vous la transmettre. Qui était à l'origine des premières cartes graphiques ?
Pour les zones périurbaines, c'était une des actions du troisième Plan national chlordécone.

Je reviens sur les études réalisées par le BRGM. J'ai retrouvé dans les archives un rapport intermédiaire de 2010 : l'analyse avait été réalisée sur des sols antillais reconstitués en laboratoire. La plus grosse difficulté était liée à l'acheminement de la tonne et demie de sol jusqu'au laboratoire.
Cette étude a-t-elle été menée jusqu'à son terme – je ne retrouve pas trace du rapport final ? Les résultats en laboratoire semblaient satisfaisants.
Oui, il y a eu un rapport final. Ce rapport fait partie des travaux de remédiation menés entre 2010 et 2017. Dans un premier temps, nous avons travaillé en laboratoire, avec des sols prélevés sur place. Nous avons réfléchi à la façon de les analyser. Un travail de thèse a été mené. Les derniers travaux ont été réalisés sur des parcelles sur place : nous avons aménagé des rotations culturales pour comprendre l'efficacité des procédés biochimiques de remédiation et vérifier l'évolution des taux de chlordécone.
Pour trouver le rapport dans la liste, il nous faudrait son intitulé précis.

Les cartographies déjà établies sont-elles fiables et complètes ?
Vous parlez d'échantillonneurs passifs. Qu'est-ce que c'est ?
Quels sont les coûts d'un prélèvement et d'une analyse ?
L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) parle de 250 euros par analyse de sol. Si je comprends bien, il faudrait deux analyses par hectare, soit 500 euros par hectare. Êtes-vous d'accord ?
J'en profite pour répondre sur le protocole d'échantillonnage : vingt carottes sont prélevées pour un hectare de parcelle.
La cartographie est-elle fiable et suffisante ? Elle est effectuée à partir de certaines données et représente des pourcentages en superficie qui ont été analysés dans les derniers rapports de 2018. En Martinique, en 2018, la restitution cartographique à l'échelle parcellaire indique 7 % de surfaces analysées, soit environ 11 % des surfaces cultivées ou potentiellement cultivables – probablement surestimées du fait de la déprise agricole – et 19,5 % des surfaces cultivées en bananes entre 1970 et 1993.
Cela ne représente donc qu'un échantillonnage. Mais, dans les deux territoires, des analyses croisées et plus poussées ont été réalisées dans les zones les plus occupées par les bananeraies, en fonction de leur durée d'implantation. Ces surfaces ont été échantillonnées de façon statistiquement représentative. La méthodologie de la cartographie est donc robuste, mais il faudrait des analyses ou des échantillons complémentaires pour que les analyses soient statistiquement valides.
S'agissant des coûts d'analyse, je n'ai pas l'information.
Le collègue qui travaille sur le sujet pourrait vous donner des chiffres fiables. Nous pourrons vous les transmettre.

Vous déterminez les zones d'analyse, vous disposez d'analyses déjà réalisées ou vous en commandez – auprès de la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDON) ou des services de l'agriculture par exemple – et vous en engagez vous-même, c'est bien cela ? Travaillez-vous à partir des analyses des autres ou effectuez-vous également directement des prélèvements et des analyses ?
Lorsqu'il existe une demande particulière – la cartographie des zones périurbaines par exemple –, nous montons un projet sur la base d'une une méthodologie de travail : nous valorisons les données existantes et indiquons lorsque cela est nécessaire qu'il faut acquérir des données complémentaires. Il est difficile d'être exhaustif mais, pour que la représentativité soit de qualité, il fallait prendre en compte l'occupation actuelle des parcelles en zones périurbaines, mais aussi les occupations à venir – liées aux plans d'aménagement. Il faut souvent entre 700 et 800 analyses. Pour des raisons pratiques et économiques – le BRGM n'employant que 5 à 6 personnes en Guadeloupe et en Martinique – nous avons travaillé avec des partenaires locaux, sélectionnés par le biais d'appels à projets, tout en réalisant une partie des analyses.

Suite à ces analyses, 7 % de la surface totale de la Martinique est désormais cartographiée. 93 % ne l'est donc pas. Dans les zones historiquement dédiées à la banane, cette méthode permet-elle d'analyser tous les sols concernés dans un temps acceptable, compte tenu de l'ampleur du drame ?
Page 14 du document que nous vous avons transmis figurent les surfaces martiniquaises historiquement consacrées aux bananiers entre 1970 et 2009 : 8 356 hectares sur 17 929 ont été analysés.
Sur la carte suivante, vous constatez que les analyses de sol effectuées sont plutôt cohérentes par rapport aux zones principalement occupées par des bananiers et représentent 36 % des zones historiquement cultivées en banane entre 1970 et 1993. À ces zones, il faut en ajouter d'autres où – on l'a vu dans les zones périurbaines – les teneurs en chlordécone sont également élevées, probablement du fait d'un usage particulier des pesticides. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut continuer les analyses.

J'ai bien compris votre méthode, encore balbutiante : vous utilisez intelligemment toutes les possibilités pour cartographier au mieux, en effectuant si besoin des commandes complémentaires afin que l'échantillon soit suffisamment large dans les zones périurbaines et dans celles cultivées en bananes pendant très longtemps.
Mais nous souhaitons surtout savoir si ce rythme vous satisfait ? Vous permet-il de donner une réponse claire aux pouvoirs publics, afin qu'ils puissent mener une politique adaptée à la réalité ? En effet, en Martinique, quarante ans après, on peut être surpris que seules 7 % des terres soient analysées, et un gros tiers pour les terres agricoles où la suspicion de chlordécone est forte. Pourtant, dans les zones périurbaines de votre échantillon, 41 % des terres ont de la chlordécone. C'est extrêmement important !
Quelles méthodes vous permettraient d'aller beaucoup plus vite afin que l'on connaisse l'ampleur des sols pollués et que l'on puisse identifier les parcelles polluées en Martinique ?
À l'heure actuelle, nous devons passer par un échantillonnage de terrains, puis par l'analyse en laboratoire. Aucun indicateur direct ne nous permet de nous en affranchir ou de faire plus rapidement le lien entre occupation et contamination, puisque les terrains occupés par des bananeraies ne sont pas les seuls affectés.
Nous avons également cherché à trouver une relation entre la nature des sols – andosols ou ferrisols, plus absorbants, sur des formations hydrogéologiques permettant un transfert plus rapide. Conceptuellement, on comprend que les terrains – et l'eau par la suite – dont les sols sont de type absorbant, sur des formations plus anciennes, seront plus vulnérables ou auront une valeur plus importante. Mais de là à développer une cartographie plus rapide en s'affranchissant de l'analyse…
Nous avons publié une étude récente avec nos collègues du CIRAD pour réfléchir à une cartographie plus simple à partir des données du sol ou de l'eau, mais c'est moins trivial que cela en a l'air…
Je n'ai pas répondu à Mme Benin sur les échantillonneurs passifs : le concept a été développé il y a une quinzaine d'années dans le domaine des eaux de surface, mais aussi souterraines. Il s'agit d'une pastille, qui peut prendre différentes formes, dont la surface va capter les contaminants de l'eau. Le plus connu – il a acquis une valeur de traitement – est le charbon actif : il capte, puis vous pouvez extraire et analyser ses composants.
L'échantillonneur captif est basé sur la même idée : on dispose une formation chimique sur une surface pour qu'elle capte certaines molécules de manière sélective. Cela n'existe pas, mais pourrait être développé pour le chlordécone. Installé pendant une période donnée, il permettrait de dire si la zone est positive ou négative à la chlordécone, voire de réaliser des comparaisons en teneur, afin de savoir si on se situe en catégorie 1, 2 ou 3. Mais cela nécessite de la recherche car ce procédé n'est pas disponible sur le marché.

Lorsque nous avons auditionné la direction générale de l'alimentation, elle nous a indiqué que le ministère de l'agriculture était en charge de la cartographie en zone agricole et le ministère de la transition écologique en charge de celle en zones urbaines et périurbaines. Faites-vous le lien ?
Nous faisons le lien en mettant à jour les cartographies de toutes ces données dans la base de données. Il n'existe pas deux cartographies, toutes les données étant disponibles dans la même base de données. Les mises à jour du système d'information, et donc de la cartographie, prennent en compte toutes les données.

Vous nous avez affirmé par deux fois ne pas pouvoir expliquer pourquoi on retrouve des doses de chlordécone élevées dans des terrains n'ayant pas produit de bananes.
En Guadeloupe, la zone bananière est bien délimitée, au sud de Basse-Terre. La Grande-Terre n'a pas connu de cultures de bananes, mais elle dispose d'un système d'irrigation agricole qui récupère l'eau de Belle-Eau Cadeau – dans une zone très fortement contaminée au chlordécone – et irrigue toute la Grande-Terre, notamment Les Saintes et la Désirade. En irriguant un terrain sain avec une eau chlordéconée, quels sont les risques qu'il soit à son tour contaminé ? J'ai bien compris la différence entre les eaux de surface et les eaux souterraines, mais est-ce possible par l'irrigation ?
Cela va dépendre de la teneur et de la concentration de chlordécone dans l'eau utilisée pour l'irrigation, du temps de contact et de la nature du sol.
En Guadeloupe, vous trouvez deux types de sols – les andosols et les nidisols. Les andosols sont les plus absorbants. En fonction de la teneur ou de la concentration de l'eau utilisée pour l'irrigation, c'est possible, mais il faudrait réaliser une modélisation et une analyse, incluant la teneur, la concentration et la durée, pour vous donner une réponse exacte.
L'eau d'irrigation va être utilisée par les plantes, mais une partie va s'infiltrer et une autre s'évaporer. En fonction du nombre de cycles d'irrigation et du type de sol, ce dernier va s'enrichir, ou pas, en chlordécone.

En Guadeloupe – mais probablement aussi en Martinique –, le BRGM est à l'initiative de tous les forages. Quelles sont vos analyses de la présence de chlordécone et de paraquat dans le cycle de l'eau ?
Le BRGM gère la base de données du sous-sol. Depuis les années 2000, il apporte son soutien au ministère de l'environnement, mais aussi aux agences et offices de l'eau et à l'Agence française de la biodiversité pour la mise en oeuvre de la directive du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, dite directive-cadre sur l'eau (DCE), et de la directive du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.
S'agissant de la qualité, objet de nos discussions, le BRGM a défini les réseaux selon une méthodologie nationale : nombre de points de mesure de la qualité de l'eau de type DCE, bon état chimique et qualitatif des masses d'eau souterraines par rapport aux différents systèmes et réservoirs souterrains et aux masses d'eau.
En partenariat avec l'office de l'eau, le BRGM suit l'évolution de la qualité des eaux souterraines de Guadeloupe au titre de la DCE depuis 2008. La surveillance est semestrielle et les cycles de six ans. Différents paramètres sont analysés. Le paraquat ne fait pas partie de la liste des paramètres de ces analyses régulières, mais il a pu être analysé lors de campagnes dites photographiques – on analyse alors plus de paramètres que lors du suivi régulier.
Certaines molécules font donc l'objet d'un suivi réglementaire, d'autres, comme le paraquat, ont pu être ajoutées au vu du contexte local. Les dernières analyses datent de 2014 – les informations m'ont été transmises par l'hydrogéologue de Guadeloupe – et montrent que le paraquat est toujours inférieur au seuil de quantification du laboratoire, soit 0,005 microgramme par litre (mgl).
Le BRGM n'intervient pas sur les analyses d'eau à destination de la consommation humaine, également appelée alimentation en eau potable (AEP). Cela ne fait pas partie de notre mission puisque c'est la responsabilité des distributeurs qui alimentent les collectivités en eau potable.

Savez-vous si le taux de pollution évolue dans les terres consacrées à la culture de la banane, mais également dans les autres ?
Certains observatoires ont peut-être travaillé sur le sujet, mais ce n'est pas notre cas. Je n'ai donc pas d'information et n'ai pas constaté, à l'analyse des cartographies, d'évolutions temporelles.
L'eau est un vecteur majeur, voire le vecteur principal, dans le déplacement de la pollution.
Le fait que l'on ait observé dans les sols des niveaux de pollution variables, selon la nature de ces sols ou en fonction de leur occupation, le fait également que l'on trouve des teneurs en chlordécone bien plus importantes dans les eaux souterraines que dans les eaux de surface traduit des phénomènes d'infiltration dans les sols, sur plusieurs mètres de profondeur, à travers différentes couches de paléosols, jusqu'à la formation volcanique. L'eau s'infiltre à travers des fractures et des hétérogénéités, en transportant avec elle le chlordécone, dont une partie peut rester stockée selon la perméabilité des milieux traversés.
La pollution se déplace donc avec l'eau et peut se retrouver en aval des bassins versants, du fait d'échanges entre les eaux souterraines et les eaux de surface. C'est typiquement le cas lorsqu'on a des lignes de suintement visibles sur le terrain, des sources, voire des sources sous-marines ou d'autres voies de sortie diffuses dans la mer. Toute cette circulation peut être établie, non seulement en mesurant la teneur en contaminant mais également, plus globalement, par la température de l'eau ou la conductivité électrique.
Le chlordécone présent dans les sols se déplace donc sous l'action de l'eau.

Pensez-vous que la mise en jachère des terres est pertinente pour favoriser la dépollution ?
C'est pertinent dans le sens où ce procédé limite l'exposition potentielle, puisque le sol contaminé n'est plus cultivé et qu'il n'y a donc plus de risque d'ingestion de cultures potentiellement contaminées. En revanche, cela ne résout pas le problème de la contamination des sols en tant que tel. La jachère permet de limiter l'exposition des populations mais on ne peut l'assimiler à une technique de remédiation.
Il existe un panel de techniques, qui ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients, et sont à des niveaux de maturité différents.
Le BRGM a essentiellement travaillé au développement de la technique dite ISCR – In Situ Chemical Reduction –, qui s'assimile à un processus physico-chimique. Il s'agit d'un procédé de décontamination dont le principe est le suivant : on apporte au sol un amendement composé de matière organique et de poudre de fer, à partir de quoi on compacte et on irrigue pour créer les conditions d'une anaérobie et qu'il n'y ait plus d'oxygène, ce qui, sans entrer dans les détails, permet de casser la molécule du chlordécone.
L'efficacité de cette technique a été démontrée, avec un taux de rendement de 70 % sur les nitisols et les ferralsols. Les résultats sont moins intéressants pour les andosols où l'on n'est qu'à 20 % de rendement mais, dans la mesure où ce sont potentiellement les sols les plus contaminés, ce peut être malgré tout une solution intéressante.
La fiabilité et la faisabilité de cette technique ont été testées en laboratoire et sur site réel, sur un nitisol en Martinique.
L'inconvénient de cette technique est qu'elle génère des dérivés de la chlordécone, des molécules ayant perdu leurs atomes de chlore. Si ces molécules sont a priori moins toxiques que la molécule-mère, leur mobilité en revanche est plus grande et elles rejoindront plus facilement les eaux souterraines.
Le traitement des sols s'effectue en une seule fois, ce qui est un avantage, mais il a un coût : 170 000 euros par hectare. Enfin, l'ISCR nécessite l'emploi d'équipements de protection individuel (EPI) – des lunettes –, et l'on doit poser la question de son accessibilité sociale.
Une seconde technique fonctionnant également selon un processus chimique est la technique dite « de séquestration ». Elle consiste en un amendement de compost, dont l'objectif est de séquestrer le chlordécone et de limiter son entraînement vers le milieu haut et vers la contamination des végétaux. Ici, on ne dégrade donc pas la molécule mais on la séquestre. En termes d'efficacité, l'IRD-CNRS a démontré que les transferts sol-plante pouvaient, grâce à cet amendement de compost, être réduits d'un facteur 2 à un facteur 15, ce qui signifie que l'accumulation de chlordécone dans les plantes cultivées sur ces sols serait moindre.
Cette technique a été éprouvée en laboratoire et sur site réel. À l'inverse de la précédente, elle ne génère pas de dérivés, et l'un de ses gros avantages est qu'en apportant un amendement organique on fertilise le sol.
Quant à son coût, il tourne autour de 80 000 euros par hectare pour une application, sachant néanmoins que les amendements doivent vraisemblablement être renouvelés tous les deux ou trois ans. C'est, quoi qu'il en soit, un procédé facile à mettre en oeuvre, puisqu'il s'agit simplement d'incorporer du compost dans les sols.
En ce qui concerne ensuite les processus biologiques, une première technique est celle de la dégradation microbienne. Elle consiste en l'utilisation de bactéries en anaérobie, car ce sont les conditions les plus prometteuses. L'efficacité de cette technique a été démontrée, puisque l'on a atteint jusqu'à 100 % de formation de dérivés, c'est-à-dire que la molécule-mère est entièrement dégradée en dérivés. Ces résultats cependant n'ont été obtenus qu'en laboratoire dans des conditions optimisées, et il reste à réaliser l'expérimentation sur site réel. Quant aux dérivés produits, ce ne sont pas les mêmes qu'avec l'ISCR, puisqu'en plus de la perte de chlore, ils se caractérisent par une ouverture du squelette carbone. À la différence des dérivés de l'ISCR, ils n'ont pas fait l'objet d'études permettant de déterminer s'ils étaient plus ou moins toxiques que la molécule, ni plus ou moins mobiles.
La dégradation microbienne a deux avantages indéniables, d'une part, son coût, qui devrait être faible et, d'autre part, le fait qu'elle pourrait aboutir à une minéralisation complète. Des questions cependant restent en suspens : son efficacité en conditions réelles, le temps nécessaire à la biodégradation et les moyens de stimuler celle-ci.
J'évoquerai en dernier lieu la phytoextraction, autre processus biologique sur lequel ont travaillé l'université de Toulouse, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et l'École nationale des travaux publics de l'État – Centre national de la recherche scientifique (ENTP-CNRS).
Le principe ici consiste à accumuler le chlordécone dans une plante spécifiquement cultivée à cet effet. Pour l'instant, l'efficacité évaluée est faible, puisque le taux de transfert sol-plante est inférieur à 0,1 % de rendement, sachant que l'expérience n'a été faite à ce jour que sur un seul type de plante et un seul cycle de croissance. Par ailleurs, la démonstration sur site réel reste à faire.
La phytoextraction ne génère aucun dérivé de chlordécone, mais se pose la question de ce qu'il advient ensuite de la plante contaminée où s'est accumulée la chlordécone : qu'en fait-on une fois qu'elle a été coupée ? On estime, cela étant, que c'est une technique dont le coût devrait être assez faible et l'accessibilité sociale plutôt bonne.
En ce qui concerne l'ISCR, on a fini les exercices d'étude, puisque l'expérimentation sur site réel a été réalisée et que le comportement des dérivés du chlordécone a été analysé pour s'assurer qu'ils étaient moins nocifs que la molécule mère.
La séquestration, quant à elle, est une méthode qui a également démontré son efficacité et fait l'objet d'une évaluation économique. Le paramètre qu'il faut ensuite prendre en compte est que le compost nécessite d'être renouvelé et que le traitement doit donc être réitéré.
En ce qui concerne la biodégradation et la phytoextraction, ce sont deux techniques dont le degré de maturité est moindre. La biodégradation doit encore être expérimentée en conditions réelles, où peuvent se produire des phénomènes plus complexes qu'en laboratoire, ce qui fait qu'on ne peut garantir a priori le même taux d'efficacité. Quant à la phytoextraction, les recherches n'en sont encore qu'à leur début, et les premiers tests ne se sont pas avérés très probants en termes d'efficacité. Mais rien n'interdit de penser qu'en l'expérimentant sur d'autres types de plantes on ne parviendrait pas à de meilleurs résultats.
Il me semble que c'est une décision qui relève des pouvoirs publics. Nous nous efforçons pour notre part, d'alimenter les débats avec des données les plus factuelles possible en proposant une vision exhaustive des différents procédés, avec leurs avantages et leurs inconvénients, sachant qu'il n'y a pas de solution miracle.

Notre commission d'enquête est là pour demander à l'État de bien vouloir non seulement expertiser avec les chercheurs ces pistes de recherche mais aussi les soutenir. Car il est incroyable d'entendre ces chercheurs dénoncer le manque de moyens financiers – comme je l'ai moi-même entendu de la bouche des représentants de l'université Antilles-Guyane, pour poursuivre les recherches alors que, si je vous entends bien, il existe des techniques qu'il suffirait de développer pour qu'elles deviennent demain un remède à notre malheur.
Pour cela, il faudrait qu'il y ait des appels à projets dotés de moyens…
Les prochains appels à projet portant sur la remédiation sont dotés de 50 000 euros : impossible d'avancer avec une telle somme.

Je demande à ce que cette phrase soit notée, car c'est important. Cela signifie qu'aujourd'hui on ne donne pas à la recherche les moyens d'avancer.
Si on veut avancer en effet, il faut pouvoir aboutir à des procédés plus efficaces, plus rapides et moins coûteux, ce qui nécessite du temps pour, éventuellement, tester d'autres solutions. Nous sommes d'ailleurs en mesure de vous fournir des éléments budgétaires précis sur nos projets de recherche.

Pourriez-vous nous établir un document détaillant les moyens nécessaires pour rendre opérationnel l'un des procédés qui pourrait constituer une solution viable et pérenne, afin que nous puissions dire au Président de la République, au Premier ministre et au président de l'Assemblée nationale qu'il faut, pour dépolluer nos terres non pas 50 000 euros mais 300 000 ou 400 000 ? La recherche doit disposer de moyens dignes de ce nom et ne plus se contenter d'appels à projets ponctuels qui sont une mascarade. Cela peut évidemment rester confidentiel et ne pas être rendu public.
Nous avons identifié trois pistes susceptibles de faire avancer la recherche. En premier lieu, il faudrait tester les techniques de biodégradation par bactérie sur site réel, pour confirmer l'efficacité démontrée en laboratoire et pour trouver éventuellement le moyen de stimuler in situ cette biodégradation, car se pose la question du temps nécessaire pour biodégrader la chlordécone.
En second lieu, il faudrait trouver des solutions permettant de réduire le coût de l'ISCR, technique dont l'efficacité est prouvée mais qui reste chère. Une piste est actuellement à l'étude, en phase exploratoire, pour tenter d'utiliser le fer naturellement présent dans les sols, en Martinique et en Guadeloupe, puisque l'ISCR consiste à ajouter aux sols un amendement constitué de matière organique et de fer, ce dernier servant à casser la molécule de chlordécone pour en éliminer les atomes de chlore.
Par ailleurs, l'ISCR n'a pas été testée en conditions réelles sur les andosols, mais uniquement sur les nitisols. Les tests en laboratoire ont démontré une efficacité de 20 % de rendement sur les andosols mais, comme je l'ai dit, dans la mesure où ce sont les andosols qui stockent le plus la chlordécone, ce taux présente malgré tout de l'intérêt.

Merci pour cette présentation qui revêt néanmoins un caractère extrêmement technique. Cette technicité me conduit à m'interroger sur la manière dont ces informations sont communiquées à la population : leur explique-t-on en termes très simples quels sont les enjeux environnementaux et sanitaires ?
Vous avez à plusieurs reprises évoqué l'accessibilité sociale de la dépollution, mais que savent réellement les populations de vos recherches ? Quel est leur degré de confidentialité ? Comment les gens sont-ils responsabilisés et jusqu'à quel point disposent-ils d'arguments pour défendre leurs propres intérêts ?
Par ailleurs, j'avoue que je suis ahurie, voire consternée, de constater que nous n'avons pas beaucoup avancé en matière de solutions techniques permettant d'éliminer le chlordécone, et je m'inquiète donc des conséquences pour la population locale, dont je me demande dans quelle mesure elle a été informée de la situation. En d'autres termes, comment conciliez-vous la confidentialité de vos démarches et les exigences de participation des citoyens ?
Le BRGM est un organisme de recherche public, et toutes nos informations sont donc publiques, que ce soit au travers de publications ou de rapports. Quelqu'un comme Monsieur Christophe Mouvet, par exemple, chercheur au BRGM, participe également au Groupe d'orientation et de suivi scientifique (GOSS) du plan national d'action Chlordécone II et il a fait partie du comité d'organisation de la conférence qui s'est tenue à l'automne 2018 aux Antilles.
Ces types de communication sont certes ciblés, mais il existe aussi des moyens de partage avec les populations. Je pense en particulier aux travaux que nous réalisons in situ, que ce soit pour de la cartographie ou pour de la remédiation, qui nous mettent en contact avec la population locale, à laquelle nous expliquons ce que nous faisons, voire que nous associons à nos travaux – c'est notamment le cas lorsque nous faisons des expérimentations sur des parcelles, qui peuvent impliquer des changements de pratiques culturales.
Il ne s'agit pas néanmoins de science participative, dans la mesure où nous n'avons pas défini les questions de recherche avec les citoyens. Cela étant, nous travaillons dans la plus grande transparence.

Je suppose qu'il existe un BRGM local avec des scientifiques, des universitaires et des experts locaux qui sont en mesure de dialoguer avec vous, au fur et à mesure de vos réflexions et de vos découvertes ?
Le BRGM a son siège social ainsi que son centre scientifique et technique à Orléans, où est basé l'essentiel du personnel, soit environ sept cents personnes. Nous disposons ensuite d'antennes dans toutes les régions, y compris aux Antilles, où travaillent essentiellement des spécialistes de l'hydrogéologie, de la géologie et de certains risques. Cette antenne est naturellement associée à nos projets et fait l'interface avec les administrations, la population et les autres organismes partenaires sur place, comme le CIRAD ou l'université.
La réunion s'achève à quinze heures trente.
————
Membres présents ou excusés
Réunion du jeudi 4 juillet 2019 à 14 heures 10
Présents. – Mme Justine Benin, Mme Claire Guion-Firmin, M. Serge Letchimy, M. Didier Martin, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Hélène Vainqueur-Christophe