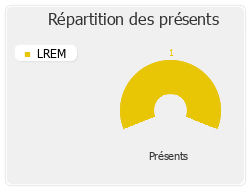Commission d'enquête sur l'évaluation des politiques publiques de santé environnementale
Réunion du jeudi 24 septembre 2020 à 11h00
Résumé de la réunion
La réunion
L'audition débute à onze heures.

Nous poursuivons nos auditions des entreprises privées pour connaître leur appréhension de la santé environnementale et les obstacles auxquels elles se heurtent quand elles s'engagent dans des démarches de santé environnementale.
Nous recevons M. Christian Zolesi, spécialiste en chimie, de l'agence QAP Conseil, une société de conseil en santé environnementale. Monsieur Zolesi, vous êtes également auteur d'un article paru dans Le Monde qui préconisait la mise en place d'une carte d'identité pour les produits. Vous êtes expert en qualité et risques des produits de consommation.
L'objet de cette commission d'enquête est de dresser un bilan des politiques publiques en matière de santé environnementale, de voir quels sont leurs points faibles, leurs points forts et les pistes d'amélioration. En ce qui vous concerne plus précisément, nous souhaitons savoir comment les entreprises privées peuvent participer à ces politiques publiques et quelle est votre définition de la santé environnementale ?
(M. Christian Zolesi prête serment.)
J'ai créé plusieurs entreprises sous la même spécificité : expertise de la sécurité, de la durabilité et de la conformité des produits. Il s'agit d'aider les entreprises à mieux maîtriser les impacts des produits qu'elles commercialisent.
Le contexte me semble important : d'après les chiffres européens, le commerce des produits de consommation représente environ 3 000 milliards d'euros, soit un quart du produit intérieur brut (PIB) européen. C'est donc une activité « poids lourd » de l'économie européenne, en particulier en France. Nous sommes entourés de produits de consommation. Dans cette salle, par exemple, nous avons des produits de construction, des produits de décoration, des produits d'ameublement, des produits d'équipement, de l'habillement…
Puisque nous nous intéressons aux impacts de cet environnement sur la santé, comment caractériser cet environnement, en particulier par la présence autour de nous de ces produits de consommation ? C'est un phénomène intéressant qui ne se présente pas toujours sous cette forme dans les projets, dans les textes, mais il me semble que, lorsque nous parlons de santé environnementale, nous devons considérer ce qui nous entoure comme un univers à part entière, avec ses propres risques et ses propres spécificités.
Les impacts des produits sont de plus en plus révélés, voire dénoncés, parce que nous nous rendons compte que nous utilisons des ressources, que nous créons des déchets, que nous avons besoin d'énergie pour transformer et transporter ces produits, que cela a un impact sur le climat. Ces derniers mois, nous avons beaucoup parlé d'un tel impact sur la biodiversité, de la pollution, du plastique. De plus, ces produits possèdent des impacts sociaux, parce qu'ils sont souvent fabriqués par d'autres que ceux qui les commercialisent, qu'il s'agisse de produits de marques de distributeur ou non. Nous avons affaire à une chaîne dans laquelle chacun a un rôle à tenir.
Lorsque les industriels possèdent leur propre marque, la problématique est un peu différente, puisqu'ils maîtrisent alors la chaîne de développement, de la conception à la fabrication et à la commercialisation. En revanche, lorsque nous devons faire la distinction entre ceux qui fabriquent – qui ne sont d'ailleurs pas forcément près d'ici – et ceux qui commercialisent, c'est un processus différent qui demande une organisation particulière, avec ses propres risques, ses propres sujets…
J'y vois une raison de considérer le monde des produits de consommation comme un univers à part entière et donc de projeter cette thématique de la santé environnementale dans ce contexte.
Les grandes entreprises sont fortement exposées sur le plan médiatique, comme nous le voyons, par exemple, avec les attaques régulières sur les réseaux sociaux. Cela oblige ces entreprises à réagir rapidement, alors que, parfois, cette notion de temps n'est pas la même pour les personnes qui travaillent dans le commerce, pour celles qui édictent les lois et pour les consommateurs. Pour autant, les entreprises ont finalement une grande influence potentielle par leur process d'achat et de sous-traitance à d'autres industriels, en France ou ailleurs. Si nous parvenons à faire que ces entreprises intègrent un certain nombre de progrès, en termes de santé et d'environnement, elles entraîneront avec elles des dizaines, voire des centaines ou des milliers de fournisseurs, y compris hors de France.
Cette présentation du contexte me semble très importante et c'est la raison pour laquelle je suis présent aujourd'hui : afin de décliner cette thématique de santé environnementale et en particulier le thème des substances chimiques.

Nous commençons à être familiarisés avec la vision institutionnelle de la santé environnementale, celle des administrations et des organismes scientifiques. Vous représentez les entreprises privées et je voudrais connaître leur vision. Avez-vous une définition plus opérationnelle de la santé environnementale ?
Vous dites que la sensibilisation des entreprises à la santé environnementale tient plus ou moins à des pressions médiatiques. J'ai bien entendu qu'à titre personnel, vous accompagnez les entreprises. Rencontrez-vous une demande ?
Pour une entreprise, choisir un positionnement plus éthique représente une véritable démarche. C'est un engagement du chef d'entreprise, car il est plus simple de fermer les yeux sur les impacts environnementaux de ses propres activités. Les entreprises viennent-elles davantage vers vous parce qu'elles sont conscientes des impacts commerciaux et de leur image dans la clientèle ? Ont-elles envie d'avoir une démarche vertueuse ? Sont-elles mobilisées pour d'autres raisons ? Avez-vous plus de facilité ou avez-vous besoin de démarchage pour les sensibiliser ? En êtes-vous à l'étape du comment et non plus du pourquoi ?
Je n'ai pas la prétention de représenter toutes les professions qui interviennent dans ce domaine. Je ne représente pas une fédération. Je ne fais que porter un témoignage, parce que j'œuvre sur ce sujet depuis quelques décennies.
Le métier consistant à concevoir des produits, à les fabriquer ou les faire fabriquer et à les commercialiser est récent dans l'histoire de l'humanité. Il a environ cinquante ans : l'évolution a commencé après la guerre et les premiers produits de marque distributeur sont apparus dans les années 1970. La consommation a explosé depuis quarante ou cinquante ans, Nous avons affaire à une thématique qui n'était pas intégrée dès le départ dans le business model, dans les expertises embauchées dans ces entreprises…
De plus, depuis peu de temps, le digital devient un paramètre très important, à divers titres. Les consommateurs, au travers des organisations non gouvernementales (ONG), des associations et réseaux sociaux puis des applications comme Yuka, mettent la pression sur les entreprises. Des attentes et des exigences sociales et sociétales naissent plus rapidement et plus fortement que si le digital n'existait pas. Cette pression intervient aussi au fil des sujets qui sont médiatisés, puisque l'opinion publique est sensibilisée par les médias. Cela crée une pression sur les marques, une pression à évoluer, à faire évoluer la conception des produits, leurs conditions de fabrication. Lors de l'effondrement du Rana Plaza, nous avons découvert que certains produits ne sont pas fabriqués dans des conditions correctes.
Tous ces éléments font progresser les marques : ces exigences doivent être captées en permanence par l'entreprise qui doit adapter ses produits, ses modes de commercialisation… C'est assez compliqué pour les entreprises parce qu'il s'agit d'un phénomène récent et complexe. Il en est de même pour le législateur, puisque je considère la réglementation comme une sorte « d'éponge à sujets de société ».
Pour les entreprises, il n'existe pas, à mon sens, de définition de la santé environnementale. Les sociétés fonctionnent beaucoup « en silos » et l'expertise scientifique n'est pas forcément très présente dans les entreprises industrielles et commerciales. Ce sont de plus en plus les applications et les réseaux sociaux qui font le lien entre un sujet scientifique médiatisé et les marques auxquelles, d'un seul coup, on demande par exemple, les raisons de la présence de bisphénol A dans les biberons. Tout le monde prend subitement peur, les mamans n'achètent plus de biberons en plastique et disent vouloir des biberons en verre. Brutalement, le marché subit une baisse de 40 %.
Cette fulgurance, cette forme « d'effet papillon » d'une information scientifique qui est médiatisée sans filtre – sachant que les scientifiques ont eux-mêmes leurs controverses –, sensibilise l'opinion publique et le législateur qui peut parfois réagir très vite et édicter des lois également quelque peu « en silos », sans connexion entre elles. Cela crée une sorte d'insécurité pour les entreprises auxquelles il ne faut évidemment pas tout reprocher.

Selon vous, le monde de l'entreprise subit une pression nouvelle, essentiellement parce que le consommateur est davantage informé, pas forcément bien informé, mais qu'il est le récepteur de nombreuses informations et que cela a des répercussions sur les entreprises qui ne savent plus très bien comment s'y prendre. Elles vous demandent donc d'intervenir pour un conseil en santé environnementale.
Le contexte que vous décrivez est celui d'une situation en évolution rapide et d'entreprises qui sont questionnées, voire sommées de s'expliquer sans avoir vu venir le problème et sans l'avoir paré.
Comment, dans ce contexte, remonter le processus de fabrication jusqu'au producteur, surtout quand les entreprises de production se trouvent à l'étranger ? Comment introduire la question des impacts environnementaux et sanitaires des produits mis sur le marché par ces entreprises ?
Il est difficile de généraliser. Nombre de grandes entreprises se sont organisées. Elles ont créé des services qualité dans lesquels interviennent des ingénieurs. Elles sollicitent également de nombreux prestataires nationaux ou internationaux. La professionnalisation de la maîtrise des risques liés aux produits commercialisés est en cours. Toute une activité de laboratoires de tests apparaît, au niveau international, avec des chiffres d'affaires impressionnants. Les entreprises réalisent des inspections, des audits d'usine. Des audits qualité sont apparus, puis des audits sociaux, puis des audits environnementaux. Certaines grandes entreprises françaises de la grande distribution sont très bien organisées et investissent des budgets importants dans ce suivi.
Toutefois, ce n'est pas le cas de toutes. De plus, une entreprise ne peut pas surveiller ses centaines ou ses milliers de fournisseurs, particulièrement lorsqu'ils sont à l'étranger. Ce n'est pas toujours facile avec les différences culturelles, réglementaires et juridiques entre les pays. Cette professionnalisation en cours doit donc continuer à progresser.
L'état des connaissances évolue en permanence et ce qui était vrai hier ne le sera plus demain. Nous découvrons de nouveaux risques, de nouvelles possibilités d'atteinte à l'environnement ou à la santé ou aux deux qu'il faut prendre en compte pour les nouveaux produits, les nouvelles fabrications… C'est donc un processus en permanente évolution.
Nous voyons donc apparaître des entreprises qui ont tenté de répondre au mieux aux attentes des consommateurs, en éliminant de leurs produits telle ou telle substance, par exemple les résidus de pesticides, les perturbateurs endocriniens… Ce sont des « listes noires », des produits « sans ». Cela a été le cas dans les cosmétiques, dans l'alimentaire. Une enseigne a même créé un magasin spécialisé dans les produits cosmétiques ne comportant pas certaines substances dont les consommateurs ne veulent plus, voire dont certaines applications ou ONG ne veulent plus : elle garantit que l'assortiment de produits présent dans ce magasin ne comporte aucune de ces substances.
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) a également connu une forte accélération avec cette période du covid-19. De plus en plus d'entreprises décident de « s'y mettre ». Les grandes entreprises ont entamé cette démarche depuis longtemps tandis que d'autres en sont aux balbutiements. Le contexte pousse les entreprises à aller vers la RSE.
Nous venons de terminer une première phase de RSE durant laquelle nous avons beaucoup parlé de stratégie RSE. Les entreprises se sont tournées vers des sociétés de conseil pour parler de stratégie RSE, avec de beaux discours, mais le passage à l'acte est compliqué.
Nous avons maintenant une opportunité pour que les entreprises concrétisent leur engagement, en travaillant d'abord sur les impacts des produits qu'elles commercialisent sur la santé et l'environnement. C'est une thématique pratique, concrète, qui fait partie des attentes principales des consommateurs d'aujourd'hui, me semble-t-il.

Le moteur de cette révolution à la fois culturelle et de procédures est donc la pression des médias.
En fait, parler de qualité signifie répondre aux attentes de ses clients. Les produits de consommation sont faits pour les consommateurs. Ces consommateurs ont des attentes tout à fait légitimes, mais qui évoluent en permanence au gré de leurs sources d'information et des réseaux sociaux, lesquels peuvent d'ailleurs dire des bêtises. Il faut aussi faire un travail de filtrage. Une marque est tout à fait légitime à répondre aux attentes de ses clients qui ne sont évidemment pas les mêmes aujourd'hui que ceux d'il y a dix ans ou vingt ans. Personne ne parlait à l'époque de perturbateurs endocriniens ou de bisphénol A. Ces sujets arrivent maintenant et doivent être intégrés.

C'est en fait devenu un critère de vente.
Vous dites que les entreprises se sont lancées dans des démarches de RSE, certaines avec des moyens plus importants. Les grandes entreprises en ont très vite compris la nécessité, ne serait-ce que pour des raisons de débouchés commerciaux. Les agences de notation comme Vigeo Eiris pratiquent aussi une évaluation de la RSE me semble-t-il.
Je m'interroge tout de même sur la qualité et surtout l'opérationnalité de toutes ces démarches de bonne conscience en quelque sorte, sur leur impact réel, d'une part, sur la recherche et le développement, d'autre part, sur la capacité d'une entreprise à contrôler réellement les process. Comment faire en sorte que ce ne soit pas du pur green washing, compte tenu de la masse de produits potentiellement dangereux qui continuent à être mis sur le marché, malgré ce que vous présentez comme une prise de conscience ?
Encore récemment, des ONG ont reproché aux déclarations extra-financières d'être effectivement trop superficielles. Dans l'application de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre, on se rend bien compte que certaines entreprises n'ont pas fait cette déclaration tandis que d'autres font des déclarations assez superficielles.
Je pense qu'il faut distinguer les industriels ou les marques qui maîtrisent la conception et la fabrication des produits qu'ils commercialisent de ceux qui commercialisent sans fabriquer, qui peuvent être de grandes marques d'ailleurs. Ce modèle économique a ses propres spécificités et ses propres difficultés.
La relation commerciale et contractuelle est en quelque sorte dématérialisée entre ces entreprises. L'une d'entre elles est en contact « frontal » avec les consommateurs, avec la réglementation, l'administration… Comme elle met son nom sur le produit, d'après les textes réglementaires français et européens, elle a les mêmes obligations que si elle fabriquait elle-même le produit,
Toutefois, cela ne fonctionne pas en réalité ainsi. Il est très difficile de contrôler un fournisseur situé à l'autre bout de la planète. La mondialisation est ce qu'elle est. Nous n'allons pas refaire le monde. Il faut en tenir compte pour que ces exigences soient prises en compte dans les modèles économiques.
Cela nous amène au problème de la connaissance de ces thématiques, donc de l'expertise, donc de la formation. Des étudiants se sont récemment un peu insurgés, en disant qu'ils ne voulaient plus aller dans des entreprises qui ne font pas de RSE et aussi en demandant pourquoi cela ne leur est pas enseigné dans leurs cours. Effectivement, dans ma carrière, j'ai rencontré de jeunes entrepreneurs, bardés de diplômes, qui n'avaient aucune connaissance des exigences s'appliquant aux produits qu'ils étaient en train de développer et s'apprêtaient à commercialiser.
Les entreprises travaillent « en silos ». Ce défaut n'est pas spécifiquement français. Certaines personnes font du commerce, d'autres du marketing, d'autres de la qualité, d'autres des achats. Elles viennent toutes de cursus universitaires ou d'écoles différents, sans communication entre eux, et ce mode de fonctionnement continue dans l'entreprise. Lors de la conception d'une gamme de produits, il faudrait pourtant se mettre autour d'une table pour tenir compte des exigences des uns et des autres, faire un « casting » d'entreprises et de fournisseurs capables d'assumer ces exigences, qu'elles soient actuelles ou à venir. C'est tout un mode de pensée, auquel il faudrait intégrer aussi toutes les innovations liées à l'économie circulaire, afin que les produits soient conçus de façon à pouvoir être réutilisés ou réemployés, en ayant minimisé leurs impacts.

Vous soulignez la difficulté à travailler de façon transversale au sein d'une entreprise ainsi qu'un problème de gouvernance.

Nous avons entendu les mêmes remarques des représentants de l'État, de la gouvernance nationale et territoriale. Nous retrouvons finalement les mêmes problématiques au sein de l'entreprise : cette difficulté à dialoguer entre collègues qui ont des formations différentes, autour d'un même objectif pour faire en sorte que le produit mis en vente ne soit pas nocif pour la santé des consommateurs.
Comment progresser ? Je suppose qu'il faut distinguer les très grandes entreprises qui ont les moyens, par exemple, de recourir à vos services, et les petits revendeurs qui sont soumis aux mêmes exigences que s'ils étaient eux-mêmes les fabricants des produits.

Comment créer une dynamique qui emmène tout le monde ? Il existe une prise de conscience citoyenne et des chefs d'entreprise, en ce qui concerne les objectifs commerciaux. Comment arriver à s'y mettre sans moyens, sans formation, sans connaissances en chimie, sans maîtrise du process de fabrication lui-même ?
Ce n'est pas le cas uniquement de cette thématique. Les lacunes sont scientifiques, technologiques mais aussi réglementaires, de connaissance du droit. Les aspects juridiques, c'est-à-dire la conformité des produits de consommation en général, quel que soit le produit même le plus simple, par exemple des cure-dents, témoignent d'un véritable « mille-feuilles » de réglementations extrêmement complexes. Je travaille avec une avocate, Me Sylvie Pugnet, qui est l'experte de référence en France sur le droit des biens de consommation non alimentaires et c'est extrêmement compliqué.
La clé d'entrée est certainement la formation. Il n'est pas normal que des élèves d'écoles de commerce qui apprennent à faire des plans de développement n'aient aucune idée de la physique, de la chimie, des ressources utilisées, même tout simplement pour fabriquer les jeans qu'ils portent. Qu'est-ce que le coton ? D'où cela vient-il ? Pourquoi est-ce polluant ? C'est assez facile à expliquer, de même qu'il faut leur expliquer l'impact climatique des activités humaines, ce qu'est la biodiversité… C'est indispensable puisque ces personnes se retrouveront dans des entreprises, grandes ou petites, dans lesquelles ces connaissances leur feront prendre les bonnes décisions et avoir les bons réflexes.
La remarque est la même pour les réglementations. Nous avons plusieurs réglementations en Europe, d'abord une réglementation générale sur la sécurité des produits, qui est relayée en France par le code de la consommation, puis des réglementations sectorielles pour les cosmétiques, les produits de construction… et enfin une réglementation transverse sur les substances. Ces différentes réglementations ne sont pas forcément cohérentes. Les bilans faits, entre autres par l'Europe, montrent qu'il existe de très grandes incohérences entre les différentes réglementations s'appliquant au même produit. Cela crée une sorte d'insécurité, d'incompréhension.
Par exemple, dans la réglementation européenne sur les substances, Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals (REACH), se trouvent un certain nombre de substances considérées comme préoccupantes, dont nous savons qu'elles peuvent être dangereuses à différents titres. Dans la réglementation des matériaux à contact alimentaire en plastique, un certain nombre de ces substances sont encore autorisées, ce qui oblige à faire la différence entre la conformité d'un produit et sa sécurité sanitaire et environnementale.
Être « conforme » ne suffit plus aujourd'hui. Certaines entreprises ayant un niveau de culture « basique » sur ces sujets ne comprennent pas pourquoi, alors que leurs produits sont conformes, il leur est reproché de contenir telle ou telle substance. Les entreprises se font devancer en permanence par les attentes de la société. Comment les aider à « renverser la vapeur » et à gérer au mieux ces situations ?
Je collabore avec différentes expertises et j'essaie, depuis quelques années, de comprendre le monde du risque. De plus en plus de gestionnaires de risques, ou risk managers, sont présents dans les entreprises. C'est un métier assez récent. L'association pour le management des risques et des assurances de l'entreprise (AMRAE) est assez dynamique et nous essayons de spécifier, dans ce domaine du risk management, la situation des produits de consommation, en expliquant que l'approche par le risque est aussi importante que l'approche RSE. Il faut sans doute en permanence combiner les deux.
À nouveau, ne fonctionnons pas « en silos » avec, d'un côté, des gens qui se préoccupent uniquement de la RSE et, de l'autre, des gens préoccupés uniquement de la conformité ou du risque. Essayons d'avoir une approche globale, dans laquelle nous sommes sûrs d'avoir identifié « à 360° » l'ensemble des approches, pour les intégrer dans la conception, la fabrication, la commercialisation d'un produit.
Comme je le disais tout à l'heure, en plaisantant, mais au fond pas tant que cela, pour vendre une boîte de cure-dents, l'origine du bois serait un sujet, les résidus de pesticides seraient un sujet, l'emballage en plastique serait un sujet, la conformité à la réglementation au contact alimentaire serait un sujet. Même pour un produit aussi simple, c'est d'une complexité phénoménale.

La réglementation est aussi faite pour protéger et apporter de la sécurité. Comment amener les entreprises à comprendre ces problématiques complexes ? Elles font appel à la chimie, il faut tenir compte des effets-cocktail à l'intérieur même du produit, entre le contenant et le contenu. Comment amener les entreprises à un certain niveau de connaissances et limiter les prises de risques ? En plus du risque sanitaire et environnemental se pose également, à terme, le problème de la prise de risques juridiques.
Pour le moment, les entreprises ne sont pas toutes mises en cause mais, à terme, de la même manière qu'il existe des recours collectifs contre les États ou des ministres, cela peut aussi être le cas contre une problématique d'exposition latente, récurrente, par exemple à des perturbateurs endocriniens.
La réglementation devrait être un filtre permettant de définir les exigences adéquates, à un instant donné, pour la société en général, qu'il s'agisse des consommateurs ou des entreprises. À chaque instant, chacun peut exprimer sa vision sur les réseaux sociaux, des controverses scientifiques ont lieu, les médias ont leur impératif d'actualité. Sans filtre, les entreprises ne savent plus où donner de la tête et à quelle partie prenante elles doivent répondre. La réglementation devrait donc être ce filtre.
Elle tente de l'être, mais elle est mise en échec bien souvent. Par exemple, l'Europe doit adopter sa nouvelle stratégie sur les substances chimiques, d'ici la fin de l'année. Selon l'état des lieux qui a été dressé, les réglementations relatives aux substances chimiques – puisqu'il en existe plusieurs de façon transverse, sectorielle… – sont pleines de « trous dans la raquette ». Il en existe plusieurs selon que l'on parle de matériaux, de produits finis, de produits alimentaires…
Ensuite, les entreprises doivent avoir leur propre approche par le risque, en mixant les normes ISO 31 000 et ISO 26 000, c'est-à-dire les approches par la RSE et par le risque. Certaines entreprises commencent à travailler dans ce sens, afin d'avoir une démarche permanente de détection, de prise en compte et d'amélioration continue des produits, à mesure de l'évolution des connaissances scientifiques. Il faut mettre en place, dans les entreprises, des organisations qui répondent à ces enjeux très complexes, globaux et planétaires, en termes d'environnement, d'aspects sociaux, économiques et technologiques. Il faut avoir un mode de fonctionnement qui intègre l'ensemble de ces éléments, alors que l'on a trop longtemps fait croire aux entreprises qu'il suffisait d'être certifié ISO 9 000 pour fabriquer de bons produits.
Tout cela a changé très vite, en quelques années et cela ira en s'accélérant. Les pouvoirs publics doivent moderniser leur manière de concevoir, définir des règles qui sont faites, certes, pour protéger le consommateur, mais aussi pour protéger les entreprises, en tout cas, me semble-t-il, par exemple en Europe. Ces règles doivent également être opérationnelles, non contradictoires entre elles.
J'ai été directeur associé chez Greenflex de 2013 à 2019. Mon objectif était d'intégrer cette thématique de conformité et de sécurité des produits, comme socle indispensable à toute démarche de RSE. Greenflex était spécialisée dans la RSE. Greenflex a connu une très forte évolution, puisque nous étions 60 personnes lorsque j'y suis entré en tant que directeur associé et 500 ou 600 personnes, lorsque j'ai quitté l'entreprise. Greenflex a été rachetée par Total en 2017 et ce n'était donc plus du tout le même contexte que celui de la start-up que j'ai connue en 2013, et j'ai décidé de redevenir entrepreneur indépendant. Certaines entreprises comme Greenflex donnent une vision, une stratégie, mais les entreprises, lorsqu'elles ont une vision, ne savent pas comment la concrétiser. J'aide donc les entreprises à œuvrer concrètement.

Le groupe Greenflex est très étendu puisqu'il a plus de 400 clients. Je voudrais savoir si les clients de ce groupe ne sont que des grandes entreprises ou si certaines petites entreprises, qui doivent se lancer dans ces démarches par nécessité ont également accès à ce conseil. Est-ce abordable ou ces petites entreprises vont-elles continuer à être dans l'improvisation, l'à-peu-près ?
Il est intéressant de voir ce que font les très grandes entreprises qui ne fabriquent pas leurs produits mais les sous-traitent à des dizaines, des centaines, voire des milliers de fournisseurs. Leur influence est extrêmement importante et cela peut être un levier très intéressant.
Nous avons parlé très récemment de l'incroyable levée de fonds d'une start-up française, la Mirakl, qui a levé 300 millions de dollars. Personne n'a parlé de l'entreprise EcoVadis qui a levé 200 millions de dollars. EcoVadis permet aux grandes entreprises de faire évaluer à distance, par l'intermédiaire de plateformes, des dizaines, des centaines ou des milliers d'entreprises, dans le monde entier, sur des critères environnementaux et sociaux. Si des entreprises comme EcoVadis ont réussi de telles levées de fonds, c'est parce que nous nous rendons compte que nous avons besoin de ce type d'outil et que c'est un outil de très grande valeur. Nous pouvons disposer d'un levier, à la fois par l'intermédiaire de la grande marque qui est fort exposée, mais aussi grâce aux plateformes et aux outils digitaux modernes qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans la vision d'un parc de fournisseurs.

Je reviens à votre prise de position personnelle dans Le Monde. Vous plaidez pour la mise en place d'une carte d'identité pour les produits. Que pensez-vous de la démarche consistant à mettre en place un Toxi-score qui éclairerait le consommateur de façon un peu plus scientifique que ne le font des applications comme Google ou Yuka ?
La chimie est partout. Comment pourrions-nous envisager un système qui permettrait d'éclairer le consommateur, même s'il n'y connaît absolument rien ? Comment lui permettre d'identifier, de façon simple, ce qui est dangereux pour lui ? Comment l'informer des effets des interactions entre les produits chimiques, puisque nous savons tous qu'il y a une difficulté entre les seuils par molécule et les effets-cocktail ?
Comment verriez-vous cette carte d'identité ? Serait-ce par produit, par molécule ? Selon les circonstances, une molécule peut être ou non autorisée, ce qui est tout aussi incompréhensible pour le consommateur que pour une entreprise qui s'engage dans une démarche vertueuse.
Je ne sais pas comment appeler cette discipline pour ne pas faire peur aux gens : de la physique des produits ou de la chimie des produits ou des sciences naturelles des produits. En tout cas, ces notions de base sur les produits qui nous entourent doivent être enseignées dès l'école et jusqu'aux niveaux les plus élevés, quelle que soit la spécialisation.
Chacun devrait avoir une compréhension de base, savoir d'où viennent le cuir, le coton, comment sont fabriqués un cahier et un stylo. Actuellement, nous avons l'impression que les produits arrivent de nulle part, qu'ils tombent du ciel. Le consommateur n'en connaît ni la composition ni les conditions de fabrication. Après avoir utilisé un produit, il le met dans un bac jaune, vert ou bleu et ne sait pas du tout ce que le produit devient.
Je prends toujours l'exemple des gels douche avec des microbilles de plastique : cela partait à la mer et que pensaient les gens ? Ils semblaient imaginer en quelque sorte que, dans la bonde de fond de douche, cela partait dans une sorte de trou noir et que cela disparaissait. Le monde dans lequel nous vivons n'a finalement aucune matérialité.
Tout est dématérialisé d'ailleurs. Il faut remettre un peu de matérialité dans nos vies de consommateurs, de citoyens, en commençant par enseigner tout cela aux enfants. Ils comprendraient très bien de quoi sont faits leur T-shirt en coton ou la brosse à dents qu'ils utilisent.
Plusieurs problèmes se posent. D'abord, nous avons vécu pendant un demi-siècle une chimie débridée et un très grand nombre de substances sont sur le marché, plus de 100 000. Toutes n'ont pas été correctement étudiées et nous n'en connaissons pas forcément les effets sur la santé.
Il est aussi problématique de savoir où sont les substances, de quoi sont faits les produits qui nous entourent. Des substances sont cachées dans les produits. La table de cette salle, par exemple, a sûrement été fabriquée avec du bois, mais aussi avec des colles, des vernis… et les gens qui l'ont achetée n'avaient sans doute pas l'information. Une table n'est pas un produit cosmétique et nous n'avons pas sa composition sur une étiquette collée dessous. De même, nous avons le nom de la fibre utilisée dans nos habits, mais aucune information sur les autres substances, telles que les colorants…
Ensuite se pose le problème des effets de ces substances sur la santé, lorsque nous y sommes exposés. C'est un sujet extrêmement sensible, bien connu des toxicologues : faire la différence entre le danger et le risque. Cette différence génère beaucoup d'incompréhensions de la part des consommateurs et des organismes de consommateurs qui confondent un peu les deux.
Le danger est un peu comme avoir une piscine dans laquelle se trouverait un crocodile. Le crocodile est le danger. Si je ne tombe pas dans la piscine, il ne m'arrivera rien mais, si je tombe dans la piscine, si je suis en contact avec le crocodile… C'est la même chose avec les substances et il faut bien faire cette distinction. Sinon, toutes les substances sont dangereuses, il faut tout arrêter et retourner vivre dans une caverne.
Cette notion d'approche par le risque est indispensable, comme le savent bien les spécialistes du médicament, ceux de la cosmétique et, de façon générale, ceux de la chimie. Nous ne savons pas forcément où sont les substances, ni comment nous sommes exposés aux substances. L'idée serait donc de mieux intégrer les produits dans cette thématique de la santé-environnement pour que nous ayons une idée de ce à quoi nous sommes exposés au travers des produits qui nous sont proposés en tant que consommateurs, travailleurs…
Certaines actions commencent à se mettre en place. En France, nous avons par exemple l'observatoire de la qualité de l'air intérieur. Je pense aussi au digital qui peut nous permettre de savoir, à chaque instant, quels produits nous entourent et donc ce à quoi nous sommes exposés. Cela permettrait également de réaliser des études épidémiologiques.
Les cohortes Elfe et Helix, suivies durant des années, donnent des informations extrêmement précieuses mais sans doute insuffisantes. Nous pourrions accélérer un tel suivi grâce au digital, en mesurant en permanence ce à quoi nous sommes exposés. Des start-up apparaissent qui proposent des mesures de la qualité de l'air intérieur en permanence ou bien de tracer les produits auxquels nous sommes exposés à différents moments de la vie.
Ce sujet des substances est assez complexe, à la fois par méconnaissance des substances en elles-mêmes, par méconnaissance de leurs effets, par méconnaissance de leurs localisations dans les produits.
La première étape est donc de rematérialiser toute la chaîne, auprès de tous les professionnels, pour que nous puissions, petit à petit, comme c'est le cas pour des produits très locaux fabriqués par des industriels que nous connaissons, connaître les substances mises en œuvre. Cette information est forcément connue, quelqu'un la détient en amont de la chaîne, par exemple les grandes sociétés qui vendent les granules de plastique. Les questions sont souvent posées aux marques qui se trouvent « en frontal » avec le consommateur, alors qu'elles n'ont pas les réponses ou sont obligées d'investir des budgets incroyables, qui font les choux gras de certains laboratoires payés pour analyser les produits, bien que, dans la chaîne, certains acteurs savent de quoi sont composés les produits.
Il est donc question ici de la donnée, de la data et même de la big data, puisqu'il s'agit d'un nombre conséquent d'informations. Il faudrait imposer une transmission d'informations vraiment effective entre les uns et les autres. Cette transmission d'informations devrait être prévue dans la réglementation sur les substances chimiques (REACH), mais nous savons qu'elle n'a qu'une portée très limitée dans le cadre actuel.
Je pense qu'il faut une vision globale du secteur de la grande consommation, donc du commerce mais aussi de l'industrie. Il faut tenir compte des aspects scientifiques qui évoluent en permanence, du digital, de l'aspect propre aux ressources humaines. Nous devons embrasser un certain nombre de disciplines pour répondre à cette problématique.

Vos propositions paraissent logiques et pertinentes, compte tenu du constat que vous faites des difficultés rencontrées par les entreprises. En revanche, je m'inquiète de l'urgence, en particulier l'urgence pour les politiques à prendre des décisions pour protéger la population, tandis que cette big data sera longue à mettre en place. Nous ne savons même pas qui la mettra en place.
Nous constatons déjà des difficultés pour le partage des données scientifiques, ne serait-ce qu'entre les deux ministères de la santé et de l'environnement. Si, à l'échelle de l'État, nous avons déjà ce type de difficultés, qu'en sera-t-il pour les entreprises ? Qui serait le porteur, l'initiateur, le gestionnaire de cette big data ?
Êtes-vous au courant de prémices de mise en place d'un tel système ?
Dans une chaîne de fabrication, vous avez, d'un côté, un certain nombre d'acteurs qui achètent des matériaux, les assemblent et en font un composant nouveau, puis transmettent ce composant au suivant et ainsi de suite. Toutefois, les informations ne sont pas transmises, sauf dans quelques rares cas. En cosmétique par exemple, il est obligatoire d'avoir la liste des ingrédients et nous savons que, lors de la fabrication d'un shampoing, l'industriel a mélangé tels ou tels ingrédients mais, dans de nombreux autres cas, nous n'en savons rien. Il suffirait que la réglementation l'exige.
Par exemple, il existe une énorme différence réglementaire entre les mélanges chimiques – colles, peintures, tout ce qui est liquide, pour schématiser – et les articles tels que cette table. Ce n'est pas parce que cette table est un article solide que nous ne devons pas savoir de quoi a été fait le vernis sur le bois, quelle est la source du bois, d'où il vient, si de la colle se trouve à l'intérieur…

Nous en revenons donc à la réglementation : une carte d'identité du produit en fait et peut-être le Toxi-score. Si la carte d'identité donne simplement la liste de tous les constituants du produit, le consommateur n'y verra pas plus clair. Nous l'avons vu avec le Nutri-score, avec trois couleurs toutes simples, rouge, orange et vert, c'est beaucoup plus compréhensible, parce que similaire aux feux tricolores que nous croisons tous les jours.
Si vous ne donnez qu'une liste de produits, c'est incompréhensible. Il faudrait une solution plus simple.
Bien sûr. Lorsque vous parlez de Toxi-score, vous parlez de la partie finale, celle qui est visible par les consommateurs mais, avant d'en arriver là, il faut que tous les acteurs de la chaîne se transmettent les bonnes informations, de façon complète, entre professionnels. Le dernier d'entre eux peut alors faire une analyse de risques et communiquer ce sur quoi il doit communiquer, ni plus ni moins.
Le reproche que nous pouvons faire à certains organismes de consommateurs est de souvent « allumer la mèche » sur le danger et non sur le risque. Ils disent « attention, ce produit contient telle substance » mais, selon l'endroit où cette substance est logée, la façon dont le produit a été fabriqué, la substance en question ne présente peut-être plus aucun risque pour la santé.
Il est exact que nous ne pouvons pas donner toutes les compositions chimiques de tous les produits à tous les consommateurs. Cette partie finale doit être travaillée par des communicants, y compris en ce qui concerne l'aspect juridique. Il faut réfléchir à ce qui doit être dit ou non au consommateur. Toutefois, pour faire correctement ce travail, il faut que tous les professionnels de la chaîne, jusqu'au dernier, puissent disposer de l'ensemble des informations chimiques.

Il faut donc d'abord faire le tri au niveau de la chaîne de production, avant de donner l'information au consommateur.
Il faut améliorer la communication d'informations sur la composition des produits. Aujourd'hui, de nombreux professionnels ne savent pas de quoi sont faits les produits qu'ils commercialisent. C'est une lacune de plus en plus lourde de conséquences. Si les fabricants ne savent pas de quoi sont faits les produits, d'où ils viennent, à une époque où les consommateurs demandent plus de transparence, de façon instantanée, où des applications, c'est-à-dire d'autres parties prenantes, parlent à la place du fabricant en prétendant savoir de quoi sont composés les produits, ce n'est plus possible.

Nous jouons tous aux apprentis sorciers en manipulant des produits dont nous ne connaissons pas la dangerosité, sans savoir le risque qu'ils font courir au consommateur.
Nous pouvons prendre l'exemple des perturbateurs endocriniens.

Vous êtes un scientifique. Quels sont les liens de causalité avérés ou non et comment concevoir une politique de réduction de l'exposition aux perturbateurs endocriniens pour la population ?
Lorsque vous dites que nous jouons aux apprentis sorciers en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens ou d'autres produits, il faut garder à l'esprit le rôle du secteur industriel et économique de la chimie dans la modernisation que nous avons connue. Grâce à la chimie, nous avons inventé les bons médicaments, les bons équipements et la société s'est modernisée. Cela s'est fait sans prise en compte des impacts sanitaires, environnementaux… Cette prise en compte commence effectivement à venir et nous découvrons depuis peu la question des perturbateurs endocriniens.
Parler de perturbateurs endocriniens est sans doute incomplet. Au-delà de la perturbation des systèmes endocriniens du corps humain, ces produits ont probablement d'autres aspects néfastes. Ce sont des substances qui contiennent souvent un atome de fluor et le fluor est l'élément le plus électronégatif du tableau de Mendeleïev. Les substances dans lesquelles se trouve du fluor sont donc très persistantes et non biodégradables, voire sont bioaccumulables. Nous l'avons tous vu dans le film Dark Waters avec les polymères fluorés, comme le téflon. Nous avions déjà travaillé sur ce sujet il y a une quinzaine d'années : DuPont a payé la plus grosse amende de tous les temps pour rétention d'informations, puisque ces substances polluent l'environnement, soit par leur production, soit par leur usage, soit par les déchets et puisqu'elles se retrouvent dans l'air.

Cette substance présente-t-elle encore plus de risques que les perturbateurs endocriniens ?
Ce sont des perturbateurs endocriniens, mais ils sont en plus persistants. S'ils étaient biodégradables, ils seraient perturbateurs endocriniens pendant un temps limité mais, malheureusement, ils se retrouvent dans les chaînes alimentaires.
Le même phénomène existe avec les substances chlorées, notamment certains pesticides. Certains commencent à être interdits, mais les pesticides chlorés sont aussi des perturbateurs endocriniens.
C'est également le cas du brome. Les molécules bromées sont des retardateurs de flamme utilisés par exemple dans les sièges sur lesquels nous sommes assis ou dans les meubles pour éviter qu'ils ne s'enflamment trop vite.
En fait, ces produits appelés halogènes – chlore, brome, fluor – confèrent malheureusement leurs qualités de résistance dans le temps à ces molécules ce qui est un deuxième handicap.
Même si les discussions se poursuivent sur la définition juridique des perturbateurs endocriniens, les scientifiques s'accordent à peu près pour définir la perturbation endocrinienne. C'est assez clair pour les toxicologues, mais nous ne savons pas bien quelles substances sont des perturbateurs endocriniens et cette question évolue chaque jour. Des listes officielles commencent à sortir, ce qui permet d'éclairer la situation.
Cette thématique est complexe également parce que la notion de dose n'est plus pertinente, ce qui est une révolution pour les toxicologues. Nous disions jusqu'à présent « la dose fait le poison » selon la formule du célèbre chimiste Paracelse, mais cela ne fonctionne pas ainsi pour les perturbateurs endocriniens. Certains produits sont assez dangereux à faible dose et moins dangereux à haute dose.
De plus, nous constatons un effet transgénérationnel : lorsque la grand-mère est exposée, c'est la petite-fille qui développera des maladies. C'est donc très compliqué, nous avons affaire à des effets sans seuil et nous ne savons pas comment appréhender la question.
En 2009, nous avions organisé un colloque sur la chambre de l'enfant, avec l'association Santé environnement France (ASEF) parce qu'il faut aussi tenir compte de la notion de vulnérabilité des cibles, selon que l'exposition a lieu chez un bébé, un enfant, une femme enceinte, par exemple. La chercheuse Barbara Demeneix qui étudie les effets des perturbateurs endocriniens sur la thyroïde ou André Cicolella qui étudie leur impact sur la reproduction et le quotient intellectuel sont des spécialistes de ces problèmes.
Nous avons donc des difficultés à savoir quelles sont les substances concernées, à quelles doses, où elles se trouvent, par quoi les remplacer. Il faut vraiment porter un « focus » sur ces substances, tandis que d'autres substances comme les composés cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) présentent des risques assez bien connus. Ce sont des substances en général bien suivies, surtout dans le monde du travail.
Les perturbateurs endocriniens réclament toute l'attention parce qu'ils cumulent tous les défauts de méconnaissance scientifique et technologique.

Quelles sont vos recommandations ? Quelles sont les pistes d'amélioration ? Par où commencer ? En santé environnementale, la difficulté de fond est souvent que nous ne savons pas par quel bout prendre les problèmes.
Je pense qu'il faut considérer la chaîne des produits de consommation comme un sujet à part entière dans la santé environnementale. Il ne faut pas parler de la santé environnementale de façon trop large et évasive.
C'est une bonne façon de faire cristalliser les questions sur des cas concrets, sur les produits de consommation tels qu'ils sont conçus, fabriqués partout sur la planète, distribués, utilisés, critiqués par les consommateurs. C'est une discipline qui n'existe pas actuellement. Il n'existe pas de cours sur ce qu'est la consommation responsable. Il faut former les gens, leur apprendre à faire preuve d'esprit critique sur ces questions et agglutiner les expertises autour de ces points.
Par ailleurs, nous pouvons rassembler les impacts sur la santé humaine, la santé animale et l'environnement, par exemple avec le plan national santé-environnement (PNSE). Tout est lié comme nous l'avons vu avec l'expérience du covid-19 et il faut arrêter de raisonner « en silos ». Les perturbateurs endocriniens ont autant d'effets sur les hommes que sur les animaux.
Il faut plus de cohérence dans la réglementation de ces substances. Nous ne pouvons pas dire, d'un côté, que telle substance est interdite tandis que, dans une autre réglementation qui s'applique au même produit, mais à d'autres titres, cette substance est autorisée. C'est illisible et il faudrait une sorte d'architecte, une superstructure qui s'assure de la cohérence des textes au moment de leur conception. La situation est très compliquée pour les entreprises et le fait d'avoir une réglementation transverse et cohérente sur les substances chimiques leur permettrait de mieux respecter les règles.
Enfin, j'ajouterai un mot sur l'administration censée faire appliquer ces textes. J'accompagne actuellement une entreprise qui travaille dans le domaine de la vente en vrac, puisque c'est une pratique encouragée dans la loi sur l'économie circulaire. Nos clients veulent vendre des produits sans emballage, mais ces produits sont soumis à des obligations de marquage d'informations. Comment faire ? Nous avons interrogé l'administration en proposant des solutions. Nous pouvons dématérialiser, mettre l'information ailleurs, sur Internet, créer une application… Pourtant, sur ce seul sujet très simple, trois ministères sont concernés – travail, environnement, économie – avec moult structures comme la direction générale des entreprises (DGE) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Chacun se renvoie la balle, voire ne répond pas. Il faut les relancer cinquante fois et, finalement, personne ne prend position.
L'administration est bien sûr là pour faire respecter les textes mais, lorsqu'elle crée des textes qui vont dans le sens des nouvelles attentes sociétales, comme l'économie circulaire, comment cette administration pourrait-elle accélérer l'innovation et non la freiner ?

Cette audition nous a éclairés sur le monde de l'entreprise et sur les difficultés rencontrées par les entreprises. Elles sont souvent montrées du doigt comme responsables de tous les maux des consommateurs, alors qu'elles s'inscrivent elles-mêmes dans des démarches qui se voudraient vertueuses et n'ont pas toujours les moyens de faire face à ces nouvelles responsabilités.
Je vous remercie des pistes que vous venez d'ouvrir. Il est très difficile de trouver les fils conducteurs dans la complexité du système. Nous en arrivons à une conclusion déjà entendue de la part d'autres personnes auditionnées : les perturbateurs endocriniens doivent être la cible de toutes nos préoccupations dans nos produits de consommation, au quotidien, en essayant de clarifier notamment la réglementation. REACH nous y aidera peut-être.
Nous notons aussi les difficultés relationnelles et organisationnelles, lorsque les administrations d'État sont sollicitées, alors qu'elles sont censées pouvoir répondre et accompagner cette mutation vers la sobriété chimique.
L'audition s'achève à douze heures quinze.
Membres présents ou excusés
Commission d'enquête sur l'évaluation des politiques publiques de santé environnementale
Réunion du jeudi 24 septembre 2020 à 11 heures
Présent. - Mme Élisabeth Toutut-Picard
Excusés. - M. Yannick Haury, Mme Sandrine Josso, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Jean-Louis Touraine