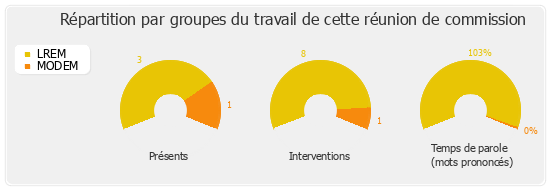Commission d'enquête sur l'évaluation des politiques publiques de santé environnementale
Réunion du mardi 27 octobre 2020 à 17h00
La réunion
L'audition débute à dix-sept heures.

Nous entendons nos collègues députées Mmes Claire Pitollat et Laurianne Rossi, co-rapporteures de la mission d'information commune sur les perturbateurs endocriniens présents dans les contenants en matière plastique, présidée par M. Michel Vialay. Votre rapport a été présenté en décembre 2019, et vous y avez dressé l'état des lieux de l'exposition aux perturbateurs endocriniens présents dans les contenants en plastique. Vous avez abordé la question de leurs effets sur la santé et de leur diffusion dans l'environnement à travers les déchets en plastique.

La mission d'information que nous avons rapportée et dont nous avons remis le rapport le 4 décembre 2019 portait sur les perturbateurs endocriniens présents dans les contenants en plastique à usage alimentaire, cosmétique ou pharmaceutique. Le rapport a été adopté à l'unanimité par les commissions du développement durable et de l'aménagement du territoire et des affaires sociales. Dès le lancement de nos travaux en février 2019, nous avons souhaité rencontrer l'ensemble des acteurs concernés par la problématique, de tous les secteurs, pour mieux en appréhender les enjeux. À cette fin, notre mission a réalisé au total 70 auditions et tables rondes auprès d'acteurs appartenant à des champs d'expertise très variés : médecins, scientifiques, chercheurs, associations, entreprises, fédérations professionnelles.
Ces sujets sont complexes et encore peu abordés dans leur globalité. La mission d'information s'est appuyée sur une revue bibliographique réalisée par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) de notre Assemblée. L'OPECST a mené un travail particulièrement précieux pour notre mission d'information, qui nous a permis d'être éclairées sur les enjeux scientifiques attachés à nos travaux. Notre mission s'est également déplacée à Bruxelles puisque nous travaillions sur un sujet éminemment européen, et nous y avons rencontré les agences européennes compétentes. Nous nous sommes aussi rendues à Helsinki, au siège de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
La mission a abordé toutes les voies de perturbation endocrinienne liées aux contenants en plastique. Les travaux ont notamment porté sur les migrations des composants du plastique vers les aliments ou les produits présents dans les contenants, mais aussi sur leurs conséquences en matière de contamination de l'environnement pour l'homme et pour les animaux qu'il consomme – poissons, fruits de mer – via la pollution plastique. Nous avons également étudié les déchets collectés, recyclés ou abandonnés dans la nature et dans les eaux usées, l'impact de la dégradation et de la migration des composants du plastique dans l'environnement et dans l'écosystème. Nos travaux rejoignent en partie les travaux de la présente commission d'enquête et témoignent de l'acuité de la question. La pollution aux plastiques est omniprésente, et aucun milieu n'y échappe. Les impacts de la pollution sont liés à ce que nous ingérons, mais également à ce que nous inhalons et, même si la mission n'a pas examiné en détail la voie de contamination aérienne, qui n'était pas dans notre champ d'investigation, elle mérite toutefois la plus grande attention.
Le système endocrinien est essentiel pour le maintien des équilibres biologiques. Aux âges cruciaux de l'organogénèse et du développement – la vie fœtale, la petite enfance, l'adolescence –, les effets des perturbateurs endocriniens peuvent être irréversibles comme l'ont rappelé la plupart des acteurs que nous avons auditionnés. Les perturbateurs endocriniens peuvent parfois affecter plusieurs générations. Les modes d'action des perturbateurs endocriniens les rendent non seulement irréversibles, mais également redoutables. Ils peuvent avoir un impact à très faible dose, interagir les uns avec les autres dans le cadre d'un effet cocktail et produire leurs effets des années après l'exposition.
Nous avons souhaité sonder les besoins de la recherche, les lacunes de nos réglementations, le rôle stratégique de l'État, ainsi que les actions de communication et de sensibilisation à mettre en œuvre sans plus tarder pour que chacun puisse adopter les bons gestes, préserver sa santé et l'environnement et faire de ce sujet une véritable priorité sanitaire nationale. L'exposition aux perturbateurs endocriniens constitue un enjeu de santé publique majeur.
En ce qui concerne nos recommandations, j'insisterai sur plusieurs points. Il faut en premier lieu renforcer la réglementation européenne, qui nous apparaît trop lacunaire et très hétérogène selon les secteurs d'application. Compte tenu de la difficulté à atteindre un bon niveau de preuve en matière de perturbations endocriniennes, il est également impératif de distinguer au sein de la réglementation européenne trois catégories de perturbateurs, comme le fait l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) au niveau national : perturbateurs avérés, perturbateurs présumés, perturbateurs suspectés. Il convient également de prendre, sur la base du principe de précaution, des mesures dès lors qu'un perturbateur endocrinien est présumé, sans attendre la preuve formelle de sa nocivité, car il est alors déjà trop tard.
Nous préconisons également d'adopter une définition transversale des perturbateurs endocriniens et d'inscrire clairement le principe de précaution dans les textes. Nous insistons sur l'impératif de renforcer l'obligation des industriels dans le cadre du règlement Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques (REACH) du Parlement européen et du Conseil, adopté le 18 décembre 2005. C'est un point très important, car il s'est en quelque sorte opéré un renversement de la charge de la preuve : les industriels peuvent fournir des dossiers incomplets dont les agences et les scientifiques passent beaucoup de temps à démontrer les lacunes. Les industriels font une déclaration et il appartient aux agences de démontrer ensuite que le dossier est incomplet. Il faut donc accroître les objectifs de contrôle et renverser cette charge de la preuve. Un autre point très important sera de supprimer l'exemption d'enregistrement des polymères dans le cadre du règlement REACH.
Nous proposons de fixer également des règles plus protectrices pour les femmes enceintes, allaitantes, les nourrissons, les enfants en bas âge et les adolescents. Nous devons aller vers les contenants les plus inertes possible. Cela aura évidemment un impact lors de la consommation du produit, mais aussi lorsque le contenant devient un déchet. Devant l'urgence, pour assurer une protection efficace de la santé et de l'environnement, nous souhaitons introduire dans le droit européen la possibilité d'interdire à la fois une molécule et celles dont la structure est proche, sans attendre la multiplication des études scientifiques sur toutes les molécules alternatives de la même famille. Nous avons donc conclu que la circulation des informations sur les matériaux et leurs propriétés reste très perfectible, ainsi que la transparence sur les substances utilisées. Il faut intensifier le travail d'information tout au long de la chaîne de valeur.
Nous proposons par ailleurs d'accentuer fortement les efforts de recherche sur les perturbateurs endocriniens, sur les matières plastiques, sur lesquelles nous sommes encore très ignorants, en particulier en ce qui concerne leur mode de vieillissement, et sur les nanoplastiques. Il nous paraît indispensable d'accroître les moyens dévolus à la recherche, de regrouper et d'assurer la coordination des initiatives en la matière, d'élargir les projets de recherche à d'autres substances que les plus connues. Nous connaissons les bisphénols, les alkylphénols, les phtalates, mais il en existe d'autres, notamment les substituts à ces substances interdites, particulièrement au bisphénol. Nous proposons aussi d'accroître la recherche sur la dégradation des composants du plastique, aussi bien dans le corps humain que dans l'environnement, ainsi que sur les métabolites de ces substances chimiques qui peuvent être aussi dangereux, voire plus dangereux que le perturbateur endocrinien lui-même.
Nous alertons sur les nanoplastiques pour lesquels nous devons faire preuve d'une vigilance particulière dans la mesure où ils traversent toutes les barrières tissulaires. Il convient d'accroître la recherche et les efforts pour disposer de méthodes d'essai robustes. Il faut poursuivre des travaux très poussés sur ces perturbateurs et toutes les autres substances susceptibles de se trouver dans les contenus, en particulier les substances non intentionnellement ajoutées.

En ce qui concerne le recyclage et l'information du public, nous avons indiqué qu'il fallait suivre plus précisément le devenir des additifs lors du recyclage. Le recyclage n'est pas une solution miracle face à la diffusion des plastiques, car aucun recyclage de plastique ne se déroule en boucle fermée. Même si nous arrivions à recycler 100 % des plastiques, nous connaissons mal le vieillissement du plastique et il se produit donc une dispersion dans l'environnement par des microplastiques ou des nanoplastiques. Tant qu'il existera du plastique, il existera une diffusion du plastique, malgré le recyclage. Le recyclage n'est pas non plus une solution miracle face aux enjeux sanitaires des perturbateurs endocriniens. Il fait partie d'un panel de solutions à mettre en œuvre, mais il faut établir un suivi sanitaire du polytéréphtalate d'éthylène recyclé (rPET) dans le cadre de recyclages successifs. Le nombre de recyclages du rPET n'est pas bien maîtrisé. Il faut aussi assurer une vigilance spécifique sur le devenir des additifs aux polymères lors du recyclage chimique en cours de test.
Pour que nous puissions substituer en toute sécurité les additifs dans ces plastiques, il faut être plus vigilant sur les molécules de substitution. Les solutions ne sont jamais universelles et s'articulent très finement avec des changements de pratique qui incombent à chacun. Les scientifiques emploient par exemple le terme de « substitution regrettable » pour le bisphénol A, qui a été substitué avec du bisphénol S et d'autres bisphénols dont nous commençons à montrer qu'ils ont un peu près les mêmes impacts sur la santé que le bisphénol A. Il ne faut donc pas autoriser une molécule en substitution d'une autre tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'un criblage particulièrement poussé.
Il est aussi nécessaire de clarifier rapidement s'il existe un risque de dispersion des microplastiques dans l'environnement du fait du compostage des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables. Il faut soutenir les travaux menés par les acteurs de la restauration collective pour anticiper l'application de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (Egalim), poursuivre la réduction de l'emploi des plastiques à usage unique par des mesures d'interdiction et de sensibilisation, et renforcer les contrôles à l'importation.
Il convient également de former, informer et sensibiliser aux plastiques, à leurs effets sur la santé et l'environnement. La connaissance des enjeux liés à la migration des substances du contenant vers le contenu est insuffisante. Dans le cas des perturbateurs endocriniens, les additifs présents dans le plastique d'emballage migrent vers le contenu que nous mangeons ou buvons. Il faut diffuser largement cette information, car des gestes simples peuvent parfois réduire largement l'exposition et ils ne sont pas appliqués. Nous saluons à cet égard la création du site « Agir pour bébé » qui est une source d'informations pour les particuliers et les professionnels, à l'image du travail réalisé par certaines agences régionales de santé (ARS), dont celle de Nouvelle-Aquitaine. Il convient de soutenir leur travail de diffusion de conseils pour un environnement plus sain et la limitation de l'exposition aux pollutions plastiques. Il manque encore des mesures pour diffuser des recommandations destinées aux adolescents. Ils sont très sensibles aux perturbateurs endocriniens puisqu'ils sont en plein développement.
Nous sensibilisons aussi sur les mauvais usages des contenants en plastique. Il est indispensable d'alerter précisément le grand public et les personnels de la restauration collective sur l'existence de ces migrations de certains plastiques vers les aliments à froid, à chaud, à température ambiante. Le phénomène est encore trop méconnu ; trop de personnes pensent que la migration se fait lors du réchauffage alors qu'elle peut se faire à froid et à température ambiante. Les personnes doivent être informées sur les conditions d'usage qui accentuent les migrations : réutiliser trop souvent une barquette plastique alors qu'elle n'est pas conçue pour cet usage accentue les migrations. Ce plastique dégradé peut même passer dans les aliments.
Il faut donc alerter sur les conditions d'emploi très spécifiques des contenants en plastique à travers une campagne d'information grand public dans les médias, à travers des messages très clairs sur les mauvais usages possibles des bouteilles en plastique. Les réutilisations successives de ces bouteilles sont extrêmement nocives. Pour assurer la pleine cohérence des messages de la puissance publique, nous avons porté une recommandation visant à faire cesser la distribution des produits cosmétiques gratuits en maternité. La valise de maternité qui montre aux parents des échantillons est complètement contre-productive lorsque nous les invitons ensuite à limiter l'exposition aux plastiques de leur bébé, comme l'explique le site « Agir pour bébé ».
Nous recommandons de mettre en place un « Toxi-score » intégrant les perturbateurs endocriniens et permettant au consommateur d'être rapidement informé de la présence de substances chimiques dangereuses et plus largement de « reprendre la main », et ce pour que les produits soient développés de façon vertueuse. Il faut indiquer les qualités nutritionnelles, mais aussi la non-nocivité du point de vue des produits chimiques, cibler la présence de substances chimiques dangereuses et particulièrement des perturbateurs endocriniens.
D'une manière générale, nous constatons que les bonnes pratiques existent, mais sont trop peu relayées et appuyées. Le changement dans les collectivités territoriales doit être accompagné par une feuille de route et des recommandations précises de substitution pour tous les produits d'entretien, tous les contenants en plastique utilisés dans les établissements recevant du public et gérés par des collectivités territoriales. Il faut simplifier leurs choix en mettant à leur disposition des listes de produits. Tous les niveaux d'action territoriale sont pertinents, chaque collectivité ayant des clefs pour agir. L'État doit agir en diffusant aux décideurs, aux acheteurs et au grand public ces feuilles de route comportant des recommandations officielles sur les stratégies de substitution sûres. Il est également nécessaire de renforcer la formation des acheteurs publics sur la mise en œuvre des clauses environnementales dans les marchés publics.
De nombreuses évolutions apparaissent déjà dans la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC) que nous avons adoptée. Nous étions nombreux à porter des amendements, adoptés dans le cadre de l'examen de ce texte, afin qu'il contienne des dispositions renforcées sur les problèmes liés aux plastiques et aux perturbateurs endocriniens. Les ambitions de ce texte en matière de lutte contre les pollutions plastiques sont élevées. La pandémie actuelle, cependant, a eu pour conséquence un recours accru aux emballages plastiques jetables, notamment dans les secteurs sanitaire et agroalimentaire. De manière générale, la philosophie du tout jetable a pu très rapidement gagner du terrain, ce qui a alerté nombre de concitoyens et d'associations. La publication des décrets d'application relatifs à la loi AGEC a été retardée par cette pandémie, comme l'indique le rapport d'application de la loi présenté le 30 septembre par nos collègues Mmes Stéphanie Kerbarh et Mathilde Panot.
Cela montre l'extrême rapidité avec laquelle les pratiques vertueuses peuvent reculer, la dépendance de nos sociétés à des consommations à fort impact pour l'environnement, mais aussi le rejet de ces pratiques par un grand nombre de personnes. Nous estimons urgent qu'une approche d'ensemble fondée sur le principe de précaution prévale dès lors que les indices de toxicité de certaines matières paraissent assez robustes. Il ne faut pas attendre une preuve établie, bien trop longue pour ce type de substance. Il reste donc beaucoup à faire : mieux réglementer, mieux soutenir la recherche, mieux protéger les publics sensibles. Il est important de prendre en compte les femmes enceintes et les bébés, mais il faut rappeler que les adolescents et les personnes âgées sont aussi des publics sensibles. Mieux informer, mieux sensibiliser, mieux contrôler sont autant de leviers qui doivent être actionnés simultanément.
Nous soulignons et saluons dans notre rapport le travail considérable assumé par les associations rencontrées. Nous témoignons également de la très forte implication du monde scientifique et médical. Toutefois, c'est aussi à chacun d'entre nous de prendre conscience individuellement des risques pour notre santé et de prendre une juste part à l'évolution des modes de consommation.

Vos propositions sont très structurées et couvrent un large éventail d'actions. Vous avez présenté ce rapport en décembre 2019. Que s'est-il passé depuis ? Des conclusions du rapport ont-elles été reprises dans les politiques publiques ? Vous avez parlé des amendements que vous avez soutenus dans le cadre de la loi AGEC. Parmi toutes les propositions que vous avez présentées voici presque un an, quelles sont celles qui ont pu passer ? Quelles sont celles qui vous paraissent essentielles et sur lesquelles il faudrait encore insister et de quelle manière ?
Nous avons reçu les représentants de France Chimie. Leur position est très claire : ils respectent la réglementation avant tout et s'en arrêtent à la catégorie des perturbateurs endocriniens déclarés avérés. Vous avez longuement parlé de la dimension juridique. C'est un travail qui ne peut être fait qu'au niveau européen. Au niveau national, que proposeriez-vous de plus urgent et réalisable facilement ? L'avez-vous évalué du point de vue du coût ?

Les décrets d'application de la loi AGEC sont en retard. Nous regrettons aussi de ne pas pouvoir mettre en place le « Toxi-score » que nous souhaitions faire passer dans cette loi, mais nous n'avions pas la capacité d'en évaluer l'impact.
Les perturbateurs endocriniens dépendent du règlement REACH au niveau européen. La France avait été précurseur sur le bisphénol : il avait été d'abord interdit par la France puis l'interdiction avait été reprise au niveau de l'Europe. C'est compliqué d'agir ainsi, car cela met en tension les acteurs industriels et ce serait plus simple de réviser le règlement REACH. Pour une révision efficace, il faut également avoir des méthodes d'expérimentation beaucoup plus rapides pour évaluer le caractère potentiellement nocif ou potentiellement perturbateur endocrinien. Ce sont des travaux au long cours que certaines démarchent ont l'ambition d'accélérer, comme la plateforme publique-privée sur la prévalidation des méthodes d'essai sur les perturbateurs endocriniens (PEPPER). Elle vise à financer des solutions de recherche très appliquée sur la détection de perturbateurs endocriniens.
Malheureusement, il ne s'est pas écoulé suffisamment de temps depuis la sortie de notre rapport, d'autant plus avec la crise sanitaire, pour que des mesures soient réellement mises en œuvre. Il faudrait, au-delà de « Agir pour bébé », pousser des développements permettant d'élargir le public visé à toutes les populations sensibles aux perturbateurs endocriniens en les informant des gestes à faire. Une autre avancée rapide possible serait d'agir auprès des collectivités territoriales. Nous sommes tout à fait capables de fournir des listes de produits contenant un minimum de substances chimiques ou des solutions pour limiter les contenants en plastique dans les collectivités territoriales et donc dans les établissements recevant du public qu'elles gèrent. Établir de telles listes est tout à fait à la main du Gouvernement aujourd'hui et serait très utile. Lorsque nous avons auditionné l'Association des départements de France (ADF), l'association Régions de France (RF) et l'Association des maires de France (AMF), toutes nous ont indiqué attendre ce type de liste pour faciliter l'achat des produits et les marchés publics en faveur de l'environnement.

Nous vivons avec ce rapport : les propositions que nous avons formulées nous accompagnent quasi quotidiennement dans le travail législatif et de terrain qui est le nôtre. Nous nous efforçons de les porter au travers de chaque texte, lorsque cela est pertinent, ainsi que dans le cadre des réunions et des échanges que nous avons, dans la mesure où toutes les recommandations que nous avons posées ne relèvent pas forcément de la loi, comme celles sur la formation initiale et la formation continue des professionnels de santé et des paramédicaux.
De la même manière, un travail est à mener auprès des collectivités qui sont très démunies sur le sujet, et peu conscientes de l'enjeu sanitaire et environnemental. Par le biais des associations d'élus, notamment de l'AMF, nous avons commencé tout un travail d'accompagnement. Nous avions pour ambition, avec Mme Claire Pitollat et M. Michel Vialay, d'organiser des tables rondes dans les territoires pour échanger avec les élus locaux. La crise sanitaire ne l'a malheureusement pas permis. Nous envisagions de porter ce rapport au niveau européen et de le présenter aux parlementaires et aux agences, aux directions générales, et nous n'avons pas pu le faire. Néanmoins, les contacts continuent.
Je citerai tout de même quelques avancées. La première figure dans la loi Egalim : c'est l'interdiction des contenants en plastique dans toute la restauration scolaire, de la crèche à l'université, adoptée au titre du principe de précaution. Deux amendements ont également été adoptés dans le cadre de la loi AGEC. L'un, de M. Michel Vialay, introduit un pictogramme destiné aux femmes enceintes sur certains produits pour signaler la dangerosité liée aux perturbateurs endocriniens. L'autre, porté par nous-mêmes, vise à mettre en données ouvertes toutes les substances chimiques de type perturbateurs endocriniens utilisées par les industriels. Nous n'avons pas réussi à obtenir le « Toxi-score », un peu anxiogène, mais nous continuerons à porter cette proposition et je crois que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) la porte également. Nous avons toutefois obtenu la mise en données ouvertes, et les décrets d'application sont parus récemment.
Le sujet qui me paraît prioritaire est l'actualisation en cours du règlement REACH, ce qui nous donne une opportunité d'avancer sur toutes les propositions que nous avons faites. La transparence sur les substances utilisées à l'égard du consommateur est aussi une urgence. Il faut être plus exigeant à l'encontre des industriels sur ce sujet. Enfin, il faut mener une campagne nationale d'information. L'Agence nationale de santé publique (SPF) a commencé à le faire avec le portail « Agir pour bébé », mais la campagne doit être plus grand public, pour alerter sur les mauvais usages et le risque présenté par certains produits.

Pourriez-vous nous expliquer comment mettre en œuvre le « Toxi-score » ? Pourriez-vous également nous expliquer comment vous envisagez la formation des personnels médicaux et paramédicaux ? Comment jugez-vous, aujourd'hui, la mise en œuvre de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens ?

Le « Toxi-score » s'inspirerait du Nutri-score avec un pictogramme très simple, très lisible, accessible à chacun de nos concitoyens, figurant sur chaque emballage et permettant de savoir quel est le degré de nocivité au regard des perturbateurs présents, qu'ils soient suspectés, présumés ou avérés, en se fondant sur la classification de l'ANSES. Cela suppose évidemment que les industriels qui mettent ces produits sur le marché soient transparents sur les substances utilisées. J'ajoute que, même si le « Toxi-score » n'a pas été adopté, l'industrie a un temps d'avance puisqu'elle a d'ores et déjà élaboré un pictogramme, dont la fiabilité pose cependant question, cet indicateur n'étant pas piloté par une agence nationale.
Les alternatives mises sur le marché sont également un vrai sujet. À partir du moment où une substance ou un produit sont interdits, d'autres types de substances ou de produits tels que la cellulose, le plastique biosourcé ou biodégradable arrivent. Certes, il n'est pas d'origine fossile, et il peut donc avoir des vertus d'un point de vue environnemental, mais, d'un point de vue sanitaire, il contient lui aussi des phtalates pour lui donner de la souplesse et de la couleur. Ces substituts sont tout aussi dangereux pour la santé humaine. La science et le politique ont malheureusement toujours un temps de retard par rapport au temps industriel, d'où la nécessité du principe de précaution. Nous n'irons jamais assez vite pour identifier et tester toutes les substances mises sur le marché.

La formation des professionnels de santé à ces enjeux est un sujet qui a été abordé dans le programme « Ma santé 2022, un engagement collectif » et la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que nous avons adoptée. Lors des discussions, il avait été dit qu'il n'était peut-être pas nécessaire de donner des précisions dans la loi, que la volonté du Gouvernement de traiter ces enjeux était déjà présente, et qu'il existait déjà des modules dans la formation des professionnels de santé, que ce soit en formation initiale ou continue. Pourtant, actuellement, nous ne voyons pas vraiment d'accélération de la diffusion de ces messages.
Le sujet est soulevé dans le cadre du rapport de la commission des 1 000 premiers jours publié en septembre 2020 qui fait valoir que, même en augmentant les structures d'accueil parents-bébé, la mise en pratique sera compliquée si nous ne formons pas les professionnels à la détection des troubles. Il faut améliorer la formation des professionnels de santé aux risques environnemental et psychique. Tout cela fait partie d'une volonté politique qu'il faut continuer de porter avec le Gouvernement pour que, petit à petit, les formations initiales et continues englobent ces sujets. Ils ne sont pas encore assez largement diffusés.

Comment parvenir à identifier la dangerosité des perturbateurs endocriniens ? C'est en fait le cœur du problème. C'est ce que nous ont opposé les industriels en disant que, tant que le lien de causalité n'est pas démontré, ils se réfugient derrière la réglementation. Avez-vous travaillé avec les agences pour savoir comment démontrer les liens de causalité des impacts de la chimie sur l'organisme ? Comment avez-vous réussi dans votre rapport à mettre en exergue l'existence réelle de ces liens qui, pour certains, ne sont encore que suspectés ?

Notre rapport évoque la migration et je crois que tous les acteurs scientifiques que nous avons auditionnés sont très clairs sur ce sujet. Il se produit une migration du contenant vers le contenu. Ensuite se pose la question de l'impact sur la santé humaine ou l'environnement de cette migration des substances vers le contenu. Bon nombre de médecins, de chercheurs, même à l'échelle européenne, mènent encore des travaux pour mettre au jour, de manière très documentée, des liens de causalité avec certaines pathologies. Elles sont nombreuses et nous en faisons la liste dans le rapport : troubles de la croissance, troubles de la fertilité, cancer, autisme, obésité, troubles cardiovasculaires et bon nombre d'autres pathologies graves. Ces recherches doivent être renforcées, et cela fait partie de nos propositions. Des moyens doivent être alloués à ces efforts, mais des travaux existent déjà, y compris aux États-Unis.

Nous demandons l'application du principe de précaution parce que les médecins et chercheurs nous ont tous dit que ces substances ont un impact sur notre santé très différent de ce qu'ils avaient l'habitude d'étudier. Elles défient toutes les règles classiques de toxicologie : la dose ne fait plus l'effet. Ce sont plutôt des fenêtres d'exposition qui peuvent produire des effets sur plusieurs générations. Ils l'ont montré dans le cadre de quelques substances qui sont aujourd'hui les perturbateurs avérés, mais au prix de combien d'années, de combien de vies affectées par de troubles de santé lourds sur plusieurs générations ! Lorsque le danger est suspecté, c'est que des effets ont déjà été constatés sur des écosystèmes. Beaucoup de chercheurs sont d'accord pour dire qu'attendre la preuve de l'impact sur l'homme est trop long. Il faut avoir des moyens de mise à l'épreuve plus rapides.
L'Agence nationale de la recherche (ANR) nous a dit que, pour développer des tests fiables de l'impact sur la santé humaine, nous en avions encore pour dix ou quinze ans. La compréhension des mécanismes est assez récente, même si le problème est étudié depuis plusieurs dizaines d'années. Ce sont des effets à très faible dose et c'est une science encore récente. Malgré tout, les effets sur les écosystèmes sont visibles et nous avons écrit dans notre rapport que nous ne pouvons pas attendre d'avoir précisé les règles de toxicologie pour les perturbateurs endocriniens. Nous savons qu'ils sont nocifs, qu'ils auront un impact sur plusieurs générations. Les médecins suivent des cohortes et voient les chiffres de ces pathologies augmenter. Il faut agir en précaution, d'autant plus que nous pouvons nous en passer : il s'agit souvent d'une consommation de produits qui ne sont pas essentiels.

Je vous remercie pour toutes les informations que vous nous avez apportées dans le cadre de cette audition et pour votre excellent travail.
L'audition s'achève à dix-sept heures quarante.