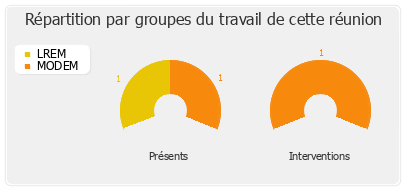Commission d'enquête sur l'évaluation des politiques publiques de santé environnementale
Réunion du jeudi 19 novembre 2020 à 17h30
La réunion
L'audition débute à dix-sept heures trente.

M. Philippe Lacoste, conseiller des Affaires étrangères hors classe, est directeur du développement et M. Vincent Szleper, chef du pôle Eaux, pollutions et affaires transversales à la sous-direction du climat et de l'environnement, à la direction générale de la mondialisation de la culture, de l'enseignement et du développement international du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Cette audition vise à replacer la politique française de santé environnementale dans son arrière-plan international.
Quelle est la portée juridique ou politique des déclarations relatives à la santé environnementale, par exemple de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ?
Quel est l'indice de la prise de conscience internationale d'un domaine d'intérêt ou d'urgence commun ? Ce qui prévaut en matière climatique peut-il être considéré comme le modèle d'une prise de conscience élevée, modèle auquel il convient de comparer ce qui prévaut dans le domaine de la santé environnementale ?
Dans cette commission d'enquête, plusieurs intervenants auditionnés ont évoqué la position leader de la France, notamment sur les plan international et européen, pour ce qui regarde la santé environnementale. Quels sont les indices d'un tel engagement et quels sont les objectifs poursuivis ?
(MM. Philippe Lacoste et Vincent Szleper prêtent serment.)
Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir demandé à m'entendre. En effet, comme directeur du développement durable, mon travail quotidien consiste à favoriser les approches transversales ou, au moins, croisées, qui ne se produisent pas naturellement en raison de la spécialisation des politiques et des organisations. Il va de soi que le sujet « santé et environnement » m'intéresse et m'encourage.
Je travaille dans le domaine de la défense de l'environnement, ma spécialité, depuis une vingtaine d'années. Je constate que la situation a beaucoup évolué. À titre d'exemple, je me souviens de la conférence des parties (COP) de la convention sur la biodiversité, qui s'est déroulée en Corée en 2014, et qui affichait le slogan « Un seul monde, une seule santé ».
Je me souviens également de la COP 21. À l'époque, j'étais le numéro deux de l'équipe de négociation française et j'ai collaboré à de longues séances de travail avec l'OMS, qui considérait le changement climatique comme un problème de santé publique, en raison non seulement de l'augmentation de la température et des grandes vagues de chaleur qu'elle induit, mais également de la modification des vecteurs de maladies. Ces problématiques intéressaient l'OMS au plus haut point. Elle a dorénavant d'autres préoccupations, mais à l'époque, un service de l'OMS était dédié aux changements climatiques.
Je pense que je peux apporter aux travaux de la commission un éclairage sur le droit international, notamment en matière d'environnement. De façon caricaturale, mais je l'espère, pédagogique et simple, je dirais que lorsqu'on est amené à s'intéresser à la gestion des biens communs internationaux – l'atmosphère, un fleuve qui traverse plusieurs pays, les océans –, on se heurte très rapidement au principe de souveraineté nationale. Il n'existe aucune juridiction internationale, aucun mécanisme coercitif, qui permettraient d'éviter, par exemple, des phénomènes de passagers clandestins. Dès lors, il convient de s'accommoder de grandes déclarations, d'engagements basés sur le volontariat des États. Finalement, la seule arme dont disposent ceux qui souhaitent faire évoluer la situation réside dans la communication. Dans ce cadre, nous réalisons un suivi des engagements pris, nous étudions le niveau des engagements réalisés et nous pointons les bons et les mauvais élèves. Aussi caricaturale soit-elle, cette présentation illustre bien les contraintes imposées par le droit international dans ces domaines qui comportent des enjeux globaux. Bien sûr, cette difficulté peut être levée par le biais d'un transfert de compétences. À titre d'exemple, l'Union européenne dispose de moyens coercitifs pour encourager la mise en œuvre d'actions. En effet, dans certaines circonstances, les États peuvent être condamnés. Il me semblait utile à vos travaux de vous indiquer les limites du droit international.
Votre première question porte sur la portée de ces grandes déclarations internationales relatives à la santé environnementale, notamment celles de l'OMS. Nous pouvons citer la conférence d'Alma-Ata de 1978 et la charte d'Ottawa de 1986. Ces déclarations ont d'abord eu le mérite d'identifier les facteurs environnementaux à prendre en compte afin d'assurer la santé des populations. Elles ont également conduit à lancer un certain nombre de stratégies liées à la santé et à l'environnement. Ces stratégies sont initiées au niveau international et proposent des objectifs ambitieux. Ensuite, elles sont déclinées aux niveaux régional et national. Ces conférences donnent naissance aux plans nationaux Santé et environnement (par exemple la conférence de Budapest de 2004). La France déploie son quatrième plan Santé et environnement. Ces plans définissent des objectifs et proposent des actions concrètes à mener sur chaque territoire.
Les grandes conférences ont également le mérite de lancer des initiatives spécifiques à certaines zones géographiques susceptibles d'être confrontées à des problématiques particulières. Je pense notamment aux petits États insulaires qui sont, non seulement très vulnérables aux changements climatiques, mais également isolés. L'OMS leur est particulièrement attentive et ils ont fait l'objet d'une nouvelle stratégie en 2017.
Votre seconde question sous-entend qu'on donne beaucoup d'importance au changement climatique, qu'une large communication est diffusée relativement aux travaux de la Conférence annuelle des parties, mais qu'on n'identifie pas très bien la santé environnementale dans cette visibilité internationale et dans l'intérêt que semble exprimer la communauté internationale. Cette impression que vous exprimez n'est pas tout à fait exacte. En effet, un des premiers accords internationaux faisant le lien entre santé humaine et protection de l'environnement est la convention de Vienne relative à la protection de la couche d'ozone qui s'est tenue en 1985. Je vous en épargnerai l'historique, mais une des principales conséquences de la dégradation de la couche d'ozone a consisté en une augmentation du nombre de cancers de la peau. J'oserai dire, un peu cyniquement, que cette convention constitue un des rares succès de la diplomatie environnementale puisque, via le protocole de Montréal, elle a fait en sorte que la fabrication des substances identifiées (gaz utilisés dans les aérosols et dans les dispositifs de réfrigération) soit arrêtée. Ces produits ne sont dorénavant plus fabriqués et la couche d'ozone est en cours de reconstitution. Ces conventions représentent des instruments à participation universelle. La convention de Vienne a été signée sept ans avant la convention-cadre des Nations unies relative aux changements climatiques et les autres grandes conventions issues de la conférence dite « du Sommet de la terre ».
D'autres outils, d'autres conventions internationales permettent de lutter contre les contaminations identifiées à l'échelle mondiale. La convention de Stockholm traitait des polluants organiques persistants (POPS), ces composés chimiques qui s'accumulent dans les sols au cours de la chaîne alimentaire et ont des conséquences sur la santé humaine. La convention vise à réduire leur fabrication et leur utilisation.
La convention de Minamata sur le mercure est récente et très emblématique. Les rejets d'une industrie pétrochimique dans la baie de Minamata au Japon avaient causé de très nombreux dégâts pour la santé des populations et c'est la raison pour laquelle la convention porte le nom de cette baie. Elle vise à limiter l'utilisation du mercure, métal très toxique et elle est en phase de mise en œuvre.
Certains outils internationaux traitent également la question des mouvements transfrontaliers des polluants ou des déchets dangereux. Dans ce cadre, il convient de retenir deux conventions célèbres. La convention de Bâle vise le transport des déchets dangereux. La convention de Rotterdam pose le principe d'un consentement préalable, c'est-à-dire qu'un pays qui ne se sent pas en mesure de recueillir des déchets ou des produits dangereux, parce qu'il ne dispose pas de la capacité de les traiter, est en droit de les refuser.
Cinq accords multilatéraux majeurs ont donc été conclus en vingt-cinq ans. Ce constat montre l'appétence croissante des États pour la réduction des impacts négatifs des pollutions chimiques sur la santé.
Pour quelle raison la convention sur le climat paraît-elle tout écraser ? Je pense que ce constat relève de son universalité. En effet, si les accidents industriels sont localisés, les changements climatiques sont universels. Je pense également qu'intervient la notion d'urgence de l'action, largement reprise dans la presse, qui insiste sur le fait que plus on tarde à agir, plus on diminue les chances d'obtenir des résultats. C'est pourquoi cette convention prime sur les autres, notamment dans les médias. Par ailleurs, contrairement aux autres conventions, la convention sur le climat se réunit chaque année. Pour autant, elle reprend des principes déjà édictés par les autres, notamment le principe selon lequel toute décision doit être basée sur la science. Dans ce cadre, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a largement communiqué relativement aux enjeux de la lutte contre les changements climatiques. La France essaie de promouvoir leurs propositions au niveau international, notamment dans le domaine des pollutions chimiques. Nous disposons de données, mais elles ne font pas l'objet de rapports périodiques aussi largement diffusés que les rapports du GIEC. Cette interface entre la politique et la science a été considérée comme un succès important de la convention sur les changements climatiques. Il en est de même d'ailleurs pour la convention sur la biodiversité qui dispose également d'un conseil et d'une interface qui publiera ses rapports. Nous proposons qu'une telle instance soit créée dans le domaine de la santé et de l'environnement, ce qui contribuerait à faire remonter cette problématique au rang des priorités.
Vous nous avez interrogés sur l'intérêt porté par la France dans le domaine des océans et de la mer. Les conventions liées au droit de la mer sont un peu plus tardives que les grandes conventions relatives à l'environnement. Le droit de la mer a surtout traité de l'exploitation du milieu marin, à savoir la détermination des zones de compétence des États et des zones de compétence universelle. En effet, la haute mer étant « res nullius », c'est-à-dire qu'elle n'appartient à personne, la question de l'utilisation des ressources halieutiques et du fond marin a donné lieu à de nombreux travaux et continue à faire l'objet de coopérations et de discussions internationales. Nous travaillons actuellement sur une convention liée à la haute mer et nous progressons sur la question de la pollution par les plastiques : un continent formé de déchets qui dérive, les microparticules de plastique que l'on retrouve non seulement dans les poissons que nous consommons, mais également dans l'eau, etc. La France tente de promouvoir ces sujets via un projet de convention internationale. Les cheminements sont toujours un peu longs, mais nous progressons, en insistant sur la prévention. En effet, moins nous produirons de déchets, moins nombreux seront les plastiques répandus à traiter.
Une de vos questions portait sur les modalités de détermination de la position de la France dans les négociations. Sur ces sujets précisément, la compétence est essentiellement communautaire européenne. Nous menons un travail piloté par les services du Premier ministre afin de coordonner les positions des différents ministères. Lorsque notre position est arrêtée, nous la défendons à Bruxelles. Lorsque la position européenne est définie, l'État membre qui assure la présidence défend notre point de vue lors des discussions et il est assisté de la Commission européenne. Le processus est long, mais il permet de travailler sur des sujets intéressants tels que la révision du règlement REACH qui prévoit de classer les produits chimiques en fonction de leur dangerosité, de leurs modalités d'accès à l'espace de l'Union européenne, etc. Ces questions font l'objet de débats entre ministères, avec le ministère de la Transition écologique, notamment, mais également avec le ministère de l'Industrie. Le ministère des Affaires étrangères apporte alors un éclairage quant aux positions internationales et les possibilités qui s'offrent à la France de se situer sur cet échiquier. Ensuite, les positions sont défendues au cours des conférences des parties et des rencontres qui ont lieu lors de ces conventions. Nous accompagnons les négociations par des contacts bilatéraux.
Au sein de l'Union européenne, nous travaillons sur ces questions de santé environnementale avec des pays partenaires, avec lesquels nous approfondissons davantage les sujets, notamment l'Allemagne et les Pays-Bas, pays très attentifs aux questions d'interface environnement/santé.
Nous rencontrons néanmoins une difficulté structurelle, à savoir que la diversité des sujets que nous sommes amenés à traiter est telle que ce ne sont pas toujours les mêmes ministres qui les portent. En Allemagne, le ministre de la Santé porte exclusivement l'ensemble de ces sujets. Dans la pandémie actuelle, il est l'unique interlocuteur compétent en matière de politique de prévention, tests, vaccins, etc. Dans ce pays, il n'existe donc aucune procédure d'arbitrage interministérielle, contrairement au dispositif français. Dès lors, le ministre de la santé allemand peut être amené à défendre une position différente de celle du ministre de l'Environnement. Il ne nous appartient pas de juger l'organisation politique de nos pays partenaires, mais force est de constater que cette multiplicité d'interlocuteurs génère des difficultés.
Nous avons également beaucoup travaillé sur le concept « Une santé » (« One Health »). Il consiste à réaliser un rapprochement de l'OMS, organisation centrale compétente, de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), organisation internationale en charge des épizooties, du programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), les organisations qui s'occupent d'alimentation. Ces rapprochements permettent de traiter de la santé humaine, de la santé des écosystèmes (animaux et humains compris) au sein des mêmes structures et de se rendre compte que tout est lié.
Vous nous avez interrogés quant aux initiatives européennes et internationales qui sont amenées à traiter des sujets de santé environnementale de première actualité (pollution de l'air, exposition aux perturbateurs endocriniens, facteurs environnementaux, maladies chroniques, etc.). Nous travaillons par « grands milieux » tels que, à titre d'exemple, la pollution des cours d'eau. Au ministère des Affaires étrangères, nous étudions les cours d'eau transfrontaliers et nous tentons de conclure des conventions internationales qui, au-delà de la navigation, traitent également des rejets identifiés le long du cours. Une de nos plus anciennes conventions concerne le Rhin. En effet, les rejets des usines de potasse d'Alsace ont causé des soucis à nos amis néerlandais, par exemple. En revanche, nous ne sommes pas parvenus à signer un accord sur le Rhône, faute d'une convergence de point de vue avec nos amis suisses concernant ce fleuve et le lac Léman. Quoi qu'il en soit, ces outils conventionnels nous permettent de traiter des sujets dans une dynamique de coopération et sans mécanisme de sanction.
De la même manière, il existe de nombreuses conventions relatives aux mers régionales (Méditerranée, mer du Nord) qui traitent des questions de rejets, industriels ou d'assainissement.
La qualité de l'air est un sujet régional. Depuis le phénomène des « pluies acides », qui avait conduit à la disparition de massifs forestiers, le sujet a été un peu oublié. Il a été traité dans une approche européenne et a abouti à la réduction de polluants, tels que le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, les composés organiques volatils et ammoniacs. Le processus est bien rodé : d'abord, on établit une liste restreinte sur laquelle l'ensemble des pays s'accorde, puis on l'élargit. Peu à peu, les émissions de gaz et de particules qui sont à l'origine de nombreux problèmes respiratoires diminuent.
La raison pour laquelle la lutte contre la dégradation de la couche d'ozone a été un succès rapide, alors que dans d'autres domaines, nous progressons plus lentement, réside dans une identification rapide de produits de substitution, d'autres molécules qui permettaient non seulement de répondre aux besoins, notamment industriels, mais également de réduire la pollution.
De la même manière, s'agissant de la pollution au mercure de Minamata, les Japonais sont parvenus à découvrir un catalyseur de substitution au mercure, ce qui a permis d'enrayer cette pollution, mais les recherches ont duré une vingtaine d'années.
En dialoguant avec les chercheurs et les industriels, il est parfois possible d'identifier des procédés industriels moins polluants ou de diminuer significativement leurs effets néfastes sur l'environnement et donc, sur la santé.
Nous menons actuellement des études relatives à la pollution plastique et nous nourrissons l'ambition d'obtenir un accord global quant à la réduction de ces déchets, dont l'élimination s'avère très complexe. Nous travaillons non seulement sur le cycle de vie des produits dans une démarche écoresponsable, mais également sur des traitements qui permettent de récupérer ces produits, de les transformer ou de les enfouir.
La réduction des pollutions chimiques demeure prégnante. Elle se décline en deux axes : la réduction de la production et la gestion des stocks. Il convient de ne pas oublier qu'en Afrique, les pesticides et les produits phytosanitaires ont permis la « révolution verte », c'est-à-dire l'augmentation des rendements, qui a conduit à éviter la grande famine prévue. En revanche, souvent, l'utilisation de ses produits ne répond pas aux normes des fabricants, faute de formation des utilisateurs : trop fortes concentrations, usage de produits périmés, etc. La gestion des stocks existants et le transport des déchets sont complexes à maîtriser, notamment dans les pays en développement, qui constatent l'intérêt immédiat de l'utilisation de ces produits sans mesurer leurs effets à plus long terme sur l'environnement et sur la santé des populations.

Je vous remercie pour ce beau voyage autour du monde ; non seulement un tour du monde des problèmes, mais également un tour du monde des démarches initiées, plus ou moins efficaces. Vous nous avez présenté un inventaire des conventions, bilatérales ou multilatérales, dont la France peut se montrer fière puisqu'elle est souvent à l'origine de ces dynamiques.
La démarche « One Health » est portée par le ministre des Affaires étrangères. Dans le cadre du Groupe santé-environnement (GSE), j'ai assisté à une conférence extrêmement intéressante, intitulée « Covid, zoonoses, One Health ». L'intervenant nous a présenté les connexions établies entre l'OMS, l'OIT et le gouvernement français, en l'occurrence. Il semble que ces connexions comportent une dimension internationale sur laquelle je souhaiterais que vous nous apportiez des précisions. Le positionnement de portage de cette démarche « One Health » correspond-il à une stratégie française en matière de santé environnementale ? Vous nous avez dressé une liste de conventions, le plus souvent de conventions thématiques, initiées sur un mode réactif ou réactionnel, en regard d'un gros problème ou d'une crise ponctuelle. Au cours de nos auditions, nous avons constaté que ce mode opératoire est mis en exergue comme un problème dans la gestion de la santé environnementale en France et il semble qu'il en soit de même à l'échelle internationale. Nous réagissons ensemble dans l'urgence face à une situation de crise. Pensez-vous que la démarche conduite par le ministre des Affaires étrangères français, « One Health », constituera une approche internationale beaucoup plus structurée qui nous conduira vers la signature d'engagements, à l'instar des engagements pris au cours du GIEC sur le climat ? Ces démarches pourraient alors déboucher sur une sorte de GIEC sur la santé environnementale, ainsi que sur des accords internationaux qui porteraient la santé environnementale dans une dimension pluridisciplinaire, multithématique et, surtout, internationale.
Je pense que la démarche « One Health » constitue en effet cette approche internationale que vous évoquez. Depuis plusieurs années, des contacts entre des organisations internationales se sont développés, chaque organisation demeurant très soucieuse de son territoire administratif et de ses prérogatives. L'OMS entretenait déjà des relations avec l'OIE et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Cependant, le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) exerce en quelque sorte une tutelle sur les grandes conventions relatives aux produits chimiques. Il existait donc peu de contacts dans le domaine environnemental. L'objectif du concept « One Health » consistait donc à élargir ce qui existait déjà, en maintenant la position centrale de l'OMS, selon une volonté fortement exprimée par le ministre français et son homologue allemand. L'OMS était alors soumise à de nombreuses critiques, mais nous avons considéré que, malgré ses défauts, l'OMS était la seule organisation légitime et qu'il était nécessaire de la conforter en la plaçant au centre d'autres organisations qui traitent préférentiellement de facteurs environnementaux. L'objectif consistait à former si ce n'est un GIEC santé environnementale, très lourd, du moins un Haut conseil, dans une approche pluridisciplinaire du sujet. En effet, à titre d'exemple, nous savons que l'origine de la Covid-19 est directement liée à des facteurs environnementaux. Les experts indépendants de ce Haut conseil pourront formuler des recommandations, voire alerter les gouvernements en cas de risque de crise. De nombreux experts avaient annoncé l'imminence d'une crise sanitaire mondiale, alors que, jusqu'à présent, les crises avaient été très localisées (Ebola, etc.). Pourtant, nous avons été surpris par l'étendue et la simultanéité de la crise liée à la Covid-19. Elle a donc constitué une occasion idéale de formaliser cette approche internationale, de casser les barrières dressées entre ces organisations, qui demeurent spécialisées par nature, et de rejoindre ce concept de santé environnementale qui rassemble des spécialités différentes, des formations académiques différentes, mais qui pourtant, se reconnaissent un intérêt commun en la matière.
Oui. Le Haut Conseil a été créé officiellement le 12 novembre 2020, à l'occasion du forum de Paris pour la paix, par le ministre français, M. Jean-Yves Le Drian, et son homologue allemand. Il convient désormais de le constituer en lui garantissant une forme d'indépendance. Les ministres nous ont demandé de ne pas construire un organisme trop bureaucratique constitué de représentants de chaque organisation, mais de regrouper un panel restreint d'experts pluridisciplinaires, capables de produire des rapports, voire de commander des études spécifiques à des organismes spécialisés.
Bref, la création du Haut Conseil a été annoncée, mais il n'est pas encore constitué et son président n'a pas été désigné.

Pour quelles raisons aucune campagne d'information relative aux maladies chroniques n'a-t-elle été déployée sur le plan national, dans le domaine de la santé publique ? Pourriez-vous nous apporter des précisions quant au « Green Deal » ? Selon vous, quelles sont les définitions du développement durable d'une part, et de la santé environnementale d'autre part ?
La santé environnementale se définit dans un large périmètre. Elle englobe l'ensemble des aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, déterminés par des facteurs physiques, chimiques, biologiques et esthétiques de notre environnement. Les grands anciens de la médecine grecs avaient déjà compris qu'il existait un lien manifeste entre les conditions de vie, l'environnement, et l'état de santé. La santé environnementale se situe à la croisée des chemins des politiques publiques en matière de santé et de protection des écosystèmes, constitués par tout ce qui est vivant et auxquels, donc, l'humain appartient. La conjonction de ces facteurs induit des conditions plus ou moins favorables à la vie. Les problèmes ont été décomposés par disciplines ainsi que par secteurs et nous avons parfois perdu l'objet principal de ce que nous cherchions, à savoir protéger et encourager la vie des êtres humains.
Le développement durable concerne un périmètre encore beaucoup plus large. Il comporte dix-sept objectifs qui traitent de questions très variées et insistent sur des aspects autres que les facteurs économiques. Certes, le développement économique – l'augmentation du PIB, du revenu par habitant, la croissance économique, etc. – constitue un facteur très important. Néanmoins, il n'est pas le seul. La démarche de développement durable est née dans le pilier environnemental et elle vise à faire en sorte que le développement économique ne soit pas réalisé au détriment de la qualité de la planète, de son eau, de ses forêts, ni au détriment de la qualité sociale qui regroupe les questions d'éducation, d'inégalités, etc. La définition du développement durable est parfois un peu bureaucratique, mais elle est aisément compréhensible. Toutefois, il s'est avéré nécessaire d'opérer un découpage par objectifs et de déterminer des cibles pour chaque thème à l'horizon de 2030.
Votre première question concerne des sujets tels que la pollution atmosphérique pour lesquels les coûts induits sont assez bien évalués. Comme dans toute société, différents groupes de pression s'affrontent. En outre, dans des périodes telles que celle que nous traversons, des menaces sur l'emploi, des contraintes sur l'activité économique et le développement de certains procédés pèsent lourdement. Dès lors, des campagnes telles que celles que vous évoquez pourraient être considérées comme inopportunes.

À plusieurs reprises, vous avez évoqué les difficultés bureaucratiques que vous rencontrez, liées à des cloisonnements. Devons-nous comprendre que la France n'est pas seule à souffrir de ce mal organisationnel ?
Je souhaiterais également que vous développiez la question des forces en présence, notamment de la puissance réelle de lobbyistes susceptibles de s'opposer à des démarches initiées en faveur de la santé publique et notamment des relations entre la santé et l'environnement. De quels leviers disposez-vous de sorte à convaincre vos interlocuteurs ?
Vous avez évoqué les relations productives avec l'Allemagne et les Pays-Bas, mais qu'en est-il des relations avec les grandes puissances actuelles ? De quelle manière parvenez-vous à initier des dialogues ? Nous savons que l'efficacité de la diplomatie française est particulièrement reconnue. Je suis tout de même curieuse de savoir de quelle manière vous parvenez à faire entendre la bonne parole en matière de santé environnementale face aux agences européennes, aux lobbyistes de la chimie ou de l'agroalimentaire.
Comment avez-vous traité la problématique de la remise sur le marché du glyphosate ?
La France s'est-elle positionnée afin de faire progresser les démarches visant à une plus grande sobriété chimique alors que les enjeux économiques sont colossaux dans le domaine de la pétrochimie ?
Comment parvenez-vous à identifier efficacement un équilibre entre les enjeux économiques et l'écologie, la santé environnementale ?
Mme la Présidente, votre question est redoutable. Nous essayons d'objectiver nos démarches, ce qui n'est pas toujours aisé. Lorsque nous parvenons à produire une évaluation des coûts qui pourraient être évités par de bonnes mesures, l'argument est plus efficace. Nous opposons ces coûts à ceux que générerait une transition vers des modes de fabrication moins nocifs. Il est plus facile d'obtenir des résultats dans le domaine de la santé, qui répond à des normes établies, que sur les aspects environnementaux parce que la dégradation des milieux naturels, des services écosystémiques, est complexe à évaluer. Nous pouvons toujours expliquer que la disparition des abeilles conduirait à l'obligation d'opérer une pollinisation manuelle ce qui générerait un coût de main-d'œuvre important, mais nous rencontrons des difficultés à quantifier ces coûts.
Quoi qu'il en soit, nous tentons toujours d'éviter l'affrontement brutal et nous nous attachons à envisager des périodes de transition. Il est plus facile d'expliquer à un industriel qu'il devra évoluer d'un point A vers un point B plutôt que de le sommer d'arrêter ses activités parce que ses productions ne correspondent plus aux normes. Nos autorités politiques estiment souvent que ces démarches sont trop longues, mais travailler sur l'idée de transition, versus une mutation brutale, nous semble plus efficace pour convaincre nos interlocuteurs de la nécessité d'une évolution.
Il existe une stratégie globale relative à la gestion des produits chimiques au niveau mondial. La compartimentation que vous évoquiez provient du développement de conventions internationales en réaction à des problèmes environnementaux plus ou moins urgents. Le problème de la couche d'ozone était très urgent et nécessitait une réaction immédiate, parce qu'il générait des impacts sur la santé humaine.
L'approche stratégique pour la gestion des produits chimiques réside dans un accord international non contraignant qui regroupe des États et des industriels, le monde de la santé et le monde onusien dans sa grande diversité, notamment l'ensemble des agences concernées par la production, l'utilisation ou l'élimination des produits chimiques telles que le PNUE, la FAO, l'OIT (s'agissant du volet « exposition des travailleurs aux substances »). L'ensemble de ces acteurs se réunissent et discutent au sein d'une conférence mondiale organisée sous l'égide de cette stratégie, conclue pour la période de 2005 à 2020.
Les discussions pour sa reconduction sur la période 2020 à 2030 sont en cours. L'impossibilité de rencontres physiques des acteurs a retardé leur terme. La conclusion des démarches visant à élaborer le nouveau cadre de cette approche stratégique pour la gestion des produits chimiques pour la prochaine décennie devrait intervenir à Bonn, lors d'une conférence internationale programmée en juillet 2021.
Dans ce cadre, la France défend l'idée du renforcement de l'interface science-politique dans le domaine des produits chimiques. Il s'agit de renforcer la connaissance scientifique et de la mettre à un niveau suffisamment clair et compréhensible de sorte que les politiques puissent prendre des décisions avisées dans le domaine des produits chimiques.
Cette stratégie répond à la problématique de décloisonnement que vous avez constatée en France, mais qui existe également au niveau international. Je pense que le fonctionnement en « silos » constitue un travers des organisations humaines. L'expertise est ainsi faite qu'elle impose la constitution d'enceintes dans lesquelles les expertises se confrontent et se complètent dans des phénomènes de synergie de sorte à aboutir aux meilleures solutions politiques possible au niveau international.

Si je vous comprends bien, il existerait une réelle volonté, affichée, de s'orienter vers une sobriété chimique, en traversant des périodes de transition qui seront longues. La prise de conscience d'une hyperconsommation de la chimie et des risques induits sur la santé serait bien réelle. Me le confirmez-vous ?
Nous n'utilisons pas le vocable « sobriété » pour ce qui concerne la chimie. Je suppose que vous associez cette expression à celle de « sobriété énergétique ».
En effet, le matériel de base est identique. Il a ensuite des utilisations énergétiques ou plastiques.
Le principe de précaution existe. Le grand principe du droit à l'environnement sain a présidé au Sommet de la terre de Rio, en 1992. Parallèlement, le principe de précaution est une des pierres fondant cette approche stratégique de gestion des produits chimiques.

Sur quels types de documentation scientifique votre démarche est-elle fondée ? Comment choisissez-vous vos experts ? Certains experts sont-ils rattachés au ministère des Affaires étrangères ? Existe-t-il simplement une équipe rattachée à l'ONU ou à l'OMS ? Quelles sont les données scientifiques qui constituent vos repères ? Sont-elles susceptibles d'être contestées par les lobbyistes ?
L'ONU compte des centres spécialisés dans la production d'expertises, notamment au sein de l'OMS. S'agissant du PNUE, le problème est sanitaire et relève des expertises de l'OMS, mais elles sont moins nombreuses dans ce domaine. L'exemple de la convention de Vienne et du protocole de Montréal pour la protection de la couche d'ozone est intéressant parce qu'il représente le modèle le plus abouti de la démarche internationale.
Les États proposent un panel de scientifiques qui, tous les trois ans, éditent des rapports relatifs à la couche d'ozone. Ils font également, à cette occasion, des prévisions sur la date à laquelle la couche d'ozone devrait retrouver son état initial.
Les États nomment également des experts techniques susceptibles d'appartenir au domaine industriel privé, malheureusement parfois seul détenteur de cette expertise. Les États proposent leurs représentants dans les panels et il relève de la sagesse collective de fonctionner correctement, sous la surveillance des parties. Les parties sont en effet les principaux donneurs d'ordre des conventions et des réunions des parties. Le consensus international fait loi.
Le glyphosate n'est pas un sujet porté au niveau national. Nous le maîtrisons donc moins bien dans notre ministère. Je vous ai fourni des exemples de dossiers que nous traitons.
Le ministère des Affaires étrangères ne dispose d'aucun expert spécifique au domaine de la chimie. Il s'appuie sur l'expertise des opérateurs du ministère de la Transition écologique, notamment l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris). Lors des réunions des parties, la délégation française est susceptible de s'adjoindre l'expertise des opérateurs de l'État dans le domaine tels que l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) ou l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), notamment s'agissant des problématiques liées aux plastiques et aux micro-plastiques. En effet, dans l'eau, les plastiques libèrent leurs substances chimiques, ce qui relève de l'expertise des deux instituts précités.

Nous arrivons au terme du temps imparti à cette audition. Je vais donc conclure sur cette notion de « sagesse collective », en espérant qu'elle sera effective et que, surtout, elle nous permettra d'évoluer dans le bon sens de la protection du vivant sur notre planète. J'espère que les intérêts économiques ne prévaudront pas sur les intérêts de survie de l'ensemble des espèces vivantes de notre planète.
Je vous remercie de vos interventions. Nous avons bien compris que la France est active à l'échelle internationale et qu'elle défend ses valeurs, notamment dans le cadre de l'OMS. Nous espérons que vous parviendrez à faire évoluer les prises de conscience et, surtout, les pratiques opérationnelles.
L'audition s'achève à dix-huit heures trente-cinq.