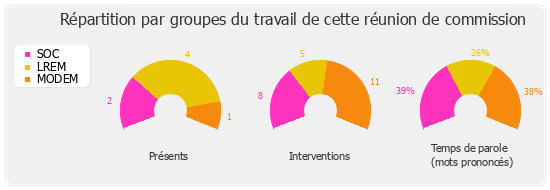Commission d'enquête sur l'impact économique, sanitaire et environnemental de l'utilisation du chlordécone et du paraquat comme insecticides agricoles dans les territoires de guadeloupe et de martinique, sur les responsabilités publiques et privées dans la prolongation de leur autorisation et évaluant la nécessité et les modalités d'une indemnisation des préjudices des victimes et de ces territoires
Réunion du mardi 2 juillet 2019 à 9h00
Résumé de la réunion
La réunion
Mardi 2 juillet 2019
La séance est ouverte à neuf heures cinq.
Présidence de M. Serge Letchimy, président de la commission d'enquête
————
La commission d'enquête sur l'impact économique, sanitaire et environnemental de l'utilisation du chlordécone et du paraquat, procède à l'audition de M. Bruno Ferreira, directeur général, M. Pierre Claquin, adjoint à la sous-directrice de la sous-direction de la qualité, de la santé et de la protection des végétaux, M. Olivier Prunaux, chef du bureau des intrants et du biocontrôle, M. Cédric Prévost, sous-directeur de la sous-direction de la politique de l'alimentation, et Mme Isabelle Tison, directrice-adjointe du service des affaires juridiques, direction générale de l'alimentation (DGAL), ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Je souhaite la bienvenue à M. Bruno Ferreira, directeur général de la direction générale de l'alimentation, que nous entendrons aujourd'hui.
Il est accompagné de M. Pierre Claquin, adjoint à la sous-directrice de la sous-direction de la qualité, de la santé et de la protection des végétaux ; M. Olivier Prunaux, chef du bureau des intrants et du biocontrôle ; M. Cédric Prevost, sous-directeur de la sous-direction de la politique de l'alimentation et Mme Isabelle Tison, directrice-adjointe du service des affaires juridiques, du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.
Je vous rappelle que nous avons décidé de rendre publiques nos auditions. Par conséquent, celles-ci sont ouvertes à la presse – quelques journalistes sont déjà présents – et rediffusées en direct sur un canal de télévision interne. Les vidéos seront ensuite consultables sur le site internet de l'Assemblée nationale.
Notre audition durera une heure trente. Avant de donner la parole à M. Bruno Ferreira, pour une introduction de cinq à dix minutes, je tiens à vous rappeler que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite à lever la main droite et à dire « Je le jure ».
Les personnes auditionnées prêtent serment.
En introduction, je souhaiterais rappeler quelques éléments, portant notamment sur l'évolution du cadre d'autorisation des substances des produits, depuis l'autorisation initiale du chlordécone.
Les modalités d'autorisation des produits phytopharmaceutiques ont profondément évolué, surtout depuis la fin des années 2000, avec la généralisation du concept d'analyse des risques et de la séparation entre l'évaluation et la gestion des risques, qui a été notamment une des conséquences de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).
Le corollaire de cette séparation a été la mise en place d'agences sanitaires pour l'évaluation scientifique des risques. En France, il s'est d'abord agi de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), devenue depuis l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Quant à l'Union européenne, elle a mis en place l'Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority, EFSA), en 2002.
La création d'agences d'évaluation s'est accompagnée du développement de méthodes standardisées d'évaluation approfondie.
Il serait inexact de dire que la toxicité intrinsèque des produits n'était pas prise en compte au moment de l'autorisation initiale d'usage du chlordécone. Toutefois, cette évaluation était relativement sommaire. On ne peut pas établir de comparaison entre un avis rendu en 1980 par la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole, au sein de laquelle des fabricants de produits phytopharmaceutiques ont siégé jusqu'en 2001, et un rapport d'évaluation de l'ANSES ou de l'EFSA de 2019, qui s'appuie sur des documents-guide et des méthodologies standardisées.
Les conditions d'autorisation des produits phytopharmaceutiques ont de plus été progressivement harmonisées. Il s'agit aujourd'hui d'un système à deux niveaux, avec une approbation des substances actives par la Commission européenne, suivie d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) de produits phytopharmaceutiques délivrée par les États membres. Ce système n'a pas été appliqué au chlordécone, qui n'a jamais été approuvé au niveau européen, contrairement au paraquat, lequel a été approuvé de 2003 à 2007.
Ces changements d'organisation ou de procédure d'autorisation ont indiscutablement concouru à une approche beaucoup plus rigoureuse, dans laquelle la science et la prise en compte des risques occupent aujourd'hui une place prépondérante.
Le second changement d'importance réside bien évidemment dans la perception des risques et le regard sociétal porté sur les pesticides. Pendant longtemps, ces produits ont été considérés comme soignant les plantes, les possibles effets négatifs sur la santé ou l'environnement n'étant pas pris en compte.
Les paramètres prioritaires étaient alors l'efficacité, et, éventuellement, la phytotoxicité, c'est-à-dire l'effet toxique sur la plante traitée. Les risques, s'ils étaient évoqués, n'étaient pas pris en compte de la même manière qu'ils peuvent l'être aujourd'hui. Cette évolution dans la perception des pesticides est largement liée à l'évolution de la connaissance des risques et des dangers, et de la problématique des risques chroniques, alors que l'accent avait longtemps été mis sur les risques aigus.
La perception des pesticides a changé : autrefois synonymes de progrès, ils sont aujourd'hui aussi perçus comme un facteur de risques. La prise de conscience des risques que peuvent présenter ces produits est également liée à l'amélioration des connaissances des citoyens et à leur niveau d'exigence accru concernant la protection de la santé, d'une part et celle de l'environnement, d'autre part.
Au niveau européen, ces évolutions se sont traduites par l'adoption en 2009 du « paquet pesticides », comprenant notamment un règlement, qui encadre la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et une directive, qui donne aux États membres des lignes directrices, afin de réduire les risques et l'impact de l'utilisation de ces produits. Cette politique a été déclinée en France au travers du plan Ècophyto, qui a connu plusieurs révisions. Plus récemment, en 2018, elle s'est traduite par le plan d'action sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides, et par le plan de sortie du glyphosate.
Dans le cadre du périmètre d'action du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, la direction générale de l'alimentation (DGAL) délivrait des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques jusqu'en juillet 2015. Elle s'appuyait sur des instances de conseil, qui se sont progressivement renforcées – la commission d'étude de la toxicité, l'AFSSA, et, enfin, l'ANSES. Depuis 2015, cette compétence d'autorisation de mise sur le marché a été transférée à l'ANSES.
Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, qui reste compétent pour l'approbation européenne des substances actives, est notamment chargé du contrôle et des règles d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, en lien avec le ministère des solidarités et de la santé, le ministère de la transition écologique et solidaire, et le ministère de l'économie et des finances. Il est de plus toujours compétent pour introduire les dérogations de 120 jours de mise sur le marché d'un produit en vue d'un usage limité et contrôlé.
Il est important de noter que la plupart des décisions sont aujourd'hui interministérielles. Cette dimension n'a cessé d'être renforcée. Déjà présente pour le paraquat en 2003, elle ne l'était pas pour le chlordécone.
La DGAL est également impliquée dans les différents plans chlordécone, auxquels elle est associée depuis 2009. Elle pilote notamment quatre des vingt et une actions du plan national d'action chlordécone III, et est particulièrement mobilisée sur les actions de protection de la population et d'accompagnement des professionnels touchés par la pollution.
En termes financiers, la DGAL est le plus gros contributeur de l'action chlordécone du programme d'intervention territorial de l'État (PIT), qui finance le plan national d'action chlordécone III à hauteur de 60 % des crédits de l'État. En 2019, elle a augmenté sa contribution financière à ce plan de près de 30 %.
À la suite du discours du Président de la République en Martinique, en septembre 2018, et du colloque scientifique d'information, qui s'est tenu aux Antilles en octobre 2018, une feuille de route interministérielle 2019-2020 a été élaborée, afin d'intégrer une trentaine de mesures complémentaires aux vingt et une actions du plan chlordécone III. La DGAL, qui a fortement contribué à cette élaboration, s'est engagée dans la mise en oeuvre d'une quinzaine de ces mesures.
Une des actions principales de cette feuille de route vise à achever la cartographie des sols pollués, qu'elle avait initiée dès 2009, en y associant un dispositif de conseil pour les agriculteurs et les éleveurs, permettant d'orienter l'utilisation des parcelles dédiées à la production de denrées. À l'heure actuelle, ce travail a permis de cartographier le niveau de contamination de 9 900 hectares de terres agricoles.
La DGAL vise l'objectif d'une exposition la plus faible possible par la voie alimentaire. À cet égard, des arrêtés renforçant les mesures relatives au chlordécone dans les viandes bovines, porcines, ovines, caprines et la volaille ont été publiés récemment, en janvier et mai 2019.
La DGAL soutient également un accompagnement technique des éleveurs, du fait de l'abaissement des limites maximales de résidus de chlordécone dans les viandes.
En 2019, nous avons augmenté de 30 % le nombre des contrôles officiels, dans le cadre des plans de surveillance et des plans de contrôle annuels, qui portent sur les denrées issues d'animaux d'élevage, sur les produits de la pêche et sur les productions végétales primaires destinées à la consommation humaine et à l'alimentation animale. Dans les deux îles, nous mobilisons pour cela près de 10 équivalents temps plein travaillés (ETPT). En 2017, 1 097 prélèvements ont été réalisés sur toutes les matrices animales en Martinique, et 952, en Guadeloupe, avec un taux de conformité de 93 % et 97 %, respectivement. De la même manière, dans les deux îles, 350 contrôles de végétaux ont été réalisés, qui se sont révélés conformes à plus de 99 %. L'effort de prélèvement sera considérablement accru en 2019, puisque 4 000 analyses sont programmées.
En lien avec le plan de surveillance et le plan de contrôle 2019, la DGAL a publié une nouvelle instruction, harmonisée entre les deux îles, qui prévoit un suivi rapproché des élevages, dont les cheptels sont susceptibles de présenter un risque. Ce dispositif est complété par un renforcement de la mesure de précaution sur les foies de bovins, qui sont systématiquement écartés de la consommation, dès que du chlordécone est détecté dans la graisse.
En outre, dans le cadre de la feuille de route 2019-2020 et de la préparation du futur plan chlordécone IV, notamment, la DGAL a initié une réflexion sur la possibilité d'interdire les cultures sensibles dans les zones où les sols sont pollués. L'ANSES a été saisie, pour que l'impact sanitaire soit évalué et qu'un outil d'aide à la décision puisse être développé.
La DGAL contribue également à la réflexion sur l'utilisation d'eau contaminée pour l'irrigation, sur le contrôle des eaux de captage utilisées dans l'industrie agroalimentaire, sur l'interdiction de certaines espèces de poissons à la consommation ainsi que sur le développement des capacités d'analyse du chlordécone aux Antilles.
Comme je l'ai indiqué, le plan chlordécone IV sera élaboré dans un cadre concerté, au niveau national comme local, en associant la population, les élus et les professionnels locaux. Il succédera au plan chlordécone III, qui court jusqu'en 2020.
Je peux vous assurer de la mobilisation complète de la DGAL sur la mise en oeuvre des plans actuels, ainsi que sur la préparation des plans futurs, en gardant notamment à l'esprit l'objectif fixé par le Président de la République, de tendre vers le « zéro chlordécone dans l'alimentation », donc de réduire au maximum le risque d'exposition de la population au chlordécone par l'alimentation.

Je remercie l'ensemble des cadres du ministère de l'agriculture et de l'alimentation d'avoir répondu à la convocation de la commission d'enquête. J'ai bien entendu la déclaration de M. Bruno Ferreira, selon laquelle, en 1980, le ministère de l'agriculture procédait à une évaluation sommaire des risques de ce produit, qui n'a jamais été approuvé au niveau européen. À cette époque, en effet, le chlordécone n'avait pas reçu toutes les autorisations prévues par les procédures.
La perception des risques a évolué. Nous sommes aujourd'hui face à une pollution, un fléau environnemental et sanitaire. Vous avez naturellement rappelé l'engagement du Président de la République à ce sujet.
Mes premières questions porteront donc sur les procédures d'autorisation du chlordécone. Je souhaiterais tout d'abord savoir si les comptes rendus de la commission d'étude de l'emploi des toxiques en agriculture sont disponibles sur cette période.
Certains comptes rendus sont effectivement disponibles. Ils avaient d'ailleurs déjà été annexés au rapport de la mission d'information parlementaire de 2005.
Entre février 1972 et juin 1989, nous n'avons pas pu retrouver de comptes rendus sur ce sujet dans les archives du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Comment expliquer que le ministère ne puisse pas retrouver des comptes rendus, qui sont de nature officielle et dont on relève la trace dans certains courriers du ministère ? Ont-ils disparu ? Ont-ils été éliminés ? Quelles sont les suspicions que vous pourriez avoir quant à leur contenu ?
Par ailleurs, quel type de classement le ministère a-t-il adopté ? S'agit-il d'un classement interne ou national ? Avez-vous cherché dans les archives nationales ces documents perdus, dérobés ou éliminés ?
Je n'ai pas d'explication sur les raisons pour lesquelles ces archives ne sont pas disponibles. La mission d'information de 2005 avait déjà relevé dans son rapport que ces documents n'avaient pas donné lieu à des archives informatisées. Nous avons naturellement consulté différentes sources d'archives, mais nous n'avons pas pu retrouver ces comptes rendus. Je n'ai pas d'explication sur les raisons pour lesquelles ils ne sont pas disponibles.

Ces comptes rendus correspondent-ils à la période de l'autorisation du chlordécone, en 1981 ?
Tout à fait. Nous n'avons pas retrouvé trace de ces comptes rendus entre février 1972 et juin 1989.

Je rappelle que cette période va de la première autorisation provisoire, en 1972, à la veille du retrait de l'autorisation de mise sur le marché, en 1990. Je demande à la commission de noter la disparition des comptes rendus pendant une période extrêmement longue. C'est une situation relativement grave, qui suscite des interrogations. À ce stade, il ne s'agit pas de juger. Nous ne pouvons que signaler, de manière très officielle et juridique, la disparition de ces comptes rendus essentiels.
La question posée par Mme la rapporteure a de l'importance car, nous le savons, les Américains ont arrêté la production de chlordécone dès 1976. Par la suite, plusieurs rapports, notamment de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), déclarent officiellement que le chlordécone est un produit dangereux. À ce titre, il serait très intéressant de connaître l'avis de la commission d'étude de l'emploi des toxiques en agriculture à ce moment, et les raisons qui pourraient expliquer l'autorisation provisoire de 1972, son renouvellement – il donnera lieu à d'autres questions –, et les prolongations accordées à partir de 1990, notamment en 1992 et 1993, qui faisaient suite à deux prolongations accordées administrativement afin de permettre l'écoulement des stocks.
La question de la rapporteure sur ces documents extrêmement précieux est donc essentielle. Elle montre le besoin, la soif de vérité de l'ensemble des élus et des deux peuples, guadeloupéens et martiniquais. Je souhaite donc que cette disparition des comptes rendus soit notée, comme elle l'avait été dans le rapport d'information de M. Joël Beaugendre et M. Philippe Edmond-Mariette.

Ces dossiers sont-ils disponibles aux Archives nationales ? Pourriez-vous par ailleurs nous transmettre la composition de la commission d'étude de l'emploi des toxiques en agriculture ? Dans un article de 2009, M. Matthieu Fintz, de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) cite des comptes rendus, rédigés entre 1968 et 1980, qui se trouvent aux Archives nationales.
Je souhaiterais apporter une précision : je n'ai pas dit que ces comptes rendus avaient disparu. J'ignore s'ils existent, car nous ne les avons pas retrouvés.
Nous disposons d'un certain nombre de pièces, jusqu'en juin 1972. Je pourrai remettre à la commission les documents relatifs aux autorisations de 1990 ainsi qu'aux prolongations, jusqu'en 1993, qui sont disponibles.
La composition de la commission d'étude de l'emploi des toxiques en agriculture ayant fait l'objet d'un arrêté, elle est parfaitement disponible. Nous pouvons également vous la transmettre.

Pourriez-vous nous transmettre ces documents le plus rapidement possible pour nous permettre de rechercher et d'auditionner les personnalités composant la commission ?
Pourriez-vous par ailleurs accélérer la procédure de recherche auprès des Archives nationales ? Je ne souhaite pas que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, que nous avons prévu d'auditionner en septembre, soit mis en difficulté sur l'impossibilité de remettre ces comptes rendus.
Les Archives nationales avaient déjà été sollicitées en 2005, pour le rapport de la mission d'information. Les documents n'avaient pas pu être retrouvés. Nous poursuivons nos recherches car elles n'ont pas pu être achevées depuis la convocation à cette audition. Nous vous transmettrons tous les textes que nous pourrons.
Je peux d'ores et déjà vous transmettre certaines pièces, qui concernent les périodes que j'ai citées, où les comptes rendus sont disponibles.
Pour le moment, les Archives nationales n'ont pas retrouvé les éléments dont il a été question.

Pouvez-vous nous transmettre le dossier de reconduction de l'autorisation provisoire, en 1976 ; le dossier d'autorisation de mise sur le marché du Curlone, en 1981 ; le dossier de retrait de cette autorisation en 1990 ; ainsi que le dossier des deux prolongations de l'utilisation aux Antilles, en 1992 et 1993 ?
Bien évidemment, nous vous demandons également de préciser qui a demandé ces prolongations.
Je suis en mesure de vous remettre dès aujourd'hui la décision d'autorisation de mise sur le marché en 1981 ainsi que les décisions de retrait de cette autorisation en 1990 et des deux prolongations d'utilisation en 1992 et 1993. À ce stade, nous n'avons toutefois pas retrouvé l'autorisation provisoire de 1976. Cela avait d'ailleurs été souligné dans le rapport de la mission d'information de 2005. Ce document n'avait pas été conservé dans la base informatique.
Naturellement, comme pour les documents précédents, si nous parvenons à retrouver des traces de ces éléments, nous les transmettrons à la commission. Je peux d'ores et déjà vous transmettre les autorisations données dans la période allant de 1981 à 1993.

Une autorisation, provisoire, est donnée en 1972, qui est reconduite en 1976. Vous ne retrouvez pas le document de 1976, mais retrouvez-vous celui de 1972 ?
En effet, le document de 1976 n'a pas été retrouvé. Nous devons vérifier les documents en notre possession, notamment les rapports de la commission d'étude des toxiques, entre 1968 et 1972.

Pourrez-vous nous faire parvenir par le biais des administrateurs les documents que vous retrouvez, notamment l'autorisation de 1972 ?
Oui. Je peux déjà vous remettre les décisions de 1981, 1990, 1992 et 1993, ainsi que du renouvellement, qui a eu lieu en 1986.

Je voudrais revenir un instant sur la disparition des archives – archives papier, forcément – entre février 1972 et juin 1989.
A-t-on des traces d'archives antérieures à 1972 et postérieures à 1989, afin de bien comprendre si un acte indélicat a pu être commis ?
Nous avons notamment des comptes rendus de réunion de la commission d'étude de l'emploi des toxiques en agriculture, entre 1968 et 1972. Puis, nous n'avons pas retrouvé de trace, jusqu'en 1989.
S'agissant des autorisations, nous avons des archives relativement parcellaires sur certains dossiers. Je n'ai pas pu comparer avec d'autres dossiers, pour établir s'ils comportaient également des pertes. Pour ces pièces, nous avons en effet un trou dans cette période.

Ces disparitions de documents sont-elles habituelles ou n'ont-elles été constatées que dans ce cas ? Connaissez-vous d'autres exemples de disparitions ou de pertes de documents ? Le ministère a-t-il été interpellé par cette situation, qui me semble assez grave ?
Je n'ai pas d'élément de réponse à vous apporter car, comme je l'ai indiqué, je n'ai pas pu effectuer de comparaison.

Puisque vous êtes un haut responsable du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, avez-vous eu connaissance de perte ou de disparition de documents dans les cinquante dernières années, qui seraient liées à des problèmes administratifs ou d'organisation ? Il paraît étrange que ces documents concernant une période très précise disparaissent. Vous imaginez les nombreuses suspicions que peut faire naître cette disparition quant à la nature de celle-ci.
Connaissez-vous d'autres exemples, oui ou non ?
Je n'en connais pas car je n'en ai pas cherché. Je ne porte pas d'évaluation sur la qualité de l'archivage, en général, ou sur ce dossier en particulier. Nous avons recherché les pièces relatives à ce dossier mais nous pouvons regarder si d'autres dossiers présentent les mêmes lacunes ou s'il s'agit d'une difficulté spécifique. Je n'ai pas d'élément pour répondre à cette question.

Pourriez-vous nous informer si, au cours des quarante dernières années, vous avez eu des disparitions de la même nature ? Je souhaite avoir une réponse écrite à cette question.
Cette perte est-elle liée à un accident – l'administration perd des documents sur une période de plus de dix ans –, ou à une organisation de la disparition, à un vol, à une destruction ? Dites-nous quelque chose : cette question est tout de même très importante.
Je vous poserai tout à l'heure plusieurs questions, et vous comprendrez alors le sens de ma remarque.
Je dois regarder ce point. Nous vous transmettrons une note, après avoir fait des tests sur les documents relatifs à plusieurs molécules anciennes pour lesquelles nous aurions pu avoir des informations sur la même période, afin d'établir si nous avons une perte globale des archives ou si certains dossiers spécifiques ont disparu. Je n'ai pas d'élément à l'heure actuelle.

Vous avez dit que vous disposiez d'archives parcellaires sur certains dossiers, et en particulier sur ce dossier, ô combien important pour nos populations, un dossier qui frise l'empoisonnement des sols de la Guadeloupe et de la Martinique.
S'agissant des deux prolongations de l'utilisation du chlordécone aux Antilles, en 1992 et 1993, confirmez-vous que vous nous remettrez les dossiers, dans lesquels nous trouverons naturellement les personnes qui ont pu demander ces prolongations ?

Je souhaiterais poursuivre avec des questions relatives à l'environnement. Quelles actions de cartographie et d'analyse des sols et des eaux menez-vous ? Qui les réalise, et suivant quelle méthodologie ?

Si vous le permettez, madame la rapporteure, avant d'aborder ce sujet, je souhaiterais rester sur la première partie. Après le cyclone Allen de 1979 et le cyclone David de 1980, à la fin de la première période provisoire d'autorisation d'utilisation du Kepone, les Américains ont déjà arrêté leur production – cette décision est prise en 1976. Au bout de deux ans, après avoir interdit la production et procédé à des indemnisations, ils ont réglé le problème.
On nous laisse entendre qu'outre une production américaine de 1 600 tonnes, 300 tonnes ont été produites au Brésil, où la synthèse est réalisée, et qu'une entreprise « a dû » en racheter les droits d'exploitation à une filiale de l'entreprise DuPont de Nemours. Il s'agissait de la Société d'exploitation de produits pour les industries chimiques (SEPPIC). La société Calliope, installée à Port-la-Nouvelle, près de Béziers, a ensuite exploité ces droits.
Pourriez-vous nous donner des précisions sur l'entreprise martiniquaise qui a passé ces accords ? Quel est son champ d'influence, qui a abouti à l'autorisation de 1981 ?
Si vous souhaitez vous concertez quelques minutes avant de répondre, nous pouvons suspendre la séance car ces questions sont essentielles.
Les éléments ont été rapportés en 2009 dans la note de l'AFSSETévoquée tout à l'heure. Je n'en dispose pas d'autres.

Vous êtes en train de nous dire qu'une autorisation d'utilisation d'un produit a été donnée en 1981 sans que l'on en connaisse l'origine ? Les Américains ayant arrêté la production, on ignore en effet d'où le chlordécone provient, qui dispose de la licence, qui a demandé cette autorisation de mise sur le marché. Il n'est pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit, par terre ou par mer ! Quelqu'un l'a bien fait venir, non ?
La note de 2009 de l'AFSSET précise bien que le 6 mai 1981, une demande d'homologation a été déposée pour le Curlone par les établissements Laurent de Laguarigue [sic], l'autorisation provisoire de vente ayant été attribuée le 30 juin 1981.
Le tableau d'autorisation fournit un certain nombre d'informations : cette spécialité, inscrite au tableau C, était composée à hauteur de 5 % de chlordécone pour lutter contre le charançon du bananier – 30 grammes par pied. Le tableau mentionne également que l'avis définitif de la commission d'étude de l'emploi des toxiques en agriculture est nécessaire.
À la suite de la délivrance de l'autorisation provisoire de vente du Curlone en 1981, différents groupements de producteurs ainsi que le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ont soumis leur demande d'homologation de ce produit en l'absence d'alternative possible en 1986.
En octobre 1988, un rapport de l'IRFA, l'Institut de recherche sur les fruits et agrumes, transmis au Service central de la protection des végétaux fait état de « l'insuffisance de solutions alternatives au chlordécone, dont l'interdiction se répercuterait sur la productivité des bananeraies antillaises ».
En août et septembre 1988, en l'absence d'alternative, les groupements de producteurs et le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché formulent plusieurs demandes au service central du ministère chargé de l'agriculture, demandes relayées par les parlementaires les 23 et 30 avril 1990 par des questions écrites et des courriers adressés au ministre de l'agriculture. En l'absence de solutions alternatives efficaces, ils demandent un délai supplémentaire d'utilisation de trois ans, soit, jusqu'en février 1995 – ces éléments figurent dans le rapport d'information de 2005 sur l'utilisation du chlordécone et des autres pesticides dans l'agriculture martiniquaise et guadeloupéenne.
Dans une réponse adressée en juin 1990, le ministre affirme que « conformément à la réglementation en vigueur, un délai de deux ans est accordé à partir de la date d'avis du comité d'homologation de février 1990 pour la vente et la distribution des spécialités ayant fait l'objet d'un retrait d'autorisation de vente. En conséquence, durant ce laps de temps, des solutions de substitution peuvent être mises au point. Cependant si, à l'issue de cette période, un délai supplémentaire d'un an s'avérait nécessaire, je ne serai pas opposé à l'accorder ». Cette pièce figure, je crois, en annexe du rapport de 2005.
Le 17 janvier 1991, l'IRFA a adressé un courrier aux services centraux du ministère pointant l'absence de solutions alternatives efficaces entre le 1er mars 1992, 1993 et 1994, années supposées de mise en oeuvre des alternatives déjà visées dans la prolongation.
Les producteurs et le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ont formulé de nouvelles demandes en juin 1992. Deux dérogations successives ont été accordées qui ont conduit à une prolongation d'un an et demi au total.
Selon l'étude publiée en 2009 par l'AFSSET, la reconduite de l'utilisation de cette substance active s'explique enfin par le contexte tropical des Antilles et l'absence d'alternative pour ces cultures.

Même si vous ne disposez pas des documents, quel était l'avis de la commission d'étude de l'emploi des toxiques en agriculture à la veille de l'autorisation de 1981 ? En outre, vous avez évoqué « les » parlementaires, or, tous les textes font état d'une seule personne.
C'était une formulation générique.
Il s'agissait d'une question écrite du député Guy Lordinot.

Je suis arrivée en retard mais j'ai bien compris que la discussion portait sur la disparition des archives.
Sans connaître nominativement chaque membre de la commission d'étude de l'emploi des toxiques en agriculture , pourrait-on savoir quelles instances étaient représentées ? Un rapport de Pierre-Benoît Joly fait état d'un témoignage d'Isabelle Plaisant, qui en était membre, relatant que les toxicologues et les défenseurs de la santé publique y étaient très peu nombreux par rapport au lobby agricole.
Je l'ai dit, nous vous transmettrons les arrêtés de composition de la commission d'étude de l'emploi des toxiques en agriculture systématiquement publiés dans le Journal officiel. Comme je l'ai également indiqué lors de mon propos liminaire, cette composition a considérablement évolué – y siégeaient également jusqu'en 2001 des représentants de l'industrie phytopharmaceutique – de manière à renforcer les compétences en matière de toxicologie et d'éco-toxicologie jusqu'à la création de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. En 2015, le transfert des autorisations de mise sur le marché à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, a également permis de renforcer ces compétences.

La composition de la commission est certes précieuse mais nous souhaitons qu'elle soit aussi nominative.
Ces deux informations figurent dans les arrêtés de composition et de nomination de la commission d'étude de l'emploi des toxiques en agriculture qui vous seront transmis.

Pourriez-vous également nous transmettre l'autorisation de commercialisation n° 8100271 de 1981 du chlordécone sous forme de Curlone ?

S'agissant de la disparition des archives, j'ai fait le tour de la question et, si vous le voulez bien, je souhaite que nous en venions au thème de l'environnement.

Qu'en est-il de la cartographie et de l'analyse des sols et des eaux ? Qui les réalise et selon quelle méthode ?
Les services du ministère de l'agriculture et de l'alimentation se chargent de la réalisation des analyses de sols agricoles. Dans ce cadre, les agriculteurs et les éleveurs bénéficient d'un conseil permettant d'assurer l'interprétation des résultats et d'orienter les producteurs sur l'utilisation des parcelles et les cultures qu'ils peuvent y entreprendre.
En outre, le géo-référencement précis des parcelles analysées et l'intégration des données dans des systèmes d'information géographique ont permis de cartographier le niveau de contamination, à l'heure actuelle, de 9 900 hectares de terres agricoles. 20 000 hectares doivent être encore analysés pour obtenir une cartographie complète.
Ce travail a donc été mené par la Direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt et le service alimentation de cette Direction.
Des cartographies des sols des zones urbaines et périurbaines existent mais elles relèvent du ministère de la transition écologique et solidaire.
Par ailleurs, sont également organisées régulièrement des analyses des eaux, lesquelles relèvent de la compétence des Offices de l'eau des Antilles, qui assurent le suivi de nombreux pesticides – dont le chlordécone – grâce à une quarantaine de stations de mesure.
Comme je l'ai également dit dans mon propos liminaire, la poursuite du travail sur le niveau de pollution des sols agricoles et la cartographie est une priorité de la Direction générale de l'alimentation et de ses services déconcentrés dans les deux Directions de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.
Dans les deux îles.

Quelle est leur surface agricole utile totale ? Pour la Martinique, celle-ci est de 24 000 hectares.
En effet, dont 8 000 hectares sont analysés, le reste n'étant pas cartographié.
La cartographie et la méthodologie utilisées par les Directions de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt dans les deux îles visent d'abord à cartographier les zones qui sont susceptibles d'être contaminées. Priorité est donc donnée à celles où le chlordécone a déjà été utilisé.

Le flou est encore grand puisque sur les 48 000 hectares de surface agricole des deux îles, 9 900 hectares ont été analysés auxquels il faut donc ajouter 20 000 hectares.
Pourriez-vous nous fournir une note précise sur le niveau respectif d'analyse et de cartographie pour la Martinique et pour la Guadeloupe ? Les informations dont je dispose à ce jour ne correspondent pas à celles que vous donnez.
Ensuite, pour quelle raison l'établissement de cette cartographie et les analyses de sol ont-ils tant tardé ? Pourquoi est-ce seulement l'année dernière qu'une accélération s'est produite en Martinique et en Guadeloupe alors que ce phénomène a duré pendant 48 ans ? Vous n'êtes certes pas responsable, mais que s'est-il passé ? Nous savons qu'il y a de la pollution depuis 1978, 1979, 1980 ; en 1988, on commence à « entrer dans le dur » et autant de temps est nécessaire pour connaître l'ampleur et la nature des terres polluées. Pour la Martinique, les chiffres sont de 12 000 hectares pollués sur 24 000, dont un tiers est hyper-pollué, un tiers moyennement et un tiers faiblement. Les conséquences sur la santé sont réelles puisque la plupart des cancers de la prostate et des récidives est constatée sur les terres très polluées. Vous imaginez bien les conséquences pour la production et la consommation !
Comment donc expliquer que le ministère de l'agriculture ou les services concernés aient pris tant de temps pour faire ce travail ?
Comme l'a mentionné le directeur général, le travail sur la cartographie a d'abord été effectué pour soutenir l'activité agricole de manière à maîtriser les risques et à avoir une vision d'ensemble de la contamination des sols afin, en retour, de pouvoir donner des conseils sur les cultures qui peuvent y être développées.
Ces trois niveaux de sensibilité et de contamination permettent de faire en sorte, par exemple en cas de niveau trop élevé en chlordécone, que les agriculteurs ne cultivent pas de légumes-racines. Initialement, l'objectif était donc cette activité de conseil auprès des agriculteurs.
Ensuite, nous avons reçu des demandes d'accès aux documents et c'est en mai 2017, je crois, que la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, a rendu un avis rendant obligatoire la publication de la cartographie. Les préfectures ont ensuite pris le relai pour que cette transparence soit effective. Ainsi a-t-il été fait par celles de Martinique et de Guadeloupe. Les cartographies ont été publiées mais elles ne sont en effet pas complètes. Comme le directeur général l'a rappelé, de même que le Président de la République en septembre 2018, l'objectif est de parvenir à un panorama complet.
Comme vous l'avez demandé, nous transmettrons une note sur la méthode qui a permis de centrer l'action sur les zones qui devaient être cartographiées en priorité, sur la méthodologie complète d'analyse et de collecte des résultats et sur le travail programmé pour avancer sur cette question.

J'ai une question concernant en particulier la Guyane.
Monsieur le directeur, la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaire créée en 1992 d'abord pour lutter contre les pratiques illicites dans l'élevage, avant que ses compétences soient étendues aux produits phytosanitaires, relève de votre Direction.
Je me pose plusieurs questions. Quels dispositifs existaient avant 1992 pour traquer les infractions phytosanitaires ? À partir de quand a-t-on commencé à recenser ceux qui ont été utilisés sur le territoire national et, bien sûr, dans les territoires ultramarins ?
De plus, cette brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires est-elle déjà intervenue en Guyane afin d'approfondir la question de l'usage du chlordécone alors que l'on nous dit que ce type de produit aurait été utilisé partout aux Antilles mais pas en Guyane, la brigade pouvant procéder à des enquêtes administratives approfondies pour prévenir ou faire face à un scandale phytosanitaire ? Je m'interroge d'autant plus compte tenu du contexte transfrontalier sensible, le Brésil et le Surinam, en l'occurrence, pouvant utiliser des produits interdits en France mais qui peuvent y être introduits. La brigade s'est-elle déjà penchée sur ces questions ?
En effet, la Direction générale de l'alimentation dispose d'une brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires qui réalise deux types d'action : des enquêtes administratives transversales pour essayer de déceler des pistes émergeantes ou mal connues qui pourraient être à l'origine de systèmes de fraudes organisées ; elle intervient également pour le compte du ministère de la justice – les informations sur les affaires en cours étant couvertes par le secret judiciaire, le directeur général peut parfois tout en ignorer – sur un certain nombre d'affaires liées à la découverte ou à la suspicion de réseaux frauduleux, qu'ils concernent des produits phytopharmaceutiques ou des médicaments vétérinaires, voirev des trafics d'animaux ou des fraudes alimentaires.
Elle intervient aussi très souvent en synergie avec le service national d'enquêtes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou avec l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, mais toujours sous l'autorité de la justice.
Avant l'extension du champ de compétences de la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires, aucune disposition spécifique ne permettait de bénéficier de la même force d'intervention dans le domaine des produits phytopharmaceutiques. En février 2014, la Direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Guyane, avec l'appui de la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires et de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, a renforcé les dynamiques de contrôle des importations illégales de produits phytopharmaceutiques en Guyane. Une intervention a donc bien déjà eu lieu en matière de produits phytopharmaceutiques dans le contexte que vous avez rappelé, même si elle ne concernait pas spécifiquement le chlordécone.

Une précision : vous avez évoqué l'absence de dispositions spécifiques. Cela signifie-t-il qu'il n'y en avait pas ou qu'elles étaient intégrées dans un autre dispositif ?
Je me suis mal exprimé. Il n'existait pas de structures dédiées à cette recherche mais elle faisait bien partie des compétences des agents chargés notamment des contrôles de l'utilisation ou de la commercialisation des produits phytopharmaceutiques.
Avant cette extension au domaine phytosanitaire, en effet, il n'existait pas de structure dédiée en tant que telle, facilement mobilisable par le ministère de la justice, pour réaliser des enquêtes approfondies et transversales comme c'était le cas dans le domaine vétérinaire.

Vous avez bien dit avoir analysé 9 900 hectares en Guadeloupe et en Martinique. Monsieur le président vous faisait remarquer à juste titre qu'il y a 24 000 hectares de terres agricoles en Martinique et qu'il en est à peu près de même en Guadeloupe. Vous avez dit que 8 000 hectares avaient été analysés en Martinique. Resteraient donc 1 900 hectares analysés en Guadeloupe. Quel pourcentage du territoire a-t-il été analysé ?
Je constate que l'établissement de la cartographie est en panne.
Je ne dirais pas qu'il est en panne. Nous sommes en phase d'accélération pour atteindre le maximum d'hectares, objectif fixé par le Président de la République.
Je n'en ai pas de précis. La question qui se pose pour atteindre l'objectif dans un minimum de temps est bien entendu celle des moyens, tant pour réaliser les prélèvements que pour faire les analyses nécessaires. Nous mobiliserons toutes les forces possibles, dont un réseau de laboratoires qui pourront analyser les échantillons de terre.
Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un certain nombre de contraintes logistiques et de moyens pour pouvoir avancer plus vite.

Je tiens à ce que la commission note de manière très précise que la cartographie des sols est loin, très loin d'avoir abouti – ce n'est pas une critique à votre endroit mais c'est une réalité et il faut la constater.
J'ai été très étonné que la préfecture de Martinique nous présente l'année dernière les premières étapes de la cartographie tant je pensais que la situation était bien plus avancée. Pourquoi ? Il est de notre responsabilité de le noter : cette cartographie et la connaissance du niveau de pollution, parcelle par parcelle, dépendent des politiques publiques qui doivent être mises en oeuvre pour accompagner les agriculteurs – les degrés de pollution sont en effet différents – et des politiques sanitaires car, nous le savons, environnement et santé sont liés.
Il y a urgence. Je demande donc à la commission d'enquête de noter aussi que la plupart des hauts fonctionnaires de l'État nous parle de moyens, et c'est très important. Vous l'avez dit, et vous avez raison : la question des moyens est toujours présente.
Cela peut nous amener à conclure que, d'une manière générale, les moyens mis en place ne correspondent pas à l'ampleur et à la gravité de la situation. C'est ce que nous ressentons à ce stade.

En 2008, j'étais maire d'une commune située dans le « croissant bananier » en Guadeloupe et lorsque les premières cartographies ont été connues, le préfet d'alors nous avait recommandé de ne pas les diffuser et de les garder confidentielles.
Vous avez dit tout à l'heure que la CADA vous obligeait à la transparence. L'État a-t-il quant à lui la volonté de ne pas prendre vraiment en compte l'ampleur du phénomène et n'a-t-il pas voulu diffuser ces cartographies ? Était-ce une décision du préfet ou cela venait-il de plus haut ? Nous connaissons les difficultés qui existent suite à la dépréciation foncière de ces terrains. L'État voulait-il vraiment dissimuler l'étendue de la catastrophe ?
Je ne sais pas pourquoi la cartographie n'a pas été rendue publique à l'époque.
Je rappelle qu'actuellement, nous voulons aller beaucoup plus loin puisque, dans le cadre de la feuille de route 2019-2020, suite au discours de 2018 du Président de la République, nous réfléchissons à la façon de rendre ces analyses de sol obligatoires – dans certain cas, il a en effet été difficile de trouver l'information – de manière à pouvoir autoriser ou non certaines cultures sensibles sur certains sols en fonction du niveau de contamination.
Nous nous inscrivons donc dans une démarche de transparence quant au niveau de contamination des sols en question.
Pourquoi cette cartographie n'a-t-elle pas été rendue publique à l'époque ? Je ne dispose pas d'éléments pour vous répondre.
Oui, en fonction du niveau de concentration de chlordécone dans les sols.
J'ai évoqué tout à l'heure les conseils donnés aux agriculteurs lorsque les résultats sont connus. Ils portent sur les cultures qui peuvent être produites. Par exemple, il est possible de cultiver certains végétaux sur les sols contaminés, notamment, les cultures fruitières arbustives – agrumes, goyaves, papayes, bananes et cultures maraîchères sans contact direct avec le sol comme les choux, les tomates, les pois et les cristophines. Ils ne sont que très peu voire pas du tout sensibles au transfert de chlordécone vers les parties consommées et ils peuvent donc être cultivés sur toutes les parcelles, quelle que soit la teneur en chlordécone du sol.
Les productions maraîchères qui, elles, poussent en contact avec le sol – concombres, giromons, melons, pastèques, salades et canne à sucre lorsqu'elle est destinée à la fabrication de jus de canne ou à l'alimentation animale – sont moyennement sensibles au transfert de chlordécone et ces productions ne doivent pas être cultivées sur des terrains fortement contaminés, dont la teneur en chlordécone est supérieure à 1 milligramme par kilogramme de sol sec.
Enfin, les légumes-racines – cives et tubercules, soit, les ignames, les patates douces, les carottes – sont en revanche très sensibles au transfert de chlordécone, la partie consommée se développant directement ou en grande partie dans le sol. Ces productions ne doivent donc pas être cultivées sur des terrains pollués au-delà de 0,1 milligramme de chlordécone par kilogramme de sol sec.
Les contrôles qui ont été effectués dans le cadre des plans de surveillance et des plans de contrôle montrent que lorsque ces recommandations sont respectées, les productions sont conformes aux limites maximales de résidus.
La question se pose essentiellement pour les ruminants, pour lesquels des concentrations importantes ont été détectées – notamment sur les bovins.
J'ai rappelé tout à l'heure les mesures de précaution qui sont prises visant à écarter systématiquement le foie dès lors que du chlordécone est détecté. En l'occurrence, il ne s'agit même pas de déterminer une concentration : il a été en effet démontré que le foie concentre des quantités importantes de chlordécone. Il a également été démontré qu'un processus de décontamination peut être mis en place en faisant paître l'animal sur des terres qui ne sont pas contaminées.
S'agissant des productions de volailles ou de porcs destinées à la vente, le problème se pose d'une manière moins prégnante puisque les élevages sont essentiellement hors sol.
Le problème peut se poser en revanche pour les animaux élevés dans le cadre des jardins familiaux – JAFA. Des opérations pilotées par la Direction générale de la santé et les Agences régionales de santé permettent de formuler des recommandations.

Monsieur le directeur général, puisque vous évoquiez l'absence d'alternative au chlordécone, les répercussions économiques qu'aurait eues sur la production antillaise de bananes l'absence d'utilisation de chlordécone ont-elles été évaluées ? Et qu'en est-il du nombre de cas de décès, de maladie et de handicaps induits par l'utilisation de ce produit hautement toxique, considéré comme n'étant pas biodégradable, dont la demi-vie serait comprise entre 3,8 et 46 ans, voire serait bien supérieure ?
Nous n'avons pas trouvé trace d'évaluation économique. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les producteurs ont demandé de manière répétée à pouvoir l'utiliser, en l'absence de solution alternative, mais sans que l'impact qu'aurait eu la non-autorisation de ce produit sur les productions de bananes ait fait l'objet d'évaluation chiffrée.
Quant à votre deuxième question, Madame la députée, un certain nombre d'études ont été conduites selon des axes légèrement différents, à propos de différentes populations. La direction générale de la santé vous répondra mieux que moi, qui ne suis pas spécialiste de la question.

À plusieurs reprises, vous avez indiqué, Monsieur le directeur général, que, selon les rapports, il n'y a pas de solution alternative. Cependant, la fin de l'usage du chlordécone n'a pas entraîné la fin des bananeraies. Il y avait bien une solution, naturelle : les pièges à charançons. Il y a toujours eu une solution, et ces pièges sont revenus lorsqu'un terme a été mis à l'usage du chlordécone. Il est donc faux de prétendre, comme certains l'ont écrit à plusieurs reprises, qu'il n'y avait pas de solution naturelle. Plusieurs rapports, notamment à la veille de l'interdiction du produit, ont d'ailleurs clairement mentionné l'existence d'alternatives.
Pouvez-vous nous dire quelle méthode vous utilisez ? Votre cartographie vise à soutenir la production. Ce n'est pas une entreprise menée à grande échelle dans le but de porter à la connaissance de la population de Guadeloupe et de Martinique l'éventuelle présence, sur telle ou telle parcelle, de chlordécone, et des dangers encourus ou de l'absence de danger. De son côté, l'agriculteur peut prendre l'initiative de demander une aide pour connaître le niveau de pollution des terres qu'il souhaite exploiter. Il y a donc, d'un côté, une cartographie établie à un rythme très lent et, de l'autre, une cartographe à l'initiative des individus, mais, ainsi, n'en avons-nous pas pour deux cents ans ? Ne serait-il pas plus utile d'entreprendre d'établir une cartographie complète ? Il s'agit non pas de 50 millions d'hectares mais seulement de 24 000 hectares ! Il faudrait régler ce problème. Par ailleurs, nous pouvons aller plus loin dans l'accompagnement, mais le rythme auquel cette cartographie est établie actuellement est insuffisant, eu égard à la gravité de la situation.
Comme je l'ai indiqué, nous sommes effectivement dans une dynamique d'accélération de cette cartographie. Nous explorons même la possibilité de rendre cette analyse obligatoire pour les sols agricoles, de manière à pouvoir interdire certaines cultures sensibles en fonction du niveau de concentration du chlordécone dans les sols concernés. Notre objectif est donc bien celui que vous avez rappelé, Monsieur le président.
Il n'a pas non plus toujours été simple, localement, de réaliser ces analyses, notamment eu égard au caractère éventuellement privatif des parcelles. Bien évidemment, il nous faut aller plus loin ; c'est dans cette dynamique que nous nous sommes engagés, pour orienter de manière plus incitative les productions, la cartographie devant permettre de déterminer ce qui peut et ce qui ne peut pas être cultivé sur tel ou tel sol. Si c'est nécessaire, nous pourrons prendre une mesure réglementaire. C'est ce qui est à l'étude en ce moment, et nous allons, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, saisir l'ANSES pour voir quels outils développer afin d'enclencher cette dynamique sur l'ensemble des terres agricoles. Bien évidemment, cela s'accompagne obligatoirement de l'analyse de tous les sols.

Comment l'État s'est-il assuré du respect de l'interdiction du chlordécone ? S'est-il assuré de la destruction de tous les stocks ? On parle beaucoup d'un enfouissement des produits restants. Qu'en est-il ?
En ce qui concerne les stocks, l'action de contrôle de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques a été constamment renforcée au sein du ministère de l'agriculture. Je ne dispose cependant pas de chiffres précis sur les forces mobilisées au moment où l'utilisation des stocks est devenue impossible.
La rumeur selon laquelle des stocks auraient été enfouis m'est parvenue par les services locaux des deux îles. Aucune information n'a cependant pu être obtenue quant à sa véracité et quant aux lieux de cet éventuel enfouissement.

Je veux revenir sur les contrôles et prélèvements que vous faites actuellement. Vous avez indiqué, monsieur le directeur général, que 99 % des prélèvements sur les fruits et légumes étaient conformes ; c'est assez rassurant. En revanche, pour les viandes, le taux est inférieur, compris entre 93 % et 97 % ; c'est légèrement préoccupant. Que deviennent donc ces viandes non conformes ? Et qu'en est-il de la fiabilité et la rapidité des tests ?
Lorsque la teneur mesurée est supérieure à la limite maximale applicable aux résidus de chlordécone qu'ils ne doivent pas dépasser pour être reconnus propres à la consommation humaine (LMR), les produits ne peuvent être mis sur le marché ; ils sont donc détruits. Je n'ai pas à l'esprit les délais précis, mais c'est une information que nous pourrons vous donner.
À la suite d'un premier avis rendu par l'ANSES sur les LMR dans la graisse, un arrêté, publié au mois de janvier dernier, a abaissé ces LMR. Un deuxième arrêté publié en mai de cette année a porté sur les autres espèces. Les différentes études ont montré qu'il fallait affiner les rapports qui permettaient d'établir la conformité de la viande en fonction de la teneur de chlordécone dans la graisse. Les valeurs ont donc été abaissées, pour que l'on soit sûr du respect de la LMR de 20 microgrammes par kilogramme dans la viande. C'est l'objet de ces deux arrêtés.

Des actions de dépollution des sols sont-elles en cours, ou envisageables ? Et qu'en est-il de la pêche ? Vous avez bien montré une évolution de la perception des risques. Des enquêtes ont suggéré à partir des années quatre-vingts la possibilité d'effets négatifs sur l'ensemble de l'environnement. La pollution se déplace-t-elle au fil du cycle de l'eau, éventuellement au point d'affecter nos pêcheurs ?
En ce qui concerne les actions de dépollution, des expérimentations ont été menées, dont des résultats ont été présentés lors du colloque scientifique et d'information du mois d'octobre 2018. Cependant, il n'existe pas encore de technique de dépollution applicable à grande échelle et économiquement viable.
Nous connaissons relativement bien les phénomènes de dépollution, notamment par des plantes remédiatrices ou dépolluantes, en ce qui concerne la pollution des sols par des métaux lourds. Pour des molécules du type du chlordécone, c'est plus complexe ; aujourd'hui, nous ne disposons pas d'une technique économiquement viable. Une expérience in situ a notamment été conduite par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), que je crois que vous auditionnerez également. Il s'agissait d'évaluer les différentes voies de dépollution des sols. À ce stade, une technique semble prometteuse, même si nous ne sommes pas au bout de l'investigation : un procédé de remédiation par réduction chimique in situ. Il s'agit de détruire la molécule de chlordécone par incorporation dans le sol d'une substance qui va permettre cette réduction. À la suite d'une première phase d'évaluation favorable en laboratoire, d'abord avec du sable de Fontainebleau, puis avec du sol des Antilles, un pilote expérimental sur une parcelle a été réalisé pour vérifier la faisabilité de cette technique de dépollution. Les travaux se sont déroulés de 2013 à 2014, sur une parcelle d'environ 1 000 mètres carrés, où la pollution moyenne était de 0,7 partie par million (PPM) de chlordécone. En fonction des différents amendements chimiques, on constate une diminution de la concentration en chlordécone et la formation de différents produits dégradés. Dans l'étude en question, dix-sept produits dégradés avaient été identifiés, dont la toxicité doit également être évaluée pour déterminer s'il est possible de poursuivre avec cette technique. Évidemment, les végétaux issus des expériences conduites dans le cadre de protocoles de phyto-remédiation, qui visent à l'extraction de la chlordécone du sol par une plante, sont détruits – selon des modalités définies par chacun des protocoles qui font l'objet d'une évaluation par les instances scientifiques.
Quant aux eaux, la pollution se déplace essentiellement par lessivage – c'est-à-dire qu'il y a un transfert en profondeur – mais a priori pas par ruissellement.
Par ailleurs, il est admis que le transport de terre participe au déplacement de la pollution, notamment par des travaux de terrassement. D'autres facteurs éventuels, tel le transfert par des eaux d'irrigation contaminées ou par la décontamination des animaux, doivent être étudiés dans le cadre de la feuille de route 2019-2020. C'est l'un des axes de travail pour ces deux années.
Depuis la fin des années 2000, des études sur la pêche visant à mesurer la contamination des espèces côtières, dont beaucoup sont pêchées et consommées, ont montré qu'elles étaient effectivement contaminées dans les zones littorales, en bordure des bassins-versants, tout particulièrement dans les estuaires, les fonds et les baies. Ces zones, qui représentent environ 10 % des zones de pêche côtières, ont été fermées à la pêche en 2010, avec une extension en 2012 en ce qui concerne les langoustes. La pêche en rivière est totalement interdite, quelles que soient les espèces, sur l'ensemble du territoire martiniquais depuis 2009. Pour protéger le consommateur, des mesures sont prises, qui visent au respect de ces interdictions, et de nombreuses actions de sensibilisation des usagers de la mer ont été menées, renforcées par les contrôles en mer de la direction de la mer, les contrôles à l'étal et aux autres lieux de mise sur le marché par la direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.
L'instauration de zones d'interdiction de la pêche a permis de réduire la proportion de poissons non conformes, qui est passée de 1 sur 4 pêchés localement à 1 sur 10. Cela concerne exclusivement les zones côtières, donc essentiellement des poissons rouges et des crustacés. Toutes les aquacultures sont contrôlées tous les ans, et aucune contamination n'a été constatée.
Les aquacultures d'eau douce contaminées ont été fermées en 2010. Celles qui fonctionnent aujourd'hui sont contrôlées tous les ans, sans qu'aucune contamination ait été constatée. Des interdictions de zones de pêche ont été prononcées en 2010 et 2012 et de nombreuses informations ont été délivrées aux pêcheurs professionnels. Par ailleurs, des actions de police sont régulièrement organisées en mer par les directions de la mer. Environ 100 jours de mer par an sont dédiés au contrôle des zones contaminées par la chlordécone et la cartographie est disponible sur les sites internet des directions de la mer. Ces contrôles sont inscrits dans le plan annuel régional de contrôle des pêches et de l'environnement marin. Ils sont principalement réalisés par les directions de la mer mais aussi par les services des douanes et de la gendarmerie nationale. Par exemple, en Martinique, environ vingt équivalents temps plein (ETP) participent à ces missions. Il s'agit de patrouiller pour s'assurer qu'il n'y a aucun navire en action de pêche dans les zones interdites. Par ailleurs, des missions sont organisées après repérage, parfois par des voies aériennes, environ deux fois par an pour relever et détruire des engins de pêche posés dans ces zones. La dernière s'est d'ailleurs déroulée les 27 et 28 juin derniers et s'est soldée par la destruction d'une vingtaine de nasses. Ces opérations se déroulent avec le concours d'un aviseur de la direction de la mer et d'un petit remorqueur de la marine nationale. Lorsque les engins de pêche détectés ne sont pas marqués et qu'il n'est donc pas possible de remonter à leurs propriétaires, ils sont détruits.

Où les tests de la pollution des sols sont-ils effectués ? Où les agriculteurs envoient-ils les échantillons prélevés ?
Actuellement, c'est a priori le laboratoire départemental de la Drôme qui réalise les analyses en question. Comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, nous travaillons actuellement au développement de capacités analytiques sur place, en Martinique et en Guadeloupe, qu'il s'agisse d'analyses sur les denrées alimentaires, d'analyses sur les animaux ou d'analyses sur les sols.

J'essaie depuis un moment de comprendre ces limitations des zones de pêche. Je comprends la logique, mais il me semble que les poissons se déplacent, il n'y a pas de barrières pour l'empêcher. Il est vrai que les zones côtières sont plus fortement polluées que les zones éloignées de la côte, mais, prenons le cas de la Guadeloupe, des poissons pêchés aux environs de l'archipel des Saintes sont contaminés ! À quoi servent donc vraiment ces zones de pêches ? Et si la sécurité alimentaire est importante, la part non prélevée aux fins de contrôle de la pêche d'un pêcheur contrôlé ne risque-t-elle pas d'être largement consommée entre le moment où le prélèvement est fait et le moment où les résultats des analyses sont connus ? S'ils ne sont disponibles qu'au bout de plus de deux mois, ce n'est pas compatible avec la protection de la sécurité sanitaire des consommateurs. Il y a quelque chose à revoir. Un autre processus de contrôle des produits de la pêche doit être mis en place.
Je ne suis pas un spécialiste des zones marines et de la façon dont une zone est considérée contaminée par rapport à une autre, mais il est clair que les premières zones frappées d'interdiction sont plutôt des estuaires, donc des zones qui se caractérisent par une arrivée d'eau en provenance de l'île. L'interdiction se fonde sur des analyses effectuées sur un certain nombre de poissons qui pouvaient manifestement présenter une plus forte concentration de produit. Certes, les poissons ne sont effectivement pas prisonniers de la zone en question et peuvent se déplacer, mais toutes les analyses ont montré que les niveaux de contamination des poissons pêchés étaient largement supérieurs dans certaines zones.
Ces interdictions dans certaines zones ont donc quand même permis une diminution du nombre de non-conformités des poissons. Bien sûr, la limite maximale de résidus s'applique aux poissons en question. Par ailleurs, l'ANSES avait également formulé certaines recommandations quant à la fréquence de consommation de ces poissons.

Cette interdiction de pêche dans les zones côtières a créé un vivier de poissons chlordéconés. La pêche professionnelle n'est plus possible dans ces zones, mais la pêche sportive ou de plaisance continue. Des zones côtières sont ainsi devenues très poissonneuses, et très riches en poissons présentant un taux élevé de chlordécone…
Je n'ai pas bien saisi votre question, Madame la députée.

La pêche par les professionnels étant interdite dans les zones côtières, celles-ci deviennent très poissonneuses, et les poissons y présentent une teneur en chlordécone très élevée.

Oui, et il ne faut pas oublier la pêche de plaisance. Les plaisanciers continuent à pêcher… et à vendre au bord de la route ces poissons très chlordéconés. Cela crée un problème.
Dans les zones où les prélèvements diminuent, les populations tendent évidemment à augmenter. Comme je l'indiquais, des opérations de contrôle sont menées, qui visent tous les engins de pêche, professionnels ou non. Les forces de contrôle ne sont pas présentes sur site en permanence dans l'ensemble des zones de pêche, mais un certain nombre de contrôles peuvent être effectués même sur les circuits informels, notamment les ventes en bord de route.
Aujourd'hui, l'ensemble des contrôles qui ont pu être réalisés sur les poissons commercialisés montre quand même, avec ces mesures d'interdiction, une très importante diminution du nombre de non-conformité. Nous n'atteignons pas encore le même niveau que sur les productions végétales ou sur les productions animales d'élevage, mais la diminution est tout de même forte.
Quant au maintien d'une population de poissons fortement contaminés dans ces zones qui deviennent très poissonneuses, je ne dispose pas d'éléments me permettant de dire quelle solution envisager. La DGAL se préoccupe essentiellement de ce que la population peut consommer. De ce point de vue, ce sont bien les mesures d'interdiction et de contrôle qui permettent de réduire les risques.

Comment la présence de chlordécone dans les denrées alimentaires est-elle contrôlée ? Où sont les laboratoires ? Qui assume les frais ?
Les contrôles des produits d'origine animale avant et lors de leur commercialisation et ceux des produits d'origine végétale avant leur commercialisation sont réalisés par le ministère de l'agriculture, donc par les services de la direction générale de l'alimentation qui sont au sein des directions de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, c'est-à-dire les services de l'alimentation (SALIM) au sein de ces directions. Quant au contrôle des produits d'origine végétale après commercialisation, ce sont les services du ministère de l'économie et des finances, ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui en sont chargés.
La DGAL exerce deux types de contrôle. D'une part, dans le cadre des plans de surveillance et du plan de contrôle annuel, il s'agit non pas forcément de contrôles de conformité des produits mais de contrôles qui permettent, pour les denrées alimentaires sensibles produites et consommées en Martinique et en Guadeloupe, d'évaluer la conformité des produits du point de vue de leur teneur en chlordécone. D'autre part, des contrôles visent à détecter les non-conformités et d'éventuelles fraudes.
La surveillance et le contrôle portent à la fois sur des denrées issues d'animaux d'élevage, sur les produits de la pêche, sur les productions végétales primaires – pour ce qui nous concerne –, destinés à la consommation humaine ou à la consommation animale. Au total, dans les deux îles, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation mobilise à peu près dix équivalents temps plein annuel travaillé (ETPT) pour réaliser ces contrôles. En 2017, nous avons réalisé 1 097 prélèvements sur toutes les matrices animales en Martinique et 952 en Guadeloupe. Le taux de conformité, comme je l'indiquais tout à l'heure, s'élevait à 93 % et 97 %. En 2019, le nombre de contrôles officiels a augmenté de 30 %, à la fois sur le secteur officiel et sur le circuit informel de circulation de ces produits – produits de la mer, les viandes et les végétaux. Au total, nous avons prévu de réaliser plus de 4 000 analyses en 2019 sur l'ensemble de ces matrices.

Ne faut-il pas prendre des mesures spécifiques pour le secteur informel, où les carences sont considérables, au contraire de ce qui se passe dans le secteur formel ?
L'un de nos objectifs est effectivement de renforcer les contrôles sur le secteur informel et de pouvoir accompagner également les autres opérations ; je pense par exemple à celles conduites par les agences régionales de santé dans le cadre du programme « Jardin familiaux » (JAFA), qui vise à analyser les contaminations observées et à donner un certain nombre de conseils quant à ce qui peut être produit sur des parcelles qui ne sont pas dans le circuit formel ; il s'agit de protéger les populations, celles qui produisent ou celles avec lesquelles ces produits peuvent être échangés.

J'ai oublié de vous interroger sur les valeurs toxicologiques de référence et les limites maximales de résidus…
La valeur toxicologique de référence actuellement retenue est de 0,5 microgramme par kilogramme de poids corporel et par jour. Cette limite repose sur une étude de la toxicité de la chlordécone chez le rat qui avait été menée aux États-Unis dans les années soixante-dix. Au regard de cette valeur toxicologique de référence, l'étude Kannari de l'ANSES a permis de caractériser les expositions de la population générale, notamment pour les enfants âgés de trois à quinze ans et les adultes de plus de seize ans résidant en Martinique et en Guadeloupe, et de démontrer les niveaux d'exposition de ces différentes populations.
Les limites maximales de résidus sont des concentrations maximales en pesticides autorisées légalement dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. C'est un outil réglementaire pour déterminer la conformité ou non des produits en vue de leur mise sur le marché. Elles sont établies au niveau européen et au niveau national, calculées pour chaque substance en fonction des quantités totales des aliments habituellement consommés, ce qui nécessite que ces informations soient préalablement disponibles, et susceptibles d'être contaminés, afin de garantir que la dose ingérée reste inférieure à la valeur toxicologique de référence chronique – c'est-à-dire qu'on s'attache non aux expositions aiguës mais bien à l'exposition à long terme – de la substance considérée et d'assurer ainsi la protection des consommateurs.
La LMR en chlordécone est, pour les viandes, de 0,020 milligramme par kilogramme avec une valeur de gestion dans la graisse qui peut varier selon les viandes et qui a été ramenée par les arrêtés des mois de janvier et de mai derniers à 0,025 milligramme par kilogramme pour la viande bovine et à 0,021 milligramme par kilogramme pour la viande porcine. Auparavant, la LMR était de 0,1 milligramme par kilogramme dans la graisse. L'étude Kannari a permis d'affiner le rapport entre la concentration dans la graisse et la concentration dans la viande, ce qui explique que l'on ait ensuite réduit les LMR par ces deux arrêtés.
Quant aux végétaux, la LMR est fixée par la réglementation européenne à 0,020 milligramme par kilogramme, ainsi que pour les poissons et crustacés.
N'étant pas toxicologue, je ne m'avancerai pas. Je connais les grands principes mais pas nécessairement le détail de la méthodologie.
Cela dit, les méthodes retenues dans le cadre des lignes directrices européennes envisagent le pire cas d'exposition. Il s'agit de s'assurer que la limite maximale de résidus qui sera retenue soit effectivement protectrice.
Les scientifiques s'appuient sur les habitudes de consommation. Il faut donc que la fréquence de la consommation de tel ou tel aliment par telle ou telle population soit connue. Ils envisagent ensuite des situations en visant à maximiser le niveau de protection, avec des facteurs qui permettent de réduire encore cette LMR pour être sûr d'éviter tout risque de dépassement des valeurs toxicologiques de référence.
Je pense que vous pourrez cependant auditionner des personnes bien plus compétentes que moi sur ce point.

Ces LMR par produit définies par l'Europe sont-elles parfois en contradiction avec la valeur toxicologique de référence globale ? Certains écarts sont en effet relativement importants. Comment l'expliquer ?
Et tenez-vous compte en établissant la LMR de l'accumulation possible dans le corps humain d'autres toxiques ? Cela peut gravement compromettre la santé publique.
La valeur numérique de la LMR et la valeur toxicologique de référence ne peuvent pas être directement comparées. La LMR porte sur la concentration dans un produit qui va être mis sur le marché, tandis que la valeur toxicologique de référence est une dose journalière par kilogramme de poids corporel ; elle varie donc également selon l'individu, sa consommation, son exposition.
Quant à l'évaluation de l'ensemble des expositions, c'est bien l'un des sujets sur lesquels nous travaillons actuellement, en France mais également au niveau européen, pour pouvoir prendre en compte la diversité de l'alimentation des différentes populations et savoir à quoi elles sont exposées et quels sont les facteurs de risque les plus importants. Je pense que le directeur général de la santé pourra développer ces aspects. C'est une autre approche que celle des LMR, qui portent chacune sur un produit en particulier. Celles-ci font aujourd'hui l'objet d'études très complexes mais cela permettra d'essayer d'étudier les effets cumulés des différentes substances auxquelles les individus sont exposés, par l'alimentation mais pas uniquement – le milieu environnant peut être une source d'exposition à un certain nombre de substances. Ce sont des travaux très complexes d'investigation toxicologique et écotoxicologique.

Le compte rendu du colloque que vous avez évoqué pourrait-il nous être transmis ? Il n'est effectivement pas en ligne. Et qu'en est-il de la problématique du paraquat ?
Ce sont les préfets qui sont en train d'établir le compte rendu en question. Nous allons en vérifier l'état d'avancement. S'il est disponible, nous pourrons sans difficultés vous le transmettre.
Le problème du paraquat est un peu différent. Contrairement au chlordécone, il a fait l'objet d'une autorisation européenne. Il était autorisé de longue date en France, mais, comme dans les autres pays, sous le régime des autorisations nationales, encadré par la directive n° 91414CEE du 150791 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques , qui était le cadre réglementaire européen et national de l'époque. Notamment utilisé comme désherbant total pour désherber les bananeraies, il était connu comme posant des problèmes pour la sécurité des opérateurs, notamment en cas d'application par pulvérisateur à dos. Un lien avait été fait avec la maladie de Parkinson.
Après l'entrée en application de la directive 91414, s'est posée la question de l'approbation européenne. Une demande a été déposée par la société Zeneca. Sur la base de l'avis rendu en 2002 par l'État membre rapporteur, qui était le Royaume-Uni, et le comité scientifique des plantes européen, la Commission européenne a d'abord proposé une approbation pour dix ans du paraquat. Initialement opposée à cette proposition, la France l'a finalement soutenue lors du vote au comité permanent, sur le fondement d'une position qui avait été l'objet d'un arbitrage, mais qui visait, d'une part, à ramener à dix ans la durée de l'autorisation et, d'autre part, à interdire l'utilisation par pulvérisateur à dos.
En 2007, l'approbation a été annulée par le tribunal de l'Union européenne, à la suite d'un recours introduit par la Suède. Aussitôt, au mois d'août 2007, la France a retiré les autorisations de mise sur le marché, sans délai de grâce pour l'écoulement des stocks.
À notre connaissance, le paraquat ne pose pas les mêmes difficultés que le chlordécone en termes de contamination environnementale. Cela a notamment été confirmé par un avis rendu en 2008 par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA).

Le 27 septembre dernier, à Fort-de-France, le Président de la République a évoqué un scandale environnemental fruit d'un aveuglement collectif. Il a ajouté deux phrases essentielles : l'État est appelé à prendre sa part de responsabilité dans cette pollution et il doit avancer sur le chemin de la réparation. Avez-vous reçu des directives en vue de la mise en oeuvre de ces deux déclarations ? Vous avez évoqué les plans chlordécone mais sont-ils suffisants face à l'ampleur du problème ? Et avez-vous commencé à travailler sur des processus d'indemnisation des victimes, notamment dans l'agriculture et la pêche ?
Comme je le rappelais tout à l'heure par rapport aux déclarations du Président de la République, une feuille de route interministérielle 2019-2020, visant à renforcer considérablement le plan d'action chlordécone III a été mise en oeuvre. La DGAL est impliquée, en tant que pilote ou copilote, dans quinze actions sur une trentaine d'actions proposées dans le cadre de cette feuille de route interministérielle.
Certaines sont d'ores et déjà définies et peuvent être mises en oeuvre. J'en ai évoqué quelques-unes, dont les renforcements d'un certain nombre d'actions. D'autres nécessitent des travaux préparatoires que nous poursuivons en interministériel, mais également avec les agences d'évaluation, notamment l'ANSES.
Quant aux dispositifs d'indemnisation, nous travaillons en lien avec le ministère de la santé et des solidarités sur un fonds d'indemnisation pour les victimes du chlordécone, dans le secteur agricole en particulier. D'ailleurs, la ministre Madame Agnès Buzyn avait annoncé que des dispositions seraient proposées dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Je vous pose cette question, car je voudrais conclure sur ce point.
Comme vous le savez, ce fonds d'indemnisation des travailleurs agricoles indemnise uniquement les victimes de maladies professionnelles. Aujourd'hui, entre 5 000 et 6 000 travailleurs agricoles, vivants et en activité, seraient concernés en Guadeloupe, et autant en Martinique. Cela représente 12 000 personnes, alors que Santé publique France indiquait en 2018 que 90 % des Martiniquais et des Guadeloupéens étaient pollués par la chlordécone. Entre 750 000 et 12 000 personnes, il y a une différence !
Vous êtes en train de dire que les possibilités de prise en charge ne concerneraient que les travailleurs agricoles dans le cadre du tableau à améliorer pour les maladies professionnelles. Vous connaissez toutefois la proportion des travailleurs agricoles, telle que l'a évaluée le rapport sur la création d'un fonds d'aide aux victimes des produits phytosanitaires, remis il y a peu et que j'ai sous les yeux. Le pourcentage des personnes réellement indemnisées est de l'ordre de 8 à 10 % de la masse totale du dossier.
Est-ce bien ce que vous dites, à savoir que, pour l'instant, l'État n'a donné de directive que concernant les maladies professionnelles et les travailleurs agricoles ?
Ce n'est pas tout à fait cela. Je ne faisais que répondre à la question sur ce que je connais de la réponse, car celle-ci n'est pas de mon champ de compétences. Je n'ai pas d'information sur d'autres voies d'indemnisation possibles.
Ce domaine ne relevant pas de la compétence de la DGAL, je ne peux pas répondre à cette question.

La directive qui a été donnée par le Gouvernement est-elle bien de répondre aux maladies professionnelles et aux travailleurs agricoles ? Pour l'instant, c'est la directive qui vous a été donnée.
Il ne s'agit pas d'une directive qui concerne ma direction. Je ne m'exprimerai donc pas dessus.
La directive qui nous a été donnée est de travailler sur les autres actions, déterminées dans la feuille de route. Je l'ai évoqué, sur cette feuille de route, nous sommes mobilisés sur quinze actions complémentaires au plan d'action chlordécone III. Ce n'est cependant pas la DGAL qui est en charge de ces actions d'indemnisation. Je n'ai donc pas nécessairement toutes les informations sur ce sujet.
Non. D'autres ministères sont en charge de ces actions au sein du ministère, mais pas la DGAL. Je n'ai donc pas d'information.
Non, encore une fois, nous nous sommes mobilisés sur des actions qui visent plutôt à accompagner les agriculteurs par les moyens que nous avons déjà évoqués – la cartographie, les conseils donnés sur les différentes parcelles en matière de culture, entre autres.

Vous n'avez aucune influence sur ce sujet ? Qu'en est-il du ministère de l'agriculture, dans son ensemble ?
Je parle de la direction générale de l'alimentation, qui n'est pas en charge de ces questions. Le ministère comporte plusieurs directions.
Le secrétariat général du ministère s'occupe de tout ce qui concerne la Mutualité sociale agricole et la protection sociale des travailleurs, en lien avec le ministère des solidarités et de la santé.

Nous en prenons note afin d'interroger des représentants de ces services, pour connaître exactement le processus mis en oeuvre pour indemniser les travailleurs agricoles. Cette indemnisation, qui sera mise en place d'ici à la fin de l'année ou à l'année prochaine, me semble être une bonne initiative.
C'est une bonne chose, même si, je le répète, ce ne sont pas 12 000 personnes qui ont été polluées, mais 750 000. C'est pourquoi je vous interroge sur les responsabilités de votre direction générale. La réponse est claire. Nous auditionnerons donc certainement ce service du ministère, avant d'auditionner le ministre lui-même.
En l'absence d'autres questions, je vous remercie d'être venus, et d'avoir répondu à nos questions.
La réunion s'achève à dix heures cinquante.
————
Membres présents ou excusés
Réunion du mardi 2 juillet 2019 à 9 heures 05
Présents. – M. Lénaïck Adam, Mme Justine Benin, M. Serge Letchimy, M. Didier Martin, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon