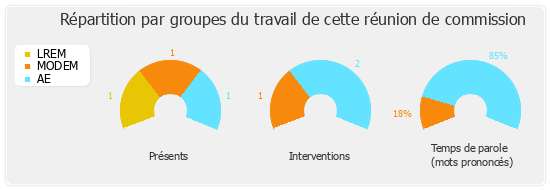Commission d'enquête sur l'évaluation des politiques publiques de santé environnementale
Réunion du mercredi 14 octobre 2020 à 16h00
Résumé de la réunion
La réunion
L'audition débute à seize heures.

Nous recevons Mme Hélène Soubelet, directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité.
Vous êtes docteure vétérinaire, diplômée d'études approfondies en pathologie végétale. Après avoir été cheffe de services vétérinaires dans le Puy-de-Dôme puis dans la Sarthe, vous avez rejoint le laboratoire national de protection des végétaux. Vous avez été responsable de la mission « Biodiversité et gestion durable des milieux » à la direction de la recherche du ministère de l'environnement. Vous êtes directrice de la fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) depuis avril 2017. Vous êtes également co-présidente du groupe de travail « Santé et biodiversité » du plan national santé-environnement (PNSE3).
La fondation pour la recherche sur la biodiversité est une fondation de coopération scientifique de droit privé créée en 2008. Elle a pour objet de favoriser les activités de recherche sur la biodiversité et leur valorisation auprès de tous les acteurs économiques, des pouvoirs publics et des gestionnaires de la biodiversité.
(Mme Hélène Soubelet prête serment.)
Je vous expliquerai pourquoi la biodiversité est importante à prendre en compte dans les politiques publiques, notamment les politiques de santé-environnement, avant de vous présenter les conclusions du groupe de travail « Santé, biodiversité » du PNSE3 que je présidais avec Thierry Galibert. Nous avons fait des propositions pour intégrer la biodiversité dans le PNSE4.
Nous étudions les publications scientifiques les plus récentes sur la biodiversité et sur les liens entre la biodiversité et certains enjeux pour nos sociétés. Je me base sur ces publications scientifiques et sur le rapport de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en anglais Intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services ). En 2019, elle a fait une évaluation mondiale qui établissait déjà que l'érosion de la biodiversité concourait à l'augmentation des risques sanitaires, notamment parce que l'empreinte humaine sur la Terre est très importante.
En 2018, 77 % des terres et 87 % des océans ont été modifiés durablement, de manière parfois irréversible, par les activités humaines ce qui a des effets directs sur les services que la biodiversité nous rend. Les principales causes de dégradation sont la culture des terres pour 12 % de la dégradation, les pâturages pour 37 % de la dégradation et les forêts gérées ou les plantations d'arbres pour 22 % de la dégradation.
De 1999 à 2019, la démographie humaine a augmenté de 30 % et le produit intérieur brut (PIB) mondial de 70 %. Il existe donc un découplage entre la démographie humaine et les impacts qui sont largement dus au PIB et à la consommation par tête.
L'érosion de la biodiversité concourt à l'augmentation des risques sanitaires parce que l'effondrement des populations animales déséquilibre les écosystèmes. Depuis 100 000 ans se produit un effondrement total de la biomasse des mammifères sauvages terrestres et marins. Par exemple, la biomasse des mammifères sauvages terrestres est passée de 40 millions de tonnes à 7 millions de tonnes et la biomasse des animaux marins est passée de 200 millions de tonnes à 4 millions de tonnes. C'est l'impact de l'humain, dont les moyens technologiques ont augmenté au cours du temps.
La biomasse végétale aurait diminué de 50 %. Nous avons actuellement 450 gigatonnes de carbone de biomasse alors que le total aurait avoisiné 900 gigatonnes de carbone avant l'apparition de l'homme moderne.
Cet effondrement de la biodiversité fait s'effondrer les services écosystémiques, c'est-à-dire les fonctions des écosystèmes qui permettent à l'homme d'en tirer des bénéfices. Trois services augmentent encore, parce que nous y consacrons beaucoup d'énergie et de finances : les services qui produisent de l'énergie, de la nourriture ou des matériaux tels que le bois, le coton… Tous les autres services diminuent, en particulier les services de régulation comme les services de régulation de la qualité de l'air. La biodiversité est en effet capable de capter des polluants et de réguler la qualité de l'air. Les services de régulation de la qualité de l'eau diminuent aussi, ainsi que les services de régulation du changement climatique ce qui a des incidences sur la santé. La pollinisation diminue également ce qui risque de provoquer un problème sur le service de production agricole, une majorité des aliments que nous consommons étant dépendants des pollinisateurs, sauvages ou non. La fertilité des sols diminue aussi.
L'IPBES a bien mis en évidence que tous les autres services diminuent et, même si nous parvenons à maintenir encore les services de production, nous constatons déjà une baisse des rendements mondiaux de 10 % sur les productions agricoles. Si la trajectoire continue, nous arriverions à une baisse de 50 % du rendement des productions agricoles. C'est donc à prendre en compte.
Le service de production agricole atteint un pic optimal lorsque le degré de nature, c'est-à-dire la proportion d'espaces sauvages, est de 30 % : lorsque les espaces sauvages autour des terres agricoles représentent 30 %, la production agricole est optimale. Augmenter encore le degré de nature réduit évidemment les terres agricoles et le service de production diminue. Augmenter la proportion de terres agricoles réduit aussi le service de production car les espèces adventices, les fleurs sauvages, les lisières avec la forêt soutiennent cette production agricole et le sol lui-même a besoin d'une certaine biodiversité sauvage. Artificialiser des espaces pour avoir plus de terres agricoles donne l'illusion de pouvoir produire plus de nourriture mais c'est faux : les rendements diminuent comme nous le constatons aujourd'hui.
Les travaux par exemple de Victor Cazalis et Michel Loreau, chercheurs du CNRS qui ont publié en 2018 des évolutions de la population humaine à l'échéance 2250, montrent que quatre trajectoires sont possibles. Deux d'entre elles amènent à l'extinction de l'espèce humaine, soit parce que nous aurons trop transformé les espaces sauvages en terres agricoles ce qui diminuera les services de régulation, augmentera trop la pollution et le changement climatique, soit inversement parce que nous n'aurons pas assez de terres agricoles ce qui provoquera une famine et le déclin de l'espèce humaine, avec une mortalité supérieure à la natalité. Les deux autres trajectoires permettent une durabilité mais l'une des deux, dans laquelle nous transformons trop d'espaces naturels en espaces agricoles, entraîne une famine chronique.
D'après un travail de compilation scientifique fait à la FRB, nous avons depuis cinquante ans une augmentation des maladies, que ce soit dans les compartiments des humains, des animaux ou des végétaux. Dans le cas des hommes, ces maladies sont à 70 % des zoonoses. Dans le cas des animaux, ces maladies sont principalement dues à l'intensification de l'élevage et à la perte de diversité génétique. Dans le cas des plantes, il s'agit de problèmes d'augmentation de la résistance des insectes aux pesticides, d'augmentation des maladies fongiques et de maladies dues au changement climatique. Depuis soixante ans, nous comptons entre 300 et 400 nouvelles maladies – 2 à 5 par an – et la courbe est croissante.

Qu'entendez-vous exactement par nouvelles maladies ? S'agit-il de maladies émergentes, d'anciennes maladies réactivées ?
Il peut s'agir de maladies émergentes ou d'anciennes maladies réactivées. Certaines maladies actuellement totalement inféodées à l'homme, comme la tuberculose, font encore 1,5 million de morts par an. Ces maladies étaient au départ des maladies de la faune sauvage et se sont adaptées à l'homme. J'espère que ce ne sera pas le cas du coronavirus mais cela a par exemple été le cas de la grippe.
Les mécanismes qui sous-tendent l'augmentation des zoonoses sont liés à trois facteurs qui accroissent le risque. Le premier facteur de risque est la présence du virus, quelque part dans l'environnement. Le deuxième facteur est le contact, l'exposition au danger. Le troisième facteur est la vulnérabilité de celui qui s'expose au danger.
Nous n'avons pas suffisamment de connaissances pour savoir si le danger a augmenté. Nous ne connaissons que 0,1 % des virus potentiellement présents sur Terre donc nous ne savons absolument pas à quoi nous faisons face. Il est certain que nous faisons face à des virus et à des bactéries. Leur biomasse est d'ailleurs plus grande que la nôtre. Ces organismes, y compris les champignons, sont extrêmement labiles et capables de s'adapter à un nouvel hôte s'ils en ont l'occasion.
L'exposition augmente parce que nous détruisons les espaces naturels. Nous rentrons donc plus fréquemment en contact avec les populations d'animaux. Ils sont porteurs de virus avec lesquels ils ont co-évolué et qui ne sont pas forcément pathogènes pour eux, comme dans le cas de la chauve-souris. Le contact des hommes avec ces animaux sauvages ou avec des écosystèmes dégradés facilite l'apparition des maladies.
Parmi les cas documentés de maladies liées à des changements environnementaux, nous pouvons citer le virus Hendra en Australie dû à un changement d'usage des terres tout comme le virus Nipah en Malaisie. Ce dernier virus a émergé du fait de la transformation des terres en plantations de palmiers à huile ce qui a provoqué le départ des populations de chauve-souris qui habitaient dans la forêt primitive. Elles sont allées chercher le gîte et le couvert dans des vergers sous lesquels paissaient des porcs ce qui a permis le transfert du virus Nipah de la chauve-souris au porc puis à l'homme. En trois épisodes successifs, la maladie a provoqué un certain nombre de morts en Asie du Sud-Est mais n'a pas entraîné de pandémie parce que la transmission interhumaine est en général impossible, un seul cas ayant été repéré.
Dans le cas du coronavirus, le transfert s'est probablement fait de la même façon à cause d'une destruction des habitats naturels ou d'une intrusion de l'homme dans des habitats qu'il ne fréquentait pas auparavant. Le virus s'est adapté de la chauve-souris ou d'un hôte intermédiaire à l'homme avant de se répandre grâce à la contagion interhumaine. Comme les hommes, les animaux vivants et les denrées circulent maintenant beaucoup, les virus sont transférés dans le monde entier.
Diverses publications indiquent que plus la biodiversité est élevée, plus le danger est fréquent mais que plus la biodiversité est élevée, moins le risque est élevé. En effet, des phénomènes de régulation se mettent en place dans les écosystèmes, en particulier l'effet de dilution : plus il existe d'animaux divers, moins un virus peut être adapté à l'ensemble des hôtes qu'il rencontre.
Dans les écosystèmes dégradés par l'homme, plus d'animaux sont eux-mêmes hôtes de pathogènes. Les hôtes sont donc plus nombreux à la fois en nombre d'espèces et en abondance dans la population. Les chercheurs ont constaté une augmentation de 45 % du nombre de chiroptères porteurs de virus, de 52 % du nombre de rongeurs porteurs de virus et une augmentation variant de 10 à 96 % selon les espèces du nombre d'oiseaux véhiculant des virus dans les écosystèmes dégradés.
Cette transformation des espaces est, à 50 %, provoquée par l'agriculture, avec un phénomène complémentaire dans le cas de l'agriculture : les animaux domestiques constituent actuellement le plus gros compartiment de biomasse d'animaux terrestres. Non seulement ces animaux domestiquent vivent dans des conditions qui ne correspondent pas toujours à leurs conditions de vie naturelles donc peuvent être plus stressés que des animaux sauvages, mais en plus ils sont sélectionnés. La perte de diversité génétique dans les élevages intensifs diminue l'aptitude de ces animaux domestiques à se défendre face aux divers pathogènes. De plus, lorsqu'un pathogène parvient à contaminer l'un de ces animaux, il parviendra à contaminer tous les autres qui sont génétiquement très semblables.
D'autre part, les échanges mondiaux, actuellement très intenses, permettent la diffusion très rapide d'une maladie d'un animal à un autre, voire à l'homme, dans diverses parties du monde.
Nous avons le même problème avec le changement d'usage des terres à vocation agricole. Ainsi, une publication de 2019 fait le lien entre le paludisme et la modification de l'usage des terres, notamment pour planter de l'huile de palme. La séroprévalence du paludisme est supérieure dans les zones agricoles irriguées, dans les zones de plantation forestière ou dans les zones de plantation d'huile de palme. Nous avons un lien clair entre monoculture et pandémie.
Il existe également un lien avec la manipulation ou la chasse ou la détention d'animaux sauvages et leur consommation. Le lien a été démontré scientifiquement entre la consommation d'animaux sauvages, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique, et l'émergence de maladies infectieuses. Ce n'est pas réellement la consommation qui est visée mais plutôt la phase de contact avec l'animal sauvage, lors de la chasse ou lors de la détention sur les marchés aux animaux vivants par exemple ou lors de l'abattage. L'homme sensible est alors en contact avec un animal porteur potentiel de virus, de bactéries ou de champignons.
Une étude récente sur le coronavirus par Hopson et alii montre que les dommages économiques liés au coronavirus s'élèvent potentiellement à 5 000 ou 6 000 milliards de dollars en termes de perte de PIB. Ces coûts sont très au-delà des coûts de prévention actuellement consentis mondialement pour gérer les maladies infectieuses qui sont plutôt de l'ordre de 20 milliards de dollars.
Des études s'intéressent aux stratégies possibles, curatives ou préventives. Nous sommes dans un système qui, en général, essaie de stopper la pandémie lorsqu'elle est déjà présente alors que nous pourrions essayer de gérer les pandémies avant qu'elles n'arrivent, en nous ancrant résolument dans une stratégie de prévention. Selon les scientifiques, les pandémies coûteraient actuellement, au niveau mondial, de l'ordre de 10 000 milliards de dollars et les politiques de prévention, mises en œuvre au moment opportun, coûteraient moins et permettraient d'économiser 350 milliards de dollars durant les cent prochaines années. En fait, la prévention coûte cher au début puis il se produit un effet de bascule et elle coûte moins cher ensuite.
Toutes les grandes instances internationales se préoccupent maintenant des relations entre la biodiversité et l'émergence des maladies infectieuses. L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a publié en septembre un rapport sur la covid. Il propose des mesures de maintien en bon état des écosystèmes. Il faudrait protéger environ 30 % de l'espace terrestre et marin pour y laisser la libre évolution aux animaux sauvages. Cela peut être sous forme d'aires protégées ou avec d'autres instruments.
L'OCDE a également recommandé – c'est une première de sa part – la mise en place et le renforcement de l'approche « Une seule santé » One Health.
Je considère personnellement que le One Health ne fonctionne pas très bien actuellement. Il se heurte à des intérêts financiers importants. L'OCDE a ainsi estimé que plus de la moitié de l'effort financier mondial finançait des activités dommageables pour la biodiversité. L'économie actuelle est donc basée sur la destruction de la biodiversité pour générer du profit. Par exemple, pour le détenteur d'une forêt, il est plus rentable de la couper à ras pour exploiter le bois que de la laisser prospérer. La laisser prospérer coûte même de l'argent étant donné que la fiscalité sur ces espaces naturels n'est pas forcément adaptée aux services rendus par ces espaces.
L'OCDE a également estimé que l'allocation financière mondiale pour la protection de la biodiversité se situe entre 78 et 91 milliards de dollars et que, sans stratégie préventive, des pandémies continueront à émerger. Il faut se poser la question non pas du gain économique à court terme que procure la destruction de la biodiversité mais du gain économique à long terme que procure la préservation de la biodiversité. La Fondation est d'ailleurs convaincue que nous pouvons faire les deux, c'est-à-dire avoir des activités humaines tout en préservant la biodiversité. Nous le voyons avec le développement d'une agriculture beaucoup plus durable.
L'approche One Health est censée avoir trois pieds : la santé des hommes, la santé des animaux et la santé de l'environnement. Néanmoins, actuellement, le dialogue entre la santé humaine et la santé animale, c'est-à-dire entre médecins et vétérinaires, fonctionne très bien dans One Health alors qu'il manque une vision plus systémique pour intégrer la santé environnementale dans ce dialogue. C'est vrai dans les deux sens. Ainsi, lors d'une restauration écologique, les problématiques de santé publique qui pourraient en découler, telles que la présence d'espèces allergènes par exemple, ne sont pas forcément prises en compte. Inversement, en santé publique, les effets de la destruction des écosystèmes et des politiques de prévention ne sont pas pris en compte.
Les grands perdants de cette approche One Health, au niveau mondial, sont les autres acteurs socioéconomiques, ceux qui n'interviennent pas dans la santé ou la restauration écologique. Le groupe de travail « Santé, biodiversité » avait pourtant réussi à le faire dans le PNSE3 puisque nous avions dans le groupe de travail environ 80 membres, de toutes obédiences. Cette instance ressemblait aux instances « grenelliennes » avec des organisations non gouvernementales (ONG), des porteurs de politiques publiques, des acteurs privés dont des aménageurs du territoire, des juristes, des écologues, des agriculteurs, des vétérinaires, des médecins… Ce groupe avait travaillé sur le sujet voici dix-huit mois et réfléchissait déjà à un niveau systémique assez élevé. Il avait proposé d'inclure un axe « Une seule santé » dans le PNSE4 en conservant quatre sous-axes.
– l'une sur les liens entre certaines maladies et les écosystèmes pour rechercher les éléments de nature qui ont un impact positif sur la prévalence d'une maladie humaine, qui permettraient de réduire la prévalence des maladies humaines ;
– l'autre sur les types de nature et les composantes naturelles qui influent sur le bien-être et la santé mentale des hommes, sujet sur lequel il existe des travaux récents et innovants qui mériteraient d'être poursuivis ;
1.2. acquisition de connaissances nouvelles sur la santé des écosystèmes puisque nous ne disposons que très peu d'études qui s'intéressent à cette problématique :
– réaliser une étude bibliographique ou une revue systématique sur le concept de santé des écosystèmes, les facteurs qui influencent cette santé, comment préserver une bonne santé et comment, dans un contexte de changement climatique, avoir tout de même des écosystèmes fonctionnels, qui rendent ce service de protection de la santé humaine ;
– s'intéresser aux indicateurs de santé des écosystèmes. Cette notion fait encore débat dans la communauté scientifique. Il faut savoir ce qu'est un écosystème en bonne santé et ce dans les différents secteurs de l'environnement : l'eau, le sol, l'air… Nous proposons de réaliser une revue systématique pour déterminer les indicateurs existants et de les évaluer pour connaître leur pertinence ;
– accompagner et soutenir des recherches sur les liens entre biodiversité et maladies infectieuses. Il reste de nombreuses lacunes dans nos connaissances dans ce domaine. La FRB a produit une synthèse qui reprend les différentes questions qui se posent, les publications actuellement disponibles – en mai dernier – et les lacunes encore présentes. Dans le PNSE4, nous pourrions favoriser les recherches sur ces lacunes.

Vous avez fait un large tour d'horizon et décrit une situation presque apocalyptique de la situation du vivant sur cette planète, du fait de l'inconscience et de l'inconséquence de l'être humain.
La communication que vous faites sur ces éléments pourrait-elle toucher réellement le grand public ? La conscience de la biodiversité se limite actuellement à quelques éléments sur les animaux de cirque, les élevages de visons… alors que l'ampleur des dégâts est colossale. Comment pourrions-nous être des relais pour alerter les humains sur les dégâts qu'ils provoquent ?
Vous avez fait des propositions en vue du PNSE4. J'espère que ces préconisations seront reprises et, plus encore, que nous en aurons bientôt connaissance puisque la parution du PNSE4 traîne un peu.
Ce que vous préconisez a-t-il été traduit en actes dans d'autres pays ? Connaissez-vous des exemples de politiques publiques de restauration de la biodiversité qui ont montré leur efficacité et sur lesquelles nous pourrions nous adosser pour « vendre » des propositions très concrètes, pour montrer que c'est possible, efficace et qu'il suffit d'avoir une volonté politique ?
La FRB n'a pas conduit d'étude sur des sujets mais il existe des exemples très intéressants dans le rapport de l'IPBES lui-même. Ce rapport de 1 800 pages est actuellement le document de référence car il s'agit de la synthèse la plus récente et la plus exhaustive. Des publications scientifiques viennent régulièrement l'amender mais ce rapport, rédigé par 150 chercheurs, répertorie tout de même 1 500 publications. C'est un socle pour la connaissance de la biodiversité et des impacts de son érosion sur les humains.
Ce rapport présente quelques bons exemples et des solutions qui ont bien fonctionné. Nous les utiliserons d'ailleurs pour l'étude que la FRB mène actuellement sur les leviers juridiques utilisables en France pour stopper l'érosion de la biodiversité dans différents secteurs tels que l'agriculture, la pêche, le développement urbain, la protection de la biodiversité dans les aires protégées, les espèces protégées et la biodiversité ordinaire.
Malheureusement, ces exemples sont éminemment territoriaux. Nous ne sommes pas certains qu'une solution qui a bien fonctionné dans un territoire pourra être utilisée de la même manière dans un autre territoire, même s'il lui ressemble. La première phase, à chaque fois qu'un problème est identifié, est une phase de concertation, ne serait-ce que parce que les groupes sociaux qui habitent le territoire ne sont pas les mêmes et que l'implémentation d'une solution peut être facile à un endroit et très compliquée à un autre. Il faut de plus mesurer l'efficience de ces mesures sur le long terme, ce qui n'a pas toujours été fait dans les exemples à notre disposition.

Que pourrions-nous faire pour la formation et l'information du public ? Quels relais pourrions-nous faire jouer ? Comment pourrions-nous nous-mêmes être des relais pour permettre la prise de conscience ?
Nous essayons de travailler sur deux aspects. Le premier est la formation de groupes d'acteurs. La FRB s'est mobilisée pour former le plus largement possible et il nous est arrivé d'aller former des juristes, d'intervenir auprès d'acteurs financiers. Nous intervenons de plus en plus dans des formations de grandes écoles, par exemple à l'école des Mines, dans les lycées à l'occasion de la Fête de la science. Toutefois, la FRB est toute petite, avec un peu moins de 30 personnes.
Le deuxième aspect est celui de la communication à destination du grand public. Lorsque je suis arrivée, la FRB s'était déjà orientée vers une politique de communication vers le grand public, en sortant du cadre de nos acteurs habituels qui était constitué des 240 membres de notre conseil d'orientation stratégique. Nous avons commencé à écrire des petits articles plus didactiques, plus courts, pour faire passer des messages scientifiques. Nous nous basons sur des publications scientifiques ou nous interviewons des chercheurs pour faire passer des messages simples.
À l'occasion des dix ans de la Fondation, nous avons notamment publié onze actions que tout un chacun peut mettre en œuvre pour participer à stopper l'érosion de la biodiversité. Jean-François Silvain et moi-même avons publié un livre pour comprendre la biodiversité et réagir. Ce n'est pas mal mais c'est ridicule au niveau national et il faudrait être beaucoup plus ambitieux.
Nous préconisons d'associer le ministère de l'éducation nationale aux formations initiales pour que, dans les collèges et surtout dans les lycées et dans le supérieur, nous ayons un socle de compréhension de ce qu'est le vivant, de compréhension du fait que nous faisons partie du vivant et de compréhension de ce que nos actions, lorsqu'elles sont menées au niveau mondial, concernent une grande surface ou de nombreux hommes et ont un impact important.
Le tourisme par exemple peut être très vertueux lorsque deux hommes visitent un endroit magnifique, mais ne pourra pas l'être pour six millions de touristes. Cela détruira l'écosystème. L'activité n'est pas mauvaise en soi mais est mauvaise du fait du changement d'échelle. C'est cela que nous essayons de faire comprendre. Il faut adapter les activités au territoire et non l'inverse. Tous les grands corps d'État, tous les acteurs économiques devraient l'intégrer dans leur développement et dans leur trajectoire pour devenir vertueux et protéger la biodiversité.

Nous sommes devant de bien tristes constats. Que vous ne soyez que trente est encore plus inquiétant. Je suis très circonspecte sur la volonté des instances gouvernementales, qu'il s'agisse des actuelles ou des précédentes.
Que devrions-nous améliorer en matière de gouvernance pour accroître l'efficacité de la politique en santé-environnement ? Faudrait-il, selon vous, améliorer la prévention et comment ?
Vous avez parlé de vos actions en partenariat notamment avec l'éducation nationale. Avez-vous la possibilité de les accroître ? Est-il prévu une évolution de votre instance ? Est-il prévu de la faire grandir ?
Nous sommes environ trente à la FRB mais nous sommes accompagnés par toute la communauté de recherche. Nous avons onze membres fondateurs dont neuf fondateurs scientifiques et leurs chercheurs travaillent dans toutes les disciplines d'ailleurs, pas uniquement en écologie. Nous mobilisons beaucoup ces chercheurs, y compris lors de sollicitations par la presse. Nous n'agissons pas seuls.
Je pense que nous sommes suffisamment nombreux pour mobiliser la communauté de recherche. Le statut de FRB ne permet pas beaucoup d'agir autrement puisque nous sommes une fondation de coopération scientifique. Notre objet est de mobiliser les scientifiques pour faire passer des messages scientifiques, de mobiliser les acteurs autour de ces enjeux pour coconstruire des programmes de recherche et communiquer les résultats de la recherche.
Notre action ne consiste pas à former tous les collégiens de France, c'est le rôle d'autres instances comme les ministères. Nous avons besoin collectivement de former les jeunes, les acteurs en place et les porteurs de politiques publiques. Il serait ensuite possible de former tout le monde, pas uniquement quelques cas particuliers comme nous le faisons et nous ne ferons pas plus. Il faudrait que cette formation soit beaucoup plus large.
En termes de gouvernance, il faut que toute décision prenne en compte ces enjeux globaux et que, lorsqu'une décision est prise, nous sachions exactement à qui cela va coûter, combien, et qui sera garant des paiements des externalités négatives de la décision. Ces externalités négatives existent toujours, par la pénalisation soit d'une catégorie socioprofessionnelle soit de la biodiversité. Il faut le chiffrer et nous avons en France des acteurs capables de le faire. Ensuite, des actions correctives devraient être apportées.
Par exemple, lors de l'épandage de pesticides dans un champ, ce qui pollue les rivières, les sols et l'océan, quelqu'un paiera pour la dépollution et ce n'est souvent pas celui qui génère l'externalité négative qui paie. Nous avons donc un découplage entre les conséquences de l'action et l'action elle-même. Il faudrait, lorsqu'une décision est prise, que l'évaluation de l'impact de cette décision soit faite et rendue publique. La justification de la décision devrait justifier aussi la façon de gérer les externalités négatives, les actions correctives et indiquer qui paiera les actions correctives mises en œuvre.
Il serait bon, également, d'évaluer si la décision est prise pour gérer un problème à court terme, par exemple autoriser à court terme certaines externalités négatives pour soutenir une filière mais en l'accompagnant de garanties que ce n'est que ponctuel et que la filière, à long terme, s'engagera sur une trajectoire plus vertueuse de façon à éviter que le problème se reproduise.
Il faudrait toujours avoir une vision de long terme de ce que pourrait engendrer la décision si, par exemple, elle était mise en œuvre pendant cent ans. Les chercheurs le font souvent. Ils se mettent à des échelles de temps plus larges pour bien voir que, certes, cette décision n'a pas d'effet important immédiat mais que, si elle est répétée tous les jours, pendant cent ans, elle peut avoir plus d'impact. Je pense qu'il est possible de réfléchir ainsi avant la décision, même si cela retarderait probablement la prise de décision. À mon avis, nous serions gagnants à long terme et même à moyen terme.

Le souci est que le temps des chercheurs n'est pas celui des politiques. Faire les évaluations d'impact à moyen et à long terme serait du bon sens mais ce n'est pas du tout dans la culture politique, de façon générale.
Les relations entre la biodiversité et la santé ne sont pas des notions familières à la population. La société civile n'est, pour le moment, pas tellement mobilisée sur ce sujet. Nous pleurons sur le sort des ours polaires mais nous n'avons aucune conscience que leur disparition peut avoir un impact sur notre qualité de vie et, à terme, sur notre existence même sur cette planète. La problématique du partage de l'information et de la compréhension des enjeux par le grand public n'est pas résolue. Même parmi les politiques, rares sont ceux qui ont vraiment conscience des connexions. Cela relève encore d'une approche poétique, émotionnelle plutôt que d'une réflexion à l'échelle planétaire sur l'enjeu de survie que représente le fait de s'attaquer à une partie du vivant, ce qui a forcément des conséquences sur les êtres humains.
Même au niveau d'une entreprise, qui a forcément des impacts sur l'environnement, faire passer la notion de comptabilité verte est très difficile. Des groupes travaillent pour faire une évaluation des externalités négatives des projets d'investissement mais ce n'est pas encore dans la culture des entreprises.
Nous parlions de l'information et de la formation du grand public mais ceux qui sont à l'origine de cette perte de biodiversité, notamment les agriculteurs, sont-ils informés ? Ceux qui sont à l'origine de la dégradation ont-ils été associés à cette réflexion générale ?

Une notion nouvelle, l'amnésie environnementale, explique peut-être pourquoi nous ne parvenons pas à intéresser les individus au fait que la biodiversité s'effondre sous nos yeux. Ce mécanisme psychologique explique cette absence de réactivité et le fait que nous ne rendions pas compte de ce qu'il se passe. L'introduisez-vous dans vos recherches pour pouvoir mieux agir et lutter contre cette forme d'amnésie ? Peut-être pourrions-nous déconstruire ce phénomène.
Cette amnésie environnementale ne concerne pas seulement la biodiversité animale mais également la biodiversité végétale. Par exemple, je suis confrontée dans mon département à une décision ubuesque : abattre des platanes sur 1,5 kilomètre sous prétexte de sécurité routière. Fort heureusement, des associations et des élus locaux se sont mobilisés et la décision est suspendue pour un an. Ce qui frappe est que la plupart des gens ne se souviennent maintenant plus que des platanes poussaient autrefois le long des routes. Cela contribue au maintien de la biodiversité. Même des éléments aussi grands et visibles qu'un arbre sont oubliés dans l'esprit collectif aussitôt qu'ils sont effacés.
Nous nous intéressons à cette question et avons eu l'occasion d'en parler lors de plusieurs colloques. Trois phénomènes sont en jeu.
Le premier est l'amnésie environnementale, mais elle a lieu presque de bonne foi puisque les personnes concernées n'ont pas connu la biodiversité que nous voudrions retrouver ou défendre. C'est de plus en plus vrai chez les jeunes qui vivent de plus en plus dans un milieu où la biodiversité est dégradée.
Le deuxième est l'opposition. Le rapport de l'IPBES proposait de partir sur des trajectoires de changement dites « transformatives », c'est-à-dire consistant à transformer nos sociétés, nos modes de consommation. Ceci défavorisera forcément certaines catégories d'acteurs qui bénéficient actuellement du système mondialisé tel qu'il est et s'y opposeront donc fortement.
Le troisième aspect est le déni : face à une mise en accusation, par exemple du monde agricole, un certain nombre d'acteurs refusent d'entendre qu'ils sont responsables. Nous pourrions considérer qu'ils sont de bonne foi parce qu'ils n'ont pas construit seuls ce modèle agricole et tout n'est pas de leur responsabilité. Ils en sont souvent plus les victimes que les coupables.
Que faire ? Il s'agit de concilier la préservation de la biodiversité et les activités humaines. Nous sommes persuadés que nous parviendrons à agir par la formation et l'information. C'est la raison pour laquelle nous avons fortement développé le service communication de la FRB. Je pense que le monde de la recherche est de plus en plus allant pour participer à la transmission d'informations. De plus en plus de chercheurs s'expriment dans les médias et communiquent sur les résultats de leur recherche, notamment parmi les chercheurs en écologie.
Cela génère malheureusement parfois aussi un certain désespoir, même de notre part, parce que nous avons l'impression de crier dans le vide bien souvent. Nous avons aussi parfois de très bonnes nouvelles. Nous sentons que la jeune génération se soucie réellement de la biodiversité ce qui est très positif. Ils y sont, je pense, beaucoup plus sensibles que ma génération par exemple, au même âge. Certains acteurs veulent résolument changer comme nous l'avons vu de la part d'entreprises et du monde agricole aussi. Une partie du monde agricole change résolument de trajectoire et veut montrer que c'est possible. C'est précisément en montrant que c'est possible que nous y parviendrons.
L'action de l'État pourrait consister à mettre en œuvre ces exemples d'actions possibles sur un territoire et à leur faire largement de la publicité pour que d'autres territoires voient ce qu'il est possible de faire à coût égal, avec des bénéfices bien supérieurs pour la biodiversité et la qualité de vie.
Un autre aspect de la question est de savoir comment mesurer la réussite. Nous l'avons beaucoup étudié via notre conseil scientifique, avec notamment Harold Levrel qui est économiste. Connaître les bons indicateurs pour mesurer la réussite est une question cruciale, soulevée également par l'IPBES qui préconise de changer d'indicateurs. Il s'agirait de se baser sur la qualité de vie plutôt que le PIB.
En gagnant beaucoup d'argent, je peux habiter dans un bel appartement mais sans voir beaucoup de nature et je serai peut-être moins heureux qu'en habitant une maison plus humble mais en ayant tous les jours accès à la nature. J'aurai peut-être moins de maladies mentales. L'une des études que nous avons menées dans le groupe de travail démontre que l'accès à des espaces verts et des espaces bleus permet une meilleure santé mentale.
Nous constatons une inégalité dans l'accès à l'environnement et les populations les plus pauvres, les plus vulnérables, sont celles qui ont le moins accès aux espaces verts, aux espaces de nature. C'est en partie pour des raisons d'argent puisque les plus riches peuvent aller à l'autre bout du monde, dans la forêt tropicale par exemple, mais c'est également vrai sur le territoire. L'organisation urbaine est telle que, dans les villes, les grands parcs ne sont pas à côté des HLM mais plutôt dans les beaux quartiers et c'est ce qui fait le prix des beaux quartiers. Les villes dans lesquelles les habitants des logements sociaux ont accès à un espace de nature sont très rares.
Il faut réfléchir de façon globale, systématiser les problèmes et essayer de remonter au niveau supérieur. Nous avons certes un problème de logement social à résoudre mais le résoudre en construisant des immeubles sur un parc en ville n'est pas forcément la solution. C'est pourtant parfois ce qui est choisi. Un parc est certes une surface libre mais il faut une réflexion globale pour savoir à quel espace de nature auront accès les habitants en cas de suppression du parc et essayer de trouver une autre solution. Je pense que, à chaque fois que les acteurs se sont mis autour d'une table et ont cherché une solution, ils y sont parvenus. Ce travail fait partie de l'évaluation.

À Singapour, toutes les chambres d'hôpital doivent obligatoirement donner sur des végétaux parce que cela contribue au rétablissement des patients. À Hong-Kong, j'avais été frappée par le choix fait de sanctuariser certaines îles en y interdisant toute forme de construction.
Vous avez soulevé le problème de la démographie en parlant du tourisme. Deux touristes ne posent aucun problème mais 5 000 détruisent tout, même s'ils sont respectueux. Ce n'est pas un problème de comportement mais de nombre et c'est le problème auquel nous avons dû faire face dans les Cévennes cet été, avec un flux de touristes que nous n'avions jamais connu. Des zones, comme le mont Aigoual, ont dû être gérées par les gendarmes car le trop grand nombre de visiteurs était destructeur.
À Hong-Kong, dans les endroits sanctuarisés, les poissons reviennent alors que le trafic maritime est insensé mais la contrepartie est la forte concentration humaine dans d'autres zones. Dans nos sociétés occidentales, ce n'est pas acceptable et je pense que c'est l'un des points sur lequel nous butons pour préserver l'environnement. J'ai proposé de sanctuariser certaines zones pour éloigner la présence humaine et y permettre une biodiversité, en particulier pour les grands prédateurs. Ce n'est pas recevable. Nous ne pouvons pas imaginer qu'un endroit ne soit pas accessible aux citoyens dans un pays comme la France.
Pensez-vous que ce serait une solution pour préserver la biodiversité dans un monde où la démographie continue à augmenter et ne s'interrompra pas ? Pourrions-nous créer une mosaïque de manière à sanctuariser des zones que nous préserverions des humains ? Nous mettrions une plus forte concentration d'humains dans d'autres zones plutôt que de coloniser tout l'espace comme nous le faisons plus ou moins sciemment.
Cette question est beaucoup étudiée par les chercheurs et de nombreuses publications préconisent effectivement non une sanctuarisation mais une protection. Certains parlent de sanctuarisation, plutôt dans le milieu marin où c'est plus facile à réaliser car nous ne sommes pas confrontés à la propriété privée, notamment dans les zones hors des juridictions nationales.
Dans le milieu terrestre, la sanctuarisation est compliquée. Des chercheurs, dont la publication que j'ai citée de MM. Victor Cazalis et Michel Loreau, disent qu'il faudrait préserver 30 à 40 % de l'espace terrestre d'une activité humaine trop intense. Dans ces zones, il s'agit soit d'interdire toute activité soit de se limiter à des activités durables. Par exemple, une agriculture biologique extensive élevant des bovins à l'herbe avec une charge très réduite est complètement compatible avec la préservation d'espaces puisque les grands herbivores font partie du cycle de ces espaces naturels et pourraient y être intégrés de façon permanente. Cela permettrait aux hommes qui les exploitent d'en tirer un revenu.
En France, nous nous inscrivons plutôt dans cette logique, mais il faudrait réfléchir aux différents statuts de nos espaces protégés. Avons-nous atteint les objectifs d'Aichi de protéger 30 % du territoire ? Certains espaces ne sont que peu ou pas protégés. Sans interdire l'ensemble des activités humaines dans tous les espaces, même s'il faudra sans doute le faire dans certains espaces, nous pourrions simplement fortement contraindre les activités humaines dans d'autres espaces.
Certains travaux disent que, en ajoutant des contraintes à certaines activités, nous créons de l'innovation parce que les acteurs s'adaptent, tout comme la biodiversité. Cela pousse à la créativité, à l'innovation et ce n'est pas forcément mauvais à long terme. À court terme, cela nécessite des changements et générera des oppositions.

Vous avez fait des propositions dans le groupe de travail du PNSE4. Par où commencer ? Il s'agit d'une problématique systémique, d'une problématique de société, de civilisation. Quelle est l'urgence ? Quelle est l'action la plus rapidement réalisable pour, au moins, amorcer le processus ? Si nous attendons que les êtres humains prennent conscience des effets de leurs activités, nous aurons tous disparu.
Par ailleurs, l'antibiorésistance semble être devenue un énorme problème. Que pensez-vous du plan ÉcoAntibio ? Vous paraît-il efficace ? Pensez-vous que nous parviendrons à « limiter la casse » ? Nous voyons apparaître de nombreuses situations de personnes hospitalisées que nous ne pouvons plus soigner parce que les souches microbiennes sont devenues antibiorésistantes et nous ne pourrons à terme plus sauver ces personnes.
À mon avis, comme tout est lié, par où commencer n'est pas la bonne question. Il faudra faire tout en même temps, mais ce ne sont pas les mêmes acteurs qui interviennent partout. Malgré l'urgence à transformer le modèle agricole, il ne faut pas laisser sans action le domaine de la pêche ou des activités financières par exemple. Tous peuvent commencer en même temps, il s'agit simplement de donner le top départ.
Nous avions publié un avis lors du Grand débat 2019, intitulé Diminuer notre empreinte écologique en préservant la biodiversité – Une grande cause nationale. Nous disposons d'indicateurs pour calculer cette empreinte écologique. Les Français ont actuellement une empreinte écologique double de la biocapacité de la France, c'est-à-dire de la capacité de la surface de la France, métropole et outre-mer, à produire de la biomasse. Chaque Français a besoin pour vivre de 5,4 hectares alors que la surface disponible en France par Français est de 2,4 hectares. Nous allons donc chercher ailleurs ces trois hectares complémentaires et nous générons des dégradations en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud…
Nous avions proposé comme grand projet que nous nous mettions tous en ordre de marche pour, à l'horizon de dix ou vingt ans, diminuer notre empreinte écologique et la ramener à la biocapacité. Cela nécessiterait l'engagement de tous les acteurs. Cela signifie produire de manière plus durable les produits agricoles, les produits de consommation courante, les produits de construction, réfléchir à l'aménagement urbain, aux infrastructures…
Je ne pense pas qu'il faille se demander quelle est l'action prioritaire. Toutes les actions sont prioritaires et, dans la plupart des cas, une action ne peut pas se développer jusqu'à son terme si les autres ne suivent pas. Si nous ne faisons pas avancer tout le monde en même temps, des freins apparaîtront.
Nous en revenons à une injonction initiale de l'État puis à une formation et une information pour que tous les acteurs, y compris les citoyens, soient en phase avec cet objectif et qu'il devienne un véritable enjeu national.
L'antibiorésistance est effectivement très inquiétante. Dans un premier temps, ce n'est pas vraiment un problème de biodiversité mais cela pourrait le devenir. Les mesures majeures du plan EcoAntibio sont des mesures de lutte contre l'antibiorésistance par la réduction de l'usage des antibiotiques et la recherche de nouveaux antibiotiques pour pallier l'antibiorésistance. Il faudrait que ce plan s'intéresse un peu plus à la valence environnementale du problème car nous savons que des bactéries antibiorésistantes sont déjà présentes dans l'environnement. Des résistances croisées apparaissent et nous proposions pour cette raison de conserver l'action contre l'antibiorésistance au sein du plan « Une seule santé » en étudiant l'effet des résistances croisées notamment avec les biocides. Nous avons peu d'études sur le sujet et cela conduirait à des recommandations sur l'usage des biocides. Si les antibiotiques restants génèrent de nombreuses résistances du fait par exemple des biocides ou de l'existence de bactéries déjà résistantes qui se trouveront favorisées, la situation peut être inquiétante.
Il faut aussi s'intéresser à la faune sauvage dont certains éléments sont porteurs de bactéries résistantes, notamment des oiseaux. Il faut essayer d'anticiper ce problème pour éviter une future transmission des oiseaux à l'homme.
Il faut surveiller en particulier les espèces synanthropiques qui se sont adaptées aux sociétés humaines et vivent à côté de l'homme. C'est le cas des rats, des pigeons, des moustiques… Ces espèces qui vivent aux côtés de l'homme depuis longtemps partagent avec nous un certain nombre de pathogènes et nous pourrions aussi partager avec elles des bactéries, dont des bactéries antibiorésistantes. La recherche n'a pas encore mis en évidence de passage à l'homme mais il pourrait se produire et il faut le surveiller.
Nous pourrions donc renforcer le plan contre l'antibiorésistance sur la partie environnementale et c'est l'objet de la proposition du groupe de travail.

Souhaitez-vous ajouter une proposition, un conseil, une remarque ?
Je pense que notre action consiste surtout à informer, à rapporter ce que nous avons entendu aujourd'hui grâce à vous et à démultiplier l'information. Nous pouvons peut-être agir concrètement sur l'évaluation des impacts, des externalités négatives.
Je souhaite ajouter que l'évaluation d'impact se fait en un temps très court qui ne permet pas toujours d'anticiper les véritables impacts. Nous avions travaillé ces questions dans les ateliers « Sciences pour l'action ». Ils consistent en une mise en relation entre acteurs et chercheurs sur différents sujets. Nous y travaillons avec le ministère de la transition écologique et l'office français de la biodiversité (OFB). L'une des recommandations de ces ateliers est, puisque nous ne pouvons pas avoir toutes les réponses dès le départ, que l'évaluation de l'impact continue tout au long de la vie de l'activité pour que, si les impacts ont été mal évalués, nous puissions revenir sur l'étude d'impact et réorienter ou stopper l'activité dans les cas les plus graves.
Une activité ne doit pas être lancée pour cent ans après l'étude d'impact initiale ; il faut que nous puissions réviser l'étude d'impact avec les données environnementales. Comme elles font souvent l'objet d'un suivi par les industriels, nous disposons en cours d'activité de nouvelles données sur l'impact réel de l'activité et non simplement sur l'impact supposé d'une activité qui n'a pas encore démarré.

Que pensez-vous du processus de l'évaluation d'impact ? Est-il bien pensé ? Nous entendons tant de contestations sur les évaluations d'impact, d'abord parce qu'elles sont très rapides et que le citoyen n'a pas le temps de réagir et de donner son avis. La grille d'analyse de l'évaluation d'impact vous paraît-elle pertinente, suffisamment étayée scientifiquement dans le domaine de la biodiversité ? Permet-elle d'éviter des erreurs ?
L'évaluation d'impact telle qu'elle est réalisée actuellement n'est pas suffisante car elle ne s'intéresse pas aux pressions mais à la biodiversité. Il existe onze millions d'espèces et il est donc impossible de s'intéresser à la biodiversité. La plupart du temps, les études d'impact se focalisent sur un petit nombre d'espèces, par exemple les espèces protégées alors que ce n'est pas la bonne question. Nous voulons éviter des pressions trop importantes sur la biodiversité.
Les études d'impacts devraient se caler sur les cinq pressions directes identifiées par l'IPBES, qui sont assez faciles à appréhender par les industriels :
– le changement d'usage des terres, par exemple, construire une route imperméabilise des terres ce qui constitue un changement majeur ;
– le prélèvement direct des ressources et, en cas de prélèvement, savoir comment elles sont prélevées, si nous pouvons diminuer ce prélèvement, le faire de manière plus durable, par exemple lors de l'exploitation du bois en prélevant un arbre sur dix plutôt que tous les arbres d'une parcelle ;
– le changement climatique, point sur lequel les entreprises sont très avancées ;
– la pollution, point sur lequel nous pourrions agir plus « fort », les industriels qui génèrent des pollutions devant gérer ces impacts ;
– les espèces exotiques envahissantes, en gérant l'impact d'une activité qui permet à ces aux espèces de coloniser de nouveaux milieux.
Ces cinq pressions peuvent assez facilement être prises en compte et nous disposons d'indicateurs pour les mesurer. Les industriels pourraient ainsi s'inscrire sur une trajectoire en prévoyant par exemple de faire de gros changements d'usage des terres et d'artificialisation à un endroit au départ puis de compenser en désartificialisant à un autre endroit qui sera par exemple mis en réserve intégrale. Nous pourrions demander aux industriels de mettre en réserve intégrale une partie de leur territoire, si possible connectée avec d'autres réserves intégrales d'autres industriels. Une telle étude d'impact serait plus efficace que l'étude de la préservation de telle orchidée rare.

C'est la caricature qui en est faite, y compris par certains hommes politiques. Certains croient que la défense de la biodiversité consiste en l'étude des crapauds à petits pois ou de la jacinthe extraordinairement rare et caricaturent à dessein alors que la démarche est beaucoup plus profonde et globale.
Je vous remercie. Cela était passionnant. Vous nous avez détruit le moral, mais cela nous renvoie à nos responsabilités. Il nous reste à agir.
L'audition s'achève à dix-sept heures vingt.