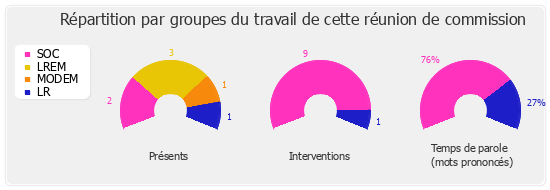Commission d'enquête relative à l'état des lieux, la déontologie, les pratiques et les doctrines de maintien de l'ordre
Réunion du mercredi 9 décembre 2020 à 14h30
Résumé de la réunion
La réunion
La séance est ouverte à 14 heures 30.
Présidence de M. Philippe Michel-Kleisbauer, vice-président.
La Commission d'enquête entend en audition Mme Sylvie Hubac, présidente de la section de l'intérieur du Conseil d'État, et de M. Francis Lamy, président adjoint de cette section.

Mes chers collègues, nous sommes heureux d'accueillir Mme Sylvie Hubac, présidente de la section de l'intérieur du Conseil d'État et M. Francis Lamy, président adjoint de cette section. Si nos travaux nous ont conduits à auditionner un grand nombre de magistrats judiciaires, il nous a semblé important d'entendre aussi des membres du Conseil d'État. En effet, cette institution – en particulier la section de l'intérieur – veille au respect des droits, en s'assurant que le pouvoir exécutif n'enfreint pas le cadre juridique délimitant son action, notamment en matière de maintien de l'ordre.
La réunion est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale.
Vous aurez la parole pour une intervention liminaire, qui précédera notre échange, sous forme de questions et de réponses.
Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, madame, monsieur, à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».
(Mme Sylvie Hubac et M. Francis Lamy prêtent serment.)
Votre commission s'est donné pour mission d'enquêter sur « l'état des lieux, la déontologie, les pratiques et les doctrines de maintien de l'ordre ». Je m'attacherai à rappeler ce que sont, vus depuis nos fonctions, les principes essentiels auxquels est soumis l'exercice du maintien de l'ordre, son cadre juridique, les nouvelles problématiques auxquelles il est confronté et les réflexions que celles-ci appellent.
Les principes essentiels sont connus. La force publique trouve son ancrage constitutionnel dans l'article 12 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, qui énonce que « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » C'est un bien commun à l'ensemble des citoyens, au service de la défense des libertés, ou de leur rétablissement quand il y est porté atteinte.
S'agissant plus particulièrement de la liberté de manifester, aucun texte constitutionnel ne la consacre, mais le Conseil constitutionnel a reconnu un droit à l'expression collective des opinions en s'appuyant sur l'article 10 de la déclaration des droits de l'Homme. Ce droit doit être concilié avec la préservation de l'ordre public, qui est un objectif de valeur constitutionnelle. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), pour sa part, n'affirme pas la liberté de manifestation en tant que telle, mais fait découler des articles 9, 10 et 11 de la convention européenne le droit à la liberté de réunion pacifique. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions qu'à la condition que celles-ci soient prévues par la loi, poursuivent un but légitime, soient nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire fondées sur des motifs pertinents et suffisants.
Je rappelle que le maintien de l'ordre est une mission de police administrative générale, qui relève exclusivement de l'État. Il n'est pas au nombre des missions de la police municipale, et la Constitution exclut que des agents de sécurité privée y participent. Dans l'exercice de cette mission de police administrative, les unités de police ou de gendarmerie qui interviennent n'ont pas le pouvoir de décision : le décideur est l'autorité civile, qui est toujours identifiable et responsable devant le Gouvernement, mais aussi l'opinion et les élus. Le maintien de l'ordre est, on le sait, un art tout d'exécution ; il constitue une mission délicate. L'emploi de la force est soumis – la jurisprudence du Conseil d'État, dans ses fonctions consultatives comme contentieuses, y fait très souvent référence – aux principes cardinaux de la nécessité, de la proportionnalité – à tout moment et, plus particulièrement, dans le feu de l'action –, de la gradation et de la réversibilité. L'article R. 434-18 du code de la sécurité intérieure dispose que « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi seulement lorsque c'est nécessaire et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité […] ». Il ne doit, en somme, pas confondre l'usage de la force et l'arbitraire.
Si, enfin, le maintien de l'ordre est une opération de police administrative, son articulation avec la police judiciaire est indispensable, tant dans la phase préparatoire à des manifestations que dans sa phase d'exécution – notamment en matière de judiciarisation, si des violences sont commises.
Le cadre juridique du maintien de l'ordre est un régime de liberté : celui de la déclaration, fixé par l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure. La formalité de la déclaration a pour objet de permettre le dialogue et la négociation sur le déroulement de l'événement. Le préfet dispose d'un pouvoir d'interdiction, qui est utilisé en dernier recours, en cas de risque de trouble grave à l'ordre public, sous le contrôle du juge. La manifestation non déclarée ne peut être dispersée, quant à elle, que si elle trouble l'ordre public, après deux sommations. Le rassemblement devient alors un attroupement et ses participants peuvent être pénalement poursuivis. Des peines complémentaires d'interdiction de manifester peuvent être prononcées par le juge judiciaire en cas de condamnation pour faits de violence ou de dégradation commis sur la voie publique. Depuis la loi du 21 janvier 1995, il est possible d'installer un dispositif de vidéosurveillance provisoire lors des manifestations et d'interdire, dans les vingt-quatre heures qui précèdent, le port et le transport d'objets pouvant constituer une arme.
Depuis quelques années, le maintien de l'ordre est confronté à de nouvelles problématiques ; j'en discerne quatre principales. Premièrement, on voit apparaître de nouvelles formes d'expression collective dans l'espace public, souvent sans déclaration ni organisateur identifié. Deuxièmement, on constate la participation aux manifestations d'individus ou de groupes d'individus extrêmement violents ; la rue se transforme parfois en véritable champ de bataille. Troisièmement, l'usage de la force est sans doute socialement moins bien accepté. L'opinion manifeste souvent le refus de la violence. La dernière évolution importante est celle des technologies, techniques et outils opérationnels employés par les forces de l'ordre, qu'il s'agisse des armes non létales, des nouvelles technologies de surveillance ou d'internet et des réseaux sociaux, qui ont contribué à une couverture quasi-systématique des manifestations en temps réel et à des regroupements à la fois spontanés, agiles et massifs.
La loi du 10 avril 2019 a tenté d'apporter des réponses et de donner de nouveaux instruments légaux d'autorité, afin de mettre hors d'état de nuire les casseurs et les agresseurs. On peut citer trois mesures fortes : la possibilité, sur la réquisition du procureur, de procéder à des fouilles visuelles des personnes et au contrôle des sacs à l'entrée d'un périmètre délimité, six heures avant le début de la manifestation ; la création d'un délit puni d'un an d'emprisonnement pour ceux qui dissimulent partiellement ou complètement leur visage ; la possibilité pour l'État de se retourner contre les casseurs. Le Conseil constitutionnel a toutefois invalidé la création d'une interdiction administrative de manifester.
A priori, on peut penser que le dispositif – qui se déploie sous le contrôle du juge administratif et du juge judiciaire – est assez complet et adapté. Des évolutions sont toutefois possibles dans deux domaines.
Sur le plan juridique, il est peut-être envisageable de réétudier la création d'une interdiction administrative de manifester, car le Conseil constitutionnel a sans doute laissé un espace ouvert. Un deuxième outil se trouve dans le projet de loi adopté ce matin en conseil des ministres : l'élargissement des motifs de dissolution des groupements de fait, notamment à ceux qui provoquent à des « manifestations armées » – premier motif énoncé dans le texte – mais aussi à des « agissements violents contre les personnes et les biens ». Le troisième outil qui pourrait se révéler utile est l'encadrement – prévu par la proposition de loi sur la sécurité globale – des caméras embarquées, qui doivent être un instrument d'appui au commandement, dans la mesure où elles sont utilisées à une échelle « macro ». Enfin, on pourrait réfléchir à l'ajout d'une mesure sur le maintien de l'ordre dans les dispositions relatives à la déontologie des membres des forces de l'ordre.
Sur le plan opérationnel, il peut être envisagé de moderniser la formation au maintien de l'ordre ; cela peut concerner tant les autorités civiles que celles de police et de gendarmerie. Il faut par ailleurs renforcer la coopération entre la police et la justice – c'est un sujet capital, souvent rappelé –, en essayant de dégager des moyens pour juger plus vite, notamment au moyen des comparutions immédiates. On sait toutefois que, dans la pratique du maintien de l'ordre, c'est parfois difficile. L'objectif à poursuivre consiste à juger plus rapidement ceux qui commettent des violences manifestes dans l'espace public, car l'opinion ne peut comprendre ni accepter l'impunité ou le retard dans la sanction.
Dans mes anciennes fonctions préfectorales, j'ai eu à gérer quelques opérations de maintien de l'ordre. En France, ce dernier relève de la responsabilité du préfet, de l'autorité civile de l'État, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Ça me paraît être un des fondements de l'ordre public républicain. La distinction entre l'autorité préfectorale et l'autorité de police est essentielle. Il y a une répartition des rôles. L'autorité de police ou le colonel de gendarmerie est le professionnel de la manœuvre, sur lequel s'appuie le préfet. Ce dernier – ou son directeur de cabinet – dimensionne le dispositif, négocie avec les interlocuteurs ou essaie de les trouver. Avec le procureur, il décide de l'organisation de la judiciarisation, qui est devenue un élément fondamental alors que, pendant de nombreuses années, elle était absente. C'est même devenu une exigence, car des atteintes sont portées non seulement aux biens et aux personnes, mais aussi à la liberté de manifestation, par les groupes s'introduisant dans les cortèges pour semer le désordre. La réponse judiciaire est très importante, et doit être parfaitement adaptée et ciblée. Elle ne doit pas créer de tensions avec les manifestants.
Il y a huit ou neuf ans, déjà, nous étions confrontés à la difficulté de trouver un interlocuteur dans certaines manifestations sur la voie publique. La mode était alors aux « apéros géants », par exemple sur la plage ou en plein centre-ville, dans les Alpes-Maritimes, ou à Rennes, ce qui causait des désordres publics majeurs. La question était de savoir comment responsabiliser celui qui était en train de préparer la « manifestation », au sens du code de la sécurité intérieure. J'avais créé un profil Facebook, ce qui avait permis d'entrer en contact avec des gens qui ne lisent pas la presse et ne regardent pas les communiqués de la préfecture. Cela nécessite une certaine dose d'imagination et d'improvisation.
Le préfet, ou son représentant, doit être très présent pour déterminer le dimensionnement de l'opération, cerner le profil de la manifestation. Son rôle est essentiel au moment de lever le dispositif et quand des changements de posture interviennent. Par exemple, la décision de lancer des grenades lacrymogènes est très importante et ne peut incomber au responsable de la police : elle relève du préfet. Celui-ci doit s'impliquer tout en faisant confiance au directeur départemental de la sécurité publique (DDSP), qui est généralement concerné. Le DDSP est le professionnel de la manœuvre, qui doit faire des propositions au préfet. Ce tandem est essentiel, comme celui qui associe le préfet et le procureur. Dans les années 2008 et 2009 ont été créés les états-majors de sécurité, pour traiter les questions de sécurité générale, qui trouvent leur prolongement naturel, aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de préparer une manifestation.

Je souhaiterais vous interroger au sujet de l'article 24 de la proposition de loi relative à la sécurité globale, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, qui a fait couler beaucoup d'encre. Son objet est d'interdire la diffusion d'images permettant d'identifier des policiers ou des gendarmes dans un but malveillant, sans préjudice du droit d'informer. Cette disposition vous semble-t-elle pertinente ? Est-elle de nature à renforcer la sécurité des forces de l'ordre tout en préservant la liberté de l'information ?
Nous avons examiné l'article 25 du projet de loi confortant les principes républicains – l'avis a été publié. Cet article crée dans le code pénal un délit consistant à révéler, diffuser ou transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne dans le but de l'exposer à un risque immédiat d'atteinte à son intégrité physique ou psychique. C'est une infraction punie de trois ans d'emprisonnement, ou cinq ans lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique.
Cette disposition est en réalité beaucoup plus large que l'article 24 de la proposition de loi, puisqu'elle concerne toute personne pouvant être l'auteur des révélations et animée par l'intention de nuire. La peine est aggravée si la personne visée est dépositaire de l'autorité publique. Nous n'avons pas identifié d'obstacles, au regard du principe de légalité des délits et des peines, à l'insertion de cette disposition dans le code pénal. Elle pourrait toutefois se heurter à des difficultés d'application, puisque l'auteur doit manifester l'intention particulière d'exposer une personne à un risque d'atteinte à son intégrité physique ou psychique, ce qui peut être difficile à démontrer. L'auteur de l'infraction pourrait être un journaliste, dès l'instant où l'intention de nuire est démontrée.
La question de l'articulation entre cette disposition et l'article 24 de la proposition de loi se pose, puisque ce dernier se trouve, dans une certaine mesure, contenu dans l'article 25. Un second problème tient à la question de la répression, puisque les deux délits ne sont pas du tout punis des mêmes peines.
L'article 24 ne vise pas les mêmes incriminations : il réprime l'intention malveillante résultant du fait de filmer des policiers dans le but « manifeste » – c'est ce que prévoit la dernière rédaction du texte – de porter atteinte à leur intégrité physique ou psychique. On ne peut pas ne pas souscrire à une telle incrimination. Certains se sont posé la question du droit d'informer : il me semble qu'il reste entier, d'autant que le délit est créé dans la loi sur la liberté de la presse, et non dans le code pénal.
Mais l'interprétation qu'en ont faite certains est sans doute juste : créer une interdiction de diffuser les images des forces de l'ordre peut conduire ces dernières à interdire, de fait, l'utilisation d'équipements permettant l'enregistrement d'images. L'article posait donc plus de difficultés dans son application que dans ses principes.

Notre collègue rapporteure George Pau-Langevin ayant été nommée adjointe à la Défenseure des droits, elle a quitté le Parlement il y a trois semaines. Étant également membre de la commission d'enquête depuis le début de ses travaux, je l'ai remplacée. Il y a cinq ans, j'avais déjà participé à une commission d'enquête portant sur le maintien de l'ordre.
Pouvez-vous nous préciser la fréquence des recours formés contre les interdictions administratives de manifester ? Quels éléments sont pris en compte par le juge administratif dans l'examen de ces recours ? Récemment, une interdiction de manifester a été levée par le juge administratif. De telles annulations sont-elles fréquentes ?
La faculté laissée à l'autorité administrative d'interdire tardivement des manifestations ne remet-elle pas en cause l'exercice d'un droit de recours effectif ? Quand l'interdiction est prononcée quelques heures à peine avant la manifestation, comment la contester ? Peut-on saisir un juge aussi tardivement ?
Je n'ai pas de statistiques sous les yeux, mais nous pouvons essayer d'en obtenir et vous les communiquer. Je pense qu'il y a peu d'interdictions de manifestations car cela reste une arme à laquelle les préfets recourent de manière extrêmement mesurée. En vue de cette audition, j'ai fait des recherches dans la jurisprudence du Conseil d'État concernant des décisions rendues sur des interdictions de manifester. Au cours des dernières années, je n'en ai pas trouvé. Peut-être y en a-t-il davantage au niveau des tribunaux administratifs ou des cours administratives d'appel ?
Comme dans toutes les matières de police, le contrôle du juge sur de telles décisions est cardinal : il analyse la nécessité de l'interdiction et le caractère adapté de la mesure ; il vérifie si elle est justifiée au regard des très graves troubles à l'ordre public qui auraient pu se développer si l'interdiction n'avait pas été prononcée.
Vous avez fait allusion à une décision récente du Conseil d'État, intervenue dans un cas assez particulier – lors de l'état d'urgence : le juge des référés a suspendu une décision du Premier ministre prise dans le cadre de ses pouvoirs exceptionnels, et qui l'avait conduit à interdire préventivement toute manifestation. Le juge a considéré que cette interdiction n'était pas justifiée puisque le code de la sécurité intérieure prévoit un système de déclaration et la possibilité pour le préfet d'interdire une manifestation, en tant que de besoin. Une interdiction réglementaire absolue et générale est donc illégale et non justifiée. En outre, le juge des référés a relevé qu'on pouvait parfaitement laisser des manifestations se dérouler grâce aux gestes barrières et à des protocoles d'organisation, alors même qu'on était en état d'urgence sanitaire.
J'ai regardé rapidement dans notre base de données et je confirme les propos de la présidente, il y a assez peu d'interdictions. Nous pourrons demander des statistiques à la section du contentieux et vous les faire parvenir.
Les préfets recourent rarement à l'interdiction. Bien sûr, elle va de soi quand il s'agit de provocations. C'est le cas lorsque des manifestants identitaires déposent une demande de manifestation pour organiser un apéritif rosé-porchetta à la sortie de la mosquée. C'est plus complexe en cas de risques importants de troubles à l'ordre public : le préfet doit-il faire prévaloir la liberté de manifestation, ou pas ? Il doit apprécier les circonstances et, s'il a le sentiment que la manifestation peut entraîner d'importants dommages, il peut être amené à l'interdire. Ce fut le cas il y a quelques années : des manifestations pour la Palestine se répétaient, et se déroulaient très mal. Il n'y avait pas vraiment d'organisateur, ni de service d'ordre, ou l'organisateur donnait l'impression d'être complètement débordé.
Une décision de ce genre n'est jamais facile à prendre. Interdire une manifestation, c'est courir le risque qu'elle se déroule quand même ; ne pas le faire vous expose – à juste titre ‑, si elle crée des désordres, aux protestations des élus de la ville concernée. Si les décisions d'interdiction sont rares, c'est que le dilemme est complexe et l'évaluation se fait au cas par cas.

Nous l'avons constaté lors des manifestations des Gilets jaunes. De semaine en semaine, dans certains lieux, elles étaient quasi systématiquement l'occasion de débordements de violence. Un tel raisonnement aurait alors pu s'appliquer, mais cela restait délicat…
Oui, car la liberté est la règle et la police, l'exception.

Madame Hubac, vous avez évoqué le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale, applicable depuis 2014. Ses dispositions vous semblent-elles suffisantes pour garantir l'indispensable relation de confiance entre la population et les forces de l'ordre ? Devrait-il faire l'objet de modifications ? Vous avez notamment parlé d'éléments relatifs au maintien de l'ordre. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Le code de déontologie comporte des dispositions de nature à assurer une relation de confiance entre la population et les forces de police ou de gendarmerie. Il explique le comportement requis vis-à-vis de la population. Les règles existent donc.
S'ils évoquent l'emploi de la force ou encore les relations de courtoisie, les articles du code de la sécurité intérieure qui constituent ce code ne comportent pas vraiment de dispositions relatives à la déontologie dans les opérations de maintien de l'ordre. Compte tenu du contexte actuel, il conviendrait peut-être d'expliciter le comportement attendu des forces de gendarmerie et de police dans les opérations de ce type.

C'est une idée que nous pourrions creuser ; je vous remercie. Dans une décision du 24 juillet 2019, le Conseil d'État a estimé que le recours aux lanceurs de balles de défense (LBD) dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre ne portait pas une atteinte excessive à la liberté de manifestation et à la liberté d'expression. Pouvez-vous expliquer les motifs de cette décision ?
Certes, les LBD n'empêchent pas les manifestants de se rassembler. Mais, quand ils sont rassemblés et que des incidents interviennent, les tirs de LBD, parfois au milieu de la foule, peuvent provoquer de graves dommages – je le dis sans aucune acrimonie. Or les personnes ne sont coupables que de manifester à un moment où la manifestation n'est pas encore terminée.
Le litige ne portait pas sur un cas spécifique d'usage de LBD mais sur les textes qui permettent d'en faire usage. Le Conseil a considéré que le législateur et le pouvoir réglementaire avaient clairement défini les conditions d'usage de ces armes : il ne peut en être fait usage qu'en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Les règles elles-mêmes ne sont pas contestables, l'encadrement de leur usage étant légitime et adapté.
À partir du moment où la doctrine d'emploi de ces armes énumère de façon limitative les circonstances dans lesquelles elles peuvent être utilisées, on ne peut suspecter les agents de la police nationale ou les gendarmes de ne pas faire usage de leurs armes dans le respect de ces conditions. Le cadre réglementaire n'appelle donc pas de censure.
C'est cela. La situation serait différente en cas d'emploi inapproprié de telles armes dans une manifestation. On pourrait alors, éventuellement, aller jusqu'à rechercher la responsabilité de l'État pour faute lourde dans l'exercice des opérations de maintien de l'ordre.
Vous avez tout dit, madame la présidente. Le Conseil d'État a considéré que le refus d'abroger l'instruction ministérielle de 2017 qui encadre l'usage des LBD n'était pas illégal, pour les raisons que vous venez de rappeler, cet usage étant strictement encadré en termes de proportionnalité et interdit à l'encontre de personnes en situation de vulnérabilité. Il a estimé que l'instruction ne méconnaissait pas les articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui interdisent les comportements violents et la torture.
Il s'agit d'une application classique de la jurisprudence, le Conseil d'État ayant analysé les dispositions de l'instruction au regard du recours déposé et les ayant jugées proportionnées et adaptées.
Je compléterai par un autre exemple : à l'inverse, en 2008, alors que j'étais présidente de la chambre du contentieux qui jugeait cette affaire, nous avons annulé un décret autorisant des agents de police municipale à se servir de pistolets à impulsion électrique, considérant qu'il s'agissait d'armes nouvelles, dont le maniement était complexe, et qui présentaient des dangers. Nous avions estimé que leur usage devait être très précisément encadré et contrôlé et que tel n'était pas le cas, puisque les agents de police municipale n'étaient pas suffisamment formés pour s'en servir de manière proportionnée et adaptée.

Dans une décision du 27 octobre dernier, le Conseil d'État a considéré que le fait que l'obligation de se disperser soit applicable aux journalistes présents dans un attroupement ne constitue pas une « atteinte grave et immédiate » aux « conditions d'exercice du métier de journaliste et à la liberté d'informer ». En clair, si des journalistes sont présents dans un attroupement et que les forces de l'ordre ordonnent la dispersion, ils doivent obtempérer de la même manière que les autres individus présents sur place. Je considère pour ma part qu'un journaliste n'a pas exactement dans la même position qu'un manifestant. Comment justifiez-vous cette décision ?
Je ne l'ai pas sous les yeux, mais je pense que le juge administratif a tenu compte des risques liés à la situation. Une opération de dispersion peut s'accompagner de violences, dégénérer. Tous ceux qui se trouvent sur place doivent donc respecter les sommations. Je comprends tout à fait la position que vous défendez, monsieur le rapporteur, mais faut-il laisser des journalistes courir de tels risques ?
Pendant que la présidente Hubac vous répondait, j'ai eu le temps de chercher la décision en question. Je peux donc apporter un complément à ce qu'elle vient de dire.
Les requérants contestaient le paragraphe du schéma national du maintien de l'ordre, rendu public le 16 septembre 2020, aux termes duquel, lors de la dispersion d'un attroupement, il n'y a pas lieu d'établir de distinction entre les journalistes et les manifestants. Dans sa décision, le Conseil d'État s'est fondé sur l'article 431-4 du code pénal, qui ne prévoit aucune exception : « Le fait […] de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement ». Le Conseil relève que, sur ce point, le schéma national du maintien de l'ordre ne fait donc que rappeler la loi.

Il convient sans doute de la modifier un peu, car le fait qu'il ne puisse plus y avoir aucun témoin extérieur lors des opérations de maintien de l'ordre interroge. Les journalistes sont là pour porter témoignage – dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Il est toujours utile d'avoir des observateurs sur le terrain.
Un débat a lieu autour de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et, dans une moindre mesure – je la mentionne pour le parallélisme des formes –, de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), chargées de contrôler l'action des forces de l'ordre. Les fonctionnaires de police et les militaires qui siègent dans ces instances sont conduits à mener des enquêtes sur leurs propres collègues. Quel regard portez-vous sur leur objectivité et leur neutralité ? Je ne prends pas parti et n'incrimine personne : encore une fois, le débat est dans la sphère publique. Avez-vous des réflexions relatives à la nécessité d'assurer une indépendance organique et administrative réelle de ces organes par rapport aux directions de la police et de la gendarmerie ?
J'ai cru comprendre que le Président de la République s'était exprimé en ce sens : il a appuyé l'idée d'un contrôle externe.

Nous pouvons alimenter la réflexion du Président de la République en même temps que la nôtre !
Non seulement le débat est sur la place publique, mais apparemment des décisions vont être prises. Pour ma part, je pense que contrôle interne et contrôle externe doivent se combiner pour permettre la plus grande objectivité dans l'analyse de ce qui s'est passé et de ce qui a posé problème. L'idée d'un contrôle externe aux forces de gendarmerie et de police me semble donc devoir être développée. Du reste, cette fonction est déjà exercée, en partie, par le Défenseur des droits, dont le rôle en matière de déontologie est important. On peut imaginer que sa compétence soit élargie.

La notion d'attroupement, telle que la définit le code pénal, peut entraîner une confusion dans l'esprit des manifestants, et même dans celui des journalistes. En effet, comme vous l'avez rappelé, un rassemblement devient un attroupement dès lors qu'il est « susceptible de troubler l'ordre public ». Pensez-vous, comme le suggérait le rapporteur, qu'il conviendrait de clarifier la notion, de la définir plus précisément ?
Non seulement le code pénal définit ce que sont les attroupements, mais il décrit la procédure destinée à les disperser. En revanche, il n'y est pas question de la riposte graduelle qui peut s'avérer nécessaire face à une manifestation, notamment à la fin, puisque c'est souvent là que surgissent les problèmes. Une clarification est peut-être nécessaire. Cela permettrait de lever certaines interrogations, de dissiper certaines ambiguïtés.
C'est une question difficile. L'article 431-3 du code pénal dispose : « Constitue un attroupement tout rassemblement […] susceptible de troubler l'ordre public. » On peut se demander pourquoi il n'est pas écrit « qui trouble l'ordre public », même si, en fait, il n'est pas certain que cela changerait fondamentalement les choses : cette rédaction laisserait elle aussi une part d'appréciation subjective. Il est vrai néanmoins que le curseur serait alors placé de manière un peu différente. Je me demande quelles conséquences cela aurait, notamment sur les fins de manifestation, dont parlait la présidente Hubac. Une fois que l'heure limite a été atteinte, la manifestation est terminée : si elle se poursuit, elle se transforme en attroupement. Quand les choses se passent bien, les forces de l'ordre annoncent la fin de la manifestation et invitent les participants à se disperser, et ces derniers le font. Il n'est pas certain que les préfets auraient la même latitude pour demander la dispersion une fois la manifestation terminée si l'on remplaçait les mots « susceptible de troubler l'ordre public » par les mots « qui trouble l'ordre public ».

Merci, madame la présidente, monsieur le président adjoint, pour ces exposés : j'y ai retrouvé la clarté propre aux conseillers d'État, à laquelle je prenais plaisir chaque fois que, dans ma vie d'avocat, j'accompagnais des confrères avocats aux conseils. C'est toujours un plaisir de suivre les débats du Conseil d'État.
Je voudrais vous interroger à propos de la gestion en amont des manifestations. Nous sommes tous très choqués par les violences commises par les black blocs ou assimilés. Elles posent la question suivante : comment se fait-il, alors que le renseignement territorial a identifié une bonne partie de ces individus, que l'on n'a pas pu les mettre hors d'état de nuire avant la manifestation ?
En 2019, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 3 de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, qui prévoyait notamment la possibilité pour l'autorité administrative d'assigner à résidence des personnes susceptibles de causer un trouble à l'ordre public. J'aurais souhaité savoir, au regard de l'expérience du Conseil d'État dans un domaine où les principes généraux du droit rejoignent peu ou prou le bloc de constitutionnalité, quelle solution vous pourriez envisager, à droit constitutionnel constant. Il s'agit d'éviter, en passant si besoin par la voie législative, que des black blocs identifiés comme tels participent à des manifestations, avec pour résultats les dégâts que l'on a vus. Par ailleurs, certains ont proposé, pour prévenir les agissements de ces personnes, de leur appliquer les dispositions de la législation antiterroriste. Même si, à titre personnel, je ne suis pas favorable à cette idée, je suis intéressé de connaître l'avis des éminents experts du droit que vous êtes.
Je laisserai à Francis Lamy le soin de vous répondre concernant la législation antiterroriste, dont il est un grand spécialiste.
S'agissant de votre première question, il y a, d'une part, ce qui est permis par le droit, et, d'autre part, ce qui pourrait l'être si l'on remettait l'ouvrage sur le métier.
Il est possible d'effectuer un certain nombre de contrôles. Sur réquisitions du procureur de la République, des contrôles visuels et des fouilles peuvent être organisés dans un périmètre de protection, ce qui permet d'arrêter certaines personnes animées par des intentions violentes et de les empêcher de rejoindre la manifestation. C'est ce qui s'est passé, notamment lors du mouvement des Gilets jaunes, aux points d'accès aux manifestations et dans les gares. Malheureusement, ces contrôles sont insuffisants.
Ce que l'on pourrait envisager de faire, comme je le disais dans mon propos liminaire, c'est de travailler de nouveau sur l'interdiction administrative de manifester. En effet, si le Conseil constitutionnel a censuré la disposition, il n'a pas fermé complètement la porte. Il a relevé, dans sa décision, que l'interdiction prononcée par la loi anticasseurs de 2019 n'était pas conforme à la Constitution pour plusieurs raisons.
Premièrement, il était possible, sur le fondement de ce texte, d'interdire à une personne de manifester sans avoir apporté la preuve qu'elle avait commis des violences lors d'une manifestation antérieure.
Deuxièmement, le législateur n'avait pas imposé que la manifestation à laquelle il s'agissait d'interdire l'accès présente des risques avérés de troubles à l'ordre public.
Troisièmement, l'interdiction de manifester n'était pas assez circonscrite dans le temps et dans l'espace. D'une part, il n'était pas obligatoire de s'appuyer sur des faits récents commis par la personne pour prononcer l'interdiction. D'autre part, celle-ci pouvait durer un mois et concerner l'ensemble du territoire national.
Sur ces trois points, des réglages peuvent être envisagés. Il me semble donc possible de réfléchir de nouveau à l'interdiction administrative de manifester.
Monsieur Thiériot, la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT) permet effectivement de prononcer des assignations à résidence et de définir des périmètres de protection, mais ces dispositions ne sont pas applicables aux black blocs, car je ne pense pas que l'on pourrait qualifier ces derniers de membres d'une organisation terroriste – en tout cas, cette qualification serait extrêmement fragile.
En ce qui concerne la possibilité d'instaurer une interdiction administrative de manifester tout en respectant la décision du Conseil constitutionnel, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Mme la présidente Hubac. J'insisterai également, pour ma part, sur l'importance des décisions d'interdiction judiciaire de manifestation, car la législation en la matière s'est beaucoup enrichie ces dernières années. Cela suppose de judiciariser le plus possible les troubles graves suscités par certains individus à l'occasion de manifestations. Il est vrai qu'il est très difficile d'établir des procès-verbaux lors d'une manifestation, car la situation peut être extrêmement confuse. Toutefois, ce sont des unités spécialisées qui le font, et non les agents chargés du maintien de l'ordre, comme le prévoit à juste titre le code de procédure pénale – car on ne peut pas être à la fois juge et partie. Il est d'autant plus important de judiciariser ces faits que, depuis la loi de 2019, leurs auteurs peuvent être inscrits au fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires. À cela s'ajoutent les nouvelles possibilités de contrôle à l'occasion de manifestations – fouilles, contrôles d'identité –, sur réquisitions du procureur.

Le nouveau schéma national du maintien de l'ordre prévoit que des magistrats « peuvent être invités à être présents dans certains lieux de décision », tels que les salles de commandement. En tant que magistrats de l'ordre administratif, pensez-vous que votre place est dans ces lieux ?
Personnellement, non, je ne le pense pas.
Tout au plus le préfet peut-il inviter le procureur – et encore, cela dépend de la relation qu'ils entretiennent. Le procureur peut se rendre dans la salle de commandement, mais il ne le fera pas spontanément, sauf en cas d'opérations de judiciarisation importantes nécessitant qu'il donne des directives. En ce qui concerne les autres magistrats, non, leur place ne me semble pas être là. Il y a, à mon avis, un risque de confusion.

Merci pour vos explications. Nous allons tâcher de nous en servir pour formuler des propositions de nature à faire avancer la réflexion et progresser le bien commun.

Merci beaucoup pour ces explications, qui, comme le disait Jean-Louis Thiériot, étaient comme toujours impeccables.
Chers collègues, je vous rappelle que nous nous retrouverons à seize heures trente pour l'audition de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve.
La séance est levée à 15 heures 35.
Membres présents ou excusés
Présents. - Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Marietta Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Philippe Michel-Kleisbauer, Mme Cécile Rilhac, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Laurence Vanceunebrock.