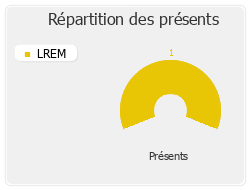Commission d'enquête sur l'évaluation des politiques publiques de santé environnementale
Réunion du jeudi 15 octobre 2020 à 11h30
Résumé de la réunion
La réunion
L'audition débute à douze heures.

M. Rémy Slama, vous êtes docteur en épidémiologie, polytechnicien et ingénieur agronome. Épidémiologiste environnemental, vous dirigez l'institut thématique Santé publique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), qui coordonne la communauté scientifique en ce qui concerne le fonctionnement et la gestion du système de santé en matière de prévention, diagnostic et prise en charge des pathologies, les politiques publiques et leur impact sur la santé, les politiques de prévention dans les domaines où les risques pour la santé sont liés à des comportements individuels ou collectifs, notamment la nutrition. Vous êtes expert auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) au sein du comité des risques environnementaux de la Commission européenne et vous êtes membre du Conseil scientifique de Santé Publique France. Votre audition à titre d'expert, de scientifique et de représentant de l'INSERM nous est donc précieuse dans le cadre de cette commission d'enquête.
Quel est l'état des connaissances dans le domaine de l'épidémiologie environnementale ? Quelles sont les pistes de recherche prometteuses ? Quels sont la place et le rôle de l'INSERM dans ces recherches ?
(M. Rémy Slama prête serment).
Je précise que l'institut thématique de Santé publique de l'INSERM que je dirige est en charge de la recherche sur ces thématiques de santé publique que vous avez évoquées et non de l'ensemble de la coordination de ces politiques publiques. Toutefois, mon propos introductif sera général et concerne également ces dernières.
Les travaux que je mène dans le cadre de mes recherches sont soutenus par des fonds publics français ou européens. Je n'ai pas de conflit d'intérêts à déclarer. Une large partie de mon propos correspond davantage à mon avis d'expert plutôt qu'à une position officielle de l'INSERM sur ces questions assez réglementaires.
Je voudrais commencer par cette image du Docteur Frances Kelsey qui reçoit une distinction du Président Kennedy dans les années soixante pour avoir mis en doute l'innocuité de la thalidomide et refusé sa mise sur le marché aux États-Unis, évitant ainsi la survenue de nombreux cas de malformations congénitales dues à cet antinauséeux malheureusement prescrit en Europe pendant la grossesse et que nous n'avions pas interdit. Cette image symbolise bien une décision publique guidée par la science. Pour que cette situation soit la règle, il faut une science et des lois fortes.
Le champ de la santé environnementale est extrêmement vaste. Les déterminants environnementaux de la santé au sens large incluent les facteurs sociaux, les agents infectieux, les facteurs physiques comme le bruit et les rayonnants ionisants et non-ionisants, les facteurs météorologiques, le changement climatique et les facteurs chimiques avec plus de 23 000 substances qui sont mises sur le marché et commercialisés au-delà d'une tonne dans l'Union européenne en excluant les champs des médicaments et des pesticides et en ajoutant les agents et les substances naturels.
Certains de ces facteurs ont un effet sur la santé qui peut être présumé, suspecté ou clairement démontré. Un chemin nous mène de la production de la connaissance sur ces effets sanitaires éventuels à la prise en compte du risque pour le bien-être de la société. Les organismes de recherche tels que l'INSERM, le centre national de la recherche scientifique (CRNS), les universités et l'institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) produisent des connaissances qui sont synthétisées schématiquement, notamment par les agences sanitaires avec, en premier lieu, l'Anses en France dans le champ qui nous intéresse, et diffusées vers la société par de nombreux acteurs. L'INSERM y contribue avec un pôle d'expertise collective qui synthétise et diffuse les connaissances, notamment dans le champ de l'environnement. La réglementation est ensuite modifiée selon les principes fixés par la loi. Nous avons quitté le domaine de la science pour nous diriger vers celui du politique. Ces décisions auront des répercussions à différentes échelles nationales ou locales.
S'agissant de la production des connaissances, il est nécessaire de mieux financer la recherche publique en santé environnementale. Je souhaite évoquer le « combien », et j'estime que les besoins ne sont nullement à la hauteur des enjeux, mais également le « comment », avec la problématique d'identification d'un mécanisme qui permettrait de rendre les moyens de cette recherche proportionnés au besoin.
Nous travaillons dans une approche interdisciplinaire à toutes les échelles, soit de la molécule à la population, dans le domaine de l'épidémiologie, de la toxicologie, des sciences humaines et sociales, de la biologie fondamentale et des biostatistiques. Nos chercheuses et nos chercheurs s'appuient sur de nombreuses cohortes et autres infrastructures comme des biobanques qui contribuent à cette thématique. Ces cohortes concernent l'exposome, les polluants atmosphériques et les pesticides, avec des travaux en Bretagne et aux Antilles concernant le chlordécone.
Une quinzaine d'équipes sont spécifiquement dédiées à ces thématiques et ont, au cours des années passées, contribué à de nombreuses questions importantes comme celle des liens entre le chlordécone et la santé, l'alimentation bio et la santé, l'impact des éthers de glycol, des perturbateurs endocriniens et des pesticides organophosphorés sur le développement. Nous avons fourni un rapport de préfiguration Recherche pour la 4ème Plan Santé Environnement. Notre pôle d'expertise collective travaille sur la question des pesticides et des rayonnements ionisants. Nous avons produit un rapport pour le Parlement européen sur les perturbateurs endocriniens.
L'INSERM co-coordonne deux des neuf projets européens actuels sur l'exposome, ainsi que l'un des sept projets sur les perturbateurs endocriniens. Nous coordonnons également le projet ERA qui vise à définir les priorités de recherche en santé environnementale en Europe. L'INSERM est le premier organisme de recherche en Europe par sa taille qui est uniquement dédié à la recherche biomédicale et qui occupe une part significative de ses efforts sur la question de la santé environnementale.
L'un des rôles de cette recherche consiste à guider au mieux la décision publique, laquelle s'est longtemps inscrite dans une logique consistant à avoir des certitudes absolues du danger avant de prendre une décision, ce qui, dans un contexte où la science était peu soutenue et où les conflits d'intérêts n'étaient pas toujours prévenus, pouvait prendre un temps considérable. En témoignent les décisions tardives concernant l'interdiction de l'amiante ou du plomb dans l'essence en 2000, soit vingt ans après les États-Unis.
Depuis le début du XXIème siècle, le principe de précaution est entré dans la Constitution française et les textes fondateurs de l'Union européenne. Il impose que l'incertitude scientifique ne soit plus mise en avant pour ne pas prendre des mesures visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement. Il s'applique aussi aux problèmes de santé.
En pratique, dans un contexte où la science est faible, la production de certitudes est lente et quantitativement limitée, ce qui conduit les décideurs à prendre des décisions fondées sur un nombre restreint de connaissances dans une situation d'incertitude. Ce fonctionnement nous ferait entrer dans une ère de décisions incertaines qui ne seraient satisfaisantes ni pour les décideurs ni pour les scientifiques et les différents secteurs de l'activité économique concernés qui percevraient certaines d'entre elles comme arbitraires. En revanche, si la science est fortement soutenue, des certitudes sont produites plus efficacement. Le besoin de recours au principe de précaution est moindre et une ère de décisions justes pourrait s'ouvrir.
Un couplage est donc nécessaire entre le soutien à la recherche et le nombre et l'importance des activités qui génèrent des questions de santé environnementale. Un moindre soutien à la recherche conduit à un recours fréquent au principe de précaution et à la prise de décision sur la base d'un nombre limité de connaissances, ce qui est mauvais pour la santé publique ou les activités sociales et économiques.
Des décisions doivent être prises concernant de nombreuses substances. Le financement annuel total disponible en France pour la recherche publique sur les questions de santé environnementale, en excluant les moyens correspondant aux personnels permanents des universités et des organismes de recherche, s'établit probablement entre 15 et 20 millions d'euros annuels. Il convient de mettre ce montant en regard des 23 000 substances présentes sur le marché, ce qui interroge sur la possibilité d'asseoir le financement et de faire en sorte qu'il soit proportionnel au nombre de substances. Un montant de 20 millions d'euros revient à 1 000 euros annuels pour chaque substance, ce qui est peu.
Alternativement ou en complément, il pourrait être choisi d'asseoir le financement des dépenses sur les problèmes de santé comme le développement, le cancer, les maladies cardio-vasculaires et les perturbations endocriniennes, dont une fraction est due à l'exposition aux facteurs environnementaux dans leur ensemble. Il s'agirait de faire en sorte que ces financements soient proportionnels aux dépenses de santé de l'assurance-maladie qui s'élèvent à plus de 200 milliards d'euros. Les dépenses de recherche en santé environnementale représentent moins de 0,01 % de ces dépenses de santé, ce qui est extrêmement faible et nécessiterait probablement d'être multiplié au moins par dix si l'on veut que la science soit capable de courir après tous les effets possibles de ces nombreuses substances sur un grand nombre de pathologies potentielles avec de nombreux mécanismes biologiques sous-jacents. Pour explorer ce champ immense, des moyens beaucoup plus conséquents sont nécessaires.
Cette logique n'est pas absolument originale. Dans le domaine des radiofréquences, une taxe sur les opérateurs de téléphonie mobile génère un montant annuel de 2 millions d'euros qui est distribué par l'Anses pour la recherche sur cette thématique. Les moyens pour la recherche sont proportionnés à l'activité du champ. Il existe aussi une taxe sur les produits phytosanitaires dont une partie est utilisée pour la recherche, mais cette logique ne s'applique pas à l'ensemble des facteurs environnementaux qui posent potentiellement problème.
Ces financements sont pris sur le budget du ministère de la recherche et entrent en compétition avec toutes les autres thématiques et les recherches plus fondamentales sur les fonds marins, la physique fondamentale ou les mathématiques. Par ailleurs, ces financements doivent être structurés sur le long terme. Un étudiant qui débute un Master en santé environnementale deviendra probablement un chercheur autonome recruté au sein d'un organisme de recherche dans huit à douze ans. Pour qu'il se maintienne dans ce champ, il lui faut réussir à obtenir des financements lui permettant de travailler durant toute cette période. Il s'agit d'une recherche coûteuse qui nécessite de nombreuses mesures, des dosages, un suivi de population et des expérimentations longues. Faute d'obtenir ces financements de manière continue, il ne tiendra pas la compétition du passage extrêmement sélectif d'un recrutement de poste de chercheur ou d'enseignant-chercheur face aux collègues des autres disciplines qui sont en concurrence avec lui. Par conséquent, il est important qu'un guichet soutienne cette recherche de manière lisible sur le long terme.
La réglementation et les lois devraient permettre une gestion du risque plus protectrice de la santé publique. Concernant les champs d'application des lois, il faudrait sortir de la logique de fragmentation qui prévaut, avec des décisions prises dans des niches et au cas par cas, et désectorialiser. Concernant la logique de gestion, il conviendrait de renforcer les lois pour que la santé publique soit plus souvent au premier plan ou, a minima, pour que les logiques d'arbitrage entre la santé et les autres intérêts soient plus explicites.
Par exemple, une loi de 2012 interdit le bisphénol A dans les contenants destinés à entrer en contact avec les aliments, laquelle n'est pas satisfaisante. Depuis une vingtaine d'années, des milliers de travaux, notamment toxicologiques, démontrent clairement que cette substance est dangereuse pour la santé, mais cette loi procède d'une logique de niche s'agissant d'une substance spécifique dans le seul secteur de l'alimentation et uniquement pour certains usages, à savoir les contenants alimentaires.
L'idée des députés consistait à protéger et à minimiser l'exposition au bisphénol A. Il faudrait la transposer et la répéter pour les additifs alimentaires, les cosmétiques, les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits chimiques REACH dans leur ensemble et l'air. Cette substance occuperait l'Assemblée à temps plein, mais l'eussiez-vous fait que les chercheurs seraient venus vous parler des bisphénols S et F qui sont aussi préoccupants. Cette logique de fragmentation ne peut être efficace si l'idée est vraiment de minimiser l'exposition au bisphénol A. Au-delà de la fragmentation sectorielle, je citerai la fragmentation par substance. Il conviendrait d'obtenir une formulation englobant le bisphénol A et toutes les substances qui agissent par les mêmes mécanismes, comme les perturbateurs endocriniens, ou les mêmes pathologies.
Une loi sur la qualité de l'air limite les concentrations atmosphériques de benzène à 5 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. Les lois européennes de 2009 et 2012 sur les produits phytosanitaires prévoient que ces derniers ne doivent pas contenir de substances cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ou présentant une activité de perturbation endocrinienne avérée ou supposée. Nous sommes en présence d'une loi plus générale qui raisonne en termes de catégories de danger avec plusieurs classes, à savoir les cancérigènes, les reprotoxiques et les perturbateurs endocriniens que le législateur ne se fatigue pas à détailler, et dans un secteur dans son ensemble avec une logique de gestion très forte puisqu'il s'agit d'une exposition zéro.
La convention internationale de Stockholm, qui a été ratifiée par la France, interdit la production, l'importation et l'exportation de certains polluants organiques persistants (POP). Cette décision englobe toute une classe de dangers. Un travail a été effectué pour valider la liste des substances entrant dans cette catégorie de polluants organiques persistants. La mesure s'applique à l'ensemble des secteurs. Il s'agit de garantir les efforts qui aideront à minimiser l'exposition, même si ce n'est pas suffisant dans la mesure où ces substances sont très persistantes et demeurent présentes dans l'environnement même lorsque l'on a cessé de les produire.
Il existe une gradation de formulations et de lois allant du plus spécifique et fragmenté au plus général et efficace. Il conviendrait que ces lois concernant la santé environnementale soient transectorielles, plutôt qu'en « silo » dans le domaine régalien de chaque ministère et s'inscrivent dans un raisonnement en grandes catégories de danger en réservant le choix d'une certaine logique au Parlement.
La formulation de la loi sur la qualité de l'air est faible et n'aide pas l'Exécutif ni la Justice. Elle dit que l'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Un juge se trouvant face à des citoyens se plaignant de la qualité de l'air peinera à identifier s'il convient de convoquer l'État, les collectivités territoriales ou les personnes privées pour déterminer la responsabilité.
La loi indique que des normes de qualité de l'air sont fixées après avis de l'Anses en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales épidémiologiques. S'agissant des particules fines, l'organisation mondiale de la santé préconise de ne pas dépasser 10 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. Les États-Unis, qui n'écoutent l'OMS que dans une certaine mesure, sont à 12 microgrammes. Le taux de l'Europe est de 25 microgrammes par mètre cube, soit deux fois et demie le niveau recommandé par l'OMS, ce que j'interprète comme la conséquence d'une formulation beaucoup trop faible et peu contraignante.
D'autres formulations sont possibles comme la fixation d'un nombre de décès attribuables aux particules fines à ne pas dépasser. Je ne peux m'empêcher de penser que cette situation contribue au décès de plusieurs dizaines de milliers de nos concitoyens chaque année en raison des effets des particules fines et des autres polluants présents dans l'atmosphère. L'OMS a été écoutée, mais probablement pas entendue.
S'agissant des autres champs de la réglementation, une ambiguïté est constatée dans de nombreux secteurs importants. Il est indiqué que les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir une concentration de substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, ce qui est flou, et être conformes aux limites de qualité définies par un arrêté du ministère chargé de la santé. Le nombre de substances à surveiller et le procédé à mettre en œuvre ne sont pas mentionnés. L'arrêté du ministère de la santé évoque quatre pesticides organochlorés qui sont surveillés, dont la plupart sont interdits de longue date. Cette formulation laisse la porte ouverte à de multiples interprétations. Il en est de même concernant l'alimentation. La réglementation ne prévoit que très peu de sujets où un niveau de risque à ne pas dépasser serait explicitement fixé, par exemple, en nombre de décès ou de pathologies par million d'habitants.
Un contre-exemple porte sur la réglementation concernant les produits phytosanitaires, lesquels ne doivent pas contenir de cancérigènes, de mutagènes, de reprotoxiques ni de perturbateurs endocriniens. Il s'agit d'une logique d'exposition zéro et de gestion extrêmement claire qui est cohérente avec les connaissances sur les perturbateurs endocriniens. D'autres existent, mais le fait de ne pas être explicite laisse une grande marge d'interprétation.
Il est nécessaire d'apporter un soutien plus fort à la recherche en santé environnementale dans une logique de proportionnalité et de durabilité. Il faudrait pouvoir indexer les financements à ce domaine sur une assiette pertinente, qui pourrait être l'Objectif national de dépenses d'assurance-maladie (ONDAM) à un niveau suffisamment élevé, à savoir 0,1 %, ou à la commercialisation des substances potentiellement préoccupantes pour la santé. Il faudrait que ces financements soient structurés sur le long terme. Il n'est pas forcément nécessaire de créer de nouvelles agences en plus de l'Anses et de l'agence nationale de la recherche (ANR), mais il conviendrait de garantir une pérennité au bon niveau.
Il serait intéressant que le financement des projets soit associé à l'animation du champ de recherche comme aux États-Unis. Il faut que les lois s'inscrivent dans la bonne granulométrie avec des principes plus clairs. Il convient de défragmenter et de sortir des logiques substance par substance et secteur par secteur. Les agences sanitaires peuvent indiquer si tel facteur appartient à une catégorie de danger ou une autre. Sauf cas spécifique, il n'appartient pas forcément à l'Assemblée nationale d'entrer dans ce niveau de détail. Il faut renforcer ces lois avec des logiques de gestion beaucoup plus explicites qui garantissent de placer la santé publique au premier plan.

Connaissant le champ de vos interventions, notamment dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, je suis quelque peu frustrée de constater que votre présentation se limite à la recherche et à la critique de la construction de la loi.
Nous avons bien compris que la recherche française est défaillante en matière de financement, ce qui peut créer des cercles vicieux obligeant les chercheurs à solliciter le secteur privé et conduit les conclusions tirées de ces recherches à être parfois contestables ou contestées quant à leur degré d'objectivité. Si nous avions des financements clairement définis de source publique en France, nous n'aurions pas cette défaillance parfois reprochée au monde de la recherche. Par ailleurs, nous avons entendu la manière dont les lois sanitaires qui voudraient bien faire sont parfois lacunaires et se retournent contre la population que l'on cherche à protéger.
Quel jugement global, indépendamment du domaine de la recherche et des documents législatifs, portez-vous sur les politiques de santé environnementale en France ? Dans quelle mesure vous semblent-elles suffisamment efficaces pour faire face au risque sanitaire provoqué par les facteurs environnementaux comme l'alimentation, l'eau, l'exposition aux perturbateurs endocriniens ou la chimie ? Quel regard portez-vous sur la politique actuelle de santé environnementale en France et les PNSE, qui sont les principaux outils officiels de cette politique ?
Le financement de la recherche est peu suffisant, ce qui n'empêche pas les partenariats public-privé, qui, dans certains cas, peuvent être louables. Dans la santé environnementale, certaines collaborations sont fructueuses, mais assez rares chez les chercheurs dont l'objectif est d'étudier les effets des substances.
Dans le contexte de la loi sur la publication des liens d'intérêts qui limite fortement le rapprochement avec le secteur privé, la conséquence réside dans le moindre nombre de chercheurs, lesquels sont toutefois extrêmement rigoureux. Ils présentent une certaine défaillance car ils sont lents, ce qui ne s'explique pas par le fait que des industries leur demanderaient de faire la mauvaise recherche. Je crois que cette époque est révolue.

Mon propos ne visait absolument pas à remettre en cause l'honnêteté intellectuelle des chercheurs. Je me référais simplement à la problématique du glyphosate sur laquelle nous avons entendu tout et son contraire de la part de chercheurs. Certaines publications présentées comme scientifiques ont été sujettes à question par l'opinion publique ou d'autres chercheurs. Il s'agit de la parole des scientifiques.
Vous souligniez la nécessité d'une science forte pour que les décisions politiques le soient également. Toutefois, la confusion et les dissonances que nous avons tous observées sur les plateaux de télévision quant à la COVID, par exemple, laisse pensif sur la coordination de la connaissance entre scientifiques sur des questions beaucoup plus importantes comme les perturbateurs endocriniens.
Il s'agit d'une vaste question. S'agissant de la COVID, le degré d'accord entre les scientifiques ne peut être jugé au niveau des plateaux de télévision. Le premier réflexe des nombreux chercheurs de l'INSERM travaillant sur la COVID consiste à générer des connaissances. Ceux qui se rendent sur les plateaux de télévision sont peut-être ceux qui en ont le temps. Nombre de nos chercheurs n'avaient pas le temps de répondre et ont préféré attendre de pouvoir disposer de connaissances avant de se rendre sur les plateaux de télévision. Les médias ont une certaine habitude à créer des discussions plus tendues en invitant deux personnes de points de vue opposés, ce qui surreprésente certaines opinions minoritaires.
De ce que j'ai pu constater de la gestion de cette crise, mon opinion est que nous avons assisté à des discussions extrêmement intenses et, pour les champs de santé publique que je connais, à une très forte convergence de vues entre les chercheurs de l'INSERM, les agences comme Santé publique France, nos partenaires de l'institut Pasteur, etc.
Je peux concevoir que ce qui circule dans les médias ou sur les réseaux sociaux donne une impression différente, mais en lisant les publications scientifiques, vous pourrez constater moins de désaccords que ce qui peut être ressenti, ce qui interroge sur les moyens de diffusion des connaissances et du temps que les chercheurs sont censés passer. Diffuser étant presque un métier à part entière, je peux tout à fait concevoir que les chercheurs puissent en faire davantage et que les organismes de recherche mettent davantage de moyens sur cette communication.
Je ne connais pas l'ensemble de la littérature sur le glyphosate, mais un effort est fourni par les revues scientifiques, notamment les plus sérieuses. Les Américains sont très avancés et nous publions souvent dans des revues américaines. Chaque personne qui publie doit indiquer ses sources de financement. Les agences accordent plus ou moins de poids à un travail selon l'origine du financement, ce qui ne signifie pas que les travaux émanant de l'industriel qui produit la substance en question ne sont pas considérés, mais un moindre poids leur est potentiellement attribué au profit des travaux indépendants.
Il se peut que je sois un peu trop optimiste en affirmant que les lois et les évolutions récentes conduisent à une diminution des conflits d'intérêts. Le fait que les scientifiques ne soient pas d'accord est lié à la façon dont nous générons nos connaissances en partant du doute pour parvenir à la certitude. L'exploration de l'ensemble des hypothèses alternatives permet de se rapprocher de la certitude. Il s'agit de la réfutation poppérienne. Cette discussion a normalement lieu dans l'arène scientifique et pas forcément sur les plateaux de télévision.
Sur ces questions extrêmement vastes qui font l'objet de centaines de publications, il appartient aux agences sanitaires, qui en ont les moyens, d'établir la synthèse des connaissances. Au niveau national, il faut s'appuyer sur l'Anses et l'INSERM avec nos expertises collectives et le centre international de recherche sur le cancer, lequel s'est prononcé sur le glyphosate. Les chercheurs discutent, débattent et génèrent des connaissances, lesquelles sont synthétisées par les agences. Nous espérons que ces dernières s'accorderont pour que le message parvienne clairement aux décideurs. La France est dotée d'excellentes agences. Tel est le message que j'incite à écouter.
S'agissant des politiques de santé environnementale, le cœur et l'architecture sont fournis par ces textes de loi. Le plan national santé environnement (PNSE) apparaît comme l'outil officiel et nos chercheurs contribuent à son élaboration. En considérant chaque mesure ou action individuelle qui y est énoncée, de nombreux éléments pertinents peuvent être identifiés, comme la réduction des cancers attribuables à l'amiante et aux effets de la pollution atmosphérique. Toutefois, l'examen du plan dans sa globalité montre un manque de vision structurante dans la mesure où il s'agit davantage d'une logique de micro-management que d'une grande stratégie structurée, ainsi qu'un faible effet d'entraînement.
Concernant la recherche, nous contribuons à ce plan, ce qui ne détermine pas largement notre action en l'absence de financements afférents. Les financements de l'INSERM paient les salaires, mais ne permettent généralement pas de faire de la recherche. Nous nous tournons donc vers les organismes financeurs, ce qui nous conduit à examiner le programme de l'ANR, de l'Anses ou de l'Union européenne et détermine les sujets sur lesquels nous travaillons. Tant que le PNSE ne sera pas associé à des sources de financement, il sera moins structurant que souhaité pour la recherche, ce qui n'est pas forcément problématique si les décisions de l'ANR et de la Commission européenne, qui financent cette recherche de manière extrêmement forte, sont pertinentes.
Les politiques publiques doivent consister à identifier les substances les plus préoccupantes et à en informer les citoyens. Des efforts sont fournis au niveau de la surveillance avec l'enquête de l'alimentation totale de l'INSERM, mais il n'est pas toujours facile d'identifier toutes les composantes de notre alimentation. Aucune obligation d'étiquetage n'est faite en dehors du champ des cosmétiques. Par ailleurs, il convient de faire en sorte que les niveaux maxima autorisés protègent la santé, ce qui est structuré par les principes figurant dans la loi.
Au-delà du PNSE, souhaitez-vous évoquer d'autres plans, programmes, actions ou politiques de santé environnementale spécifiques ?

Il est vrai que je focalisais sur le PNSE qui est l'outil de gouvernance officiel en matière de santé environnementale. Vous avez certainement pris connaissance des rapports des inspections qui sont extrêmement critiques sur le PNSE3. Je m'interroge sur la façon dont le PNSE4, que nous attendons depuis deux ans, pourrait redonner cette dynamique en étant plus structuré. Le faible effet d'entraînement est-il lié au fait que les financements ne soient pas rattachés à ce plan ou à une mauvaise approche des problématiques ? Y a-t-il un problème de gouvernance ? Le Français de base vous semble-t-il suffisamment informé sur la stratégie de la France dans ce domaine ? Des priorités sont-elles à favoriser ?
Les officiels et les institutionnels des différents ministères ne savent généralement pas de quelle façon aborder les problèmes de santé environnementale qui sont souvent systémiques. Existe-il une action rapide et remarquable par son efficacité probable à mettre en place ? Quelles propositions pourriez-vous formuler pour améliorer indépendamment d'un meilleur financement de la recherche et d'une meilleure construction du contenu des lois ?
Je laisserai de côté la question de l'information des citoyens s'il s'agit d'un plan censé structurer l'action publique et guider la recherche. J'insisterai sur la bonne façon de parvenir à cet objectif. L'information est cruciale, mais pourrait être dispensée dans d'autres cadres.
J'essaie d'esquisser une vision globale et structurante. Voici plus de 2 000 ans, Hippocrate invitait à examiner le contenu de l'air et de l'eau pour réfléchir à la santé des populations. Schématiquement, il peut être considéré que certains dangers ne sont pas du tout identifiés et que d'autres le sont. Des moyens sont nécessaires pour identifier les substances et les comportements émergents. Grâce à la loi REACH, nous connaissons les substances nouvellement commercialisées. Nous pouvons établir des baromètres et des études sur des comportements nouveaux pour identifier les problèmes ayant une influence sur la santé. Sur la base d'un programme ambitieux de criblage toxicologique, nous pouvons parvenir à identifier, parmi les substances commercialisées qui ont généralement été testées par l'industriel avec, parfois, des contraintes de test insuffisantes, les nouvelles substances et les nouveaux comportements qui posent problème, ce qui permet de lancer certains signaux d'alerte.
Lorsque le danger est identifié, il est crucial de disposer de programmes de biosurveillance forts. À ce titre, ESTEBAN de Santé publique France est exemplaire. L'Anses dispose d'un programme de surveillance de l'alimentation qui couvre des centaines de substances et est remarquable dans sa démarche méthodologique. Ce type d'approche est onéreux et doit être poursuivi sur le long terme. Si le danger est identifié, ces systèmes de surveillance permettent de qualifier les substances dont le niveau pose potentiellement problème.
Nous disposons de relations dose-réponse qui nous permettent de convertir ces niveaux d'exposition en nombre de cas de pathologies attribuables. Nous pouvons faire part aux décideurs du nombre de cas de problèmes métaboliques ou autres rencontrés avec le bisphénol A, le DDT et les retardateurs de flammes polybromés, ce qui leur permet de choisir l'axe de l'action. La recherche peut alors, sous réserve que lui soient attribués les moyens de faire de la recherche interventionnelle, comparer différentes mesures de gestion face à un problème donné et guider les décideurs.
Ce système n'est pas très éloigné de ce qui existe dans notre pays sans être écrit de manière explicite ni soutenu à tous les niveaux. Avec le concept d'exposome qui nous incite à considérer un grand nombre de substances, si nous disposons de ces plateformes permettant d'effectuer un criblage haut débit à partir de modèles cellulaires, voire animaux, et de cohortes fortement soutenues avec des biobanques permettant de confirmer chez l'humain les signaux qui sont générés chez l'animal, nous commençons à avoir une couverture globale et suffisamment générale des problèmes pour que les signaux émergents recouvrent réellement les problèmes majeurs. Le fardeau de maladies aide à hiérarchiser ces facteurs environnementaux en fonction de leur impact attendu ou suspecté. Santé publique France s'efforce d'opérationnaliser cette problématique à l'échelle de notre pays.
Pour toutes ces raisons, dans le rapport sur la préfiguration recherche du PNSE4, l'INSERM a formulé une proposition qui s'appuie sur ce concept et ce paradigme de l'exposome et de logique de criblage des expositions, d'identification des substances les plus préoccupantes, de surveillance des substances dans l'environnement, de caractérisation des effets chez l'humain et du risque avec cette approche du fardeau de maladies.

Vous nous avez expliqué la façon dont devrait être organisé le système avec un regard de chercheur en identifiant les signaux pour en tirer des conclusions sanitaires.
En évoquant les priorités, je m'interrogeais sur l'urgence à s'occuper, par exemple, des mille premiers jours de la vie ou à s'interroger sur la formation communiquée au corps médical. Je cherchais des actions rapides. Vous nous proposez une organisation structurante, ce qui demande du temps. À court terme, quelle démarche aisément opérationnelle pourrait être mise en œuvre ? Je pense, par exemple, à la protection des mille premiers jours de la vie, qui semble être le plus facile avec la possibilité de faire de la prévention alors que la structuration relève davantage d'une politique publique au long cours.
Le Docteur Rémy Slama. Je ne voudrais pas donner l'impression que rien n'est fait. Le système que j'évoquais n'est pas très éloigné d'efforts existants, mais qui sont peut-être insuffisamment intenses dans certains domaines et qui souffrent d'un certain manque de vision globale, mais de nombreuses actions sont mises en œuvre dans tous les champs évoqués.
Ma première préoccupation consiste à identifier ce qui est juste et important. Il est absolument capital de s'intéresser aux mille premiers jours de la vie qui correspondent à une période de sensibilité très importante alors que l'organisme est en plein développement. Des expositions à des niveaux très faibles peuvent avoir des répercussions sur la vie entière. Toutefois, l'idée n'est pas d'oublier les personnes âgées et les adultes qui sont également sensibles aux facteurs environnementaux. Si les moyens sont limités et que des choix doivent être opérés, ceux-ci appartiennent aux décideurs sur la base des éléments dont nous disposons. Réussir à être efficace sur les mille premiers jours de la vie aura des conséquences, mais il s'agit d'une action sur le long terme avec des répercussions sur la santé de ceux qui vivent aujourd'hui et qui seront présents à la fin du XXIème siècle et au début du XXIIème siècle.
Il serait intéressant de mettre en œuvre un plan sur ce champ si les actions se maintiennent sur le long terme et si elles ne s'exercent pas au détriment d'autres populations qui sont aussi très sensibles.
Interdire le bisphénol A dans les contenants alimentaires et dans d'autres sources bénéficiera aux fœtus qui y sont exposés, mais également aux adultes, aux femmes enceintes et à l'ensemble de la population. Des actions permettent de ne pas avoir à choisir entre certaines catégories de la population, ce qui ne minore pas l'importance de diffuser les connaissances concernant la sensibilité aux différents âges de la vie qui est une réalité scientifique.

Je comprends combien il peut être frustrant de répondre à une telle question sur la priorité alors que vous nous proposez un regard général et restructurant. L'une des grandes critiques adressées au PNSE3 résidait dans le nombre excessif d'actions. Comment éviter de retomber dans le même piège avec le PNSE4 ?
Conviendrait-il de commencer par l'eau et l'air tout en s'intéressant simultanément à la production chimique afin de pouvoir revenir à une espèce de sobriété dans ce domaine ?
En matière de recherche, une action structurante visant à prioriser les substances pourrait consister à lancer une grande cohorte à visée de santé environnementale avec un recrutement aussi précoce que possible pour pouvoir documenter les mille premiers jours de la vie, soit au plus tôt autour de la conception. L'idée serait de procéder à des prélèvements biologiques répétés afin de caractériser efficacement l'exposition à des substances qui sont variables au cours du temps et pour lesquelles un prélèvement unique ne suffit pas à obtenir une mesure précise de l'exposition.
Cette démarche nécessite de grosses infrastructures de biobanques, mais des travaux de recherche, notamment dans mon équipe, en ont démontré la faisabilité. Les couples acceptent ces prélèvements biologiques répétés qui sont également possibles chez les enfants. Il convient éventuellement d'utiliser des dosimètres pour les substances qui ne peuvent être caractérisées à partir de prélèvements biologiques ou des modèles environnementaux. Un suivi sur le moyen et le long terme est nécessaire afin de caractériser le devenir et la santé des enfants qui grandissent.
L'efficacité et la précision de la démarche pour mettre en évidence des effets à des faibles doses impliquent des tailles de l'ordre d'une centaine de milliers d'enfants. Au Japon, une cohorte qui a été mise en place dans ce sens inclut cent mille enfants avec de nombreux prélèvements biologiques au cours de la vie.
En termes de recherche, cette action, qui est de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros sur quelques années, serait probablement très structurante sur le long terme. Si une nouvelle substance pose problème dans dix ans, il « suffirait » de décongeler quelques millilitres d'urine ou de sang de l'ensemble des volontaires et de doser cette substance afin d'observer si les sujets les plus exposés, après ajustement sur les facteurs de confusion pertinents, sont à risque accru de maladie. Si nous disposons en parallèle de plateformes de dosage couvrant l'ensemble des substances chimiques, cette démarche serait très structurante pour la recherche.
En termes de gestion du risque, il conviendrait que la France se fixe des objectifs explicites et parfois plus ambitieux que ceux qui sont décidés à Bruxelles. La norme européenne relative à la qualité de l'air est insuffisante. Rien n'empêche la France d'adopter des normes plus contraignantes, ce qui ne briderait pas l'activité économique. Chaque municipalité dispose de leviers pour lutter contre la pollution atmosphérique et limiter les sources que sont le chauffage urbain, le transport et certaines activités industrielles, bien que de nombreux efforts aient été fournis dans ce secteur. Il serait intéressant de continuer à agir avec un objectif explicite formulé en termes de nombre de décès évités ou de niveau à atteindre en cohérence avec ce que nous indique l'Organisation mondiale de la santé. Il serait sensé de parvenir à faire de même dans le domaine de l'eau et de l'alimentation, ce qui nécessite une grande force politique, mais serait crucial pour la santé publique.

Je souhaiterais revenir sur la catégorisation des substances préoccupantes. Quelle gouvernance pourriez-vous nous conseiller, notamment dans le cadre des différentes catégories ? Un nombre impressionnant de substances est déjà présent sur le marché et beaucoup d'autres sortent chaque année. Comment parvenir à contrôler le flux et mettre en place une démarche de protection sur des bases scientifiques prouvées en sachant que les lobbies nous opposent systématiquement la problématique du lien de causalité ?
À ma connaissance, environ 80 % des lois dans le champ de l'environnement relèvent d'un cadre européen. L'action a du sens à cette échelle, mais la France peut tout à fait être moteur et l'a été à de multiples reprises. Elle l'est dans le domaine des perturbateurs endocriniens où de nombreuses décisions prises en France finissent par être adoptées à l'échelle européenne.
La loi REACH de 2006 a constitué un progrès important dans la mesure où elle permet d'identifier les substances qui sont mises sur le marché et édicte certaines règles concernant cette commercialisation. Cette loi, qui est extrêmement complexe et dense, a fait l'objet d'importantes négociations. L'objectif d'identification et d'enregistrement est atteint. Les substances commercialisées au-delà d'un certain volume sont connues dans la plupart des secteurs.
Les agences réglementaires examinent chacune de ces substances afin de les classer par catégorie de danger. Le Règlement Classification, étiquetage et emballage (Classification Labelling and Packaging – CLP) de 2008 définit ces dernières, notamment les cancérigènes et les reprotoxiques, mais pas les perturbateurs endocriniens. Au niveau européen, la loi proposée voici une vingtaine d'années par l'OMS est valable pour le champ des pesticides, mais pas dans tous les secteurs.
L'écriture de la définition au niveau de la CLP permettrait une reconnaissance dans tous les secteurs, ce qui constitue un préalable à la gestion du risque. Au niveau des parlements sont nommés les dangers jugés les plus préoccupants. Les agences sanitaires classent chacune des substances, ce qui nécessite des outils. Il convient que les tests réglementaires qui sont rendus obligatoires par la loi soient aussi efficaces et actualisés que possible pour savoir si telle substance entre ou non dans la définition des grandes catégories de dangers.
Le choix est donné au législateur concernant le niveau de preuve. Pour les pesticides, le Parlement européen a décidé des cancérigènes prouvés ou suspectés ne devant pas être utilisés. Il s'agit d'un niveau de preuve ne requérant pas une absolue certitude. Des catégories supplémentaires pourraient être créées et les substances jugées présumées pourraient être traitées différemment. Il s'agit d'une manière d'adresser un signal aux industriels avant d'éventuelles décisions plus fortes. La science suivra les décideurs qui fixeront le niveau d'incertitude.

Vous semble-t-il que la gestion des données scientifiques puisse être améliorée dans le partage des informations ? Serait-il bienvenu de créer une plateforme ? Santé publique France nous a indiqué qu'une bonne dizaine d'années seraient nécessaires pour y parvenir. Or nous avons la preuve que des régions se sont mobilisées pour faire le rapprochement entre les données épidémiologiques et environnementales, et ont pu mettre en place des politiques publiques régionales pour pouvoir cibler sur certaines pathologies ou zones à risque sur lesquelles il est possible d'intervenir rapidement.
Je souhaiterais connaître votre point de vue sur la manière dont vous envisagez la mise en action du principe de précaution. À quel niveau placez-vous le curseur ? Vous faites valoir qu'il appartient aux décideurs politiques de définir le niveau de preuve qui permet, à partir de la catégorisation établie par les scientifiques, de poser les limites. Quel est votre avis personnel sur ce principe de précaution ?
Que sait-on actuellement de l'épigénétique qui laisse espérer de nouvelles découvertes et mises en pratique thérapeutiques ou mesures de prévention ?
Il est crucial de disposer de bases de données claires et complètes sur les problèmes potentiels ou démontrés. Les bases de données publiques concernent les substances surveillées. Les bases de données sur l'air incluent les particules fines, les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, le benzène et l'ozone qui sont des polluants présentant des effets sanitaires avérés connus de longue date, mais beaucoup moins de problèmes émergents dont l'effet n'est pas certain dans ce milieu ou au sujet desquels la réglementation n'est pas contraignante. Par exemple, les efforts concernant les pesticides dans l'air sont balbutiants. S'agissant des résidus de médicaments dans l'eau, il n'y a rien de systématique à ma connaissance. Quatre pesticides sont mentionnés, mais peu sont actuellement utilisés. Il est fait état de quatre trihalométhanes, ce qui est très important dans la mesure où certains sont des cancérigènes suspectés, mais de nombreux autres sous-produits de chloration ou contaminants de l'eau pourraient être surveillés.
Nous sommes à l'ère de la science des données, mais celle-ci ne peut s'exercer sans données, ce qui est souvent le cas. L'État ne dispose pas d'un grand nombre de données sur la qualité de l'environnement et la santé des concitoyens de manière systématique. Les cancers de l'enfant sont suivis à l'échelle nationale, mais il n'existe pas de registre national des cancers. Des efforts sont fournis en faveur de sa mise en place à partir du système national des données de santé, ce qui ne sera peut-être pas aussi efficace qu'un registre, même s'il s'agit d'un pas dans la bonne direction. Pour les autres pathologies, nous n'avons pas d'idée précise de l'incidence dans chacune des régions.
Il faut être conscient de l'enjeu premier de l'élargissement de la couverture de ces bases. L'État met des informations en ligne sur les pesticides. J'ai pu prendre connaissance des variations en pourcentage des ventes de pesticides, année après année, à l'échelle du département, ce qui ne permet pas de savoir ce que telle ou telle personne vivant à proximité d'un champ ou en plein centre-ville trouvera dans son air ambiant ou son eau de boisson.
Mes collègues californiens peuvent s'appuyer sur un registre d'exposition aux pesticides à la parcelle agricole. Ils savent quelle substance est utilisée sur quelle parcelle chaque trimestre, ce qui permet de constituer une base de données pouvant être utilisée pour la recherche. Il est crucial de parvenir à s'améliorer. Il serait extrêmement utile que les industriels fournissent un maximum d'informations sur ce qui est utilisé, voire dosé. Aujourd'hui, ces bases de données sont notoirement insuffisantes en termes de couverture par rapport à toutes les substances qui posent question, ce qui n'empêche pas de traiter au mieux les données existantes. Les recherches sur l'air s'appuient sur ces données. Sur la qualité de l'eau, il existe un enjeu de structuration et d'accessibilité de la base.
L'utilisation de ces bases est intéressante pour la recherche si elles sont suffisamment fines et si une cohorte ou une base de données administrative permet la géolocalisation et d'en déduire le niveau d'exposition d'une personne à partir de son lieu de résidence et de la qualité de l'eau qui y est desservie.
L'autre approche concerne la surveillance des niveaux et, si la substance est connue, le couplage de ces derniers avec des relations dose-réponse qui permettent d'identifier les zones où l'on s'attend à un excès de pathologies. Pour les déclinaisons locales, le potentiel réside dans la surveillance.
Je suis favorable à l'extension et à l'harmonisation des bases de données existantes, ce qui sera très utile pour la surveillance et, dans certains cas, pour la recherche. Les bases de données sur le bisphénol A n'existent pas. Il est crucial de disposer d'autres outils comme les biobanques ou les campagnes de biosurveillance pour identifier ces nouvelles substances à partir de prélèvements effectués chez l'humain ou dans l'environnement. Croiser des bases de données est faisable avec des cohortes et des données individuelles fortes, mais il convient d'être prudent lorsque l'opération est effectuée sur des données agrégées car certains biais sont difficiles à contrôler, notamment les facteurs de confusion individuelle comme le tabac, la consommation d'alcool et la corpulence qui peuvent influencer le risque de maladie et être associés aux expositions. L'obtention de données individuelles permet de contrôler efficacement ces facteurs de confusion. En croisant simplement l'incidence d'une maladie dans une région avec le niveau moyen d'usage des pesticides, les résultats obtenus ne sont absolument pas rigoureux. Par conséquent, l'usage est plutôt dans cette approche du fardeau de maladie que dans des croisements de données agrégées.
La question du principe de précaution est complexe. Mon sentiment personnel est qu'il figure dans la Constitution, mais que nous manquons probablement de décrets d'application et d'opérationnalisation. Il est largement critiqué, mais je peine à comprendre ce qui pose problème. Il indique que l'incertitude des connaissances ne doit pas être utilisée comme une excuse à l'inaction face à un dommage potentiel qui peut être très important. Ce principe nous incite à prendre des réactions proportionnées à ces dommages possibles. Si je traverse une rue à l'approche d'un camion, même si je pense qu'il est équipé de freins et que le conducteur m'a aperçu, je n'estime pas illogique d'accélérer et de me réfugier sur le trottoir au regard du dommage potentiel.
Ce principe permet de sortir de l'impasse consistant à attendre la certitude avant d'agir. La certitude scientifique, surtout si la science est peu soutenue et en présence de conflits d'intérêts, peut mettre du temps à apparaître. Il s'agit donc d'un vrai progrès, mais il a été peu utilisé. Les organismes génétiquement modifiés (OGM) constituent un exemple d'application du principe de précaution. Parmi les substances fortement réglementées ou interdites, figurent les polluants organiques persistants dont l'effet nocif sur l'environnement, voire sur la santé, ne fait pas de doute. Le benzène, qui est un cancérigène certain, est réglementé mais pas interdit. Le bisphénol A fait l'objet d'une littérature conséquente sur ses mécanismes d'action et ses effets à partir de données chez l'animal. À moins de considérer que l'existence de preuves chez l'animal ne suffit pas, j'ai l'impression que peu de décisions sont prises selon ce principe dans le champ de la santé environnementale, ce qui pourrait inviter à une réflexion sur son opérationnalisation. Pour les décideurs, il n'est pas simple d'identifier les situations où il faudrait agir face à un problème de manière proportionnelle.
Il existe des outils de décision comme les jurys citoyens et la démocratie participative permettant de considérer l'ensemble des options de gestion. Notre environnement a été profondément modifié et il peut parfois être considéré que la loi peine à suivre. L'avènement du principe de précaution constitue une manière de tenter d'intégrer ces évolutions colossales de notre environnement et le nombre important de substances en aidant à structurer la problématique de la décision en situation d'incertitude. Néanmoins, il conviendrait de réfléchir davantage à son opérationnalisation.
Les marques épigénétiques conditionnent l'expression de nos gènes et expliquent qu'avec un patrimoine génétique identique, une cellule de notre foie et un neurone ne jouent pas du tout le même rôle. Elles fonctionnement différemment, notamment, parce que les marques épigénétiques font que certaines protéines et certains gènes sont exprimés dans le foie pour métaboliser les sucres ou l'alcool et d'autres dans le cerveau. Il s'agit d'un mécanisme biologique fondamental qui a été mieux compris au cours des dernières décennies. Il est central pour étudier le développement, la genèse de différentes pathologies et de certains cancers. La liste des pathologies pour lesquelles sont impliqués des mécanismes de régulation épigénétique est très vaste.
Cependant, je me garderais de l'envisager comme une piste thérapeutique prometteuse au-delà de la génération de connaissances. Je ne suis pas un expert du domaine, mais nous savons que certaines molécules et certains additifs et compléments alimentaires pourraient modifier l'expression génétique, ce qui pourrait être utilisé pour modifier nos marques épigénétiques. À ma connaissance, le faire en étant spécifique et assuré que seul le gène que l'on souhaite voir exprimer ou réprimer sera touché est extrêmement complexe. Il existe peut-être des pistes thérapeutiques que j'ignore, mais il s'agit d'un enjeu de recherche fondamental qui est également majeur pour la santé environnementale car l'épigénétique médit probablement l'effet à court ou à moyen terme, voire sur plusieurs générations de certaines substances environnementales. Dans ce contexte, il est important d'effectuer des recherches dans ce domaine plus que comme une voie de thérapeutique extrêmement prometteuse.
L'audition s'achève à treize heures vingt-cinq.