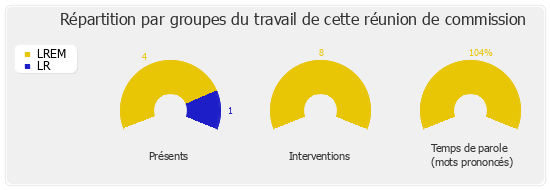Mission d'information sur l'aide sociale à l'enfance
Réunion du jeudi 13 juin 2019 à 14h00
Résumé de la réunion
La réunion
Mission d'information de la Conférence des présidents sur l'aide sociale à l'enfance
Jeudi 13 juin 2019
La séance est ouverte à quatorze heures.
Présidence de M. Alain Ramadier, président de la mission d'information de la Conférence des présidents
————

Mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui Mmes Fabienne Quiriau et Laure Sourmais, respectivement directrice générale et responsable du pôle protection de l'enfance de la Convention nationale des associations de la protection de l'enfance (CNAPE). Cette audition sera pour les membres de la mission d'information l'occasion d'avoir une vue générale et une approche synthétique du travail de ces associations et de leur positionnement parmi les différents acteurs ainsi que des difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans l'exercice de leur activité.
Je vais donc, mesdames, vous laisser la parole pour une présentation, puis mes collègues vous poseront des questions.
La CNAPE est une fédération nationale reconnue d'utilité publique, elle rassemble à peu près 130 associations, elles-mêmes réparties en plusieurs entités dans les territoires, y compris les territoires ultramarins. La particularité de la CNAPE est aussi d'être composée de mouvements d'associations professionnelles, ce sont ainsi treize d'entre eux qui interviennent au titre de la protection de l'enfance essentiellement, mais encore de personnes qualifiées groupées en collège, et d'ATD Quart Monde en tant que représentant des familles et des personnes accompagnées.
Nos associations sont réparties sur l'ensemble du territoire, elles sont toutes plus ou moins centrées sur l'enfant, ce qui ne se limite pas à la protection de l'enfance puisque les registres du médico-social, du handicap de l'enfance, de la délinquante juvénile et des jeunes majeurs entrent aussi dans le champ de préoccupation de notre fédération.
Je souhaite tout d'abord vous faire part de la perception de la situation qui est celle de la Fédération à travers ce que nous en disent les associations, puisque des commissions nationales et des groupes de travail se réunissent régulièrement, ce qui nous permet de prendre la température du terrain.
La protection de l'enfance est régie par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, qui a notamment modifié celle de 2007 alors même que certaines de ses dispositions ne sont toujours pas mises en oeuvre, mais a aussi profondément remanié la perception de la protection de l'enfance. Toutefois, les associations constatent que la réglementation est inégalement appliquée ; de fait, nous relevons de façon frappante des disparités de mise en oeuvre de la protection de l'enfance dans les différents territoires.
En fonction des politiques menées par les départements, du degré d'implication de l'État, de leur association ou non à des instances comme l'observatoire départemental ou à l'occasion de l'élaboration du schéma départemental de protection de l'enfance, de très grandes disparités sont constatées ; nous sommes toujours perplexes devant l'étendue des écarts, qui à tout point de vue tend à s'accroître.
Nous sommes donc confrontés à un grave problème d'égalité de traitement devant la chose publique, qui est très ancien. C'est pourquoi la Fédération souhaite en premier lieu que la loi soit également appliquée dans toute sa dimension sur l'ensemble du territoire national. En effet, nous ne sommes pas exclusivement concentrés sur le danger encouru par les enfants, mais aussi sur l'ensemble des situations auxquelles ils peuvent être confrontés en amont et en aval. Par ailleurs, les associations ne demandent pas une nouvelle loi, car elles n'ont pas encore eu le temps de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions en vigueur ; l'application de la loi de 2016 est d'ailleurs seulement amorcée et bien des points qui méritent de l'être sont loin d'être approfondis.
Ces disparités dans l'application de la politique de protection de l'enfance font particulièrement apparaître les manques ; ainsi tout l'axe de la loi de 2016 consacré à l'approche de l'enfant par les besoins fondamentaux est très insuffisamment développé.
Une démarche de consensus a produit un corpus théorique de référence auquel nous devrions nous conformer, mais nous bloquons sur sa mise en oeuvre concrète : comment faire pour conduire l'approche par les besoins en fonction du développement de l'enfant ? Car, pour l'enfant, l'enjeu primordial est celui de son développement.
Et, selon que l'on est médecin, éducateur ou psychologue, on a sa propre conception de ce développement, ce qui implique des seuils d'attention et de tolérance susceptibles de varier. Or ce sont avant tout les atteintes au développement qui marquent les écarts : comment mesure-t-on les atteintes au développement de l'enfant, qui font que l'on peut considérer que cet enfant a des problèmes en fonction de ce qu'il laisse paraître ou laisse diagnostiquer de son état ? Les associations demandent donc que soient mis à leur disposition des outils propres à repérer que les enfants ne vont pas bien, qu'ils sont en situation de danger ou de maltraitance. C'est précisément à partir des éléments que l'on peut recueillir qu'il est possible de prendre des décisions et de construire un suivi.
Le suivi est en effet primordial, car il ne suffit pas de constater à un moment donné que quelque chose ne va pas ; c'est pourquoi il faut savoir mesurer l'évolution de l'enfant telle qu'elle résulte de l'action conduite dans le cadre de la protection de l'enfance. C'est que là l'écart peut être le plus grand : dans la difficulté à évaluer l'impact des actions, quelles qu'elles soient, conduites envers l'enfant.
C'est pourquoi les acteurs de la protection de l'enfance souhaitent disposer d'un cadre de référence de l'approche par les besoins fondamentaux de l'enfant. Un tel outil a été créé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais cette initiative est demeurée à l'échelon local, alors que la demande porte sur un référentiel national commun à tous, quel que soit le professionnel approchant l'enfant, quel que soit le temps de l'enfant, petit ou grand ou jeune majeur, et quelle que soit sa problématique.
Par ailleurs, au cours des dernières années, la question de la santé et des soins prodigués à l'enfant s'est posée de façon toujours plus accrue ; et elle se pose avec une intensité variable en fonction de l'offre de soins disponible dans les territoires considérés. Or, c'est la santé à laquelle il n'a sans doute pas été porté une attention suffisante, notamment à ses carences ; cela particulièrement en matière de santé mentale, mais aussi de handicap et de protection de l'enfance, qui sont intimement liés. Cette double problématique a été mise en exergue par le rapport du Défenseur des enfants publié en 2015, elle constitue une réalité criante qui est loin d'être anecdotique et demeure entière aujourd'hui : comment bien prendre en compte à la fois le handicap et le danger lorsque celui-ci se présente ?
En outre, depuis plusieurs années, nos réflexions et nos échanges ont conduit au constat que la gouvernance nationale et le pilotage régional de la politique de l'enfance souffrent d'un sérieux manque de cohérence. Des améliorations ont toutefois été apportées dans le domaine de la gouvernance nationale par la loi de 2016 qui a institué le Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE). Cet organe plutôt consultatif émet des avis et constitue une instance de réflexion.
Il n'en demeure pas moins que le besoin le plus prégnant et celui de la déclinaison opérationnelle dont nous ne disposons pas au niveau national. De ce fait, à l'échelon local, chacun décline sa pratique de façon plus ou moins précise et rigoureuse, plus ou moins empirique et intuitive. Une fois encore, cette situation est source de nombreuses disparités dans la politique de protection de l'enfance.
S'agissant de la gouvernance à l'échelon départemental, nous manquons encore d'éléments de pilotage, concrétisé par des outils et des indicateurs qui seraient communs à tous. Certes, les schémas départementaux de protection de l'enfance donnent une idée des grands enjeux et des actions conduites dans chaque département, mais nous ne disposons pas pour autant d'une vision d'ensemble au niveau national.
Des progrès incontestables ont pourtant été réalisés dans le domaine des données grâce aux travaux de l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE). Nous disposons ainsi de beaucoup plus d'indications relatives aux flux, et les livraisons de ces données se font désormais à l'année n-1, ce qui permet leur actualisation. Nous peinons toutefois toujours à harmoniser ces informations qui proviennent de sources hétérogènes, ce qui empêche la constitution d'un vrai tableau de bord national.
Il serait en effet fort utile de disposer d'indications sur les publics et les mouvements, car nous sommes souvent au fait des grandes tendances par grandes masses, mais nous ne parvenons pas à identifier ce qui fait l'actualité de la protection de l'enfance dans son évolution. Car, comme tous les autres sujets, la protection de l'enfance évolue très vite en fonction de l'actualité et de tous les faits de société qui la chahutent et la remettent en question.
Ces manques rejaillissent sur les associations qui éprouvent des difficultés à se situer dans un ensemble ; c'est pourquoi nous tâchons de leur transmettre des indications afin de leur préciser leur positionnement dans cet ensemble assez hétérogène.
Nous considérons donc qu'une réflexion reste à conduire au sujet de la gouvernance nationale, mais nous nous interrogeons aussi sur ce que signifie le fait de piloter une politique de la protection de l'enfance au niveau départemental. En premier lieu il s'agit certainement de l'aide sociale à l'enfance (ASE), mais elle n'est qu'une composante de la protection de l'enfance, et il y a lieu de développer ce qui se situe en amont comme la prévention.
En effet la politique de protection de l'enfance demeure très curative, et nous avons du mal à déplacer le curseur vers l'amont. Or on constate que, les années passant, nous sommes condamnés à gérer trop tardivement des situations très dégradées, alors que l'évolution des connaissances devrait permettre des politiques bien plus préventives. Nous pourrions ainsi intervenir beaucoup plus tôt, sans toutefois céder au déterminisme ou à la stigmatisation, ce qui n'est pas la question. ; il s'agit d'amortir les préjudices que peuvent connaître les enfants du fait des situations familiales qu'ils sont susceptibles de vivre.
Une large réflexion est engagée à cet égard ; on perçoit un bouillonnement et l'effervescence des idées. Nous nous en réjouissons tous, car nous avons toujours déploré que la protection de l'enfance et l'aide sociale à l'enfance demeurent des sujets confidentiels, ou présentés dans les médias comme difficiles ou relevant du fait divers. Nous nous réjouissons donc de l'intérêt que l'État porte à ces sujets, mais nous restons dans l'expectative.
Nous répondons à toutes les sollicitations, qu'elles émanent du Parlement, de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ou de la Cour des comptes, et nous sommes présents au sein des cinq groupes de la concertation initiés par Adrien Taquet. Nous espérons ainsi que la politique de l'enfance gagne en cohérence, en lisibilité et en visibilité ainsi qu'en efficience ; c'est là notre objectif.

Vos propos font écho aux réflexions que nous conduisons depuis quelques semaines ; nous partageons votre constat : il existe autant de protections de l'enfance que de départements. Comme l'a dit une de nos collègues, la question ne se poserait pas pour l'éducation nationale alors que c'est le cas pour la protection de l'enfance, ce qui est assez étonnant.
Si j'ai bien entendu, la CNAPE regroupe à la fois les mouvements de professionnels et les associations du secteur. Aussi ma première question sera la suivante : comment la maltraitance institutionnelle est-elle gérée ? En effet, même si certains départements le nient, nous savons tous qu'il y a de la maltraitance dans nos institutions. Que peut-on faire et mettre en place pour lutter contre cette maltraitance institutionnelle ?
Je souhaiterais également connaître vos propositions pour améliorer la protection de l'enfance, que ce soit en amont du placement, mais aussi pendant le placement, voire au-delà. Le lien entre les professionnels, les associations et les départements doivent-ils être améliorés ?
Quelles sont selon vous les mesures à prendre dans les domaines de l'éducation, de l'autonomie, de l'amélioration de la santé ; tout ce qui regarde le parcours de ces enfants ?
Enfin, nous entendons beaucoup que le phénomène des mineurs étrangers non accompagnés et celui de leur accueil déstabiliseraient la politique de l'enfance jusqu'au dysfonctionnement. Confirmez-vous cette assertion ?
Nous ne nions pas l'existence de la maltraitance institutionnelle qui est une réalité. Je considère toutefois qu'il faut jeter un regard positif sur ce qui est fait dans le domaine de la politique de l'enfance ; c'est pourquoi nous posons toujours en contrepoint ce qui va bien et ce qui ne va pas.
On n'a sans doute pas assez pris la mesure de la réalité de ces violences ; les acteurs, qu'ils soient associatifs ou publics, considèrent qu'en premier lieu leur mission est de mettre l'enfant à l'abri. Cela signifie que l'on va se focaliser sur cette notion de danger, et, même si les choses changent encore aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui a constitué un danger à un moment donné ; sur les facteurs tel le dysfonctionnement du système familial.
Cela peut expliquer, que, sans toutefois complètement l'oublier, on a longtemps mis de côté le fait que les intéressés restaient des enfants. Alors que l'on a conscience qu'ils sont marqués par une histoire singulière et douloureuse ayant abouti à des traumatismes, les violences institutionnelles commencent peut-être à partir du moment où on ne perçoit plus l'enfant en tant que tel, mais comme sujet de danger. Alors que les enfants que l'on accueille, que l'on suit et que l'on accompagne restent des enfants.
Il faut donc penser à ce qui leur est nécessaire. Et la première des choses est bien entendu la sécurité, c'est la première dimension, mais mettre à l'abri du danger ne concerne pas la seule sécurité physique, c'est aussi la sécurité affective, se sentir bien, etc.
Peut-être a-t-on trop longtemps négligé cet aspect alors qu'il fallait non seulement mettre l'enfant à l'abri, mais encore le protéger à tout point de vue. Cela signifie que la notion de protection doit s'entendre dans tous les sens du terme ; comme il est dévolu à tout un chacun : aux parents, à l'école, à tous les lieux où l'on a cette obligation de protéger l'enfant. Or, protéger consiste certes à prévenir de tout ce qui est néfaste pour lui, mais en même temps de veiller à son épanouissement, son bien-être et son développement.
Tout ce volet de développement a en effet été un peu négligé ; à l'instar de ce qui s'est passé dans le domaine de la santé et du soin : c'est comme si on l'avait eu en tête sans que ce soit la priorité. On a commencé à parler de violences institutionnelles lorsque l'on a commencé à parler de bientraitance, mais aussi lorsque l'on a commencé à parler de ce qui faisait qu'un enfant devait aussi grandir et s'épanouir. Tous ces mots ont résonné il y a une quinzaine ou une dizaine d'années, et sont venu questionner à nouveau les institutions, et les professionnels.
Il faut aussi se poser la question : pourquoi la violence est-elle là ? Est-ce le cadre institutionnel qui est insuffisamment sécurisant pour tout le monde ? N'a-t-on pas donné les consignes qui convenaient aux professionnels pour établir la règle du jeu en termes de protection ? Qu'est-ce qui fait violence dans l'accueil des enfants, qu'il soit institutionnel ou familial ? C'est toutefois au sein de l'accueil institutionnel que la violence est plus visible, car il s'agit d'un contexte collectif. Qu'est-ce qui fait violence de manière institutionnelle ; qu'est-ce que cette violence ? Est-elle autorisée, est-elle prévenue ? Est-elle pensée en amont ; y a-t-il des directives ou non ?
Nous avons réalisé que les établissements sont plus attentifs et sécurisants pour les professionnels lorsque la réflexion y est organisée en amont, avant que les violences n'arrivent, que cette éventualité est pensée en identifiant ce qui peut faire violence à un enfant ; le rapport d'un professionnel à un enfant, les interdictions, les atteintes à ses droits, etc., que des procédures de recueil des faits ont été organisées, et, qu'après que des actes de violence ont été consignés, on travaille à comprendre ce qui s'est passé et comment éviter la réédition.
Il ne faut en effet pas oublier que la première violence institutionnelle est celle qui ne met pas les professionnels en sécurité, car pour sécuriser les enfants, il faut être soi-même en sécurité. C'est un incontournable préalable, on voit bien que les professionnels ne seront sécurisants et bien traitants pour les enfants que si eux-mêmes se sentent dans un cadre sécurisant où ils sont bien traités ; c'est un processus.
Il faut donc parler de la violence, la penser en amont ; car ce n'est pas au moment où ça brûle qu'il faut le faire. Il faut disposer de signaux d'alerte et de repérage, et la responsabilité de la violence est aussi collective qu'individuelle, nul ne peut se soustraire à cette responsabilité ; ce n'est pas l'affaire de l'autre, la violence nous concerne tous. Et les institutions ont à travailler à ces processus.
Nous avons travaillé à la CNAPE à la question des violences institutionnelles. Nous avons d'ailleurs croisé les travaux des commissions « protection de l'enfance, médico-social et protection des mineurs », car tous les établissements et services sont concernés. On constate que certains sont beaucoup plus en avance que nous dans cette réflexion et ont beaucoup plus réfléchi à cette question des violences institutionnelles.
Les travaux de la commission consacrée à la protection de l'enfance ont surtout fait ressortir la question des violences par défaut, car c'est une violence institutionnelle que de ne pas offrir à l'enfant la réponse à ses besoins, particulièrement en matière de soins. Lorsqu'il faut six à dix mois pour obtenir un rendez-vous en CMP (Centre Médico-Psychologique), une violence est faite à l'enfant, qui se retrouve dans un établissement de protection de l'enfance avec des professionnels n'étant pas formés pour sa prise en charge particulière. La non-réponse ou le délai excessif de réponse constitue donc une forme de violence.
Nos adhérents ont aussi souligné la difficulté de recruter des professionnels, la protection de l'enfance n'étant pas un secteur très attractif, cela d'autant plus que l'on en parle souvent mal. Ainsi beaucoup d'établissements ne parviennent-ils pas à recruter des éducateurs spécialisés par manque de candidats ; de ce fait ils manquent d'adultes pour soutenir les jeunes.
Nous avons d'ailleurs réalisé un document sur ces violences, que nous pourrons vous transmettre si vous le souhaitez.
Il est important de parler des violences institutionnelles et de les prévenir. Il faut établir des procédures connues de tous ainsi que des consignes claires, et sans cesse repenser les réponses apportées aux enfants. Car plus il y a d'écart, plus on devient maltraitant, ce qui rejoint la question du soin, qui est aussi celle de l'offre, mais encore celle de la formation.
Mais la question de la formation n'épuise pas le sujet. Les professionnels bénéficient souvent de formations, mais il faut une stratégie dans ce domaine ; si un seul professionnel reçoit une formation sur la violence, il n'a que très peu d'impact sur l'établissement dans lequel il travaille pour faire bouger les choses. Il faut donc conduire une réflexion collective sur la formation afin de définir une stratégie.

J'ai évoqué la maltraitance, car elle constitue un sujet. Bien entendu, les professionnels dans leur grande majorité font bien leur travail, mais sont aussi eux-mêmes en difficulté parce qu'ils ne bénéficient pas d'un accompagnement « psy » lorsqu'ils rencontrent des difficultés ni d'analyse des pratiques à mettre en oeuvre devant la situation d'un enfant.
À travers cette question, nous ne stigmatisons pas les professionnels, bien au contraire. Pour les avoir rencontrés, je considère que nous devons les soutenir, car, par-delà la faiblesse de la rémunération des éducateurs, si l'on souhaite qu'ils viennent, il faut leur garantir de bonnes conditions de travail.
C'est bien dans ce sens que nous avons entendu vos propos. Il faut dire qu'il se passe de très belles choses dans la protection de l'enfance, car le contraire serait désespérant. Il n'en faudra pas moins s'attaquer sérieusement à tous ces îlots de violence, et surtout se demander pourquoi ils existent et quelle en est l'origine. De fait, certaines institutions deviennent folles, et toutes les relations deviennent violentes : entre les professionnels comme entre les enfants ; c'est un engrenage contre lequel il faut lutter.
De son côté, la prévention ne se résume pas à des actions ponctuelles, c'est un état d'esprit. Ce qui signifie être attentif ; il y a des signaux faibles, qui deviennent toujours plus visibles et devant lesquels il faut réagir. Ce qui doit se traduire par l'observation, le repérage et la réaction immédiate. Aussi la priorité est-elle la vigilance en amont ; la prévention précoce chez les tout-petits.
Je ne parlerai pas de la protection maternelle et infantile (PMI), mais nous voyons bien que beaucoup d'histoires de mauvais traitements et de danger s'ancrent dès le plus jeune âge, voire au moment de la naissance, là où les choses se jouent. Certes, il ne faut pas systématiser ce constat, mais lorsqu'à partir du moment où on a repéré une situation de danger et que l'on remonte dans l'histoire de l'enfant, on voit bien qu'au tout début quelque chose s'est mal installé dans la relation parents-enfant, et que c'est à ce moment que nous aurions pu être plus présents.
La question vient ensuite de savoir qui observe ; il me semble que les acteurs de la protection de l'enfance ès qualités, ne doivent pas être les seuls à le faire ; tous les acteurs sont concernés par la prévention, dont l'école et les crèches. Des crèches préventives commencent d'ailleurs à être créées, nous les soutenons beaucoup, car on y est très attentif aux relations parents-enfant ainsi qu'aux troubles précoces du développement ; c'est pourquoi l'attention doit être mobilisée dès l'accueil du tout-petit.
Bien sûr on ne peut pas tout suivre, mais on ne saurait négliger la place de l'école, de la santé à l'école ainsi que celle des plus grands ; or nous déplorons de constater à quel point la santé scolaire est exsangue et démunie, notamment dans le primaire. Cela nous désespère, car nous savons que c'est là que toute l'enfance se joue, alors qu'il y a très peu de repérage et de suivi, ce que montrent les carnets de santé, qui ne sont pas toujours remis et sont souvent perdus. On voit bien que quelque chose se joue avant la préadolescence après laquelle tout devient terrible ; on est alors confronté à de graves troubles du comportement et on est complètement dépassé par la situation de l'enfant et son état.
C'est pourquoi à nos yeux la prévention doit être permanente, être présente à tous les moments, et doit porter sur les parents, l'enfant et la famille, etc., mais doit avant tout s'exercer en amont, à l'âge précoce de l'enfant.
Certains enfants et certaines familles ne se trouveraient pas dans le dispositif, s'il existait un accompagnement simple, pratiqué sur une courte durée. Certaines familles en difficulté demandent de l'aide à un moment donné sans la recevoir, et la dégradation de la situation les conduit à entrer dans le dispositif alors qu'un suivi de quelques mois par une technicienne de l'intervention sociale et familiale (TISF) dans le cadre de la caisse d'allocations familiales (CAF) aurait suffi à l'éviter.
Par ailleurs, les familles qui n'adressent pas de demande sont beaucoup moins repérées, c'est pourquoi il faut aller au-devant d'elles. La polyvalence des secteurs ainsi que les mouvements dans les territoires font que l'on ne repère pas nécessairement les familles qui ont besoin d'aide ; ce qui conduit à une orientation vers la protection de l'enfance alors que des actions très simples auraient pu permettre de l'éviter.
Que l'enfant soit à domicile ou séparé de sa famille de façon plus ou moins durable, il faut s'assurer de la bonne adéquation de la réponse qui lui est apportée ; cela constitue à nos yeux un préalable. Cette réponse doit être individualisée et correspondre aux besoins propres de l'enfant, qui à un moment donné peuvent exiger plus d'attention et d'affection, alors qu'à un autre moment il a besoin d'être plus tranquille, plus en retrait. La question est donc de bien d'adapter les réponses au plus près de l'enfant, au gré de son état et de son évolution.
Il faut être attentif et en veille, particulièrement en milieu ouvert. Lorsque l'enfant relève de l'action éducative en milieu ouvert (AEMO), on observe que le temps de passage des éducateurs est très court et très espacé. Or pour protéger l'enfant du danger tout en suivant son évolution, une fréquence de visites beaucoup plus soutenue serait nécessaire.
Certes, il peut y avoir des temps au cours desquels il est souhaitable d'espacer les visites, mais pendant les périodes de crises, il faut pouvoir les rapprocher ; ce qui renvoie à la question de la modulation. On n'a pas encore réussi à moduler les interventions, et cela ne concerne pas la seule AEMO, mais toutes les interventions à domiciles ; TISF, accompagnement budgétaire, etc. Il faut être massivement présent dans les moments de crise, souvent on redoute la multiplicité des intervenants, mais du coup on espace trop les visites. Dans ces périodes, il faut mobiliser l'ensemble des acteurs, mais aussi la famille en lui expliquant ce que l'on fait, tout en étant clair sur ce que l'on fait avec l'enfant, même tout petit, et la famille. En effet, l'explication insuffisante est souvent source de malentendus, de réticences et de difficultés.
En tout état de cause, il faut bâtir pour l'enfant un vrai projet qui ne se limite pas à un document administratif.
S'agissant de l'accueil en établissement, la loi de 2016 a ouvert la possibilité de diversifier les réponses ; plus l'éventail sera élargi plus nous aurons de chances de répondre aux besoins de l'enfant. Toutefois, les connaissances, qui sont toujours plus fines, nous convainquent, quoi qu'il arrive, de l'impératif de stabilité et de continuité ; et cela vaut pour tout enfant. Ce qui n'interdit pas de proposer ponctuellement à l'enfant des temps passés en dehors de son accueil afin qu'il puisse vivre normalement comme tout enfant.
En effet, un de nos principes d'action est que l'enfant est avant tout un enfant, et qu'autant que possible, on doit se comporter comme tout adulte à son égard, et ne pas toujours le percevoir comme un enfant protégé, faute de quoi il ne grandira pas ; car l'enfant est très sensible à la perception qu'il génère.
C'est pourquoi nous considérons qu'il est indispensable que chaque département puisse disposer d'un éventail de solutions suffisant pour apporter une réponse à toutes les situations. Pour les uns ce sera l'accueil familial, pour les autres l'assistant familial, les lieux de vie, la maison d'enfants à caractère social (MECS) ou l'articulation de plusieurs dispositifs. Le tout est de ne pas les balloter d'un lieu à un autre par défaut de réponse ; des études démontrent d'ailleurs à l'envi à quel point ces ruptures répétées sont cause de troubles.
Nous constatons en effet qu'il faut parvenir à stabiliser la situation de l'enfant ; ne plus être dans le rejet, et essayer de trouver le point d'ancrage et de réassurance. Toutes les recherches que nous avons conduites à propos de la délinquance juvénile montrent à quel point ces jeunes qui connaissent des parcours délinquants ont vécu des successions de ruptures doublées d'échecs scolaires. Ces jeunes ne connaissent que des échecs, que ce soit avec leurs pairs, les adultes, l'école, la santé, etc. Plus les expériences sont négatives, plus on ancre des situations qui seront de plus en plus complexes et des troubles comportementaux, qui constituent une grande question pour les adolescents aujourd'hui.
Par ailleurs, comme je l'indiquais dans mon propos liminaire, les liens entre les associations et les départements sont à géométrie variable. Nous déplorons que des questions de personne se trouvent à l'origine de ces situations ; tout dépend de la relation entre tel cadre territorial et tel responsable associatif. Nous déplorons particulièrement que la qualité de la politique d'une association soit effacée au profit d'une relation beaucoup plus technique et gestionnaire.
Les associations représentent 79 % à 80 % de la mise en oeuvre des décisions de protection, ce qui fait d'elles des acteurs de premier plan, placés en première ligne dans le domaine de la protection de l'enfance. Nous observons, nous avons des choses à dire, nous réfléchissons, nous sommes organisés en fédérations, nous faisons des contributions, et nous gardons du corporatisme au profit d'une vison d'ensemble, de politique publique et pas seulement d'association ; et nous nous interrogeons sur le bien-être que nous devons tous rechercher pour l'enfant.
Nous regrettons ce manque de contacts entre les politiques, l'exécutif départemental et l'exécutif associatif, qui sont vraiment très rares. Nous déplorons encore que les associations ne soient pas reconnues comme des acteurs à part entière dans les instances au sein desquelles elles sont conviées par les départements, que l'on ne reconnaisse pas le rôle qui devrait leur revenir. Elles s'expriment certes, puisqu'elles sont invitées à cette fin, mais si parler est une chose, être pris en compte en est une autre.
Afin de pallier cette situation, nous avons élaboré des chartes entre associations et départements, mais un travail reste à faire, alors qu'il y va de l'intérêt des départements, des pouvoirs publics et de l'État de ses services déconcentrés de s'appuyer sur les associations. Car elles assurent la présence dans les territoires qui souvent sont désertés, ce sont les dernières à être là. Je pense à la prévention spécialisée, à l'intervention à domicile dans certains quartiers très dégradés et très déshérités, où les éducateurs spécialisés relèvent souvent des associations.
Il faut donc ménager les associations, nous avons tous intérêt à ce qu'elles soient partie d'une politique publique d'ensemble lisible, portée et pilotée par les pouvoirs publics pour donner envie d'y participer. Car une action présentée de façon négative ou qui n'est pas politiquement soutenue, qui ne bénéficie pas d'un affichage en sa faveur de la part des pouvoirs publics, n'est pas attractive. Dans ces conditions, elle finit fatalement par connaître les difficultés qui sont les siennes, alors que nous sommes des partisans du faire ensemble.
En effet, on parle de l'approche holistique de l'enfant, mais aucun professionnel au monde n'est capable de répondre à tous les besoins de l'enfant. Nous sommes donc condamnés à nous entendre, peu importe le public ou l'association : lorsque l'on est auprès de l'enfant, il faut pouvoir dépasser tout cela. Vient ensuite la question de la gouvernance – qui est autre chose – ainsi que celle d'un vrai pilotage, avec des indicateurs et une approche par l'effet des actions conduites par les uns et les autres afin de nous assurer que nous sommes sur la bonne voie et réajuster en cas de besoin.
En tout état de cause, tous professionnels confondus, y compris les psychologues et les éducateurs spécialisés, nous rencontrons de sérieuses difficultés de recrutement. Et si nous ne parvenons plus à recruter des professionnels, peu importe que nous les formions nous-mêmes ou qu'ils le soient déjà, nous aurons quelque souci pour assurer convenablement nos missions.
De plus en plus les associations participent aux travaux des départements, mais des interrogations demeurent. Nous répondons à des appels à projets lancés par les départements, mais ce sont les associations qui sont au plus près du terrain et voient les besoins émerger ; or pour proposer des réponses, il faut répondre à un appel à projets !
La logique est ainsi renversée, ce qui rend d'autant plus utiles les diagnostics partagés, notamment dans le cadre du schéma départemental. J'ai ainsi coutume de dire que j'attends du président du conseil départemental qu'il soit un chef d'orchestre et non pas un chef de file de la protection de l'enfance. Car chef de file, c'est tous derrière et lui devant, alors que le chef d'orchestre évoque l'idée de tous se mettre autour de la table, et de mettre tous les acteurs en harmonie.
Comme le disait Fabienne Quiriau, tout le monde ne peut pas tout tout seul, chacun à des spécificités et des réponses à apporter, c'est pourquoi il est important de faire ensemble ; cela fonctionne bien par endroits, mais malheureusement pas sur l'ensemble du territoire.

Vous avez évoqué les difficultés que vous rencontriez dans le recrutement ; que faudrait-il faire selon vous pour le faciliter et attirer plus de jeunes vers ces métiers ?
La loi de 2016 tendait notamment à la déjudiciarisation de l'ASE, cet objectif semble toutefois difficile à atteindre ; selon vous quelles en sont les raisons ? Car les magistrats sont totalement débordés par le nombre important de dossiers à suivre.
Enfin, pensez-vous qu'il est nécessaire de passer par un juge pour régler les affaires quotidiennes des jeunes, comme les sorties extrascolaires, les sorties chez les copains, etc. ?
Au sujet du recrutement de jeunes, je reconnais que nous ne faisons sans doute pas assez de campagnes autour de ces métiers. Dans les forums, il y a parfois quelques informations sur ces métiers sociaux, mais rien n'est fait en matière de communication sur les métiers de la protection de l'enfance. Ou alors celle-ci se fait de façon ponctuelle, hier j'ai ainsi pu voir une communication faite par un département pour recruter des assistants familiaux, secteur qui, lui aussi, vit une crise. Le président du conseil départemental disait d'ailleurs que cette action leur avait permis de compenser ce déficit.
Il me semble qu'il faut effectivement communiquer et informer. Les choses commencent par là, il faut montrer que la protection de l'enfance est un métier d'avenir pour des jeunes qui ont envie de s'investir, de donner beaucoup d'eux-mêmes, car ces métiers ne s'exercent pas de façon neutre et indifférente ; ils impliquent d'être engagé et investi.
La question de la formation dans les écoles se pose aussi, nous y travaillons avec l'Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale (UNAFORIS), fédération qui rassemble des écoles de travail social. D'un autre côté, on nous dit que les choses sont désormais « pliées » pour la formation initiale et qu'elle a été redéfinie.
Nous regrettons que les métiers de la protection de l'enfance ne soient pas davantage mis en lumière : en quoi elle consiste, ce que l'on peut y faire. Certes ces métiers sont difficiles, mais c'est le lot de tous les métiers touchant à l'humain comme la médecine ; si c'était facile, on le saurait. Il faut donc savoir susciter des vocations dès la formation initiale.
Par ailleurs, nous avons aussi développé la formation continue sous forme d'accompagnement comme la supervision, l'analyse des pratiques, outils propres à rassurer les professionnels. Nous devons encore repenser la formation des cadres travaillant en institution, qu'il s'agisse d'un département, d'une association ou d'un service de l'État. Nous devons les former à être des stimulants pour qu'ils donnent envie aux équipes de continuer à s'investir et de ne pas se démobiliser.
En effet, les professionnels ont parfois un sentiment d'impuissance, qu'ils travaillent pour un résultat qui peut être modeste et n'est pas reconnu. La politique de l'enfance est souvent stigmatisée dans des déclarations publiques ou des articles de presse à charge, et nous mesurons par la suite ce que cela induit dans l'esprit des intéressés. C'est ce que nous redoutons ; nous venons de subir une deuxième vague de campagne un peu difficile, et nous constatons que cette absence de reconnaissance est cause de désespérance. Cela signifie que ce que nous faisons ne se voit pas, que ce n'est pas bien, que nous passons à côté des choses ; et cela n'est pas accessoire, mais très fortement ressenti par les professionnels qui nous en parlent beaucoup, ce que nous devons entendre.
Nous réalisons des supports vidéo, et tâchons de penser des campagnes valorisantes pour le métier. Ce qui ne signifie pas que nous allons prétendre que tout ce qui se fait dans la protection de l'enfance est super, mais nous essayons de mettre en avant le métier, l'investissement, l'engagement qu'il suppose, mais aussi l'enrichissement qu'il apporte.
Nous avons participé à la réalisation du film À tes côtés, consacré au travail de l'éducateur, cofinancé par la CNAPE, l'Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé des départements et métropoles (ANDASS), les départements de la Gironde, de Paris, de la Moselle, le Club ASE et la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Centré sur la relation, le film montre quatre professionnels qui suivent un jeune. Nous voulons montrer une autre facette de la protection de l'enfance ; il ne s'agit pas de dire que tout va bien, mais de montrer la réalité du travail. La semaine dernière, nous l'avons testé auprès d'éducateurs et de travailleurs sociaux dans le cadre des rencontres du Club ASE ; ils nous ont remerciés d'avoir montré leur travail sous un angle positif. Ce film pourrait ainsi être un outil pour faire connaître notre travail ; c'est pourquoi nous souhaitons le diffuser ; pourquoi pas auprès de vous, mesdames et messieurs les députés ?
Ce film ne prend pas le parti du « tout va bien » ; il veut montrer le partage et l'enjeu de la relation entre les professionnels de la politique de l'enfance et les jeunes.

Je considère comme très important, et c'est aussi le but de cette mission d'information, de montrer ce qui marche. J'ai rencontré des professionnels désespérés parce qu'ils n'arrivaient pas à avancer : il faut leur montrer qu'une autre solution existe, et qu'il est bon de se battre pour y parvenir.
Il est donc très important de mettre les bonnes pratiques en valeur, et l'un des buts de cette mission est de dire à un département en difficulté que tel département a adopté telle solution et que cela fonctionne. Et plutôt que de toujours réinventer le fil à couper le beurre, il faut aller chercher sur étagères les solutions qui fonctionnent.
Le film est en phase finale de montage, il serait intéressant que la mission d'information puisse le visionner. J'insiste sur le fait qu'il montre aussi des choses qui ne fonctionnent pas ; il montre ce qu'est le travail d'éducateur, et parle de la relation entre les éducateurs et le jeune ou la famille suivie.

Nous croyons beaucoup à l'impact de l'image que le discours politique donne de nous. Que dit-on de la protection de l'enfance ? Comment les politiques, que ce soit au niveau national ou à celui des territoires, en parlent-ils ? S'ils la présentent comme un amoncellement de problèmes et de difficultés, dans toute la noirceur que l'on imagine, l'effet est répulsif.
Encore une fois, c'est un métier difficile, qui à chaque fois nous remet en question, et auquel on ne s'habitue jamais, quand bien même on a derrière soi des années d'observation, d'expérience et de réflexion, il nous surprend toujours, nous met en émoi. Le politique doit en prendre toute la mesure et donner toute sa dimension à cette politique publique avec toute la sensibilité et l'humanité nécessaire, ce dont nous avons grand besoin.
Nous avons mené des travaux prospectifs sur le bien-être de l'enfant, et une de nos conclusions est que le politique doit apprendre à parler de ces questions en reconnaissant qu'il y a de grandes difficultés, sans évacuer le sujet. Mais nous sommes là, nous sommes investis. Je suis persuadée qu'un tel discours de la part du politique aurait un effet d'entraînement.
À cet égard, nous conduisons avec des professionnels un travail auprès des jeunes et nous leur demandons : « Qu'entendez-vous de ce que les adultes disent des enfants, notamment de vous, enfants de la protection de l'enfance ? Comment aimeriez-vous que l'on parle de vous, enfants de la protection de l'enfance ? »
Les intéressés n'ont pas spontanément parlé de leur situation d'enfants protégés ayant été en danger, mais de ce qu'ils font chaque jour, des tablettes et des écrans, en nous disant que nous portions évidemment sur eux un regard très négatif à cause de leurs écrans, etc., qui sont peut-être mauvais, mais leur apportent aussi des choses. Ils nous ont montré à quel point ils avaient envie que l'on parle d'eux comme de simples enfants ; et il me semble qu'à travers son discours, le politique doit dire la même chose.
Ce qui justifie l'approche holistique et de ne pas réduire l'enfant de la protection de l'enfance à un enfant à problème, à un enfant en danger ou qui l'a été. Cela ne signifie pas que nous sommes dans le déni de son histoire, au contraire, c'est parce que nous la prenons particulièrement en compte que nous voulons avancer avec lui, et que nous devons l'aider à dépasser ce qu'il a connu parce que c'est trop douloureux.
Les jeunes majeurs qui nous parlent de leur parcours nous disent : « Nous étions complètement là-dedans, on nous renvoyait à ça. Et c'est très difficile, car on a parfois envie d'y penser et parfois non. » Nous avons par ailleurs la responsabilité individuelle et collective des signaux que nous adressons à travers ce que nous disons aux enfants et aux professionnels.
S'agissant de la judiciarisation, la loi de 2007 avait posé le principe de l'accord des parents pour engager une protection dite administrative en cas de danger pour leur enfant ; toutefois, la perspective de la déjudiciarisation s'est trouvée à l'origine de beaucoup de malentendus.
Pourquoi une telle démarche ? Il nous est apparu que, si nous souhaitons déplacer le curseur vers l'amont, si nous voulons pouvoir travailler plus sereinement lorsque la gravité des faits n'est pas telle qu'elle appelle le recours au juge, si les décisions de l'aide sociale à l'enfance sont suffisantes pour protéger l'enfant, celui-ci n'est pas forcément nécessaire, car il n'est jamais anodin qu'un enfant passe devant le juge, même dans le huis clos de son bureau. Même si l'enfant est la victime, cette confrontation le marque.
La déjudiciarisation avait aussi pour objet de désengorger les greffes et de décharger les juges des enfants. La France nous paraît d'ailleurs très judiciarisée par rapport à d'autres pays : pourquoi y arrivent-ils et pas nous ? Sommes-nous moins fiables pour garantir à des enfants une protection suffisante sans qu'il soit nécessaire de passer par le juge ?
D'ailleurs, en recourant au juge pour des situations qui ne relèveraient pas de lui, on le prive de solennité, alors qu'il doit être le recours des situations où l'on ne parvient pas à protéger l'enfant, où on ne peut pas mettre la protection en oeuvre, lorsque d'autres réponses ont abouti à des échecs, etc.
Le juge doit conserver cette place particulière dans laquelle il intervient parce qu'effectivement on n'arrive pas à protéger l'enfant.
Il est vrai que nous n'y arrivons pas. En 2005-2007, le taux de judiciarisation avait tendance à progresser sans cesse par rapport aux décennies précédentes – il s'élevait à 80 ou 85 %. Il me semble qu'on frise encore les 80 % aujourd'hui.
Pourquoi ? C'est une vraie question pour nous. Qu'est-ce que cela change, au fond, de faire intervenir le juge ? Pour les professionnels, cela change tout, surtout vis-à-vis des parents, parce que cela permet de mieux travailler avec eux. Cela change aussi la situation pour l'enfant, car il est reconnu comme victime.
Il nous arrive toutefois de remettre en question ces deux affirmations. Seul le juge est-il en capacité d'agir, par ce qu'il représente et par son pouvoir, qui constitue malgré tout une atteinte aux droits parentaux, qu'on le veuille ou le non ? Quel est l'intérêt pour l'enfant ? Cela permet-il d'assurer plus facilement sa protection et de mettre en place une décision de protection ? Peut-être. Cela signifie qu'on va moins travailler avec les parents sur le pourquoi. On obtient une adhésion, et non un accord – il y a une forte nuance. L'adhésion implique que les parents reconnaissent, a minima, qu'il y a un problème et que l'on met en place une décision de protection, puisque le juge a parlé. Quand on travaille avec l'accord des parents, c'est beaucoup plus compliqué : on va chercher leur accord, ce qui veut dire que l'on réalise tout un travail sur l'identification de la difficulté. Les parents la reconnaissent-ils, quelle est leur sensibilité au mal-être de l'enfant, que sont-ils prêts à changer, à transformer sans que l'on sollicite nécessairement le juge des enfants, mais en ayant un regard de parents ? Ce travail est très difficile à réaliser, il demande beaucoup de temps et de mobilisation, parce que rien n'est acquis. L'intervention du juge permet de marquer, à un moment donné, que cela suffit, et on passe beaucoup plus vite à la mise en oeuvre de la décision, même si les professionnels vont retravailler sur le pourquoi du comment, sur le danger.
Il y a une difficulté, parce que dans les esprits, dans les écoles, dans les formations et en France en général, on a le sentiment que l'on peut mieux travailler dans un cadre judiciaire. C'est peut-être quelque chose qui relève de la transmission. Même les jeunes générations sont convaincues qu'il faut faire appel au juge des enfants.
Là où on a des progrès à faire, peut-être – vous avez parlé d'embouteillage –, c'est sur la question des listes d'attente, qui n'est pas nouvelle. Ce qui nous affole, c'est que ces listes se prolongent dans le temps. Il n'est pas acceptable, lorsque les enfants sont vraiment en danger et que l'on décide de les séparer, que cela ne se mette pas en place. Cela nous inquiète sérieusement.
Il y a déjà des travaux qui ont été faits, des accompagnements, sur la manière dont on restitue la situation au juge, d'abord au procureur de la République mais aussi au juge. Est-on bien au point, dans les écrits que les institutions transmettent, via les professionnels, sur ce qu'il est important de dire au juge, pour qu'il prenne la mesure du danger, de sa gravité ? Nous avons toujours une interrogation sur les évaluations, sur ce qui constitue un danger pour un enfant. L'approche par les besoins et le développement est très importante : on va se concentrer sur l'impact pour l'enfant, et non sur la difficulté du lien entre les parents et lui – parfois, cela ne permet pas de traduire la gravité d'une situation. On va mettre davantage en avant la relation, qui peut être pathogène, ou difficile, entre le parent et l'enfant, la négligence. On n'accorde pas suffisamment de poids à ce qu'est une négligence lourde, aux effets qu'elle peut avoir sur un enfant. Les négligences peuvent être désastreuses. Souvent, on ne mesure pas assez, on ne met pas suffisamment en relief, en tout cas, ce qui fait qu'une négligence qui dure, pour un enfant, qui est forte, violente, sans qu'il y ait de coups ou d'abus sexuels, peut engendrer comme dégâts durables chez un enfant. Il faut se réinterroger sur la manière dont on saisit le juge, sur ce qu'on lui dit, sur ce qu'on écrit, pour l'alerter véritablement du danger. Peut-être qu'on n'a pas encore une bonne maîtrise de la graduation du danger. Cela pourrait être un moyen de désengorger les juridictions qui ont des difficultés au niveau des greffes, mais pas seulement. Il y a peut-être aussi une augmentation des situations à traiter, et on rejoint là votre question sur les MNA.
En 2005-2007, on avait à peu près 265 000 ou 270 000 enfants protégés – je parle des enfants, et non des mesures prononcées. Il y en a environ 308 000 aujourd'hui, selon les dernières données de l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE). Il y a quand même un différentiel. Des indicateurs nous seraient utiles pour comprendre cette progression. Cela paraît peu, mais cela représente quand même quelques milliers d'enfants.
Il faudrait peut-être que l'on s'interroge sur des solutions plus en amont, afin de désengorger la justice, et que l'on améliore les écrits et les temps de synthèse avec les magistrats. A-t-on la possibilité de rencontrer les services d'aide sociale à l'enfance, notamment, et les magistrats pour bien organiser les saisines, les procédures ? Que disent les protocoles départementaux qui sont peu ou prou mis en place ? Nous sommes convaincus qu'il y a des marges de progrès, mais cela suppose d'assurer un pilotage, une gouvernance, d'une manière encore plus fine.
Il y avait à peu près 5 000 MNA pris en charge dans le cadre de la protection de l'enfance en 2005-2007, de mémoire. Je suis bien embarrassée en ce qui concerne les chiffres actuels – mais Laure Sourmais les connaît peut-être mieux que moi. Y en a-t-il 15 000, 20 000 ou 25 000 qui sont protégés – je ne parle pas de ceux qui ne sont pas entrés dans le cadre de la protection de l'enfance ? Quel poids cela représente-t-il au sein de la protection de l'enfance en termes de temps, de disponibilité et de charges financières ?
Les MNA sont un problème qui déconcerte, qui déstabilise. Peut-être est-ce parce que tous les départements se sont trouvés concernés d'un seul coup, avec la clef de répartition, et que l'on a eu l'impression, pour cette raison, d'une arrivée massive de MNA. Ce qui remonte du terrain, c'est le fait que chaque semaine, ou chaque mois, il en arrive tel nombre.
Je ne sais pas si cela pèse considérablement sur la protection de l'enfance, mais nous observons que cela a pour effet de pervertir les réponses. Celles que l'on apporte à la question des MNA, aujourd'hui, parce qu'on agit dans l'urgence, ou parce qu'on a demandé aux préfets d'ouvrir des places, ne permettent pas nécessairement de répondre aux besoins de ces enfants, de ces jeunes. Ce sont souvent, là aussi, des solutions par défaut. On accueille dans des conditions qui, de notre point de vue, ne sont pas tout à fait acceptables, voire pas du tout. Il y a des ouvertures de places par dizaines, voire plus, avec un suivi quasiment inexistant, sur le plan éducatif.
Le problème est surtout lié à ce que cela induit pour la protection de l'enfance, même s'il faut prendre en compte les problématiques de ces jeunes d'une façon plus spécifique, de notre point de vue. Il faut qu'on apporte des réponses en adéquation avec les besoins. Par définition, nous disons que si ce sont des enfants, il faut qu'on les considère aussi comme tels, selon leurs besoins, dont certains sont plus spécifiques que ceux de la plupart des autres enfants, et qu'il faut qu'on apporte des réponses appropriées.
Je vais revenir sur la question de l'impact. On est à peu près à 16 000 MNA pris en charge à la fin de l'année 2018. Quand on regarde le nombre d'enfants pris en charge dans le cadre de la protection de l'enfance, on peut se dire que cela ne représente pas grand-chose. Je pense qu'il y a surtout un effet « ciseaux » : on a connu une très forte augmentation de l'arrivée des MNA au cours des dernières années et, en même temps, toute une démarche a été engagée par les départements pour réduire le nombre de places dans les établissements. Il y a donc moins de places et plus de MNA : on arrive, nécessairement, un peu à une gestion de crise. C'est peut-être ce qui fait qu'on aborde directement le sujet des MNA aujourd'hui quand on parle de la protection de l'enfance, et qu'ainsi on n'évoque surtout pas les autres questions.
Ce qui a un impact sur les départements, c'est aussi qu'ils doivent réaliser l'évaluation – ils ne travaillent pas seulement sur l'accompagnement, mais aussi sur toute la phase de l'évaluation. On sent que la phase de l'accueil d'urgence et de l'évaluation est peut-être ce qui pose le plus de problème aux départements. Je n'ai pas l'impression que l'accompagnement des jeunes, une fois qu'ils sont entrés dans le dispositif, pose vraiment problème.
La grande difficulté, par ailleurs, est que l'on ne pense pas « l'après », c'est-à-dire ce qui se passe une fois que les jeunes ont 18 ans.
Nous avons créé un groupe de travail sur les MNA et nous nous permettrons de vous transmettre nos documents.
On accueille les MNA, une fois qu'ils sont entrés dans le dispositif de protection de l'enfance, d'une manière qui est variable selon les départements, car les politiques menées sont très différentes. Il y a parfois des appels à projets qui sont vraiment a minima pour l'accueil des MNA, et certaines associations de protection de l'enfance qui font partie de notre réseau refusent de répondre d'y répondre parce qu'elles considèrent qu'elles ne peuvent pas, compte tenu du prix indiqué, loger et accompagner les enfants – il faut aussi les accompagner, car ils ont de vrais besoins, notamment en matière de santé.
Il y a également, je l'ai dit, toute la question de l'insertion : il faut penser ce qui se passe après. Or on ne réfléchit pas à la sortie.
La question des MNA embolise les débats dès lors qu'il est question de protection de l'enfance, mais les chiffres ne sont pas si élevés, en réalité. En tout cas, on peut questionner leur importance.

Je suis la « madame MNA » de cette mission d'information (Sourires), mais je ne vais pas revenir sur ce sujet, car vous venez d'en parler.
Je voudrais revenir, en revanche sur la gouvernance et le pilotage ainsi que sur l'apport des associations dans la réflexion sur les politiques publiques de protection de l'enfance. Vous avez raison : cela marche très bien au niveau national, où vous êtes entendues régulièrement, mais ce n'est pas le cas au niveau départemental. Comme je le fais toujours observer, on n'axe jamais sa campagne, quand on veut devenir conseiller départemental, sur la protection de l'enfance. Ce n'est pas vendeur.
La protection de l'enfance est-elle un échec de la décentralisation ? Était-ce mieux avant ? En même temps, je ne pense pas qu'il y ait un Président de la République qui ait fait campagne sur la protection de l'enfance. Faut-il se reposer la question du rôle du département comme chef de file ? Faut-il choisir un autre niveau, celui de la région, par exemple ?
On est trop près du politique au niveau local. C'est ce qu'on nous dit. Nous sommes peut-être préservés au niveau national, même si nous sommes à proximité des ministres. Il y a d'autres choses qui se jouent au niveau national et qui permettent d'amortir le lien direct. Au niveau local, la question qui se pose est celle de la proximité avec les élus ou de leur réaction par rapport à ce que fait un acteur associatif dans un territoire donné. Les associations craignent parfois d'exprimer ce qui ne va pas. Nous ne nous l'interdisons pas, en revanche – vous pourrez lire nos prises de position –, même si nous restons toujours dans un cadre respectueux des institutions.
Je vais vous en donner une illustration. On nous dit que les appels à projets ne vont pas, qu'ils pervertissent le dispositif, parce qu'il y a des ententes préalables, qu'on sait qui va gagner, que la règle de la concurrence ne joue pas, que ce n'est pas toujours le mieux-disant mais le moins-disant qui l'emporte, etc. Quand on réunit un groupe de travail et qu'on demande ce qui est attendu de la fédération sur ce point, à un niveau politique, au niveau des préfets, on nous dit de ne surtout rien faire, même au niveau national, pour ne pas créer de préjudice. Cela nous interpelle.
Cela veut dire, quelque part, que la proximité entre le département et les familles est la juste proximité, si je puis dire. La région est trop éloignée – nous ne croyons pas à cette solution – et le maire est trop près, pour des raisons diverses – certains maires, en tout cas. On se dit alors que le département est le bon niveau de décentralisation pour l'aide sociale à l'enfance : il n'est pas suffisamment près des familles, heureusement – il y a une espèce d'amortisseur par rapport aux situations – et, en même temps, il peut avoir une vision d'ensemble à l'échelle d'un territoire, il peut y avoir de la cohérence. Nous pensons que c'est la juste distance, et nous ne faisons pas partie de ceux qui disent qu'il faut que tout revienne à l'État. On se dit qu'il faut rester dans cette proximité, même si on doit revoir le pilotage de la gouvernance.
Sur ce point, on voit bien que quelque chose s'enclenche mal, d'une manière générale, avec les acteurs des territoires. Piloter, pour nous, signifie avoir des objectifs – c'est un peu ce qui existe avec les schémas, dans une certaine mesure –, et bien définir avec tous les acteurs ce qu'ils vont faire, comment chacun est partie prenante dans la mise en oeuvre de la politique, comment on observe les résultats, comment on réajuste et comment on débat. C'était le rôle dévolu à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance, mais cela ne se passe pas toujours ainsi. Nous pensons que les associations ne se sentent pas suffisamment libres de s'exprimer quand ça ne va pas – quand ça va bien, elles savent le dire, mais elles n'osent pas le faire dans le cas contraire. Si nous voulons avoir un véritable échange, un véritable dialogue – car c'est bien de cela qu'il s'agit –, il faut dire, aussi, les choses qui ne vont pas. Je pense que les politiques sont capables de l'entendre.
L'enjeu, ce sont les territoires : nous sommes très clairs sur ce point. Ce qui se passe au niveau national est essentiel. Cela définit le cadre juridique et les politiques publiques, pas de problème, mais la question est de savoir quelle est la déclinaison au niveau des territoires. Je vais me référer de nouveau à l'étude prospective que nous avons achevée il y a deux ans : ce qui se dégage de nos travaux est que l'enjeu des politiques sociales, quelles qu'elles soient, et c'est particulièrement vrai pour celles qui concernent l'enfance, parce qu'il y a l'école, le soin, les loisirs, les familles, l'environnement et beaucoup d'autres éléments encore, c'est la proximité, et donc les territoires. Une politique de protection de l'enfance se pilote vraiment à partir du territoire et, pour nous, le département est quand même le bon échelon.
Nous n'avons pas entendu de remise en question de la décentralisation. Certains disent parfois que l'État serait plus à même d'assurer cette mission, mais nous demandons alors combien d'années il faudrait pour réinvestir, au niveau de l'État, les compétences que celui-ci a perdues. Je me permets d'en parler car j'ai fait partie du ministère des solidarités au moment où la décentralisation a eu lieu. J'ai été le témoin de la décentralisation et de tous les débats qu'il y a eu à ce moment-là. Au sein du service « enfance », tout partait vers les départements : il y a eu des transferts de compétences et de personnel. Nous nous déterminons par pragmatisme, et non pas en nous demandant si l'État serait mieux. La question est de savoir combien de temps on perdrait et ce que cela induirait si l'on reconfiait à l'État cette mission, qui n'est quand même pas si simple, on le voit bien. Il faudrait sans doute réétoffer les services de l'État – lesquels, d'ailleurs ? Cela nous inquiète… Je pense que la protection de l'enfance ne va pas assez bien, qu'elle n'est pas suffisamment solide aujourd'hui pour tenir le coup en cas de recentralisation. C'est notre point de vue.
On voyait qu'il y avait déjà des différences entre les territoires avant la décentralisation en ce qui concerne la protection de l'enfance. Aujourd'hui, et cela va vous parler, puisque vous êtes « madame MNA » (Sourires), l'État a des politiques très différentes d'une préfecture à l'autre dans ce domaine – et pourtant c'est l'État. On met toujours le département et l'État dans une sorte de face-à-face, en pensant que l'État a une cohérence, une ligne d'ensemble, mais on voit que ce n'est pas toujours le cas.

Je suis d'accord sur la nécessité absolue de toujours partir des besoins fondamentaux de l'enfant. On oublie souvent, dans nos politiques et nos approches, cette notion fondamentale, qui est au coeur des dispositifs. Cela fait du bien d'entendre ce que vous avez dit.
Autre point qui me semble absolument fondamental, comment repérer les enfants en danger afin de les protéger ? On peut avoir les meilleures politiques de la terre, mais beaucoup de choses peuvent se passer si les temps d'attente sont de trois, six ou neuf mois.
Par ailleurs, il est important d'avoir un cadre structuré et partagé – pour moi, ces deux aspects sont tout aussi importants – afin de mesurer l'évolution de l'enfant. La mesure d'impact reste quand même floue : en quoi peut-on être satisfait de notre politique pour les droits de l'enfant, en quoi peut-on estimer qu'elle est efficace ? Je rappelle également que l'enfant a besoin de repères et de savoir, quelque part, à quoi se raccrocher – cela peut être structurant, aussi, dans un parcours qui est chaotique du fait que l'enfant est placé.
En ce qui concerne l'organisation que vous représentez, quel est votre plan à cinq ans ? Quels objectifs prioritaires vous êtes-vous donnés ? Sans vous interroger sur votre vision, votre mission et vos valeurs, j'aimerais savoir quels sont les attendus et les objectifs pour vous ? Comment voyez-vous leur pertinence et leur efficacité ? En quoi considérez-vous que vous avez atteint vos objectifs ?
D'une manière plus personnelle, j'ai vu que l'association Cultures, Loisirs, Animations de la Ville d'Issy-les-Moulineaux (CLAVIM) fait partie de vos membres. Cette ville étant située dans ma circonscription, j'aimerais en savoir plus.
Je vais commencer par votre dernière question. Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé, personnellement, sur les droits de l'enfant avec CLAVIM, notamment dans le cadre de la semaine des droits de l'enfant. Je m'étais investie dans le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et on travaillait beaucoup à cette époque sur l'accompagnement des villes qui promouvaient les droits de l'enfant. J'ai eu donc l'occasion de côtoyer cette association.
Nous évoluons vers la prévention et vers une approche des jeunes et des enfants qui s'interroge beaucoup plus sur la relation entre les parents et eux – nous sommes en train de changer, nous-mêmes, depuis quelques années – depuis 2010, en gros. Nous avons modifié notre approche autour de la question des besoins de l'enfant, qui sont un dénominateur commun pour tout le monde. On s'est rendu compte que lorsqu'on est dans un conflit, à cause de divergences de points de vue, il faut revenir à l'enfant, y compris avec les parents. Ce que nous essayons d'apprendre aux professionnels, c'est qu'il peut y avoir des malentendus, des crispations, quand on parle des actes qui ont été commis, mais quand on se déporte et qu'on pose la question de savoir ce qu'il faudrait pour que l'enfant aille mieux, cela change déjà tout. C'est très simple : nous n'avons pas d'ambitions démesurées.
CLAVIM, comme d'autres organisations, a vu la CNAPE évoluer vers l'amont, vers des actions qui sont au plus près de l'enfant, c'est-à-dire en relation avec l'école, la rue ou la santé, et cela intéresse, parce qu'on travaille sur ces problématiques. Nous avons des partenariats qui évoluent beaucoup. Nous travaillons maintenant avec l'Association nationale des équipes contribuant à l'action médico-sociale précoce (ANECAMSP), pour les enfants en situation de pré-handicap ou de handicap, et beaucoup d'autres organisations avec lesquelles nous n'avions pas de partenariats il y a quelques années.
Ce qui nous paraît important, c'est que tous les professionnels de l'enfance – je pense notamment aux médecins, aux magistrats, aux éducateurs, aux psychologues, bref à tous ceux qui sont autour de l'enfant, à un titre ou un autre – puissent mieux connaître les droits de l'enfant ou plutôt comment on les met en oeuvre. La question n'est pas tant de connaître l'ensemble des dispositions de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), mais de savoir comment on les met en pratique quand on est un médecin qui reçoit un enfant en présence de sa mère, comment on tient compte de ce qu'il dit, de sa parole, de sa façon de s'exprimer. Cela vaut aussi pour les éducateurs, pour les psychologues, pour les enseignants – cela vaut pour tous. La France a beaucoup de retard par rapport à d'autres pays européens en ce qui concerne la mise en pratique des droits de l'enfant – on a mis vingt-cinq ans à les découvrir.
Ce n'est pas un gadget, mais quelque chose d'absolument important : c'est toute une philosophie de l'approche, toute une vision de l'enfant, tout un portage politique, cela sous-tend l'ambition qu'un pays peut avoir pour l'enfance et la jeunesse. Ce n'est donc pas anodin. On aimerait que ces droits soient mieux connus. Peut-être qu'on peut y arriver d'ici à 5 ans – on va fêter les 30 ans de la CIDE et il y aura peut-être déjà tout un battage sur ce sujet. C'est une façon, aussi, de sensibiliser les parents à ce qu'est un enfant, en tant qu'individu, en tant que personne, en tant que sujet de droit. Il me semble que si on travaillait selon une approche par les droits, avec tout ce que cela implique – ce n'est pas : « j'ai le droit de faire » : cela concerne les besoins essentiels, l'identité, tout l'épanouissement –, si on promouvait bien les droits de l'enfant en France – nous agissons au niveau européen : nous faisons partie du réseau « Eurochild » et nous travaillons auprès de la Commission européenne –, cela représenterait déjà un grand progrès. Il faudrait un objectif de bien-être pour tous les enfants.
Sur ce point, on devrait être moins discriminant : on a une approche encore trop catégorielle. On n'approche pas beaucoup les enfants des milieux favorisés, on ne les connaît guère, alors qu'on sait très bien qu'il existe de graves problèmes. Il y a des violences intrafamiliales dont les enfants sont témoins, dans le huis clos, il y a la pression subie pour exceller dans des arts ou dans le sport, ce qui est absolument insoutenable – cela concerne plutôt les milieux favorisés. Il faut vraiment diffuser les droits de l'enfant dans tous les milieux, dans tous les endroits et à tous les moments. C'est, pour nous, un objectif que l'on pourrait peut-être atteindre d'ici à 5 ans – soyons optimistes.
Il faudrait vraiment mettre en avant toute la question des besoins fondamentaux et du développement de l'enfant. C'est notre objectif prioritaire. Quand on saura aborder cette question, quand on saura travailler dessus, quand le médecin, le psychologue, l'éducateur, le travailleur social et la technicienne de l'intervention sociale et familiale (TISF) auront un même fil rouge – je vous parle en l'occurrence d'un objectif à 1 an, ou au plus à 2 ans – on aura progressé. On aimerait élaborer, en collaboration avec d'autres acteurs, un cadre référentiel dans ce domaine, parce qu'on n'y arrive pas aujourd'hui. Il va falloir donner une impulsion, faire quelque chose, pour qu'on ait tous le même regard, les mêmes attentes, les mêmes objectifs, les mêmes enjeux, quel que soit l'enfant.
On aimerait aussi, mais c'est peut-être un sujet qui n'entre pas dans le cadre de votre mission, donner vraiment aux jeunes majeurs la possibilité de trouver leur place dans la société. C'est un enjeu essentiel pour nous, et c'est même toute la raison d'être de la protection de l'enfance. C'est toute la question de l'autonomie, sur laquelle on ne peut pas travailler seulement à 18 ans – il faut le faire tout au long de la vie, en douceur, progressivement, dans le cadre de tous les apprentissages. Il faut impérativement que l'on arrive à faire en sorte que les jeunes sortent de la protection de l'enfance en ayant envie de la société, en ayant le sentiment qu'ils sont des jeunes à part entière, qu'ils peuvent avoir de l'ambition et le désir d'être dans la société. On voit bien qu'ils se mettent eux-mêmes en retrait, qu'il y a du rejet. On constate que tous ces processus sont à l'oeuvre et on s'en désole, comme beaucoup d'acteurs.
Il y a aussi la prévention. Il faut arriver à insuffler cet esprit en France. Nous sommes un pays où la prévention n'est pas considérée. Elle est même, parfois, remise en question, par exemple au niveau médical, avec le sujet de la vaccination des enfants – mais on entre là dans un autre débat. On ne croit pas trop à la prévention alors qu'il faudrait vraiment investir dans ce domaine. On commence à faire des calculs : les Polonais ont été les plus forts en ce qui concerne le retour sur investissement pour la société, plus tard. On commence aussi à avoir quelques projets. On voit bien que ce qu'on investit pour les petits, à un moment donné, pour les accompagner dès la crèche, pour les apprentissages fondamentaux, afin que les enfants ne soient pas en échec scolaire, pour les accompagner dans les loisirs, pour accompagner les parents face à l'isolement, aux difficultés, à la précarité, tout ce que l'on peut étayer en amont, dans un esprit positif et non en stigmatisant, socialement, c'est autant qui est gagné pour les enfants et pour leur avenir. Cela nous semble absolument essentiel.
Je voudrais ajouter la question de la participation, qui est centrale pour nous : comment les jeunes, les enfants, les familles peuvent être associés – cela ne doit pas être un voeu pieux, il faut les associer dans de bonnes conditions, pour qu'ils puissent parler, pour qu'on puisse préparer des choses, etc. C'est une autre thématique sur laquelle on souhaite vraiment travailler
C'est la question de la prise en considération de l'enfant, de son respect. On doit vraiment avoir une société respectueuse de ses enfants. On nous objecte souvent la notion de l'enfant-roi mais quand on regarde les choses de plus près, on voit que ce n'est pas si vrai que ça, au fond. Je vous renvoie aux travaux du centre de recherche Innocenti, de l'UNICEF, qui est installé à Florence : il produit annuellement des rapports, depuis une dizaine d'années, sur le bien-être des enfants, des jeunes, notamment dans les pays européens, et plus généralement dans ceux de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
La France consacre beaucoup d'argent à l'éducation et à l'aide aux familles. Or on voit que ce n'est pas toujours une question d'argent, mais aussi de cap, de modalités de redistribution ou de priorités politiques – elles ne sont peut-être pas si clairement définies que ça en direction de l'enfance. Cela nous questionne. La France, en dépit des bons financements qui existent – elle est bien située sous l'angle des financements éducatifs, sociaux et autres –, reste à un niveau très moyen, voire en deçà de la moyenne, pour tout ce qui concerne le ressenti du bien-être, la manière dont les enfants et les jeunes se perçoivent dans notre société, dont ils vivent, dont ils se sentent reconnus, considérés et respectés – on n'est pas très bien placé pour cet indicateur, ce qui doit nous conduire à nous interroger.

J'ai quelques questions très techniques et très rapides – je pense que cela peut valoir aussi pour les réponses.
Dans les remontées du terrain, constatez-vous des placements d'enfants qui ne seraient pas justifiés ou qui le seraient par un problème de logement, par de la précarité, mais pas du tout par de la maltraitance ou par un déficit éducatif ?
Que pensez-vous de l'idée de placer les institutions concernées sous le contrôle de l'État au lieu de celui des départements ?
Que pensez-vous de la proposition de rendre obligatoire la présence d'un avocat auprès de l'enfant lors des procédures judiciaires ?
Y a-t-il des choses à alléger, concrètement, pour les travailleurs sociaux en ce qui concerne la paperasserie administrative ?
Enfin, pensez-vous qu'il serait temps d'avoir un référentiel d'évaluation unique en matière d'informations préoccupantes (IP) ?
S'agissant des placements injustifiés, il en existe peut-être qui sont par défaut, c'est-à-dire faute de trouver d'autres réponses ou dans l'urgence. Malheureusement, nous n'avons pas de données permettant de nous renseigner. On suppose que cela existe toujours : certains professionnels le disent, en tout cas.
La précarité est le sujet hypersensible. Place-t-on des enfants parce qu'ils sont pauvres ou qu'ils vivent dans des conditions pauvres ? Il me semble que l'on peut procéder à un placement, à une séparation entre l'enfant et sa famille, parce que ses conditions de vie sont telles qu'elles menacent, au sens de l'article 375 du code civil, son éducation, sa sécurité, sa santé, son développement.
Faut-il, pour autant, faire le lien entre placement et précarité ? On observe que la proportion des enfants issus de milieux précaires, en situation de pauvreté, ou d'enfants pauvres, est évidemment plus élevée que la moyenne nationale. On l'a dit tout à l'heure : la protection de l'enfance, dans une grande majorité de cas, concerne des enfants qui sont issus de milieux momentanément ou durablement en situation précaire – on entend par là toutes les vulnérabilités, notamment l'isolement, la difficulté à avoir un emploi stable, des ressources suffisantes, un logement, à nourrir suffisamment l'enfant, comme il doit être nourri pour se développer, à l'habiller convenablement, et non de manière inadéquate, ou à ce qu'il puisse fréquenter une école. Je dirais que ce n'est pas la précarité en tant que telle, ou la pauvreté, mais ses effets qui peuvent conduire à un placement. On ne peut pas le nier.
Lorsque les parents ne peuvent pas assurer des conditions de vie suffisantes pour l'enfant, l'article 27 de la CIDE prévoit, à défaut, que l'État, la puissance publique, doit aider les parents, pour permettre de compenser. Par État, il faut entendre l'État et les collectivités territoriales, l'ensemble des pouvoirs publics. Ce n'est pas toujours simple, ne serait-ce qu'en matière de logement.
Celui-ci fait partie des éléments qui sont mis en avant quand il est question des conditions de vie de l'enfant – la promiscuité l'insécurise, elle ne lui permet pas d'apprendre convenablement et de faire ses devoirs, etc. La question du logement se pose fréquemment. Il est souvent très précaire, très instable, insalubre, et on entre donc objectivement dans les critères de l'article 375 du code civil.
J'appréhende essentiellement le contrôle de l'État à travers le travail des inspections générales. La mission de contrôle n'est pas suffisamment assurée. Les inspections repèrent quatre ou cinq sites chaque année, ou quatre ou cinq problématiques sur lesquelles elles vont travailler – je pense notamment à l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS). De notre point de vue, le contrôle est insuffisant. Cela ne signifie pas que l'on veut plus de contrôle en soi, mais il est nécessaire pour progresser. Curieusement, les associations sont souvent demandeuses de contrôles – de contrôles constructifs, afin de corriger ce qui ne va pas.
Quant aux départements, on a du mal à identifier ce qu'ils contrôlent. La seule chose qu'ils semblent se limiter à contrôler est liée à la tarification de la gestion, en période budgétaire. Il y a un temps d'échange, parfois assez dur, où on n'est pas véritablement dans le cadre du contrôle, mais plutôt dans des demandes de justifications, ce qui est différent du contrôle de la manière dont on met en oeuvre une politique publique : on est surtout sur des lignes budgétaires, des enveloppes. On ne peut pas dire qu'il y ait réellement un contrôle.
En ce qui concerne le contrôle du préfet, c'est-à-dire le contrôle de légalité, pour l'essentiel, je n'ai pas le sentiment qu'il s'exerce nécessairement d'une manière systématique, continue, sur les actions menées au titre de la protection de l'enfance. C'est vraiment un contrôle limité, sauf quand il faut fermer des établissements ou bien, en vertu de la loi de 2016, en cas de situations de maltraitance – il faut faire des remontées auprès des services de l'État. On n'a aucune visibilité, aucun retour, sur la question de savoir si cela se met en place, si l'État contrôle et s'il est saisi. Il y a une grande interrogation.
Nous défendons depuis des années, avec le barreau de Paris, la présence d'un avocat auprès de l'enfant, notamment lorsque les parties s'opposent, lorsque l'enfant n'a pas de parent auprès de lui. Certains disent que l'administrateur ad hoc joue ce rôle, mais il nous semble qu'il y a des nuances entre ce que défend l'avocat et ce que défend l'administrateur ad hoc, en ce qui concerne les intérêts de l'enfant qu'il faut préserver. Nous sommes plutôt favorables à la présence d'un avocat, mais il est très rare que l'enfant en bénéficie. Nous avons réalisé une enquête auprès de quelques services d'aide sociale à l'enfance : ils nous ont fait comprendre, négativement, que la présence d'un avocat complique sérieusement la situation et n'est pas forcément dans l'intérêt de l'enfant. Cette réponse nous avait un peu étonnés, mais peut-être que cela complique, effectivement la procédure – je ne sais pas. C'est une vraie interrogation pour nous. En tout cas, la loi n'interdit pas la présence d'un avocat, bien au contraire.
Il n'y a pas nécessairement une information sur l'existence de ce droit.
Par ailleurs, il n'existe pas beaucoup d'avocats pour enfants. On en connaît quelques-uns. Ils nous disent qu'ils ont du mal à assurer leurs fins de mois.
Pour ce qui est de la paperasserie et des procédures, les travailleurs sociaux se plaignent beaucoup du surcroît de documents qu'ils doivent remplir : les rapports de suivi se sont ajoutés, il y a aussi le projet pour l'enfant (PPE) – même s'ils ne l'établissent pas, ils sont concernés –, les rapports d'évaluation annuels ou encore les rapports aux juges et aux départements. Les travailleurs sociaux ont le sentiment de passer une bonne partie de leur temps à écrire, plutôt qu'à être auprès des familles. C'est aussi une question d'organisation. Est-on plus ou mieux informatisé aujourd'hui dans les services d'aide sociale à l'enfance ? Quasiment tous les rapports passent par eux. Quels sont leurs moyens logistiques ? Si on doit délester un peu les travailleurs sociaux, on ne pourra jamais le faire pour ce qui leur appartient en propre, à savoir évaluer la situation et rendre compte de ce qu'ils ont pu observer – je ne vois pas quel autre professionnel pourrait le faire.
Il y en a, bien sûr. Un premier professionnel évalue, puis on réévalue parce que le cas passe à un autre professionnel ou à un autre service. Ceux qui interviennent à domicile refont, parfois, des évaluations alors qu'elles ont déjà été faites. Il y a peut-être des doublons que l'on pourrait éviter. C'est vraiment une question d'organisation, mais aussi de pilotage, d'indicateurs, de stratégie de mise en oeuvre pour cette politique publique au niveau des départements. Il nous semble que l'organisation est à repenser. La question des cadres se pose.
Pardonnez-moi : quelle était votre question à propos du référentiel ?

On voit bien qu'une information préoccupante n'est pas nécessairement traitée de la même façon selon les territoires. Certains interlocuteurs demandent un référentiel unique, et d'autres non. Quel est votre avis sur ce point ?
Pour moi, cela rejoint l'idée qu'il faut un cadre référentiel intégré – nous sommes en train d'y travailler, conceptuellement, avec d'autres acteurs – pour repérer, évaluer, décider et suivre l'enfant. C'est notre ambition. Quand on évalue ou quand on saisit d'une information préoccupante le service de l'aide sociale à l'enfance, le procureur de la République ou le juge des enfants, on est toujours dans la même approche, qui est l'atteinte aux besoins fondamentaux, au développement de l'enfant, et il y a toujours, dans les différents temps, des questions incontournables à se poser. Il existe tout un cheminement, tout un questionnement que l'on essaie actuellement de penser, pour que les professionnels soient attentifs à certains aspects de la vie de l'enfant.
Peut-on établir un référentiel propre aux informations préoccupantes ? Pour nous, ce ne serait pas une bonne chose. Là encore, les approches risqueraient d'être différentes d'une situation à une autre, d'un cycle à un autre. L'idée est d'avoir toujours un fil rouge continu qui nous amène tous, quel que soit le métier concerné, à regarder l'enfant sous l'angle de ce qui est essentiel en termes de sécurité, notamment affective, de soin, d'apprentissage. Il faut avoir tous ces critères, tous ces repères, sur lesquels doit s'interroger aussi bien celui qui évalue que celui qui transmet ou celui qui décide. Cela signifie que les magistrats doivent être complètement impliqués dans cette approche. Si toute la chaîne de traitement, depuis le stade de la prévention jusqu'à celui des jeunes majeurs, est rompue parce que, à un moment donné, des professionnels, et non des moindres – les magistrats –, sont déconnectés de ces enjeux, alors c'est toute la chaîne qui est fragilisée. De notre point de vue, tout le monde est concerné. C'est pour cette raison que nous parlons d'un cadre de référence « intégré ».
La réunion s'achève à seize heures.
————
Membres présents ou excusés
Mission d'information de la Conférence des présidents sur l'aide sociale à l'enfance
Réunion du jeudi 13 juin 2019 à 14 heures
Présents. – Mme Delphine Bagarry, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Perrine Goulet, Mme Florence Provendier, M. Alain Ramadier.
Excusés. – Mme Jeanine Dubié, Mme Françoise Dumas, M. Franck Marlin.