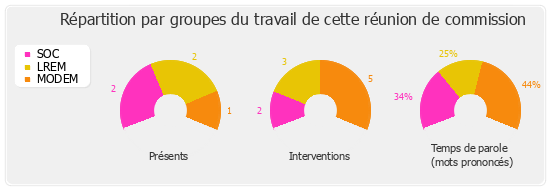Commission d'enquête sur l'impact économique, sanitaire et environnemental de l'utilisation du chlordécone et du paraquat comme insecticides agricoles dans les territoires de guadeloupe et de martinique, sur les responsabilités publiques et privées dans la prolongation de leur autorisation et évaluant la nécessité et les modalités d'une indemnisation des préjudices des victimes et de ces territoires
Réunion du mardi 9 juillet 2019 à 9h05
Résumé de la réunion
La réunion
Mardi 9 juillet 2019
La séance est ouverte à neuf heures cinq.
Présidence de M. Serge Letchimy, président de la commission d'enquête
————
La commission d'enquête sur l'impact économique, sanitaire et environnemental de l'utilisation du chlordécone et du paraquat, procède à l'audition de M. Thierry Woignier, directeur de recherche à l'Institut de recherche et de développement (IRD) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), responsable du laboratoire « Physique des sols et milieux poreux » de l'Institut méditerranéen de la biodiversité et d'écologie marine et continentale (IMBE CAEC-Le Lamentin Martinique), et de M. Hervé Macarie, microbiologiste à l'IRD Marseille (IMBE), spécialiste de la bioremédiation.

Mes chers collègues, je souhaite la bienvenue à Monsieur Thierry Woignier, directeur de recherche à l'Institut de recherche et de développement (IRD) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), responsable du laboratoire « Physique des sols et milieux poreux » de l'Institut méditerranéen de la biodiversité et d'écologie marine et continentale (IMBE), et à M. Hervé Macarie, microbiologiste à l'IRD Marseille, spécialiste de la bioremédiation.
Je vous rappelle que ces auditions sont publiques et diffusées en direct sur le canal de l'Assemblée nationale. Elles seront disponibles sur le portail vidéo et la commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie des comptes rendus qui en seront établis.
Je dois, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, vous demander de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
MM. Thierry Woignier et Hervé Macarie prêtent successivement serment.

Monsieur Woignier, vous avez la parole pour un exposé liminaire. Vous devrez ensuite répondre aux questions des membres de la commission d'enquête.
Je remets à chacun d'entre vous le support que j'avais préparé sur notre approche de la remédiation afin de faciliter la compréhension et la discussion. Nos recherches visent à acquérir des connaissances sur la contamination à différentes échelles, du sol jusqu'à la parcelle. Nous avons développé au Lamantin, en Martinique, où je travaille depuis quinze ans, quatre sujets d'étude : outre la contamination des sols, nous avons étudié le procédé de réduction chimique in situ ou in situ chemical reduction (ISCR) en collaboration avec le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et la biodégradation, sur lesquels mon confrère Monsieur Hervé Macarie reviendra plus en détail, ainsi que la technique de la séquestration, dont j'expliquerai en quoi elle constitue une solution alternative à la dépollution.
La molécule de chlordécone a pour principales caractéristiques une très faible biodégradabilité – on ne se débarrassera donc pas de cette molécule en attendant qu'elle soit dégradée par l'érosion ou par des micro-bactéries –, une très faible solubilité – elle ne peut être facilement éliminée par l'eau – et une grande affinité pour la matière organique, ce qui explique sa persistance dans les sols vingt-cinq ans après l'arrêt d'utilisation du pesticide. Les travaux menés par Yves-Marie Cabidoche de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ont mis en évidence qu'il faudrait des décennies pour que cette molécule soit éliminée naturellement par lixiviation. Parce que la contamination des sols a pour effet une contamination secondaire des aliments et des ressources en eau, il est nécessaire de diminuer la concentration en chlordécone dans les sols.
Il faut savoir toutefois que la contamination diffère selon la nature des sols, selon leurs propriétés. Trois types de sols ont été contaminés en Martinique : les andosols situés dans le nord, près de la montagne Pelée, les ferralsols et nitisols, plus au sud et plus anciens. Les taux de concentration des andosols sont deux à cinq fois plus élevés que ceux des autres types de sols, mais les taux de transfert y sont paradoxalement moins importants. On observe, en d'autres termes, que les sols les plus pollués sont les moins polluants. Étant physicien de formation, j'ai pensé que ce paradoxe pouvait s'expliquer par la nature de l'argile. L'argile des andosols du nord a précisément une microstructure très différente de l'argile classique ou kaolin qui est la caractéristique des sols du sud : elle est hiérarchique et poreuse au lieu d'être homogène, les plus petites particules s'agrégeant pour en former des moyennes puis des grosses. Dans les andosols, 70 % du chlordécone est fixé dans les plus petites particules, alors que cette répartition est assez homogène dans les sols du sud. À cette très petite échelle, qui est de l'ordre de la dizaine ou de la centaine de nanomètres, soit le millième de l'épaisseur d'un cheveu, il est très difficile d'aller chercher la molécule.
Deux paramètres physiques sont à prendre en compte quand on veut transporter une molécule d'un point à un autre ou, en l'occurrence, l'extraire ou la détruire : la perméabilité et la diffusion. La perméabilité se conçoit facilement avec l'image du tuyau d'arrosage : si le tuyau a un petit diamètre ou qu'il est obstrué, la perméabilité diminue. Ainsi, plus une structure est tortueuse, plus elle est complexe, moins la perméabilité est élevée. Quant à la propriété de diffusion, vous l'observez dans votre tasse de café le matin si vous y ajoutez une goutte de lait sans remuer le liquide. Nul besoin d'un transport mécanique, d'un écoulement d'eau pour transporter des éléments chimiques ou biologiques. À cette petite échelle, on ne peut mesurer ces paramètres mais on peut les calculer à l'aide de modèles qui ont permis de démontrer que la perméabilité et la diffusion des structures des andosols sont mille fois plus faibles que dans les argiles à la porosité classique. Nous sommes par conséquent confrontés à une difficulté réelle pour extraire les molécules de chlordécone des sols du nord, et il convient de tenir compte de ces paramètres physiques pour envisager des solutions.
Je laisse la parole à mon confrère sur les méthodes de décontamination que sont la bioremédiation et le procédé ISCR. Je conclurai ensuite avec la question de la séquestration.
Je suis pour ma part microbiologiste à l'Institut de recherche et de développement, affecté à l'IMBE, et je travaille sur le chlordécone depuis une dizaine d'années. Quand je suis arrivé en Martinique en 2009, puis pour quatre années en 2011, il était communément admis que la molécule de chlordécone ne pouvait être biodégradée, même si on trouvait dans la littérature la démonstration que des transformations étaient possibles. Tant la structure de la molécule – molécule en cage comportant dix atomes de chlore – que ses propriétés – faible solubilité, forte hydrophobicité et affinité pour la matière organique – indiquaient que celle-ci serait difficile à dégrader biologiquement.
Le rôle du microbiologiste est de lancer sa canne à pêche pour trouver des microorganismes capables de dégrader la molécule étudiée. Si la structure n'est pas attaquable, une telle stratégie est toutefois vouée à l'échec. Nous avons donc dans un premier temps étudié sur le plan théorique, en thermodynamique, si les réactions envisagées – destruction complète de la chlordécone en composés minéraux ou dégradation légère de la structure par arrachage d'atomes de chlore ou réduction de la fonction cétone – étaient ou non réalisables chimiquement. Les résultats de ces travaux, publiés en 2012, ont permis de conclure que ces réactions pouvaient avoir lieu et qu'elles libéreraient des quantités d'énergie suffisantes pour permettre une croissance bactérienne. Il apparaissait donc possible, en d'autres termes, d'attaquer la molécule de chlordécone au moyen de microorganismes. Comme je l'ai indiqué, des travaux avaient été réalisés aux États-Unis à l'époque de l'incident de Hopewell en Virginie. Partant de ces premières études, j'ai pour ma part montré que des bactéries méthanogènes étaient capables de dégrader la chlordécone. Les chercheurs impliqués avaient utilisé une méthanogène particulière, mais les enzymes, la machinerie cellulaire qui avaient attaqué la chlordécone étaient communes à toutes les méthanogènes. Or, on trouve des méthanogènes dans les digesteurs qui traitent les vinasses de distillerie en Guadeloupe et en Martinique. L'idée était donc d'utiliser les méthanogènes disponibles pour faire de la bioaugmentation, c'est-à-dire apporter des microorganismes aux sols pour augmenter leur capacité de dégradation. L'expérience en laboratoire fut malheureusement un échec : nous avons obtenu des taux de transformation de la chlordécone extrêmement faibles.
Nous avons mené parallèlement une autre étude : nous avons observé dans l'environnement l'évolution du ratio entre le chlordécone et un dérivé qui aurait perdu un atome de chlore. On pensait alors que ce composé intermédiaire était formé au cours du processus de fabrication du chlordécone, et qu'il était par conséquent normal d'en retrouver dans les sols où avait été épandu le pesticide. Après l'interdiction du chlordécone, l'État a saisi tous les stocks de pesticide, sans que personne n'ait pensé à conserver des échantillons pour effectuer des analyses. Nous en avons toutefois retrouvé trois, en petites quantités, ainsi que du Képone technique, le pesticide utilisé avant le Curlone. Nous les avons analysés, et montré qu'on retrouvait dans ces formulations commerciales le composé ayant perdu un atome de chlore. Nous avons également pu mesurer les rapports massiques entre ce composé et la molécule de chlordécone, que nous avons comparé à ceux mesurés aujourd'hui dans les sols, et nous nous sommes aperçus que ces derniers étaient vingt-cinq fois plus élevés. La seule explication cohérente à cette évolution était que ce composé était issu de la déchloration de la chlordécone. Contrairement à ce qui avait été présupposé, une transformation naturelle de la molécule avait donc eu lieu. Ces deux séries d'études ont ainsi mis à mal les deux paradigmes selon lesquels la molécule ne serait ni dégradable biologiquement en raison de sa structure ni dégradable dans l'environnement.
Pourquoi, dans ce cas, n'avons-nous pas observé, depuis l'interdiction du pesticide il y a près de trente ans, d'atténuation naturelle du chlordécone ? Pour que la molécule soit dégradée, il faut qu'elle soit en contact avec des microorganismes autochtones, présents dans les sols. Il faut en outre que les conditions environnementales des sols soient favorables à l'expression de leurs capacités métaboliques. Mes propres travaux n'ont pas permis de mettre en évidence la présence de microorganismes autochtones, mais un groupe de chercheurs autour du professeur Sarah Gaspard de l'université des Antilles et des collègues du Génoscope ont montré qu'il y avait déjà aujourd'hui dans les sols antillais des microorganismes capables d'attaquer la chlordécone. Toutefois, selon ces mêmes chercheurs, les travaux sur les autres organochlorés vont dans le même sens, c'est en l'absence d'oxygène que la molécule peut être attaquée. Or, comme c'est le cas généralement, les sols aux Antilles sont très aérés. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la culture de la banane y est autant développée : le fruit a besoin d'eau, mais l'eau doit circuler, et si l'eau circule bien, l'air et donc l'oxygène aussi. Des collègues de l'INRA et de l'IRD avaient déjà montré que dans un andosol incubé avec de l'oxygène, la minéralisation de la chlordécone était extrêmement faible. Pour attaquer la chlordécone, il faut bien des conditions anoxiques. Tout l'enjeu est donc de savoir si on est en mesure de créer de telles conditions, et à quelle vitesse la dégradation pourrait alors avoir lieu. Nos collègues ont réussi à dégrader de grandes quantités de chlordécone en soixante jours, mais ils n'ont pas travaillé sur la molécule présente historiquement dans les sols : ils ont ajouté du chlordécone à un échantillon de sol qu'ils ont incubé dans des conditions anoxiques. Ce ne sont pas du tout des conditions réalistes.
Mon collègue vient donc de vous présenter le principe de la remédiation à partir de bactéries, mais il existe aussi le procédé ISCR, par ajout de fer, sur lequel les chercheurs du BRGM ont travaillé. Il a ainsi été démontré qu'en Martinique, on pouvait décontaminer jusqu'à 70 % du chlordécone présente dans les sols du sud, mais seulement 20 % dans les sols du nord. Pour les deux techniques se pose la question de l'accessibilité, et l'une comme l'autre sont inefficaces dans les andosols. La taille des particules d'argile allophane qui caractérisent ces sols est en effet de l'ordre de la dizaine ou de la centaine de nanomètres, tandis que celle des bactéries ou des éléments ferreux est supérieure au micron : il est impossible que ceux-ci pénètrent à l'intérieur des particules d'argile. Or les sols du nord représentent 50 % des sols contaminés. Ces techniques sont donc très intéressantes, et je publie d'ailleurs conjointement avec les chercheurs du BRGM, mais elles ne pourront pas être réellement utiles dans 50 % des sols pollués de Martinique.
J'ai donc tenté une autre approche : si on ne peut pas décontaminer, pourquoi ne pas séquestrer ? Ce qui compte, en effet, c'est que la contamination ne soit pas transférée dans l'eau et dans les cultures de consommation. Je précise que, vivant en Martinique depuis seize ans avec ma famille, je me sens totalement concerné par le sujet, imprégné au sens propre comme au sens figuré. Je ne suis pas un chercheur hexagonal qui regarderait le problème de loin. Le principe de la séquestration est de fixer davantage le chlordécone dans le sol pour éviter qu'il ne parte dans l'eau ou dans les plantes que l'on cultive. Assez naturellement, nous nous sommes tournés vers la matière organique, pour laquelle le chlordécone a une grande affinité. Nous avons ainsi mélangé dans des conteneurs de sol entre 3 et 5 % de compost, et nous avons pu montrer que les taux de transfert dans les radis que nous y avions plantés étaient cinq à dix fois plus faibles. La contamination du sol est inchangée, mais l'eau qui percole ou le légume que l'on fait pousser sont moins chargés en chlordécone. Les résultats sont différents selon les cultures, mais les taux de transfert sont systématiquement de deux à cinq fois plus faibles. Cette solution, en attendant d'en trouver d'autres, permettrait aux agriculteurs d'avoir des taux de transfert plus faibles dans les sols contaminés du nord.
Pour conclure, il n'y a pas de solution unique pour résoudre le problème du chlordécone, pas de poudre de perlimpinpin, pour reprendre ce terme cher à quelqu'un que nous connaissons bien. Les techniques ISCR, par exemple, fonctionnent mais uniquement sur des sols plats, car il faut pouvoir créer des conditions anoxiques. Pour réaliser nos études avec le BRGM, nous avions en effet gorgé les parcelles d'eau et les avions recouvertes d'une bâche pour travailler dans des conditions sans oxygène, ce qui n'est possible que sur des sols plats. Pour avancer, il faudra donc ajuster les techniques à la géographie, à la topographie et à la nature des argiles présentes dans les sols.

Je salue la présence de nos collègues Mesdames Ramlati Ali, Annie Chapelier et Hélène Vainqueur-Christophe, Madame Véronique Louwagie étant excusée.

Pouvez-vous détailler les caractéristiques chimiques de la chlordécone ? À quelle profondeur est-elle détectable ? Quel est le délai envisageable pour que la chlordécone se dégrade naturellement dans l'environnement des Antilles, de manière significative, voire totalement ? Un objectif de zéro chlordécone dans les fruits et légumes vous semble-t-il envisageable ? Dispose-t-on d'études sur l'évolution de la chlordécone depuis 1993, date à laquelle son utilisation, débutée en 1972, a pris fin ?
Je laisserai mon collègue Monsieur Hervé Macarie répondre à la question sur la structure chimique, qu'il a commencé à évoquer dans son exposé liminaire. Il présentera plus en détail les propriétés de cette molécule.
On a pu mesurer des taux de concentration de chlordécone non négligeables, détectables jusqu'à 90 centimètres. On s'intéresse généralement à la zone comprise entre 30 et 40 centimètres, où poussent les légumes-racines et les tubercules – tels que dachines, ignames, patates douces, radis – qui sont les plantes les plus contaminées. En revanche, les fruits – je pense évidemment aux bananes – et les solanacées ne sont a priori pas contaminés.
La chlordécone a été répandue au pied des cultures, mais on a pu constater, par des creusements profonds, la présence de taux mesurables, jusqu'à 90 centimètres. Sa concentration est en revanche beaucoup plus faible à cette profondeur que dans les 40 premiers centimètres.

Comment s'explique la présence de la molécule à cette profondeur ? Est-ce seulement l'effet de sa diffusion, ou cela est-il dû au fait que les sols ont été remaniés ?
Elle s'explique par la diffusion du produit. Des labours importants ont certes pu être réalisés, mais il est rare qu'ils atteignent cette profondeur ; ils ne dépassent généralement pas 30 ou 40 centimètres. En dessous, la présence de chlordécone est due à la diffusion du produit par l'eau. Même si elle est très faiblement soluble, une partie de la molécule finit, au fil des ans, par se répandre et peut s'écouler jusqu'à 90 centimètres.
Pourquoi a-t-on appelé cette molécule « chlordécone » ? Le préfixe vient du fait qu'elle contient du chlore. Le terme « décone » est issu de « décane », en raison de la présence de dicarbone, le suffixe « one » correspondant à la fonction cétone. Comme je l'ai indiqué, le chlordécone a une structure en cage. Elle appartient au groupe des « bis-homocubane ». À l'origine, les chimistes sont tombés un peu par hasard sur ce type de structure. Elle se caractérise par des angles de près de 90 degrés, ce qui semblait chimiquement impossible. La structure du chlordécone se caractérise par une double liaison entre un atome de carbone et un atome d'oxygène : c'est ce que l'on appelle une « fonction cétone ». Au contact de traces d'eau, une réaction spontanée se déclenche, qui conduit à la transformation de la cétone en un dialcool. Dans l'environnement, dans notre corps, la chlordécone est essentiellement présente sous la forme de dialcool.
La solubilité de la chlordécone est avérée en présence d'un pH – potentiel hydrogène – 7, c'est-à-dire neutre, et à température ambiante ; elle est de l'ordre de 2 à 3 milligrammes par litre. On dit généralement qu'elle est peu soluble. En réalité, par rapport aux autres polluants organiques persistants, elle présente un haut degré de solubilité. Peut-être avez-vous entendu parler du MIREX, qui a la même structure – en cage – que le chlordécone mais une solubilité limitée à 0,085 milligramme par litre. D'un côté, on a 3 milligrammes par litre, dans des conditions classiques, et, de l'autre, 0,085 milligramme. Le chlordécone est donc, en réalité, l'un des polluants organiques persistants les plus solubles. La solubilité dépend du pH et s'accroît à mesure que celui-ci augmente. On a mesuré la solubilité de la chlordécone jusqu'à un pH de 10,9, niveau auquel elle atteint 176 milligrammes par litre. Les sols antillais sont, dans l'ensemble, acides, ce qui engendre une solubilité de l'ordre de 2 à 3 milligrammes. Le chlordécone présente un coefficient de partage octanol-eau compris entre 4 et 5. Autrement dit, bien qu'il soit un peu soluble dans l'eau, il va plutôt se fixer sur la matière organique, dès que celle-ci apparaît. Des collègues ont réalisé une expérience consistant à ajouter, à une solution de chlordécone à 1 milligramme par litre, de la matière organique à 0,5 gramme par litre : en cinq minutes – temps à partir duquel commençait l'expérience –, 85 % de la chlordécone avait quitté le stade aqueux et avait été absorbée.
Si l'on prend en compte le Koc – coefficient de partage eau-sol –, le chlordécone atteint des valeurs comprises entre 1 000 et 2 000 millilitres par gramme. Ces résultats indiquent que cette molécule est très fortement absorbée par le sol, ce qui explique pourquoi, en l'absence de dégradation, dans les conditions environnementales normales des sols antillais, elle se caractérise par une telle persistance. Elle va en effet rester fixée au sol ; seule, sous l'action des pluies, une petite part sera entraînée par l'eau.
Par ailleurs, le chlordécone est extrêmement peu volatile ; de faibles quantités de cette molécule peuvent être désorbées du sol pour gagner l'atmosphère. En revanche, des particules de sol, des poussières sont susceptibles d'être emportées.
Je n'ai pas de compétence particulière sur ce sujet mais il est certain que, si le chlordécone était emporté par des particules, on pourrait les inhaler et être contaminé par la voie respiratoire. Je ne crois pas, toutefois, que ce soit un problème très important. Il me semble que l'ANSES développe un programme visant à mesurer les résidus de pesticides – pas uniquement le chlordécone – dans l'air. Si je ne m'abuse, des tests sont actuellement pratiqués en Martinique et en Guadeloupe, qui incorporent le chlordécone. En tout état de cause, la voie aérienne est, me semble-t-il, une source très secondaire de contamination.

Madame la rapporteure a posé une question très précise : quel est le délai envisageable pour que le chlordécone se dégrade naturellement – sans processus – dans l'environnement des Antilles, de manière significative, voire totalement ?
Les travaux de Yves-Marie Cabidoche, réalisés il y a une dizaine d'années, montrent que, pour les sols du sud de la Martinique, cela prendra des décades – moins d'un siècle – tandis que, pour le nord, le délai serait de six siècles. Le modèle proposé ne fournit toutefois que des grandes lignes. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra énormément de temps pour que la dégradation se produise naturellement. Le modèle prévoit qu'au bout de 100 ans, 90 % du chlordécone présente dans les andosols devrait être éliminé. Or, ce n'est pas la tendance que l'on observe depuis vingt-cinq ans. Toutefois, je le répète, ce n'est qu'un modèle, qui propose seulement des grandes lignes. Je ne pense pas qu'il faille le prendre à la lettre. Nous ne disposons pas de données garantissant le délai de six siècles – cela pourrait prendre 200 ou 300 ans.

Les études de Yves-Marie Cabidoche n'ont jamais été contestées et sont reprises par la plupart des scientifiques.
Absolument.

Dans les sols du sud de la Martinique, le délai annoncé est de 100 ans, ce qui est extrêmement long, au regard de l'espérance de vie d'un individu.

L'objectif consistant à parvenir au zéro chlordécone dans les fruits et les légumes vous semble-t-il envisageable ?
S'agissant des fruits, si j'en crois les travaux du CIRAD, il est atteint : il n'y a pas, à ma connaissance, de chlordécone dans la banane, pas plus que dans les arbres fruitiers – je vous invite à interroger le CIRAD. En revanche, les cultures très sensibles – tubercules et racines – sont fortement affectées. Les cultures dites « intermédiaires » – telles les concombres, salades et tomates –, pour leur part, peuvent toucher le sol. Autrement dit, ce qui est vraiment dans le sol est contaminé, ce qui est très au-dessus ne l'est pas, et ce qui peut être au contact du sol est susceptible d'être partiellement touché. S'agissant des racines et des tubercules, l'objectif zéro chlordécone ne peut être poursuivi, à mon sens, que si on travaille sur des sols – c'est une lapalissade – qui ne sont pas du tout chlordéconés. Envisager un tel résultat sur des sols même faiblement contaminés relève de la gageure. Même avec les techniques ISCR, on ne peut retirer, au mieux, que 70 % de la molécule, et ce, dans les sols du sud – dans les sols du nord, cette part ne saurait excéder 20 %. Les techniques de séquestration, quant à elles, ne peuvent pas tout résoudre, puisque les taux de transfert ne sont divisés que par deux ou trois. S'agissant de l'utilisation des bactéries, pour le moment, nous ne disposons pas véritablement de technique applicable, même si des pistes pourraient se dégager à l'avenir.
La difficulté tient au fait qu'on ne trouve pas de sols préservés dans le nord. Il y a quelque temps, je me trouvais au Morne-Rouge. J'y ai vu des agriculteurs travailler très proprement et sachant ce qu'ils peuvent cultiver, compte tenu de la contamination de leurs parcelles. Il me paraîtrait regrettable qu'ils ne puissent pas obtenir le label « zéro chlordécone ». Mais pourra-t-on le leur attribuer, puisque leur sol est contaminé ? Ils risquent d'être ostracisés par rapport à d'autres, qui en bénéficieront. Cette question n'est évidemment pas de mon ressort, mais j'exprime mon sentiment de citoyen vivant en Martinique.

Évoquant l'utilisation de bactéries par bioremédiation, vous avez pris l'exemple des rizières sur des sols anoxiques. Serait-il envisageable de créer un sol anoxique et, ainsi, de déchlordéconer des terres qui le sont fortement, en les inondant, par l'installation de rizières ou la culture de liserons d'eau ?
Nos collègues du BRGM ont travaillé sur la technique de l'ISCR, qui consiste à ajouter du fer zéro valent au sol. Ils ont arrosé des sols pour les inonder, sachant que l'oxygène est moins soluble dans l'eau s'il ne peut circuler librement dans le sol. Parallèlement, ils ont arrosé des sols témoins, exactement dans les mêmes conditions, mais sans ajouter le fer zéro valent ni les autres produits utilisés dans l'expérience. Les résultats se sont révélés insuffisants. Pour obtenir de meilleures performances, il faudrait inonder complètement les sols, qui sont très drainants. C'est beaucoup plus difficile à réaliser sur des sols pentus. En revanche, on pourrait envisager d'inonder pendant un certain temps les sols dans la plaine du Lamentin. Les sols des rizières produisent du méthane, ce qui n'a lieu que sur des sols complètement anoxiques. Au Japon, des rizières sont cultivées sur des andosols – mot d'origine japonaise –, qui peuvent produire du méthane. Si on inonde complètement un andosol, on pourra obtenir un environnement sans oxygène.
Cela étant, l'inondation n'est pas nécessairement le moyen à privilégier ; inonder complètement les sols exigerait beaucoup d'eau. On pourrait employer plusieurs techniques alternatives : ajouter de la matière organique très labile, afin d'activer la respiration des micro-organismes et faire en sorte que la vitesse de consommation de l'oxygène soit plus élevée que la vitesse de diffusion de l'air vers les sols ; parallèlement – le BRGM a employé les deux méthodes – rendre les sols plus compacts, ce qui diminue leur porosité macroscopique et rend plus difficile la diffusion de l'oxygène en leur sein. Plusieurs techniques pourraient sans doute être mises en oeuvre mais restent à étudier.

Ce sont des techniques très difficiles à mettre en oeuvre, qui impliquent des changements radicaux de cultures, mais qui pourraient potentiellement porter leurs fruits. On pourrait envisager de développer des cultures inhabituelles sur ces sols, qui n'y sont pas prédisposés. Cela permettrait éventuellement de retirer le chlordécone du sol sur la durée d'une vie humaine et non sur plusieurs siècles. Serait-ce une solution envisageable malgré les difficultés qu'elle présente ?
Je ne suis pas certain qu'il faille changer complètement le type de cultures. Comme l'expliquait Monsieur Hervé Macarie, le BRGM a mené des travaux en la matière, auxquels j'ai participé avec mes collègues de l'IRD. Ces expériences ont été concluantes, mais il s'agissait de sols plats, alluvionnaires, deux types de sols pour lesquels on savait que ça allait fonctionner – ce n'étaient pas, en tout état de cause, des andosols. Il fallait les inonder, mais aussi les compacter fortement – l'inondation, à elle seule, n'avait pas permis d'atteindre les taux de décontamination attendus. Ces travaux ont été présentés dans un rapport du BRGM, il y a plusieurs années. Une publication va bientôt avoir lieu dans Environmental Science and Pollution Research. Cela produit des résultats, mais ne portera ses fruits que sur un certain type de sols, et dans des conditions un peu particulières. On n'est pas obligés de concevoir des rizières ; on peut planter à nouveau des patates douces, par exemple. Mais on n'arrivera pas au zéro chlordécone : on aura diminué sa concentration de 70 %. Il en restera toujours un peu. Je ne sais pas s'il est possible d'aller au-delà ; il faudra poser la question au BRGM. D'après ce que j'ai compris, une fois que le processus a été lancé, le reste n'est pas accessible, ou l'est difficilement. Même en appliquant à deux ou trois reprises les techniques que j'ai décrites, je doute qu'on parvienne à éliminer le chlordécone. Je pense qu'on ne connaîtra pas le zéro chlordécone, mais qu'on travaillera avec les limites maximales de résidus, parce qu'on se trouvera à un niveau inférieur à la norme qui sera fixée.
Je participais la semaine dernière au comité de pilotage local, en Martinique, en présence, notamment, de Monsieur le préfet, Monsieur Louis Boutrin et Monsieur le sénateur Maurice Antiste. J'ai senti, d'après les questions posées par l'assemblée, que les gens ne veulent plus entendre parler de la limite maximale de résidus, ils veulent le zéro chlordécone. Là réside la difficulté. On nous a demandé si on était sûrs que, même pour les bananes, le chlordécone était à un niveau nul. Il peut être difficile de concevoir que lorsqu'on fait pousser une banane sur un sol chlordéconé, le fruit n'est pas contaminé. Cela soulève des questions, même si c'est vrai – c'est certainement la réalité, c'est ce que montre le CIRAD. Les gens demandent si c'est certain, s'il n'y en a pas un peu, et, le cas échéant, à quel taux.

La solution de l'ISCR que vous avez évoquée – le lavage, pour le dire sommairement – implique-t-elle l'utilisation de fer, et n'est-ce pas là une pollution supplémentaire ?
On utilise en effet du fer, mais ce n'est pas une source de pollution.
Le fer n'est pas considéré, à ma connaissance, comme un polluant, même si je me peux me tromper – à forte dose, tout peut le devenir. Son utilisation présente toutefois, dans un premier temps, l'inconvénient de détruire une bonne partie de la biologie du sol. Je pense qu'après un certain délai, on peut retrouver un sol naturel en ajoutant des éléments tels que des composts, des vers de terre. On peut recréer la biologie du sol, mais les expériences auxquelles j'ai participé m'ont montré qu'après avoir retiré 70 % du chlordécone, on a obtenu des radis et des concombres de très petite taille ; ils avaient beaucoup de mal à pousser. On a pu faire des mesures de transfert dans ces légumes, mais au prix de certaines difficultés. Sans être un agronome – il vaudrait sans doute mieux poser la question à l'un d'eux –, je pense qu'au bout de quelques années, on doit pouvoir retrouver un sol réutilisable sur un plan agronomique.
J'ajoute un mot sur les travaux auxquels Monsieur Thierry Woignier s'est référé. Les essais agricoles ont été réalisés trois mois après la fin des épandages, délai insuffisant pour que le sol retrouve des conditions naturelles. Le fer a été ajouté sous forme de limaille – ce que l'on appelle le fer « zéro valent ». Au contact du sol, de l'eau, il va s'oxyder, former de la rouille, déjà présente dans les sols. Les sols antillais sont en effet extrêmement riches en fer : 7 à 11 % de leur poids sec en est constitué. Il ne se présente toutefois pas sous la forme de fer zéro valent ; c'est un fer très oxydé, que l'on peut qualifier de « rouille ». Dans la plaine du Lamentin, en cas d'inondations, le fer va être réduit sous l'action de micro-organismes. Lorsque l'eau aura été retirée, il va être réoxydé. C'est le cycle naturel du fer. Si les tests agronomiques n'avaient pas été faits trois mois, mais six, ou même dix mois après la fin des essais relatifs à l'ISCR, les résultats auraient été, me semble-t-il, différents, mais c'est là un avis personnel ; je pense que cela aurait laissé le temps au sol de récupérer ses fonctions naturelles.

J'ai deux questions à vous poser. La première a trait aux recherches sur la dépollution. À l'origine de la pollution au chlordécone, on ne pensait pas qu'il était possible de fracturer la molécule. Les recherches récentes ont démontré le contraire, du moins en laboratoire. Pensez-vous qu'à grande échelle, sur des sols, ce serait envisageable ? J'ai cru comprendre, d'après vos précédentes réponses, que cela engendrerait des difficultés. Si on y parvenait, pensez-vous que le coût de la dépollution serait acceptable ? Ma seconde question concerne les ouvriers agricoles, qui sont préoccupés par les poussières qu'ils rapportent chez eux, après le travail sur un sol chlordéconé. Estimez-vous qu'ils sont confrontés à une surexposition du fait du dépôt de poussières, en particulier sur leurs vêtements ? Compte tenu de la solubilité, même partielle, de la molécule, que se passe-t-il lorsqu'on lave des vêtements enduits de ces poussières avec d'autres vêtements ?
Je n'ai pas de réponse au sujet des poussières. Comme l'a dit Monsieur Hervé Macarie, des organismes, tels l'ANSES, cherchent à déterminer si les poussières de sols chlordéconés présentent une forme de volatilité ; ils pourraient vous apporter des réponses. Il me paraît toutefois très peu probable que l'on ait un peu de poussière de chlordécone sur soi. Je vis en Martinique mais je ne me pose pas vraiment ce genre de questions. Je vis avec.
S'agissant de votre première question, l'ISCR présenterait, d'après les calculs qui ont été faits, un coût de l'ordre de 170 kiloeuros à l'hectare. Pour ma part, j'ai chiffré le coût de la séquestration, qui est évidemment beaucoup moins élevé, à un montant compris entre 3 et 7 kiloeuros à l'hectare. Ce procédé consiste, je le rappelle, à ajouter de la matière organique pour fixer le chlordécone, ce qui empêche son transfert ou, du moins, le limite – elle ne le nettoie pas mais le retient. Pendant une durée de six mois à un an, le procédé fonctionne bien. Au-delà de cette période, faute d'avoir pu mener les expériences nécessaires, on ne sait pas si la matière organique se stabilise ou, au contraire, se minéralise – cette seconde issue paraissant la plus logique. On peut penser qu'à un moment donné, elle va se transformer et ne plus jouer son rôle. Il est donc vraisemblable qu'on doive renouveler l'opération régulièrement.
Un autre procédé est proposé, à base de biochar, à savoir de matières organiques stabilisées, qui se détruiront moins facilement. Nous menons actuellement un projet de recherche avec la société martiniquaise VALECOM, même si des difficultés de financement nous empêchent de lancer réellement les expériences. Il s'agirait de travailler non pas avec du compost, mais avec du biochar, qui fixerait la matière organique. C'est un amendement agricole beaucoup plus stable, qui se transforme beaucoup moins rapidement en une matière qui ne remplirait plus son office.
Tous les procédés dont on a parlé – les bactéries, l'ISCR et la séquestration – présentent des avantages et des inconvénients. Aucun d'eux ne constitue une solution immédiatement disponible. Une méthode fonctionnera dans certains cas, mais moins, voire pas du tout, dans d'autres. L'ISCR apportera de très bons résultats dans des zones plates, où on pourra ajouter de l'eau, compacter les sols, travailler en condition anoxique. En revanche, elle ne pourra être appliquée dans des zones très montagneuses – ou, du moins, sur ce que l'on nomme les « mornes », bien connus aux Antilles – ni sur les sols du nord de la Martinique. Dans ces derniers cas, en effet, le manque d'accessibilité ne permettra de nettoyer que 20 % de la chlordécone s'y trouvant. Si on se satisfait de cela, pourquoi pas, mais cela représente un coût important pour un résultat très limité.
Le compost se trouve à l'intérieur du sol. Il n'est pas nécessaire de l'éliminer car il participe au sol. Tout à l'heure, j'ai indiqué que l'ISCR faisait pousser de tout petits radis et concombres. En revanche – nous avons fait des essais sur de vraies parcelles –, sur des sols où on a ajouté de la matière organique, l'agriculteur était ravi d'obtenir des concombres deux à trois plus gros. On ajoute en effet 3 à 5 % du poids en compost, lequel joue son rôle à l'intérieur du sol, tant pour fixer le chlordécone que, sur un plan agronomique, pour faire pousser les plantes.
Je viens de passer deux mois en Martinique. Sur le campus agro-environnemental Caraïbe, j'ai vu une affiche relative à l'application des produits phytosanitaires et aux mesures à respecter. Des recommandations minimales peuvent être faites aux ouvriers agricoles. Lorsqu'ils travaillent sur des sols chlordéconés, il faut leur conseiller, pour éviter d'ingérer des poussières – malgré les conditions atmosphériques parfois difficiles aux Antilles – de porter un masque – simple, qui ne les gêne pas dans le travail – pour se prémunir des particules grossières. Ils devraient aussi porter une combinaison. Comme l'affiche en question le montrait bien, une fois qu'on a appliqué les produits phytosanitaires – ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, puisqu'on parle de sols chlordéchonés – il faut laver la tenue avant de la rapporter à la maison. Des recommandations de ce type pourraient être faites. Les ouvriers de l'usine Life Sciences, à Hopewell, rapportaient à la maison leur bleu de travail, lequel était devenu blanc, parce qu'ils travaillaient dans de la poussière de chlordécone. On avait observé, dans les maisons, une contamination au chlordécone. Il y a, selon moi, des recommandations minimales, de bon sens, à apporter aux ouvriers.

Êtes-vous en train de dire que ces recommandations minimales ne sont pas faites aujourd'hui ?
Je ne sais pas, je réponds simplement à la question de Madame Vainqueur-Christophe.

C'est très intéressant, car vous êtes au coeur de la recherche. Je ne dis pas que vous êtes en train de porter des accusations, mais nous serions surpris d'apprendre que cette protection minimale n'est pas appliquée. Cela pourrait illustrer la distance extrêmement importante entre le drame et les mesures qui devraient être appliquées pour protéger le salarié agricole. On est en train de parler d'une modification du tableau des maladies professionnelles. Cela va très loin. Je souhaite qu'on se penche sur le sujet et qu'on interroge les administrations sur les recommandations à faire pour protéger les ouvriers agricoles. Cela me semble être le minimum qu'on puisse faire.
Je ne sais pas si ces recommandations ont été faites, mais je crois me rappeler que, dans le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de Madame Catherine Procaccia et de Monsieur Jean-Yves Le Déaut, publié en 2009, ce problème était clairement posé. On savait, à l'époque, que les travailleurs agricoles n'utilisaient pas systématiquement des masques et des protections, en raison, notamment, de la chaleur.

Pour avoir auditionné les ouvriers agricoles dans le cadre de l'élaboration de la proposition de loi que j'ai portée, je peux vous dire que ces recommandations ne sont pas faites. Par ailleurs, les vêtements de protection qui leur sont proposés ne sont pas adaptés à nos pays tropicaux. J'ai soulevé ce problème dans les courriers que j'ai adressés aux bananiers, aux producteurs agricoles, et leur ai demandé de chercher des protections et des vêtements adaptés aux conditions tropicales.

Vous avez beaucoup parlé des transferts vers les tubercules et les racines. Y a-t-il des plantes qui absorberaient plus rapidement que d'autres le chlordécone et qui permettraient, ce faisant, d'assainir les sols dans un délai plus court ? En effet, une fois extirpé du sol, le chlordécone n'y retourne pas – c'est l'avantage du minéral par rapport à l'organique.
Sans être des spécialistes de la phytoremédiation, nous savons, d'après les travaux de nos collègues du CIRAD, que les plantes alimentaires sont contaminées, à partir de certains niveaux de pollution, au-delà des limites maximales de résidus. Plusieurs méthodes peuvent être employées.
Dans le cadre de la phytoextraction, une plante accumule un polluant dans ses parties aériennes et, ce faisant, la retire du sol. En l'occurrence, ce phénomène n'a pas été observé dans les plantes alimentaires. Un chercheur de l'INRA a publié récemment une étude à ce sujet. Il a utilisé une plante d'un usage courant en phytoremédiation, du type des viscontus. Sur des sols contaminés à hauteur de 1 milligramme de chlordécone par kilo de matière sèche – ce qui constitue un niveau élevé – le viscontus était capable d'éliminer à peu près 1 gramme de chlordécone à l'hectare dans ses parties aériennes par an. Or, sur les 30 premiers centimètres, ces sols abritent un stock de 3 000 grammes de chlordécone à l'hectare. Vous mesurez aisément la disproportion.
Vous voyez que par rapport au lessivage des sols, la phyto-extraction n'entraîne pas d'élimination, mais seulement un transfert du chlordécone. Car on n'a jamais de lessivage du chlordécone. On est seulement dans des ordres de grandeur négligeables, si on veut l'extraire avec ces plantes.
Cependant, je ne suis surtout pas en train de dire qu'il n'y a pas de plante qui serait peut-être capable d'hyper-accumuler la chlordécone. Les éléments que l'on possède aujourd'hui ne semblent pas dire que c'est une voie prometteuse. Mais je sais qu'un collègue de l'INRA, Monsieur François Laurent, pense à des plantes absorbant beaucoup plus d'eau, et donc entraînant avec elles beaucoup plus de chlordécone. Il y a donc peut-être des recherches à faire. En tout cas, selon les éléments d'aujourd'hui, la phyto-extraction ne semble pas une voie prometteuse.
Cela étant dit, il y a d'autres mécanismes, tels que la phytoremédiation ou la phytoévaporation. Toutefois, on a vu que le chlordécone est peu volatil. Donc cela ne semble pas non plus quelque chose qui soit vraiment prometteur. Il peut aussi y avoir de la dégradation par les enzymes propres de la plante ; pour l'instant, il n'y a cependant pas d'indicateurs qui semblent le montrer.
Il peut y avoir de la rhizo-stimulation : la plante, à travers ses racines, apporte de la matière et des aliments aux micro-organismes qui sont présents dans sa rhizosphère ; cela va stimuler leur activité. Toutefois, en général, elle injecte en même temps de l'air, or c'est plutôt en absence d'oxygène que des micro-organismes seront capables d'attaquer la chlordécone. Je ne vous livre qu'un avis personnel : cela ne me semble pas être quelque chose qui soit envisageable.
Enfin, il y a aussi la phyto-stabilisation, un peu semblable à la séquestration, c'est-à-dire qu'au niveau de leurs racines, les plantes vont piéger la chlordécone et la rendre moins mobile, pour les nappes phréatiques par exemple.
Voilà quelques éléments qui semblent montrer qu'en tout cas, la phytoextraction ne semble pas être une voie prometteuse.

Vous nous avez présenté des travaux sur la séquestration de la chlordécone. J'aurais aimé savoir quels en ont été les résultats en laboratoire. Est-ce que vous avez procédé à des expérimentations sur le terrain et, par ailleurs, combien coûterait votre solution pour traiter un hectare ? Le BRGM a présenté les coûts de ces différentes techniques. Au regard du rapport coûtefficacité, quelles solutions préconiseriez-vous ?
En laboratoire, on a pu montrer que, par exemple, sur des radis, on avait des taux de concentration de l'ordre de cinq fois plus faibles – en fait, entre 5 et 10 fois plus faibles – lorsqu'on avait ajouté cette matière organique, en travaillant sous serre, dans des conditions parfaitement contrôlées. De manière systématique, on relève des taux de concentration qui sont de deux à dix fois plus faibles.
Ensuite, on travaille sur des parcelles qui sont les mêmes que celles sur lesquelles a été expérimenté le procédé ISCR du BRGM, puisque nous menons nos travaux ensemble. On a pu montrer que, sur les patates douces, les taux observables étaient de l'ordre de deux fois plus faibles, de quatre fois plus pour les radis et de trois fois plus faibles pour les concombres. Cela fonctionne aussi sur de vraies parcelles.
Vous posez la question du coût ? Comme je l'expliquais tout à l'heure, on se situe entre 35 000 euros et 60 000 euros à l'hectare pour ces techniques-là. On est obligé de faire normalement plusieurs épandages. Mais je ne voudrais pas qu'on ait le sentiment que je voudrais essayer de mettre une technique en concurrence avec une autre. Car toutes ont des avantages et toutes ont des inconvénients. On ne pourra pas en adopter uniquement une. Je trouve que la technique ISCR est une excellente technique, mais elle ne pourra pas fonctionner partout. Sur les sols du Nord, elle ne pourra pas être appliquée, car le problème de l'accessibilité physique se pose. Des contraintes physiques feront que les particules de fer utilisées, qui font une cinquantaine de microns, ne pourront pas agir à l'intérieur d'une boîte qui fait moins d'un micron. C'est physiquement impossible.
En revanche, sur les autres types de sols, cela pourra fonctionner. Mais cela a un coût. Cela modifie la nature du sol et sa structure. Comme l'a expliqué mon collègue Monsieur Hervé Macarie, il faudra attendre un certain temps pour que le sol retrouve ses caractéristiques agronomiques. Cependant, c'est certainement un procédé qui est intéressant. Je ne voudrais donc pas mettre en compétition ce que je propose et le reste. Ma solution n'est qu'une alternative là où le reste ne marche pas. Elle permettra, en tout cas, de diminuer les taux de transfert et, si nos travaux sur les biochars aboutissent et nous permettent de dire qu'on a une structure de matière beaucoup plus stable, sans avoir à recommencer tous les ans ou tous les deux ans. Elle se révélera alors une solution intéressante. En revanche, elle ne décontamine pas. Il faudra que l'on accepte que ces sols restent contaminés ; simplement, ils seront utilisables.

Ne pensez-vous pas qu'en matière de recherche, au vu de la variété des procédés mis en oeuvre dans ce domaine du traitement de sol, il y aurait besoin d'une coordination beaucoup plus efficace et de moyens beaucoup plus importants ? Cela est vrai pour ce thème de la recherche sur le sol, mais on pourrait faire la même analyse sur la question du cancer et de la santé. Quel est votre point de vue sur la gouvernance de la recherche, s'agissant d'un drame aussi important ?
Effectivement, on a un peu le sentiment que, notamment dans le domaine des micro-bactéries où Monsieur Hervé Macarie travaille, il y a une équipe en Guadeloupe, il y a l'équipe du Genoscope du CNRS, il y a l'IMBE à Marseille… Les gens se connaissent et travaillent parfois ensemble, mais cela manque un peu de synergies. Des phénomènes de chapelle s'observent aussi. Il y a toujours un petit peu de compétition dans les domaines de la recherche, surtout quand on est éloigné des autres de milliers de kilomètres.
Sur la question des moyens, on a bien sûr toujours besoin de plus d'argent, mais je pense plutôt qu'on a besoin, en l'occurrence, de plus de bras et d'équipes qui seraient motivées pour travailler sur ce sujet-là. Ceux qui pensent que ce serait parce qu'on manque un peu de moyens que les laboratoires ou que les instituts ne font pas…
Oui, bien sûr, mais il faut aussi que les gens s'intéressent au sujet. Or c'est un sujet difficile. On sait qu'il est difficile et qu'il ne sera pas évident de publier, parce qu'on n'aura pas automatiquement des résultats hyper-intéressants. Il y a donc peut-être des chercheurs qui n'ont pas envie de s'investir sur ces sujets-là.
Telle est du moins mon impression. J'ai un peu le sentiment qu'on manque de personnel pour travailler sur ces sujets et que les instituts installés en Martinique ou en Guadeloupe continuent à travailler sur ce sujet-là pour une bonne part. Je ne peux pas dire qu'ailleurs, personne ne fait rien, mais c'est là que les choses continuent à être motivantes.

Madame Sarah Gaspard sera auditionnée en Guadeloupe. Il est tout de même étonnant de savoir qu'on ne lui a pas suffisamment donné de moyens pour poursuivre ses recherches…
Je ne sais pas si vous connaissez les dossiers de demandes de financements formulées auprès de l'Agence nationale de la recherche (ANR). Il est extrêmement difficile d'obtenir des réponses positives. D'abord, quand on vient de laboratoires qui ne sont pas hexagonaux, les moyens ne sont pas les mêmes. Nous n'avons pas les mêmes moyens d'investigation en Martinique ou en Guadeloupe, donc on ne se bat pas avec les mêmes armes quand on présente un projet.
Il faudrait des actions spécifiques, orientées sur le chlordécone, c'est-à-dire des financements ANR qui soient estampillés « chlordécone ». Cela ferait d'ailleurs peut-être venir des laboratoires extérieurs, alors que nous essayons aujourd'hui de nous battre contre des laboratoires d'excellence qui signent d'excellents projets…
Je voudrais ajouter quelques éléments.
On ne peut pas dire aujourd'hui que l'effort de recherche soit nul. Si on regarde seulement les salaires des agents qui travaillent aujourd'hui sur le sujet et qu'on les cumule sur de nombreuses années, on arrive à des chiffres non négligeables. Pour mon seul cas, par exemple, on est à 1,3 million d'euros… Par contre, il est vrai qu'à une certaine époque, la direction de l'IRD souhaitait expressément que l'on se positionne sur la thématique de la chlordécone.
Il y a peut-être un manque d'incitation. Comme vous le savez, les chercheurs sont libres dans le choix de leurs thèmes de recherche. Aujourd'hui, si on considère les collègues du Genoscope, l'équipe de Madame Sarah Gaspard à l'université des Antilles (UA), ce qu'on a pu faire à l'IMBE, on s'aperçoit qu'on parle effectivement de millions d'euros. Mais il n'y a pas eu, à mon avis, d'incitation suffisante. Il n'y a pas eu de budget incitatif tel que des équipes se disent que cela vaut vraiment la peine de se positionner sur le sujet.
Le chlordécone est un sujet qui a intéressé les chercheurs et qui les a motivés intellectuellement. Ils ont décidé de travailler sur ce sujet et se battent pour essayer d'obtenir des financements. Mais ce n'est pas facile. Le mode actuel de sélection des projets de l'ANR met les projets ciblés chlordécone en compétition avec six mille autres projets. Comment vont-ils pouvoir réussir à émerger ? C'est assez difficile pour eux.
En fait, il est impossible de savoir, à notre échelle, combien de projets sur le chlordécone ont été déposés et combien ont été financés. À une époque, l'ANR finançait à peu près un projet par an. Mais est-ce qu'il y a 50 projets déposés pour cinq projets financés ? Je crois qu'il serait intéressant de connaître ces chiffres, qui ne sont absolument pas disponibles.
Au niveau de la coordination, il est vrai qu'il y a une certaine compétition entre les équipes de recherche qui, parfois, ne souhaitent pas vraiment discuter et dialoguer. C'est un peu dommage, parce qu'on peut être amené à faire des recherches menées de façon exactement identique par d'autres. On travaille à l'aveugle et ce sont des ressources qui ne sont finalement pas utilisées de façon complètement efficace, puisqu'on fait le même travail, en parallèle. Il serait peut-être préférable de pouvoir être mieux coordonnés, pour éviter de partir exactement sur la même piste.

On a fait exactement le même constat que vous, mais vous êtes encore mieux placés pour nous expliquer cela. C'est, pour moi, peut-être un des graves problèmes révélés par l'affaire du chlordécone.

Dans le plan chlordécone III, il y avait un volet scientifique, mais il était consacré aux études sur le cancer. Comment imaginez-vous qu'on puisse, dans le cadre d'un futur plan chlordécone, mettre en perspective des travaux de recherche sur la dépollution des sols ? Quelles seraient les études et les expérimentations à mener ? Ne pensez-vous pas qu'il serait opportun, dans le cadre de ce futur plan chlordécone IV, de constituer un pôle de recherche sur la dépollution et la décontamination des sols ?
Oui, ce serait une bonne idée d'essayer de mutualiser les moyens et d'instituer des synergies, pour éviter que les gens cessent de travailler dans leur coin. Mais on travaille déjà beaucoup avec le BRGM, le CIRAD et l'INRA. On arrive à travailler ensemble, même si parfois les 8 000 kilomètres qui nous séparent sont un problème.
Quant à la recherche sur la décontamination, je vous ai livré mon sentiment sur les limites auxquelles on est arrivé. A priori, la phytoextraction ne fonctionne pas, en tout cas pas pour le moment. On n'a pas de piste. En ce qui concerne la bio-remédiation par l'utilisation de bactéries, on sait maintenant, d'après les travaux de Monsieur Hervé Macarie ici présent comme d'après ceux du Genoscope et de Madame Gaspard, qu'un début de décontamination naturelle se fait. Mais ce n'est pas beaucoup. C'est-à-dire que les mécanismes existent et que des bactéries sont capables d'opérer cette décontamination, mais cela va très lentement. Est-ce qu'on sera capable de l'accélérer ? Comme l'a expliqué Monsieur Hervé Macarie, il faut qu'on travaille dans des conditions anoxiques, ce qui n'est pas simple à mettre en oeuvre… Les problèmes qui se posent ensuite sont peut-être moins des problèmes de recherche que des problèmes technologiques. Il faudrait peut-être que des industriels s'intéressent au sujet et arrivent à proposer une solution sur la manière de décontaminer dans des conditions anoxiques.
S'agissant du procédé ISCR, je crois qu'il a fait la preuve de son efficacité, même s'il y a sans doute encore des travaux à faire pour aller tout à fait au bout. Il a fait preuve de son efficacité pour un certain type de sol, mais il ne pourra pas marcher pour tout. Il y a là sans doute encore de l'argent à mettre pour qu'ils puissent boucler leur procédé et cadrer le système.
Pour la séquestration, on a aussi montré l'efficacité du procédé. Pour en assurer la continuité, il faut utiliser des biochars, permettant d'aller au bout de l'idée.
Il y a des pistes qui émergent. Certaines commencent à fonctionner, mais de manière partielle. Pour d'autres, comme la bioremédiation, on attend des résultats un petit peu plus effectifs. Aujourd'hui, on a encore besoin de savoir, dans l'hypothèse où on emploie telles bactéries, quel pourcentage de terrain on va pouvoir décontaminer et dans quelle quantité. Il faut donc aller plus loin. C'est peut-être là qu'il faut mettre l'accent, dans le domaine de la recherche.
Le reste relève plutôt, à mon avis, de la technologie. Il faut des entreprises capables de développer l'ISCR comme pourrait le faire un industriel.

Est-ce que vous êtes informé des différentes recherches technologiques menées dans d'autres pays, ou même aux États-Unis ?
Aux États-Unis, d'après les informations dont on dispose, ils ont décidé qu'il fallait laisser faire la nature. Une fois cette décision prise, dans les années 1970, la recherche spécifique au chlordécone a disparu. À ma connaissance, il n'y plus d'activité dans ce domaine.
Aux États-Unis, pour mémoire, des eaux usées d'usine avaient contaminé la James River sur une longueur de 150 kilomètres, pour une surface d'à peu près 500 kilomètres carrés, soit tout de même la moitié de la surface de la Martinique. Les Américains ont conclu à la vanité de tout ce qu'ils avaient envisagé : draguer les sédiments contaminés, ajouter des absorbants qu'ils auraient récupérés… Après des calculs, ils en étaient arrivés à la conclusion que cela coûterait plus de un milliard de dollars, sans compter le coût environnemental d'un dragage qui aurait eu des conséquences pour l'écosystème. Ainsi, les Américains sont arrivés à la conclusion qu'une remédiation était économiquement inenvisageable et écologiquement peu satisfaisante.
En outre, comme, dans la zone concernée, une fois l'usine arrêtée, il n'y avait plus de relargage de chlordécone dans l'environnement, et comme il y avait eu une sédimentation très importante, ils se sont dit que, petit à petit, les sédiments contaminés seraient recouverts par des sédiments propres. Par suite, le transfert de la chlordécone vers la chaîne trophique serait cassé, des sédiments vers les organismes qui y vivent, puis vers les poissons qui mangent ces organismes, vers les oiseaux, et vers les gens qui mangent du poisson… En fait, ils ont laissé faire la nature.
Ils avaient calculé qu'il leur faudrait entre une et trois décennies pour arriver à casser ce transfert. Mais, au bout de treize ans, ils se sont rendus compte que les concentrations relevées dans les poissons étaient déjà arrivées à un niveau inférieur à la limite maximale de résidus en vigueur à l'époque pour protéger les populations. Cette limite s'établit par contre à 300 microgrammes par kilo de poisson frais, c'est-à-dire qu'elle est plus de dix fois supérieure à celle que nous utilisons. Ainsi, ils ont seulement laissé faire la nature.
La seule chose qu'ils ont continué à suivre, au cours du temps, est tout de même la décontamination, pour voir comment elle évolue. Au bout de treize ans, ils ont pu lever toutes les interdictions de pêche sur la James River. Aujourd'hui, en 2016, une dernière estimation de la contamination des poissons a révélé que, en 2020-2025, ils ne seraient plus capables de détecter de la chlordécone dans les poissons. On passerait ainsi en dessous de la limite de détection.
Cela étant dit, il y a peut-être d'autres méthodes de remédiation qui ont été développées, mais pour traiter d'autres composés. D'ailleurs, le processus ISCR qui a été testé aux Antilles était basé au départ sur un brevet détenu par une société américaine. Mais il n'avait pas été développé spécifiquement pour le chlordécone.
Les études qui ont été réalisées dans d'autres pays l'ont été après 2009, une fois la chlordécone inscrite sur la liste des polluants organiques persistants annexée à la convention de Stockholm. Des inventaires de la présence de chlordécone dans l'environnement ont été dressés, au titre du suivi des polluants organiques persistants (pop) dans l'environnement. Pour ce faire, des gens ont engagé des développements analytiques. Voilà, à notre connaissance, les recherches qui sont faites.
Il n'y a pas, ailleurs qu'en France, de gens qui travaillent spécifiquement sur le chlordécone. Par contre, il y a, ailleurs dans le monde, des spécialistes susceptibles de s'y intéresser. On a fait appel à eux lorsqu'un atelier chlordécone a été organisé en 2010 ; des experts étrangers sont venus y participer. Mais il est vrai qu'on n'a pas mobilisé la communauté internationale sur cette thématique. Les Américains ont résolu eux-mêmes leur problème. En fait, pour eux, il n'y a plus de problème de chlordécone, donc ils n'incitent pas leurs chercheurs à travailler sur ce sujet.

Les Américains sont extraordinaires. Ils produisent 1 600 tonnes de chlordécone, mais n'en utilisent que 1 %, plus spécifiquement pour le tabac, mais non pour les produits alimentaires. Puis, en à peine deux ans, ils ont réglé le problème, en fermant l'usine et en en indemnisant les salariés – à ce sujet, on a cité des chiffres relativement importants. Ensuite, ils ont trouvé une solution naturelle de recouvrement des fonds de rivière, de façon à éviter un maintien de la pollution. Et c'est reparti !
Entre-temps, il n'y a eu aucune coopération entre la France et la Virginie pour savoir exactement ce qui s'est passé. Ni aucune coopération avec le Cameroun, qui a tout de même utilisé la chlordécone pendant très longtemps. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est anormal ?
Effectivement, cela semble surprenant. En France, en tout cas, le rapport de Monsieur le député Yves Le Déaut et de Madame la sénatrice Catherine Procaccia a mis le doigt sur le problème. Je crois qu'ils ont utilisé l'expression de « politique du lampadaire », ou une expression approchante…
Aux Antilles, on a quand même utilisé, d'après les estimations, 300 tonnes de chlordécone. Un sixième de tout ce qu'on a fabriqué dans le monde a ainsi été épandu aux Antilles. C'est tout de même un chiffre important. Ces chiffres sont beaucoup moins importants, je pense, dans les autres pays. On peut être surpris, mais personne ne veut savoir que 90 % du chlordécone produit aux États-Unis a été exporté vers l'Europe, essentiellement en Allemagne, pour y être transformée en un dérivé de la chlordécone qu'on appelle le kelevan. Or on sait que, quand on épand du kelevan sur le sol, la liaison entre la chlordécone et l'acide éthyl-lévulinique se casse très rapidement. Le kelevan devient de la chlordécone, l'acide éthyl-lévulinique étant lui biodégradable sans problème. Reste le chlordécone…
Cela veut dire qu'elle est présente en Europe aussi. Un article allemand oublié montre qu'on en avait retrouvé dans les cendres de l'incinérateur de la ville d'Amsterdam… Cela veut dire qu'il y en a dans les ordures ménagères. Cela signifie bien qu'en Europe, il y en a eu, mais que personne ne veut le savoir.

Ne faut-il pas aller un petit peu plus loin sur ce que les Américains ont fait sur la James River, pour traiter la question du chlordécone. Est-ce qu'on a simplement laissé faire la nature ou est-ce qu'il y a véritablement un dispositif qui a été mis en place et s'est structuré pour éliminer dans la rivière la chlordécone ? A-t-on seulement laissé faire les alluvions ?
À ma connaissance, ils ont décidé de laisser faire la nature. Mais, dans leur cas, le problème est complètement différent, la source de la pollution du chlordécone étant une usine. Dès lors qu'ils l'eurent fermée, il n'y avait plus de source de pollution.
Aux Antilles, malheureusement, la source de la pollution au chlordécone, c'est le sol. On en a un stock qui est aujourd'hui présent dans les sols. On ne peut pas faire comme si on avait une usine qu'on va fermer, de sorte que les rejets, soit par voie atmosphérique, soit par voie liquide, vont cesser. Le problème américain était tout de même un problème beaucoup plus simple à résoudre que le problème antillais. Le rôle joué par l'usine de Virginie, ce sont les sols de Guadeloupe et de Martinique qui le jouent… Malheureusement, il faudrait extraire le chlordécone de ces sols ou le détruire pour que les autres compartiments environnementaux ne soient plus contaminés.
Il y a là effectivement une grosse différence. Quand on a une usine, on est capable de récupérer le sol qui est autour, en pratiquant de l'excavation : on prend cet ensemble de terre contaminée et on la traite à part. Évidemment, on ne peut pas faire cela en Martinique ou en Guadeloupe. C'est impossible. Telle est la différence qui sépare ce que nous vivons maintenant en Guadeloupe et en Martinique et le problème de la James River, parfaitement localisé et circonscrit. La mesure du problème n'est pas du tout la même.

Est-ce que vous êtes informés des cartographies établies ? Pour la Martinique, pensez-vous que ces cartographies sont fiables ou complètes ? Faudrait-il faire une cartographie de l'ensemble de la surface agricole des parcelles où des bananes ont été cultivées ou choisir spécifiquement des terrains tests ? Pour terminer, constate-t-on des évolutions dans le taux de pollution des sols testés ?
Les techniques de mesure sont a priori fiables. Elles fonctionnent bien. Je crois même qu'une étude croisée du laboratoire du BRGM, du laboratoire d'analyses de la Martinique et du laboratoire d'analyses de la Drôme, le « LDA 26 », a pu montrer que les résultats étaient cohérents. Car il fallait tout de même vérifier que les mesures étaient cohérentes.
Cela étant dit, en ce qui concerne la valeur d'une parcelle mesurée, c'est toujours compliqué à établir. Pour une raison simple : le chlordécone diffuse mal. Quand il était mis au pied du bananier, vous n'en avez pratiquement pas à un ou deux mètres. D'où une hétérogénéité importante, diminuée seulement par les labours successifs qui ont homogénéisé la terre. Mais des études du CIRAD ont pu montrer qu'il peut y avoir un facteur de un à quatre entre une mesure donnée et une autre mesure réalisée ailleurs dans la même parcelle. C'est pourquoi les chercheurs du CIRAD préconisent de réaliser à peu près une vingtaine de prélèvements par hectare, pour agréger ensuite les données et produire une mesure composite. Est-ce que les organismes qui sont en charge des mesures suivent cette méthode ? En Martinique, je crois qu'il s'agit de la chambre d'agriculture, mais ce peut être aussi une direction départementale. Je pense qu'il faut leur poser la question.
Quant à la carte, qui repose sur une analyse de données faite ultérieurement par le BRGM, je pense qu'elle est fiable. Peut-être n'est-elle pas fiable au mètre carré, mais cela n'aurait pas de sens. On ne peut pas affirmer qu'une valeur mesurée à un point donné doit être la même à deux ou trois mètres. Car, dans les cas où il n'y a pas eu de labour, les travaux ont pu montrer que le facteur de variation était parfois de l'ordre de dix ! On peut relever une variabilité spatiale – horizontale, non en profondeur – qui peut, dans certains cas, aller jusqu'à dix. Mais c'est exceptionnel. Car, la plupart du temps, les champs ont été labourés, de sorte que la variabilité y est de deux à quatre.
Est-ce qu'il y a eu des évolutions au cours du temps ? À notre connaissance, excepté peut-être dans quelques cas très particuliers, on n'est pas revenu chaque année, ou tous les deux ou trois ans, ou tous les cinq ans, sur une même parcelle, pour y refaire des mesures. On ne peut donc pas vraiment vous répondre sur la question de savoir s'il y a eu une évolution. Cela étant dit, une période de trois à cinq ans reste un temps relativement court, relativement à petite échelle.
En tout cas, nos collègues du BRGM, qui ont fait leurs tests ISCR à l'échelle d'une centaine de jours, en suivant la concentration de chlordécone dans le sol sur trois mois à trois mois et demi, n'ont observé aucune variation du témoin. Mais c'est une période très courte.

Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille lancer sur deux territoires précis, l'un au Nord et l'autre au Sud, une expérimentation globale, portant à la fois sur la recherche, sur les pratiques culturales, sur la commercialisation et sur les habitudes sociales, afin de modéliser le problème ? Il me semble que cela pourrait permettre de s'attaquer à la pollution du sol, avec des méthodes choisies au vu des dernières avancées de la recherche, tout en agissant jusqu'à la consommation et jusqu'à la production. Ne serait-il pas intéressant d'avoir une modélisation territoriale ? En s'appuyant sur des moyens destinés à pousser la recherche sur une durée de cinq ans ou dix ans, ne pourrait-on aboutir à un modèle qu'on puisse reproduire sur l'ensemble du pays ?
Je pense que vous avez tout à fait raison. Car il est vrai qu'on a toujours un peu de peine, quand on veut travailler, à trouver des agriculteurs qui acceptent qu'on puisse travailler chez eux. On doit parfois se rabattre sur des parcelles ou des endroits qui n'étaient pas forcément extrêmement chlordéconés, de sorte que le résultat que l'on obtient est toujours plus difficile à mettre en avant.
Ce que je souhaiterais, du moins ce que j'aurais aimé, c'est donc qu'il y eût un endroit, notamment dans le Nord, par exemple du côté du Morne Rouge, et un endroit dans le Sud, mais pas plus au sud que le Lamentin, qui soient achetés par quelque organisme pour que nous puissions y mener des expérimentations systématiques. Plutôt que de changer et de travailler un jour au Lamentin et un autre du côté du Morne Rouge.
Car des agriculteurs qui ont parfois accepté qu'on travaille avec eux nous indiquent ensuite un jour qu'ils ont autre chose à faire. C'est pourquoi des zones d'expérimentation manquent, c'est-à-dire des zones préservées où nous pourrions, nous ou d'autres chercheurs, faire nos propres expériences – une sorte de laboratoire ouvert.

Pour moi, l'expérimentation doit aller de la physique du sol, en incluant toutes les solutions de médiation possible, jusqu'aux recherches sur les pratiques culturales et sur les productions, en passant par la prise en considération des comportements alimentaires et des questions de traitement, de concert avec les pêcheurs.
Aujourd'hui, on a l'impression que chacun travaille dans son coin. Le plan chlordécone a l'avantage de vouloir fédérer tout le monde, mais ce qui ressort de ce débat, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais peu de moyens et peu de coordination scientifique et technique permettant d'aboutir à quelque chose de lisible. Or il faut qu'on puisse éliminer très clairement les solutions qui ne sont pas viables.
Il faut que la population concernée bénéficie de la même dynamique scientifique sur les plans psychologique, social et humain, qu'il s'agisse de questions de santé ou de foncier, ou de la production elle-même. On ne peut pas décréter qu'on va planter de la patate douce, car ce sont des propriétés privées qui sont concernées. Si on n'a pas d'approche globale, je ne vois pas comment on peut s'en sortir.
Ce n'est qu'une idée que je lâche comme ça. Mais je pense que ce peut être une bonne solution pour qu'on sorte du flou artistique dans lequel j'ai l'impression que nous sommes.
Au niveau des coûts, c'est certainement une bonne idée d'avoir des zones atelier. Il y a déjà des bassins versants instrumentés, l'un en Guadeloupe et l'autre en Martinique. Nos collègues du CIRAD n'y travaillent pas que sur la question de l'eau. Sur le bassin versant du Galion, ils s'intéressent bien sûr à la qualité de l'eau, mais aussi à toutes les pratiques culturales, pour comprendre comment les phytosanitaires, et non seulement la chlordécone, impacte effectivement la qualité de l'eau. Ils s'intéressent aux transferts de ces phytosanitaires, depuis les endroits où ils sont appliqués jusqu'à la rivière.
Au niveau de la remédiation, je pense qu'il y a aussi des questions de coût. Il ne faut pas se lancer de manière précipitée dans des expérimentations sur le terrain. Je pense qu'il faut d'abord mettre le budget suffisant pour faire des expérimentations de laboratoire et démontrer la faisabilité de la technique.

Le drame, c'est qu'il n'y a pas que cette recherche à mener. Vous avez aussi, in fine, la recherche concernant les pratiques culturales, concernant la santé, concernant l'organisation même des familles…
Je vous poserai une dernière question. Je crois que le BRGM nous disait que, pour la cartographie, seulement 7 % des surfaces sont couvertes. Seulement 7 %, ça fait quand même frémir ! Ainsi, nous avons entendu qu'il serait sans doute bon d'être moins exigeants sur le détail de la connaissance des terres polluées notamment physique, mais d'accélérer les relevés pour arriver à une vision globale à moindre coût. Quelle est votre position ?
Je vous avouerai que je n'ai pas vraiment de position sur ce sujet. Est-ce qu'il faudrait avoir une cartographie complète de toute la Martinique, alors qu'on sait déjà qu'il y a des zones où, a priori, il n'y a pas de chlordécone ? Ne serait-ce pas dépenser de l'argent pour rien ?
Voilà des choix politiques à trancher par d'autres que moi. Pour ma part, je n'ai pas besoin d'une cartographie complète. Hors les zones agricoles, je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire des relevés partout. Cela me surprend un peu que le BRGM veuille vraiment une cartographie complète.

Il me semble que c'est bien lui, mais je n'en suis pas très sûr. À mon avis, ce n'est pas aussi incohérent que cela. Je pense que si on veut dire aux dizaines de milliers de propriétaires qui plantent des dachines, des patates douces ou des ignames quelles pratiques culturales il vaut mieux qu'ils suivent, au vu des concentrations dans le sol, cette connaissance est indispensable. Seulement 7 % de terrains qui sont identifiés, cela me semble peu, 48 ans après la contamination…
Je comprends, mais j'avais cru que le BRGM suggérait d'établir une cartographie complète pour toute la Martinique
Dans les zones dites sensibles, une cartographie me semble bien entendu indispensable. J'ai l'impression que les choses sont en train d'avancer. En effet, chaque année, plusieurs centaines de mesures sont faites chaque année dans les sols.
Il y a une question de coût pour toutes ces analyses. Je ne sais pas si cela faisait partie des éléments que l'on vous avait donnés. Mais, en fonction du volume d'analyses qu'on va demander à un laboratoire, les prix peuvent baisser. Il me semble que le tarif peut aller de 68 euros jusqu'à 130 euros. Si on veut avoir beaucoup d'autres éléments, notamment sur les produits dérivés de la chlordécone, on peut monter jusqu'à 500 euros.
Il serait probablement nécessaire de stimuler aussi la recherche sur des méthodes d'analyse plus rapides et moins coûteuses.

Renseignements pris, c'est l'ANSES qui avait plaidé en faveur d'une cartographie complète.
Des méthodes moins coûteuses permettraient probablement d'obtenir, avec le même budget, une cartographie beaucoup plus importante. Des budgets publics incitatifs pourraient amener des laboratoires à s'y intéresser.

Vous partagez donc notre point de vue qu'il faut des budgets incitatifs importants ciblés chlordécone. Nous avons entendu pratiquement tous les chercheurs qui se sont présentés ici dire la même chose.
Permettez-moi d'ajouter que des budgets incitatifs permettraient de s'adresser à des chercheurs qui, actuellement, ne travaillent pas du tout sur la chlordécone. On pourrait ainsi toucher un autre domaine de recherche ou, en tout cas, d'autres chercheurs qui développent des techniques de spectrographie ou d'infrarouge. Techniques qui vont, peut-être, un jour, montrer leur efficacité.
La réunion s'achève à dix heures quarante-cinq.
————
Membres présents ou excusés
Réunion du mardi 9 juillet 2019 à 9 heures 05
Présents. – Mme Ramlati Ali, Mme Justine Benin, Mme Annie Chapelier, M. Serge Letchimy, Mme Hélène Vainqueur-Christophe
Excusé. – Mme Véronique Louwagie