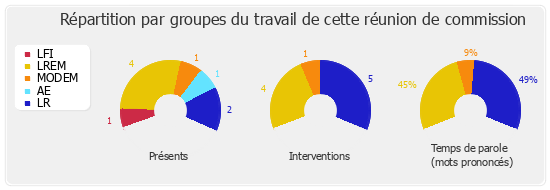Commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire
Réunion du jeudi 20 février 2020 à 15h00
Résumé de la réunion
La réunion
La séance est ouverte à 15 heures.
Présidence de M. Ugo Bernalicis, président.
La Commission d'enquête entend M. Jean-Jacques Bosc et Mme Marie-Christine Tarrare, membres de la Conférence nationale des procureurs généraux.

Mes chers collègues, avant de procéder à notre audition, je vous informe que M. Pascal Gastineau, président de l'association française des magistrats instructeurs et Mme Joëlle Munier, présidente de la conférence nationale des présidents des tribunaux judiciaires, ont souhaité que leur audition se déroule à huis clos.
Pour motiver sa demande, M. Pascal Gastineau indique qu'il est en fonction au pôle financier du tribunal judiciaire de Paris et qu'une audition publique pourrait lui être préjudiciable dans le cas où ses prises de parole lui étaient reprochées. Mme Joëlle Munier, quant à elle, souligne qu'elle est soumise à un devoir de réserve.
Comme je vous l'ai indiqué dès le début de nos travaux, je suis opposé par principe aux auditions à huis clos et très soucieux que nos auditions soient publiques en raison même du sujet dont nous traitons. Je ne suis donc pas favorable à ce que l'audition de ces deux personnes se fasse à huis clos.

Nous avons effectivement décidé, au début de nos travaux, que nos auditions seraient publiques. Mais nous avons également indiqué que si des demandes particulières étaient formulées et justifiées, la commission les examinerait et les trancherait au cas par cas – c'était en tout cas mon souhait personnel. Je rappelle enfin qu'en cas de désaccord entre le président et le rapporteur, c'est la commission qui est appelée à trancher.
Les deux demandes de huis clos qui nous sont parvenues ne me semblent pas devoir recevoir la même réponse. Mme Joëlle Munier justifie la sienne en invoquant son droit de réserve. Dans la mesure où elle représente une organisation professionnelle, une organisation de magistrats parmi d'autres, cet argument ne me semble pas suffisant et je ne vois aucune raison de l'auditionner à huis clos.
La situation de M. Pascal Gastineau est différente, puisqu'il n'est pas seulement président de l'association française des magistrats instructeurs, mais aussi magistrat instructeur au pôle financier du tribunal judiciaire de Paris. Il craint qu'on puisse lui reprocher des propos qu'il tiendrait devant notre commission en tant que juge d'instruction. À titre personnel, je donnerai donc un avis favorable à la demande de huis clos de M. Pascal Gastineau.
La commission accepte la demande de huis clos de M. Pascal Gastineau.
Puis elle rejette la demande de huis clos de Mme Joëlle Munier.
La commission en vient à l'audition de M. Jean-Jacques Bosc et de Mme Marie-Christine Tarrare, membres de la conférence nationale des procureurs généraux.

Mes chers collègues, notre commission d'enquête entend aujourd'hui M. Jean-Jacques Bosc et Mme Marie-Christine Tarrare, tous deux membres de la conférence nationale des procureurs généraux et respectivement procureur général près les cours d'appel de Nancy et de Bourges.
L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Jean-Jacques Bosc et Mme Marie-Christine Tarrare prêtent successivement serment.)
Vous avez rappelé que nous sommes l'un et l'autre procureur général. Nous sommes aussi vice-présidents de la conférence nationale des procureurs généraux, qui a été créée en 1994 et qui n'a pas de personnalité juridique. Elle a d'abord pour objet de favoriser la discussion entre les procureurs généraux sur les questions de justice, de droit pénal et d'administration judiciaire. Elle peut également, lorsqu'elle est consultée, être amenée à donner son avis sur des projets de loi ou des projets de l'administration centrale. Enfin, elle a vocation à fluidifier les relations entre l'administration centrale, d'une part, et les cours et les procureurs généraux, d'autre part.
La conférence est actuellement présidée par Mme Marie-Suzanne Le Quéau, procureure générale d'Aix-en-Provence, et son bureau compte six membres. Nous avons pour habitude d'intervenir à deux, afin de garantir un équilibre. Des conférences régionales préparent nos réunions et nous tenons un séminaire annuel au cours duquel nous réfléchissons à toutes les questions qui concernent la justice.
Mme Marie-Christine Tarrare évoquera la question statutaire et je me concentrerai, pour ma part, sur la question financière et budgétaire, qui est aussi un élément important de l'indépendance de la justice.
L'indépendance de l'autorité judiciaire est inscrite dans la Constitution et il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'appartenance des magistrats du parquet à l'autorité judiciaire : elle va de soi. Le principe d'indépendance concerne aussi bien les magistrats du siège que ceux du parquet.
La question qui se pose, en revanche, est de savoir si les garanties de l'indépendance des magistrats du parquet sont suffisantes et si elles sont au niveau de ce que nos concitoyens sont en droit d'attendre. Le statut des magistrats du parquet a certes déjà évolué, mais d'autres évolutions sont attendues depuis de nombreuses années. Au début du mois, lorsque Mme la garde des sceaux a réuni les chefs de cour, la présidente de la conférence nationale des procureurs généraux a rappelé la nécessité de faire évoluer le statut des magistrats sur deux points. Premièrement, nous souhaitons que les nominations des magistrats du parquet fassent l'objet d'un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Deuxièmement, nous demandons l'alignement du régime disciplinaire des magistrats du parquet sur celui des magistrats du siège.
Certains candidats aux élections s'étaient engagés à mener ces réformes que nous appelons de nos vœux depuis de nombreuses années mais que d'autres questions sont venues les éclipser. La conférence nationale des procureurs généraux est convaincue que ces deux évolutions sont absolument nécessaires si nous voulons que nos concitoyens cessent de s'interroger sur l'indépendance des magistrats du parquet et sur les pressions qu'ils pourraient subir de la part des pouvoirs exécutif ou législatif.
Si les deux points que je viens d'évoquer font l'unanimité, d'autres questions sont moins consensuelles.
Par exemple, le garde des sceaux doit-il ou non conserver son pouvoir de proposition pour la nomination des magistrats du parquet ? Aujourd'hui, le CSM donne un avis simple sur la proposition de nomination du garde des sceaux – dans les faits, il s'agit désormais d'un avis conforme, mais nous souhaiterions passer du fait au droit. Les procureurs généraux souhaitent majoritairement que le garde des sceaux conserve son pouvoir de proposition, parce qu'ils considèrent que le rôle des magistrats du parquet est d'appliquer la politique pénale, qui est l'une des politiques publiques du Gouvernement. La nomination par le garde des sceaux garantit à leurs yeux une application uniforme des politiques pénales au niveau national, c'est-à-dire la protection de l'intérêt général et l'égalité de nos concitoyens.
L'évolution du CSM fait également débat. Faut-il qu'il ait des pouvoirs de proposition, de nomination, voire de gestion du corps ? Certains le proposent. Actuellement, c'est la direction des services judiciaires qui est chargée de la gestion du corps des magistrats. Faut-il que le CSM s'en charge à l'avenir, ce qui entraînerait une déconnexion totale avec le ministère ? Je n'ai pas trouvé, dans les dernières motions de la conférence nationale de procureurs généraux, de position officielle sur ce sujet.
J'en viens à l'aspect financier. Vous nous demandez si les moyens à la disposition de l'autorité judiciaire nous semblent suffisants pour assurer son indépendance et vous vous interrogez également sur les relations, en matière budgétaire, entre les chefs de cour et l'administration centrale, d'une part, et les chefs de cour et les chefs de juridiction, d'autre part.
L'organisation budgétaire de l'autorité judiciaire fait actuellement l'objet de réflexions. La conférence nationale des procureurs généraux ne revendique pas une autonomie de décision, qui supposerait l'instauration d'un conseil de justice ou d'un CSM amélioré, qui ne dépendrait pas du Gouvernement pour ses crédits et qui les allouerait aux juridictions. Notre conférence continue de penser que c'est au garde des sceaux d'obtenir du Parlement, dans le cadre de la loi de finances, les crédits nécessaires au fonctionnement de la justice. De notre point de vue, c'est au pouvoir politique de fixer le montant de ces crédits – même si nous pouvons avoir un avis là-dessus.
La conférence nationale des procureurs généraux souhaite en revanche une large autonomie de gestion des crédits alloués. Les chefs de cour sont, en vertu du code de l'organisation judiciaire, ordonnateurs secondaires. Il nous paraît essentiel que les cours d'appel bénéficient de crédits et que les chefs de cour disposent de l'autonomie de gestion de ces crédits : ce sont deux données essentielles de l'indépendance de la justice.
Si, par exemple, des arbitrages doivent être rendus au sujet des frais de justice, les chefs de cour, parce qu'ils sont des magistrats, me semblent être les mieux placés pour le faire. Au risque d'être un peu technique, j'évoquerai les budgets opérationnels de programme (BOP). Dans le système actuel, certains chefs de cour sont responsables de BOP qui concernent plusieurs cours d'appel : c'est par exemple le cas de la cour d'appel de Nancy. Ils ont donc une prééminence en matière budgétaire, puisqu'ils répartissent eux-mêmes les crédits entre les différentes cours. La conférence serait favorable à ce que chaque chef de cour soit responsable d'un BOP pour sa cour d'appel.
En revanche, le principe « un BOP pour une cour d'appel » paraissant peu compatible avec le maintien de trente-six cours d'appel, il convient de réfléchir à la carte judiciaire et peut-être d'envisager la fusion de certaines cours – même si c'est une question difficile. L'autonomie de gestion implique de pouvoir choisir des marchés et de faire des choix budgétaires. Elle concerne des questions aussi différentes que le gardiennage, l'amélioration de l'environnement de travail ou l'équipement des juridictions en moyens informatiques et téléphoniques. Pour le bon fonctionnement des parquets, notamment de ce que l'on appelle la permanence – le service de traitement en temps réel –, ce dernier point est absolument essentiel. Il faut que les chefs de cour aient leur mot à dire sur ces questions.
J'en viens à la question des moyens humains et financiers alloués aux juridictions. Ces moyens ont longtemps été insuffisants et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Il y a trois ans, l'Inspection générale des finances (IGF) et l'Inspection générale des services judiciaires ont rendu un rapport sur les dépenses de fonctionnement courant des juridictions. Ce rapport montrait tout d'abord que les chefs de cour étaient de bons gestionnaires, alors qu'on avait tendance à dire le contraire pour leur contester cette autonomie de gestion. L'IGF soulignait toutefois que les budgets étaient très contraints et ne couvraient guère que les dépenses nécessaires et incompressibles : l'environnement de travail et la maintenance immobilière pouvaient ainsi en pâtir.
La situation s'améliore depuis quelques années, notamment en ce qui concerne les frais de justice. Il y a encore quatre ou cinq ans, nous devions fréquemment procéder à des arbitrages en fin d'année parce que nous n'avions pas les crédits nécessaires : ce temps est révolu. Des efforts ont également été faits pour réduire le nombre de postes vacants, notamment pour les parquets de première instance. Le projet de mouvement des magistrats pour le mois de septembre prochain, dit « transparence », a été publié hier : tous les postes seront pourvus dans les parquets de première instance.
Il existe encore une marge de progression, s'agissant de l'assistance des magistrats des parquets : il est essentiel que les substituts soient assistés, notamment dans les services de permanence. Il faut qu'ils puissent s'appuyer sur un greffier ou, pour leurs travaux écrits, sur des juristes et des assistants de justice. C'est un élément essentiel et nous sommes loin du compte.

Monsieur le procureur général, vous soulevez le sujet de la nomenclature du cadre de la gestion budgétaire de l'application CHORUS en parlant des budgets opérationnels de programme. Vous dites que, dans l'idéal, il faudrait un BOP par cour d'appel. J'imagine qu'alors une juridiction devrait être une unité opérationnelle (UO) en tant que telle, pour disposer d'une forme d'autonomie de gestion. Aujourd'hui, certaines cours d'appel sont responsables d'unités opérationnelles (RUO), alors que d'autres, en bout de chaîne, ne sont que des « centres de coûts », ce qui signifie que leur marge de décision est quasi inexistante. Nous interrogerons l'administration centrale du ministère, puisque c'est elle qui a la main sur la cartographie budgétaire, mais j'ai bien compris que vous appelez à une clarification, à travers l'augmentation du nombre d'UO et de BOP.
S'agissant des marchés publics, où fixez-vous la frontière entre ce qui devrait relever de marchés nationaux mutualisés, voire interministériels, et ce qui devrait rester à la main du chef de juridiction ?
Chaque cour devrait avoir un budget opérationnel de programme, ce qui impliquerait de réduire le nombre de cours. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut que chaque juridiction soit une UO : certaines d'entre elles sont trop petites et ont donc des moyens trop limités. La gestion des moyens par la cour me semble être la meilleure option.
S'agissant des marchés, il faudrait que les chefs de cour puissent choisir, soit d'adhérer au marché national s'ils y trouvent un intérêt, soit de recourir à un marché local. Je pense par exemple au nettoyage, qui représente une certaine somme et qui a une grande importance dans la vie de tous les jours, mais aussi au gardiennage. Nombre de juridictions souhaitent avoir un service de gardiennage, mais il n'est pas possible que toutes en bénéficient, surtout les plus petites : il importe donc, une fois encore, que le chef de cour puisse faire des arbitrages.
Se pose néanmoins la question de la capacité des services administratifs régionaux (SAR), qui assistent les chefs de cour dans leur gestion budgétaire et administrative, de conclure des marchés. En effet, passer un marché requiert une véritable expertise mais, dans le cadre de BOP renforcés, les SAR pourraient plus facilement comprendre des experts en matière de marchés.
Ma cour est une unité opérationnelle et n'a pas de BOP – je suis procureure générale depuis deux ans et demi maintenant : c'est ma seule expérience en la matière. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous lorsque vous affirmez que les UO ne seraient que des centres de coûts ; nous avons tout de même une petite marge de manœuvre. Les UO ont voix au chapitre : l'allocation des moyens fait l'objet d'une véritable discussion avec les chefs de BOP, de sorte que nous ne nous sentons pas les mains complètement liées. De même, ce n'est pas parce que ma cour est une UO que, lors du dialogue de gestion annuel avec les services de la chancellerie, le premier président et moi n'avons pas la possibilité d'exprimer les besoins de la cour, quitte à soutenir des demandes qui vont à l'encontre de la répartition budgétaire envisagée par le BOP. C'est un élément important.
Par ailleurs, il est vrai que les marchés nationaux apparaissent parfois comme peu adaptés aux réalités et aux besoins locaux. Le SAR de Bourges, par exemple, ne comprend pas de responsable de la gestion des marchés publics, de sorte qu'il n'est pas en mesure de préparer et de négocier un marché, car c'est une tâche extrêmement lourde qui requiert des compétences spécifiques. Dans le cadre des contrats de services que nous avons signés avec les délégués régionaux du secrétaire général, nous avions demandé, précisément pour pouvoir faire des propositions et mieux maîtriser nos besoins, que nous soit alloué un responsable chargé de la gestion budgétaire et des marchés publics (RGBMP). Manifestement, nous n'obtiendrons pas satisfaction, en raison de la petite taille de la cour. Un BOP par cour, ce serait très bien, mais, comme l'a dit mon collègue, il y a aussi d'autres enjeux.

Je précise qu'on ne délègue pas de crédits à un centre de coûts : la ventilation se fait a posteriori, par imputation, alors que l'UO permet de disposer de crédits.
Je souhaiterais vous interroger à présent sur les aspects statutaires. Vous avez peu évoqué, dans votre exposé, la circulaire de 2014 sur la remontée d'informations. Quelle est votre pratique professionnelle en la matière ? Quel filtre appliquez-vous ? Faites-vous remonter l'information dès qu'une enquête correspondant aux critères de la circulaire est ouverte ? Êtes-vous amenés à interroger vos parquets sur des informations dont vous pensez qu'il est important qu'elles soient remontées ? Avez-vous avec ces derniers un dialogue sur le choix de la stratégie d'enquête à adopter dans les affaires les plus sensibles, sans forcément en référer à la chancellerie ? Enfin, estimez-vous que cette circulaire doit évoluer et, si oui, quelles évolutions proposeriez-vous ?
Pour ma part, je me sens très libre. La circulaire de 2014 n'est pas un carcan et j'estime qu'en ma qualité de procureure générale, j'ai la capacité d'apprécier ce qui doit faire l'objet d'une remontée d'informations au niveau central.
En matière d'information, il faut distinguer deux niveaux – il en est en tout cas ainsi dans ma cour. Le premier concerne la relation entre le parquet général et les parquets. Certaines affaires n'intéressent absolument pas et n'intéresseront jamais l'administration centrale mais ont un intérêt local, soit qu'elles présentent un caractère de gravité spécial ou que la question à traiter est particulière, soit qu'elles donneront lieu à un procès sensible lors duquel un grand nombre de personnes devront être jugées. Cette information relève d'un dialogue quotidien et continu. Je demande ainsi très souvent aux substituts de contacter le parquet général pour discuter des affaires qu'ils peuvent avoir à gérer et, le cas échéant, pour partager une décision car il n'est pas toujours simple d'identifier la qualification pénale à retenir, l'orientation à donner ou le service d'enquête à saisir. Il est donc important qu'il y ait un dialogue constant et régulier entre les parquets de première instance et le parquet général, qui a un certain recul par rapport aux magistrats de première instance, soumis à davantage de pression.
Ensuite, il revient au procureur général de déterminer ce qu'il lui semble utile et important de communiquer à l'administration centrale, laquelle attend qu'on lui fasse remonter les questions qui présentent un intérêt juridique particulier, un intérêt national, ou qui vont faire débat. Mais je n'entre pas pour autant – je ne peux pas parler au nom de mes collègues – dans le détail de l'affaire en question. Ainsi, pour répondre à votre question, je ne suis pas du tout convaincue que la remontée d'informations doive se faire dès le déclenchement d'une enquête préliminaire. On peut très bien estimer qu'il faut laisser du temps au temps et qu'il est préférable d'attendre de voir la manière dont l'affaire va évoluer. Peut-être, à un moment donné, faudra-t-il faire remonter l'information, par exemple si des questions juridiques particulières sont soulevées ou si l'affaire va avoir un retentissement important. De fait, le ministre peut avoir besoin de cette information pour répondre – dans le cadre des questions au Gouvernement, par exemple – aux questions que les parlementaires lui posent sur la manière dont une affaire a été gérée, sur les raisons pour lesquelles telle décision a été prise ou non. Mais il est de la responsabilité du procureur général de déterminer le moment et le contenu de la remontée ainsi que le rythme auquel l'information est portée à la connaissance de l'administration centrale.
En la matière, il existe une règle, que tout le monde applique : on ne fait remonter à la chancellerie que les décisions juridictionnelles, arrêts et jugements, et non les pièces de procédure, notamment les procès-verbaux, non plus que les mesures envisagées, comme une garde à vue.

Merci pour ces éléments. Est-il arrivé que la police judiciaire procède elle-même à une remontée d'informations qui vous aurait court-circuités, qui aurait été plus rapide que la vôtre ou qui aurait eu lieu alors que vous aviez souhaité vous abstenir ? Je rappelle en effet que le canal de la police remonte également jusqu'à l'exécutif, même s'il s'agit d'un autre ministre.
Je n'en ai pas eu d'exemple dans mon exercice professionnel, mais je pense que ce phénomène existe, oui.
Je ne parlerai pas de court-circuitage, mais il est arrivé qu'une remontée soit plus rapide que la mienne. Cela n'a toutefois pas perturbé les investigations et je n'ai pas été gênée dans la manière dont je souhaitais diriger l'enquête. C'est un constat que je peux faire.

Madame la Procureure, vous avez indiqué, à propos de la nomination des membres du parquet, que, selon l'opinion majoritaire des parquets généraux, le pouvoir de proposition du garde des sceaux devait être maintenu, au motif que ceux-ci appliquent une politique pénale. En quoi le fait de priver le garde des sceaux de son pouvoir de proposer des nominations remettrait-il en cause l'application de sa politique pénale ? Ce pouvoir ne met-il pas un tant soit peu en doute l'indépendance du parquet aux yeux de l'opinion publique et ne contribue-t-il pas, de ce fait, à le fragiliser ?
Si l'on part du haut de la pyramide, le garde des sceaux définit et met en œuvre la politique pénale du Gouvernement, qu'il appartient aux procureurs généraux d'appliquer. Ceux-ci adaptent cette politique à leurs territoires respectifs et l'affinent, ce qui leur ouvre une certaine indépendance vis-à-vis de la position adoptée par le Gouvernement. Si la conférence nationale des procureurs généraux souhaite majoritairement le maintien du pouvoir de proposition du garde des sceaux, c'est parce qu'elle estime que ce pouvoir est une garantie que les procureurs généraux veilleront à l'application de la politique pénale et que sera ainsi respectée l'égalité de traitement de nos concitoyens. On ne peut certes pas empêcher ces derniers de penser que le lien entre un membre du Gouvernement et ces magistrats est trop étroit.
Tout dépend de la manière dont on envisage la politique pénale. Si l'on considère qu'il s'agit d'une politique publique au titre de l'article 20 de la Constitution, selon lequel « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation », on peut soutenir que le garde des sceaux est fondé à choisir – même si ce choix doit être entériné par d'autres – le magistrat, en l'espèce le procureur général, qui sera amené à décliner régionalement cette politique pénale. J'ajoute que l'appréciation du garde des sceaux n'est pas discrétionnaire puisque le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis, dont nous souhaiterions, comme la révision constitutionnelle le proposait, qu'il soit désormais conforme. Le CSM aurait ainsi la possibilité de s'opposer à la nomination d'un candidat.

Je comprends mal le lien que vous établissez entre les questions budgétaires et financières et la notion d'indépendance de la justice. La situation budgétaire des juridictions, singulièrement des cours d'appel, vous donne-t-elle le sentiment de ne pas disposer de l'indépendance nécessaire pour accomplir votre tâche de représentant du ministère public et, si tel est le cas, pouvez-vous nous citer des exemples précis ? Je crois avoir compris, monsieur le procureur général, que, s'agissant des frais de justice, par exemple, vous ne subissiez pas de contraintes particulières, lesquelles auraient pu peser sur votre pouvoir juridictionnel.
Nous souhaitons le maintien du dispositif actuel. Les frais de justice sont engagés par le magistrat enquêteur : juge d'instruction, officier de police judiciaire, etc. Le chef de cour doit simplement veiller à ce que la dotation de frais de justice allouée à la juridiction couvre les dépenses. En revanche, en matière de gestion, la question budgétaire a des implications évidentes. Par exemple, les chefs de cour allouent des crédits à la documentation, notamment pour l'achat des codes et veillent à ne pas limiter la documentation à la disposition des magistrats. Si cette question relevait d'un administrateur qui ne soit pas magistrat, celui-ci pourrait décider d'y consacrer un budget limité. Ces questions financières ont nécessairement une incidence sur le fonctionnement et, d'une certaine façon, sur l'indépendance de la justice. Je pourrais citer d'autres exemples : allouer des crédits permettant à un procureur de la République de disposer d'un assistant de justice participe de son indépendance, dans la mesure où il peut ainsi exercer ses fonctions de façon plus sereine, faire des choix… C'est pourquoi la question budgétaire et financière me semble être un élément de l'indépendance. Les moyens existent mais il me paraît essentiel que, in fine, des magistrats, en l'espèce les chefs de cour, restent maîtres de leur emploi et des arbitrages.

Si cela contribue sans aucun doute à la qualité de la justice, le lien avec la notion d'indépendance me semble moins évident.
La loi du 8 août 2016 impose aux magistrats de remplir une déclaration d'intérêts. Pouvez-vous nous indiquer la manière dont vous appliquez cette loi ? Réalisez-vous vous-mêmes les entretiens individuels ou déléguez-vous cette tâche ? Avez-vous, par ce biais ou par d'autres, repéré des situations discutables au plan de l'indépendance du magistrat et, le cas échéant, avez-vous des préconisations pour améliorer encore ce dispositif ?
La loi impose un certain formalisme – un peu pesant, du reste – en la matière. Le chef de cour ou le chef de juridiction reçoit le magistrat, qui doit lui remettre sa déclaration d'intérêts. Lors de l'entretien déontologique, il est rappelé au magistrat que la question de l'impartialité peut se poser de façon très concrète, dans des situations quotidiennes auxquelles il doit être attentif, en décidant, le cas échéant, de se déporter. À cet égard, la loi a été positive et contribue à faire en sorte que tous les magistrats soient pénétrés de cet impératif. J'ajoute que la question de l'impartialité se pose, certes aux magistrats professionnels, mais aussi aux magistrats non professionnels : conseillers prud'homaux, magistrats des tribunaux de commerce… Il faut, me semble-t-il, être vigilant en la matière. En tout état de cause, j'estime que cette évolution législative est positive.
L'entretien déontologique durant lequel on remet à son chef de cour ou à son chef de juridiction sa déclaration d'intérêts dûment remplie n'est pas une simple formalité. Je rappelle, du reste, que cette déclaration est remplie à chaque nouvelle installation ou mutation, et non une fois pour toutes. C'est important, car le respect de la déontologie est la garantie pour le justiciable de l'indépendance et de l'impartialité des magistrats. Pour les chefs de cour et les chefs de juridiction qui doivent y veiller, l'entretien est l'occasion de poser un certain nombre de principes. Pour ma part, j'ai exercé dans de petites villes de province, où il est souvent beaucoup plus compliqué d'être impartial. De fait, lorsqu'un jeune collègue est nommé dans une petite ville – s'il a des enfants qui vont à l'école, il va côtoyer les parents d'élèves, il fera peut-être du sport… –, il est important de lui rappeler les principes déontologiques, de le mettre en garde contre certains pièges qui pourraient lui être tendus et de lui indiquer que son chef de cour, son chef de juridiction, est un garde-fou à cet égard.
L'entretien déontologique permet de faire un certain nombre de rappels, notamment dans des situations, que j'ai pu connaître, où un magistrat est l'époux d'un avocat qui exerce dans le même ressort ou d'un officier de police judiciaire. Il faut alors veiller à maintenir une étanchéité. Ce ne sont pas des cas d'école, mais des situations que l'on rencontre au quotidien et qu'il faut gérer le mieux possible pour éviter les difficultés. Mais je vous accorde que ce n'est pas toujours simple, notamment dans des petits ressorts.

S'agissant de la remontée d'informations, vous avez insisté sur votre indépendance en précisant que vous étiez maître de son contenu, de son opportunité ainsi que du moment où elle est effectuée et qu'elle ne comportait ni indications sur les actes à venir ni pièces de procédure. Or, cela peut susciter des interrogations. Puisque vous mettez en œuvre la politique pénale, quel est l'intérêt de vider d'une partie de sa substance le dossier dont vous remontez les informations ? Par ailleurs – c'est un peu l'objet de notre commission –, qu'en est-il de « la redescente », c'est-à-dire des instructions ? Certes, dans les dossiers individuels, celles-ci n'existent pas mais, comme tout ce qui n'existe pas, cela nous intéresse. On a vu que certains bénéficiaires de la remontée d'informations pouvaient être mis en cause. Avez-vous eu à connaître ou avez-vous été confrontés à des instructions, qu'elles soient individuelles ou d'ordre général, dans l'exercice de vos fonctions ?
Que voulez-vous dire par « vider le dossier de sa substance » ?

Je ne dirais pas que vous le videz, mais que vous nuancez le contenu de l'information qui est remontée. Encore une fois, nous avons bien compris que ni les actes à venir ni les pièces de procédure ne faisaient partie de l'information remontée, mais nous avons bien compris également que c'est vous seul, dans l'exercice indépendant de vos fonctions, qui déterminez le contenu de cette information.
Oui, cela relève de notre responsabilité. En ce qui concerne la redescente, il est possible qu'au vu du compte rendu établi, la chancellerie nous demande des précisions factuelles sur un certain nombre d'éléments que nous leur avons proposés. On peut, par exemple, nous demander si la personne mise en cause a des antécédents judiciaires.
Des instructions, qui seraient illégales au regard de la loi de 2013, je n'en ai pas été destinataire dans l'exercice de mes fonctions. Il est vrai que les affaires dont je tenais informée la direction des affaires criminelles et des grâces ne le justifiaient peut-être pas. En tout état de cause, il me semble que, politiquement, un garde des sceaux se trouverait en grave difficulté si le fait qu'il a donné des instructions se savait.

La loi et la circulaire organisent un entonnoir : les procureurs doivent vous remonter beaucoup plus d'informations que vous ne devez en transmettre à la chancellerie. Vous arrive-t-il, avant d'envoyer la fiche de renseignements par écrit, de contacter la DACG ou le cabinet du ministre pour savoir si une information doit y figurer ?
Je ne contacte jamais le cabinet du ministre ; notre interlocuteur est la DACG, qui se charge de remonter les informations au cabinet.
Il a pu m'arriver d'appeler la DACG pour lui transmettre une information que j'estimais urgente. Par exemple, il y a trois ans et demi, un immeuble a explosé à Dijon et il était possible de suspecter un attentat terroriste. J'ai tout de suite obtenu des informations permettant d'établir qu'il s'agissait d'un accident, et j'en ai immédiatement avisé la DACG par téléphone. Mais je n'utilise jamais le téléphone pour savoir ce que je dois écrire dans mon compte rendu.

Les informations que vous remontez auprès de la chancellerie ne consistent pas dans des propositions, mais il ne s'agit pas d'une proposition : vous faites remonter une fiche d'informations.
En effet, nous ne proposons rien, nous envoyons un compte rendu en toute indépendance lorsqu'une affaire nous paraît justifier une remontée d'informations. Nous ne rédigeons plus les rapports administratifs qui étaient encore la norme il y a une dizaine d'années : nous envoyons un e-mail à la DACG exposant les faits que nous souhaitons faire connaître.
En retour, nous recevons un accusé de réception de la DACG, qui nous indique si elle ne souhaite pas plus d'informations ou si elle veut continuer à être informée, auquel cas nous lui faisons remonter les informations actualisées lorsque nous l'estimons utile.
Exceptionnellement, notre rapport peut se terminer par une demande d'expertise juridique sur une situation particulière. Nous pouvons en effet solliciter la DACG afin de discuter, par exemple, d'une qualification pénale dans certains cas hors normes. Pour ma part, je n'ai jamais eu à le faire, et je n'ai jamais appelé la DACG avant de faire mon rapport. J'ai toujours rédigé mes comptes rendus en mon âme et conscience.

Monsieur Bosc, vous avez indiqué que la chancellerie pouvait vous adresser des demandes de précisions. De quelle nature sont-elles ?
Il s'agit de demandes de précisions factuelles sur les personnes en cause : leur profession, leurs antécédents… La plupart des affaires concernent des repris de justice.
Actuellement, il nous est demandé de tenir la DACG informée des homicides par conjoint. Si nous ne l'informons pas des antécédents et des procédures antérieures dans ces cas, elle nous demandera de le préciser.

Vous semble-t-il normal que le garde des sceaux mène sa politique pénale avec des remontées d'informations qui dépendent du bon vouloir de chaque intervenant sur le terrain ? Est-ce compatible avec l'indépendance de la justice ?
Oui, je pense que c'est compatible avec l'indépendance de la justice. Ceci étant, il arrive que la DACG nous demande des précisions sur une affaire dont elle a eu connaissance, par exemple par voie de presse ; nous faisons alors remonter l'information selon les règles habituelles.
Cela ne me paraît pas porter atteinte à l'indépendance. Il est légitime que le garde des sceaux demande des informations. Et puisqu'elles peuvent lui arriver par d'autres canaux, notamment le ministère de l'intérieur, le magistrat que je suis préfère que les informations qui parviennent à la chancellerie aient été validées de façon judiciaire. Cela permet que nos institutions fonctionnent conformément à la Constitution.
Suite à la suppression des instructions individuelles, cette remontée d'informations ne peut pas contrecarrer l'indépendance du magistrat.
Nous donnons l'information que nous estimons utile au ministre pour mener la politique pénale. Il doit savoir quels phénomènes de délinquance se développent, dans quels endroits, et quelles évolutions sont en cours, pour adapter la politique conduite. Cette remontée d'informations du terrain me semble utile pour faire évoluer la réflexion au plus haut niveau.
Ce qui importe, c'est la disparition des instructions individuelles. Il n'est pas possible d'obliger le magistrat à orienter son enquête dans un sens ou à la retenir dans un autre. Nous restons libres des orientations que nous souhaitons donner à une enquête.
Vous avez évoqué la « rétention » d'informations de notre part, mais dans certains cas, notamment les ouvertures d'informations judiciaires, le procureur de la République ne connaît pas les instructions que le juge d'instruction donnera dans ses commissions rogatoires ; il ne l'apprend qu'au moment de la décision. Il n'y a donc pas de rétention d'informations dans ces situations.

Madame la procureure générale, vous avez expérimenté dans le ressort de votre cour d'appel le remplacement du jury populaire par la cour criminelle. La justice, qu'elle soit rendue par des magistrats ou un jury populaire, l'est toujours au nom du peuple. Cette expérimentation soulève néanmoins plusieurs questions.
Les cours criminelles mobilisent cinq juges pour une seule audience, alors que les effectifs ne sont pas au complet dans de nombreuses juridictions, ce qui rappelle que la question des moyens humains est centrale.
Elles ont pour effet d'éloigner la justice du peuple, car les citoyens qui étaient appelés à être jurés prenaient ainsi conscience de la difficulté de la mission qui incombe aux magistrats.
Enfin, la garde des sceaux n'a pas caché que cette expérimentation avait un objectif d'économie. Était-ce la meilleure solution ?
Il ressort des auditions que nous avons menées qu'une des principales difficultés de la justice tient à la défiance des citoyens à l'égard de l'institution judiciaire. Éloigner les décisions de justice du peuple ne risque-t-il pas de renforcer cette défiance et d'accréditer le sentiment d'un entre soi ? L'expérimentation est encore très récente, mais avez-vous de premiers retours ?
Précisons tout d'abord que la cour d'appel de Bourges ne s'est pas portée candidate à l'expérimentation parce qu'elle rencontrait des difficultés pour gérer le stock d'affaires criminelles. Au contraire, nous pouvions juger les affaires criminelles dans des délais extrêmement raisonnables, de l'ordre de huit mois après le renvoi. Nous voulions justement montrer quelles répercussions cette future évolution législative aurait sur des cours qui fonctionnent bien. Le concept a été imaginé pour des cours qui n'étaient pas capables de juger dans des délais raisonnables des personnes à qui l'on reprochait des faits extrêmement graves, et qui se trouvaient en détention provisoire pendant très longtemps. Or, il n'est pas question que les mesures pensées pour aider des juridictions très engorgées viennent désorganiser celles qui fonctionnent bien.
L'expérimentation a commencé au mois d'octobre dernier. Nous avons donc très peu de recul : nous n'avons traité que deux dossiers en deux sessions, car dans les deux cas, il s'agissait de dossiers très lourds. Un cas impliquait des accusés multiples, l'autre un nombre de parties civiles très important.
Avec ce tout petit recul, il ressort que l'oralité des débats n'a pas été oubliée. Les présidents de cour criminelle et l'ensemble des participants ont tenu à échanger comme ils le feraient devant une cour d'assises, afin que les parties civiles, les accusés ou les témoins puissent s'exprimer. Devant la cour criminelle du département du Cher, nous continuons à faire citer des témoins ; ce n'est pas une audience correctionnelle à un échelon supérieur. Il faut se laisser le temps nécessaire pour juger une personne.
Dès le premier dossier, il est également apparu que les débats sont plus juridiques et techniques que devant une cour d'assises ; nous avons beaucoup plus discuté de points de droit.
S'agissant des moyens, la cour criminelle est effectivement composée de cinq magistrats juges et le parquet est représenté par un avocat général – ce dernier point ne change pas. Il est possible de faire siéger des magistrats temporaires et des magistrats juridictionnels honoraires, ce qui peut aider dans certains ressorts. Le premier président de la cour criminelle départementale du Cher a décidé d'ouvrir l'assessorat à l'ensemble des magistrats du siège du ressort de la cour, répondant à la demande des magistrats du siège d'autres départements qui souhaitaient participer à cette expérimentation et voir vivre cette cour criminelle pour se forger un avis sur la pertinence de l'expérimentation.
Enfin, la seule économie constatée est celle liée au dédommagement des jurés, puisqu'il n'y a plus de jury d'assises.
Vous me demandez si nous ne risquons pas de nous couper encore plus de nos concitoyens. Ceux-ci connaissent très peu et très mal le fonctionnement de leur justice. Chaque fois que j'ai reçu dans ma juridiction des personnes qui n'étaient pas juristes, elles en sont reparties positivement étonnées, et j'ai pensé qu'elles pourraient ensuite expliquer autour d'elles comment fonctionne notre justice. Derrière des murs parfois un peu austères, notre fonctionnement n'est pas obscur : des règles sont appliquées, au quotidien, par des personnes compétentes, motivées, d'une grande déontologie et animées par le respect du service public.
Votre question est donc pertinente. Notre droit fait juger les affaires les plus graves avec une participation citoyenne. La participation des citoyens aux tribunaux correctionnels a même fait l'objet d'une expérimentation pendant un temps. Je n'ai pas eu l'occasion de la mettre en œuvre, mais l'expérimentation n'a pas prospéré.
La présence de citoyens aux côtés du magistrat est incontestablement une richesse : tous les présidents de cour d'assises vous diront que les délibérés y sont riches et les interventions des jurés de qualité. Ces derniers prennent vraiment à cœur cette mission, qui leur est parfois imposée. Lors des révisions de listes, on voit souvent des personnes arriver en traînant les pieds, espérant ne pas être tirées au sort, mais après avoir participé à un jury d'assises, elles souhaitent recommencer. Cette participation permet de comprendre notamment combien il est compliqué de juger une personne. Tout le monde se fait aisément un verdict au-dehors, mais lorsqu'il faut prendre la décision, c'est beaucoup plus compliqué.
Faire participer nos concitoyens à l'œuvre de justice contribue à leur éducation civique. Mais si l'on constate que le système ne fonctionne pas, pourquoi ne pas essayer de trouver une autre solution ? Peut-être que la conclusion de cette expérimentation sera qu'il ne faut pas se passer des jurys populaires. Il est difficile de dire s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise idée, pour l'instant. Nous essayons de faire fonctionner l'expérimentation au mieux, pour reproduire la dynamique qui existe au sein d'une cour d'assises. La présence des magistrats à titre temporaire, qui peuvent avoir une autre profession et venir d'un autre horizon permet d'apporter un regard différent. Nous verrons, au terme de l'expérimentation, s'il est décidé de la généraliser.

Je constate que nous sommes tous convaincus de l'importance des jurys populaires. Vous dites que le système ne fonctionne pas. Comment préconisez-vous d'associer les citoyens aux décisions de justice ?
Je vous donnerais tout de suite la solution si je l'avais ! Il est vrai que le fonctionnement des cours d'assises, qui implique le tirage au sort des jurés, les révisions de listes, les constitutions de jurys, est extrêmement lourd et prend beaucoup de temps. Nous pourrions assouplir les modalités de désignation des citoyens assesseurs en prenant exemple sur les autres pays qui fonctionnent avec des jurys populaires. Et si nous y parvenions, pourquoi réserver la participation des citoyens aux décisions les plus graves ? Ils pourraient prendre part à bien d'autres contentieux.

Imaginons qu'un article de presse fasse état d'un comportement condamnable de la part d'une personne morale ou physique dans le ressort de votre juridiction, qui n'aurait pas fait l'objet d'une remontée d'information de votre part. La DACG pourrait-elle vous demander si une enquête est ouverte ? Et si ce n'est pas le cas, pourrait-elle vous demander d'en ouvrir une ?
Dans quelle mesure le fait de vous demander si une enquête est ouverte ne va pas vous pousser à le faire, alors que la sérénité de la justice aurait conduit à laisser les choses en l'état tant qu'aucun élément tangible ne lui était communiqué ?
L'article 41 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République doit rechercher les infractions. Il n'y aurait rien de choquant ou d'illégal à ce qu'un procureur de la République, ou un procureur général – qui garde le pouvoir de donner des instructions individuelles –, ordonne une enquête sur le fondement d'informations de presse, cela s'est déjà fait, mais ce n'est pas lié aux remontées d'informations à la DACG.
Et selon le retentissement médiatique, on peut imaginer que la DACG demande au procureur général si une enquête est ouverte, mais cette simple interrogation ne déterminerait pas l'ouverture d'une enquête.
J'ai vécu un cas de cette nature. Un hebdomadaire de la presse nationale avait fait paraître un article relatant qu'un patient était décédé dans la salle d'attente d'un hôpital, et mettant en cause la responsabilité de l'établissement dans la chaîne de prise en charge du patient.
Le décès de ce patient n'avait pas été porté à notre connaissance. Cette affaire publiée dans la presse, a suscité l'attention de la DACG qui m'a appelé pour me demander si j'avais des informations. Je n'en avais absolument aucune, et je me suis renseignée avant de décider des suites éventuelles. Mais je n'ai pas reçu d'instructions m'incitant à diligenter une enquête ; j'ai simplement été sollicitée car l'affaire semblait avoir une forte importance.
La séance est levée à 16 heures 30.
Membres présents ou excusés
Présents. - M. Ugo Bernalicis, M. Ian Boucard, M. Vincent Bru, Mme Émilie Guerel, Mme Nadia Hai, M. Dimitri Houbron, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, M. Antoine Savignat