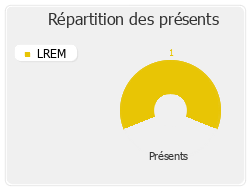Commission d'enquête sur l'évaluation des politiques publiques de santé environnementale
Réunion du jeudi 1er octobre 2020 à 11h00
Résumé de la réunion
La réunion
L'audition débute à onze heures.

Nous poursuivons nos auditions avec M. William Dab, professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), médecin et docteur en épidémiologie, et ancien directeur général de la santé. Votre enseignement au CNAM a porté sur l'hygiène industrielle et de l'environnement, et la sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. Vos travaux ont porté sur la surveillance épidémiologique, l'organisation du dispositif de sécurité sanitaire, la sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. Votre audition à titre d'expert, de scientifique et de gestionnaire est précieuse pour notre commission d'enquête. Nous vous remercions pour votre présence.
Les questions que nous souhaiterions aborder avec vous sont les suivantes. En l'état des connaissances, quels sont les déterminants de la santé ? Comment appréhender l'environnement comme facteur de santé ? Comment faire face aux risques affectant la sécurité sanitaire environnementale ? L'objet de cette commission d'enquête est d'établir un bilan des points forts et faibles des politiques publiques actuelles en matière de protection de la santé environnementale.
(M. William Dab prête serment.)
Merci, Mme la présidente, pour cette convocation. J'y ai répondu volontiers, d'abord parce qu'on ne peut pas s'y soustraire, ensuite parce qu'il est important que la représentation nationale se penche sur cette question.
En premier lieu, la culture de l'évaluation des politiques publiques doit être développée en France, non pour critiquer ou sanctionner davantage, mais pour s'inscrire dans une logique d'amélioration continue.
En deuxième lieu, l'étude des rapports entre l'environnement et la santé est relativement récente en France. La création du ministère de l'environnement date de la présidence de Georges Pompidou, dans les années 1970, mais son objet portait initialement sur la préservation des paysages, des sols, de la faune et de la flore. Cette mission était parfaitement respectable, mais, à travers différentes crises successives, une préoccupation de santé en lien avec l'environnement a émergé et s'est renforcée. Lorsque la grande loi de sécurité sanitaire a été votée en 1998, nous étions un certain nombre à plaider pour la création d'une agence susceptible d'aider les pouvoirs publics dans le domaine de la santé-environnement. Nous n'avions pas alors été écoutés. Il a fallu la marée noire de l'Erika, en 2000, pour que l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement soit créée. Elle est depuis devenue l'Agence française de l'environnement et du travail, puis l'ANSES : l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Ce chemin est donc assez récent, et encore en cours de construction.
En troisième lieu, ce secteur présente la difficulté intrinsèque d'être éminemment interministériel. De fait, il n'y existe pas de leader. Le ministère de la santé, qui serait le candidat naturel à cette fonction, n'a en réalité la main que sur l'eau, qui, seule, relève du code de la santé publique, en termes de sécurité sanitaire. Tous les autres domaines de la santé-environnement sont partagés entre d'autres ministères : l'environnement, l'agriculture, l'industrie, les transports, etc. Or, dans le fonctionnement « en silos » de notre organisation administrative, cela constitue une difficulté. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), une direction du ministère des Finances, ne doit pas être oubliée dans cette énumération, car elle joue un rôle très important.
Le secteur est globalement peu doté. Grâce à l'action des agences, des universitaires et des chercheurs, notre expertise est assez bonne et peut se comparer à celle des pays similaires. Notre faiblesse vient de notre capacité sur le terrain. Dans les agences régionales de santé (ARS), le secteur environnement est faible, et principalement orienté vers les contrôles d'eau (potable et de baignade). Le secteur des installations classées reste relativement faible. La ministre a annoncé, lors du premier anniversaire de l'accident de Lubrizol, qu'il serait renforcé. Sur le terrain, nous ne sommes pas équipés à la hauteur des enjeux, même si nous ne sommes pas totalement démunis. Ce décalage trop grand entre les ambitions affichées dans les différents plans et notre capacité à les réaliser suscite un problème de confiance du public.
Lorsque les citoyens se posent des questions en santé-environnement, parce qu'ils pensent que leur santé peut être altérée, d'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas d'interlocuteur. Depuis longtemps, je parle de l'existence d'un besoin social à cet égard. Il n'existe pas d'interlocuteur unique pour la population. Lorsqu'on dispose d'une entrée par pathologie, c'est alors le médecin, le ministère de la santé et les ARS qui seront consultés. La plupart du temps, ce n'est cependant pas le cas : il n'existe pas de malade, mais des expositions, qui inquiètent les gens – faut-il s'attendre, à court, moyen ou long terme, à un effet de ces expositions, pour nous ou nos enfants ? Il n'y a alors pas d'interlocuteur, car selon l'exposition concernée, il faudra s'adresser à différents départements ministériels ou services déconcentrés gérés par les préfets. Ce « maquis », dans lequel le citoyen ne se reconnaît pas, a une conséquence. Devant cette complexité, le réflexe est de créer une association et d'alerter les médias, de sorte que l'entrée habituelle des questions de santé-environnement est la dénonciation, l'inquiétude et l'alarmisme. C'est en effet la seule manière de se faire entendre. Il faut donc que vous y réfléchissiez.
Pour préparer cette audition, j'ai examiné les priorités de la stratégie nationale de santé, du plan national santé-environnement (PNSE) et du plan national santé-travail (PNST), car l'environnement de travail fait partie de l'environnement. Je n'ai pas examiné les priorités des plans sectoriels (phytosanitaires, perturbateurs endocriniens, etc.). Or, les priorités ne sont pas les mêmes selon les plans, et elles sont au total une trentaine. Cela signifie en réalité qu'il n'existe pas de priorités. On touche ici à la difficulté ministérielle de la création des plans.
Au Conservatoire national des arts et métiers, nous dispensons très peu de formation initiale, mais surtout de la formation tout au long de la vie. Nos étudiants travaillent en journée dans les entreprises et viennent en cours du soir. Ils réalisent en entreprise des mémoires d'hygiéniste, des mémoires de licence professionnelle ou d'ingénieur en prévention des risques. Nous disposons ainsi d'une assez bonne vision de ce qui se passe en entreprise. Je ne dis pas que le secteur public doit fonctionner comme une entreprise, mais certaines des pratiques en entreprise me paraissent intéressantes. Les entreprises très impliquées dans le domaine de la santé-environnement – les entreprises de l'énergie, de l'eau, des services aux collectivités, etc. – établissent des cartographies des risques. Elles identifient les sources de danger et d'exposition et établissent des cotations des niveaux de risque, qui ne sont pas nécessairement très élaborées, mais comportent du moins des indicateurs de fréquence et de gravité, même simples (allant de 1 à 4), et un indicateur d'urgence. Certaines expositions présentent en effet des risques à court terme : il faut alors agir de manière urgente. Certaines expositions sont cancérigènes et n'ont pas d'effet immédiat, mais seulement retardé : on dispose alors d'un peu de temps pour organiser l'action. À partir de ces cartographies des risques, les entreprises construisent des plans d'action, avec des moyens dédiés. C'est ce qui nous manque dans l'élaboration des politiques publiques. J'ai relu les trois plans que j'ai évoqués : stratégie nationale de santé, PNSE, PNST. Les arguments ayant amené leurs concepteurs à choisir des priorités ne sont pas fournis dans ces plans, du moins pas de manière systématique, telle qu'une cartographie des risques permet de le faire.
Je sais que l'exercice est difficile. J'ai eu à préparer le premier PNSE. J'ai collaboré au premier PNST, qui était naturellement dirigé par la direction générale du travail, mais en bonne intelligence avec la DGS. Je ne dis pas « y a qu'à, faut qu'on ». Cet exercice est difficile, mais il est nécessaire. Il est de plus facilité aujourd'hui par l'existence d'agences de qualité : l'ANSES, Santé publique France, l'INERIS, l'IRSN, l'INRA, certaines unités de l'INSERM, etc. garantissent de disposer du soutien scientifique nécessaire à l'organisation de ce travail.
Enfin, même si je sais que cela est difficile politiquement, il vaut mieux définir cinq priorités et y affecter des moyens et des plans d'action, avec un dispositif de suivi sérieux, que de se disperser, car on n'obtient alors que très peu de résultats tangibles. Il faut expliquer à la population qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes à la fois. Il est frappant de constater que les politiques publiques comportent aujourd'hui une trentaine d'énoncés de priorités, sans budget clairement affecté aux plans d'action.
Or, tout cela crée un état de défiance. Des études extrêmement sérieuses le montrent. Il ne s'agit pas seulement d'une opinion. L'excellent observatoire des risques de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mène depuis vingt-cinq ans de véritables études, qui ne sont pas de simples sondages. Y participent des sociologues, des psychologues, des épidémiologistes, des statisticiens de très haut niveau. Les données qui en résultent sont très facilement accessibles en ligne. Sur de nombreuses questions, les Français estiment majoritairement qu'on ne leur dit pas la vérité. Deux facteurs structurent l'opinion face aux risques environnementaux. Le premier facteur est, logiquement, l'importance du risque perçu. On ne prend cependant pas suffisamment garde au deuxième facteur, qui est l'incertitude. Ce qui est incertain fait plus peur que ce qui est certain. Un certain discours rationaliste traite la population comme irrationnelle : je ne suis pas d'accord. Il suffit de réfléchir à nos comportements dans la vie quotidienne pour réaliser que, vis-à-vis de nous et surtout de nos enfants, nous faisons plus attention dans un environnement incertain que dans un environnement certain et familier. Il s'agit d'une caractéristique générale de la psychologie humaine. Ce qui est incertain fait peur, indépendamment du niveau de risque. C'est pourquoi il est essentiel de fournir à la population un interlocuteur unique, qui ne la laisse pas dans le brouillard et dans l'incertitude, car l'incertitude fabrique l'inquiétude. Même en tant qu'épidémiologiste, je ne recommanderais donc pas une approche conduisant à définir les priorités sur une base purement épidémiologique et rationnelle. Il faut croiser cette dimension épidémiologique avec ce que l'on sait de la perception sociale des risques, et notamment des secteurs qui suscitent le plus d'inquiétudes. À défaut de procéder ainsi, on ne peut pas comprendre pourquoi les OGM font si peur, alors qu'ils ne présentent aucun risque démontré. Ce n'est pas irrationnel : les gens savent qu'il existe des controverses sur les OGM, et qu'ils sont soutenus par de puissants intérêts industriels. Ils n'ont pas confiance.
La préoccupation est insuffisamment présente de savoir comment gouverner l'incertitude et créer la confiance. Je m'adresse aussi cette critique. Lorsque j'ai créé le premier PNSE, je n'ai pas tenu compte de ces facteurs. Avec l'expérience et le recul, je partirais toujours des grands problèmes de santé et d'environnement qui se posent à nous, mais en intégrant la manière dont la population vit ces problèmes, car la finalité d'une politique publique est de répondre aux besoins de la population. Même si ces besoins ne sont pas nécessairement formulés en termes épidémiologiques, c'est la population qui a raison. C'est la manière dont la population définit sa préoccupation qui doit constituer la préoccupation des décideurs.

Je vous remercie de cette présentation liminaire.
Ce que vous dites réveille ma formation de psychosociologue. Ces questions tendent à être abordées sous un angle scientifique, que l'on croit partagé, en oubliant la dimension de l'impact psychologique, qui est déterminant pour la tranquillité démocratique. Toute méfiance à l'égard d'un gouvernement présente en effet un risque pour le fonctionnement et la stabilité de nos institutions démocratiques. Surtout en ruralité, où l'information est davantage filtrée, des interrogations apparaissent, qui sont relayées et amplifiées à des fins politiciennes. Je vous remercie donc de souligner cette dimension, qu'on a trop tendance à oublier dans la définition de nos stratégies.
Mes questions portent également sur la manière dont vous intervenez dans ces dispositifs de politique publique, comme enseignant, notamment au CNAM. Quel contenu dispensez-vous à vos étudiants ? De nombreuses auditions ont souligné à quel point la formation des professionnels et l'information publique sont déterminantes pour évoluer avec l'ensemble de la population, et non au seul niveau administratif, ministériel et politique parisien. Il faut diffuser largement l'information pour pouvoir mobiliser et limiter les risques d'incertitude, donc de crainte et de contestations. Quel est le contenu de cette formation ? Vous avez dit que vos étudiants étaient déjà engagés dans une vie professionnelle. Quel lien existe-t-il entre votre enseignement et la santé environnementale ? Enfin, vous avez indiqué que les politiques publiques devraient s'inspirer du pragmatisme d'approche de la santé environnementale dans les entreprises, même si elle ne constitue pas une « panacée ». Ce pragmatisme tient au fait qu'une entreprise doit assurer sa survie économique et son image de marque vis-à-vis du public. Elle suit donc une méthodologie de marketing qui pourrait servir d'exemple à nos politiques publiques.
Je donnerai aujourd'hui un cours intitulé « Pourquoi évaluer les risques ? ». Il constitue le premier cours d'un module de sécurité sanitaire. J'y pars d'une définition large de la santé. Tout ceci figure en réalité dans le Que sais-je ? que j'ai écrit.

J'ai oublié de signaler que vous êtes l'auteur d'un petit ouvrage remarquable. On sait que les Que sais-je ? sont très bien écrits et surtout très accessibles aux personnes non savantes. Celui-là est particulièrement bien fait.
J'ai fini par l'écrire, car les étudiants me le demandaient. J'y explique que la santé est multi-déterminée. Or, nous sommes dans un pays où la pensée médicale est très forte. Tout au long du XXe siècle, les progrès de la médecine, de l'hygiène et des antibiotiques nous ont fait oublier le rôle de l'environnement comme déterminant de la santé, un enjeu très présent au XIXe siècle. Même Pasteur à la fin de sa vie a dit : « Le microbe n'est rien, le terrain est tout ».
Nous expliquons ensuite à nos étudiants les quatre grands déterminants de l'état de santé de la population : la médecine ; les comportements individuels ; la génétique et la biologie ; les environnements, en particulier général et professionnel.
Nous leur présentons ensuite les deux grands modèles qui permettent de penser les relations entre l'environnement et la santé. Selon le premier modèle, que j'appelle pasteurien, un facteur entraîne une maladie. Ce modèle n'est pas erroné : seule l'exposition au plomb entraîne le saturnisme ; seule l'exposition à l'amiante entraîne le mésothéliome ; etc. En revanche, ce modèle est partiel. Le modèle qui a émergé grâce à l'épidémiologie, dans les années 1950, est multifactoriel. Même si elles ne sont pas totalement unifactorielles, les maladies infectieuses relèvent certes, comme le rappelle l'actualité, du modèle pasteurien. Lorsqu'on n'est pas exposé au microbe, on ne développe pas la Covid -19. Pour toutes les maladies chroniques, il en va autrement : cancers, maladies cardiovasculaires, maladies digestives, maladies neurologiques, maladies rhumatismales, etc. sont autant de maladies dans lesquelles les quatre grands déterminants de l'état de santé jouent, et notamment l'environnement. C'est pourquoi, lorsqu'on me demande quelles sont les maladies de l'environnement, je réponds : toutes. Hormis les maladies purement génétiques (qui sont une centaine sur les 5 000 maladies répertoriées), toutes les autres maladies sont en partie liées à l'environnement. Des travaux de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), que je cite dans mon cours, permettent de distinguer, pathologie par pathologie, la part contributive de l'environnement dans le fardeau de chaque maladie.
Mon équipe se constituait de juristes, de mathématiciens, de statisticiens, d'hygiénistes, d'ingénieurs. Je parle au passé, car je suis maintenant professeur émérite, même si le concours de ma succession n'a pas encore été ouvert. La doctrine de mon équipe repose sur l'idée que pour prévenir un risque, il faut le mesurer. On n'améliore que ce que l'on mesure. Une fois ces grands concepts présentés, nous apprenons à nos étudiants comment mesurer le risque. Nous leur apprenons quels outils permettent de mesurer les expositions. Sans chercher à faire de nos étudiants des épidémiologistes, car ce n'est pas le but de la formation, nous leur apprenons à lire des travaux épidémiologiques, pour qu'ils puissent se faire une idée de la qualité du niveau de preuve apporté ; nous leur apprenons à lire les travaux des agences de sécurité sanitaire, pour comprendre comment elles raisonnent et synthétisent les données toxicologiques ou épidémiologiques disponibles ; et nous leur enseignons les méthodes d'évaluation quantitative des risques sanitaires. Ces méthodes ont maintenant une quarantaine d'années et sont très utilisées, notamment par l'ensemble des agences de sécurité sanitaire. J'ai d'ailleurs formé une grande partie des personnes qui travaillent dans ces agences, en évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS).
J'ai forgé cette doctrine, avec mes collaborateurs, en prenant du recul sur mes années de décideur et de gestionnaire. Je me suis en effet aperçu que, parmi tous les dossiers sur lesquels la DGS est intervenue, chaque fois que nous avons pu quantifier, même approximativement, un risque, sa gestion est restée relativement facile. Lorsque nous ne l'avons pas fait, nous avons plutôt vécu des moments critiques. Cela a par exemple été le cas pour l'Erika. Au tout début de la marée noire, le discours sanitaire était plutôt rassurant, ce qui semblait une évidence du point de vue de l'expertise et de l'épidémiologie. Pourtant, les goudrons, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, sont notoirement cancérigènes. Ce mot a suscité une émotion particulière dans l'opinion, et j'ai convaincu la ministre de l'époque, Mme Dominique Gillot, de lancer ce qui reste encore aujourd'hui en France la plus grande évaluation quantitative des risques sanitaires jamais réalisée. Commencée en mars, elle a été terminée en mai. Grâce à elle, 95 % des plages du littoral atlantique ont été ouvertes et fréquentées à l'été 2000, sans aucune plainte.
Je cite souvent un autre exemple. La décennie 1980 avait été celle de la transmission transfusionnelle du SIDA. La décennie 1990 avait été celle de la vache folle. Lorsque je croisais les deux, j'obtenais la possibilité d'une transmission transfusionnelle du prion. Je l'envisageais régulièrement, en arrivant le matin au bureau, comme la pire des catastrophes que je pourrais avoir à gérer au sein de ma propre cartographie des risques. Et c'est arrivé. L'Institut de veille sanitaire m'a prévenu, un soir, que les huitième et neuvième cas de maladie de Creutzfeldt-Jacob en France avaient été donneurs réguliers de sang, avant qu'on apprenne qu'ils étaient atteints de cette maladie du prion. Les plus hautes autorités ont été immédiatement prévenues, car le retentissement et l'émotion étaient évidemment considérables. L'été précédent, dans le British Medical Journal, un article convaincant avait en effet montré que les transfusions de globules rouges pouvaient transmettre le prion. Or, le don du sang permet de transfuser des globules rouges, mais aussi de produire du plasma, qui sert à fabriquer des médicaments dérivés du sang.
Grâce à la traçabilité de l'Établissement français du sang et de l'AFSSAPS de l'époque, les 24 patients ayant reçu des globules rouges issus de ces lots avaient pu être retrouvés immédiatement. Les globules qui n'avaient pas été consommés avaient été immédiatement retirés de la circulation. Gérer 24 patients est facile : cela relève d'une décision médicale. Nous avons pris contact avec leurs médecins et leur avons expliqué la situation. La plupart de ces patients étaient extrêmement malades, raison pour laquelle ils avaient été transfusés : nombre d'entre eux étaient atteints du cancer, etc. En discutant avec ces médecins, je me suis donc vite rendu compte que ce n'était pas le prion qui tuerait leurs patients. Les médecins avaient toutefois été prévenus de l'existence d'un risque, et la question avait été réglée.
Savoir combien de personnes avaient pu recevoir des médicaments à partir du plasma dérivé du sang de ces donneurs était plus difficile, car la traçabilité était moins bonne. L'AFSSAPS a toutefois réalisé un travail extraordinaire, m'ayant appelé quelques jours plus tard pour m'indiquer un nombre de personnes évalué à 70 000. La décision n'était alors plus médicale, mais de santé publique. Les juristes me conseillaient, pour ma propre sécurité juridique, de tout faire pour retrouver ces 70 000 personnes et les informer. Le médecin qui sommeillait en moi se demandait toutefois quoi leur dire : « Vous avez peut-être reçu du prion, je n'ai pas de test à vous proposer, je ne sais pas si vous serez malade, et je ne dispose d'aucun traitement. Toutefois, je vous ai prévenus ». J'ai saisi le comité consultatif national d'éthique, qui a conclu comme moi qu'il était impossible de procéder de cette manière du point de vue de l'éthique médicale, même si cela m'aurait davantage tranquillisé juridiquement. Comme j'avais longuement réfléchi au problème auparavant, j'ai demandé une quantification du risque. Elle a été réalisée, avec beaucoup de difficultés, car nos agents avaient commencé par estimer qu'elle serait impossible, faute des outils requis. En tant que gestionnaire, je ne pouvais pas me charger moi-même de cette évaluation des risques : je voulais qu'elle soit menée indépendamment du système de décision. Finalement, cette expertise a été réalisée, avec une aide britannique, et surtout celle de Stanley Prusiner, prix Nobel.
Dans le pire des scénarios, en forçant toutes les hypothèses les plus pessimistes, l'excès de risque était minime. J'ai donc soutenu la position qu'il ne fallait rien dire aux 70 000 personnes en question. Politiquement, c'était inaudible. Le 1er mars 2005, je me suis rendu en conférence de presse pour expliquer la position de la direction générale de la santé, et en quoi consistait l'évaluation des risques. Le président de l'association française des hémophiles, M. Edmond-Luc Henry, avec qui j'avais longuement parlé de ce dossier, était à mes côtés. Il m'avait dit que, selon lui, j'avais cette fois utilisé les données de la science aussi bien qu'on pouvait le faire, pour cerner les incertitudes. Je lui ai demandé de le déclarer publiquement, sans prendre parti sur la justesse ou non de ma position. Ce n'était pas son rôle : il devait conserver une position critique, compte tenu de ce qu'il représentait, et du tribut que les hémophiles avaient payé au SIDA. S'il était en désaccord avec ma position, je lui ai demandé de le dire, évidemment. Il a dit publiquement que nous avions utilisé les données aussi bien que possible. J'ai quant à moi expliqué publiquement ce jour-là que tout ce que nous pourrions faire vis-à-vis de ces 70 000 personnes aurait plus d'inconvénients que de bénéfices pour elles. Au nom du principe de précaution, nous préconisions donc de ne rien faire. Cela montre d'ailleurs bien que tous ceux qui font du principe de précaution un principe de surenchère se trompent. Au nom du principe de précaution, nous nous sommes abstenus. J'ai ajouté, malgré les communicants qui me le déconseillaient, qu'il s'agissait de notre position de départ et que nous la réviserions, si elle n'était pas comprise dans le pays. Il paraît que l'État ne doit pas dire cela.
En réalité, j'ai beaucoup appris de cet événement. Cette affaire a fait la une des journaux, mais seulement vingt-quatre heures. Tout le monde l'a aujourd'hui oubliée. Nous n'avons reçu aucune lettre, aucune plainte, aucune protestation nous disant que cette position était trop laxiste, que nous étions des négationnistes du risque et que nous ne prenions pas les responsabilités et les décisions qu'il fallait. C'était pourtant pour moi le pire des cauchemars. Nous nous en sommes sortis, parce que nous avons établi une quantification des risques, en retenant, dans toutes les situations d'incertitude scientifique (c'est-à-dire en l'occurrence dans toutes les situations), le scénario le plus défavorable, c'est-à-dire le plus favorable à la santé.
La doctrine scientifique de mon équipe a donc été forgée sur la base de tels exemples. On ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Or, aujourd'hui, nous disposons des outils scientifiques requis à cette fin. Dans le cas du prion, ils étaient trop rudimentaires : il ne s'agissait pas encore de science, mais de « bricolage », à des fins d'aide à la décision. En l'absence d'avis de la science, comment pouvais-je prendre une décision, ou plutôt recommander au ministre de prendre une décision ? Toutefois, nous avons « bricolé » intelligemment, et surtout de manière scientifique, c'est-à-dire réfutable. Il était toujours possible de revenir sur les hypothèses retenues pour les modifier, et examiner ce qu'il en résultait pour le résultat final. À la lecture du rapport d'expertise, M. Edmond-Luc Henry m'a d'ailleurs suggéré de retenir une autre hypothèse concernant la dose minimale infectante. J'ai demandé aux agences de refaire les calculs de modélisation sur cette base : le changement n'affectait que la huitième décimale après la virgule. M. Edmond-Luc Henry m'a remercié : il avait obtenu la réponse à la question qu'il se posait. Il était écouté. La science avait parlé, et il écoutait la science en retour. C'est la meilleure chose à faire.
Évidemment, nos étudiants apprennent ensuite à transformer ces évaluations de risques, ces cartographies de risques, en plans de gestion : comment établir des priorités, affecter des ressources, qu'est-ce qu'une démarche de programmation de l'action, quels indicateurs d'évaluation a-t-on besoin de suivre, comment réaliser des évaluations économiques, comment calculer le retour sur investissement ? Ce dernier point est très important dans les entreprises : depuis qu'on sait calculer le retour sur investissement des actions de prévention, le regard des entreprises a totalement changé sur la prévention. Elle était jusque-là considérée comme une obligation réglementaire imposée de l'extérieur à la société. Mais montrer à un entrepreneur qu'investir un euro en prévention en rapporte deux en dix-huit mois change totalement son regard. Lorsque nous apprenons à nos étudiants à améliorer et renforcer l'action des entreprises en matière de santé-environnement, comme en matière de santé au travail, nous leur apprenons à choisir les actions qui présenteront le meilleur rendement. Cela peut paraître cynique, mais au stade de relative faiblesse où nous nous trouvons, il faut partir de ce qui motivera les entreprises. Un mouvement sera ainsi généré, dont résulteront d'autres actions.
Notre approche consiste ainsi, fondamentalement, à apprendre à nos étudiants à raisonner en termes de population. Les ergonomes et les psychologues raisonneront davantage en termes de personnes, de postes de travail, etc. : tout cela est important. Nous apprenons aussi ces approches à nos étudiants, qui sont formés de façon pluridisciplinaire. Nous collaborons avec la chaire de psychologie du CNAM, et avec les sociologues du CNAM, lequel constitue à cet égard un établissement fantastique, puisque nous avons la chance qu'il regroupe toutes ces spécialités. Ainsi, nos étudiants reçoivent des cours d'ergonomie, et pourront obtenir un master d'ergonomie, s'ils veulent devenir ergonomes. Ils reçoivent des cours de droit de l'environnement et de droit du travail. Toutefois, s'ils suivent nos cours, c'est parce qu'ils souhaitent acquérir des compétences en évaluation quantitative des risques et en raisonnement populationnel. Le raisonnement populationnel n'est pas plus important qu'un autre, mais il doit être couplé avec le raisonnement individuel pour répondre au mieux aux besoins des entreprises, et surtout de la population.

Je vous remercie de cette réponse, qui montre combien la fonction de directeur général de la santé est elle-même un métier à risque. Vous-même avez dû faire une évaluation des risques que vous preniez en tant que responsable des décisions à prendre. On sent combien cette période de gestion de la crise du prion vous a profondément marqué, mais vous a aussi permis d'établir une méthodologie, qui ne puisse pas être contestée, et qui donc réponde au besoin de certitude et de réconfort que vous avez évoqué au début de votre intervention.
Je vous propose de revenir au cadre officiel de cette commission d'enquête, et à votre regard sur les PNSE. Nous avons entendu les inspecteurs de la santé et de l'environnement en charge de l'évaluation du PNSE3. Leurs conclusions étaient extrêmement critiques, non seulement, quant au contenu de ce plan, mais aussi, quant à l'inefficacité de nos politiques publiques. En contrepoint de cette critique acerbe, une autre personne auditionnée a tout de même souligné, même si c'était de manière rapide, l'intérêt de disposer d'un tel outil de politique publique, qui n'existe officiellement dans aucun autre pays d'Europe. Toutefois, un outil qui ne sert à rien, non seulement est inutile, mais génère plutôt de la frustration, en n'étant pas à la hauteur des espoirs qu'il suscite. Dans le cadre de cette inspection, vous-mêmes aviez tenu des propos très sévères concernant le PNSE3, en parlant du « désert » des politiques publiques en matière de santé environnementale, et en soulignant à quel point il était préoccupant que nous en soyons encore là aujourd'hui. Je souhaiterais donc que vous reveniez sur cette évaluation critique. Comment avez-vous été amené à cette conclusion, et que pourriez-vous nous proposer ? L'objectif est en effet de trouver des pistes d'amélioration, et non de s'en tenir à votre opinion personnelle extrêmement négative concernant le bilan de ce PNSE3. L'opinion des directeurs d'administration qui ont été auditionnés dans cette commission d'enquête était d'ailleurs très atténuée à cet égard.
Pourriez-vous nous rappeler pourquoi le PNSE3 a constitué, selon vous, une catastrophe managériale, ou de gouvernance ? Faut-il incriminer une incurie, un manque de partage de données ? En quoi ce PNSE3 a-t-il failli aux objectifs annoncés, et comment faudrait-il s'y prendre pour que les bonnes volontés, qui sont extrêmement nombreuses – comme le montre le nombre des bénévoles mobilisés dans le groupe Santé-environnement (GSE) –, soient réellement mises à contribution ? Quels blocages avez-vous identifiés ? Comment pourrions-nous évoluer collectivement vers une politique beaucoup plus efficace ?
Les priorités du PNSE3, telles que je les ai listées dans ma note, étaient les suivantes : cancers liés à l'amiante, radon, perturbateurs endocriniens, obésité, risques reprotoxiques et neurotoxiques, métaux lourds, épidémie dans le contexte du changement climatique, qualité de l'air intérieur, bruit. Tous ces objectifs étaient pertinents. Outre la nécessité, que je soulignais en introduction, d'enrichir cette vision des priorités, issue d'une appréciation scientifique et technique, d'une approche par les préoccupations de la population, il faut également, pour améliorer ces politiques, penser en termes de gouvernance de l'action. Nous disposons à cet égard de bons modèles. Certaines politiques publiques nous en ont fourni. Le premier programme national nutrition santé (PNNS) date de 1999. Il se poursuit, et ses priorités ne changent pas tous les quatre ans. En effet, ces plans constituent des « paquebots », non des « hors-bord ». Il leur est donc nécessaire de s'inscrire dans une continuité. De problèmes de ce type ne se résolvent pas en « claquant des doigts », grâce à trois ou quatre ans d'action. Le PNNS dispose d'une structure de fonctionnement clairement identifiée ; d'un pilote clairement identifié (la direction générale de la santé, même si elle travaille naturellement en lien avec la direction générale de l'alimentation) ; d'un pilote scientifique ; d'actions qui ont été phasées dans le temps et à qui des budgets et des moyens spécifiques ont été attribués ; et d'objectifs quantifiés, qui avaient été annoncés dès le départ avec un système d'indicateurs de suivi. Changer les comportements alimentaires est extrêmement difficile, mais je porte un regard positif sur le PNNS : sans lui, nous ferions face à une épidémie d'obésité beaucoup plus sévère encore qu'actuellement. Pour cela, il aura fallu vingt ans d'une politique qui a été suivie, avec des méthodes précises, et qui a su faire des alliances avec les industriels. La bataille du nutriscore est en train d'être gagnée : Danone, Franprix placent des nutriscores sur tous leurs produits, parce que l'appareil scientifique et de gouvernance impliqué est très puissant et solide. Par conséquent, même les puissants, qui voient leurs intérêts dérangés par la prévention, finissent par fléchir.
De même, les plans nationaux cancer sont évalués et donnent des résultats, en prévention et surtout en soins, très favorables. Or, ils utilisent les mêmes méthodes de planification et de programmation que le PNNS, avec l'Institut du cancer dans le rôle de pilote.

Il s'agit en l'occurrence de plans monothématiques, qui sont beaucoup plus faciles à conduire.
Je suis d'accord, même si le cancer regroupe des centaines de maladies. La nutrition est également un champ très vaste, car la relation entre notre mode d'alimentation et la santé touche l'ensemble des pathologies organiques, et parfois même les pathologies mentales. Plus que monothématiques, ces plans sont surtout « monopilotes ». Un comité de pilotage « chapeau » est nécessaire, avec une présence réelle des directeurs d'administration centrale concernés, et non de leurs bureaux. L'impulsion doit venir des directeurs ou directrices. Ensuite, il faut répartir équitablement le pilotage de chaque partie des plans pour qu'un pilote soit clairement repéré pour chacune d'elles. Cela ne signifie pas que les autres acteurs ne feront rien. S'agissant des métaux lourds, par exemple, le ministère de l'environnement pourra prendre le leadership, puisque les sources d'exposition aux métaux lourds viendront principalement du sol ou des aliments. Cela ne veut pas dire que la DGS ou la DGAL n'apporteront pas une contribution, mais dans un cadre clair de pilotage. Le pilote doit alors disposer d'une enveloppe de moyens, au niveau national comme régional, et construire une stratégie en la concertant, y compris avec la population, les élus et les collectivités. Il doit être accompagné d'une expertise, lui fournissant les indicateurs à suivre pertinents, avec un système d'enquête afférent. S'agissant des métaux lourds, il faudra, par exemple, réaliser des prélèvements d'urine sur des échantillons représentatifs de la population, ou, pour le mercure, prélever des mèches de cheveux afin d'effectuer des mesures d'imprégnation. L'ANSES ou Santé publique France savent parfaitement le faire, mais il s'agit de coordonner l'ensemble de ces actions. Surtout, il faut se donner des objectifs quantifiés, non par fascination des chiffres, mais parce qu'il faut se doter d'un tableau de bord. Si les objectifs ne sont pas atteints, ce n'est pas une catastrophe. Cela ne signifie pas que l'on a mal travaillé. C'est que, peut-être, des erreurs ont été commises dans la conception du plan ; peut-être les moyens n'étaient-ils pas suffisants ; peut-être n'ont-ils pas été déployés à bon escient, etc. L'important est qu'on apprend de ses erreurs. Il n'est pas possible de faire bien du premier coup.
Enfin, il ne faut pas changer de priorité trop souvent. En réalité, le véritable problème auquel nous sommes confrontés est que nous n'avons pas de politique de sécurité sanitaire. Dans un domaine aussi important, nous ne disposons pas d'une politique générale dans laquelle l'environnement, l'alimentation et le travail seraient correctement intégrés. C'est ce qui, fondamentalement, fait défaut. Nous disposons d'institutions de sécurité sanitaire (d'agences, d'administrations, etc. ). Dans notre pays, on pense que, face un problème, il faut créer une institution, et que cela suffira à le résoudre. C'est utile, mais ce n'est pas suffisant. Nous n'avons pas de doctrine de sécurité sanitaire. Nous sommes ballottés par l'actualité, par la pression des événements. En prenant un peu de recul (ce qu'un universitaire sait faire), on s'aperçoit des différences très importantes d'allocations de ressources qui existent entre les différents secteurs de la sécurité sanitaire, précisément parce que nous n'avons pas de doctrine partagée.
Pour définir une politique de sécurité sanitaire, la question qui se pose à notre société, et dont nous devrions débattre collectivement, est la suivante : comment gouverne‑t‑on l'incertitude dans une société comme la nôtre ? L'exemple du prion auquel j'ai été confronté (mais je pourrais en prendre d'autres) m'apporte la réponse suivante : il est possible de parler d'incertitude à la population. Il n'est pas nécessaire de faire croire qu'on sait, alors qu'on ne sait pas. La France est un pays où, malgré des inégalités énormes, la population est relativement éduquée. Même si cela commence à dater, j'ai passé dix ans de ma vie dans les services de recherche médicale d'EDF, à un moment où une réelle interrogation portait sur le caractère cancérigène ou non des champs électromagnétiques, de 50 hertz, produits par l'électricité. Cette interrogation n'a pas totalement disparu, même si nous y voyons désormais beaucoup plus clair. J'ai mené des dizaines de débats publics à l'époque, non pas pour porter la parole d'EDF (qui n'avait d'ailleurs pas de conviction à ce sujet : les directeurs et présidents successifs disaient que leur conviction serait celle de la science), mais pour expliquer les programmes de recherche mis en place par EDF pour répondre à cette question. En même temps, lorsqu'on me demandait de rassurer la population, je m'y refusais. J'étais en train d'expliquer que des centaines de millions de francs de l'époque étaient investis dans un programme de recherche : il n'aurait pas été crédible de nier qu'ils répondaient à une préoccupation. J'assumais donc le fait de dire qu'on ne savait pas. Je reconnaissais qu'il était possible que l'électricité soit cancérigène : j'indiquais que nous le reconnaissions, et que nous travaillions dessus. J'ai tenu le même discours lorsque nous avons ouvert la ligne qui a permis de mettre en service la centrale de Civaux (qui est la dernière à avoir été construite en France). Même au fin fond du Poitou-Charentes, un tel discours est compris. Les gens vous remercient de ne pas essayer de les convaincre, mais de leur présenter les arguments favorables, les arguments plutôt rassurants, et les travaux que mène une entreprise comme EDF pour essayer de répondre à ces interrogations. C'est ce type de débats qui doit aboutir à l'élaboration d'une politique de sécurité sanitaire, qui soit partagée avec le pays et entre tous les ministères, et qui soit portée (au regard de l'importance du sujet) par le Premier ministre.
À mon sens, l'enjeu justifie la mise en place d'un véritable ministère du risque. Le ministère de la santé pourrait ainsi rester le ministère des soins : la tâche est suffisamment vaste. Le risque est aujourd'hui un objet de politique publique tellement dilué qu'il est rare de faire ce qu'il faut, au moment où il le faut, avec les moyens qu'il faut. En effet, nous sommes purement réactifs dans ce domaine. Nous ne sommes pas proactifs. Or, nous avons les moyens de l'être aujourd'hui. Mais il faudrait une réforme de l'organisation des pouvoirs publics et de l'État pour éviter que les plans présentés se réduisent à des effets d'annonce. De tels effets d'annonce, qui ne sont pas suivis d'effets réels, effondrent la confiance de la population. Et il est impossible de gérer du risque sans avoir la confiance de la population, car gérer du risque, c'est gérer de l'incertitude. En l'absence de confiance des parties prenantes, il est normal qu'elles demandent un surdimensionnement des moyens permettant d'assurer leur protection.
Grâce à la psychosociologie, à l'épidémiologie, à l'expologie, et au savoir-faire dont nous disposons en matière d'élaboration de politiques publiques, avec les modèles que j'ai évoqués, nous disposons aujourd'hui des moyens de faire bien mieux, sans que cela coûte plus cher. Cela coûterait même peut-être moins cher, mais se pose un vrai problème de gouvernance, de choix de priorités et de relation avec la population, les élus, les corps intermédiaires, les associations, etc. Nous avons la chance en France de disposer de tous ces interlocuteurs. Discuter avec des membres de France Nature Environnement, ou de l'Association française des hémophiles, n'est jamais une perte de temps. Ils ne se complaisent pas dans une position d'accusation, comme certains membres d'associations radicales, qui existent certes aussi, et avec lesquels il est très difficile d'avoir un dialogue construit.

Vous avez dressé un bref historique des politiques publiques en santé environnementale montrant qu'elles avaient été quasi-improvisées en situation de crise. Une trentaine de plans sectoriels « en silos » se juxtaposent au gré des thématiques qui prennent le dessus à certaines époques. Si l'existence de tels plans, pour des thématiques comme le cancer, se comprend et se justifie, il en existe aussi pour des sujets extrêmement précis, et la distribution des fonds entre ces thématiques laisse parfois perplexe. Le plan Nutrition par exemple n'a reçu que 40 millions d'euros, alors que le grand plan pour l'autisme a reçu 400 millions d'euros. Je ne remets pas en cause la pertinence de l'objectif poursuivi par ce plan ou de la somme qui lui a été consacrée. Aucune explication n'est cependant fournie des écarts considérables d'investissement entre les différents plans et leurs objectifs ne sont pas indiqués.
La structure de certains plans sectoriels a en effet permis leur efficacité. Le plan cancer constitue une très belle réussite, mais il a aussi bénéficié d'un engagement au plus haut niveau de l'État, avec une volonté politique affichée. Peut-être peut-on également établir un lien de causalité entre cette volonté et l'importance économique des enjeux de recherche afférents, notamment dans le secteur des laboratoires et des thérapeutiques. Cette juxtaposition de plans fait en tout cas que nombre d'entre eux se poursuivent hors du plan santé environnementale, comme s'ils n'en relevaient pas, alors que ce plan est supposé national. Aucun retour n'est fourni sur l'évaluation de l'efficacité et de l'opérationnalité de ces dispositifs, qui présentent des superpositions et des oublis. Il en résulte l'impression d'une myriade de démarches, sur lesquelles aucun retour, aucune prise et surtout aucune vue d'ensemble ne sont possibles.
J'entends avec intérêt votre proposition d'un ministère du risque ou de l'incertitude. J'en vois l'intérêt politique majeur, mais je saisis moins la méthodologie que vous proposeriez de suivre. La Convention citoyenne sur le climat a ouvert les yeux de nombreux décideurs, y compris au niveau de l'État, sur l'intérêt de lancer ce genre de débats. La demande est très forte, comme on l'a vu avec le mouvement social des Gilets jaunes et le Grand débat qui l'a suivi. Il s'agit bien d'une revendication de la population française. Toutefois, on ne sait pas toujours comment s'y prendre. J'ai moi-même été élue locale d'une très grande ville, et même conseillère métropolitaine d'une grande métropole, et j'ai pu voir que, chaque fois qu'on cherche à mettre en place une démarche d'ouverture, visant à associer la population, il est rare qu'on obtienne en retour une participation effective. Les gens veulent participer, mais lorsqu'on leur offre la possibilité de le faire, ils contestent le cadre prévu pour cette participation, soupçonnent des conclusions déjà écrites, et subodorent une manœuvre politique, de sorte qu'on a toujours affaire aux mêmes personnes : celles en âge d'être disponibles, notamment parce qu'elles sont à la retraite, ou les représentants des associations. Il est donc parfois frustrant de chercher à ouvrir réellement le débat avec les citoyens.
La Convention citoyenne sur le climat s'est avérée très fructueuse, mais il a fallu passer par une période de formation, parce que personne n'est omniscient et que la complexité des sujets rend compréhensible le besoin d'un regard d'expert. Surtout, il est frappant que cette Convention n'ait absolument pas abordé les questions de santé environnementale, grandes absentes de cette réflexion. Cela signifie que les experts venus « évangéliser » les participants à cette Convention n'étaient pas au courant de cette problématique, alors même qu'en pleine période de Covid -19, les questions de zoonose et de trop grande proximité entre l'univers humain et l'univers animal sont particulièrement d'actualité. Comment se fait-il que, dans de grands débats publics, on oublie de parler de la santé environnementale ? Peut-être ce concept même, et cette terminologie, ne sont-ils pas suffisamment clairs. À ma grande surprise, j'entends dire autour de moi qu'il s'agit d'une thématique émergente, alors qu'il s'agit d'une question fondamentale de survie de l'organisme humain. Lorsque j'essaye d'expliquer ces problématiques avec des mots simples, on me répond généralement qu'il s'agit en effet de bon sens.
Par ailleurs, comment peut-on ouvrir un débat public sur autant de sujets en même temps ? J'anime actuellement le groupe de travail d'un think tank sur la santé environnementale : nous avons commencé par découper la question en sous-groupes thématiques, ce qui s'est avéré un travail infini, car chaque sous-groupe pouvait à son tour être découpé en sous-thèmes. Lorsque je communique sur ces questions, j'établis moi-même en général une liste de tous les risques impliqués : les risques liés au réchauffement climatique, aux expositions à la chimie, aux pollutions, les risques émergents, etc. J'ai alors surtout l'impression de contribuer à l'inquiétude générale par une telle énumération. Quelle méthodologie préconiseriez-vous ? J'entends votre souci de diminuer le caractère anxiogène des politiques publiques. La crise de la Covid-19, notamment, fait que la perte de confiance à l'égard des politiques et des élus est particulièrement aiguë actuellement. Toutefois, je ne vois pas bien comment, concrètement, gérer ce problème.
Honnêtement et modestement, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à cette question.
Une expérience m'a beaucoup marqué. Peu après mon départ de la DGS, mon successeur Didier Houssin m'a demandé de réfléchir à un dispositif de débat sur les aspects de sécurité sanitaire des nanotechnologies. Il en a résulté une initiative qui s'est appelée le NanoForum du CNAM, dont les traces se retrouvent facilement sur Internet. Nous aurions pu aborder la question comme des universitaires chercheurs classiques : dresser une liste de thèmes et d'invités pour « porter la bonne parole », mais je commençais déjà à tirer les leçons de mon expérience des années précédentes, et à vouloir procéder autrement.
Pour ne pas émettre seul les propositions à cet égard, j'ai mis en place un comité de pilotage pluraliste, incluant la DGS, la direction générale de l'industrie, mais aussi Greenpeace, France Nature Environnement, différentes agences et des journalistes. Nous avons réalisé quelques séances de travail sur la manière de traiter cette question. Je refusais le modèle consistant à faire venir des experts pour nous dire ce qu'il faut penser, tandis que le public assisterait passivement aux séances, en croyant ou non les experts. Collectivement, nous avons ainsi construit le modèle suivant.
En premier lieu, chaque séance était préparée par un texte de problématique, qui ne prétendait pas affirmer la vérité, mais seulement indiquer les questions qui se posaient. La seule préparation d'un tel texte représente déjà énormément de travail. On ne prend pas suffisamment la peine d'élaborer les questions auxquelles on veut répondre. Lorsqu'on le fait, on s'aperçoit alors que, derrière les mêmes mots, les gens ne mettent pas les mêmes choses, et qu'une clarification est d'abord nécessaire à cet égard pour que le débat soit fructueux.
En deuxième lieu, une pluralité de points de vue était prévue à chaque séance du NanoForum : un point de vue scientifique, un point de vue industriel et éventuellement un point de vue associatif.
En troisième lieu, nous avions établi un protocole de bonne conduite. Les débats étaient ouverts, gratuits puisqu'ils avaient lieu au CNAM, mais, avant d'entrer dans la salle, les gens signaient un engagement de bonne conduite et de non-agression : on n'utilise pas l'insulte, on n'utilise pas l'invective, on s'écoute. À une occasion, en position d'animateur, j'ai dû suspendre les débats, parce que cette règle n'avait pas été respectée. J'ai rappelé que les participants avaient signé un engagement, et qu'ils étaient là pour s'écouter, non pour s'affronter ou s'insulter. La personne concernée s'est excusée, reconnaissant s'être laissée emporter. Dans ces conditions, j'ai laissé les débats reprendre. Même les industriels les plus mis en cause m'ont ensuite remercié pour le climat ainsi créé, parce qu'il changeait de la situation d'affrontement habituelle entre les « pour », les « contre », les « forts », les « faibles », etc. Ce protocole, qui devait être signé, a ainsi joué un rôle très important.
Enfin, tout ce qui était dit durant les séances du NanoForum était enregistré et retranscrit, de sorte que j'avertissais les participants qu'ils ne pourraient rien enlever aux propos qu'ils tiendraient. Ils devaient prendre la responsabilité de leurs propos. S'ils venaient à les regretter, une note pourrait être ajoutée en bas de page, mais ces propos ne seraient pas supprimés du compte rendu de la réunion. Je vous garantis que cela a un effet apaisant : les gens sont obligés de vraiment réfléchir à ce qu'ils disent. Ils savent que cela laissera une trace.
Je ne dis pas qu'il s'agit de la bonne méthode. C'est un modèle parmi d'autres.
Le NanoForum s'est arrêté à la demande des pouvoirs publics, qui le finançaient, à hauteur de quelques milliers d'euros. Nous n'avions pas besoin de grand-chose : organiser ce type d'événements relevait déjà de la mission du CNAM. Néanmoins, le gouvernement a fini par saisir la Commission nationale du débat public (CNDP), et nous a opposé qu'il ne pouvait exister deux instances de débat simultanées, ce que nous avons accepté. Nous avons alors écrit un testament du NanoForum, reprenant ce que nous y avions appris, mais surtout concernant les questions qui se posent à notre société pour gouverner le développement des nanotechnologies, dont tout le monde comprend l'importance. Ce débat est similaire à celui qui porte sur la 5G. Un pays sans nanotechnologie risque de devenir un « musée », mais au nom de cela, peut-on faire n'importe quoi en termes de sécurité sanitaire ? Non. Peut-on concilier un développement industriel et la protection de la santé ? Oui. Quel contenu donner au principe de précaution ? La France est imbattable en matière de principes : personne ne nous arrive à la cheville. Nous disposons ainsi d'un principe de précaution. Mais cela ne suffit évidemment pas. Il est d'ailleurs présent aussi dans les traités européens, et dans de très nombreuses lois, y compris à l'Organisation mondiale du commerce. L'important est de disposer d'une procédure de précaution. Le principe ne dit rien. Dans une situation d'incertitude, comment décide-t-on, en démocratie, de ce qu'on peut faire : avec l'aide de quelles mesures, de quels indicateurs d'alerte, de quelles procédures de suivi ? Des milliers d'heures de débat ont eu lieu sur la définition du principe de précaution, mais personne ne s'intéresse réellement à la procédure de précaution : comment décider sous incertitude dans une société comme la nôtre ?
La CNDP est repartie du modèle classique, avec des sachants qui parlent et un public qui écoute. Comme vous vous en rappelez peut-être, elle n'a pas pu terminer son travail, parce que les débats de la CNDP ont été sabotés par des associations radicales. Les dernières réunions de la CNDP se faisaient sous la protection des CRS. On ne peut pas concerter de cette manière.
Il est donc possible de faire évoluer le modèle. Dans le cadre du NanoForum du CNAM, j'avais contacté les associations radicales, notamment l'association Pièces et main d'œuvre, qui était très connue à l'époque, mais dont je n'ai plus entendu parler depuis longtemps. À la lecture de ses textes, il était évident que des scientifiques les avaient écrits, et qu'ils savaient de quoi ils parlaient. Je les ai invités au comité de pilotage : ils n'ont pas voulu y venir, indiquant qu'ils étaient radicalement opposés au fonctionnement de l'État en France. Pour autant, aucune des réunions du NanoForum n'a été sabotée. Je ne dis pas qu'il s'agit du modèle à suivre, mais c'en est un. Dès la conception du débat, il faut associer les parties prenantes. L'organisation même du débat ne doit pas être une production administrative ou politique. Le plus important dans un débat, dans une concertation, c'est la méthode d'élaboration des questions, et elle doit être partagée. Disposer d'un code de bonne conduite, qui a été discuté, a réellement un effet apaisant. Il est possible de dire aux participants qu'ils sont là pour s'écouter, et qu'ils peuvent réserver leurs affrontements pour les plateaux de télévision, qui ne manquent pas. Si on participe à ce débat, c'est pour apprendre de l'autre et pouvoir s'exprimer soi-même, le temps qu'il faut et de manière raisonnable, sans être jamais interrompu. Ces procédures produisent de la confiance et facilitent le débat. D'autres personnes (Michel Callon, Pierre Lascoumes, etc.) ont eu des expériences intéressantes de ce type. En réalisant un partage de ces expériences, il serait possible d'élaborer un protocole de construction d'un débat public qui produirait des situations moins stériles et stéréotypées que celles que vous évoquiez. Il faut à cette fin changer de paradigme dans la manière dont on discute avec la population.

Je vous remercie de ces pistes de réflexion. Je partage assez votre opinion selon laquelle le respect de l'interlocuteur rend possibles la confiance et le débat. Et il faut en effet rappeler à cette fin quelques règles du jeu, car, surtout en France, nous sommes habitués à ce que l'émotion prenne le dessus. Un cadre est donc nécessaire pour en rester à des comportements de respect mutuel.
Vous proposez des pistes de solutions, mais je m'interroge sur leur faisabilité au niveau régional, car vous en êtes pour l'instant resté à un niveau très national. De plus, ces pistes restent très théoriques : elles mériteraient d'être développées et étudiées.
Votre approche me semble assez révolutionnaire. Vous dénoncez en conclusion l'absence d'une politique publique de sécurité sanitaire dans notre pays. Il est grave de vous l'entendre dire, d'autant que vous avez certainement pesé vos mots. Or, la solution que vous proposez inverse le processus habituel, puisqu'elle consiste à aller débattre avec les gens. Il faut selon vous que l'ensemble des parties prenantes aient droit à la parole pour qu'elles se sentent respectées, et qu'elles soient ainsi moins belliqueuses ou polémiques. Cette solution reste toutefois extrêmement complexe à mettre en place, puisqu'elle revient à faire en sorte que le peuple s'approprie le contenu d'une politique publique de santé-environnement.
Vous venez de nous suggérer une méthodologie à cette fin, mais au sein d'un cadre déjà défini. Je vous demanderai d'approfondir votre réflexion. Qui devrait selon vous porter ces démarches ? Certaines associations environnementales ont demandé la tenue d'états généraux : cette forme vous semble-t-elle pertinente ? Faudrait-il une convention citoyenne ? Elle devrait alors se tenir aux deux niveaux de participation, nationale et régionale, ce qui m'amène à vous interroger sur la gouvernance territoriale de la santé environnementale. Lors de votre évaluation du PNSE3, vous avez beaucoup critiqué la gouvernance à l'échelle nationale, mais vous n'avez pas étendu cette critique jusqu'à la gouvernance territoriale. Professionnellement, et par votre formation, vous êtes issu du monde de la santé. Vous avez évoqué le fait que les ARS constituent les piliers ou les porteurs de certains contrôles pour lesquels elles disposent de mandats très spécifiques. Je m'interroge sur le bon niveau décisionnaire dans les territoires : s'agit-il du conseil régional, du département, etc. ? Ces niveaux de collectivités territoriales sont extrêmement politisés, ce qui risque d'induire l'instrumentalisation politique de problématiques à caractère général. Faut-il s'adresser aux DREAL, aux services préfectoraux, aux services déconcentrés de l'État ? Faut-il continuer à travailler prioritairement avec les ARS ? Il m'a été signalé que la prise en compte territoriale de ces questions dans les ARS variait énormément en fonction de la personnalité et de la mobilisation des personnes en charge. L'efficacité reconnue de certaines régions tient parfois à l'investissement des conseils régionaux, parfois à celui d'une ARS. Ailleurs, c'est une association ou un organisme privé qui ont été mandatés pour créer une organisation et une émulation. Quel est à votre avis le bon interlocuteur au niveau de la région, pour porter ce type de débat public ? À l'heure actuelle, des plans régionaux santé-environnement existent, même s'ils sont défaillants. Quels porteurs seraient les mieux positionnés pour progresser sur ces questions ?
J'ai moi aussi constaté que l'investissement des ARS dépendait des personnes. Il en est ainsi, précisément parce que nous n'avons pas de politique nationale de sécurité sanitaire : chacun est livré à son initiative, en fonction des forces disponibles et de la sensibilité du directeur général de l'ARS. Il en résulte une hétérogénéité territoriale, qui n'est pas satisfaisante du point de vue du fonctionnement des pouvoirs publics.
Soyons clairs : les batailles de la prévention se gagnent ou se perdent sur le terrain, et nulle part ailleurs. Il ne faut jamais le perdre de vue. Par conséquent, les politiques de sécurité sanitaire ont nécessairement besoin d'un échelon territorial. Je pense que le bon échelon est régional.
Au CNAM, j'ai également découvert l'importance des branches professionnelles, qui ne sont pourtant jamais associées à ces dispositifs de politique publique. Or, elles jouent un rôle très important dans le pays, au-delà même de la santé au travail. Le problème de l'échelon régional est qu'il a sa pertinence dans l'organisation des pouvoirs publics, mais qu'il n'existe pas dans les entreprises. Ce qui régule la vie des entreprises et les cadre, ce sont les branches. Un dispositif hybride doit donc être conçu. La région constitue le bon niveau territorial, mais il n'est pas possible de mener une politique de santé environnementale sans y associer les entreprises – c'est-à-dire (pour parler clairement) les pollueurs. Il ne faut pas agir contre elles, il faut agir avec elles. Or, la région n'est pas capable d'intervenir à leur niveau. C'est l'un des points de faiblesse du PNSE. J'ai moi-même mis du temps à comprendre que pour atteindre les entreprises, il faut passer par les grandes branches.
Non, elles ont des délégations régionales.

Faites-vous allusion aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) ?
Non : l'Union des industries et métiers de la métallurgie (IUMM) par exemple a des délégations régionales.
Je trouve également que nous avons trop tendance à créer des entités par problème. Nous disposons d'une conférence nationale de santé (CNS) et de conférences régionales de santé (CRS), qui sont inscrites dans la loi. Je m'appuierais dessus, sans créer un dispositif supplémentaire. Disposons-nous d'un équivalent de ces dispositifs au niveau de l'environnement ? Je n'en suis pas familier. Le ministère de l'environnement dispose du Comité national de l'air, par exemple.

En dehors des PRSE, il n'existe pas à ma connaissance de dispositif de ce type en santé environnementale.
Il y a donc là une réflexion à mener, en discussion interministérielle. Toutefois, le cadre existe déjà. Je m'appuierais sur le dispositif CNS-CRS, mais en l'enrichissant de la présence du ministère de l'environnement, pour qu'il ne se sente pas dépossédé. Un comité d'organisation réunissant les grands acteurs de la santé-environnement (associations, syndicats et patronat) pourrait ensuite être mis en place pour discuter, non pas des problèmes à résoudre, mais de la méthode de travail des CNS-CRS. Il pourrait également fournir aux CRS notamment des guides de mise en œuvre en région des actions de prévention en santé-environnement.
Pour responsabiliser l'ensemble des parties prenantes, il faut ensuite déléguer des budgets au niveau régional. Un équilibre est à trouver entre être jacobin et être girondin, ce qui n'est jamais facile en France : un cadre national doit être fixé, mais en laissant des degrés de liberté aux régions. En Nord-Pas-de-Calais et en Pays de la Loire, les priorités ne peuvent pas être les mêmes. Des priorités nationales peuvent être fixées, comme l'amélioration de la qualité de l'air. Mais même la manière dont une telle priorité sera déclinée dépendra du degré d'urbanisation de la région. Il faut donc donner des responsabilités aux régions, avec des enveloppes budgétaires dédiées.

Dans une interview récente, vous avez émis quelques critiques à l'égard du fonctionnement du ministère du budget, et plus précisément de Bercy.
Je n'ai pas critiqué le fonctionnement du ministère des finances, qui a été particulièrement remarquable dans la crise que nous traversons. Je mets en cause le fait que notre politique publique soit pilotée par les moyens, et non par les objectifs. Vous discutez actuellement du projet de loi de finances : regardez le nombre de postes qu'a perdu Santé publique France depuis trois ans. L'Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) est en conséquence devenu la variable d'ajustement au sein de Santé publique France. Or, le manque de stocks de masques, auquel nous avons été confrontés, tient au fait d'avoir ainsi « déplumé » l'EPRUS. Je suis sous serment. Dans les deux dernières années, Santé publique France a perdu 40 postes : j'ai vu cette donnée de mes propres yeux. C'est ce fonctionnement-là que je mets en cause. Bercy fonctionne remarquablement bien. Dans la crise actuelle, ce qui a été fait est extraordinaire. En revanche, le pilotage par les moyens et le fait d'exiger des établissements de rendre chaque année vingt postes ne constituent pas une manière de mener une politique publique. En effet, les missions à supprimer ne sont pas indiquées. S'il s'agit de faire la même chose avec moins, je ne vois pas comment c'est possible. La logique de réduction des dépenses publiques qui prévalait jusqu'alors ne s'accompagnait d'aucune discussion des missions attribuées au service public. Il faut commencer par les missions, et n'examiner les moyens qu'ensuite.

Je ne peux qu'approuver cette remarque, ayant passé toute ma carrière dans les hôpitaux, et ayant dû subir ce type de politiques publiques. Être évalué sur les effectifs « rendus » (comme s'ils avaient été volés) a constitué une expérience extrêmement douloureuse. On voit bien maintenant l'état critique des établissements de santé qui en résulte, et toute la difficulté qu'il y a à remettre de la vie dans des organisations qui ont été vidées de leur substance.
J'évoquais vos remarques sur Bercy en réaction à votre proposition de déléguer des budgets au niveau régional. Sur le principe, on ne peut qu'être d'accord. Compte tenu de la situation tendue de notre budget, et des nombreuses incertitudes qui pèsent sur la possibilité de retrouver à l'avenir un équilibre budgétaire, Bercy, le gouvernement ou n'importe quel autre gouvernement auront beaucoup de mal à trouver de l'argent à déléguer aux régions pour des objectifs de santé environnementale. Où donc trouver de l'argent, sinon dans les plans « en silos » déjà existants ? La tâche ne semble guère aisée, mais je ne vois pas comment trouver ailleurs de l'argent qui n'existe pas, et qui aura de plus en plus de mal à exister. Qui en conséquence verriez-vous capable de reprendre en main ou de redéfinir les missions de la santé environnementale, pour se voir confier la gestion d'un budget général, incluant un budget national et des budgets régionaux, au regard des difficultés financières actuelles, qui ne feront que s'accentuer ?
Je ne crois pas que le problème soit celui des moyens. Nous disposons de beaucoup de moyens, en tout cas financiers, mais ils sont très dispersés : les communes, les métropoles, les départements, les régions, les entreprises, les ministères, les administrations centrales en ont. Une politique de santé devrait ainsi commencer par dresser l'inventaire des moyens disponibles. Avant de dire qu'il en faut davantage, commençons par regarder ce que nous avons, dans le domaine de l'eau, de l'air, des sols, des rayonnements ionisants, des rayonnements non ionisants, du bruit, etc. Cet inventaire doit être réalisé, car les processus de décision actuels ne sont pas cadrés, ils sont souvent opportunistes, réactifs, et non proactifs.
Oui : elle saurait tout à fait mener cette action !

Cette commission d'enquête pourrait proposer de mandater la Cour des comptes pour réaliser un état des lieux.
Ce serait en effet une excellente proposition. Je ne doute pas que la Cour des comptes serait très à même de réaliser cet état des lieux, bien plus qu'une mission d'inspection commune IGAS-IGF, par exemple.

Nous avons largement dépassé le temps imparti. Souhaitez-vous dire un dernier mot en conclusion ?
Non, je me suis déjà trop exprimé. Quand votre commission doit-elle rendre son rapport ?

Elle doit officiellement le rendre le 7 janvier au plus tard, ce qui signifie que notre commission d'enquête s'arrêtera à la mi-décembre.
Peut-être puis-je alors en conclusion vous conseiller de ne pas oublier que le coronavirus constitue fondamentalement un problème de santé environnementale. Les microbes font partie de l'environnement. Or, pour parler de retour sur investissement, cette question est imbattable. Si j'en crois mes collègues économistes au CNAM, le confinement coûtera 700 milliards d'euros à la France. Le coût d'une politique de préparation à une pandémie aurait été sans commune mesure avec une telle somme. Sans doute 2 milliards d'euros, soit 2/700èmes seulement de ce coût, auraient suffi pour que nous disposions des masques, des tests, des doctrines et du gel hydro-alcoolique qui nous ont fait défaut au mois de mars, raison pour laquelle il a fallu confiner le pays. Je n'ai jamais vu un aussi bel exemple de retour sur investissement.

Je vous remercie de cette conclusion, et pour les pistes très originales que vous nous avez suggérées.
L'audition s'achève à treize heures.