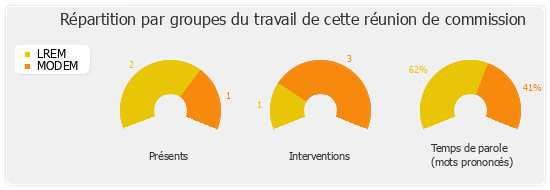Commission d'enquête sur l'évaluation des politiques publiques de santé environnementale
Réunion du jeudi 19 novembre 2020 à 15h30
La réunion
L'audition débute à quinze heures trente.

M. Jean-François Guégan est directeur de recherche de classe exceptionnelle à l'Institut de recherche pour le développement (IRD), actuellement accueilli en raison de ses travaux antérieurs à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) pour conduire une approche de recherche « Une seule santé ». Il enseigne également à l'université de Montpellier et à l'École des hautes études en santé publique. Il est expert auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ancien membre du Haut Conseil de la santé publique et préside le conseil scientifique de l'École nationale vétérinaire de Toulouse.
Quelles conséquences la conception de la santé-environnement qui prévaut en France emporte-t-elle, en particulier en ce qui concerne la prise en compte du risque infectieux biologique et les choix de conduite de la recherche ?
(M. Jean-François Guégan prête serment.)
Après trente ans de carrière dans la recherche scientifique en tant que fonctionnaire d'État et plus de cinq ans de doctorat et de post-doctorat, ce dernier réalisé en Grande-Bretagne, je vous propose une rapide synthèse de quelques avis et constats que j'ai pu faire sur la recherche actuelle dans le domaine environnement-santé et, en ce qui me concerne, dans le domaine biologique-infectieux.
J'ai effectué mes dix dernières années de recherche dans un laboratoire d'excellence. Je trouve que c'est une formidable initiative qui permet un « confinement géographique » de la recherche, ici en Guyane. Cela permet une meilleure transversalité, une meilleure multidisciplinarité. Je copilote un projet soutenu par la National science foundation, le National Institutes of Health et la fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB).
Mes disciplines sont la parasitologie, l'infectiologie non médicale – c'est-à-dire que je ne suis pas médecin – et l'écologie numérique, avec beaucoup de modélisations et de biostatistiques. Mes thèmes de travail sont la transmission infectieuse environnement-humain ou environnement-animal-humain ou animal-humain. C'est une approche aujourd'hui nommée « One Health » mais que je développe depuis plus de vingt-cinq ans.
Le cadre de ma recherche est constitué des changements globaux et des maladies infectieuses émergentes. Je travaille particulièrement sur deux sujets : changement climatique et maladies infectieuses, biodiversité et maladies infectieuses. Je suis spécialiste de la transmission infectieuse. J'ai travaillé sur le virus de la rougeole, le virus de la fièvre du Nil occidental, les grippes aviaires, la bactérie de la coqueluche, des bactéries responsables de la méningite à méningocoques et je travaille actuellement sur la bactérie responsable de l'ulcère de Buruli. Mon formalisme de recherche est constitué d'épidémiologie biostatistique avec des approches comparatives et intégratives.
La recherche française en épidémiologie est structurée selon une pensée que je qualifie de « mimétique ». Je veux dire qu'elle mime des préceptes qui reposent sur une connaissance dans le temps récent et qu'elle s'intéresse essentiellement à des évènements actuels ou du passé proche, au détriment d'une compréhension historique et écologique. En conséquence, les évènements et les explications historiques et écologiques sont expurgés. Ceci entraîne une perte de connaissances, une moindre importance accordée aux déterminants de santé situés en amont et une incapacité à comparer entre elles les crises, à la faveur d'évènements et d'explications actuelles, avec un formalisme étiologique biologique.
Les phénomènes chroniques ont toujours plus d'intérêt ou d'importance que les phénomènes aigus. Nous nous intéressons à la dernière molécule produite, nous développons la recherche pour cette molécule et nous oublions un peu l'amont, en particulier le risque chimique et biologique. Je constate que tous les programmes santé-environnement en France, y compris en ce qui concerne l'analyse des risques naturels, sismiques, chimiques, toxiques ou biologiques, écartent rapidement les risques biologiques parce que cette épidémiologie est mimétique et s'intéresse à des dangers immédiats, nouvellement apparus, comme dans une course en avant. J'appelle ceci l'hypothèse de la Reine rouge : la recherche s'intéresse au dernier questionnement, par exemple à un nouveau fongicide. Ceci prime sur les interrogations anciennes non résolues, comme dans le processus de la Reine rouge du livre de Lewis Carroll : la Reine rouge court très vite et Alice ne parvient pas à la rattraper.
Le processus de recherche est un peu similaire aujourd'hui, y compris dans le milieu infectieux avec ces fameuses maladies infectieuses émergentes. On nous parle aujourd'hui de la covid-19 et du virus qui en est responsable, mais qui travaille aujourd'hui en France sur des virus ou des bactéries dont nous parlions voici deux ou trois ans comme le virus Zika ou le virus du chikungunya ? Cette fuite en avant est très dommageable pour l'appareil de recherche.
Je vous ai transmis le rapport Biodiversité et néonicotinoïdes de la FRB. Il s'agit d'une expertise collégiale concernant les néonicotinoïdes et leurs impacts sur la biodiversité. Nous avons fait dans ce rapport des propositions de recherche et d'orientations stratégiques.
Notre première proposition est la nécessité d'une compréhension globale de la toxicité et du devenir des produits et molécules. Par exemple, nous ne savons rien ou pratiquement rien des produits de dégradation des néonicotinoïdes, de leur persistance dans les sols, dans l'eau et de leur niveau de toxicité pour l'animal, la biodiversité et l'humain.
La deuxième proposition porte sur l'importance des cohortes, des suivis de populations et d'espèces au long terme, du changement d'échelles spatiales et temporelles. La toxicologie travaille à des niveaux d'échelle très fins alors qu'il est recommandé de passer à des niveaux d'échelle supérieurs, de s'intéresser à la toxicité de ces molécules « en communauté ». Si ces molécules affectent les batraciens, les bactéries du sol, les oiseaux, mais aussi l'humain, cette conjonction d'évènements nous permet de définir que ces molécules sont nocives pour la vie sur Terre.
Notre troisième préconisation est de renforcer les approches numériques et la modélisation. Les analyses statistiques effectuées aujourd'hui en toxicologie pouvaient être puissantes et acceptables dans les années 1950-1960 mais, eu égard au développement de la statistique ces dernières années, ces recherches nécessitent maintenant de nouveaux outils.
Ce rapport préconise donc une vision globale étudiant la toxicité de ces molécules, non seulement chez l'humain, mais aussi dans l'environnement, dans les sols, dans l'eau et sur les différentes composantes de la diversité biologique.
La recherche en épidémiologie et santé publique est aussi très analytique, disjonctive, insuffisamment intégrative et transversale. La démarche consiste à décortiquer des ensembles, complexes par nature, en composantes simples pour les analyser, en imaginant que la somme des parties reproduira l'organisation d'ensemble. Ceci constitue une erreur fondamentale. Nous savons aujourd'hui que la reconstitution des plus petites briques ne nous permet pas de comprendre l'ensemble. La théorie des systèmes l'interprète et l'analyse très bien. Nous constatons ainsi que 70 % à 72 % des résultats de la recherche en biomédecine et en biologie sont non reproductibles pour différentes raisons, dont celle que je viens de donner.
Les questions de recherche sont posées dans des temps courts et spatialement réduits, au laboratoire ou dans des études de biologie cellulaire ou moléculaire. Le temps des appels d'offres scientifiques, la pensée réductionniste conduite par une étiologie biologique, l'évaluation de la recherche concourent tous à réduire la recherche à des compréhensions dans des temps courts et à des échelles spatiales fines. Les problématiques mondiales actuelles telles que la pandémie, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité ne peuvent pas toutes être étudiées au laboratoire et selon les préceptes de la pensée réductionniste.
Nous sommes donc face à un dilemme. La recherche prioritaire, celle qu'il faut faire, consiste à décortiquer les éléments en plus petites parties et à travailler au laboratoire, entre autres sur la preuve de la causalité, alors que les problèmes que nous rencontrons se développent à de larges échelles. Vous ne pouvez pas placer l'écosystème ou la Terre entière dans un laboratoire.
Il existe donc à mon avis une déconnexion entre certaines recherches, leurs méthodologies, et les questions complexes, globales, interconnectées. Il devient urgent de sortir les chercheurs de leurs laboratoires et d'une forme de conformisme.
L'approche expérimentale et le réductionnisme biologique constituent une étape de la démarche scientifique mais ne sont pas une fin. À nouvelle question, nouveau positionnement de la recherche. Face à cette crise mondiale, nous sommes conduits à repositionner cette recherche et à devoir le faire très rapidement.
Je prends comme exemple un travail effectué par des collègues de niveau international pour comprendre les déterminants de la covid-19. Certains sont connus, comme les facteurs de comorbidité : par exemple, les gens porteurs de problèmes cardiaques sont plus affectés par le virus de la covid-19 et en meurent. D'autres graphiques montrent d'autres paramètres intéressants à analyser, comme le régime politique qui a énormément d'importance pour expliquer le taux de mortalité. Ce type d'analyse qui foisonne dans le monde anglo-saxon n'est en général pas très apprécié en France. C'est ce que la médecine appelle une recherche écologique. Cette recherche écologique est pour la médecine l'état zéro de la connaissance et de la démarche scientifique alors que cette même recherche, basée certes sur des faits corrélatifs, permet de comprendre certains déterminants non mis en avant auparavant.
Je prends un exemple proche de mon domaine de recherche. Il existe des similarités entre la transmission du virus Ebola en Afrique et du virus Nipah en Malaisie. Le virus Nipah a provoqué des mortalités très importantes, avec un taux de mortalité de 70 % à 80 %, bien plus élevé que pour le virus responsable de la covid. Nous comprenons aujourd'hui l'écologie de la transmission de ce virus, associé à la présence de palmiers. Toutefois, même lorsque les systèmes infectieux présentent de nombreuses similitudes, la comparaison entre ces deux situations est interdite en France, du fait de l'hégémonie de formation, en l'occurrence la taxonomie. Le virus Ebola est un filovirus alors que le virus Nipah est un paramyxovirus et la médecine refuse toute comparaison parce que ce sont des virus de familles différentes. Pourtant, le système infectieux et les déterminants qui sont à l'œuvre pour voir l'émergence de ces virus sont identiques, même si les virus sont de natures différentes.
La recherche privilégie la recherche aval, curative, dans la réaction, très bien dotée au détriment d'une recherche en amont, anticipative, extrêmement peu dotée. Le déséquilibre est flagrant. Comme la question des déterminants de santé publique est fondamentale en santé publique, elle l'est aussi en matière de maladies infectieuses émergentes. Ce sont des circonstances anthropologiques, sociologiques, démographiques, agricoles, pas du tout bactériennes ou virales à l'origine, qui orientent et favorisent la survenue de ces émergences.
Un virologue par essence nécessite l'apparition d'un virus. Ce virus donnera un foyer épidémique, voire une pandémie, pour pouvoir être étudié, mais il est déjà trop tard, lorsque le foyer épidémique a éclos et que l'épidémie risque de se répandre. Il faut donc repenser nos dispositifs de recherche pour comprendre, en amont de l'émergence, les déterminants de cette émergence. Ils sont autres que ceux de la médecine et de la virologie dans le cas de la covid. Le système emprisonne finalement le raisonnement.
La stratégie de tout miser sur la recherche vaccinale est pour moi un pari risqué. Je ne dis pas qu'il ne faut pas produire des vaccins. Au contraire, il faut continuer à le faire, mais il ne faut pas seulement avoir la stratégie de fabriquer des vaccins. Il faut aussi d'autres types de thérapeutiques, en particulier des antiviraux. Actuellement, dans le monde, personne n'est capable d'estimer globalement le coût de la recherche et de la production des vaccins. Personne ne parle non plus des très nombreux échecs, pour quelques succès qui miment un processus aléatoire : nous faisons énormément de recherches, nous enregistrons énormément d'échecs pour quelques résultats. Ce pari est donc très risqué. Nous n'avons pas de vaccin contre le virus Ebola, contre le paludisme. Ceux développés contre la dengue ne fonctionnent pas pour différentes raisons. J'en parle dans un article dans le journal économique La Tribune qui sortira dans quelques semaines.
Les estimations des économistes, en particulier ceux de l'École d'économie de l'université d'État du Wyoming, montrent qu'une recherche d'anticipation sur les maladies infectieuses émergentes revient 100 à 700 fois moins cher qu'une recherche à visée curative.
De mon point de vue, la recherche et les institutions ne sont pas suffisamment armées pour se positionner en amont dans la surveillance et l'anticipation. J'appelle ceci le paradoxe des déséquilibres de masse, car nous avons énormément de chercheurs qui travaillent dans la réaction et très peu dans la pro-action et l'anticipation. Nous ne sommes pas préparés et il faut mener une réflexion à ce sujet, opérer des recrutements dans des recherches d'anticipation.
La plupart des grandes organisations, dont le Wellcome Trust, revoient leur stratégie, parce que les épidémies que nous connaissons depuis une trentaine d'années coûtent à la société mondiale 60 milliards de dollars chaque année. C'est aussi approximativement ce qu'ont coûté les deux épidémies à coronavirus liées aux SARS-CoV-1 et MERS-CoV.
Énormément d'institutions anglo-saxonnes très réactives ont lancé un processus de réflexion et des actions pour une compréhension et un développement de la recherche beaucoup plus en amont sur des territoires de pré-émergence. Il s'agit de connaître les conditions que l'homme organise pour voir émerger de futurs virus ou de futures bactéries. Charles Nicolle, un de nos grands infectiologues des années 1930 disait : « Un agent pathogène ne le devient pas par nécessité mais par circonstances. » Nous développons par nos activités des circonstances qui permettent ces éclosions virales et bactériennes.
En incise, j'ai montré dans le journal The Conversation, en avril 2020, qu'il existe une très nette corrélation entre le nombre de cas de covid enregistrés dans un pays et le nombre de tests pratiqués. Plus vous développez de tests, plus vous trouverez d'individus affectés par le virus de la covid. En extrapolant à la population française le nombre de tests pratiqués en avril 2020, vous auriez donc trouvé entre 1,2 et 8 ou 9 millions de personnes infectées en France le 10 avril. Je suis très choqué que cette réflexion n'ait pas eu lieu en amont, comme si l'utilisation de la technologie servait à elle seule et que les résultats suffisaient. Pourtant, il faut interpréter ces résultats et, derrière l'utilisation de la technologie, il existe toujours des hypothèses sous-jacentes.
Nous observons actuellement, notamment au niveau européen, une pluie d'appels d'offres sur les thèmes d'une vision intégrative et transversale à ces recherches alors qu'il n'existait quasiment rien pendant vingt à trente ans. Il a été très difficile de se maintenir pour certaines équipes. Une stratégie de recherche ne peut se décliner ainsi. En France, il demeure très difficile de financer un programme intégratif transversal par l'Agence nationale de la recherche (ANR). Une analyse sur huit à dix ans des programmes financés et de leur adéquation aux problématiques actuelles serait judicieuse. Je suis moi-même financé par des programmes financés par des institutions américaines comme je vous l'ai dit en introduction.
Il existe une difficulté à faire apparaître de nouvelles problématiques dans les institutions et il n'existe pas de promotion des prises de risques en matière de recherche. Cela me semble un point très important. C'est la raison pour laquelle j'apprécie de travailler dans le monde anglo-saxon car nous pouvons y avoir une prise de risques en recherche.
Les sujets sont, de plus, pas, mal ou partiellement traités et les mots-clés actuels – changement climatique, érosion de la biodiversité, maladie infectieuse émergente – sont en fait utilisés pour continuer à pratiquer la même recherche avec le même formalisme. Ces thèmes majeurs, essentiels servent souvent de prétexte ou d'alibi et il existe aujourd'hui en recherche un monde entre les mots et les choses.
Avec le changement civilisationnel, un changement des pratiques et du formalisme scientifique est recommandable. Ce changement doit interroger sur l'organisation actuelle des institutions de recherche qui sont trop conservatrices et sur le processus d'évaluation de la recherche lui-même. Le Comité national français des changements globaux (CNFCG) a rendu un avis qui préconise un changement des pratiques et des formalismes scientifiques, de la manière dont nous pratiquons la recherche, aujourd'hui basée sur un fondamentalisme réductionnel.
La cacophonie générale qu'a entraînée un positionnement très autoritaire dans la crise pandémique en France, faisant un contraste saisissant avec nos collègues allemands, a amené la suspicion sur la démarche scientifique et médicale. Je pense qu'il sera très difficile de récupérer de cet état de fait. Des messages malheureux ont été délivrés à nos jeunes chercheurs et aux lycéens qui souhaiteraient devenir chercheurs. Ils auront une mauvaise image de ce qu'est la recherche.
Nous vivons nous-mêmes, en recherche, une période très difficile, du fait de ces positionnements autoritaires de quelques personnes. Je remarque d'ailleurs une absence de positionnement du ministère de la Recherche. Il aurait été bon que quelqu'un de ce ministère se positionne sur ce problème. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics d'intervenir pour rétablir la confiance des citoyens, mais aussi des personnels médicaux et de recherche. Je peux vous dire que beaucoup de jeunes chercheurs aujourd'hui se posent la question de savoir s'ils continueront dans cette voie.
Au-delà, je pose une question toute simple, pour avoir évalué de nombreuses équipes, dont les équipes de certaines personnes qui sont beaucoup intervenues dans les médias ces derniers temps : à quoi servent les évaluations du Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ?
Je reviens sur deux sujets qui ne sont pas correctement traités. Le premier concerne le changement climatique et les maladies infectieuses à transmission vectorielle. Chacun dirait que le changement climatique a énormément d'importance pour comprendre la diffusion, la transmission et l'expansion des maladies à transmission vectorielle. Un travail de méta-analyse a été publié en avril 2019 ; il montre que 54 % des papiers produits ces vingt-cinq à trente dernières années trouvent un effet du changement climatique dans la dispersion et l'expansion des maladies infectieuses et parasitaires à transmission vectorielle mais cela signifie que le complémentaire, soit 46 % des articles, montre un effet inverse ou une absence d'effet. Qui en parle ? Pire, en ce qui concerne les 54 % de papiers qui montrent un effet du changement climatique, 97 % n'ont utilisé en entrée d'analyse que des variables biométéorologiques. Ils s'étonnent que ces variables biométéorologiques soient des variables explicatives parce qu'ils ne les confrontent pas à des variables sociologiques, politiques, écologiques ou d'autres domaines. Nous avons donc une vision très tronquée.
Le second sujet concerne le lien entre déforestation et maladies infectieuses émergentes. Nous constatons à partir des années 2007-2008 une explosion de la quantité de publications sur ces sujets, mais une grande partie de ces articles ne traitent pas le sujet. Ils ne se replacent pas dans le cas d'une forêt en cours de déforestation pour analyser un processus conduisant à l'émergence de maladies infectieuses. La plupart de ces équipes vont en forêt, à la recherche ou de virus ou de nouvelles bactéries et les décrivent. Ces micro-organismes pourraient se révéler être potentiellement pathogènes pour l'humain, mais les chercheurs ne répondent pas à la question principale posée : quel est l'effet de la déforestation sur le processus d'émergence ?
Voici comment les mots-clés actuels peuvent être utilisés par les chercheurs eux-mêmes, alors que le papier ne traite pas du sujet annoncé, soit dans le résumé, soit dans le titre de l'article.
J'anime au niveau national un séminaire suite à mon mandat au Haut conseil de la santé publique. Il s'agit d'un séminaire de l'École du Val-de-Grâce sur les maladies infectieuses émergentes. Voici quelques semaines, nous avons réalisé un atelier sur la communication. Je trouve toujours très étonnant que soient publiés dans les médias des propos tels que « Comment s'est effectuée la découverte du vaccin ? » Nous pouvons penser aujourd'hui que ces vaccins seront efficaces, mais nous ne connaissons pas leur niveau de toxicité. Nous ne savons pas s'ils seront acceptés par les populations. Nous voyons un problème de communication, non seulement médiatique, mais aussi scientifique, et un problème de parole publique sur lequel il faut sérieusement travailler.
Une de mes étudiantes a travaillé cette année, à l'OMS, sur la prochaine pandémie selon cette organisation. Le taux de transmission R0 du virus de la covid-19 est entre 2 et 3 et son taux de mortalité est inférieur à 1 %. Il existe une relation entre la transmissibilité d'un agent pathogène et son niveau de morbidité : plus il est transmissible, moins il est pathogène. Les formes les moins transmissibles peuvent être peu pathogènes ou très pathogènes. Nous nous attendons, dans le futur, à une pandémie de grippe aviaire. Le virus de la grippe aviaire a une pathogénicité et un taux de mortalité en population nettement plus élevés que la covid. Que ferons-nous avec ce type de virus, beaucoup plus mortel que la covid-19 ? Dans quel état seront nos sociétés face à un risque qui peut cette fois être considéré comme majeur ?
J'ai quelques remarques concernant plus spécifiquement le quatrième plan national santé environnement (PNSE4). Ce plan ne contient pas d'indicateur de réussite en termes de santé. Il ne contient pas d'action claire donnant des chemins de transformation prenant en compte la santé environnementale, même si One Health et le fameux triptyque santé animale, santé humaine et santé environnementale sont mentionnés. Nous héritons souvent des maladies que la santé des environnements nous apporte.
Il faut à mon avis développer des recherches dans les territoires sur les socio-écosystèmes et suivre, comprendre, analyser les trajectoires dynamiques en dotant ces recherches de moyens à long terme. Il s'agirait d'étudier comment évoluent l'ensemble des acteurs en fonction du taux d'occupation des sols, de la densité de population humaine, de la biodiversité, qui peut représenter un danger sanitaire en termes de risque infectieux, du niveau de pollution et des différents types de pollution. Puisque nous assistons actuellement à la disparition de 30 % des espèces d'oiseaux à cause des insecticides, nous pouvons penser que ces insecticides et d'autres biocides affectent aussi la population humaine de façon importante. Nous devons croiser ces sujets.
Il faut réfléchir aux notions d'état des lieux – le fait qu'un lieu soit pollué, contaminé – et d'effets concomitants et similaires sur différentes espèces, dont l'humain. Nous ne pouvons pas extraire l'humain d'une communauté animale. Si des oiseaux, des batraciens, l'eau elle-même ou les sols sont pollués, l'espèce humaine qui vit sur ces substrats en subit aussi les conséquences. Il n'existe aucune raison de séparer l'humain des autres espèces. Il faut analyser ces sujets de façon communautaire.
Je pense aussi, mais ce n'est pas mon domaine d'expertise, qu'il faut faire évoluer la juridiction sur ces sujets plutôt que de chercher à comprendre l'impact sur l'humain uniquement. Je suppose que vous avez tous vu l'émission télévisée consacrée à la situation en Bretagne avec les algues, leur dégradation, la production de sulfure d'hydrogène et la mortalité de certains animaux, dont les sangliers, et cette personne dont le cheval meurt de ces gaz tandis que l'homme lui-même tombe en état comateux. La responsabilité des gaz dans la mort du cheval est reconnue, tandis qu'elle est discutée pour le malaise de l'humain. Il s'agit de milieux pollués, contaminés, d'effets concomitants et similaires. Ces gaz affectent autant l'animal que l'humain.
Je propose donc :
– de constituer un groupe de travail « Une seule santé, One Health » qui prendra la suite du groupe de travail (GT) 1 « Biodiversité et santé » du PNSE 3 ;
– de mieux prendre en compte les interactions entre santé et biodiversité dans les actions du plan ;
– de faire du plan un document porteur de solutions fondées sur la nature, avec des indicateurs de suivi associés ;
– d'organiser le suivi des interactions avec des plans sectoriels sous l'égide du groupe de travail « Une seule santé, One Health ».
Parmi les références bibliographiques sur ces questions, j'insiste sur un rapport du Haut conseil de la santé publique intitulé Les maladies infectieuses émergentes : état de la situation et perspectives, paru en 2011 sous la direction de Mme Catherine Leport, professeur infectiologue, et moi-même. Nous avons travaillé sur la préparation de l'État au risque infectieux émergent.

Je vous remercie pour ce cours magistral et un peu « décoiffant » sur l'état de la recherche en France. Vous avez soulevé des problèmes éclairants sur le fait que nous paraissons finalement ne rien apprendre de l'expérience. Nous nous habituons tant bien que mal, nous essayons de trouver des solutions sur un mode toujours réactif mais nous ne prenons jamais vraiment le temps de réfléchir ni, surtout, comme vous l'avez bien dit, d'anticiper. J'entends avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez dit sur la déformation intellectuelle de nos chercheurs. Vous avez d'ailleurs osé dénoncer le conservatisme de la recherche qui, dans certains cas, comme actuellement pour la covid, peut être mortel. Vous avez indiqué travailler sur ces sujets depuis un certain nombre d'années et cela ne nous a pourtant pas permis de nous préparer à cette pandémie. Vous avez ajouté, en nous faisant peur, que cette pandémie n'est rien par rapport à ce que nous pourrions vivre si jamais la grippe aviaire prend le relais.
Vous disiez apprécier davantage l'ambiance de la recherche anglo-saxonne qui favorise les formations initiales pluridisciplinaires alors que, en France, nous sommes hyperspécialisés. Cela entraîne, dans le travail de recherche, des biais cognitifs par manque d'expertise pluridisciplinaire et le fait que les hypothèses sous-jacentes sont influencées par l'ambiance intellectuelle du moment. L'ambiance est toujours dans le curatif plutôt que le préventif et l'anticipation.
Le manque d'appétence des jeunes chercheurs à travailler en France ne s'explique peut-être pas uniquement par le niveau des salaires, mais aussi par cette ambiance très frustrante qui empêche la créativité et la prise de risque, par le manque de liberté de penser et d'oser penser différemment.
Les problématiques que vous avez soulevées appartiennent à l'ambiance culturelle de la recherche actuelle, mais sont dues aussi au fait que l'objet recherché est complexe, puisque vous avez parlé d'approche systémique. En santé environnementale, nous nous heurtons souvent à ce problème de savoir par où commencer. Les interactions sont tellement nombreuses, les interdépendances tellement diffuses que nous ne savons plus très bien quelle approche méthodologique suivre. Que pourriez-vous nous proposer pour être réellement opérationnel sur cette réalité infiniment complexe, sachant aussi que le temps du chercheur n'est pas le temps du politique ? Les politiques sont amenés à demander conseil aux chercheurs. Lorsqu'ils sentent un flottement sur la parole scientifique, ils sont déstabilisés et désorientés, surtout lorsqu'ils essaient de s'accrocher à quelques résultats scientifiques qui semblent probants mais ne sont pas totalement fiables. Les lobbyistes s'engouffrent dans ces brèches en contestant la parole scientifique.
Quelle approche méthodologique permettrait d'être opérationnel pour un politique coincé dans le délai d'un mandat, obligé de faire vite et d'être efficace ?
Depuis trente ans, avec l'essor fantastique de la biologie moléculaire en particulier, nous avons beaucoup favorisé la spécialisation, voire l'hyperspécialisation. Nous manquons de généralistes, de gens qui ont un bon degré de compétence dans une discipline, mais sont aussi capables de broder, de faire des liens avec d'autres disciplines. Nous le retrouvons avec la difficulté d'évaluer ces personnes qui ont un esprit plus généraliste, qui sont souvent plus inventifs et créatifs. Le premier pas est de remédier à ceci en favorisant la démarche généraliste dans les universités et les grandes écoles.
Je m'intéresse beaucoup à l'épistémologie et la philosophie des sciences. Je fais aujourd'hui une différence entre un intellectuel et un chercheur. Nous avons de nombreux chercheurs mais beaucoup moins d'intellectuels. L'histoire n'intéresse pas. Malheureusement, pour avoir enseigné l'épistémologie des sciences à Montpellier, les premiers cours supprimés dans les universités françaises sont l'histoire des sciences et la philosophie des sciences, alors que le besoin de ces enseignements est très important.
Il faut certes des spécialistes, mais il faut aussi des généralistes, des gens capables d'interpréter ce que dit un spécialiste d'une discipline et de voir les ponts, les jonctions à faire avec un autre spécialiste d'une autre discipline. Cela demande de la curiosité. Je pense que les spécialistes vivent dans un cocon confortable, parce qu'ils côtoient les leurs, mais ne vont pas, ou très peu, au contact d'autres disciplines. Personnellement, mon monde est d'aller au contact d'économistes, de spécialistes de sciences politiques, de gens qui sont différents de moi.
Par exemple, dans une spécialité comme l'immunologie, les progrès récents faits dans le monde anglo-saxon concernent l'immunologie computationnelle, c'est-à-dire l'immunologie numérique. Nous avons des difficultés avec des systèmes que nous croyions simples et qui sont finalement extrêmement complexes, comme le système immunitaire. La seule solution pour étudier ces systèmes complexes est de passer par l'immunologie numérique, c'est-à-dire en utilisant les statistiques et l'intelligence artificielle.
Il nous manque des gens capables de faire des synthèses, d'intégrer et des formations qui apprennent à le faire. En France, je pense que des gens capables de faire des synthèses sont présents dans les grandes écoles, mais l'Université s'est à mon avis beaucoup trop spécialisée. Il faut réfléchir rapidement à des formations beaucoup plus transversales, qui permettraient de reconstruire ces liens entre les disciplines. Il faut aussi travailler sur l'évaluation de la recherche et l'évaluation des chercheurs. Je ne peux pas me plaindre puisque j'ai le plus haut grade de la fonction publique pour un chercheur et j'ai toujours eu de très bonnes évaluations, mais les évaluations restent toujours très difficiles parce que les gens ne savent pas où mettre un chercheur comme moi : suis-je biostatisticien, épidémiologiste ? Je prétends être les deux.

Comment évaluez-vous le dispositif actuel de financement de la recherche en santé environnementale ? Comment l'améliorer ?
En tant que chercheur, avez-vous participé à des actions de mise en œuvre du PNSE 3 ? Avez-vous pris connaissance du projet de PNSE 4 actuellement soumis à consultation publique ? Si oui, qu'en pensez-vous ? Pourriez-vous en particulier préciser de manière assez concrète ce qu'il serait bon d'améliorer ?
À l'origine, le financement des dispositifs de recherche en santé-environnement provenait pour l'essentiel du ministère de l'Environnement. À ma connaissance, ce ministère, devenu aujourd'hui ministère de la Transition écologique, n'a plus d'appels à projets. C'était pourtant une très bonne idée : les initiatives prises dans le cadre de certains programmes de recherche étaient fabuleuses. Il faudrait recréer des appels d'offres par ce ministère mais, ces dernières années, le Gouvernement a voulu que la seule institution pouvant faire des appels d'offres soit l'ANR où toute approche globale de ces sujets, sortant d'une étiologie et d'un formalisme réductionnistes, n'est pas en odeur de sainteté, depuis quatre ou cinq ans. La plupart de mes collègues ont cessé de répondre aux appels d'offres de l'ANR, lorsqu'ils proposent des visions globales, car ils sont sanctionnés à la lumière de cette vision très conservatrice d'une étiologie réductionniste. Nous sommes plusieurs à ne plus répondre à l'ANR et à chercher l'argent ailleurs.
Si une nouvelle crise pandémique à virus a lieu, nous recruterons évidemment des virologues. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en recruter. Nous en avons déjà beaucoup, il en faudra certainement d'autres, mais nous devons aussi réfléchir aux autres disciplines qui peuvent travailler en amont.
J'ai beaucoup travaillé dans le cadre du PNSE 2 et du PNSE 3, notamment pour le plan régional 3 en Guyane. J'ai été très sollicité par mon institution ces derniers mois pour le PNSE 4. Nous avons produit un document qui préconise une approche de santé-environnement en territoires, en suivant des cohortes de population.
Par exemple, des collègues de l'Inserm ont travaillé sur les niveaux d'incidence de la maladie de Parkinson en population humaine. Cette incidence est très liée au développement agricole et, en particulier, à certaines agricultures, dont notamment la viticulture. À l'intérieur même de la viticulture, le Bordelais est plus particulièrement touché. Les biocides ont été beaucoup utilisés dans cette région ces dernières années. Il existe ainsi un fort lien entre le développement agricole et la maladie de Parkinson, mais aussi probablement d'autres maladies.
Je préconise le suivi de cohortes de population humaine, mais aussi de populations d'espèces animales. Le même phénomène doit se produire chez les oiseaux, chez les batraciens, chez les bactéries du sol. Quels sont les niveaux des différents biocides dans le sol, dans les eaux ? Que deviennent les molécules issues des biocides ? Nous n'en savons rien. Nous demandons une meilleure coordination entre les ministères de l'Agriculture, de la Santé, de l'Environnement et de la Recherche. Nous souhaitons que soit conduite une étude sur huit à dix ans qui permettrait de comprendre, dans différents types de cohortes de différentes espèces, les incidences que peuvent avoir ces toxiques, ces biocides et autres sur la biodiversité, l'humain en faisant partie. Nous obtiendrions des faisceaux de compréhension sur différents éléments, dont l'humain, mais pas uniquement, qui nous permettraient de mettre en évidence les effets sur tel ou tel type de territoire. Voir ce qu'il se passe au niveau de multiples cibles serait mieux que de travailler uniquement sur l'humain, que de plonger systématiquement dans la recherche au laboratoire ou la recherche de la causalité pour savoir si telle molécule est bien responsable, est bien toxique.

Nous devons modifier profondément nos habitudes alimentaires pour préserver notre environnement, peut-être réduire notre consommation de viande. Quelles sont les alternatives à la portée d'une majorité d'individus pour permettre cette transformation, sans que ces changements soient trop drastiques ?
Les changements ne peuvent de toute façon pas être drastiques. Il faudra des années pour assurer cette transition. Je travaille actuellement sur ces sujets à l'INRAE.
Nous ne savons pas bien, car peu de recherches ont été effectuées, si le fait de sortir des animaux d'élevage pour les remettre dans les champs présente des dangers sanitaires pour ces animaux. Ces animaux ont été mis sous cloche exactement comme nous avons été mis sous cloche, ces derniers mois, pour nous protéger d'un danger sanitaire. L'une des premières raisons de la constitution des élevages est la minimisation du risque sanitaire infectieux. Nous n'avons pas de réponse toute faite. Sans parler de l'élevage intensif, je vous explique finalement que mettre des animaux en élevage est intéressant, parce qu'il minimise le risque infectieux.
Nous savons que l'élevage mondial, notamment pour la production de viande rouge, donc essentiellement des ruminants, altère les terres, les espaces naturels, en particulier les forêts primaires atteintes de déforestation pour le développement de cet élevage. Ces vaches produisent des quantités importantes de gaz à effet de serre – 20 à 30 % – ce qui a un effet sur le changement climatique. De plus, la consommation de cette viande rouge est responsable de maladies chroniques, de cancers, de maladies cardiovasculaires ou du diabète de type 2. Manger de la viande n'apporte donc pas que des avantages, mais a aussi des conséquences dramatiques. Nous essayons à l'INRAE de calculer et de mesurer ces différents bénéfices et risques du développement de la production animale.
Nous devrons effectivement réduire notre consommation, en particulier de viande rouge. Je suis né dans les années 1960 et, à l'époque, la population mangeait en moyenne seulement deux ou trois fois par semaine de la viande rouge. Un excès de consommation a eu lieu dont nous voyons aujourd'hui les conséquences, les conséquences négatives étant bien supérieures aux effets positifs de cette consommation.
Il est important de réfléchir au développement de l'agriculture : dans quels espaces ? Comment ? Combien ? Il s'agit d'éviter des dangers sanitaires nouveaux, par exemple le risque infectieux. Des pays comme la Thaïlande, le Vietnam, le Nigeria ont toute une politique agroalimentaire de développement de production de poulets dans des zones à forte diversité biologique, donc à fort risque de nouvelles maladies infectieuses émergentes. Il faut vraiment réfléchir à ces orientations, à ces trajectoires. Nous ne pouvons pas empêcher ces pays de le faire, mais, d'ici dix ans, ces pays seront très probablement des foyers d'émergence de nouvelles infections.
Il faut développer la cartographie, la surveillance, l'incitation à de nouvelles orientations et proposer des solutions. Le problème de la viande de brousse, notamment en Afrique, ne provient pas tellement de la consommation elle-même, en ce qui concerne le risque infectieux, mais plutôt des pratiques de chasse lorsque les gens sont mordus ou griffés ou reçoivent des postillons ou des fèces lorsque les animaux sont tués. C'est probablement de cette façon que les précurseurs des virus HIV sont passés de l'animal à l'homme. Malgré tout, vous ne pouvez pas interdire à ces populations de chasser. Les populations les plus pauvres du monde pratiquent cette chasse, de manière séculaire. Il faut leur proposer les moyens de leur subsistance, en leur donnant la possibilité de développer une agriculture respectueuse de l'environnement.

Quelles actions spécifiques pourraient être conduites à destination des jeunes et des enfants pour les sensibiliser à ces problématiques ?
Nous pourrions enseigner de manière simple ce que je viens d'expliquer : ne pas afficher uniquement les bénéfices de la consommation de viande rouge, mais discuter des impacts de cette consommation sur la dégradation des écosystèmes naturels, sur la perte de diversité biologique, sur le risque infectieux, sur le développement de nouvelles maladies chroniques.
L'histoire se répète de manière géographique. Nous observons actuellement la transition épidémiologique en Afrique où les gens cumulent des dangers sanitaires infectieux et des dangers chroniques.

Vous avez beaucoup insisté sur l'approche complexe au sens d'Edgar Morin et d'autres et sur l'approche systémique. La masse de connaissances ne cesse d'évoluer. Nous parlons beaucoup aujourd'hui de perturbateurs endocriniens et, dans les équipes d'endocrinologues des hôpitaux, certains qui connaissent bien sûr la matière sont plus spécialisés l'un sur la thyroïde, l'autre sur les surrénales… Nous avons besoin de spécialistes, de gens qui connaissent vraiment un sujet.
Les généralistes connaissent un peu tout mais la masse actuelle de connaissances permet-elle de connaître un peu tout ? Ne faudrait-il pas plutôt des approches pluridisciplinaires, en mettant en relation des secteurs vétérinaires, des agronomes… ? Mettre en relation ces personnes qui, chacune dans son domaine, maîtrisent un certain nombre de connaissances ne serait-il pas mieux que d'avoir des généralistes ? Je pense que, depuis l'époque de Léonard de Vinci, la masse de connaissances est devenue telle qu'elle ne permet plus à un même individu de maîtriser les interactions possibles entre tout ce qui explique ou fait naître un phénomène pathologique.
Je suis en grande partie d'accord. Je pense tout de même qu'il existe des gens capables d'agréger, plus ou moins bien, même si la masse d'informations qui nous arrivent est très difficile à agréger par une personne. Elle peut l'être par un collège de personnes.
J'insiste toutefois sur le fait que nous avons en France beaucoup moins capitalisé sur la capacité de synthèse des chercheurs et plus sur leur raisonnement analytique, descriptif et réductionniste. Je suis d'accord avec vous que cela doit se faire dans le cadre de collèges où la multidisciplinarité puisse s'exprimer. C'est ce que nous avons développé en Guyane dans le laboratoire d'excellence Centre d'étude de la biodiversité amazonienne (Labex CEBA). Par confinement géographique, nous sommes tous en Guyane et nous devons tous collaborer ou quitter la place, si nous ne sommes pas d'accord pour collaborer avec les collègues. Ce confinement par place géographique est une très bonne solution pour obliger les chercheurs à devoir coexister et se parler. Finalement, dans la démarche scientifique actuelle, nous avons laissé la place à une forme d'isolationnisme de la démarche scientifique.

Espérons que la crise de la covid nous aidera à évoluer et à remettre les curseurs au bon niveau. Vous nous avez donné quelques motifs d'espoir, en parlant d'une forte agitation avec une pluie d'appels d'offres. Quelques recherches porteront peut-être sur des démarches beaucoup plus synthétiques.
L'audition s'achève à seize heures quarante.