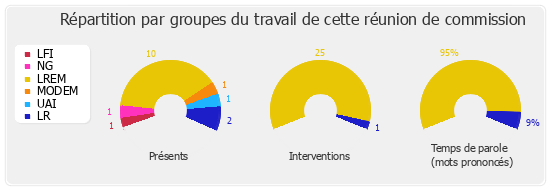Commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires
Réunion du jeudi 8 mars 2018 à 10h00
Résumé de la réunion
La réunion
La commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires a procédé à l'audition de M. Pierre-Marie Abadie, directeur de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).

Nous accueillons M. Pierre-Marie Abadie, directeur de l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), laquelle met son expertise au service de l'État pour trouver, mettre en oeuvre et garantir des solutions de gestion des déchets radioactifs français.
Créée en 1979, l'ANDRA est devenue un établissement public industriel et commercial (EPIC) par la loi du 30 décembre 1991, EPIC dont les missions ont été complétées par la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs. L'ANDRA, indépendante des producteurs de déchets, est placée sous la tutelle des ministres chargés respectivement de l'énergie, de la recherche et de l'environnement.
L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées de déposer sous serment. Je vous demande donc de jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Abadie et Torres prêtent successivement serment.)
J'entends vous présenter un panorama des enjeux actuels et de demain. Je n'ai pas prévu d'exposé complet sur le projet de centre industriel de stockage géologique (Cigéo), à propos duquel je sais que vous avez de nombreuses questions. En effet je concentrerai mon propos liminaire sur les centres industriels existants ; mais je pourrai bien sûr revenir sur ce projet si vous le souhaitez.
Je suis accompagné de Patrice Torres, directeur des centres industriels de l'ANDRA, qui dirige les opérations industrielles – c'est donc lui, d'une certaine manière, l'exploitant –, et de M. Matthieu Denis-Vienot, responsable des relations institutionnelles de l'ANDRA.
L'ANDRA est effectivement un établissement public placé sous la tutelle directe du ministère de l'écologie. Ce choix a été fait dès 1991 lorsqu'il a été décidé que la question des déchets ne relèverait plus des producteurs – à l'époque le CEA –, mais d'un organisme indépendant.
L'ANDRA recouvre trois métiers : la recherche et développement (R & D), la conduite de projet et l'exploitation de sites industriels. C'est une originalité dans le monde des agences, notamment vis-à-vis de l'étranger, que d'avoir ainsi regroupé l'ensemble des activités ; or c'est très précieux en matière de retours d'expérience, depuis la recherche jusqu'à l'application industrielle.
La R & D et la conduite de projet se trouvent au même endroit que notre siège social. Seule une partie de la R & D se trouve au centre de Meuse-Haute-Marne (CMHM), le laboratoire souterrain. Nous avons trois sites industriels : le centre de stockage de la Manche (CSM) – le centre historique, sous surveillance, je vais y revenir – et les deux centres de l'Aube (CI2A), l'un destiné aux déchets de très faible activité et l'autre aux déchets de faible et moyenne activité. Quand on évoque l'industrie et l'activité, c'est du CSM et du CI2A qu'il s'agit ; quand on évoque la R & D, le laboratoire souterrain, la conduite de projet et les activités de siège, c'est du siège situé à Châtenay-Malabry qu'il est question.
En France, les déchets radioactifs sont classés en fonction de leur activité et de leur durée de vie. Nous avons les déchets de très faible activité (TFA), au sujet desquels on pourrait presque parler de banalisation, de faible activité (FA), de moyenne activité (MA) et de haute activité (HA), ces derniers étant issus de la production électronucléaire et des combustibles. Pour ce qui est de leur durée de vie, nous avons les déchets à vie très courte (VTC), dont la périodicité est de moins de cent jours, qui sont banalisés une fois achevée la décroissance radioactive naturelle ; viennent ensuite les déchets à vie courte (VC), d'une durée inférieure à trente et un ans, traités dans nos sites de surface ; enfin les déchets à vie longue (VL), d'une durée supérieure à trente et un an.
Nous regroupons les TFA dans le centre industriel de regroupement, d'entreposage et de stockage (CIRES). Les déchets à faible ou moyenne activité et à vie courte (FMA-VC) sont également stockés dans un centre de surface : au CSM jusqu'au début des années 1990 et, depuis, au centre de stockage de l'Aube (CSA). Les déchets de haute activité (HA) et les déchets de moyenne activité et à vie longue (MA-VL) se trouvent dans les entreposages des producteurs – Électricité de France (EDF), AREVA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) – et ont vocation à aller au Cigéo. Une dernière petite catégorie regroupe les déchets de faible activité et à vie longue (FA-VL) qui ne diffèrent guère des FMA que, précisément, par leur durée de vie et qu'on ne peut donc pas laisser en surface ; c'est pourquoi le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR) nous a confié la mission de travailler sur un concept intermédiaire, proportionné, qui permette de stocker ces déchets à faible profondeur du fait de leur faible dangerosité ; il s'agit de déchets « historiques », des déchets radifères issus de l'industrie, ou des graphites issus des réacteurs uranium naturel graphite gaz (UNGG).
J'en viens à la répartition du volume des déchets radioactifs. L'ANDRA s'occupe de l'ensemble des déchets radioactifs, ceux qui proviennent de la filière électronucléaire, de la recherche – notamment du CEA –, de la défense, mais également de l'industrie non électronucléaire, qu'il s'agisse de l'industrie chimique ou de tous les petits producteurs – laboratoires, firmes médicales, missions de service public –, et des déchets comme les anciens paratonnerres, les vieux réveils trouvés dans les greniers… Il faut avoir en tête que 90 % du volume des déchets, les TFA et les FMA-VC, sont déjà pris en charge dans nos sites.
En revanche, ce sont les HA qui représentent l'essentiel de la radioactivité des déchets, et les MA-VL dans une bien moindre mesure. Tous ont vocation à être stockés dans Cigéo. Il faut en outre savoir qu'une grande partie des déchets HA – 30 % – et des déchets MA-VL – 60 % – sont déjà produits – pourcentage élevé car les déchets MA-VL représentent pour beaucoup toute l'histoire du nucléaire.
De quelles matières nucléaires parle-t-on notamment pour ce qui est de la sécurité et du contrôle ? Dès lors que nous entreposons ou stockons des déchets FMA, nous sommes soumis à un certain nombre d'autorisations, tandis que les déchets FA ou issus du traitement des déchets non électronucléaires sont seulement soumis à une déclaration de contrôle matières.
En ce qui concerne le suivi, la France prévoit trois catégories de matières. La catégorie I correspond aux quantités de matières les plus importantes et nécessitant le maximum de protection et la catégorie III aux quantités de matières les moins importantes nécessitant un niveau de protection moindre. Il faut avoir bien présent à l'esprit que les déchets que nous manipulons – c'est vrai au CSA, au CIRES et ce le sera au Cigéo – ne présentent que des traces difficilement récupérables d'activité par le fait qu'ils sont emprisonnés dans des matrices cimentaires, dans des matrices bitumées, dans des matrices de verre et l'on se trouve donc ici au plus bas sur l'échelle du contrôle des matières. Cela signifie qu'il n'y a pas d'enjeu de détournement de matières, même si les questions de malveillance, de sûreté, d'intrusion ne sont pas réglées pour autant ; mais c'est ce qui explique qu'ils soient le plus bas dans la chaîne en termes de contrôle matière stricto sensu.
Le centre de stockage de la Manche a été exploité de 1969 à 1994. Cette installation nucléaire de base (INB) est en phase de fermeture et sous surveillance. Sa sécurité est assurée par une clôture lourde, un gardiennage permanent, des vidéos, mais les déchets ne sont plus accessibles.
Le centre de stockage de l'Aube est également une INB, mise en place en 1992. Il est rempli à hauteur d'environ 30 % et est suffisant pour traiter l'ensemble des déchets FMA-VC de la filière existante. Vous êtes les bienvenus pour visiter ces installations sur site. Le CSA est composé de casemates en béton, des bâtiments d'accueil, de transit, d'une unité de compactage qui permet le conditionnement des déchets. Aucun processus n'est prévu sur ce site hormis le compactage : les déchets nous parviennent déjà conditionnés de la part des producteurs. Le CSA est un point d'importance vitale (PIV) depuis 2011 ; avant même qu'il soit classé comme tel, un plan particulier de protection (PPP) avait été défini. Nous avons également un protocole d'usage avec la police via le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (COSSEN) pour tout ce qui concerne les enquêtes sur les demandes d'accès. Ces installations sont suivies par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) qui a donné un avis positif sur l'exploitation du CSA. Ainsi, en 2017, nous n'avons eu, en tout et pour tout, que trois événements de niveau zéro sur l'échelle INES (Échelle internationale de classement des événements nucléaires — International Nuclear Event Scale), donc sans conséquences sur la sûreté. Le dispositif de sécurité du CSA est classique : clôture lourde, surveillance vidéo, détection anti-intrusion, postes de garde et de sécurité vingt-quatre heures sur vingt-quatre, contrôle d'accès sanctuarisant les points névralgiques, plan d'urgence interne (PUI).
Le Centre industriel de regroupement, d'entreposage et de stockage (CIRES), situé lui aussi dans l'Aube, qui accueille les déchets de très faible activité, est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), soit un dispositif très proche d'une installation de stockage de déchets dangereux classiques (ISDD), qu'on appelait autrefois les centres d'enfouissement technique (CET) de classe 1, à ceci près que nous y avons ajouté un toit mobile pour protéger les alvéoles des pluies. Le CIRES a été mis en service en 2003 et 54 % du volume autorisé a été atteint en 2017. Nous avons des perspectives d'extension de capacité. Cette installation accueille des déchets avec des restes d'activité et des déchets issus des zonages nucléaires mais avec des activités quasi-nulles. Le CIRES est une installation classée, surveillée par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Depuis 2012, on y entrepose des déchets collectés issus d'activités non électronucléaires, comme les paratonnerres, et pour lesquels il n'a pas encore été mis en place de filière définitive. On a ajouté en 2016 l'activité de tri et de traitement des déchets issus d'activités non électronucléaires – notamment des petites fioles provenant de la filière médicale. Ici aussi l'installation est pourvue de moyens de sécurité : clôture lourde autour du bâtiment d'entreposage – soumis à autorisation spécifique de détention de matières nucléaires – surveillance vidéo et autres dispositifs classiques.
Le centre de Meuse-Haute-Marne enfin est une ICPE sans matière radioactive – je tiens à le souligner pour couper court aux allégations selon lesquelles ce serait le début du stockage et qu'il s'y trouverait déjà des déchets… C'est tout à la fois un laboratoire souterrain, un espace technologique et une écothèque. De 150 à 170 personnels de l'ANDRA y travaillent soit la moitié du total des personnels. Cette ICPE est située dans les communes de Bure dans la Meuse et de Saudron en Haute-Marne. Le coeur du laboratoire bénéficie d'une sécurisation renforcée avec une structure lourde.
Au total, vous constatez donc que nous traitons 90 % des déchets sur plusieurs sites avec un niveau de risque faible au regard des matières que nous manipulons.

Ma première question concerne les rapports annuels relatifs à chaque installation publiés sur le site internet de l'ANDRA : les documents postérieurs à 2014 ne sont pas disponibles. Pouvez-vous nous en donner la raison ?
Nous avons vérifié et ces rapports sont bien disponibles sur internet. Nous vous en communiquerons les liens.

Je vous en remercie.
Vous avez évoqué les mesures de surveillance du centre de stockage de la Manche, aujourd'hui fermé. Quelles mesures ont-elles été prises à la suite des observations de tassement dû à l'écrasement de colis métalliques anciens, stockés lors des premières années d'exploitation et qui n'avaient pas été complètement remplis de béton ?
Ces tassements ont en effet été identifiés et sont suivis. Le CSM, on l'a dit, ne reçoit plus de déchets depuis 1994. Il a été recouvert d'une matière composée de différents éléments et en particulier d'une membrane bitumineuse qui, entre autres propriétés, a une certaine élasticité. Des plots ont été posés par des géomètres afin que nous puissions suivre l'évolution de ces tassements et procéder à des réparations pour stabiliser un éventuel glissement de talus – ce que nous avons fait il y a environ six ans.
J'ajoute que ce centre est en phase de fermeture et sous surveillance – il y a donc encore du personnel sur place – et qu'il est encore sous le contrôle de l'ASN. Nous avons remis plusieurs rapports sur la tenue et la bonne robustesse de la membrane ; un réexamen de sûreté est prévu pour 2019.

Il est question, dans le projet de stockage, de déchets de faible activité à vie longue. L'ANDRA a remis un rapport à l'ASN en 2015 présentant le résultat des explorations géologiques menées dans la communauté de communes de Soulaines-Dhuys et présentant les options techniques retenues pour la conception du stockage ; or l'ASN a estimé que ce rapport d'étape était insuffisamment détaillé et laissait plusieurs questions en suspens, notamment le choix du site. Où en est-on, des précisions ont-elles été apportées, un point d'étape sera-t-il fait en 2018, ce qui avait été annoncé par l'ANDRA ?
On parle ici déchets à faible activité, de type radifère, donc pas très dangereux, mais à vie longue. Les laisser en surface pose problème du fait, précisément de leur longévité. La demande faite à l'ANDRA depuis plusieurs années par le biais du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR) est de travailler à la définition d'un concept permettant d'intégrer cette vie longue, mais proportionné à leur faible dangerosité : descendre ces déchets à 500 mètres sous terre serait excessif – ils ne sont pas très différents des dépôts miniers, ni de ceux que nous stockons d'ores et déjà sur nos sites, à leur vie longue près.
Nous avons dès lors travaillé sur des hypothèses de stockage à faible profondeur. En 2008, un appel à candidatures a été lancé mais les communes intéressées se sont finalement retirées. Après examen du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire (HCTISN), il a été décidé d'examiner les sites déjà existants, si possible à proximité du site de Soulaines-Dhuys, afin de favoriser des synergies industrielles.
Le rapport que nous avons remis à l'ASN en 2015 a ainsi montré que la zone autour de Soulaines-Dhuys présentait des qualités, en particulier parce qu'on y retrouve de bonnes couches d'argile. Se posent néanmoins des questions comme celle de sa capacité à prendre en compte l'ensemble de cette population – plutôt fermée – de déchets ou celle des exigences à long terme liées à ces substances. On se retrouve à devoir répondre à une sorte d'injonction contradictoire : le PNGMDR fait le constat que ces déchets, pour lesquels on essaie de trouver une solution proportionnée, ne sont pas très dangereux ; il reste que si on les laisse à faible profondeur, on imagine bien qu'à l'horizon de 50 000 ans il peut se produire des intrusions, des érosions qui les remettraient en contact direct avec l'environnement. Quelle appréciation la société porte-t-elle donc sur les risques résiduels à cette échéance ? On sait qu'ils sont faibles, beaucoup plus faibles que les risques présentés par nombre de produits stockés dans à peu près toutes les installations d'entreposage de déchets industriels classiques et dont la durée de toxicité est infinie ; mais ce n'est pas l'approche habituellement retenue dans le secteur nucléaire.
Nous avons par conséquent continué nos explorations sur le site, afin d'avoir une meilleure connaissance de la géologie et, en liaison étroite avec les collectivités locales, nous avons mené une campagne en train de s'achever. Nous comptons d'autre part remettre, en 2019, un rapport portant précisément sur ces exigences de sûreté à long terme et sur la manière dont un concept, dans un environnement tel que celui de Soulaines-Dhuys, pourrait répondre à ces exigences et jusqu'à quel point. Il s'agit de nourrir un débat technique mais également, j'en suis convaincu, un débat sociétal. Nous devons en effet nous interroger, j'y insiste, sur la manière d'aborder ces risques à très long terme en fonction de ce que peut apporter dans l'immédiat un tel site.

Au cours des années 1970 et 1980, des fûts de déchets radioactifs ont été immergés dans la Manche. Quel type de déchets ? Y a-t-il un suivi de radioactivité des sites concernés ?
Ces déchets ne sont pas sous notre responsabilité. Ils figurent dans l'inventaire que nous produisons en tant qu'établissement public.
Improviser une réponse sur un sujet que je ne connais pas n'est pas mon genre, aussi vous répondrons-nous par écrit. Et si nous ne trouvons pas la réponse nous-mêmes, nous vous indiquerons où la trouver. Reste que nous avons gardé la trace de ces déchets puisqu'ils se trouvent dans l'inventaire international.

À quelle fréquence l'ANDRA effectue-t-elle des contrôles chez les producteurs de déchets pour vérifier que ces derniers sont bien conditionnés, selon les normes que vous avez prescrites et qui justifient leur agrément ? Ces contrôles sont-ils planifiés, annoncés ou bien inopinés ?
Bien évidemment, le producteur est responsable de la qualité de la production de son colis de déchets ; nous sommes, pour notre part, responsables de ce que nous accueillons sur nos sites. Ces principes ont été clairement réaffirmés par la décision sur le conditionnement des déchets prise il y a un peu plus d'un an par l'ASN et que nous avions déjà intégrée dans nos pratiques. L'ANDRA a donc le devoir de s'assurer que la chaîne de production des déchets est de qualité, ce qui suppose qu'elle s'appuie sur des outils propres et les outils des producteurs ; et quand elle s'appuie sur ces derniers, bien sûr, il convient de s'assurer qu'elle peut auditer ces chaînes de contrôle et qu'elle est associée à leur définition. L'idée est bien que nous exercions nous-mêmes des contrôles et que nous exercions un contrôle de second niveau sur la chaîne de maîtrise de la qualité des colis chez les producteurs.
Nous ne sommes pas prescripteurs pour ce qui touche à la sécurité du transport : nous prenons les colis livrés à nos portes. Nous ne sommes pas responsables du transport. Le transport des matières dangereuses et des matières radioactives fait l'objet de réglementations qui ne sont pas édictées par l'ANDRA. En revanche, nous nous entendons, pour l'aspect logistique, avec les producteurs, de façon que les livraisons correspondent bien à nos capacités industrielles à les accueillir.
J'ajoute qu'en tant qu'opérateur industriel, pour ce qui est du transport, nous avons la responsabilité de la réception ; à ce titre nous devons réaliser des contrôles. Si ces contrôles font apparaître des écarts, nous devons en informer le responsable du transport ainsi que l'Autorité de sûreté nucléaire.
Personne n'est autorisé à livrer des déchets radioactifs sur une installation de l'ANDRA sans être titulaire d'un agrément – qui s'appellera demain une approbation – en vertu duquel nous aurons vérifié que les déchets produits respectent tous les critères de sûreté du site destiné à les accueillir. L'ensemble du processus – identification et vérification de tous les paramètres – peut ainsi durer, par exemple pour le CSA, deux à trois ans. Nous procédons également à des audits et à des inspections sur le site, vérifions l'outil de production des colis de déchets ; une fois le producteur titulaire de l'agrément en question, différents types de contrôles sont réalisés, qui peuvent prendre plusieurs années. Nous réalisons en général entre quarante et cinquante inspections par an : nous visitons les sites les plus importants chaque année et les sites de moindre importance au minimum une fois tous les trois ans.
Ces contrôles physiques sur le site sont complétés par différents types de contrôles informatiques : nous disposons d'outils informatiques interfacés avec ceux des producteurs de déchets qui leur imposent de déclarer les caractéristiques de leur colis. De notre côté, nous devons vérifier que ces caractéristiques respectent l'agrément qu'ils ont reçu. Nous avons aussi la possibilité d'effectuer des prélèvements inopinés dans certains colis de déchets radioactifs. Nous ne le faisons pas au hasard : nous ciblons les colis les plus « impactants » vis-à-vis de la démonstration de sûreté, les déchets nouvellement produits ou venant d'un producteur déjà repéré pour certains écarts. Ces prélèvements se font d'autant moins au hasard qu'ils nous conduisent généralement à devoir détruire le colis contrôlé et à le remettre dans un conditionnement conforme à sa prise en charge sur le centre de stockage. Ces prélèvements nous permettent de vérifier certains paramètres.
Ces prélèvements étant inopinés, le producteur n'en est pas informé. En revanche, nous sommes obligés de prévenir les producteurs de nos visites sur site et de nos inspections : ce sont les exploitants d'INB et nous ne sommes pas des inspecteurs de l'ASN. Nous n'avons pas la possibilité d'entrer sur une INB sans être annoncés. De toute manière, d'un point de vue logistique et d'intérêt de ces contrôles, il est tout à fait préférable d'avoir préparé ces visites avec le producteur pour assister à la fabrication de certains colis. Ce qui ne serait pas possible si nous ne prévenions pas.
Nous avons complété notre panoplie d'outils par une installation de contrôle des colis, qui va bientôt être mise en service et qui a permis de ré-internaliser certains contrôles, sachant que nous nous appuyons aussi sur des installations extérieures, notamment celles du CEA.

Au cours de ces contrôles inopinés, avez-vous déjà relevé des problèmes engageant vraiment la sûreté de ces colis ?
Tout dépend ce que l'on entend par « engageant la sûreté ». Nous avons effectivement mis en évidence des écarts par rapport à nos spécifications d'acceptation ou par rapport à l'agrément qui avait été délivré aux producteurs de déchets. D'ailleurs, nous avons l'obligation de publier chaque année le bilan de la qualité des colis et de transmettre les résultats de tous nos contrôles à l'ASN.
Si nous constatons un écart, jugé suffisamment important sur une échelle de gravité pour que nous décidions de prendre le temps de tout comprendre et surtout, dans l'intervalle, de ne plus recevoir aucun colis qui pourrait présenter le même écart, nous suspendons l'agrément. Le producteur de ce déchet n'est plus autorisé à nous en livrer ; l'ASN est prévenue de cette suspension, puis des conditions de la nouvelle délivrance de l'agrément et de la reprise des livraisons de déchets.
La grande majorité de ces écarts, que nous avons décelés au travers de nos inspections ou des contrôles de colis, sont sans incidence réelle ni même potentielle. Ce n'en sont pas moins des signaux faibles qui nous permettent d'aller chercher d'éventuelles anomalies plus importantes. Il nous est ainsi arrivé de détecter la présence de sources scellées à l'intérieur de colis de déchets radioactifs, ce qui en fait des déchets interdits puisqu'ils devront être gérés dans l'installation destinée aux FA-VL, voire dans Cigéo. Nous ne sommes donc pas autorisés à les recevoir. Des producteurs en avaient mis par erreur dans leurs colis de déchets.
Il ne faut pas non plus se faire peur : il s'agissait en l'occurrence de capteurs ioniques de fumée, par exemple, puisqu'ils contiennent des sources. Malgré tout, c'est interdit. Nous considérons donc qu'il s'agit d'un écart important et nous l'avions déclaré au niveau 1 de l'échelle INES. Il nous arrive aussi de mettre en évidence d'autres types d'écarts qui n'ont pas d'impact quand ils sont limités – la présence d'un cadavre d'oiseau dans un caisson par exemple. Les matières organiques dans certains colis sont interdites mais nous savons qu'un tel incident ne se répétera pas : c'est simplement que l'oiseau est venu mourir dans le caisson et personne ne l'a remarqué au moment de la fabrication du colis. Cela ne pose pas de problème vis-à-vis de la sûreté du stockage, même si l'écart est détecté par nos contrôles sur colis prélevés.
Quand nous faisons des inspections ou des audits sur les sites, nous nous intéressons davantage aux processus, à la documentation, aux outils informatiques des producteurs de déchets. Lors de ces inspections, il a pu arriver que nous mettions en évidence une mauvaise calibration de l'outil de mesure, une mauvaise interprétation des marges d'erreur à considérer ou des anomalies de ce genre. Chaque écart fait l'objet d'un traitement, en fonction d'une échelle de proportionnalité, et donne lieu à un dialogue avec le producteur. La sanction extrême, c'est la suspension de l'autorisation de nous livrer des déchets ; l'ASN en est informée et, en général, elle procède lors de ses inspections sur le site à des recoupements en lien avec la production de déchets.
Oui, mais si je vous donne les numéros d'agrément, cela ne vous aidera pas. Je peux vous citer le cas d'une entité du CEA dont nous avons reçu des colis de déchets contenant un radioélément dont l'activité était sous-estimée et dépassait ce que l'on appelle la limite maximale d'activité pour un colis donné. Nous avons procédé à une suspension, le temps de procéder à l'analyse – qui est en cours. Ce n'est pas un fait extraordinaire que de mettre en évidence des signaux faibles ou des écarts : on peut décider en moyenne deux à trois suspensions, dont les durées peuvent être très courtes, allant de quelques jours à quelques semaines, le temps de nous assurer que le problème ne va pas se reproduire. Quelques suspensions peuvent durer plusieurs mois si les actions à entreprendre pour garantir que l'écart ne se reproduira pas sont plus longues.
Nous appliquons le même principe à notre gestion industrielle nucléaire que celui qui vaut pour le reste du secteur nucléaire : il s'agit d'identifier le plus tôt possible le signal à bas bruit, c'est-à-dire un écart par rapport à un référentiel, même s'il n'a pas d'impact significatif sur la sûreté. La suspension temporaire dure le temps de comprendre la cause de l'écart : c'est une manière de s'assurer que le système est bien sous assurance qualité. Une suspension d'agrément ne fait pas plaisir au producteur, mais elle n'est pas non plus vécue comme un drame : cela fait partie de la vie normale entre deux installations nucléaires.

Pour les colis, vous appliquez certains référentiels et le concept de stockage multi-barrières. Ce concept suffit-il à empêcher tout rejet radioactif en toutes circonstances ? Avez-vous une « marge » de rejet ?
Pour éviter toute ambiguïté, je signale que le centre de stockage de l'Aube est une INB qui dispose d'une autorisation de rejet. Comme Pierre-Marie Abadie l'a rappelé, l'un de nos process industriel – qui sont extrêmement simples – vise à compacter des fûts de déchets avec beaucoup de vide à l'intérieur, à en faire des galettes, à les mettre dans un fût plus gros que l'on va combler avec du mortier pour ne pas stocker de vide.
Quand on compacte, l'air contenu dans ces fûts est chassé au travers de filtres à très haute efficacité, mais certains radioéléments, tels que le tritium, ne seront pas bloqués dans ces filtres. Nous avons donc des autorisations de rejets – gazeux ou liquides – radioactifs, mais elles portent sur des niveaux extrêmement faibles car nous n'avons pas de process de fabrication de radioactivité – nous ne travaillons pas sur la matière elle-même.
Pour ce qui est du concept de stockage multi-barrières, nous avons pour coutume d'expliquer les choses en disant que nous ne construisons pas de coffre-fort. Nous construisons trois barrières : le colis ; l'ouvrage maçonné qui est une grosse boîte en béton dotée de tout un système de collecte ; la barrière géologique qui est naturelle en partie basse et qui est reconstituée en partie haute pour former une sorte une couverture argileuse de plusieurs mètres.
L'objectif est de retenir les radioéléments pendant la phase d'exploitation puis, par une gestion du terme source – c'est-à-dire de la quantité de radioactivité que l'on va mettre dans ce centre à l'intérieur des différentes barrières –, de garantir que lorsque des radioéléments migreront, dans quelques dizaines ou quelques centaines d'années, la quantité de radioactivité qui pourra venir au contact de l'environnement ou de l'homme sera suffisamment faible pour que cela ne pose pas de problème.
En phase d'exploitation, pour reprendre mon exemple du tritium, le rejet autorisé est un gaz que l'on ne retiendra jamais avec du béton, de l'acier ou autre. Nous limitons les quantités de tritium autorisées sur notre site pour nous assurer de ne jamais retrouver des niveaux qui poseraient problème à l'extérieur.
C'est une idée reçue de croire que nous construisons un coffre-fort qui empêcherait tout radioélément de se retrouver dans l'environnement. Nous gérons l'impact, en situation normale comme en cas d'accident. En toutes circonstances, y compris en cas d'accident, l'impact devra être acceptable à l'extérieur. Nous avons élaboré des scénarios d'incendie, de chute d'avion, de séisme ou autres ; et pour tous ces accidents, nous évaluons l'impact, et en majorant les effets. Au moment de la création d'un site mais également lors des réexamens de sûreté décennaux, ces évaluations sont présentées à l'ASN et à l'IRSN qui vérifient si l'impact est d'abord bien évalué, et ensuite acceptable ou pas.

L'ANDRA fait-elle appel à des équipes de sécurité internes ou externes, publiques ou privées ? Comment les personnels employés sur les sites sont-ils contrôlés, y compris sur le plan médical ? Font-ils l'objet d'un suivi médical particulier, notamment psychologique ? Nous avons pu constater que certaines personnes peuvent avoir une sensibilité particulière et se mettre à déraper. Faites-vous appel à des sous-traitants pour la construction et l'exploitation des sites ?
Patrice Torres va répondre à toutes ces questions en tant qu'opérateur industriel. Je voudrais seulement souligner que nous n'avons pas de forces locales de sécurité comme les sites du CEA ou d'Areva. Nous n'avons pas de gardes armés qui seraient susceptibles de faire l'objet d'un suivi psychologique ; nous avons un système de protection et nous nous appuyons sur les forces de l'ordre habituelles.

Le suivi psychologique peut aussi être adapté dans le cas de personnes qui pourraient commettre un acte de sabotage.
Selon les cas, nous nous appuyions sur des personnels internes ou externes. Les responsables de la protection physique de nos installations, ceux qui imaginent les barrières physiques, les dispositifs de sécurité, de sanctuarisation et de vidéosurveillance, et qui vont échanger avec les autorités compétentes, sont des personnels de l'ANDRA.
En revanche, le gardiennage au sens physique du terme, à savoir les hommes qui sont positionnés aux barrières vingt-quatre heures sur vingt-quatre, qui contrôlent les passeports et autres, est assuré par des sociétés sous-traitantes habilitées pour une durée généralement de cinq ans. En tant qu'établissement public, nous devons respecter des procédures d'achat particulières pour sélectionner, parmi les entreprises habilitées, celles avec lesquelles on peut travailler. Nous avons l'habitude de passer des contrats de prestation de services d'une durée de cinq ans.
Dans notre cas particulier, le contrat de sécurité physique s'accompagne d'un volet sécurité pompier, c'est-à-dire que le prestataire doit nous envoyer des personnels possédant la double compétence. Dans les métiers de la sécurité, l'entreprise doit recevoir une habilitation pour les personnels qu'elle emploie et cette autorisation s'appuie sur différents contrôles de police.
Le suivi médical de tous les intervenants, quels qu'ils soient, dépend de leur catégorie – A ou B – vis-à-vis du risque radiologique. Sont-ils ou non autorisés à travailler en milieu ionisant ? Les gardiens y sont autorisés puisqu'ils peuvent être amenés à travailler auprès des déchets. Dans ce cas, ils font l'objet d'un suivi médical renforcé par rapport au suivi médical classique, même si, depuis la parution d'un nouveau texte, les obligations sont étalées en termes de fréquence.
En revanche, il n'est prévu de suivi psychologique spécifique que pour les rares personnes habilitées au secret défense – il s'agit d'ailleurs d'un contrôle plus que d'un suivi. En revanche, tous les personnels du CSA font l'objet d'une enquête puisque l'installation est autorisée à recevoir des matières nucléaires. Tous les personnels sont passés au crible par le COSSEN avant de pouvoir entrer sur le site. Qu'ils dépendent de l'ANDRA ou d'une entreprise sous-traitante, ils subissent ce contrôle tous les ans. Si le suivi psychologique ou psychiatrique n'existe pas, les enquêtes menées par le COSSEN permettent de détecter certaines évolutions dans la vie de telle ou telle personne ; il nous est arrivé d'interdire l'accès à certains individus à la suite de ces enquêtes.
Il nous arrive effectivement de faire appel à des sous-traitants pour la construction et l'exploitation des sites : nous sommes maître d'ouvrage, la plupart du temps, et nous pouvons aussi être maître d'oeuvre pour la fabrication des ouvrages de stockage. En revanche, nous n'avons pas de compagnons ou de maçons pour fabriquer en béton ou ferrailler les ouvrages. Pour ces tâches, nous faisons appel à des entreprises spécialisées. Comme cela se pratique de manière traditionnelle dans le nucléaire, nous limitons les cascades de sous-traitants. Sur ce genre de chantiers, nous nous en restons à deux niveaux de sous-traitance au maximum.
De même que l'ASN, nous faisons évidemment preuve de vigilance à l'égard des opérateurs industriels sous-traitants. La part dévolue aux sous-traitants ne sera pas forcément la même pour Cigéo que pour nos sites où il y a peu de process. Nous travaillons sur ce sujet et nous le ferons aussi avec l'ASN.

J'imagine que le suivi des colis, depuis le producteur jusque dans les ouvrages, est informatisé. Quelles mesures avez-vous prises pour éviter les piratages informatiques ou tout accès non autorisé à ces données éminemment sensibles ?
Au sein de l'agence, nous avons un responsable de la sécurité informatique et, conformément à la réglementation, un plan de sécurité des systèmes d'information. Nous avons donc des dispositifs de filtrage aux détections des attaques. Les systèmes informatiques sont surveillés, mis à jour régulièrement. Au coeur du système, il y a les calculateurs que nous utilisons pour réaliser les modélisations dans le cadre de nos recherches, installées une salle qui bénéficie d'un niveau de sécurisation supplémentaire contre les intrusions, qu'elles soient physiques ou informatiques. En tant qu'opérateur d'importance vitale, l'ANDRA a sécurisé l'accès physique de ses serveurs.
Les seules attaques informatiques que nous ayons subies n'ont touché que nos sites extérieurs. C'était des opérations de déni d'accès qui n'ont eu que peu d'impact sur notre gestion opérationnelle et notre capacité de communication. Elles n'ont pas visé les bases de données que nous avons sur les colis ; elles ont seulement empêché les citoyens d'accéder à nos sites d'information.
On vit avec et cela ne dure que deux ou trois heures.

Sur votre site, vous indiquez que les centres de stockage sont conçus pour résister à plusieurs risques : incendie, chute d'avion, explosion, intrusion. Quelles mesures sont-elles spécifiquement mises en place pour lutter contre les risques d'attentat ou les actes de malveillance ? Quel est leur coût ? Avez-vous déjà fait l'objet de tentatives d'intrusion ou de sabotage. Avez-vous été survolé par des drones ? Pourquoi les sites de l'ANDRA ne sont-ils pas floutés sur Google Earth ?
Les centres de l'Aube n'ont jamais subi de tentatives d'intrusion. En revanche, le centre de stockage de la Manche a fait l'objet d'une intrusion à visée médiatique de la part d'une association d'opposants à nos activités. Son but était précisément de montrer qu'elle pouvait y pénétrer.
Nous ne prétendons pas que l'accès à nos sites soit impossible : certains font plusieurs centaines d'hectares. Cependant, nous voulons que les matières soient protégées et inaccessibles, et elles le sont grâce à une série de barrières. Pour détecter le plus rapidement possible toute intrusion dans nos installations, nous possédons différents dispositifs : détection de coupure de clôture, vidéosurveillance à détection automatique, contrôle d'accès. Ces investissements et le salaire des personnels chargés de leur exploitation et de leur maintenance représentent plusieurs millions d'euros.
Pour prendre l'exemple du CSA, la sécurité représente 3 ou 4 millions d'euros par an pour un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros, en lissant le coût des investissements. Il y a une équipe de sept à huit personnes pour assurer le gardiennage 24 heures sur 24, la vidéosurveillance ; à cela s'ajoute une organisation de crise qui intègre la gestion des phénomènes que vous avez décrits, sans oublier les entraînements avec les services de police ou de gendarmerie. Dans le département de l'Aube, où nous exploitons des centres, nous sommes en zone gendarmerie. Nous avons passé des conventions ; il faut les faire vivre ; il faut s'entraîner. Mises bout à bout, ces dépenses représentent quelques millions d'euros chaque année.
Nous ne sommes pas floutés sur Google Earth mais nos centres se visitent et se survolent. En fait, ce que vous voyez sur Google Earth, vous le verrez encore mieux si vous venez visiter nos centres ou si vous les survolez. Nos installations de l'Aube n'ont pas été survolées par des drones mais nous avons une suspicion de survol du centre de la Manche. Que ce soit avec un drone ou un autre engin, on ne verra jamais qu'une butte herbeuse… En revanche, nous tenons à ce que tous nos dispositifs anti-intrusion, de vidéosurveillance et de contrôle d'accès ne soient pas accessibles, que ce soit pendant les visites, depuis Google Earth ou autrement, et c'est le cas. Pour le reste, tout le monde sait où sont nos centres. Sur notre site internet, il y a aussi des photos aériennes qui montrent où ils sont et à quoi ils ressemblent, puisqu'il n'y a pas de risques associés.
Quant au survol du CSM, on ne sait pas vraiment quelle installation était visée puisque le CSM est collé à l'usine de La Hague.

Venons-en au Cigéo. On parle beaucoup des options alternatives au stockage en couches géologiques profondes. Ont-elles été étudiées pour les déchets de moyenne et haute activité à vie longue ? Certains considèrent que l'entreposage à sec en subsurface est plus sûr dans la mesure où sa réversibilité serait assurée sur une longue période. Qu'en pensez-vous ?
Vous pouvez vous reporter au document que nous vous avons remis pour situer ce que sont les déchets de moyenne et haute activité à vie longue. Les déchets de haute activité sont essentiellement ceux qui sont issus du traitement des combustibles usés. La solution de référence actuelle, ce sont les combustibles vitrifiés issus du processus de retraitement, avec la perspective de la quatrième génération pour traiter les MOX usés.
Les déchets de moyenne activité à vie longue sont plus variés puisqu'ils correspondent à toute l'histoire du nucléaire : ils proviennent de la recherche, de l'enrichissement, du retraitement, et sont emprisonnés dans différentes matrices : blocs de béton, fûts, matrices en bitume.
Votre question s'est posée dès 1991. L'histoire, qui nous a amenés là où nous en sommes actuellement, a été une succession de cycles qui se sont déroulés sur le mode études, concertations, décisions. On peut dire qu'à un moment les décisions n'ont pas été le reflet exact des concertations. Le processus s'est bien déroulé tel que je viens de le décrire mais, à un moment donné, le Parlement et le Gouvernement – et non pas l'ANDRA – ont pris et assumé leurs décisions.
En 1991, on avait démarré après un échec, un blocage : il avait fallu décider un moratoire. Le Parlement avait remis les choses dans l'ordre en plusieurs temps. Le premier temps correspondait à un cycle de quinze ans, orienté autour de la recherche, durant lequel la réflexion s'est développée dans trois directions : le stockage profond, l'entreposage de longue durée, les possibilités de séparation et transmutation.
Au cours de ce premier cycle, de 1991 à 2005, un temps a été consacré à identifier des laboratoires. Après avoir envisagé quatre sites, on en a retenu un. Le cycle d'études s'est achevé par la remise d'un rapport en 2005. Après un temps de concertation, la conclusion qui se dessinait s'orientait plutôt, il est vrai, vers un stockage en surface et une absence de décision.
Le Gouvernement et le Parlement ont pris leurs responsabilités en faisant le choix du stockage profond. La raison de ce choix est tout à la fois technique et éthique.
La séparation-transmutation pouvait certes diminuer la dangerosité et le volume des déchets, mais sans résoudre totalement le problème : il restait les MA-VL et des HA déjà produits et, qui plus est, l'opération est elle-même productrice de déchets. En fait, la séparation-transmutation améliore le sujet, mais elle ne le traite pas.
L'entreposage de long terme, c'est-à-dire à l'horizon du siècle, l'ASN l'a confirmé, ne pouvait être considéré comme une solution pérenne : par définition, étant donné la durée de vie des déchets, elle implique une ré-intervention de la société au bout d'un siècle, pour refaire d'autres entreposages de longue durée. On sait faire, mais cela n'apporte pas une sûreté passive à très long terme pour ces déchets. Voilà pour l'analyse technique.
Il en a donc été déduit qu'il fallait choisir entre la géologie et la société. Faisait-on davantage confiance à la géologie ou à la société – en supposant que celle-ci ré-intervienne régulièrement sur le sujet – pour protéger l'environnement et l'homme à très long terme de ces déchets ? C'est la géologie qui a été choisie. Cette décision se doublait d'un choix éthique implicite, qui du reste n'a pas été beaucoup mis en avant : l'entreposage de longue durée revient à laisser aux générations suivantes la tâche de trouver une solution.
La solution de l'entreposage subsurface, que vous évoquez, n'apporte rien de plus sur le principe tout en présentant les défauts de chacune des autres solutions. Compte tenu de la durée de vie des déchets, ce type d'entreposage à faible profondeur n'offre pas une sûreté passive à très long terme, protégeant de l'érosion, des intrusions, etc. Il ne présente donc pas les avantages d'une option technique qui puisse devenir passive. En revanche, il présente à peu près tous les inconvénients des travaux souterrains, que ce soit durant l'exploitation ou par la suite, en termes de durabilité du stockage et de capacité à pouvoir réintervenir.
Il ne faut pas confondre le débat sur la meilleure option à choisir pour la gestion des déchets sur le très long terme et celui, tout aussi légitime, sur la qualité et la robustesse des entreposages existants. Or, lorsqu'on aborde la question de l'entreposage subsurface, on a tendance à mélanger le problème de Cigéo et celui du choix des meilleures conditions d'entreposage, en termes notamment de résistance aux agressions violentes ou aux chutes d'avions, de déchets destinés à demeurer entreposés pendant de longues années. Or le projet Cigéo a vocation à s'étaler sur cent cinquante ans, avec des enjeux de système, qui ne sont pas ceux de l'ANDRA, et sur laquelle l'ASN est très vigilante.
Enfin, avec la loi de 2006, le gouvernement et le Parlement ont privilégié plutôt qu'une approche sociétale une approche géologique du problème, mais ce choix n'était pas sans certaines ambiguïtés.
À l'époque, le choix du stockage profond nous laissait le temps de poursuivre nos recherches scientifiques sur la séparation-transmutation des déchets ainsi que toutes les études techniques nécessaires à la conception du site ; du coup, il n'était pas nécessaire de nous presser, d'autant qu'à l'époque, le nucléaire, considéré comme une option, était parti pour durer très longtemps : il n'y avait donc aucune raison de se précipiter.
Aujourd'hui, le contexte a changé et le nucléaire n'est plus qu'une option parmi d'autres, ce qui me conforte dans l'idée qu'il est plus que jamais indispensable de continuer à explorer la solution du stockage profond, pour plusieurs raisons. Les opposants au stockage profond appellent à poursuivre la recherche de solutions alternatives. Cigéo est un projet qui n'exclut pas la recherche, puisqu'il est incrémental et progressif et que nous avançons de manière très précautionneuse. Pour autant, il faut mesurer ce que sont les échelles de temps dans le nucléaire, où la recherche ne s'écrit pas en décennies mais quasiment en demi-siècles : l'EPR a été imaginé dans les années quatre-vingt-dix et le réacteur Astrid de quatrième génération, dans les années soixante-dix. En d'autres termes, une idée qui n'est pas développée aujourd'hui n'a aucune chance d'aboutir à un résultat opérationnel dans cinquante ans. Partant, ralentir sur le projet Cigéo pour privilégier la recherche de solutions alternatives ne signifie rien d'autre que choisir l'option des réacteurs au sodium, sachant qu'ils n'apportent pas de solution totalement satisfaisante en matière de séparation-transmutation.
Ajoutons que si le nucléaire cesse d'apparaître dans les années à venir comme une solution de long terme, n'imaginons pas que nous serons prêts à investir dans un secteur de recherche – les déchets nucléaires – qui appartient au passé. Il est donc d'autant plus important de progresser aujourd'hui sur la solution de référence qu'est le stockage profond que nous en avons les capacités scientifiques et les capacités d'ingénierie et que nous avons une connaissance des déchets que n'auront pas nécessairement les générations suivantes.
Lorsqu'on voit les difficultés que nous avons eues avec la construction de Flamanville, dans la phase d'exécution et de fabrication du béton, simplement parce que nous avions cessé de construire des réacteurs pendant quinze ans, on imagine les risques que nous prendrions collectivement si nous sautions une génération, alors que nous sommes actuellement dans une dynamique portée par l'état actuel de nos connaissances, de notre R & D et de nos expérimentations.
Au niveau international enfin, rappelons que le stockage profond est globalement la solution de référence, celle notamment retenue dans la directive européenne. Tous les pays qui se sont sérieusement attaqués à la question des déchets en arrivent à la même orientation, ce qui a du reste un côté un peu frustrant, en laissant à penser qu'il n'y aurait pas d'autre solution. Au demeurant, je n'aime pas le mot « solution » : la première fois que j'ai été nommé au poste de directeur général de l'ANDRA, je l'avais utilisé, ce qui m'a valu cette réponse d'un parlementaire : « Mais ce n'est pas une solution ! » Cela m'avait surpris, mais il avait raison : je ne solutionne pas le problème des déchets et je ne prétends pas le faire puisque je ne les fais pas disparaître. Ce que nous cherchons à faire en revanche, c'est à offrir à notre génération et aux générations suivantes l'assurance d'une sûreté passive à long terme, ce qui n'exclut pas de maintenir la surveillance de ces déchets le plus longtemps possible, tout en nous prémunissant autant que faire se peut contre ce qui arrivera inéluctablement malgré tous nos efforts : le fait qu'un jour nous aurons perdu la mémoire de ces déchets.
Au plan international donc, sur la trentaine de pays qui utilisent des moyens électronucléaires, une quinzaine ont fait le choix du stockage profond et huit s'en approchent. La France, la Finlande et la Suède sont dans le trio de tête, et il est préférable d'être dans un trio que seul en tête, car il ne faut pas être tout seul à avancer sur ce sujet. Chacun fait avec ses contraintes géologiques, ses concepts et son histoire technique, industrielle et administrative : la Finlande a délivré l'autorisation de construction ; en Suède, la procédure d'autorisation est en cours ; nous en sommes-nous, en amont, au stade de préparation du processus d'autorisation formelle.

Avez-vous rencontré des difficultés pour accéder aux données des mille deux cents producteurs ou exploitants de matières et déchets radioactifs – hôpitaux, industries électronucléaires, centres de recherche, laboratoires de mesure des effluents radioactifs ou de la radioactivité dans l'environnement –, dans le cadre de l'élaboration de votre inventaire national ? Plus concrètement comment le rédigez-vous ? Impliquez-vous dans ce travail votre division R & D ? Vous basez-vous sur rapports d'activité externes ? des contrôles réguliers sur le terrain ? des rencontres avec les producteurs ou exploitants ?
Parmi nos missions de service public, figure en effet la réalisation de cet inventaire national qui est un outil précieux et régulièrement salué dans les revues internationales, au même titre que le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR).
Cet inventaire est piloté par un groupe pluripartite auquel participent notamment des producteurs, des ONG, des associations, des experts et des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire. Il est intégralement remis à jour tous les trois ans, avec des revues intermédiaires entre-temps. Globalement, nous ne rencontrons pas de difficultés pour obtenir des informations, d'abord parce que, dès lors qu'il s'agit de matières dangereuses, elles font l'objet d'un contrôle matière et d'une traçabilité. La difficulté réside en réalité davantage dans les discussions sémantiques – dont le secteur nucléaire en est assez friand – pour déterminer si les déchets doivent être classés dans telle ou telle catégorie – déchets historiques, déchets de production, matières, etc. Nous nous sommes efforcés de dépasser ces considérations pour aboutir à l'inventaire le plus exhaustif possible.
Il s'agit par ailleurs d'un inventaire à date et d'un inventaire prospectif. Nous avons en effet développé dans les dernières éditions des scénarios prospectifs, qui ont d'abord vocation à éclairer la politique de gestion des déchets et notamment nos perspectives en termes de capacité. C'est ainsi que nous savons que le Centre de stockage de l'Aube dispose des capacités suffisantes pour la totalité des déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC) mais qu'en revanche ce n'est pas le cas pour les déchets à très faible activité (TFA), ce qui doit conduire l'ensemble de la filière à travailler sur la réduction de ces déchets à la source, sur leur réutilisation ou leur recyclage, comme sur le développement de nos capacités. Ces exercices prospectifs servent également à éclairer le choix des décideurs publics entre les différents scénarios de politique énergétique et leur impact en matière de déchets.
En ce qui concerne les producteurs, nous avons les trois géants, EDF, Areva et le CEA, suivis du CERN ; viennent ensuite les petits producteurs qui ne sont concernés que pour des quantités très faibles. Avec ces tout petits producteurs, l'enjeu de nos relations tourne moins autour des questions d'inventaire qu'autour de problématiques industrielles, sachant qu'il s'agit d'aboutir au système de collecte le plus performant et le plus souple, à un prix qui couvre nos coûts tout en étant supportable pour la filière. Ce n'est nullement hors de portée depuis que nous avons redressé les comptes – en augmentant les tarifs, disons-le clairement. J'ajoute par ailleurs que, dans le secteur médical, par exemple, le coût de traitement des petits déchets reste marginal par rapport au coût d'achat du matériel d'exploitation.
Concrètement, cet inventaire se réalise sur des bases déclaratives, c'est-à-dire via une interface Web. Les déclarations des producteurs et exploitants sont ensuite compilées et contrôlées selon différentes procédures. Pour procéder à ces vérifications, nous ne nous appuyons pas sur la R & D mais sur notre connaissance des producteurs ou détenteurs. Sur les mille deux cents que vous avez cités, trois cents environ sont des producteurs ou utilisateurs réguliers de très petits volumes de déchets, que nous connaissons nécessairement puisque, dans la mesure où ils ne disposent que d'autorisations d'entreposage très limitées, nous collectons et évacuons régulièrement leurs déchets. Des recoupements ont ensuite systématiquement lieu entre les équipes spécifiquement affectées à l'inventaire et les chargés d'affaires de la direction opérationnelle, pour repérer d'éventuelles erreurs si on imagine qu'il peut avoir des erreurs d'un inventaire à l'autre, ou sur la nature des déchets concernés.

Une thèse récente pose la question de savoir si les modélisations du projet Cigéo, qui s'apparentent davantage à un agencement cohérent de savoirs et à un faisceau d'arguments nous permettent réellement de prévoir l'évolution de la situation pour les dizaines ou les centaines de milliers d'années à venir, ce qui nous place bien au-delà des cent cinquante ans que vous évoquiez tout à l'heure ; et l'on peut craindre, comme vous l'avez dit fort justement, que la mémoire du projet Cigéo ne s'efface au fil du temps. Qu'en pensez-vous ?

Existe-t-il des conventions avec les producteurs et les exploitants agricoles installés aux abords des sites de stockages actuels et futurs ? Les produits alimentaires produits dans ces zones sont-ils vendus ou détruits ?

Comment anticipez-vous les différents scénarios qui s'offrent à nous en matière de politique énergétique ? Vous parliez tout à l'heure des réacteurs de quatrième génération et de la baisse de volume de déchets qu'ils pourraient induire, au même titre que la réduction de notre production nucléaire dans le cadre de la loi de transition énergétique pour une croissance verte, voire un arrêt complet du nucléaire : comment intégrez-vous ces hypothèses dans vos projections ?
Il n'y a aucune incompatibilité entre les activités agricoles ou sylvicoles et les centres de stockage de déchets radioactifs autour desquels elles se développent. Notre centre de l'Aube est installé sur une zone de production de champagne, mais qui est également une des premières zones de productions de choucroute française, autour de Brienne-le-Château, une aire d'appellation du brie de Meaux et une région enfin de chênes à merrains dont la réputation est excellente puisqu'ils sont utilisés par différents viticulteurs bordelais pour la fabrication de leurs fûts. Les agriculteurs n'ont aucun problème ni de production ni de commercialisation, et c'est heureux, puisque nos centres ont précisément été conçus pour ne pas avoir d'impact inacceptable sur l'environnement.
Nous avons d'ailleurs l'obligation réglementaire d'évaluer l'impact de notre activité sur le territoire environnant à partir de nos rejets éventuels sur le site. Pour ce faire, nous simulons un groupe de référence qui vivrait en autarcie, à proximité du site, sur le ruisseau qui reçoit nos rejets liquides et sous les vents dominants. Or l'impact du CSA sur ce groupe se chiffre aujourd'hui à quelques nano sieverts, de 2 à 5 selon les années, c'est-à-dire un million de fois moins que la dose de radioactivité naturelle que chacun peut recevoir. Sans prétendre donc que la présence du site n'a pas de conséquence sur l'environnement, nous disons qu'en termes radiologiques son impact est extrêmement faible. Ce qui retient en fait le plus notre attentionné sont les conséquences potentielles en termes d'image dont auraient à souffrir les exploitants agricoles. Nous travaillons donc à ce qu'ils ne pâtissent pas de notre présence, et nous efforçons pour cela de nouer des relations de confiance avec eux, à titre individuel ou via les chambres d'agriculture. Nous effectuons auprès d'eux un gros travail de pédagogie, pour qu'ils soient en mesure non seulement de comprendre la situation mais de se forger leur propre opinion et de répondre aux questions qui pourraient leur être posées par leurs clients, dans le but parfois de négocier les prix. L'impact de notre activité est évalué, mesuré : il est inexistant et c'est heureux.
Dans cette démarche de réassurance, nous sommes également autorisés par convention à effectuer des prélèvements – 15 000 par an – sur les productions agricoles, lait, miel, etc., dans les exploitations alentour, qui font partie de notre chaîne de contrôle de l'environnement proche. Nous restituons évidemment ces résultats aux exploitants, que nous nous efforçons de tous réunir au moins une fois par an pour échanger sur nos problématiques communes.
Voilà plus de vingt ans que nous sommes implantés dans l'Aube et, si les inquiétudes étaient extrêmement fortes au départ, elles se sont aujourd'hui considérablement atténuées. Sans doute n'ont-elles pas entièrement disparu mais les résultats commerciaux que maintiennent les exploitants sont le meilleur argument pour montrer que nous sommes parvenus à vivre en bonne entente.
Mme Abba a fait allusion à la thèse d'histoire des sciences de Leny Patinaux, financée par l'ANDRA, qui traite de la question de la démonstration de sûreté depuis les années quatre-vingt jusqu'en 2013, en cherchant à répondre à la question des limites épistémologiques de la démonstration scientifique, compte tenu de l'horizon temporel dans lequel nous nous projetons. Comment en effet atteindre un niveau de démonstration scientifique capable d'asseoir des décisions publiques sur des horizons de temps qui donnent le vertige ? Quelle crédibilité apporter à une modélisation sur un million d'années ?
Cette thèse montre comment l'ANDRA et l'ensemble des acteurs scientifiques et des autorités de contrôle sont passés d'une démarche, au début des années quatre-vingt, où la question de la sûreté des déchets nucléaires était abordée à travers une approche et des démonstrations scientifiques pures et dures, qui ont vite buté sur les limites méthodologiques que je viens d'évoquer, à une démarche fondée, pour reprendre les termes de Leny Patinaux, sur une « démonstration robuste et convaincante ». Comment, en d'autres termes, on est passé d'une méthodologie reposant sur des modèles de calculs à une méthodologie axée sur les faisceaux d'arguments, la compréhension phénoménologique, la comparaison et l'analogie, la mise à l'épreuve, le débat contradictoire, l'évaluation extérieure, sans oublier une part de bon sens. C'est à partir de ce faisceau d'arguments qu'on fondera la démonstration en robustesse. Il ne s'agit pas de convaincre en faisant de la rhétorique en en hypnotisant les gens ; c'est à partir de ce faisceau d'arguments et en monopolisant toutes les ressources que je viens de citer, que les experts se forgeront leur intime conviction leur permettant d'aboutir à une conclusion solide.
Cette analyse épistémologique de Leny Patinaux vient rejoindre un ensemble de travaux que nous avions conduits et qui avaient mené à la tenue, en 2016, d'un colloque international organisé par l'ANDRA, le CNRS et l'INRIA, autour de la démonstration scientifique, de l'administration de la preuve et de la décision publique dans un contexte d'incertitude.
Ce que j'ai retenu de ce colloque, c'est en premier lieu que nous ne sommes pas les seuls à être confrontés à cette difficulté, liée pour ce qui nous concerne à la question du temps long. Des problématiques identiques se retrouvent dans le domaine de la sécurité sanitaire ou de la sécurité alimentaire, voire en matière de dissuasion nucléaire, où l'on atteint l'extrémité de la physique sans pouvoir se confronter in fine à l'expérience, puisque les essais nucléaires sont désormais interdits. Et nous ne le pouvons pas davantage, puisque cela dépasse notre horizon de temps.
Mon second constat a été que non seulement nous n'étions pas les seuls confrontés à ce type de problématique, mais que nous n'étions pas non plus les plus à plaindre dans la mesure où on nous avait laissé vingt-cinq ans : dans le domaine de la sécurité sanitaire ou alimentaire, on vous laisse plutôt vingt-cinq semaines, rarement vingt-cinq mois…
Enfin, la troisième leçon à retenir, c'est que, pour sortir de l'impasse, il est indispensable de hiérarchiser les incertitudes, d'éprouver les différentes approches, de croiser les modèles, à l'instar de ce que fait le GIEC sur le climat lorsqu'il confronte différents modèles.
Leny Patinaux montre ainsi dans sa thèse comment s'est progressivement développée, autour de la question de l'enfouissement des déchets nucléaires, une culture de la mise à l'épreuve permanente, appuyée sur la hiérarchisation des incertitudes, et dans laquelle chaque décision de retenir ou d'abandonner une hypothèse est publiquement motivée – ce qui devrait faire taire ceux qui imaginent un agenda caché.
Un très bon exemple de ce processus est fourni par la fameuse question des déchets bitumés. À notre sens, le bitume devait se comporter correctement, ce qui nous avait conduits, durant l'instruction du dossier d'options de sûreté (DOS), à exclure le scénario d'une reprise de réactions exothermiques et d'emballement. C'était le sens des conclusions que nous avions rendues et soumises à l'ASN et à l'IRSN, mais ceux-ci ont estimé, au vu des éléments fournis, qu'au stade où nous en étions, nous ne pouvions exclure le scénario de l'emballement. Nous avons donc revu nos conclusions opérationnelles.
Une des vertus de la thèse de Leny Patinaux, notamment parce qu'elle a été médiatisée, est d'avoir permis de clarifier des enjeux auxquels se confrontent de longue date les instances d'évaluation et de contrôle sur la question des déchets, et de faire comprendre comment nous tentons d'aborder les incertitudes de manière raisonnable et raisonnée, dans le but de nourrir la décision publique.
La question de M. Cellier sur les conséquences qu'emporteront les choix de politique publique sur le volume de déchets est importante, car elle nourrit l'argumentaire de ceux qui préconisent d'attendre que des choix énergétiques soient définitivement arrêtés pour poursuivre le programme Cigéo.
Le déploiement de Cigéo sera extrêmement progressif. La première phase de construction, c'est-à-dire la phase industrielle pilote, qui comporte la descenderie, un début de quartier de stockage pour les déchets MA-VL et un simple quartier pilote pour les déchets HA, lequel ne comptera à l'horizon 2030 que treize alvéoles sur le millier que doit comporter le projet final. On considère que, vers 2050, on aura rempli la moitié du quartier MA-VL, sans rien faire de plus sur le quartier HA. En 2080, la descente des déchets MA-VL sera à peu près achevée, et la construction des quartiers HA1 et HA2 débutera, pour se terminer à l'horizon 2140-2150.
Cette construction extrêmement progressive laisse donc une grande place à la réversibilité et à l'adaptabilité. Elle nous permet d'intégrer au fur et à mesure dans le projet, non seulement le retour d'expérience du processus de construction, mais également l'innovation technologique et l'évolution des politiques énergétiques, sous réserve – et j'y insiste – que nous apportions la preuve dès le début, c'est-à-dire lors du dépôt de la demande d'autorisation de construction (DAC), par des études d'adaptabilité, que nous sommes capables de nous adapter.
Dans le périmètre de ce que l'on appelle les études d'adaptabilité, demandées par l'ASN et faisant partie du dossier, nous étudions toutes sortes de scénarios, notamment ceux où il n'y aurait plus de quatrième génération, plus de retraitement, où les réacteurs dureraient cinquante ou soixante ans. Nous nous efforçons ainsi d'envisager tous les possibles, de nous assurer que les choix que nous avons faits n'ont pas créé d'impossibilités scientifiques, et que nous sommes capables de nous adapter à toutes les situations.
Aujourd'hui, la conception de base repose sur la solution du retraitement et d'une reprise des MOX dans le cadre d'une filière de quatrième génération. Mais s'il n'y a plus de quatrième génération, nous savons, depuis 2005 et le dossier de faisabilité du stockage géologique en formation argileuse, comment descendre les MOX le moment venu ; nous savons même comment descendre des combustibles usés, ce qui pourrait se révéler nécessaire dans l'hypothèse où il n'y aurait plus de retraitement. Ce point est essentiel pour montrer que nous ne préemptons pas les décisions futures, que nous n'enfermons pas les générations de demain dans les choix actuels. Il s'agit par ailleurs d'une position de bon sens car, étant donné les échelles de temps du projet, il est clair qu'il peut se passer dans le futur toutes sortes de choses en matière d'évolution des politiques énergétiques.
Enfin, la stratégie de démantèlement a très peu d'impact sur Cigéo. En effet, le démantèlement produit essentiellement des déchets de très faible activité (TFA), voire de très très faible activité (TTFA), ainsi que quelques déchets de faible et moyenne activité (FMA), mais extrêmement peu de déchets ayant vocation à être dirigés vers Cigéo : l'enjeu du démantèlement ne concernerait donc que les capacités du CIRES, notre installation de l'Aube ayant vocation à recevoir des déchets de très faible activité.
Le seuil de libération n'a aucun impact sur Cigéo. En revanche, il comporte un enjeu consistant à savoir quelles sont les bonnes filières pour les déchets de très faible activité et de très, très faible activité, notamment vis-à-vis du site du CIRES. Il faut sortir des débats doctrinaires sur le mode : « pour ou contre le seuil de libération ». L'histoire de cette notion en France remonte aux années 1990 : je suis bien placé pour le savoir puisqu'à l'époque, j'étais responsable des installations classées en Lorraine…
La notion de seuil de libération concerne les déchets d'une activité extrêmement faible, mais qui sont aujourd'hui catalogués comme déchets radioactifs parce qu'ils proviennent d'un périmètre considéré comme une zone nucléaire. Pour ces déchets, la question est de savoir s'il faut définir un seuil en deçà duquel ils sont banalisés. Contrairement à la plupart des pays, la France n'a pas retenu de seuil, et a mis en place une filière dans laquelle tout déchet qui vient de la zone nucléaire doit être dirigé vers une installation dédiée – en l'occurrence le CIRES. Cette orientation a été prise au début des années 1990, à une époque où des portiques de détection étaient placés à l'entrée des centres d'enfouissement technique (CET) de classe 1 et 2, afin de s'assurer que les déchets arrivant dans ces centres ne provenaient pas du secteur électronucléaire. Ce système, où tous les déchets provenant du nucléaire sont dirigés vers des installations dédiées, est bien géré et a toujours très bien fonctionné en période d'exploitation.
Le passage à la phase de démantèlement n'est pas sans poser de nouvelles questions, car on peut alors se retrouver avec des quantités énormes de déchets qui se retrouveraient à devoir traverser toute la France pour rejoindre un site dédié, à savoir le CIRES, pour l'unique raison qu'ils proviennent d'un périmètre nucléaire et alors même que leur contamination est inexistante. Si je dis que le débat sur le seuil de libération est devenu un peu doctrinaire, c'est que si l'absence de seuil répondait au souci de s'assurer de la parfaite traçabilité des déchets, le statu quo ne paraît plus raisonnable, ne serait-ce qu'en termes de bilan environnemental global. En effet, si ces déchets sont complètement inoffensifs sur le plan radiologique, leur faire traverser la France pour mettre une montagne de gravats ou de ferraille dans nos sites n'est pas une bonne chose sur le plan environnemental – cela pourrait même se révéler dangereux, car l'accumulation de grandes quantités de cuivre ou d'autres métaux peut un jour donner l'idée à certains d'aller se servir.
Un débat s'est donc ouvert, avec la perspective d'une sortie par le haut qui tournerait autour de la triple notion de filières, de contrôles et de traçabilité.
Parler de filières, c'est se demander ce qu'on pourrait faire de ces déchets : il est difficile de trouver des débouchés moins coûteux que l'acheminement vers des sites dédiés. Si la même approche avait été retenue pour les déchets ménagers, le recyclage n'existerait même pas…
Les contrôles ont quant à eux pour but de s'assurer de l'absence de radioactivité résiduelle, ce qui pose des questions techniques, notamment de métrologie, mais aussi des questions d'organisation.
Se pose enfin la question de la traçabilité sur les débouchés : si l'on veut tracer ces produits jusqu'au bout, y compris une ferraille non radioactive qui a servi à fabriquer un tuyau de fonte qui devient une conduite d'égout, cela nous ramène à la case départ et on ne s'en sort pas. Mais il faut pouvoir apporter la garantie que jamais un déchet contenant une trace de radioactivité, fût-elle infime, ne pourra être utilisé pour fabriquer un objet de la vie quotidienne. Trouver le moyen de sortir par le haut de ce débat sur la traçabilité constitue un enjeu collectif environnemental ; mais le but n'est pas de jouer les Shadocks et de multiplier les capacités de stockage.

Je reviens sur la potentielle future installation de contrôle de colis du centre de stockage de l'Aube. Sauf erreur, l'IRSN a tout récemment émis un avis disant qu'il n'identifiait pas d'obstacles à la mise en service de cette installation, sous réserve de précisions à apporter au sujet du dispositif de détection de séismes. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les précisions demandées ?
Par ailleurs, si j'ai bien compris, l'installation va vous donner la possibilité de faire des analyses plus poussées. Pouvez-vous nous dire en quoi vont consister ces analyses ?
Un gain de réactivité devrait résulter du fait que vous allez éviter des allers-retours avec les laboratoires partenaires qui procédaient jusqu'alors aux analyses. Pouvez-vous nous préciser combien de temps vous allez gagner ?
Enfin, quel est le calendrier de mise en service de l'installation, étant précisé que vous devez attendre aussi l'avis de l'ASN ?

Messieurs, je commencerai par vous remercier pour les informations que vous nous transmettez. La communication est un élément très important, notamment vis-à-vis de nos agriculteurs. À force de se montrer soupçonneux, on ne vient à devenir paranoïaques : pour ma part, j'ai confiance dans les documents et les informations que vous nous communiquez.
Comme chacun le sait, les essais nucléaires français se sont arrêtés au milieu des années 1990. Sans vouloir refaire tout le débat sur ces essais, j'aimerais savoir quelles informations vous en tiriez à l'époque, et quels liens vous aviez avec le ministère de la défense et ses satellites. Si je me réjouis de la fin de ces essais, j'aimerais cependant savoir si vous êtes pénalisés par le fait de ne plus recevoir les informations qu'ils vous permettaient autrefois de recueillir.

Au sujet de la visibilité qu'on peut avoir sur l'évolution du stockage de déchets radioactifs, vous avez répondu tout à l'heure en évoquant la « gestion de l'incertitude », ce qui me paraît constituer un bel oxymore. J'aimerais vous entendre sur la mémoire et la transmission des informations relatives aux déchets dans les milliers d'années à venir.

Vous avez expliqué tout à l'heure que le tritium était l'une des matières qui s'échappaient des fûts. On sait que si le tritium à l'air libre n'est pas dangereux, ce n'est pas le cas de l'eau contaminée au tritium. Avez-vous réfléchi, avec les agriculteurs qui entourent vos installations, aux scénarios basés sur une pollution à l'eau tritiée ?
Si tous les colis que les producteurs nous expédient font l'objet d'un contrôle portant sur la contamination surfacique et le débit de dose, nous en prélevons certains auxquels nous faisons subir un contrôle poussé – on parle parfois de « super-contrôle ». Ce contrôle se fait en pratiquant un carottage dans un fût en béton, ce qui permet d'obtenir un échantillon que nous pouvons analyser. Les colis reçus au centre de stockage de l'Aube se répartissent en une quinzaine de types, mais il faut savoir qu'un colis contient en moyenne 30 % de déchets et 70 % d'autres matières – généralement un liant constitué de ciment ou de béton, que l'on appelle la matrice.
Les analyses que nous effectuons sur les carottes sont des mesures d'activité, de tenue physique, et de qualité du béton. Un autre équipement va nous permettre de réaliser des inventaires : quand nous recevons des colis sans matrice, nous en sortons tous les déchets un par un afin de vérifier que nos spécifications d'acceptation ont bien été respectées et que les déclarations des producteurs sont exactes – c'est ainsi que nous mettons en présence une source, par exemple un détecteur ionique de fumée. Nous disposons également d'un équipement de radiographie à haute efficacité, similaire à ceux qui équipent les salles d'embarquement des aéroports : cela nous permet de visualiser le contenu des fûts sans les détruire et, avec un peu d'expérience, de détecter la présence de liquides – interdite dans les colis de déchets – ainsi que certaines formes de déchets que nous ne souhaitons pas passer à la presse à compacter ; auquel cas, nous n'ouvrons le fût pour vérifier son contenu.
Nous possédons des installations de dégazage, qui sont des cloches équipées de dispositifs permettant de mesurer le taux de dégazage, en particulier du tritium et du carbone 14, qui peuvent se dégager de certains colis. Enfin, nous disposons également d'un équipement de spectrométrie qui permet de mesurer les différents radioéléments présents dans un colis et leur niveau d'activité : il s'agit en fait de vérifier les informations que les producteurs se doivent de nous fournir en procédant eux-mêmes à des mesures.
Il y a encore quelques années, nous réalisions la plupart de nos analyses en utilisant les installations du CEA ou d'autres opérateurs privés. L'avis récemment publié par l'IRSN au sujet du contrôle de colis de l'Aube ne nous permet pas de procéder directement à sa mise en service : il est d'abord destiné à l'Autorité de sûreté nucléaire qui, sur son fondement et en tenant compte également de la documentation que nous avons fournie, délivrera ou non l'autorisation de mise en service. Cela dit, nous savons déjà que nous l'obtiendrons : nous travaillons depuis près de quatre ans sur ce projet important pour la sûreté et les réserves émises par l'IRSN ne portent que sur un point bien particulier.
Il faut savoir que l'installation comprend des équipements de détection et d'extinction automatique d'incendie qui, à l'origine, n'étaient pas dimensionnés à la tenue aux séismes : si les bâtiments étaient conçus pour résister à un séisme, ces équipements, eux, ne l'étaient pas, car les règles d'alors ne l'exigeaient pas. En cours de projet, l'Autorité de sûreté nucléaire et l'IRSN nous ont dit qu'ils souhaitaient que cet équipement soit dimensionné aux séismes – à moins que nous ne trouvions une solution pour qu'il ne puisse y avoir de départs de feu. Il se trouve qu'il était très compliqué de dimensionner tous ces équipements à la tenue aux séismes. Nous avons donc choisi de retirer toutes les sources potentielles de départs de feu à l'intérieur de l'équipement de l'installation de contrôle de colis (ICC), les seules sources restantes étant des sources électriques – mais nous avons fait en sorte qu'en cas de séisme, les détecteurs coupent instantanément l'alimentation électrique. Le délai s'estime en micro-secondes, et c'est précisément sur ces points que portent les demandes de précisions de l'IRSN : il veut connaître le délai exact et le type de capteurs mis en place. Nous avons indiqué que nous placerions trois capteurs afin d'éviter un déclenchement intempestif du dispositif de coupure, mais l'IRSN veut également des précisions sur la profondeur et la vitesse de propagation des ondes des capteurs.
Nous serons autorisés à mettre en service dans maintenant moins de deux semaines et demie par l'ASN, étant précisé que cette autorisation de mise en service nous permettra seulement pour l'instant de procéder à des « essais à chaud », autrement dit avec des colis radioactifs, alors que pour le moment, nous n'avons fait que des essais de bon fonctionnement sans radioactivité. Tout le programme de contrôle qui sera réalisé au cours de l'année 2018 correspondra aux essais à chaud ; ce n'est qu'à partir de 2019 que nous pourrons mettre en oeuvre notre programme annuel de contrôle et de surveillance.
Pour répondre à M. Cordier, je dirai qu'il n'y avait pas de lien entre les essais nucléaires et nous, et qu'ils ne nous apportaient pas d'informations particulières.
Pour ce qui est de nos liens avec la défense, ils consistent dans le fait que nous prenons en charge un certain nombre de ses déchets, dans une gamme assez large : certains viennent de l'armée de terre, d'autres de la dissuasion ou de la marine. La seule chose qui nous reliait aux essais nucléaires, c'est que certains de nos experts foreurs sont allés faire des forages à Mururoa, avant de revenir travailler chez nous à la fin des essais.
Non, cela ne nous apportait rien.
Avant de répondre à la question de la mémoire, évoquée à juste titre par Mme Abba, je veux revenir sur le concept de solution passive. Depuis que des réflexions portant sur le stockage en couches profondes ont été engagées, le concept de solution passive est parfois interprété comme une volonté d'oublier les déchets en les cachant sous le tapis. Peut-être sommes-nous tous un peu responsables de cette situation : en insistant sur le fait que c'est la seule option technique de nature à fournir une sûreté passive à long terme pour ces déchets, on a aussi nourri l'idée que l'objectif était de les oublier. Or un important effort est accompli pour en conserver la mémoire, même s'il viendra forcément un moment où on la perdra : d'où la nécessité d'une sûreté passive. Mais cela ne signifie pas que l'on enfouit les déchets le plus profondément possible afin de les oublier.
Depuis le début, nous avons donc entrepris un travail sur la conservation de la mémoire de nos sites : cela sera fait pour Cigéo, comme c'est déjà le cas pour le centre de stockage de la Manche et pour le CSA. La conservation de la mémoire recouvre des actions extrêmement pratiques, à savoir conserver les archives, les enregistrer sur des supports de long terme, faire des archives plus synthétiques en rendant la mémoire de synthèse plus accessible, etc. Pour cela, nous travaillons avec des archivistes, en passant en revue les différents supports possibles, mais aussi en effectuant des recherches relevant davantage du domaine des sciences humaines et sociales, centrées sur le concept des supports culturels de la mémoire à très long terme – en nous interrogeant, par exemple, sur les notions de rites et de monuments. Ces questions suscitent d'ailleurs un débat au niveau international, certains estimant que le fait de préserver la mémoire pourrait aussi susciter l'envie d'aller voir de plus près ce qui se cache sous la terre… Cela peut aller jusqu'à des travaux universitaires dans le domaine de la sémiotique, portant sur les signaux qui, sur le très long terme, permettent de garder la mémoire.
Il ne s'agit pas seulement de créer des panneaux d'avertissement à très long terme. Sur le plan philosophique – j'ai eu une discussion avec une philosophe sur ce point il y a quelques jours –, prendre soin des déchets ne consiste pas à s'en débarrasser, mais à trouver une solution pour leur conservation. C'est aussi privilégier une approche d'ordre patrimonial, nous faire les gardiens de ces déchets qui constitueront une trace de la période nucléaire par laquelle l'humanité est passée – et, en ce sens, on peut considérer que la connaissance du fait que nous avons produit des déchets fait partie du patrimoine collectif de l'humanité.
Comme on le voit, les questions portant sur la sécurité passive ne sont pas seulement techniques : elles soulèvent des interrogations d'ordre éthique et philosophique, ce qui montre que notre société ne cherche pas à se soustraire à ses responsabilités en faisant le choix de la sûreté passive, mais qu'elle les prend, au contraire, en faisant en sorte que l'humanité en garde le souvenir, avec tout ce que cela implique – que l'aventure nucléaire ait vocation à s'arrêter ou à continuer.

Effectivement, nous abordons un registre quasiment philosophique, ce qui semble inévitable compte tenu des enjeux que représente la question des déchets nucléaires. Malheureusement, cela nous conduit à nous poser des questions auxquelles il est bien difficile de trouver la réponse, notamment celle qui consiste à savoir s'il vaut mieux essayer de préserver la mémoire aussi longtemps que possible, ou si cela représente au contraire un risque pour l'avenir.
Chacun conviendra qu'il est impossible d'exclure l'éventualité que dans quelques siècles, par exemple dans 2 500 ans, l'humanité ait perdu la mémoire des déchets, et que des forages soient entrepris sur un site de stockage de déchets nucléaires. Pour ma part, j'estime que si cela devait arriver, personne ne peut dire aujourd'hui quelles en seraient les conséquences. Qu'en pensez-vous ?
Je suis d'accord avec votre raisonnement, sauf sur la dernière phrase. Nous sommes effectivement obligés d'admettre que, sur des échelles de temps aussi longues, notre civilisation peut disparaître et laisser la place à une autre, qui n'aurait pas conservé la mémoire. D'ailleurs, si nous cherchons les moyens de préserver la mémoire le plus longtemps possible, l'hypothèse selon laquelle elle pourrait avoir disparu au bout de 500 ans fait partie des hypothèses sur lesquelles nous nous basons pour établir notre modèle de sûreté passive, y compris pour les sites de surface : il s'agit là d'une approche prudentielle et conservatrice car, sur cette période, il paraît possible de conserver des éléments de mémoire assez robustes.
Pour mettre au point une solution à très long terme, pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'années, nous devons faire le choix d'options techniques robustes, capables de résister aussi bien aux tentatives d'intrusion qu'à l'érosion naturelle : c'est ce qui nous conduit au modèle du stockage profond. Nous avons la chance, sur le site de Bure, de disposer d'une couche d'argile extrêmement stable, garantissant que les phénomènes d'érosion resteront très limités. Ce n'est pas le cas d'autres pays, par exemple en Suède, où le phénomène d'érosion est sans comparaison, ou en Suisse du fait de la remontée du plateau alpin.
Bien entendu, sur les échelles de temps considérées, l'hypothèse du forage accidentel fait partie des scénarios que nous devons envisager. Cela nous conduit à nous interroger sur les conséquences qui en résulteraient, et à vérifier que le percement du stockage n'aurait pas de conséquences inacceptables. La zone choisie ne présente pas d'intérêt géologique particulier ; pour ce qui est du potentiel géothermique du site, il n'a rien d'exceptionnel, contrairement à ce qui a parfois été affirmé. Il n'y a donc pas de raison particulière d'aller creuser à cet endroit, ce qui ne nous permet cependant pas d'exclure que quelqu'un ait un jour l'idée d'y pratiquer un forage – dont les conséquences, je le répète, seraient maîtrisées.

Si un forage était fait dans 2 500 ans en plein milieu du site de Bure, il n'y aurait donc pas de problème ?
Exactement.
Pour ce qui est du tritium, il est inévitable d'en retrouver des traces – quelques becquerels – aux abords d'un lieu de stockage, car il s'agit d'un élément très léger, donc très mobile dans l'environnement. Nous nous efforçons donc d'en limiter ce que nous appelons le terme source, c'est-à-dire la quantité d'activité en tritium admise sur notre centre, et d'évaluer aussi précisément que possible sa migration, en fonction de sa forme et des ouvrages dans lesquels il est présent. Sur le centre de stockage de l'Aube, nous avons stocké des plaques radioluminescentes, sans aucun rapport avec l'électronucléaire – il s'agit de panneaux qui signalaient autrefois la sortie de secours sur des navires, et qui étaient recouverts d'une peinture au tritium.
Nous avons effectué des prélèvements sur ce site, y compris dans les eaux souterraines, dont l'analyse au piézomètre a montré des teneurs maximum de 58 becquerels par litre. Je précise que l'OMS fixe une valeur de potabilité de l'eau en présence de tritium à 10 000 becquerels par litre ; quant au seuil d'alerte national pour la qualité de l'eau, il est fixé à 100 becquerels par litre – l'atteinte de ce seuil devant conduire à contrôler la présence éventuelle d'autres radioéléments. En fonctionnement normal, c'est-à-dire en l'absence d'incidents particuliers – c'est le cas sur le site du CSA –, il nous suffit de prendre quelques mesures, consistant à limiter la quantité de tritium qui entre sur le site, à la répartir et à utiliser des colis d'un type adapté, pour nous assurer que la quantité de tritium retrouvée à l'extérieur est tout à fait admissible et ne pose aucun problème.
La situation est différente pour le centre de stockage de la Manche, où s'est produit un incident à la fin des années 1970 – l'ANDRA n'existait pas encore à l'époque, mais on stockait déjà des déchets radioactifs sur ce site. Le centre a reçu un jour des colis de déchets contenant des quantités de tritium extrêmement importantes et présentant des défauts, qui ont été stockés à un endroit qui s'est trouvé inondé. À la suite de cet événement, on a retrouvé dans l'environnement du CSM, notamment dans les nappes phréatiques et le ruisseau se trouvant à proximité, du tritium à des niveaux supérieurs aux valeurs de potabilité admises – cela dit, l'eau du ruisseau Sainte-Hélène n'est pas potable pour d'autres raisons, liées à l'activité agricole. Il convient par ailleurs de préciser que l'activité du tritium décroît assez rapidement, ce qui permet de la gérer simplement : il suffit de procéder régulièrement à des analyses afin de vérifier la décroissance, c'est-à-dire la diminution de la pollution au tritium que l'on trouve dans l'environnement du centre.
Si j'ai bonne mémoire, elle est de l'ordre d'une douzaine d'années.

Je veux revenir un instant sur les forages qui pourraient être réalisés dans 2 500 ans. J'aimerais que vous nous fournissiez les éléments techniques qui permettent de dire que n'importe quel forage ne peut pas percer…
Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que s'il y avait un forage, les conséquences seraient maîtrisées.
Nous vous l'expliquerons dans notre réponse écrite.

Quel sera, selon vous, le coût final du projet Cigéo ? Quelle est la clé de répartition entre les différents exploitants ?
La loi prévoit que nous fournissions au Gouvernement les éléments qui permettent d'apprécier le coût du projet.
Définir le coût du projet est nécessaire pour sa conduite, pour s'assurer que la facture du consommateur couvre celle des déchets, et surtout pour fixer les provisions des producteurs.
Il faut rappeler que les déchets représentent 1 à 2 % de la facture. Avec un projet sur cent cinquante ans qui en est encore au stade de développement, il y a bien évidemment des incertitudes. Mais pour ce qui est de la facture du consommateur, en gros, c'est couvert.
Nous avons essayé d'approcher ce coût de 25 ou 30 milliards de manière assez originale – puisque le but est de fixer les provisions –, en regroupant l'ensemble des coûts sur la durée totale du projet en construction, en exploitation, en maintenance, en fermeture et surveillance après fermeture, sur cent cinquante ans.
Le chiffre de 25 milliards qui figure dans l'arrêté pris par la ministre de l'écologie à l'époque comme un coût objectif correspond à un coût non actualisé sur cent cinquante ans. Ce qui implique forcément de nombreuses incertitudes méthodologiques : quels seront l'évolution des coûts de production, le prix du béton dans trente ans, le nombre de pompiers ? Par exemple, l'impact brut, sur une durée de cent cinquante ans, ne sera pas le même selon que l'effectif des pompiers sera de cent ou de quatre-vingt-dix. Ce qui explique que l'on parle de 25, 30 milliards, voire plus.
Il est important d'avoir en tête ce chiffre de 30 milliards, car on le compare souvent à d'autres, notamment au coût du grand carénage ou à la construction de Hinkley Point au Royaume-Uni, qui seront réalisés ou non dans les quinze prochaines années. Cet horizon de temps correspond en gros à la première tranche du projet, c'est-à-dire les installations de surface, la descenderie, le tout début du quartier MA-VL et le quartier pilote HA0, qui représentent un coût total de l'ordre de 6 à 7 milliards, ce montant intégrant l'ingénierie, les études, la construction, et l'exploitation. Quant aux dépenses d'investissement pur, elles s'élèvent à 4 milliards.
Environ 2035, c'est-à-dire le périmètre de la première tanche ou de la phase industrielle pilote.
Cela ne veut pas dire que ce n'est pas un gros objet, à l'échelle de l'agence, mais il n'est pas non plus incommensurable. Il faut bien le mener, bien le réaliser, mais il est tout à fait en rapport avec un investissement dans le secteur du nucléaire, dont le coût représente 10 % du grand carénage. Il est commensurable avec des gros pilotes industriels dans le secteur du nucléaire, et avec cette notion de phase industrielle pilote pendant laquelle on construit les éléments nécessaires qui permettent de confirmer ce qui doit l'être et d'obtenir les informations complémentaires qui détermineront les phases ultérieures.
Notre estimation de départ était plutôt prudente et conservatrice puisqu'elle tablait sur une trentaine de milliards. Le coût objectif a été fixé à 25 milliards à mi-avant-projet détaillé. Nous avons réalisé une revue complète d'optimisations, d'améliorations que nous n'avions pas intégrée au début de l'avant-projet détaillé il y a deux ans parce qu'elle n'était pas suffisamment mature, mais nous avions fait gagner en maturité. Depuis 2017, nous avons tout passé en revue – la sûreté, la démontrabilité, l'intérêt industriel, le coût, l'impact sur les études – pour aboutir à un montant de l'ordre de 4 milliards. Cela donne surtout un ordre de grandeur des objets qu'on manipule, mais cela ne fait pas tout le chemin pour atteindre le coût objectif. D'autres questions se posent : quel sera le coût du béton, y aura-t-il des marchés compétitifs le moment venu ? Cela dépend de nous, de la performance des processus d'achat mais aussi éventuellement de la concurrence avec le Grand Paris à ce moment-là : arriverons-nous à un moment où tout le monde voudra commander des tunneliers, ou au contraire à un moment où le fabricant sera très heureux de nous en fournir un ? Il y a encore de nombreuses incertitudes au-delà même des enjeux de conception.
Alors que tout le monde mélange tout et compare les choux et les carottes, il est important de mettre ces chiffres en perspective.

Les producteurs contribuent-ils, à quelle hauteur et selon quels critères ? Selon la dangerosité du produit ? Sa longévité ?
Bien évidemment, l'Agence est intégralement payée en application du principe pollueur-payeur. C'est le producteur qui finance l'Agence selon des modalités que je vais décrire, à l'exclusion de quelques missions de service public payées sur le budget du ministère de l'écologie : traitement des sites orphelins, inventaire national, missions de service public.
Les producteurs nous financent, soit sous forme contractuelle – les sites en exploitation sont sur des bases contractuelles avec les producteurs en fonction du type de déchets, du mode de livraison, des opérations à réaliser, de la place que cela prend dans le stockage, etc. –, sur la base de contrats régulièrement renégociés et soumis à des processus d'audits contradictoires –, soit sous forme de taxes et de contributions. S'agissant de Cigéo, la recherche est financée par une taxe qui était historiquement de l'ordre de 100 millions d'euros, ramenée à 65 ou 70 millions d'euros et d'une contribution à la conception de l'ordre de 150 millions d'euros – la première entre dans la comptabilité maastrichtienne, la seconde pas. Il s'agit là de la phase des travaux de recherche et de conception : bien évidemment, lorsqu'on entrera en phase de réalisation, il faudra trouver d'autres modalités de financement qui seront négociées le moment venu.
Une clé de répartition entre ces producteurs a été établie historiquement à 78 % pour EDF, 15 % pour le CEA et 7 % pour Areva. Cette répartition est basée sur les volumes et les enjeux de déchets. Lorsque l'on sera en phase de réalisation et surtout en phase d'exploitation, il faudra voir comment les mécanismes évolueront de façon à être doublement incitatif pour être performant et pour que les producteurs de déchets envoient au bon moment les déchets dans de bonnes conditions. Cette clé de répartition historique 78-15-7 traduit le poids des trois opérateurs dans le projet de Cigéo.
Pour les centres existants, la répartition est directement liée au volume de déchets qu'ils livrent et qui ont été inventoriés à l'origine avec des mécanismes différents selon qu'il s'agit d'une ICPE, c'est-à-dire des déchets de très faible activité, ou d'une INB. Pour une ICPE, on a une obligation de durée d'exploitation de trente ans et de durée de surveillance de trente ans. Les producteurs paient le coût complet : à chaque fois qu'un mètre cube est livré, ils paient la part fixe de l'exploitation de l'année et une part qui nous permettra d'assurer la surveillance une fois ces déchets pris en charge, ce qui représente des coûts importants pour des installations comme les nôtres. Pour une INB, le mécanisme est différent : les producteurs de déchets paient le coût d'exploitation, et les coûts de démantèlement, de surveillance et de couverture sont provisionnés au prorata des volumes livrés dans leurs comptes sur la base des estimations de coûts futurs que l'ANDRA produit, y compris pour les services compétents de l'État. Ils devront décaisser les sommes le moment venu, c'est-à-dire lors du démantèlement et de la réalisation de la couverture, la surveillance étant fixée à 300 ans pour l'INB de stockage en surface.

L'ASN a pointé un risque de dégagement d'hydrogène, donc un risque d'incendie. Pouvez-vous nous garantir qu'il n'y aura pas de dégagement d'hydrogène, et donc pas de risque d'incendie sur le site de Cigéo ?
Nous avons abordé le risque lié à l'hydrogène et le risque d'incendie dès le début dans la conception.
S'agissant d'un projet comme celui de Cigéo, il y a d'une part la démonstration de la sûreté à long terme, et d'autre part la démonstration de la sûreté en exploitation. Les travaux initiaux de recherche et de démonstration ont été essentiellement focalisés sur les enjeux de sûreté à long terme puisqu'il s'agissait de démontrer la faisabilité du concept sur un très long terme. En 2011, nous sommes entrés en phase de conception et nous avons, bien évidemment, intégré et commencé à préparer les enjeux de sûreté en exploitation. C'est un des enjeux essentiels de la conception.
Parmi les enjeux de sûreté en exploitation, on trouve bien évidemment les risques d'incendie, les risques d'hydrogène et les risques d'explosion. Chacun sait que des incidents de ce genre se sont produits sur certains sites : sur le site non radioactif de StocaMine, des déchets incompatibles avaient été descendus, provoquant un incendie. Dans une installation dédiée à des déchets nucléaires de la défense américaine, le Wipp, deux incendies se sont produits, le premier lié à un mauvais entretien des outils miniers restés au fond et qui se sont enflammés, le second à la descente de déchets conditionnés dans une matrice incompatible. Depuis le début de la conception, l'enjeu de la sûreté en exploitation des incendies et de risque de formation d'une atmosphère explosive (ATEX) est bien évidemment dans la tête de tout le monde. C'est pour cette raison que ces deux risques ont été abordés selon le principe habituel : réduction à la source, prévention et élimination du risque ; mesure et maîtrise des conséquences du risque résiduel s'il y en a un.
En fait, c'est le risque sur les bitumes qui a été pointé par l'ASN, non le risque d'hydrogène. Par construction, on peut produire de l'hydrogène : il peut y avoir des batteries, de la corrosion. L'objectif est donc de limiter la quantité de gaz que l'on descend, par exemple en limitant la capacité des colis eux-mêmes à en produire – que l'on définit au travers des spécifications d'acceptation –, ensuite en procédant à des mesures, des contrôles sur les émissions d'hydrogène et en limitant tout ce qui peut provoquer les émissions d'hydrogène. Comme on sait que des phénomènes de corrosion peuvent en produire, il faut veiller au risque de défaillance des dispositifs de ventilation et de maîtrise de l'ambiance dans une logique de défense en profondeur et de défaillances multiples : on doit être capable d'intervenir même si tous ces dispositifs ont défailli.
Pour le risque incendie, la démarche est la même : il s'agit de réduire systématiquement les risques à la source. Par exemple, il n'y a pas de combustible. Dans le Wipp, les outils miniers classiques fonctionnent au gasoil et il y a des dépôts de gasoil au fond du stockage. Pour notre part, nous avons fait le choix de ne pas utiliser de moteurs thermiques au fond, mais un funiculaire qui descend le stockage le long de la rampe, dont le moteur est situé en haut et non dans le véhicule. Il n'y a donc pas de risque d'incendie sur le véhicule qui transporte le colis jusqu'à son alvéole. Le seul endroit où il y a un moteur, c'est sur le pont stockeur dans les alvéoles de MA-VL. Là aussi, on fait en sorte de limiter les objets combustibles pour réduire le potentiel calorifique. Et il y a, en plus, des systèmes de détection et de lutte contre l'incendie.
L'ANDRA et le CEA ont réalisé un travail de caractérisation des fûts de bitume et de leur comportement. Ces fûts dits de bitume sont des déchets qui ont été mis dans une matrice au début des années soixante jusqu'au début des années quatre-vingt-dix. Cette matrice a beaucoup de qualités : nos prédécesseurs n'avaient pas fait n'importe quoi. Elle est extrêmement stable, y compris sur le plan thermique. Aujourd'hui, ces fûts de bitume sont dans des casemates à Marcoule, et alors qu'ils connaissent des amplitudes thermiques élevées, on n'a relevé aucune difficulté particulière. Tous les travaux de caractérisation ont montré que ces bitumes se comportent plutôt correctement et que le risque de reprise de réaction exothermique et d'emballement d'un colis à l'autre est extrêmement faible. D'ailleurs, nous avons fait des essais, notamment au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), pour voir s'il y avait un risque que l'intérieur du colis monte en température en cas d'incendie à l'extérieur du colis. Voilà pour le comportement normal du fût normal dans des conditions normales.
Nous avons donc fait une analyse, dans la droite ligne de la thèse de Leny Patinaux, expliqué ce que nous retenions ou pas, et nous l'avons soumise à l'IRSN puis à l'ASN. Nous voulions que ce sujet soit débattu. L'IRSN a considéré que nous avions fait beaucoup de progrès sur la connaissance des bitumes, de leur comportement, et obtenu un certain nombre de résultats ; mais il nous a demandé si nous pouvions exclure définitivement le risque de reprise d'une relation exothermique dans les colis et d'un emballement. Or ces bitumes ont été produits durant une époque assez longue avec une variabilité importante, et ils peuvent évoluer dans le temps. La réponse est donc probablement techniquement et scientifiquement difficile à apporter.
Pour renforcer la logique de défense en profondeur, deux logiques sont possibles : ou bien on élimine le risque en traitant en surface ces fûts bitumés, par exemple dans un processus de vitrification, ou bien on fait en sorte, une fois ces fûts descendus, d'améliorer la robustesse de la conception d'alvéoles dédiées pour les bitumes, ce qui augmente notre capacité à prévenir, intervenir et limiter les conséquences. Ce sont bien les deux voies que l'on nous demande d'analyser, et nous devons le faire de manière complète, rigoureuse et exhaustive parce que chaque solution comporte bien évidemment des avantages et des inconvénients. On pourrait estimer que le traitement en surface, c'est-à-dire la vitrification, résout le problème, mais on imagine bien quel serait l'impact en termes d'environnement, d'exposition, etc., si l'on devait reprendre 60 000 fûts. Reste l'autre solution : les descendre en l'état, mais dans des alvéoles renforcées. Nous devrons donc répondre à cette question le moment venu pour savoir quelle est la meilleure des solutions. Cela dit, cette question dépasse l'ANDRA car son métier n'est pas d'aller faire de la vitrification de déchets ; elle concerne toute la filière. C'est pourquoi, comme l'a annoncé hier le secrétaire d'État, l'ASN va demander l'organisation d'une revue internationale à laquelle nous travaillons déjà, et qui mobilise des enjeux scientifiques propres au nucléaire, des enjeux de doctrine de sûreté, mais également des compétences dans d'autres domaines, comme la pyrotechnie.
En attendant, parce que le choix ultime nécessitera peut-être un certain temps, que fait-on ? Premièrement, ces fûts de bitume ne seront descendus que le jour où l'ANDRA et l'ensemble des évaluateurs et des contrôles seront convaincus que les conditions robustes et rigoureuses de sûreté sont remplies. En attendant, ils resteront en surface. Lorsque l'on aura décidé quelle est la meilleure manière de les descendre, on mettra en oeuvre l'option retenue. Cela signifie notamment que nous ne mettrons pas de bitumes dans la phase industrielle pilote, contrairement à ce qui avait été prévu initialement. C'est une bonne illustration de ce à quoi va servir cette phase pilote : ce temps nous permettra de prendre en main l'installation, d'acquérir des éléments qui confirment, confortent, complètent les éléments de démonstration, et des informations complémentaires afin de prendre ultérieurement les décisions qui s'imposent sur l'élargissement du spectre de déchets ou la manière de descendre les bitumes le moment venu. En attendant, ils resteront en surface dans leurs installations d'entreposage dans le cadre d'un processus de reprise et de reconditionnement que mène le CEA.

On voit bien que la question de la sécurité se pose moins dans la mesure où tout en passe en sous-sol. Toutefois, les tuyères d'aération verticales prévues constituent-elles une source de vulnérabilité en matière de sécurité ?
Les enjeux de sécurité seront totalement pris en compte pendant la phase d'exploitation. Le dossier d'options de sûreté – partie exploitation (DOS-Expl) comporte un volet relatif aux enjeux de sécurité dont le cadre est plus lourd que celui des installations existantes. On s'est demandé quel modèle retenir, la force locale de sécurité modèle CEA-Areva ou le peloton spécialisé de protection de la gendarmerie (PSPG) avec des gendarmes d'EDF ; nous nous orientons vers un modèle qui sera probablement un peu mixte, mais plutôt avec des gendarmes. La sécurité est, pour nous, un sujet est important. Ce n'est pas parce que les déchets sont tout au fond qu'il faudrait négliger cette question.
Les tuyères d'aération verticales ne seront nécessaires que pour la phase d'exploitation et non pour la phase à long terme. En phase d'exploitation, l'ANDRA prévoit un ensemble de mesures pour protéger le Cigéo d'éventuels actes de malveillance qui intègrent les tuyères et les puits. Je ne peux vous en dire davantage en raison de la confidentialité qui prévaut sur la conception de ces dispositifs. Si vous le souhaitez, nous pourrons creuser le sujet dans un format adapté.

Je vous remercie pour vos propos. Cette audition a été longue car le sujet en valait pleinement la peine.
S'agissant des questions auxquelles vous répondrez par écrit, nous nous permettrons peut-être de les restituer oralement puisque nos séances sont publiques. Il est légitime en effet que le public en ait connaissance. Et nous nous réservons l'opportunité de vous inviter à nouveau au cas où nous aurions besoin d'éléments complémentaires ou d'autres questions à vous soumettre.
Pour notre part, nous publierons nos propres réponses sur notre site internet par souci de transparence.
M. Torres m'indique, avec un peu de retard, qu'il a la réponse en ce qui concerne les immersions de déchets.
L'inventaire rappelle que la France a participé à deux campagnes d'immersion en 1967 et 1969, au large de la Galice et de la Bretagne, pilotées par l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN), avec plusieurs autres pays. Au total, 5 000 tonnes, soit 14 000 colis environ ont été immergés.
Ces campagnes, ont également fait l'objet, toujours sous l'égide de l'AEN, d'une surveillance depuis les années quatre-vingt qui a cessé en 1995, les campagnes d'immersion ayant été interdites en 1993. La surveillance a été arrêtée parce qu'ils ont pu démontrer qu'il n'y avait eu aucun accroissement de la radioactivité au-delà de la radioactivité naturelle à proximité des lieux d'immersion qui ont été choisis à chaque fois spécifiquement dans des fosses abyssales.
La France a également effectué une campagne d'immersion dans le Pacifique en lien avec les essais, qui a concerné un moindre volume et un terme source radioactif beaucoup plus faible. Toutes ces informations sont rappelées dans l'inventaire que nous publions tous les trois ans.
A priori de déchets provenant du CEA de Marcoule, c'est-à-dire plutôt des déchets technologiques, des déchets d'exploitation d'installations du CEA. Il pouvait y avoir également des déchets liquides, mais pas dans les déchets français.
Je n'ai pas d'information précise, mais je pense qu'il y avait plutôt un mix de radioéléments à vie courte et à vie plus longue : à l'époque, ce tri n'existait pas.

Nous sommes preneurs d'une réponse écrite et nous avons pris bonne note de votre invitation. Il est fort probable que nous y donnions une suite favorable.
Cette invitation est valable tant pour le CSA et le CIRES, qui sont des installations industrielles, que pour le CMHM et le laboratoire.
——²——²——
Membres présents ou excusés
Réunion du jeudi 8 février 2018 à 10 heures
Présents. - Mme Bérangère Abba, M. Philippe Bolo, Mme Émilie Cariou, M. Anthony Cellier, M. Pierre Cordier, M. Paul Christophe, M. Grégory Galbadon, Mme Sonia Krimi, M. Adrien Morenas, Mme Mathilde Panot, M. Patrice Perrot, Mme Barbara Pompili, Mme Isabelle Rauch, M. Hervé Saulignac, M. Raphaël Schellenberger, M. Jean-Marc Zulesi.
Excusés. - M. Xavier Batut, Mme Perrine Goulet, M. Jimmy Pahun,