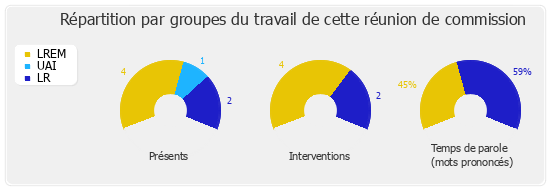Mission d'information sur la gestion des évènements climatiques majeurs dans les zones littorales de l'hexagone et des outre-mer
Réunion du mardi 22 mai 2018 à 17h30
Résumé de la réunion
La réunion
L'audition débute à dix-sept heures quarante-cinq.

Reprenons nos travaux, mes chers collègues. Je tiens tout d'abord à saluer nos invités à cette table ronde, M. Jean-François Rapin, sénateur du Pas-de-Calais et président de l'Association nationale des élus du littoral (ANEL), M. Lionel Quillet, vice-président du conseil départemental de Charente-Maritime et membre de l'Assemblée des départements de France (ADF), Mme Alix Mornet, conseillère développement durable auprès de l'ADF, Mme Ann-Gaëlle Werner-Bernard, conseillère pour les relations avec le Parlement auprès de l'ADF, et M. Jacques Merino, conseiller de l'ADF pour les questions de sécurité. Je vous remercie d'être là et de nous accorder votre temps pour cet échange.
Vous vous rappelez que l'Assemblée nationale a décidé de créer cette mission d'information afin de mieux définir les politiques publiques en matière d'anticipation et de gestion des crises entraînées par les événements climatiques majeurs, essentiellement en zone littorale, que ce soit dans l'Hexagone ou dans les outre-mer. Cette commission a été créée après le passage de l'ouragan Irma aux Antilles. Si notre mission couvre l'ensemble du territoire, elle a donc vocation à se concentrer particulièrement sur la reconstruction des Antilles. Elle porte autant sur la phase d'anticipation et de gestion des crises que sur celle de la reconstruction après ces événements climatiques.
Nous avons donc choisi d'auditionner quatre types d'acteurs. Des représentants du monde scientifique, bien sûr, pour faire le point sur les évolutions actuelles du climat, sur ce qu'il faut en attendre, et sur les risques encourus dans l'ensemble de nos zones littorales. Le deuxième groupe représente la sphère publique, politique, les élus, dont vous faites partie. Il est pour nous du plus grand intérêt de connaître votre sentiment sur les politiques publiques nationales et la manière dont elles sont coordonnées au niveau local. Quelles sont les pistes d'amélioration ? Que retenir des retours d'expérience ?
Nous recevons aussi, évidemment, ceux qui mettent en oeuvre les politiques publiques : les responsables des établissements publics et des services compétents. Le dernier volet est enfin celui de la société civile, le monde privé, mais aussi le monde associatif, afin de comprendre comment ont été perçues ces politiques publiques et comment ces acteurs ont été associés aux décisions, ou à l'organisation de ces politiques.
Après ce bref rappel de l'ensemble de nos objectifs, je vous remercie encore de votre présence. Nous pourrons évidemment continuer à échanger par écrit, ou lors d'autres rendez-vous, si nous le souhaitons.

Je voudrais prolonger les propos de notre présidente par plusieurs questions, qui n'épuisent pas le sujet, mais vous laissent libres de développer d'autres thématiques.
Les collectivités ont-elles perçu une intensification des phénomènes climatiques majeurs en zone littorale ? À votre avis, le recul du trait de côte accroît-il ce risque ?
Quelle appréciation les collectivités territoriales portent-elles sur les plans de prévention des risques naturels ? Sur leur élaboration ? Y a-t-il en la matière des insuffisances, comme des zones trop peu intégrées dans un plan, ou des risques quant à l'implantation, par exemple, de centrales nucléaires ou d'autres activités industrielles dangereuses ? La même question se pose au sujet des plans de prévention des risques d'inondation (PPRI), des plans de prévention des risques de submersion marine (PRSM) et des plans de prévention des risques littoraux (PPRL).
Quelles sont les actions menées par les collectivités territoriales pour réduire l'impact des événements climatiques majeurs ?
Quelle est la place, dans les stratégies élaborées, des mesures d'atténuation reposant sur le milieu naturel ?
Pouvez-vous décrire très précisément la gestion des événements climatiques dans les différentes phases de surveillance, d'alerte, d'information aux habitants, de mise en sécurité des populations, de secours aux personnes, de remise en état des services publics prioritaires, d'aide dans les démarches assurantielles et la reconstruction des bâtiments, de reconstruction des infrastructures publiques, enfin de documentation et de réflexion, à distance de l'événement, en vue notamment de l'échange de bonnes pratiques ?
Quels sont les besoins exprimés par les collectivités pour améliorer les différentes étapes de la prise en charge des événements climatiques majeurs en zone littorale ?
Quels sont les retours d'expérience recueillis par les collectivités, le cas échéant ? La solidarité territoriale doit-elle être renforcée, selon vous, en cas d'événement climatique majeur ?
De quelles aides de l'État et de l'Union européenne les collectivités territoriales bénéficient-elles aux différentes étapes ?
Quelles sont vos recommandations pour améliorer la prévention et la gestion de ces événements climatiques majeurs dans les zones littorales ?
Y a-t-il une corrélation entre les événements majeurs dans ces zones – tempêtes, cyclones, submersions… – et des problèmes relevant de l'urbanisme, comme celui des « dents creuses » ?
Les mécanismes de mise en cause de la responsabilité des élus à l'occasion des catastrophes naturelles vous inspirent-ils une réflexion particulière ?
Êtes-vous favorables à des mesures administratives de mise en péril provisoire permettant à la puissance publique de contraindre les personnes en danger à quitter provisoirement leur domicile ?

Merci, monsieur le rapporteur, pour ces questions qui guideront nos échanges. Nos invités ne sont pas dans l'obligation de répondre de manière exhaustive, ils peuvent d'ailleurs le faire aussi par écrit. Nous aimerions surtout recueillir leur avis sur ces trois sujets majeurs que sont l'anticipation, la gestion de crise et la reconstruction.
Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs, chers collègues, j'ai dit tout à l'heure à mon collègue Lionel Quillet : « Parlons peu, parlons bien ». Sur le sujet qui vous occupe, et pour répondre à toutes les questions que vous nous posez, il y aurait effectivement beaucoup à dire. À ces questions, des réponses de bon sens s'imposent immédiatement, au sujet notamment des problèmes d'urbanisme, ou à celui de la solidarité – il est certain qu'en période de crise elle est très importante.
Nous avons vécu plusieurs étapes. La première de vos questions, madame la présidente, portait sur le problème des événements climatiques : perçoit-on, des uns aux autres, une évolution sensible ? La réponse est oui. Je faisais partie, il y a une quinzaine d'années, des climato-sceptiques. Maire d'une petite commune littorale, j'ai pourtant constaté, au fil du temps, le réchauffement, le changement climatique, et parfois des événements tempétueux rapprochés, totalement différents de ce que j'avais vécu enfant. Le changement est perceptible à l'échelle de trente, quarante, cinquante ans, pas d'une année sur l'autre. Je peux comprendre qu'il y ait encore aujourd'hui des gens qui n'y croient pas.
Le rapport direct avec l'érosion du trait de côte a été établi très récemment. Plusieurs textes en témoignent : deux propositions de lois émanant du Sénat, en particulier, reflètent directement la perception, sur les territoires littoraux, des événements climatiques, mais aussi de l'érosion côtière. Il y a un travail à faire, il est engagé. Il permettra de prendre en compte tout à la fois l'organisation territoriale et urbanistique du littoral, et les événements climatiques, notamment les risques de submersion. Sur ce dernier point, Lionel Quillet sera peut-être mieux à même de vous répondre, à partir des travaux pratiques qu'il mène dans sa commune.
Sur les systèmes d'alerte, la France n'est pas la dernière de la classe. Son approche du sujet a progressé, depuis de nombreuses années, grâce aux travaux d'organismes comme Météo-France et à ceux des associations, en coopération parfois avec le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). La carte de vigilance météorologique, par exemple, est aujourd'hui un élément important des stratégies de court et de moyen terme – quant à parler de long terme en météorologie du quotidien, c'est difficile… Mais on a là quelque chose de très intéressant, qui peut être un bon support préalable, avant l'alerte, notamment pour les populations d'Outre-mer.
Parmi les éléments qui me sont transmis à l'ANEL, en particulier depuis les territoires ultramarins, je retiens la dépendance satellitaire des informateurs susceptibles de nous alerter. La plupart des satellites d'où proviennent, dans les moments de crise, nos informations météorologiques seraient, pour autant que je puisse en parler sans expertise dans ce domaine, des satellites américains. Donc, si nous visons à l'indépendance face à des phénomènes dramatiques comme Irma, il faut se poser la bonne question sur ces satellites d'information, mais aussi sur les satellites de suivi au moment de la crise, lorsqu'il est crucial de pouvoir remettre en place des moyens de communication très rapides, au-delà de ceux du réseau courant. Or, la voie satellitaire est aujourd'hui la plus sûre et la plus rapide, notamment pour permettre aux secours de venir sur place.
Beaucoup d'élus m'ont parlé d'un site nommé Géorisques, réalisé par le BRGM, qui fait connaître les risques pour un territoire donné. Il ne fournit pas d'anticipation, à court ou moyen terme, de ce qui pourrait se produire, mais définit au présent les types de risques susceptibles de s'y réaliser. On est, certes, confronté, dans ce domaine, aux échelles de temps et d'espace, mais je pense qu'il est intéressant de développer ce genre d'outils pour affiner notre connaissance des événements et de l'influence du réchauffement climatique sur les digues.
Un dernier mot, avant de laisser la parole à mes collègues, sur les PPRL et sur le sentiment des élus du littoral à leur sujet. Il y a eu plusieurs phases, et un traitement différencié des PPRL selon les territoires. Ils ont souvent été élaborés lors d'une première phase d'urgence, de manière peut-être un peu précipitée, dans la situation dramatique qui a suivi la tempête Xynthia. De tous bords, face la gravité de l'événement, on a souhaité verrouiller les territoires littoraux. Dans certains, la discussion et le temps pris pour l'élaboration de ces documents ont permis de les amender, mais dans d'autres la situation reste figée et très complexe pour les élus locaux – Lionel Quillet nous en parlera –, qu'il s'agisse de réaliser les projets ou simplement de reconstruire et de développer le territoire.
Il y a là un vrai problème. Je pense que les PPRL devraient être traités de la même façon par tous les préfets, de manière à être à la fois équitables et conformes aux problématiques du territoire, qu'elles soient climatiques, comme dans les outre-mer, ou liées à la géographie locale. Là où les côtes sont très basses, on ne se pose évidemment pas les mêmes questions que là où le premier point de contact avec la ville est à neuf ou dix mètres au-dessus de la plage, parce que les effets de la submersion ne seront pas les mêmes.
Voilà, donc, en quelques mots, ce que je souhaitais vous dire en préambule sur ma vision de votre mission. Je l'approuve pleinement, et je l'ai d'ailleurs citée lors des discussions générales, au Sénat, sur les textes littoraux que j'évoquais tout à l'heure. Après chaque événement grave, on organise une nouvelle mission, mais il est important de pouvoir évaluer les réponses apportées, afin de se poser les bonnes questions sur ces sujets sensibles.
J'arrondirai moins mes propos que ne l'a fait mon collègue. C'est la neuvième fois que je suis auditionné sur ce sujet depuis Xynthia. J'ai connu la période précédente, où l'on ne faisait pratiquement plus de digues, parce que c'était compliqué… et puis la catastrophe s'est produite. J'ai moi-même vécu Xynthia, j'ai eu 80 centimètres d'eau chez moi et j'ai failli perdre mon fils. C'est dire si la question me touche.
Étant de l'île de Ré, je me considère comme un insulaire, même si un pont nous relie au continent. J'ai connu Xynthia, qui a bien sûr été, pour tout le monde, un moment difficile. Le moment suivant a été celui de la solidarité, de la réponse de l'État face un événement majeur. Cette réponse a parfaitement fonctionné : l'État s'est montré présent, et nous avons trouvé une solidarité extraordinaire aussi bien du côté des pompiers que du côté militaire, de l'action civile comme des élus. Ce moment a pour moi été le meilleur, ou le seul bon, entre Xynthia qui a été difficile, et la période suivante, dominée d'abord par la précipitation, puis, finalement, par la volonté de ne pas assumer le risque. J'ai toujours du mal à l'accepter.
J'espère aujourd'hui que cette audition sera l'occasion de faire le bilan, huit ans après, et de nous poser cette question : si Xynthia revenait demain, si un fort vent de sud, s'ajoutant à un grand courant, touchait à nouveau la Vendée, la Charente-Maritime, ou une autre région, que se passerait-il ? En huit ans, qu'a-t-on fait ? Qu'allons-nous dire ?
Nous avons vécu, après le moment de la solidarité, celui de la définition des zones noires et des zones rouges, et la décision – traumatisante, et sans fondement technique – de raser les maisons. Le problème était d'une complexité rare : si vous rasez la première maison parce que l'eau y est montée à un mètre, et la deuxième où elle a atteint 30 centimètres, que faites-vous de la troisième, où elle n'est montée qu'à dix centimètres ? Même sort que la deuxième ? Suivant cette logique, il aurait fallu évacuer bien plus largement. On s'est arrêté pour des raisons financières, selon la réponse de la Cour des comptes.
Après ce moment, extrêmement traumatisant, est venue la phase de culpabilisation des élus. Elle a été forte, rappelez-vous le procès de La Faute-sur-Mer. L'ensemble des élus ont été tenus pour plus ou moins responsables. Puis ont été mis en place les programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) et les PPRL.
J'ai vu à l'oeuvre les huit ministres qui ont géré le dossier, M. Borloo, Mme Batho, M. Martin, Mme Royal, M. Lecornu, tous. Devant l'ampleur du problème et les chiffres annoncés après Xynthia – dans l'entourage du président Sarkozy, on disait qu'il fallait, pour remettre en état les digues fluviales et maritimes existantes, entre 30 et 40 milliards d'euros, mais les chiffres qui filtraient résultaient de calculs très approximatifs, au mètre, dont certains arrivaient plutôt à 20 milliards d'euros –, on a annoncé que la remise en état de la deuxième façade maritime d'Europe et de l'un de ses premiers pays fluviaux – dont l'aménagement avait déjà pris cent ans de retard, puisque les travaux, déjà ralentis à la fin du XIXe siècle, avaient été pratiquement tous arrêtés après la seconde guerre mondiale – se heurtait à une impossibilité financière et technique, sachant que 30 % ou 40 % des digues étaient orphelines, et que, de toute façon, on ne savait plus bien à qui elles étaient.
La décision des cabinets, à ce moment-là, toutes appartenances politiques confondues, a été très clairement, selon moi, de décentraliser le risque. Quel ministre, quel président envisagerait de se trouver au journal de 13 heures de TF1 où l'on annoncerait 40 morts dans une collectivité, et d'avoir à répondre à la question « Qui est responsable ? »
On a alors senti, à tous les niveaux, une décentralisation du risque. Il y a bien eu un plan national « Digues », un plan national de remise en état, des PPRL, certes indispensables, des plans communaux de sauvegarde, etc… mais la décentralisation du risque.
Si bien qu'aujourd'hui, si Xynthia revient, la diversité des situations géographiques fera qu'une collectivité bien dotée, c'est-à-dire un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pourvu de moyens financiers et techniques importants, et d'un réel poids politique, comme La Rochelle, par exemple, qui compte près de 180 000 habitants, sera défendue ; mais, 30 ou 40 kilomètres au nord, l'EPCI d'Aunis-Atlantique, dont la population se répartit dans des communes d'environ 2 000 habitants, et dont le budget complet ne dépasse pas 10 millions d'euros, a pour 30 millions d'euros de digues à construire.
Huit ans après Xynthia, le résultat de cette volonté de décentralisation et de l'attribution aux élus locaux de la compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) – les députés l'ont votée, c'est un choix sur lequel je ne reviens pas – est que l'on nous dit que la responsabilité d'une digue, dont on ne sait pas à qui elle appartient – peut-être à celui qui l'a construite il y a trois siècles, mais pas à l'État, ni au département, ni à la région – incombe aux élus locaux, parce que, même si les collectivités n'en sont pas propriétaires, elles doivent, en vertu de la GEMAPI, en assurer la gestion, et parce que leurs élus sont réputés avoir connaissance du risque. Les présidents d'EPCI maritimes s'entendent dire : « En gros, c'est vous qui êtes responsables ».
Avec quels moyens financiers allons-nous faire face ? Si certains départements y parviennent, d'autres collectivités n'ont pas de réponse. Or Xynthia peut revenir, et sous une forme plus violente puisqu'il faut tenir compte du changement climatique. Quant à notre connaissance du risque, elle est parfaite, l'analyse du réchauffement climatique est hors de discussion, tous les élus l'ont comprise. Mais l'enseignement qu'ils en tirent est : « Pourvu que ça ne tombe pas sur moi ! », parce que, dans ce cas, ils seraient réputés avoir eu connaissance du risque et reçu l'alerte.
L'alerte météo, c'est une merveille : on en reçoit par téléphone entre huit et dix par hiver, et à la quatre-centième, je ne suis pas certain que l'on s'en alarme encore beaucoup. Sans compter que l'alerte météo, pour le maire d'une commune de 800 habitants, cela veut dire trouver deux ou trois adjoints dans la nuit, prévenir les uns et les autres, emmener sa femme en pyjama et réveiller tout le monde. C'est cela, la réalité d'une petite commune à l'arrivée d'une tempête. Si l'étape suivante, celle des secours, est bien organisée, les premières réactions – je me rappelle celles qui ont suivi Xynthia – sont autrement chaotiques. Il est vrai que la prochaine fois, cela se passera mieux, puisque l'alerte est maintenant connue, et que les populations locales veillent à la prévention du risque. Mais les habitants des résidences secondaires peuvent aussi être là au mauvais moment. Les tempêtes ne se produisent pas seulement en hiver, il peut y en avoir au printemps ou en septembre. Chez nous, par exemple, la grande tempête de 1713 s'est produite le 12 août. Imaginez la situation, de nos jours, si Xynthia se reproduisait à cette date.
En attendant, pour l'alerte, je crois que le plus gros est fait. Mais nous avons senti aussi qu'elle est un moyen pour l'État, par l'intermédiaire de Météo France, de nous dire : « Je vous ai alertés, d'ailleurs vous allez l'être un peu plus, pour que vous ne puissiez pas dire le contraire si jamais il se passait quelque chose ». Donc on vous met en jaune, en orange, en rouge s'il le faut…
Mais l'alerte une fois donnée, la collectivité est livrée à elle-même, face à un problème d'envergure départementale, au minimum, avec des réponses communales. Il est vrai que, de l'EPCI au département, tout le monde fait preuve de solidarité. Mais l'enjeu est beaucoup trop important pour les collectivités. On ne décentralise pas le risque, la sécurité des personnes, qui est une compétence régalienne. Or nous avons très bien senti que, pour des raisons techniques, financières, voire purement politiques, l'État nous disait : « C'est pour vous ».
Une fois l'alerte donnée par la Météo-France, que la digue ait été faite ou non, nous sommes totalement responsables, au titre de la connaissance du risque, du plan communal de sauvegarde et du PPRL. Dans certaines collectivités, les élus sont tranquilles, puisque la digue est faite et que tout a été financé. Dans d'autres, rien n'a été fait. Huit ans après Xynthia, la France est un véritable gruyère : certains endroits sont défendus, puis, cent mètres plus loin, d'autres ne le sont pas, et ainsi de suite…
Si bien que nos amis européens, hollandais notamment, qui sont venus nous voir au début, sont repartis en courant, en disant : « Vous êtes un pays très spécial, tout de même, avec un problème dont l'enjeu est crucial, l'un des plus importants en France… » – de fait, rappelez-vous Colbert, pour qui, après l'agriculture, le plus grand enjeu pour le pays était la façade maritime, pour des raisons militaires, certes, mais aussi des raisons de submersion.
La réponse fluviale est plus adaptée, parce qu'elle permet aux collectivités, aux EPCI en particulier, de s'adosser à des bassins et à des agences de l'eau. Dès lors, la réponse est plus collective et favorise la réalisation des projets. Mais on n'a jamais transposé les solutions du problème fluvial au problème maritime, où il n'y a pas de bassins versants, très peu d'agences de l'eau, et où les financements sont extrêmement compliqués. Sans compter qu'une bonne partie des financements est absorbée par la lutte contre les effets de l'érosion. Or, je le rappelle, elle n'est pas financée par le fonds Barnier. Cela veut dire que, soit vous faites du dur, soit vous ne faites rien. Et si vous ne faites rien, votre situation devient extrêmement compliquée. De sorte que, même dans votre propre dispositif, vous faites du gruyère.
L'analyse est donc imparfaite, et je ne suis pas sûr que la réponse aux risques soit suffisante. Parce que, de précipitation en précipitation – même si nous sommes aussi arrivés à de très bonnes réponses, grâce à l'intelligence des élus – on n'a pas résolu le problème de la continuité territoriale. Évidemment, La Rochelle est défendue, mais Aunis-Atlantique ne l'est pas, si bien que ceux qui habitent là feraient mieux d'habiter ailleurs. Autant le dire, huit ans après Xynthia.
Prenons un exemple : en Charente-Maritime, nous devons faire pour 260 millions d'euros de travaux pour remettre en état les ouvrages de protection existants, tels qu'ils ont été construits il y a cent ans. Quant à moi, sur l'île de Ré, j'en ai pour 100 millions, au moins. Or les financements sont en train de s'épuiser, puisqu'après la période de transfert de la compétence de prévention des inondations, nous allons entrer dans celle où les différents échelons nous répondront : « Ce n'est plus de ma compétence, donc ce n'est plus à moi de financer ». La région Nouvelle-Aquitaine commence à nous dire : « Je vous ai aidés pour la première partie mais, maintenant que la compétence a été transférée, comment voulez-vous que je vous aide encore ? » Les départements, chez nous, ne se retirent pas, grâce à l'amendement que nous avons voté pour qu'ils restent compétents pour la maîtrise d'ouvrage, mais finalement, en toute logique, ils pourraient se retirer. Et l'État annonce tranquillement que, vers 2024, il serait bon qu'il puisse se dégager. Bien sûr, on n'y croit pas, mais allez savoir…
Une dernière chose, enfin, est typiquement française : on a mis cinquante médecins autour du patient, si bien que, pour monter maintenant un projet de digue dans le cadre du PAPI 3, il faut avoir fait de très hautes études – que, bien sûr, je n'ai pas faites, comme beaucoup d'élus. Car les PAPI 3 imposent une logique imparable : vous ne pouvez pas organiser la défense d'un territoire sans prendre en compte les interactions avec ses voisins. Mais, d'étude en étude, certains cabinets en arrivent à nous répondre : « Finalement, je ne sollicite pas le marché, parce que c'est tellement compliqué que je préfère faire des pistes cyclables. » Même une piste cyclable au Mont-Saint-Michel sera plus simple à faire qu'une protection dans le cadre d'un PAPI. Les difficultés ne sont certes pas identiques partout : les responsables de certains territoires, qui ont les moyens, vous diront que tout se passe très bien. Ce sera plutôt le cas des agglomérations comme Bordeaux ou La Rochelle… Ou bien d'autres vous diront : « C'est pas grave, on a fait ça de nuit », comme en Vendée où, à un moment donné, ils ont monté des digues. « C'est fait, on n'en parle plus ».
Mais les territoires qui jouent le jeu se heurtent, dans la préparation de leurs projets, à des difficultés insurmontables. Si bien que, je vous le garantis, l'ADF ne croulera pas sous les projets. Il est même question, maintenant, d'établir des PAPI d'intention pour préparer le PAPI, qui lui-même sera peut-être mis en place un jour… Tout cela, huit ans après Xynthia.
Sauf que demain, une seule chose va compter : si l'événement se reproduit et fait des victimes, on ne demandera pas pourquoi la protection du territoire était compliquée, ni qui a écrit tel ou tel projet. On voudra un responsable. Or qui sera responsable ? Les collectivités l'ont parfaitement compris : on reprochera au maire de n'avoir pas évacué à temps, et à l'EPCI gestionnaire de la digue de ne l'avoir pas construite parce que, tout en ayant la connaissance du risque, il n'a pas été capable de la financer. Notre système institutionnel, vous le voyez, n'est pas adapté au risque.
Dernière difficulté : nous sommes très en retard en matière d'architecture du littoral. Alors que dans certains pays, on construit déjà des maisons flottantes ou sur pilotis, comme aux États-Unis, au Japon, ou aux Pays-Bas, où l'on a mis au point des systèmes parfaitement adaptés, pour nous, essayer de faire passer un projet de construction sur pilotis auprès des Bâtiments de France, en contradiction avec la volonté exprimée dans le PPRL, c'est tomber dans de sérieuses difficultés.
Des projets commencent bien à se mettre en place, mais nos architectes n'apportent pas encore de vraies propositions. Or le meilleur système face au risque, c'est avant tout la prévention, l'information et l'architecture en elle-même. Il devrait exister des obligations rendant impossible de construire aujourd'hui comme on le faisait dans le passé. Or il arrive, lors de réunions avec les services de l'État, que les intervenants ne soient pas d'accord entre eux sur la vision architecturale : vous présentez un projet pour un site protégé aux Bâtiments de France, ils vous donnent un avis conforme, mais ils refuseront toute autorisation de modifier le dispositif du bâtiment ou d'en augmenter la taille, alors même que la direction départementale des territoires et de la mer vous demande d'en rehausser le sol de 80 centimètres. Je connais ainsi des maisons où la hauteur de l'entrée a été nettement réduite, parce que l'on y a remonté la dalle de 45 centimètres, le toit restant au même niveau. Comme il faut bien trouver une solution, les services de l'État finissent par se montrer compréhensifs…
Il faut aujourd'hui prendre le temps de la réflexion sur ces incohérences, avec le recul nécessaire. Tout, jusqu'ici, n'a été que précipitation. Si l'on aboutit finalement à un dossier important, si des avancées sont acquises, restent l'incohérence des mesures prises d'un territoire à l'autre et le risque grave qui pèse toujours sur nombre d'entre eux.
Pour sortir de cette situation extrêmement préjudiciable, il faut faire évoluer les choses. Mais plus on s'éloigne de l'événement, plus sa mémoire s'estompe, et avec elle la conscience du risque. Et on a tellement décentralisé que l'on a donné des responsabilités énormes à des syndicats de gestion qui, à la rigueur, auraient pu gérer la salle sportive locale, mais certainement pas assumer la responsabilité de la protection des habitants. De toute façon, ils savent bien qu'ils ne pourront pas le faire. Quant au transfert de la GEMAPI, c'est une opération admirable : on a transféré aux collectivités la responsabilité d'effectuer 30 à 40 milliards d'euros de travaux, sans évaluation des charges. À cette question, l'État a répondu très clairement : « Je ne peux pas évaluer les charges, puisque ce n'est pas à moi d'intervenir. ».
En effet, et sans évaluation des charges, alors que c'est le plus gros transfert de compétences opéré au cours des dix dernières années. Donc, sans vouloir être sévère, la seule question que je pose est : dix ans après – nous sommes bientôt en 2020 – a-t-on répondu au problème ? On y a répondu partiellement.
Mais nos amis élus d'autres pays, ou les techniciens hollandais avec lesquels je travaille – vous devriez les auditionner un jour –, ne comprennent même pas comment notre système fonctionne. Ils ne comprennent pas, en particulier, le concept français de digue transparente, qui n'existe nulle part ailleurs. Lorsque l'on construit une digue, aux Pays-Bas, on l'élève à un niveau qui soit supérieur à celui des vagues qui peuvent déferler, et l'on assume le risque de vivre derrière – sans urbanisation galopante –, au-dessous du niveau de la mer, comme c'est le cas dans une bonne partie du pays.
En France, en revanche, notre système est tel qu'une nouvelle digue ne change rien au PPRL, parce que nous sommes d'abord préoccupés par une réflexion politique sur la loi « littoral » et sur l'urbanisation galopante. On essaie de gérer un problème d'urbanisation en même temps qu'un problème de risques. Les deux sont liés, évidemment, mais il faudra bien se demander, in fine, si l'on est encore en danger ou non. La confusion doit cesser. Si l'on veut l'arrêt de l'urbanisation, il faut le dire. Mais on ne sait pas délocaliser : les projets de délocalisation, depuis huit ans, se comptent sur les doigts d'une main. Dans les Landes, on a délocalisé deux choses : un bâtiment de surf et une cabane à frites. Et la région, bien sûr, s'oriente finalement vers la délocalisation et le repli stratégique, dont elle privilégie le financement. Pendant ce temps-là, 876 kilomètres de dunes et de digues restent exposés. La réponse n'est pas satisfaisante.
Je suis certes de parti pris, parce que je vis tous les jours sur ce territoire. Quand je me promène en Charente-Maritime, je vais partout, et tous les 30 kilomètres, la réponse au risque est différente. Ce n'est pas normal. Ceux qui ne font que passer sur la côte ne s'en soucient guère, peut-être, mais sauront-ils que l'hôtel où ils sont hébergés n'est pas défendu, qu'il n'y a pas eu de financement pour la digue, et qu'ils sont exposés à un risque majeur ? Voilà ce qui n'est pas normal.
La réflexion devrait donc prendre le recul nécessaire, au lieu de céder à la précipitation et aux complications inutiles, pour déterminer, à partir d'une évaluation complète, notre situation face au risque. Depuis huit ans, nous n'avons pas consulté de véritables experts littoraux. Je rappelle que toute la base des PAPI et des PPRL a été établie par nos inspecteurs qui, de même que leurs techniciens, étaient tous spécialistes des pays fluviaux. De sorte qu'aujourd'hui encore, pour prendre un exemple concret, la remise en état d'une maison après submersion marine est évaluée à 10 000 euros, parce que c'est le tarif dans le domaine fluvial, pour une inondation à l'eau douce. Je peux vous dire, pour avoir perdu ma maison, qu'avec 10 000 euros je n'aurais pas pu refaire la cuisine.
Quand vous devez construire une digue, un critère typiquement français s'impose : l'analyse coût-bénéfice. On vous dit : « Ne faites une digue que si cela en vaut la peine » et, pour que cela en vaille la peine, il faut que le coût des dégâts que causerait une submersion marine soit supérieur à celui de la digue. Vous pouvez construire une digue à un million d'euros si vous avez le nombre suffisant de maisons à 10 000 euros à protéger. Des critères complémentaires ont certes été définis, pour intégrer notamment le patrimoine et les interactions économiques, mais la valeur de la vie humaine n'entre toujours pas dans le calcul.
On vous dit ensuite qu'il faut une évaluation totale – vous faites cette digue ici, voulez-vous aussi en faire une autre ? –, et finalement l'ensemble du projet est compromis parce que le résultat de l'analyse coût-bénéfice est négatif. Commence alors une nouvelle négociation auprès de la direction générale de la prévention des risques, au niveau national, avec des calculs stratosphériques, pour essayer de faire comprendre que des vies humaines sont en jeu, parce que les gens qui vivent là ne peuvent pas être délocalisés, parce qu'un PPRL annonce le risque, qu'une digue est donc nécessaire, mais qu'elle est trop coûteuse par rapport au risque. C'est là que les Hollandais nous disent : « Il faut choisir. Si vous ne construisez pas de digues, dites aux gens d'aller habiter ailleurs. Si vous ne voulez payer ni les freins, ni les airbags, ne prenez pas la voiture. Ne restez pas entre deux résolutions, assumez votre risque. »
Je considère toujours qu'au niveau national, toutes appartenances politiques confondues, on n'a jamais assumé ce risque, parce qu'il impliquait de telles responsabilités politiques, pénales et financières que l'on a préféré le laisser aux élus locaux. Or ils ne peuvent pas prendre en charge une politique nationale. La DGPR vous dira le contraire, on vous parlera de bons résultats qui, c'est vrai, ont été obtenus. Pour moi, à l'île de Ré, tout ira bien, de même qu'à La Rochelle. Mais je n'irais pas habiter à Charron, ou dans un endroit semblable, parce qu'ils n'obtiendront pas la construction de leurs digues, et que s'ils devaient l'obtenir un jour, elles seraient incomplètes, pas assez financées et pas assez hautes.
Je voudrais ajouter, en complément de ce que vient de dire Lionel Quillet, une remarque sur l'aspect financier du problème. Lorsque le plan « digues » a été conçu, les uns comme les autres ont dit qu'il se monterait en France à un milliard d'euros, investi une fois pour toutes. Aux Pays-Bas, c'est un milliard d'euros tous les ans qui est budgété en faveur de la protection, ou simplement de la vie sur le littoral. Rien d'étonnant, alors, à ce que les Néerlandais que nous consultons partent en courant, devant notre refus d'assumer cette réalité financière.

Merci beaucoup pour cet échange très instructif. J'apprécie votre franchise, puisque notre objectif est de tirer le bilan des mesures prises depuis Xynthia. Il y a bien eu un avant et un après Xynthia. L'événement Irma a bien sûr ravivé les débats, dont nous devons, je crois, nous saisir. Car, au-delà des initiatives actuelles, notamment sur le trait de côte, il importe d'établir un bilan en vue du deuxième plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC). Or les expériences dont vous venez de nous faire part se retrouvent outre-mer : je partage votre sentiment d'une superposition des procédures et de la discontinuité territoriale qui en découle.

Vous avez surtout évoqué le problème des digues. On acceptait jadis le postulat qu'elles étaient infranchissables. Il faut admettre aujourd'hui que l'imprévisible peut survenir et que l'on n'est pas préparé à tout. Car Xynthia a été provoquée par la conjonction de phénomènes qui, somme toute, n'avaient chacun rien d'extraordinaire. Il est donc extrêmement compliqué de déterminer les dimensions adéquates pour un ouvrage de protection. Quel est votre avis sur la question ?
Entre la notion illusoire de digue infranchissable et celle de digue transparente, qui est actuellement la base des raisonnements de la DGPR, il y a un entre-deux. Quand les Hollandais viennent sur nos digues, un peu partout en France, ils nous disent « Trop petit ! ». Que voulez-vous, on les a faites en fonction d'une analyse coût-bénéfice… Il y a un risque technique, que l'on prend ou que l'on ne prend pas, il n'est pas le même en métropole et dans les outre-mer, etc.… Mais nos digues sont trop petites pour nous protéger, on a beau en construire, cela ne change pas grand-chose à la situation de départ. Nous devons y remédier.
Un deuxième problème est fondamental. Je me rappellerai toujours le directeur de cabinet d'un ministre, dont je tairai le nom, qui disait : « Le bon échelon, c'est l'EPCI ». Pourtant, quand il se passe quelque chose, seul le département est prévenu, et c'est lui qui est mis en alerte. D'ailleurs, sur la carte météo diffusée à la télévision, ce sont les départements en alerte qui apparaissent. Leurs administrations sont aussitôt sollicitées pour effectuer des surveillances et coordonner l'ensemble des collectivités. Comme celles-ci répondent qu'elles manquent d'agents compétents, ce sont les services départementaux qui mettent en place les engins nécessaires pour que le territoire reste approvisionné en électricité, etc. : les départements sont mobilisés pour l'ensemble des opérations. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) leur a ôté la compétence générale, mais quand un problème survient, seul le département est là. Les EPCI n'ont pas les moyens de réagir. L'État, bien sûr, répond très bien dans les situations d'urgence – nous étions soulagés, après Xynthia, de voir arriver pompiers et militaires –, mais le département était sorti du jeu.
Nous faisons tout pour l'y ramener, parce que tous les EPCI nous disent : « Ne nous laissez pas tout seuls ! ». Il y a certes des collectivités qui ont des moyens, la communauté urbaine de Bordeaux, par exemple, n'a pas besoin du département, mais ce n'est pas le cas des autres. Or toute la loi a été faite en dépit de ces besoins. On s'est trompé d'échelon : si l'on veut que les responsabilités soient exercées au plus près, il faut en donner les moyens aux collectivités locales. Or la plupart des EPCI littoraux ne les ont pas.
Pour en revenir aux digues, il est vrai qu'elles ne sont pas infranchissables. Le risque est absolu, il faut vivre avec. En France, on n'assume pas le risque, on vit contre, alors qu'on devrait vivre avec. Je suppose que les habitants de La Réunion ou de Tahiti vivent avec le risque, qu'ils le connaissent, et qu'ils savent qu'il est inutile de bâtir des ouvrages énormes. Au lieu de nous obstiner à faire quelque chose contre le risque, nous devrions admettre son existence. Or, plutôt que de chercher une solution, nous en restons à la question : « S'il y a des victimes, qui sera responsable ? » Et nos dirigeants se sont montrés soucieux, avant tout, que ce ne soit pas l'État. Je rappelle la phrase célèbre d'un directeur de cabinet ministériel : « La Faute-sur-Mer a été un grand traumatisme, le directeur adjoint de la direction départementale de l'équipement a donc été renvoyé devant la justice. » Après ce mot malheureux, la réunion s'est mal passée.
La réponse n'est pas juridique. Il s'agit de s'adapter au risque, en tenant compte du fait que, de Hendaye à Saint-Brévin-les-Pins en passant par l'île de Ré, la majorité des habitants ne résident pas là en permanence et ne connaissent de la mer que le spectacle pittoresque des vagues à marée montante. Quelles conséquences tirer du drame de La Faute-sur-Mer ? Que le maire est responsable ? Cela ne suffira pas.
La culture du risque est toujours très difficile à intégrer dans les textes. Nous en avons fait l'expérience lors des discussions avec les ministères pour l'élaboration de la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation, et ce malgré la présence de techniciens et d'agents de très bon niveau.
Au-delà de la culture du risque, se pose également le problème, évoqué par Lionel Quillet, de l'adaptation de l'urbanisme au milieu littoral. Il concerne bien sûr les maisons, mais aussi tout un pan de l'économie locale, comme l'hôtellerie de plein air, pour laquelle il faudra, à terme, trouver des solutions. Car délocaliser un camping situé au bord de la mer, d'ici dix ou quinze ans – si la stratégie nationale s'oriente dans ce sens –, ce sera très compliqué. Afin de trouver des solutions, l'ANEL s'efforce de mettre sur pied une mission, qui devrait être financée, avec des architectes urbanistes capables de concevoir les modalités de l'adaptation. Mais cela suppose l'inscription dans la loi de la culture du risque, et l'adaptation de l'ensemble des textes liés à l'urbanisme en milieu littoral.

Je comprends que la question de la responsabilité ait, jusqu'à présent, été la plus importante, puisque l'on doit tirer les conséquences de ce qui s'est passé pour prévoir l'avenir. C'est en particulier notre tâche de législateur.
Quelles orientations faut-il prendre désormais, à votre avis ? Doivent-elles s'inspirer de la culture du risque ? Car il est certain que l'on ne peut pas construire des digues partout, ni élever une barrière sur toutes les côtes françaises. L'eau entrera, il faut l'accepter.
Comment les collectivités locales peuvent-elles donc s'approprier cette culture du risque dont vous parlez, et qui me paraît essentielle ? Comment la faire adopter par la population ? Faudra-t-il transférer des activités économiques qui ne sont plus viables, pour les protéger, ainsi que les personnes ?
Serait-il également possible d'améliorer la qualité des matériaux des digues ? La technologie a-t-elle progressé depuis huit ans ? C'est une question qui m'intéresse particulièrement.
Le sujet est délicat, parce que l'on est toujours en équilibre entre l'acceptation et le refus du risque. La solution du repli stratégique s'imposerait, si on pouvait la mettre en oeuvre. Mais il y faudrait une loi, car on ne peut pas délocaliser d'autorité les habitations et les activités établies sur un site protégé ou classé, pas plus que l'on ne peut délocaliser des terres agricoles.
En plus, les coûts annoncés sont énormes : sachant que la construction de sa défense reviendrait à 100 millions d'euros, Lacanau s'est renseigné sur le coût d'un transfert, techniquement faisable. En apprenant qu'il se monterait à 300 millions, le maire a évidemment choisi de rester là où il était, avec sa population.
On en revient donc à ce que nous disent les Néerlandais et les experts de tous les pays soumis à des risques : « Vous avez un risque, vivez avec, sans l'accentuer par l'urbanisation. » Contrairement à ce que l'on pense, tous les maires ne tiennent pas absolument à urbaniser. On peut bloquer l'extension des zones à urbaniser, mais on doit pouvoir vivre à l'intérieur, la question étant de savoir si l'on peut encore y construire, et jusqu'à quelle hauteur…
Il y a donc là toute une politique à mettre en place, non pas une politique de techniciens, mais une politique de responsabilité. Non que les techniciens n'aient rien à nous apprendre. Pour moi, j'ai été auditionné neuf fois, mais je ne suis jamais parvenu à faire venir un Néerlandais en commission. M. Van der Meer, l'expert international sollicité aux États-Unis et écouté partout, n'a jamais été auditionné en France. Il a pourtant trente-cinq ans d'expérience, et a conçu le modèle des digues que l'on construit aux Pays-Bas.
Les digues ne sont pas la seule réponse. Un jour ou l'autre, l'eau entrera, l'événement se reproduira. Les populations y sont-elles préparées ? Pas suffisamment, et il faut y remédier. Mais certains élus, n'ayant pu faire construire dans leur collectivité les défenses nécessaires, se laissent aujourd'hui aller à une politique d'abandon, et attendent simplement la fin de leur mandat. Quant aux préfets qui proposent leur aide, ils se heurtent à la complexité des contraintes imposées par le PPRL, auxquelles s'ajoutent, de manière parfois incohérente, les normes des Bâtiments de France.
Il faut donc prendre le temps de tout remettre à plat. C'est le moment, je me permets de le dire, dix ans après, maintenant que le traumatisme est derrière nous. Il faut notamment travailler bien davantage à la prévention et à l'éducation. Quant aux matériaux et aux digues, nous avons les connaissances suffisantes, mais nous ne pourrons pas tout barricader, ni élever indéfiniment la hauteur des digues. Nous devons donc faire des choix, en faveur de la prévention, d'une part, mais aussi des choix urbanistiques : si une maison est exposée à la submersion, l'eau y entrera, puis elle en sortira. Mon arrière-grand-mère a connu les inondations à l'époque des sols en terre battue. Après le passage de l'eau, un nettoyage suffisait. Maintenant, les plaques de plâtre partent avec.
D'ici la prochaine inondation, qui se produira tôt ou tard, les populations doivent acquérir des réflexes : se réfugier dans le haut de la maison, prévoir une solution de secours, laisser toujours des volets de bois à l'intérieur pour ne pas être bloqué et pouvoir sortir par l'arrière. Avec mon fils dans les bras, j'ai pu sortir par une chambre, parce que mon arrière-grand-mère m'avait toujours dit, je l'entends encore : « Laisse toujours un volet ouvert à l'arrière. » Les volets roulants doivent donc être interdits, mais cette mesure, parmi tant d'autres, reste à prendre. On vous dit simplement que vous êtes dans une zone à risques, que la digue ne sert à rien parce qu'elle est transparente, et l'on vous invite à concevoir d'autres défenses. Mais toutes les maisons devraient être modifiées dès aujourd'hui selon ce principe-là, et les gens devraient vivre autrement. Avant de prendre une voiture, il faut passer un permis, et pour chaque voiture, il y a en général un même conducteur. Mais dans les maisons du littoral, les gens viennent en vacances. Quant aux hôtelleries de plein air, si l'une d'elle est touchée par une vague, ce sera un désastre.

Juste après Xynthia, on avait interdit la construction au-dessous de 3,2 mètres, et, entre 3,2 et 4,2 mètres, on devait prévoir un refuge, c'est-à-dire un étage ou une terrasse. Cette mesure-là était applicable immédiatement. N'a-t-on pas imposé des obligations analogues dans votre département ?
En site classé, l'architecte des Bâtiments de France s'y oppose. Donc, dans un premier temps, la maison ne se fait pas, et puis un jour on voit apparaître un toit-terrasse, on ne sait pas comment. Les obligations imposées après Xynthia valent d'ailleurs pour les nouvelles maisons, non pour les anciennes.
On a pris le problème à l'envers : on aurait dû être très contraignant envers les propriétaires des maisons existantes, quitte à exiger d'eux l'investissement de 10 000 à 15 000 euros pour l'aménagement de refuges, de même que l'on exige des conducteurs qu'ils payent la révision de leur véhicule. Faute que cette mesure ait été prise, la plupart des gens vivent encore dans des maisons dont ils connaissent le risque, mais où rien n'a changé. Pourtant, si l'eau arrive, je peux vous le dire pour l'avoir vécu, on n'a guère que huit à dix secondes pour s'échapper. Or les volets roulants sont toujours là, les maisons sont toujours fermées, et les refuges n'existent pas.
Quant aux nouvelles constructions, on arrive à peine à en faire, parce qu'elles donnent lieu à des contentieux inextricables. Ces difficultés sont certes spécifiques à l'île de Ré, mais en général le système ne fonctionne pas bien. Les normes concernant les établissements recevant du public, par exemple, ne sont pas respectées, sinon il serait impossible d'aménager un collège.
Les réponses diffèrent d'un territoire à l'autre, bien sûr. Vous ne recevrez pas la même, monsieur le rapporteur, à l'île de Ré et dans une commune du Pas-de-Calais.
Pour répondre à la première question de Mme Tuffnell, on doit tenir compte de plusieurs dimensions. Il est aujourd'hui très compliqué de demander à des élus de faire accepter à leurs administrés l'idée d'un repli stratégique. Comment un maire fraîchement élu pourra-t-il expliquer à un habitant de sa commune que, dans cinquante ans, sa maison ne vaudra plus rien et qu'il doit la reculer de cent mètres ? L'agenda politique est complètement décalé par rapport à l'agenda technique d'adaptation au risque. Toute une génération d'élus pourrait être sacrifiée, dans les circonscriptions du littoral, si on en venait à un dogme imposant le repli stratégique comme seule solution. C'est impossible.
Dans les projets qui sont actuellement en cours de construction ou d'élaboration, il faut vraiment tenir compte des prévisions d'élévation du niveau de la mer. Je pense par exemple au projet d'agrandir le port de Calais de 200 hectares sur la mer. Les fondations sont prêtes à accepter une élévation future – je dis bien future –, des digues du port ; nous sommes prêts, autrement dits, à nous adapter un jour à une élévation du niveau de la mer. On doit en général se dire que l'on ne sait pas bien ce qui se passera dans cinquante ou soixante ans, mais qu'il faut d'ores et déjà s'y préparer.
Si les réponses varient d'un territoire métropolitain à l'autre, la différence est encore plus grande entre la métropole et les territoires ultramarins. Je connais certaines communes, notamment à la Martinique, où l'on sait très bien que, d'ici à vingt ou trente ans, l'élévation du niveau de la mer aura fait disparaître 30 % de ces communes, dont les territoires sont très urbanisés. Donc la réponse, là-bas non plus, n'est pas la même.

Merci, monsieur le sénateur, monsieur le vice-président, pour vos présentations et pour votre connaissance parfaite des problèmes posés par les digues littorales. C'est évidemment un sujet très pointu, et l'on comprend qu'en Charente-Maritime, ce soit, depuis Colbert, une préoccupation majeure.
En Outre-mer, l'histoire du problème se sépare en deux périodes. La première a commencé, pour l'île de La Réunion mais aussi pour les Antilles, après Hyacinthe, le grand cyclone de 1980. Raymond Barre, alors Premier ministre, a instauré un vaste plan pluriannuel d'endiguement des ravines, reconduit ensuite tous les cinq ans, qui avait pour objet d'endiguer, de corseter l'ensemble des cours d'eau dans les îles exposées aux cyclones.
Jusqu'en 2007, l'État français a renouvelé ce plan, dont l'exécution était confiée à la DDE. Des bureaux d'études venaient spécialement, grâce à un financement de l'État à hauteur de 80 %, et 90 % pour les petites communes ; ces proportions se sont ensuite modifiées, en intégrant des financements européens. On a ainsi construit des digues très importantes, comme celles que vous avez vues à La Réunion.
Mais, en 2007, le rapport Balland a décidé que les digues étaient passées de mode et que l'on ne pouvait pas endiguer toutes les ravines. Ce dernier point n'est pas faux, mais il ne tient pas suffisamment compte des différences considérables que l'on trouve d'un littoral ou d'un cours d'eau à l'autre. Leurs rivages, leurs berges ne sont pas les mêmes, pas plus que les habitations voisines et les enjeux à protéger.
À la suite du rapport Balland a été adoptée, en 2007, la directive communautaire contre les risques d'inondation, à l'origine du programme général contre les risques d'inondation. Son application s'est soldée par l'arrêt complet de toute construction de digue. Depuis, on met en place des PAPI, mais les fonds publics ne sont plus destinés à l'endiguement. Si bien que nous avons abouti, dans les territoires d'outre-mer, au même problème que celui que vous venez de décrire : entre 1980 et 2007, on a construit des digues dans les communes dont les élus avaient su se montrer les plus pressants – pas forcément là où le risque d'inondation était le plus fort –, puis, en 2007, tout s'est arrêté. Depuis, il faut assurer exactement la même gestion, mais sans financements ni constructions nouvelles.
Quant aux digues existantes, leur entretien incombe désormais non à ceux qui les ont construites, c'est-à-dire à l'État, par l'intermédiaire de la DDE, mais aux EPCI. Les collectivités doivent, de surcroît, assumer un risque supplémentaire, parce qu'en réalité ces digues n'ont pas été prévues pour durer mais, souvent, pour aménager des voiries ou étendre des logements sociaux.
Certains EPCI se trouvent ainsi dans l'obligation de gérer des kilomètres de digues, sans beaucoup de sécurité et sans financements. Ils doivent, dans le même temps, gérer des espaces qui n'ont pas été endigués et qui aujourd'hui ne peuvent plus l'être, puisque cela est désormais interdit par les PAPI. La situation est donc particulièrement complexe. Elle l'est en Charente, mais aussi dans les départements d'outre-mer. Leurs digues maritimes sont évidemment différentes des digues littorales, mais elles posent des problèmes analogues.
Quant à la réponse de l'État… j'en parlais lors de notre précédente réunion avec le préfet de Guadeloupe ; comme je lui disais que les plans de prévention des risques (PPR) et les PPRL n'étaient pas de bons instruments de gestion du risque, il m'a répondu à peu près : « Mais si, voyez, nous avons mis en place un PPR, et le risque qui s'est réalisé y était exactement conforme. »
Certes, il s'agit de phénomènes aléatoires, et il est bien normal que ceux que l'on prévoit correspondent à ceux qui se produisent. Mais le risque ne mesure pas au phénomène lui-même, mais à ses conséquences et à ses enjeux. L'important n'est pas que ce qui arrive corresponde exactement à ce que l'on a dessiné sur une zone en rouge, en bleu ou en noir – une modélisation suffit pour cela et, heureusement, nous savons en faire –, mais que les conséquences du phénomène soient prévenues. Or, aujourd'hui, aucun projet de PPR ne gère réellement les conséquences, et l'État n'assure en réalité, par les PPR, que la prévision du risque. Je n'ai pas voulu débattre avec le préfet parce que ce n'était pas le lieu, mais, à la Réunion comme à Saint-Martin, les PPR ne gèrent pas les risques, ils ne font que prévoir les phénomènes dangereux.
La question que je voudrais vous poser est donc celle-ci : pensez-vous que, pour certaines zones – car je ne dis pas que les PPR soient inutiles partout, ils sont adaptés par exemple aux grandes vallées, avec des risques de crues lentes que nous connaissons et que nous maîtrisons bien –, pour des situations exceptionnelles, du fait de risques complexes de tempête et de submersion, comme il s'en produit à La Réunion ou aux Antilles lors des marées de tempête, avec des vents catastrophiques qui provoquent le débordement des cours d'eau par des embâcles aux embouchures – situations pour lesquelles il faut évidemment une gestion complète du risque, qui ne se limite pas à le cartographier –, pensez-vous que l'on puisse imaginer, pour des cas particuliers comme ceux des littoraux des îles tropicales, exposés au risque de passages cycloniques, un nouveau système de gestion du risque, plus globale que celle des PPR ? Pourrait-on éventuellement appliquer des PAPI littoraux ? Ne serait-ce pas un mode de financement possible pour certaines zones ?
Il faut tout réévaluer. Il va bien falloir que la DGPR produise l'évaluation réelle des enjeux, et en établisse une cartographie qui ne représente pas simplement les phénomènes aléatoires prévus par différentes couleurs. Il va bien falloir aligner les chiffres. Cela fait, on envisagera les réponses à donner.
Votre analyse, monsieur Lorion, est parfaite. Je vous remercie pour sa formulation, plus adéquate que les miennes. Il faut évaluer les véritables enjeux et ne pas avoir peur de chiffrer. Il faut assumer le risque. Nous ne l'assumons pas. Je pense qu'à la Réunion ou aux Antilles, vous l'assumez mieux parce que vous vivez avec, que vous savez qu'il se réalisera et que vous ne pourrez pas faire face. En métropole, on ferme les yeux, et c'est le pire : « Prends la voiture, fais comme tu peux, tu as des airbags –… s'ils ont été financés – et roule, même si tu n'as pas le permis. » Je pense qu'il faut une réévaluation.

Merci, monsieur, pour le temps que vous nous avez consacré. Nous auditionnerons les responsables d'autres systèmes de prévision des risques, comme de celui des Pays-Bas, que leur proximité rend particulièrement intéressants pour nous, mais également ceux de certains systèmes américains.
Les PAPI littoraux, monsieur Lorion, seraient bien sûr la solution idéale pour parvenir à une vision globale. Car la question qui nous ramène à la réalité des choses est toujours celle du financement. Elle a été largement évoquée au Sénat ces derniers temps. On a imaginé notamment un transfert du fonds Barnier pour la prévention de ces risques.
Car une dimension reste aujourd'hui peu évoquée : nous avons parlé d'aléas, mais il ne faut pas oublier – ce n'est pas au géographe que vous êtes que j'apprendrai quelque chose à ce sujet – l'aléa prévisionnel intégrant des données géographiques : cette dimension est celle de l'érosion côtière.
Je m'évertue à répéter à la ministre que l'érosion côtière crée une situation de risque. Comme je le dis souvent, même si les agents de l'État n'aiment pas l'entendre : l'érosion d'aujourd'hui, c'est la submersion de demain. Nos systèmes préventifs sont définis en fonction de l'évolution géographique d'un territoire, telle que la prévoit notamment le comité national de suivi pour la gestion du trait de côte. On peut établir une cartographie qui nous indique aujourd'hui ce qui sera submergé demain, et intégrer cette prévision dans une stratégie. C'est pour cela que je m'évertue à dire qu'il s'agit vraiment d'un dossier stratégique, concernant un risque.
Le point délicat, vous le savez tous, est que si l'on identifie un risque, l'État doit intervenir pour sa prévention. Il sait le faire, bien sûr. J'en ai vu plusieurs exemples dans mon département, notamment une digue qui vient d'être refaite et dont j'avais visité le chantier avec le préfet. L'État est capable de refaire deux kilomètres de digue dès lors qu'il est responsable de l'ouvrage. Le syndicat gestionnaire ayant attiré l'attention sur le risque de submersion directe, le risque de brèche, qui exposait la commune, l'État a reconnu sa responsabilité de propriétaire et s'est montré capable de refaire deux kilomètres de digue, en une seule opération. Il est donc compréhensible qu'il ne veuille pas disperser sa responsabilité sur tout le littoral métropolitain et ultramarin, en l'absence d'évaluation précise des coûts.
Cela dit, je profite de cette mission pour insister une fois de plus sur un risque important à intégrer dans nos prévisions : celui de l'érosion côtière. Vous le savez, madame la présidente, j'ai été maire d'une commune dont j'aurais aimé qu'elle fût construite cent mètres plus loin du trait de côte actuel. Parce qu'en cent ans, bien des choses se sont produites, et qu'un risque réel pèse aujourd'hui sur ses habitants, qui n'y peuvent rien.
Ce risque doit être intégré dans nos dispositifs… sans sacrifier les élus. Car, en tant que sénateur, je ne peux que défendre nos élus locaux, qui ne peuvent expliquer seuls à leurs habitants la nécessité de déplacer leurs maisons. L'État doit se mobiliser et participer à cette explication.
J'en reviens enfin aux problèmes d'architecture. Nous serons bientôt confrontés à la question de la loi « littoral », à l'occasion probablement de l'examen du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN). Les élus doivent avoir les moyens d'adapter leur urbanisme, je ne dis pas de construire à outrance, mais d'autoriser des constructions adaptées aux risques dont parlait Lionel Quillet. Des maisons en bord de mer ne peuvent plus, par exemple, avoir leur installation électrique à moins d'un mètre de haut. Cette interdiction suffira à éviter des drames. Mais ces dossiers doivent faire l'objet d'examens très minutieux de la part d'experts et de techniciens.
L'hôtellerie de plein air requiert elle aussi un travail normatif important, parce qu'il serait très dangereux que l'eau entre dans un camping, même si le principal est qu'elle en ressorte sans avoir fait de victimes. C'est pourquoi il est crucial, sans imposer d'interdiction complète, de définir les conditions auxquelles cette activité peut être exercée.

L'exemple de la plaine du Tech, dans le Roussillon, est intéressant : on y voit encore des maisons du XIXe siècle construites sur pilotis parce que les crues du Tech passaient, pendant un jour ou deux, puis s'en allaient, et les maisons sont toujours là, malgré les inondations.

Parmi les nouvelles pistes scientifiques en matière de reconstruction se trouve l'idée de construire en renforçant la résilience naturelle des territoires, ce qui passe parfois par des décisions qui peuvent paraître contradictoires, comme, dans certains cas, la déconstruction d'ouvrages. Je voudrais savoir si une telle démarche est réellement enclenchée, et si elle est partagée par les élus du littoral.
On dispose aujourd'hui, pour certaines façades maritimes, d'une vraie analyse du risque intégré terre-mer, qui indique quels sont précisément les risques et les mouvements du trait de côte, de cette ligne qui varie régulièrement. Comment intégrer ces risques, sans forcément construire des ouvrages qui pourraient l'aggraver ? Car on a bien constaté qu'en réalité, lorsque l'on touche au littoral, on aggrave la situation. Il y a là un vrai point de clivage, je pense, entre les pistes de protection durable pour l'avenir. J'aimerais connaître votre avis sur ce sujet.
Deux cas sont à distinguer. S'il s'agit de territoires habités, on rencontre le problème que nous venons d'évoquer. Quel choix faire ? Vous parlez de résilience, j'emploierais plutôt l'expression de stratégie de repli. Elle est possible, pourvu que l'on soit capable de reconstruire à proximité, même s'il est compliqué de faire comprendre aux gens qu'ils doivent quitter leur pré carré de littoral avec vue sur mer, et s'éloigner de 500 ou 600 mètres. À supposer, bien sûr, que la loi « littoral » autorise de nouvelles constructions. Les capacités de résilience, voire de reconstruction d'un territoire dépendront donc aussi des assouplissements que l'on apportera à cette loi. Lorsqu'elle a été votée, il y a trente-deux ans, on n'entendait jamais parler de repli stratégique, d'érosion du trait de côte, ou de submersion marine. Il faut tenir compte de cette évolution naturelle.
Dans les territoires inhabités, cette résilience est très bien étudiée par le conservatoire du littoral, qui s'attache à la favoriser, notamment par des programmes d'endiguement naturel, comme le programme architectural Adapto. On accepte donc le fait que la mer puisse entrer sur le territoire, tout en s'assurant qu'elle ne dépasse pas, dans un premier temps, une limite donnée. Il est donc plus facile de favoriser la résilience des territoires naturels. Dans les zones habitées ou économiquement développées, c'est beaucoup plus compliqué, et je n'appelle pas cela de la résilience, mais du repli.
Un travail a été fait sur ces questions, notamment par le groupement d'intérêt public (GIP) Littoral Aquitain. Un appel à projets a également été lancé par l'État il y a deux ans, et des réponses ont été proposées par certains territoires, dont le littoral aquitain. Mais les services de l'État restent depuis silencieux, et les moyens n'ont pas été mis en oeuvre. C'est le conservatoire du littoral qui est aujourd'hui le principal défenseur de sa résilience.

Je vous remercie. Nous sommes preneurs de toute réponse écrite et de tout complément d'information. Je serais également intéressée par les contacts évoqués par M. Quillet, puisque nous souhaitons entendre les acteurs des politiques publiques d'autres pays, d'Europe ou d'ailleurs. Tout exemple utile serait le bienvenu.
L'audition s'achève à dix-neuf heures cinq.
Membres présents ou excusés
Réunion du mardi 22 mai 2018 à 17 h 30
Présents. - Mme Claire Guion-Firmin, M. Yannick Haury, Mme Sandrine Josso, M. David Lorion, Mme Sophie Panonacle, Mme Maina Sage, Mme Frédérique Tuffnell
Excusé. - M. Bertrand Bouyx