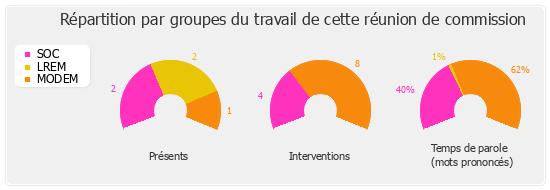Commission d'enquête sur l'impact économique, sanitaire et environnemental de l'utilisation du chlordécone et du paraquat comme insecticides agricoles dans les territoires de guadeloupe et de martinique, sur les responsabilités publiques et privées dans la prolongation de leur autorisation et évaluant la nécessité et les modalités d'une indemnisation des préjudices des victimes et de ces territoires
Réunion du jeudi 11 juillet 2019 à 15h30
Résumé de la réunion
La réunion
Jeudi 11 juillet 2019
La séance est ouverte à quinze heures vingt-cinq.
Présidence de M. Serge Letchimy, président de la commission d'enquête
————
La commission d'enquête sur l'impact économique, sanitaire et environnemental de l'utilisation du chlordécone et du paraquat, procède à l'audition de M. le professeur Jérôme Salomon, directeur général de la santé, Mme Joëlle Carmes, sous-directrice de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation au sein dela direction générale de la santé (DGC), Mme Barbara Lefèvre, chargée de dossier au bureau de l'alimentation et de la nutrition, en charge du plan chlordécone et des produits phytosanitaires, et M. François Klein, chef de la mission outre-mer de la DGS.

Mes chers collègues, nous accueillons, pour notre deuxième audition de l'après-midi, M. le professeur Jérôme Salomon, directeur général de la santé, qui est accompagné de Mme Joëlle Carmes, sous-directrice de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation, de Mme Barbara Lefèvre, chargée de dossier au bureau de l'alimentation et de la nutrition, en charge du plan chlordécone et des produits phytosanitaires, et de M. François Klein, chef de la mission outre-mer de la DGS.
Nos auditions sont ouvertes à la presse et diffusées en direct sur un canal interne. Les vidéos seront consultables sur le site de l'Assemblée nationale, ainsi que le compte rendu des différentes réunions.
Avant de vous passer la parole, monsieur Salomon, je dois, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, vous demander de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Les personnes auditionnées prêtent successivement serment.
Je suis avant tout un médecin attentif à la souffrance de chacune et de chacun, à l'écoute des populations en tant que spécialiste de santé publique. Professeur de médecine, je suis aussi un scientifique, ardent défenseur de la rigueur intellectuelle, de l'indépendance de l'expertise et de la transparence, ainsi qu'un enseignant qui aime partager et expliquer.
Concernant le chlordécone je suis personnellement très engagé, depuis ma nomination en janvier 2018 comme directeur général de la santé. Je me suis rendu à deux reprises aux Antilles. J'ai eu l'honneur d'y accompagner M. le Président de la République et ai aussi activement participé au premier grand colloque international organisé durant quatre jours sur place en octobre 2018. J'avais alors demandé au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), Roger Genet, au directeur général de Santé publique France, François Bourdillon, et au président de l'Institut national du cancer (INCa), Norbert Ifrah, d'être présents, ainsi qu'aux équipes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Ce colloque a été très riche, avec des discussions passionnantes entre les scientifiques impliqués, la population venue en très grand nombre – jusqu'à 600 personnes –, les associations, les professionnels de santé, les hospitalo-universitaires, la presse et, bien sûr, les élus.
En tant que directeur général de la santé, je pilote avec le directeur général de l'Outre-mer le comité de pilotage national chlordécone et communique régulièrement avec les responsables des comités de pilotage locaux, les préfets et les deux directions générales des agences régionales de santé.
Je souhaite rappeler d'emblée l'implication forte et ancienne et les actions du ministère chargé de la santé, en particulier de la direction générale de la santé. Elle est mobilisée depuis 1999, par l'intermédiaire de ses services locaux – les services déconcentrés appelés directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) à l'époque. C'est grâce aux analyses réalisées par la DDASS, dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux, que la présence de chlordécone dans l'eau a été constatée. La DDASS de Martinique, puis la cellule d'intervention en région (CIRE) Antilles-Guyane, le service local de Santé publique France, qui à l'époque s'appelait Institut de veille sanitaire (InVS), ont lancé en octobre 1999 une alerte, en pointant les autres sources de contamination alimentaire par le chlordécone.
C'est encore la DDASS qui, en 2001, a lancé une étude pour mettre en évidence le transfert de la contamination au chlordécone des sols vers les végétaux cultivés. Le rapport présenté en juillet 2002 en Martinique confirmera la contamination des légumes racines au chlordécone et servira de fondement à la démarche d'évaluation des risques mise en oeuvre par les agences sanitaires – à l'époque, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et l'InVS –, saisies par les ministères de tutelle à partir de juillet 2002. Dès le début des années 2000, des actions ont été mises en oeuvre au niveau local, sous l'égide des préfets. Les administrations centrales sont intervenues pour solliciter des expertises auprès des agences sanitaires nationales, mais également pour prendre des mesures réglementaires. La DGS a contribué à la réalisation des études et des expertises auprès des agences sanitaires nationales. Bien entendu, les organismes de recherche ont été associés, avec des enjeux de définition et de prises de mesures réglementaires, notamment la fixation de limites maximales de résidus (LMR), en lien avec les autres administrations centrales concernées. Les plans nationaux sont venus compléter et renforcer les actions mises en place au niveau local, sous l'égide des préfets. Les actions de l'État se sont enchaînées sur la base des avancées des connaissances, le plus souvent à l'initiative du ministère chargé de la santé.
Ce ministère assure, depuis 2008, la lourde et délicate mission de coordonner au niveau national le dossier du chlordécone aux Antilles. La direction générale de la santé a piloté les deux premiers plans nationaux chlordécone et copilote avec la direction générale des Outre-mer (DGOM) le troisième plan, qui est en cours depuis 2014. Aujourd'hui, la direction générale de la santé est fortement engagée et mobilisée pour coordonner les actions de lutte contre cette pollution et mène une politique de santé publique renforcée pour protéger les populations antillaises des impacts sanitaires du chlordécone. Elle s'est avant tout attachée à préserver la santé de la population antillaise et à défendre la santé publique, en portant une attention particulière, dans les études menées, au respect des principes d'indépendance de l'expertise, de rigueur scientifique et de transparence à l'égard du public. C'est grâce au résultat des études et des travaux menés depuis vingt ans par les agences sanitaires et les organismes nationaux de recherche, enrichis au fur et à mesure de l'amélioration des connaissances scientifiques et des innovations techniques, que nous disposons aujourd'hui d'une vision de plus en plus précise des effets sanitaires de cette mollécule.
Nous avons pu définir des mesures de santé publique et de protection de la population, qui reposent sur des données scientifiques fiables. Les populations les plus à risque ont pu être identifiées : femmes enceintes et jeunes enfants, en particulier. Les aliments les plus contaminés sont aujourd'hui connus, ce qui a permis d'émettre des recommandations de consommation visant à réduire l'exposition alimentaire des populations au chlordécone, en veillant – et j'y tiens personnellement – à lutter contre les inégalités sociales, territoriales et d'accès à l'information, dans une politique volontariste de réduction des risques et d'éducation de tous à la santé. Des dispositifs spécifiques de surveillance des populations ont été mis en place : un registre des cancers en Guadeloupe et en Martinique ; un registre des malformations congénitales des Antilles (Remalan), un dispositif de toxico-vigilance des Antilles, ainsi que des mesures ciblées sur le suivi médical des travailleurs agricoles.
La prévention, la protection des populations, la promotion de la santé et l'éducation de tous à la santé sont les principes fondamentaux de la politique de santé publique menée contre les effets du chlordécone. Je suis très attaché à la transparence sur ce sujet et veille à ce que la population soit informée au mieux sur la base d'éléments scientifiques solides. Le colloque scientifique et d'information sur le chlordécone qui s'est tenu en Martinique et en Guadeloupe, en octobre dernier, en a été une belle illustration. Il a connu un vif succès populaire.
Malgré toutes les mesures qui ont été mises en oeuvre aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que cette pollution est un scandale environnemental, comme l'a reconnu M. le Président de la République lors de son déplacement aux Antilles en septembre, et que l'État doit prendre sa part de responsabilité.
La lutte contre la pollution par le chlordécone est un sujet profondément interministériel qui doit associer au même niveau d'implication et d'engagement toutes les administrations de l'État, chargées en particulier de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, de l'économie, de la recherche et des Outre-mer. Il reste beaucoup à faire pour améliorer encore nos connaissances scientifiques et préserver au mieux les populations antillaises des effets de cette pollution. L'un des enseignements des différents plans qui se sont succédé est que rien ne se fera de façon efficace sans associer à nos travaux tant les professionnels concernés – professionnels de santé, de l'agriculture, de la pêche – que la population antillaise elle-même, pour qu'elle y adhère, puisse faire des propositions, participer et s'approprier les recommandations. Nous allons nous y atteler dans les mois et les années à venir. Nous avons besoin de construire avec vous, parlementaires, avec les élus locaux, les collectivités territoriales et la population des Antilles. Vous pouvez compter sur mon engagement fort.

S'agissant des politiques de santé publique, quelles sont les raisons du délai entre l'interdiction du produit en 1990, l'interdiction de son utilisation aux Antilles en 1993 et la mise en place des plans chlordécone à partir de 2008 ? Quelles ont été les mesures prises à partir de 1990 ?
La politique de santé publique concernant le chlordécone repose sur trois volets : l'amélioration des connaissances, la réduction des expositions et la surveillance. Comme vous le savez, ces travaux sont en place depuis vingt ans. La connaissance des impacts sanitaires du chlordécone s'affine depuis ce temps, grâce aux études mises en place par le ministère de la santé. Par exemple, l'exposition au chlordécone est associée à des effets sur le déroulement de la grossesse, avec un surrisque d'accouchement prématuré, et sur le développement de l'enfant, avec un moins bon score du neurodéveloppement du nourrisson. Ces connaissances ont été admises grâce à l'étude de cohorte mère-enfant Timoun, lancée par l'Inserm en 2004, qui a confirmé les effets de perturbateur endocrinien du chlordécone.
Nous savons que le chlordécone a des propriétés hormonales et que cette molécule est classée actuellement comme cancérogène possible, du groupe 2B, par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). C'est pourquoi les recherches de l'Inserm se sont focalisées d'emblée sur ce que l'on appelle les cancers hormonodépendants, en particulier sur le cancer de la prostate, qui était, comme vous le savez, une préoccupation majeure aux Antilles. L'Inserm conduit l'étude Karuprostate en population générale, en Guadeloupe, depuis 2004, qui a montré que le risque de survenue du cancer de la prostate était plus important chez les hommes dont la concentration en chlordécone dans le sang est la plus élevée. Il est cependant nécessaire de quantifier le surrisque, c'est-à-dire d'estimer le nombre de cas de cancers de la prostate attribués au chlordécone sachant qu'il existe d'autres facteurs de risques, l'âge, par exemple, les facteurs génétiques ou l'alimentation – le professeur Multigner vous a aussi présenté aussi ses travaux.
L'Inserm poursuit ses recherches sur ce cancer, avec l'étude de cohorte KP-Caraïbes, constituée de cas incidents et suivie prospectivement en Guadeloupe et en Martinique. Nous sommes actuellement à 300 cas incidents inclus annuellement, pendant les six années consécutives de l'étude, avec un effectif final attendu de 1 500 à 1 800 cas. Cette étude s'intéresse à l'influence du chlordécone, mais aussi à tous les autres facteurs génétiques, cliniques et environnementaux et à l'évolution de la maladie – survie sans récidive et survie sans progression de la maladie.
Nous savons également que la mortalité des travailleurs de la banane est globalement proche de la mortalité observée dans la population générale antillaise. Ces résultats ont été admis grâce à l'analyse des données de mortalité de la cohorte de travailleurs qui comprend 13 417 exploitants agricoles et salariés agricoles en activité dans une exploitation bananière entre 1973 et 1993 en Guadeloupe et Martinique : 5 692 décès ont été dénombrés sur la période 1973-2013. Il s'agit des premiers résultats de l'étude de mortalité qui porte sur la période 2000-2015. Ces données préliminaires sont susceptibles d'être affinées, notamment avec des données antérieures à 2000. L'analyse de la cohorte se poursuit, dans le cadre du programme Matphyto, que vous connaissez, pour étudier l'exposition, en croisant les données de mortalité avec les données d'exposition du chlordécone, afin de définir des scores d'exposition à la mortalité en fonction du degré d'exposition. Ce travail est en cours et devrait être terminé l'année prochaine.
Une étude de morbidité doit débuter dès l'année prochaine, grâce à l'utilisation des informations des registres des cancers et à leur croisement avec les bases de données médico-administratives, pour identifier les excès de risques de certaines pathologies chroniques – les pathologies neurodégénératives et les cancers.
Le deuxième axe, monsieur le président, la réduction des expositions…

Monsieur le directeur général, excusez-moi de vous interrompre. J'ai bien vu que vous avez préparé vos réponses, mais la rapporteure vous a posé une question très précise. Quelles sont les raisons du délai entre l'interdiction du produit en 1990, l'interdiction de son utilisation en 1993 et la mise en place de plans chlordécone à partir de 2008 ?
Je vous entends, monsieur le président. Dans la mesure où nous parlions de politique de santé publique, je tenais à vous la rappeler. Sur le délai, il y a une évolution temporelle très importante à mentionner. Vous l'avez dit : 1990-1993 correspond à la période de fin d'utilisation du chlordécone et 2008 au premier plan national chlordécone. Au cours de cette période, c'est l'alerte sanitaire qui a prévalu. La présence de chlordécone a été constatée aux Antilles dans des prélèvements d'eau effectués par la DDASS dès 1998. Auparavant, je n'ai pas trace d'une alerte causée par un autre signal. Comme vous le savez, les services de la DDASS étaient en charge du contrôle de la qualité des eaux. Ces prélèvements nécessitaient des techniques particulières. Avant 1990, il n'existait pas d'analyse technique de ce niveau. C'est donc grâce à ces progrès et en particulier à la capacité qu'avaient les laboratoires des DDASS des Antilles à rechercher les composés organochlorés que les experts du service du ministère de la santé ont, de façon très adaptée, voulu comprendre la cause de ce bruit de fond. Grâce à leur alerte, très rapidement, la présence de chlordécone a été démontrée. Immédiatement, des actions ont été engagées, notamment en Guadeloupe, pour distribuer de l'eau dépourvue de risque. C'est bien en 1998 qu'a eu lieu l'alerte eau.
Dès 1998, les inspections générales se sont rendues sur place et le rapport Balland-Mestre-Fagot, sur l'évaluation des risques liés à l'utilisation des produits phytosanitaires en Guadeloupe et Martinique, a été publié au mois de septembre 1998, mettant en avant les risques liés à l'utilisation des pesticides dans les deux départements et formulant des recommandations visant à en améliorer la connaissance et à structurer l'action. À la suite de ce rapport, les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement ont demandé en novembre 1998 aux préfets de la Guadeloupe et de la Martinique d'élaborer un plan d'action pour chaque département. En 2001 a été réalisé un rapport d'évaluation de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l'inspection générale de l'environnement (IGE) sur les risques liés à l'utilisation des produits phytosanitaires. Il soulignait que les services de l'État avaient réagi rapidement, de manière coordonnée, sous l'impulsion du préfet, dès que la pollution au chlordécone avait été confirmée.
Dès le début des années 2000, des actions locales ont donc été mises en place sous l'égide des préfets. Les administrations centrales sont intervenues pour solliciter des expertises nationales, mais aussi pour prendre des mesures réglementaires : étude sur la contamination des aliments en 2002 et saisine de l'AFSSA, saisine de l'InVS dès 2002, arrêtés de limite maximale de résidus en 2005. Comme vous le savez, la direction générale de la santé a ensuite piloté les deux premiers plans, dès 2008 et copilote le troisième.

Monsieur le directeur général, vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous ai interrogé sur les mesures mises en place à partir de 1990 ; or vous avez seulement parlé de celles qui ont été prises à partir de 1998.
Pour la simple raison que la première alerte sur la présence de chlordécone dans l'eau, qui faisait courir un risque potentiel pour la santé humaine, est venue de la DDASS de Guadeloupe et de Martinique en 1998.

Entre 1990 et 2008, dix-huit ans se sont écoulés. Ce que nous essayons de comprendre, c'est ce qui s'est passé pendant cette longue période. Les prélèvements en 1998 ont été le déclencheur d'un processus, qui a vu la publication du rapport d'Éric Godard, lequel a donné le signal d'alarme. Il a également fallu la mobilisation de scientifiques – je pense au professeur Belpomme –, qui ont été des lanceurs d'alerte. Ce délai ne vous semble-t-il pas trop important, d'autant que deux rapports avaient été faits – les rapports Snegaroff en 1977 et Kermarrec en 1980 –, qui déjà relevaient la persistance du chlordécone dans le sol ? Est-ce que ces délais ne vous semblent pas trop importants face à un tel drame ?
En 1975 s'est produit un accident industriel gravissime, une exposition massive aiguë à la molécule du chlordécone, qui a eu des conséquences très graves aux États-Unis.

Je parlais, pour ma part, du rapport Snegaroff, un ingénieur de l'INRA. En Virginie, ce n'était pas un accident. Il n'y a jamais eu d'explosion d'usine.

En effet, mais de manière très ponctuelle. L'alerte était lancée depuis bien longtemps, malgré les autorisations, dont vous n'avez bien sûr pas la responsabilité.
Si la fin de l'utilisation aux Antilles remonte à 1993, force est de constater qu'il n'y a eu aucune alerte sanitaire avant celle de la DDASS. Depuis lors, nous avons beaucoup progressé, pour plein de raisons, sur tous les sujets de sécurité sanitaire et de santé publique. Mais, pour qu'il y ait une réaction de santé publique, il faut qu'il y ait un signal populationnel. Parce que les services de la DDASS sur place ont poussé l'investigation pour rechercher l'origine du toxique dans l'eau – ils ignoraient alors qu'on pouvait trouver du chlordécone dans l'eau –, ce signal inédit a conduit à des prises de mesures réglementaires et de protection des populations, puisque des mesures de réduction de l'exposition de la population à l'eau ont été prises. Par la suite, ils ont décidé d'élargir leurs investigations sur la présence de chlordécone dans d'autres sources, notamment dans la source alimentaire. Les choses se sont enchaînées localement, et beaucoup de mesures ont été prises par les préfets à la demande de l'État. Puis il y a eu des demandes d'investigations complémentaires et de saisine des expertises nationales, qui ont débuté dès les années 2000. La seule période où il n'y a pas eu de signal, c'est entre la fin de l'utilisation en 1993 et la première alerte lancée par les services du ministère de la santé en 1998.
Après 1998, on voit s'enchaîner les demandes d'expertise, d'investigation, les mesures réglementaires, la saisine des agences nationales, la saisine de Santé publique France, la mise en place de tous les outils de surveillance que je vous ai énumérés tout à l'heure. Sur l'aspect santé, la réaction a été rapide dès l'alerte. Elle a été rapide aussi bien pour l'eau que pour les aliments. Les Antillais ont été informés qu'il fallait faire attention à certains aliments. La saisine des agences sanitaires a également été rapide. Les agences nationales ne connaissant pas ce produit, elles ont progressé avec l'évolution des connaissances scientifiques. Toutes les études mises en oeuvre sur place – études de cohorte, d'imprégnation et de toxicovigilance – ont permis d'affiner grandement l'expertise et de proposer des mesures de plus en plus adaptées à la population.

Monsieur le directeur général, vous avez bien présenté la chronologie. Je me souviens bien de la découverte de la pollution de l'eau en 1998, puisque c'était chez moi, à Trois-Rivières, que la première contamination a été décelée. Trente ans après l'interdiction de vente, nous savons que le chlordécone a contaminé toute la chaîne alimentaire et que le principal mode de contamination est alimentaire, ce qui a imposé une surveillance accrue de nos aliments. Comment expliquer que, trente ans plus tard, nous n'ayons pas sur place des moyens suffisants de contrôle, soit des laboratoires appropriés permettant de déceler la présence de chlordécone et de le mesurer, dans les légumes racines, le sang, l'eau ou encore les animaux ? Le plus souvent, les échantillons sont envoyés dans l'Hexagone. Par exemple, pour l'eau, il y a un décalage de pratiquement deux mois entre le moment du prélèvement et celui des résultats. Pour assurer la protection sanitaire et un véritable contrôle des produits, il est important que nous puissions réagir très vite. Or nous n'avons pas les moyens suffisants pour déceler et doser le chlordécone sur place.
Madame la députée, vous avez raison de rappeler le caractère rémanent de ce toxique. Vous le savez mieux que moi, il y a une imprégnation importante sur l'ensemble du territoire. Malheureusement, elle a également été repérée parmi la population, puisque les études d'imprégnation que nous avons menées démontrent que l'on retrouve du chlordécone chez une part très importante de la population, à des niveaux très faibles heureusement, mais néanmoins préoccupants, dans la mesure où l'on ne devrait pas en retrouver du tout.
La sécurité de l'eau est assurée par les services de l'agence régionale de santé (ARS). Il est de la responsabilité du ministère de la santé de déterminer sa qualité, sa turbidité, son état chimique ou micro-biologique. Pour ce qui est des aliments, nous savons aujourd'hui, après les études d'exposition alimentaire qui portaient sur les différentes sources de contamination alimentaire, datant de 1999, qu'il faut renforcer notre pédagogie. Depuis très longtemps, nous savons quels sont les aliments les plus contaminés – et des études récentes l'ont confirmé : les légumes racines et les produits issus des circuits informels de zones fortement contaminées. C'est pourquoi les services de la santé ont beaucoup investi dans le programme Jardins familiaux (JAFA), qui permet de faire des dosages pris en charge par l'ARS, pour vous assurer que votre jardin est sûr ou vous aider, le cas échéant, à l'aménager, en apportant de la terre saine, par exemple, ou en donnant des conseils sur le type de culture à privilégier. C'est une initiative fortement soutenue et encouragée par l'ARS. D'après les retours que j'ai eus, les populations en sont très satisfaites. Nous avons effectué des mesures et leur avons démontré qu'elles pouvaient continuer à consommer et à partager les produits de leur jardin familial.
Pour ce qui est du dosage dans le sang, cette question a été abordée lorsque j'étais sur place aux Antilles. Je n'ai aucun problème à discuter de ce sujet majeur. Néanmoins, c'est très compliqué. Le prélèvement permet de savoir si vous avez ou non du chlordécone dans le sang et, partant, de faire une analyse de population, sur cent ou mille personnes, afin de voir quelle part a du chlordécone dans le sang. C'est tout à fait possible. Les résultats de ces prélèvements ont d'ailleurs été présentés par Santé publique France.

Vous dites que c'est possible, alors que cela a été fait. La question est celle du dépistage !
La question est celle de la pertinence. J'avance doucement… La technique existe, mais la question est celle de l'interprétation et de la pertinence du test. Nous avons démontré, grâce au dosage collectif, que la population était fortement concernée et que le niveau était en train de baisser – nous avons eu plusieurs points d'analyse. Parce que la demande locale est très forte en ce sens, j'ai demandé à l'ARS, qui a travaillé avec les médecins et les universitaires sur place, la pertinence du dosage de la chlordéconémie. Plusieurs réflexions sont en cours. Nous n'avons pas, à l'heure actuelle, de valeur critique d'imprégnation, c'est-à-dire que nous ne savons pas quelle est la valeur de référence du taux qui fait que vous êtes ou non en danger. Nous avons saisi l'ANSES à ce sujet au mois de juillet dernier. Nous avons également saisi la Haute Autorité de santé (HAS), pour savoir si elle jugeait utile de mettre en place une évaluation scientifique afin d'étudier la meilleure forme du dépistage, ponctuel ou systématique, et les enjeux de remboursement pour les populations. Au niveau local, vous le savez puisque beaucoup de professionnels ont été associés à cette démarche, l'ARS a mis en place des groupes de travail avec les médecins, les sages-femmes et les universitaires pour connaître l'intérêt du test et voir comment le faire.
Sur les deux, monsieur le président.
Aujourd'hui, ce que nous disent les experts des Antilles que j'ai sollicités avec l'ARS de Guadeloupe, c'est qu'au stade des connaissances actuelles, le dosage individuel de chlordéconémie ne se justifie pas au plan médical. En effet, il est difficile à interpréter, ce qui est quand même un problème pour un test, en raison de la variabilité de l'exposition et de l'impossibilité à la caractériser. J'avais donné un exemple un peu caricatural, lorsque nous nous étions rencontrés, il y a quelques semaines, sous la présidence de la ministre : un travailleur de la banane, qui a passé vingt ans à travailler dans les bananeraies, peut avoir aujourd'hui un dosage proche de zéro, parce qu'il a fait attention, parce qu'il a un jardin familial ou pour d'autres raisons encore, ce qui ne veut pas dire que cela efface toute son exposition pendant vingt ans ; inversement, un touriste qui passe quelques jours aux Antilles et qui utilise des circuits informels peut avoir un dosage positif, ce qui n'a pas du tout la même signification – cela n'a aucun intérêt de suivre cette personne.
Nous avons du mal à faire le lien, ce qui est problématique en médecine, entre un test et une décision. Le test doit-il déboucher sur une attitude thérapeutique ? Faut-il suivre les personnes ? Faut-il leur signifier qu'ils courent un risque particulier de pathologie, alors que la valeur sanitaire de référence, soit la valeur critique d'imprégnation, n'est toujours pas définie ? Cela étant, l'accessibilité locale au dosage est recommandée. Pour moi, elle est très importante, parce qu'il faut pouvoir suivre l'évolution d'imprégnation. Il faut surveiller l'impact des actions de prévention, dont beaucoup sont lancées par la population. Le dosage doit être le plus simple, officiel et local possible. L'institut Pasteur de la Guadeloupe, qui a l'expérience du dosage et qui est doté de l'équipement nécessaire, pourrait le faire très rapidement. Il a demandé une accréditation, qu'il pourrait obtenir d'ici à la fin de l'année.
Par ailleurs, parce que la question est fondamentale et que les Antillaises et les Antillais n'arrêtent pas de me la poser, je pense qu'il faut lancer une étude de recherche clinique le plus vite possible, comme je vais le suggérer aux directeurs généraux des ARS et aux universitaires que j'ai rencontrés. Le but serait de proposer sur place aux personnes qui le souhaitent d'être incluses dans un protocole permettant de doser le chlordécone et de voir si le test est pertinent, s'il a un impact thérapeutique, s'il rassure ou inquiète – il pourrait rassurer certaines femmes enceintes, par exemple, mais en inquiéter d'autres. Il faut pouvoir suivre l'impact du dosage sanguin et en vérifier la pertinence sur plusieurs mois dans un cadre universitaire antillais.

Les dosages sont-ils labiles en fonction de la consommation quotidienne, ou l'imprégnation est-elle pérenne ?
Selon nos connaissances actuelles, la demi-vie du chlordécone dans le sang est assez longue. En cas d'exposition unique, on peut imaginer que l'évolution est assez linéaire, et que le même dosage se retrouvera d'un jour sur l'autre. Vous avez néanmoins raison, nous devons nous assurer de la reproductibilité de ce dosage.
En revanche, une exposition supplémentaire va totalement modifier ce taux, ce qui complique les choses. Il est possible de mesurer un dosage rassurant un jour, puis d'être recontaminé le lendemain suite à l'ingestion d'un aliment. Tandis qu'une personne exposée une seule fois à un aliment fortement contaminé éliminera lentement le chlordécone, et les conséquences ne seront pas du tout les mêmes.
C'est pourquoi nous devons recueillir davantage d'éléments sur place, avec les médecins et les universitaires antillais, pour savoir si le dosage est facile, pertinent, utile, et quel sera son impact sur les populations. Imaginons le cas d'une femme enceinte : si son dosage est faible, elle sera rassurée et poursuivra sa grossesse. Mais que devons-nous faire en cas de dosage élevé, si cette femme demandait à interrompre sa grossesse ? Il n'y a pas de thérapeutique ou d'antidote, donc l'impact anxiogène peut être très significatif. Nous avons donc besoin d'un cadre sérieux, clinique, au sein duquel les personnes entreraient volontairement pour être régulièrement prélevées. C'est ainsi que nous pourrons déterminer si les dosages itératifs ont un intérêt pour la santé.

Vous parlez de lancer une étude clinique, pouvez-vous détailler cette proposition ?
Faut-il imaginer un dispositif de suivi sanitaire spécifique pour les populations de ces territoires, et selon quelles modalités ?
L'Institut Pasteur attend toujours la réponse à sa demande d'agrément, maintenant ancienne. Cet agrément permettrait de ne pas effectuer les analyses en Hexagone.
Suite à l'étude de Santé publique France, pensez-vous nécessaire de réaliser des tests du taux d'imprégnation sur l'ensemble de la population ?
S'agissant de l'Institut Pasteur et du traitement des prélèvements, avant de pouvoir rassurer ou inquiéter la population, nous avons besoin de connaître la valeur critique d'imprégnation, c'est un élément très important, et nous l'ignorons pour l'instant.
D'un point de vue médical, la connaissance de cette donnée est essentielle. Nous savons que si une personne présente un taux d'hémoglobine de trois grammes, c'est très inquiétant, car nous connaissons la norme. Mais que ferions-nous d'un résultat si nous ne connaissons pas le niveau à partir duquel une substance est toxique, très toxique, ou entraîne des conséquences majeures ?

Comment expliquer qu'on ne connaisse pas cette valeur critique, alors que le plan chlordécone date de 2008 ?
Il est très compliqué de déterminer cette valeur, car nous ne disposons d'aucune donnée.
En pratique, pour élaborer une valeur critique d'imprégnation, il faut des données humaines. Nous savons que sur 10 000 femmes qui ont une dose de neuf ou dix grammes d'hémoglobine, les risques de malaises vagaux sont augmentés.
Pour établir cette valeur critique, il faut corréler les taux de chlordéconémie avec des événements cliniques. C'est ce que nous avons demandé à l'ANSES.
Pour déterminer la stratégie de dépistage, nous avons saisi la Haute Autorité de santé. Elle doit trouver des éléments afin de décider si le dépistage doit concerner tout le monde, ou se concentrer sur certaines populations telles que les femmes enceintes ou les enfants.
Vous m'avez demandé quelles recherches cliniques pouvaient être réalisées. Je trouve choquant que des associations fassent des tests, localement, sans prise en charge et sans accompagnement. Les populations ont droit à une prise en charge de qualité, dans le cadre d'une recherche clinique, avec un protocole, un suivi psychologique et médical, et les prélèvements devront être pris en charge.
Il ne faut pas continuer à réaliser des prélèvements sans aucune recommandation, payés par les Antillais, alors que dans deux ans, nous pourrions être amenés à conclure que ce test n'est pas utile. Nous pouvons rapidement acquérir des connaissances, et si elles venaient à démontrer l'utilité de ce test, sur tout ou partie de la population, il faudra évidemment le prendre en charge. Nous devons rapidement obtenir des données fiables, et je ne comprends pas que l'on persiste avec des circuits parallèles dans lesquels les gens paient pour un test qui n'est pas fiable, et qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale.
Il est donc urgent d'avoir ces éléments, et c'est uniquement sur place que nous pouvons les recueillir. Il faut que les Antillais participent à un suivi hospitalier, avec les centres hospitaliers universitaires (CHU) des Antilles, et que l'on choisisse les populations les plus vulnérables et les plus exposées. Nous pourrions expliquer à une femme en début de grossesse que nous nous interrogeons sur l'intérêt de mesurer la chlordéconémie, et lui proposer de suivre l'évolution de son taux. Et après la naissance, selon le déroulement de la grossesse et la santé du nouveau-né, nous pourrons corréler les événements survenus aux taux de chlordécone relevés. Cette étude peut être mise en place assez vite, j'ai proposé aux hôpitaux universitaires et à l'ARS de travailler très rapidement à un protocole. Nous pouvons vraiment les aider, nous pouvons financer des protocoles hospitaliers de recherche clinique, car le chlordécone est une priorité. Nous pourrions ainsi obtenir des données très fiables et structurées, dans l'intérêt des populations antillaises.

Vous préconisez un test clinique, il me semble que les différentes cohortes qui ont fait l'objet d'études participaient à de tels tests cliniques. Vous souhaitez aussi que ceux font le test de manière spontanée soient remboursés, il me semble que ces personnes font cette démarche sans être malade, simplement pour savoir ce qu'elles ont dans le sang.
N'est-il pas contradictoire de préconiser le remboursement de ces tests tout en étant défavorable à un dépistage général dans le cadre d'un protocole ? Vous ignorez les valeurs critiques, mais il n'en demeure pas moins que pour mettre en place un suivi spécifique des personnes les plus touchées, un dépistage généralisé et pris en charge serait plus pertinent que des tests cliniques ponctuels et ciblés.
La situation est très particulière, elle ne tient pas au chlordécone, mais à notre attitude à l'égard d'un test dont nous ne savons rien. Nous recherchons le chlordécone dans un prélèvement sanguin sans savoir les conséquences pour l'organisme de la présence de chlordécone dans le sang. Ce chlordécone va-t-il s'accumuler, où, et est-ce variable selon les individus ? Un taux de chlordécone dans le sang élevé peut s'accompagner d'un taux dans les organes faible, ou l'inverse. Nous avons besoin d'acquérir cette information.
Vous établissez une différence entre imprégnation générale et imprégnation individuelle. Nous soutenons et nous finançons les études d'imprégnation générale, elles ont permis de démontrer qu'une part très importante de la population était imprégnée, en large majorité à des taux faibles, seule une petite minorité présente des taux très élevés, et nous avons pu caractériser les personnes très fortement exposées et les comportements potentiellement à risque. Cet instantané de la population a été réalisé à plusieurs moments, et nous constatons que l'imprégnation de la population diminue.
Nous pourrions effectuer ce test sur tout le monde, je n'y suis pas défavorable, mais nous ne savons pas quelles conséquences en tirer. Allons-nous susciter de la panique chez ceux dont le taux est élevé, alors que nous ne savons pas si ce taux a un effet ? Ou à l'inverse, courrons-nous le risque de rassurer ceux dont le taux, bien que bas, pourrait avoir des conséquences ? Des personnes ayant été très exposées risquent d'être rassurées à tort par un taux très bas, tandis que d'autres peuvent avoir un taux très élevé sans que cela n'ait la moindre conséquence pour leur santé.

Cela permettrait toutefois d'introduire une politique nutritionnelle adaptée à la réalité de la personne.
J'y suis favorable, il faut étudier cela sur place, avec les Antillais, dans le cadre d'un protocole. Nous devons mettre en place un protocole de recherche clinique impliquant au maximum la population antillaise, pris en charge par l'État.
La recherche sera plus fiable si elle est menée par des universitaires antillais, sur des populations choisies, informées, qui seront surveillées et accompagnées. C'est le sens d'un protocole de recherche clinique : effectuer des prélèvements et chercher d'éventuelles conséquences sur le déroulement des grossesses ou la santé des enfants.

Des tests d'imprégnation généralisés permettraient d'appliquer le protocole clinique aux populations les plus concernées.
Non, car cela aurait pour effet d'en exclure certains. On peut imaginer faire le test à toute la population, mais ensuite il serait compliqué de décider de n'appliquer le protocole clinique qu'à certaines personnes, car certains demanderont pourquoi ils ne sont pas pris en compte.
Il faut avancer très vite avec les Antillais et les universitaires. Je suis très favorable à ce protocole, et s'il démontre que le dépistage est pertinent, il faudra le mettre en place et indiquer à quelle fréquence le test doit être répété, et quelles conséquences il faut en tirer sur l'alimentation et les comportements. Il nous manque des connaissances acquises dans un cadre rigoureux. Je ne veux pas que les Antillais s'inquiètent et décident de payer de leur poche un test tous les mois, ce n'est pas sérieux. Si ces tests sont nécessaires, ils doivent être faits dans un cadre scientifique, à l'hôpital.

M. Norbert Ifrah, président de l'INCa, a rappelé que la classification du chlordécone dans le groupe 2B – cancérogène possible – a été décidée en 1979. Il s'est dit favorable à la réévaluation du chlordécone dans le groupe 2A – cancérogène probable. Quel est votre sentiment sur cette question ? Faudrait-il instaurer en conséquence un dépistage systématique du cancer de la prostate ?
Vous m'avez demandé précédemment s'il fallait surveiller spécifiquement la prévalence des cancers de la prostate au sein de la population antillaise, c'est bien sûr le cas. La population antillaise est déjà l'une des mieux surveillée de France puisque c'est la seule à bénéficier de registres des cancers couvrant l'ensemble de la population, d'un registre des malformations et d'un dispositif de toxicovigilance.

Absolument, même s'il est malheureux que la Guadeloupe n'en ait bénéficié que plus tard. Ces registres des cancers sont une bonne chose, mais c'est une évidence vu le drame que nous connaissons.
Ce sont des dispositifs anciens, très utiles pour connaître la population des Antilles, et nous les soutenons sans réserve.
S'agissant de la classification du chlordécone, ces classifications internationales sont établies par des scientifiques qui évaluent les risques. Effectivement, la classification du chlordécone est ancienne, et les molécules sont régulièrement réévaluées au regard des connaissances accumulées. Beaucoup de publications documentent l'impact de la chlordécone aux Antilles, ce qui peut conduire à une réévaluation du risque.
Mais si les scientifiques français sont très mobilisés, ceux des autres pays le sont beaucoup moins, et nous devons nous battre en nous appuyant sur les publications de nos scientifiques. Celles portant sur le lien entre taux élevé de chlordécone et risque de cancer ainsi que les recherches du professeur Multigner sur la part attribuable au chlordécone des cancers de la prostate peuvent faire pencher la balance pour modifier la classification.
Je ne sais pas quelle décision prendront les cancérologues et les toxicologues du CIRC, il va falloir leur donner le maximum d'informations et leur apporter toutes les publications scientifiques pour qu'ils décident de changer la classification de la chlordécone.

Nous saluons cette procédure qui permettrait de classer le chlordécone comme cancérogène probable et non seulement possible. Mais ne pensez-vous pas que cette demande est un peu tardive ? Ne pourrait-on y voir une forme de reconnaissance par l'État de sa responsabilité pour avoir accepté une classification 2B qui justifiait les autorisations données en 1988 ? N'est-il pas surprenant que l'État ait prolongé à trois reprises les autorisations d'utiliser la chlordécone, de 1990 à 1993 ?

Vous avez hérité de cette situation, je ne vous tiens pas responsable. Mais la continuité de l'État permet de le tenir responsable.
Fort heureusement, dans mon domaine, les connaissances évoluent, et il faut faire évoluer les classifications en fonction. C'est malheureusement ce qui se passe encore aujourd'hui, avec toutes les molécules. Une molécule mise sur le marché en 2019 sera classée sur la base des données disponibles.

Je peux donc saluer positivement la demande de reclassification du chlordécone que vous soutenez, et vous reconnaissez par cette demande que le cancérogène probable est certainement plus nocif qu'on ne l'imaginait, et que l'État n'a pas eu la vigilance requise vis-à-vis d'un tel drame. Nous reconnaissons en 2019 ce qui aurait pu être fait beaucoup plus tôt.
C'est une très belle démarche, je la soutiens totalement. Mais ce n'est pas l'État, et nous encore moins, qui décidons de cette classification. C'est un groupe de scientifiques internationaux et les critères sont très durs, nous devons fournir des preuves. Nous les avons accumulées au fil du temps, et je ne suis pas certain que nous aurions pu en présenter autant en 1995, 2000 ou 2005. C'est terrible, mais il faut que nous accumulions des éléments humains pour prouver scientifiquement que quelque chose se passe.

Le président de l'INCa nous a dit que la demande de reclassement a été faite, que la démarche de réexamen a reçu un avis favorable du CIRC, mais qu'elle a été classée en priorité basse. Il souhaite surtout être accompagné par le ministère de la santé pour accélérer la procédure. C'est une question de délai, et si la demande reste en priorité basse, son traitement peut prendre plus de deux ans.
Ce reclassement serait un facteur important à l'appui de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Vous avez raison, c'est un symbole très fort, et je pousserai cette demande si je peux le faire, mais l'INCa est le plus légitime pour le faire : c'est l'opérateur national, placé sous la tutelle des deux ministères, et il est considéré comme le référent par le CIRC.
Il lui est acquis. Nous soutenons toutes les démarches scientifiques rigoureuses, mais je n'ai pas de pouvoir sur le CIRC, qui est sous la responsabilité de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Nous verrons ce qu'il est possible de faire pour que la procédure soit rapide, car c'est une question symbolique très forte pour la population des Antilles.
Mais je ne garantis pas le résultat, il s'agit de scientifiques indépendants, et il y a toujours un risque d'être déçu par les scientifiques, malheureusement.
Vous m'avez également interrogé sur l'incidence élevée du cancer de la prostate aux Antilles. M. Ifrah vous a exposé tous les éléments dont il disposait, notamment grâce aux registres des cancers. L'incidence est élevée, supérieure à la moyenne nationale, pour des facteurs multiples.
Dans une publication récente, le professeur Multigner a démontré un lien épidémiologique entre le taux de chlordécone dans le sang et la survenue de cancers de la prostate. Il se penche actuellement sur la question de la part attribuable, qui est définie comme le poids du facteur sur la survenue de la maladie. Par exemple, pour le cancer du poumon, la part attribuable du tabac est énorme : 95 % des cancers du poumon sont liés au tabac. Mais des personnes n'ayant jamais fumé développent des cancers du poumon.
Pour les cancers de la prostate, l'âge est un facteur. Nous savons également que la génétique joue un rôle majeur, c'est pourquoi il vous a rappelé que les taux observés aux Antilles sont proches de ceux en vigueur dans les Caraïbes et au sein de certaines populations d'origine africaine en Amérique et en Grande-Bretagne. Comme pour tous les cancers, des différences majeures existent entre les populations en fonction de leurs caractéristiques génétiques.
Par ailleurs, s'agissant des autres cancers, en particulier des cancers féminins, les Antilles ont la chance de connaître beaucoup moins de cas que la moyenne nationale. Je pense que le mode de vie et l'alimentation aux Antilles y participent beaucoup, et nous essayons de nous inspirer de cette alimentation pour formuler des recommandations à la population hexagonale.
S'agissant spécifiquement du cancer de la prostate, nous ne connaissons pas la part attribuable au chlordécone.
De plus, nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de savoir si un cancer de la prostate est lié au chlordécone, ce qui serait très utile.
Enfin, des dépistages organisés et systématiques existent pour le cancer du sein, pour les cancers colorectaux, et la ministre de la Santé Agnès Buzyn vient de décider du dépistage systématique du cancer du col de l'utérus. Mais aujourd'hui, les experts de la Haute Autorité de santé estiment qu'il n'est pas pertinent de réaliser un dépistage systématique du cancer de la prostate. Il pourrait être proposé à toute la population française, mais le seul moyen de dépister le cancer de la prostate – hormis un geste très invasif impliquant des biopsies dont les conséquences peuvent être délétères – est par la mesure du taux d'antigène prostatique spécifique, en abrégé PSA, dans le sang. Or nous pensions que ce test était extraordinaire, mais nous nous sommes rendu compte que des personnes souffraient de cancers très avancés avec des taux de PSA très bas, tandis que d'autres ont été opérés d'un cancer alors qu'ils n'en avaient pas car leur taux de PSA était très élevé.
Nous avons été trompés par un test massivement répandu dans la population qui montre aujourd'hui toutes ses limites. Un avis récent de la Haute Autorité de santé établit qu'il n'est pas raisonnable, aujourd'hui, de faire un dépistage généralisé.
Mais, pour la population des Antilles, l'étude de cohorte KP-Caraïbes établit en permanence l'incidence des cancers de la prostate. Elle est de 163 cas pour 100 000 en Guadeloupe, 161 pour 100 000 en Martinique. C'est plus qu'en Hexagone, mais moins que lors de la période précédente. L'incidence du cancer de la prostate diminue donc aux Antilles.
Elle est très variable, entre le Doubs et Pyrénées-Orientales, les chiffres varient beaucoup. La moyenne métropolitaine est de 98 pour 100 000.
Oui, l'incidence est 60 % plus élevée. Nous le savons, c'est une constante, mais cette incidence est en baisse puisqu'elle est passée de 182 pour 100 000 durant la période 2005-2009 à 161 pour 100 000.
Vous avez cependant raison, monsieur le président, il y a plus de cancers de la prostate aux Antilles, et je l'ai toujours reconnu quand j'étais sur place. Toutefois, il est important de noter que les cancers de la prostate sont plus répandus parmi les personnes originaires des Antilles qui vivent dans d'autres régions du monde. C'est probablement du fait de facteurs génétiques, c'est pourquoi il est difficile de déterminer la part du chlordécone, et si la cause d'un cancer est le chlordécone.

Le professeur Multigner cherche la part attribuable du chlordécone, et dans une étude de 2019, il constate que la récidive est trois fois supérieure dans les zones polluées. C'est un indicateur très important. Et l'étude Karuprostate donnait déjà des indications sérieuses.
Il existe donc une part attribuable, pourquoi prétendre aujourd'hui qu'il n'y a aucun lien entre cancer de la prostate et chlordécone ?
Il est important d'être clair, car les Antillais sont inquiets. Personne ne prétend qu'il n'y a aucun problème, et c'est pourquoi nous finançons des études.
Il faut étudier la relation épidémiologique. Mais la relation causale est très compliquée, pour les raisons que je vous ai citées. Nous ne savons pas attribuer un cancer à une molécule, car il n'y a pas de marqueur.

C'est important pour nous, car nous voulons sortir par le haut de cette controverse. Le président Macron a été le premier à parler de réparations et de responsabilité. Mais c'est au plus haut niveau de l'État que l'on a affirmé que le lien n'était pas avéré. Je respecte la République, mais je vous suggère, monsieur le directeur général de la santé, de donner de bonnes informations au président Macron.
J'essaierai ! C'est le lien causal qui est difficile à établir.
Des personnes fortement exposées au chlordécone développent des cancers de la prostate, mais c'est aussi le cas de personnes qui n'y sont pas exposées, et d'Antillais ne vivant pas aux Antilles.
Les propos que je vais vous tenir peuvent choquer, ce sont ceux d'un épidémiologiste et je les prononce naturellement en toute bienveillance. La seule façon que nous aurions de démontrer définitivement le lien causal serait de comparer des populations exposées au chlordécone à des populations exactement identiques qui n'y sont pas exposées. Cela imposerait de suivre une cohorte pendant vingt ans, dont une partie ne serait pas du tout en contact avec le chlordécone, tandis que l'autre partie devrait en consommer. Ce serait très choquant et éthiquement inacceptable, mais pour un épidémiologiste, c'est la manière d'apporter la preuve du lien causal.
C'est ce qui a été fait il y a des dizaines d'années pour lutter contre un lobby extrêmement puissant, celui du tabac, qui affirmait que le tabac ne provoquait pas le cancer du poumon. La cohorte de Framingham, au sein de laquelle certains fumaient et d'autres non, a été suivie pendant des années, et il est apparu que le nombre de cancers du poumon était bien plus élevé parmi les fumeurs. Le lien était démontré, et ce fut le début des campagnes de santé publique contre le tabac. C'est dur, c'est violent, certains se battaient pour dire que le tabagisme n'avait pas de conséquences.

Il y a plusieurs indices inquiétants : cancers de la prostate, naissances prématurées. L'ANSES a précisé les liens entre tous ces facteurs. Pensez-vous que les politiques de recherche autour du drame du chlordécone, qui concerne 750 000 personnes, sont à la hauteur des besoins ? N'y a-t-il pas un problème de cohérence entre les recherches sur le sol, le sang, la mer, les activités, les enfants ? Tous les chercheurs que nous avons rencontrés ont déclaré qu'il n'y avait pas de moyens, pas de fonds dédiés, pas de cohérence. Lors de l'audition précédente, il nous a été dit que tout le monde s'en fichait.
Il règne le sentiment d'un manque de cohérence, ne pensez-vous pas, en tant que directeur de la santé, que des améliorations sont nécessaires ?
Je suis très engagé à titre personnel, la critique selon laquelle tout le monde s'en fiche ne me concerne pas, ni la direction générale de la santé, qui est mobilisée depuis très longtemps.
Vous avez raison de rappeler que nous avons besoin de l'engagement de tous, notamment du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Mais nous devons faire face à une difficulté gigantesque : il s'agit d'un drame aux Antilles, et dans le monde de la recherche, on privilégie les sujets très médiatiques, qui ont un impact scientifique considérable et permettent de belles publications.
De plus, la recherche sur le chlordécone est très compliquée car elle a des implications dans de nombreux domaines. Ce drame concerne l'ensemble de la communauté scientifique, pas uniquement le domaine sanitaire. La santé se trouve en bout de chaîne, elle constate les conséquences, mais nous ne pouvons pas aller prélever dans des milieux, trouver des solutions pour capter des toxiques rémanents, identifier le circuit alimentaire chez l'animal ou étudier la faune marine.
Nous disposons en France d'organismes de recherche de très haut niveau, notamment aux Antilles, et des universitaires souhaitent s'engager. Mais il faut mobiliser l'expertise dans tous les domaines.
Dans le domaine de la santé, l'expertise est regroupée au sein de l'alliance Aviesan, l'INSERM s'est rendue sur place et nous soutenons toutes les recherches cliniques.
Un autre aspect fondamental ne dépend pas de nous, c'est l'approche environnementale. Le chlordécone est un scandale environnemental, et il faut utiliser notre expertise en la matière, qui est réunie dans l'alliance AllEnvi.
Un troisième enjeu, c'est l'accompagnement et l'éducation des populations. Pour nous assurer d'être compris par toutes les générations, il faut faire du porte-à-porte, intervenir à la radio, faire des réunions dans les communes, car certaines personnes découvrent encore la chlordécone et n'ont pas du tout intégré les comportements nécessaires. Il faut pour cela une approche comportementale, adaptée aux populations et s'appuyant sur l'expertise d'autres chercheurs sachant tenir compte des spécificités et des attentes de la population, ils sont regroupés au sein de l'alliance Athéna.
Pour répondre à toutes les questions de recherche, il faut une mobilisation de tous les acteurs. J'encourage mes directeurs, les directeurs d'agences sanitaires et l'ANSES à se rendre sur place car c'est ainsi que l'on prend la mesure de toutes ces questions, et du potentiel existant sur place avec les universitaires et les facultés de médecine. Il permet de faire énormément de choses. Il faut mobiliser les chercheurs pour qu'ils se rendent sur place, et le colloque était une occasion extraordinaire de le faire, il faut le renouveler.
Les chercheurs sont souvent réducteurs, ils éprouvent une forme de retenue à l'égard d'un sujet sur lequel ils n'ont jamais travaillé, il faut les mobiliser pour répondre à une attente fondamentale de la population.
S'agissant des aspects financiers, les crédits sont interministériels, et sur les grands programmes de recherche, il existe des financements par appels à projets. La première étape consiste à mobiliser la communauté des chercheurs sur des questions clés. Ensuite, quand la question scientifique est pertinente et que les scientifiques sont bons, on trouve des financements. Le blocage n'est pas financier.

Je ne doute pas qu'il y ait moins de cancers aux Antilles qu'en Hexagone. J'entends aussi que le cancer de la prostate est plus fréquent au sein des populations antillaises.
Mais sachant le nombre de Guadeloupéens et de Martiniquais qui viennent se faire soigner en Hexagone dès qu'ils ont la moindre suspicion de cancer, j'aimerais savoir comment ils sont comptabilisés : apparaissent-ils sur les registres antillais ? Sur quel registre sera consigné un Antillais dont le cancer est détecté en métropole et qui s'y fait soigner ?
Oui, puisque c'est tout l'objectif de ces registres populationnels et géographiques. Pour une population contrôlée, c'est le lieu de résidence de la personne qui compte.
Entre nous, je vais être un peu taquin : les équipes hospitalo-universitaires antillaises sont d'une très grande qualité. Il faut le leur reconnaître et dire qu'elles font du bon travail sur place. Je n'arrête pas de le dire mais chacun fait ce qu'il veut.

Il faut effectivement saluer le courage des médecins qui travaillent en Guadeloupe et en Martinique mais il faudrait renforcer puissamment les plateaux techniques. Nombre de personnes sont obligées de venir se faire soigner ici, y compris en prenant un appartement pour que la maman puisse accompagner son enfant ou que le mari puisse accompagner sa femme.
C'est vrai, mais il va y avoir un magnifique centre hospitalier universitaire (CHU) en Guadeloupe et il sera doté d'un très beau plateau technique. C'est un investissement majeur – ce qui est très bien.

Pour votre information, nous aimerions que les choses avancent beaucoup plus vite en Guadeloupe.

Et en Martinique, l'hôpital est à rénover totalement, ce qui nécessite des moyens exceptionnels.
La question de notre collègue Vainqueur-Christophe est très subtile. Si vous ne comptabilisez pas les gens qui partent de là-bas pour se faire soigner, cela vous donne raison sans que vous ayez raison.
Comme je l'ai indiqué, c'est le lieu de résidence qui compte. Il en va de même pour les grossesses pour lesquelles nous avons un registre des malformations : nous tenons compte du lieu de résidence de la mère qui peut être suivie dans un CHU situé à 200 ou 300 kilomètres de chez elle. Ce qui compte c'est l'exposition, donc le lieu de vie.
À l'inverse, mesdames et messieurs les députés, j'appelle votre attention sur le fait qu'il n'existe pas de statistiques ethniques en France, conformément à la volonté de la représentation nationale. Nous n'allons pas discuter de la nécessité d'avoir ou non des statistiques ethniques en France, mais leur absence pose une difficulté dans ce domaine où elles seraient très utiles.

M. Norbert Ifrah en avait fait état.
J'ouvre une parenthèse sur ce gros sujet qu'est le CHU. Nous aurons peut-être bientôt un magnifique ensemble hospitalier, mais nous nous demandons surtout comment vivre au quotidien. Ce n'est pas évident, professeur Salomon ! Ce n'est évident pour personne, pas plus pour les soignants que pour la population.
Vous avez évoqué la complexité des difficultés liées au chlordécone, disant que c'était l'affaire de tous, que tout le monde devait se mobiliser, en particulier les chercheurs. Lorsque nous avons interrogé le président de l'INCa, il nous a indiqué que l'INCa avait accepté de financer l'étude Madiprostate, en donnant suite à une « demande dérogatoire », eu égard à l'importance de l'enjeu. Pour quelle raison a-t-on arrêté cette étude ? Vous avez dit que le problème n'était pas financier. Or le président de l'INCa nous a précisé qu'il s'agissait d'appels à projets compétitifs. Dans le cadre des plans chlordécone, y a-t-il des fonds dédiés concernant le volet de la recherche scientifique ?
À la demande du professeur Multigner, de l'INSERM, nous avons financé l'étude Karuprostate conduite en Guadeloupe et dont les premiers résultats ont été publiés en 2010.
Le professeur Multigner a formulé une autre demande pour le financement d'une nouvelle étude en Martinique, Madiprostate, en 2010. Comme toujours, le protocole de cette étude a été soumis à un collège d'experts. Après un échange classique sur la méthode, notamment avec la DGS et l'INCa, une étude de faisabilité a été financée et lancée dès mars 2012.
En mars 2014, des difficultés techniques et logistiques sont apparues. L'INSERM a transmis à l'INCa un rapport scientifique sur cette première partie. Un collège d'experts s'est réuni et a conclu que le protocole de recherche, fondé sur une sélection de cas et de témoins, ne permettrait pas de répondre à la question posée. Au vu de la participation des personnes composant le panel et de la sélection effectuée entre les cas et les témoins, les experts ont estimé qu'il ne serait pas possible de répondre à la question clé du président sur le lien causal entre l'exposition au chlordécone et le risque de survenance du cancer de la prostate en Martinique. La DGS n'était pas du tout impliquée dans ce collège d'experts qui a recommandé d'arrêter le déploiement de l'étude. Quand un collègue d'experts recommande d'arrêter une étude, celui qui la finance l'arrête. En l'occurrence, l'INCa a pris cette décision.
Pour le financement des études, il faut distinguer deux aspects : les études en santé et la recherche fondamentale. Côté santé, toutes les études sont financées. Nous finançons les cohortes, les études de Santé publique France, les études en cours sur l'imprégnation des populations, les études de l'ANSES, les études sur le croisement entre une exposition et la survenue d'un cancer. En revanche, la recherche fondamentale n'est pas du tout dans le champ de la santé ; elle est du ressort du ministère de lʼenseignement supérieur, de la recherche et de lʼinnovation (MESRI).
Du fait de la spécificité du chlordécone, toutes les études actuelles – en cancérologie, neurologie ou en cardiologie – passent par des appels à projets. Or, dans un domaine aussi particulier, les appels à projets sont plus compliqués. Cet aspect du dossier m'interpelle. Depuis mon arrivée, j'en ai beaucoup discuté avec les équipes, le MESRI et le président-directeur général (PDG) de l'INSERM – je ne sais pas si vous avez prévu de l'auditionner.
Comment procéder dans un domaine qui n'est pas classique ? Les études sont financées par l'Agence nationale de la recherche (ANR). En général, les grands organismes de recherche n'ont pas de budget spécifique pour les études. L'Europe finance massivement par le biais de grands programmes : Horizon 2020, Horizon Europe. La difficulté est ensuite d'entrer dans le cadre de ce type d'appels d'offres qui portent très largement sur les produits phytosanitaires, les enjeux concernant l'environnement. Nous devons obtenir que les études scientifiques majeures entrent dans ce cadre.

D'après ce qui nous a été dit, vu que le chlordécone était utilisé pour lutter contre le charançon du bananier, que cette pollution se trouve être dans deux territoires – Guadeloupe et Martinique – et que, finalement, les recherches ne s'effectuaient pas hors de la France, il était très difficile pour les chercheurs de faire des appels aux dons, aux fonds.
Nous venons d'auditionner deux chercheurs sur les produits de dégradation pour décontaminer les sols. Ils ont déjà envoyé des dossiers ici ou là pour demander des financements. Le résultat a été nul. C'est un vrai sujet, monsieur le directeur général. Si nous voulons réellement en finir avec cela, même si nous savons que les sols seront pollués durant quatre ou sept siècles, il faut que nos actions puissent converger et que nous aboutissions à des fonds dédiés, peut-être dans le cadre du Programme des interventions territoriales de l'État (PITE). Ce serait encore dérogatoire pour les Antilles. C'est un peu difficile pour nous parce que je me rends compte qu'il n'y a que l'action 8 du PITE qui soit consacrée au plan chlordécone. C'est bien cela ?
Dans l'immensité du PITE, cette action 8 est en effet consacrée au plan chlordécone.

L'objectif de cette commission d'enquête est de faire une étude de l'impact, sanitaire, environnemental et économique de l'utilisation du chlordécone. Je pense que nous en viendrons à constater qu'il faut des fonds dédiés pour la recherche. Si nous n'arrivons pas à sanctuariser ces fonds, nous donnerons des coups d'épée dans l'eau. On organise un premier colloque, puis un deuxième. Et après, où allons-nous ?
Le premier colloque a eu la vertu de sensibiliser les chercheurs. Pour être franc, je trouve qu'une grande partie de la communauté des chercheurs ne connaît pas du tout le sujet. Je vais défendre ma paroisse mais je pense que c'est au ministère de la santé que nous avons la vision la plus globale de l'effet du chlordécone.
Le chercheur se voit comme spécialiste d'un sujet très pointu, dans son laboratoire situé à tel endroit et, face au chlordécone, il se dit : c'est loin, je ne connais pas. Comment faire en sorte que les chercheurs prennent conscience de l'enjeu ? C'est toute la difficulté. Dans son laboratoire de Grenoble, par exemple, le chercheur ne voit pas de quoi il retourne quand on lui parle de chlordécone. Au ministère de la santé, nous sommes mobilisés depuis longtemps sur des études comme la cohorte Timoun ou celle qui concerne les travailleurs de la banane. Nous voyons très bien de quoi il s'agit. Il y a de la recherche clinique : interventionnelle, épidémiologique, sur lien causal. Ce que vous décrivez très bien, c'est le problème de l'amont.
Vous avez raison de dire que les Antilles sont contaminées pour des siècles, sauf si des chercheurs trouvent des solutions en amont. C'est là que se trouve la clé. Pour notre part, nous essayons de réduire le risque, c'est-à-dire l'exposition des populations, en recommandant aux personnes – et particulièrement aux femmes enceintes – de faire attention à ce qu'ils boivent et à ce qu'ils mangent. Mais s'il était possible d'agir sur la source, ce serait extraordinaire. Il faut donc intéresser des chercheurs spécialisés dans l'environnement, les cycles complexes, les produits lourds ou la chélation car, jusqu'à présent, ce sujet est hors de leur champ. La difficulté est de mobiliser les chercheurs fondamentaux spécialistes des milieux.
J'essaie d'être rationnel. Vous allez peut-être penser que je fais de la communication mais je pense qu'il faut faire connaître les enjeux du chlordécone à ces équipes qui sont très loin du sujet. Un drame pareil ne doit pas se renouveler et, grâce à l'innovation, il est peut-être possible de trouver des solutions. Imaginez que, dans cinq ou dix ans, des équipes trouvent la solution et sachent capter la molécule. Cela changerait tout pour les Antillais.
L'énorme défi est d'intéresser les chercheurs, peut-être même ceux qui ne connaissent pas le sujet. Au colloque de 2018, il n'y avait que de grands spécialistes du sujet. Pour ma part, je parle de chlordécone quand je rencontre des chercheurs et, très souvent, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Il va donc falloir que nous arrivions à les mobiliser. L'État se mobilise aussi. Nous mobilisons tous les départements ministériels – l'innovation, la recherche, l'environnement.
Pour l'Union européenne, c'est aussi un sujet majeur : il s'agit d'une catastrophe environnementale que l'on n'a pas intérêt à reproduire. J'ai rencontré la directrice générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission européenne. Quand je lui ai parlé du chlordécone, elle découvrait le sujet. Nous devons tous être capables de porter ce sujet au sein des institutions de l'Union européenne, en insistant sur le fait qu'il ne concerne pas uniquement les Antilles et qu'il est révélateur de ce qui se passe face à un scandale environnemental. C'est utile à tout le monde.

Pourquoi alors ne pas sortir des appels à projets libres en France et en Europe ? Pourquoi ne pas passer par des appels à projets ciblés, avec des budgets garantis ?

Une fois les masses financières sécurisées, vous pourrez vous attaquer en amont aux sujets que vous avez parfaitement listés. Pourquoi ne pas envisager une initiative française en ce sens ? Il serait peut-être possible de trouver des solutions dans cinq ou dix ans parce que l'échéance de 500 ans a de quoi effrayer.
Nous oscillons toujours entre deux positions : les chercheurs sont des gens indépendants qui n'aiment pas qu'on leur dicte leur sujet ; les prescripteurs ont des priorités nationales et la volonté d'orienter les travaux sur tel ou tel sujet. La représentation nationale, par exemple, peut peser de tout son poids pour décider des priorités des grands programmes français. À l'inverse, les chercheurs demandent des appels à projets très larges auxquels ils pourront répondre en fonction des thématiques. C'est exactement ce qui se passe en France et surtout en Europe.

Avez-vous le pouvoir d'imposer des appels à projets ciblés ou est-ce que cela dépend de l'Europe ?
Nous avons tous le pouvoir d'influencer les futurs appels à projets. Les Français l'ignorent souvent mais ces appels d'offres sont rédigés par des gens qui sont soumis à des sortes de lobbyistes suggérant qu'il faut travailler sur tel ou tel sujet : les transports du futur, les villes de l'avenir, etc. La France a ce pouvoir d'influence – ce n'est pas péjoratif dans ma bouche. Nous devons utiliser toutes nos armes.

Monsieur Salomon, vous êtes le directeur général de la santé et Mme la rapporteure a raison de marteler sa demande.
Les parlementaires et les représentants français à l'Union Européenne ont un rôle majeur à jouer. Quand je rencontre la directrice générale de la santé et de la sécurité alimentaire de l'Union européenne, je lui en parle.

On ne peut pas laisser le destin de deux peuples entre les mains de lobbyistes. Ce n'est pas possible. Pouvez-vous orienter vers le chlordécone une masse d'appels à projets ciblés avec un budget dédié ? Avez-vous le pouvoir de le faire ? Si c'est le cas, il nous faudra alors convaincre le Président de la République et le Premier ministre d'aller dans ce sens, ne serait-ce que pour la réalisation d'études essentielles visant à s'attaquer à l'origine du mal. Nous avons parlé de remédiation et de séquestration. C'est vital. Sinon, nous en parlerons encore pendant cinquante ans. Oui ou non, avez-vous le pouvoir de le faire ?
Nous pouvons faire passer le message mais la décision n'est pas de notre ressort.
Je suis persuadé qu'il faut pousser, au niveau européen, tout ce qui présente des effets majeurs pour la santé.

Pourquoi me parlez-vous de l'Europe ? Moi, je vous parle de la France. En tant que directeur général de la santé en France, pouvez-vous le faire ? Si vous me dites que vous le pouvez, qu'il n'y a pas de contrainte juridique, vous avez face à vous deux élus, l'une de la majorité et l'autre de l'opposition, qui iront main dans la main voir le Gouvernement avec une proposition en ce sens. Nous pourrons dire que nous avons balisé le sujet avec vous et que vous n'êtes pas contre l'idée. À toute situation exceptionnellement grave, il faut des solutions exceptionnelles.
Je partage votre analyse, monsieur le président, mais le directeur général de la santé ne décide pas des appels à projets et du budget du ministère de la recherche. En revanche, je peux aller batailler auprès de mes collègues du ministère de la recherche et leur dire qu'il faut orienter des crédits vers ce type de sujets.

Nous allons recevoir la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
C'est parfait. Elle oscille entre les deux difficultés que je vous ai décrites. Chaque chercheur veut son propre budget et lui demande un fléchage spécifique. Elle est obligée de refuser de donner de l'argent à toutes les équipes en faisant valoir que ce n'est pas la tendance. D'autres lui demandent de mettre x millions sur la table, en expliquant qu'ils vont se débrouiller avec les projets.
Pour des sujets comme celui-là, que je qualifierais d'orphelins, il faut être capable de dire qu'il est nécessaire d'avoir un budget dédié. S'il le faut, je peux vous assurer que je pousserai en ce sens au niveau national. Le niveau européen est aussi très important pour trouver des chercheurs qui ont d'autres compétences. Il faut influencer les rédacteurs du futur appel à projets européen qui est très fortement doté, en faisant valoir qu'il est très important de travailler sur les incidences de l'environnement sur la santé. Le chlordécone entre complètement dans ce cadre, comme les produits phytosanitaires ou la pollution.
Les Français doivent user tous ensemble de leur influence – les ministres, les députés européens, les personnes qui nous représentent auprès des instances européennes. C'est une occasion très importante de créer un mouvement de recherche internationale parce que certaines expertises ne sont peut-être pas en France, afin de répondre à toutes ces questions scientifiques.

Il faut peut-être activer aussi ceux qui ont utilisé le chlordécone en Europe de l'Est ou ailleurs, de telle sorte que cette dimension internationale ait un sens. Si la France enclenche immédiatement ce processus vis-à-vis du chlordécone, je pense que nous n'aurons pas de mal à convaincre l'Europe.
Vous avez raison : nous devons montrer que nous sommes mobilisés avant de demander l'aide des Européens.

Le sujet entre parfaitement dans la problématique du développement durable et nous pouvons donc aller souffler à l'oreille de ceux qui font le programme, d'autant plus que les collectivités de Guadeloupe et de Martinique participent au plan chlordécone dans le cadre des actions du fonds européen de développement régional (FEDER) si mes souvenirs sont exacts.
Monsieur le directeur général, j'aurais une dernière question : quels montants ont effectivement été consacrés aux plans chlordécone successifs et pourquoi certains crédits n'ont-ils pas été consommés ?
Le financement est interministériel.
Le premier plan national d'action couvrait la période 2008-2010 ; son budget était de 33 millions d'euros et 20 millions d'euros ont été consommés.
Pour le deuxième plan, couvrant la période 2011-2013, le budget de 31 millions d'euros n'a été consommé qu'à hauteur de 8 millions d'euros. À l'époque, je n'étais pas là et je ne sais pas comment les gens ont tiré sur les lignes budgétaires. D'après ce que j'ai compris, la sous-consommation des crédits tient à la difficulté de mobiliser les fonds européens : FEDER, fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
Pour le troisième plan, qui couvre la période 2014-2020, le budget s'élève à 30 millions d'euros. Pour la première étape, allant de 2014 à 2017, le montant des crédits consommés atteignait 14,8 millions d'euros sur les 18 millions d'euros de participation de l'État, soit un taux de consommation de plus de 81 %, beaucoup plus satisfaisant. Sur la période 2014-2017, le différentiel assez faible est lié au fait que le plan a démarré un peu tardivement – en fait, il a été lancé au début de 2015 – et qu'il a subi des modifications locales. On note toujours une difficulté à mobiliser les fonds et parfois une inadéquation entre les projets scientifiques et ce qui a été déposé à l'ANR.
La partie santé, pilotée par la DGS, est dotée d'un budget propre, le programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » de la mission Santé. Nous accordons des financements nationaux, en particulier pour de grandes études comme Timoun, une cohorte d'enfants qui sont suivis de la naissance jusqu'à l'âge de la puberté. Nous finançons l'analyse très attendue des données de la cohorte des travailleurs des bananeraies, effectuée par l'INSERM et Santé publique France. Nous finançons le registre des malformations congénitales aux Antilles (REMALAN), l'étude KP-Caraïbes de l'INSERM. Nous sommes aussi en lien avec le secrétariat général du ministère de l'agriculture pour les recommandations et le suivi médical des travailleurs des bananeraies, effectué par l'Institut national de médecine agricole (INMA). En 2019, nous finançons à hauteur de 400 000 euros l'étude Timoun, la cohorte des travailleurs, REMALAN et l'INMA.
Pour 2020, en espérant que les arbitrages soient favorables et que le projet de loi de finances se déroule dans les bonnes conditions, nous prévoyons un budget de 600 000 euros pour divers financements : les registres, l'étude de morbidité de la cohorte des travailleurs qui doit permettre de voir s'ils sont malades et de les suivre au long cours, l'étude KP-Caraïbes sur le cancer de la prostate qui est fondamentale, l'étude de l'alimentation totale (EAT) qui est importante pour les Antillais et qui permet de faire le lien entre l'alimentation, la contamination et le suivi de bio-surveillance. Le coût total de cette dernière étude est estimé à 4 millions d'euros.
Sur la période des plans, les financements strictement nationaux du ministère de la santé s'élèvent à 8,5 millions d'euros.
Outre ces crédits du ministère, il y a les mesures du PITE, pilotées au niveau local par les préfets. Le préfet de Martinique suit, depuis décembre 2007, ce PITE qui est alimenté par des prélèvements à la source. Il s'agit d'un financement dédié, fléché et efficace pour les actions locales. Les ministères de l'agriculture, de l'économie, de la recherche, de l'écologie, de l'Outre-mer et de la santé contribuent au programme. Le ministère de la santé finance 11,2 % du PITE, en particulier parce qu'il supporte l'ensemble du programme JAFA qui rencontre un grand succès, selon les ARS de Guadeloupe et de Martinique.
Le Président de la République a annoncé un montant de 3 millions d'euros, il me semble.
En tout cas, le Président de la République avait annoncé que l'action de l'État serait portée à 3 millions d'euros par an. Je m'aligne évidemment sur la décision du Président de la République. Cela représente une augmentation importante puisque la moyenne était d'environ 2,1 millions d'euros sur la période d'analyse, sachant qu'une progression a déjà été enregistrée en 2019 – le montant du PITE a atteint 2,5 millions d'euros cette année. J'avais en tête un montant de 3 millions d'euros pour 2020. Sur toute la période des plans, le financement global du ministère de la santé s'élève à 3,3 millions d'euros.
Je vous ai parlé du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins », des mesures du PITE, de notre contribution. D'autres financements participent à la lutte contre la chlordécone : le budget, que nous finançons aussi, des agences sanitaires nationales que sont Santé publique France, l'ANSES et l'INCa ; le Fonds d'intervention régional (FIR) des ARS est fortement sollicité pour les populations antillaises ; des crédits des collectivités territoriales ; des fonds européens. Je précise qu'il s'agit de fonds dédiés et qu'il n'est pas question de les confondre avec les fonds pour la coopération, l'agriculture ou la recherche. Pour la recherche, par exemple, il faut chercher le FEDER.

Le ministère de la santé et le PITE représentent quelque 15 millions d'euros sur un total d'environ 30 millions d'euros pour les trois plans. La part de l'État représente entre 15 et 18 millions d'euros, le reste étant fourni par les collectivités, à travers les fonds européens. Pour le dernier plan, les fonds européens ont-ils été mobilisés par les collectivités ?
C'est une bonne question à laquelle je ne suis pas sûr de pouvoir répondre. Nous n'avons pas encore le retour concernant la deuxième partie du plan mais je vous ferai transmettre la réponse dès que je serai en mesure de le faire. Sur la partie plus récente, que je suis depuis mon arrivée, je peux vous dire que le niveau d'utilisation des fonds est beaucoup plus satisfaisant.

S'agissant du financement des deux premiers plans chlordécone, vous avez vous-même mis en avant l'insuffisance de consommation de ces fonds. Y a-t-il eu un report de ces fonds non consommés ?
À partir de 2008, j'ai été maire de Trois-Rivières, une commune située dans le sud de zone contaminée. Avec mes services, j'ai été actrice des programmes JAFA qui sont très performants, qui atteignent la population, et dont le résultat est visible et quantifiable. Leur limite était financière, les acteurs de terrain se plaignant de n'avoir pas de fonds suffisants. La sous-consommation des crédits m'étonne alors que de 2008 à 2014, au cours du premier plan chlordécone en Guadeloupe, nous avons manqué de fonds pour le programme JAFA.
Avec le président Letchimy, j'avais eu l'occasion de parler de JAFA. En fait, j'ai déploré les faiblesses de la communication, de la capacité à montrer la mobilisation de l'État. En tout cas, c'est ce qui a été ressenti. Depuis mon arrivée, j'ai vraiment demandé à ce que l'on intensifie les actions de communication. Peut-être avez-vous noté que le site internet chlordécone info permet désormais d'avoir accès à l'ensemble des informations officielles. C'est très important car des personnes se plaignaient de ne pas savoir si les informations glanées ici ou là étaient fiables. Toutes les ARS, qui ont aussi leur site, ont relayé le plan chlordécone. Et puis, il y a le programme JAFA.
Quand je me suis rendu aux Antilles, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient demander de l'aide pour ce programme, ce qui témoigne d'un véritable déficit d'information. Lorsque j'ai rencontré les deux directeurs généraux d'ARS, je leur ai demandé de faire de la publicité pour le programme JAFA. C'est ce qui est en train de se passer.
Toutes les familles, qui ont eu recours à ce programme et que nous avons sollicitées, sont très contentes. Elles expliquent qu'elles ont été bien informées, qu'elles ont fait effectuer des prélèvements, qu'elles ont modifié leur façon de travailler, en élevant leurs poules hors sol, par exemple. Certaines situations ont complètement changé. Les gens ont posé plein de questions sur le chlordécone et ils sont très satisfaits. Le retour est très valorisant. Nous avons massivement soutenu les deux directeurs des ARS des Antilles et l'utilisation du programme explose. Je ne connais pas le taux de croissance exact mais les directeurs ont parlé de plus de 50 %. C'est satisfaisant. Les gens comprennent l'intérêt des programmes JAFA.
Nous avons mis en place deux autres programmes pour réduire l'exposition alimentaire et protéger les femmes enceintes. Vous avez la chance d'avoir énormément d'étudiants, de futurs professionnels de santé, aux Antilles. Pour le service sanitaire qui se met en place, nous avons demandé aux recteurs et aux directeurs généraux d'ARS de faire en sorte que ces étudiants en santé parlent de chlordécone aux élèves du primaire et du second degré. L'initiative prend forme et elle a l'air de plaire : les gens trouvent que c'est une bonne idée. Des étudiants vont aller à l'école primaire, au collège et au lycée pour parler du chlordécone aux plus jeunes. L'idée est que ces jeunes discutent ensuite avec leurs parents du chlordécone, des programmes JAFA, de la réduction de l'exposition alimentaire, de la protection des femmes enceintes.
Nous allons mobiliser la population antillaise. C'est un peu ce que je voulais vous dire en conclusion. Mon objectif, en tant que défenseur de la santé publique, est que la population antillaise soit la moins exposée possible, que l'on atteigne le niveau zéro d'exposition par voie alimentaire. C'est la demande du Président de la République et elle me paraît totalement légitime.
En copilotage national avec le directeur général des Outre-mer, mon rôle va aussi consister à mobiliser tous les acteurs de l'État. À cet égard, je voudrais vous signaler un changement complet de gouvernance ou d'ambiance : actuellement, nous travaillons extraordinairement bien avec les comités de pilotage locaux. Nous sommes en lien permanent avec eux, nous discutons avec les préfets et avec les directeurs généraux d'ARS. Il me semble qu'il y a désormais des réunions au niveau municipal pour mobiliser la population. C'est la clé pour l'avenir.
Si nous voulons construire un grand plan chlordécone IV à la fin de cette feuille de route, cela ne peut se faire qu'en co-construction. Nous avons aussi besoin des élus nationaux et locaux et peut-être même de la population qui a envie de s'impliquer pour déterminer la marche à suivre. Il est très important de définir les bonnes actions, celles qui manquent dans les champs de l'information, de l'éducation, du suivi. Nous restons évidemment dans le domaine de la santé parce que je ne peux pas imaginer tout ce qui peut se faire en environnement ou en agriculture. Il est très important que nous ayons ce retour de votre part sur le ressenti des populations, sur leurs difficultés d'accès à l'information ou sur leurs inquiétudes vis-à-vis de l'impact sanitaire du chlordécone.

La mobilisation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est absolument essentielle et elle existe notamment dans le cadre du programme JAFA. Mais il ne s'agit pas seulement d'informer les responsables politiques, maires ou présidents d'EPCI. C'est une implication en soutien logistique. Si l'on doit être en contact avec l'agriculteur de tel ou tel secteur ou quartier, c'est du face à face, pas de la théorie. La clé du succès d'un changement des pratiques agricoles passe par cette proximité et par des moyens. D'où ma question : pensez-vous qu'un budget de 30 millions d'euros soit suffisant si nous voulons mettre tout cela en oeuvre ? Ne faut-il pas beaucoup plus ?
Je ne tiens pas les cordons de la bourse mais il faudra évidemment adapter les montants alloués – dans le projet de loi de finances et le PITE – aux enjeux construits.
Cela paraît logique. En tant que directeur général de la santé, je ne peux que déplorer la sous-consommation des crédits. Nous mobilisons des crédits de l'État pour des enjeux de solidarité nationale. Autant utiliser ces crédits pour répondre de la manière la plus rapide et efficace possible à ces enjeux.

C'est révélateur d'un blocage. À mon avis, le montant de 30 millions d'euros n'est déjà pas grand-chose compte tenu de l'ampleur de ce qu'il faut faire. A-t-on expertisé les raisons de la sous-consommation ? Les collectivités n'auraient pas apporté leur contribution. Si c'est le cas, il faut le dire.
On peut regarder très précisément, même si je ne suis pas un expert du budget et que le financement est interministériel. Sur la partie santé, j'ai vraiment l'impression que nous avons très peu de sous-consommation, c'est-à-dire que tout ce qui a été décidé et lancé est consommé. De mon côté, je ne me sens pas inquiet. Des crédits venant d'autres ministères n'ont visiblement pas été utilisés. Ce n'est vraiment pas normal en termes de rigueur budgétaire et c'est regrettable par rapport aux enjeux.
Nous avons tous intérêt à poser toutes les bonnes questions, à co-construire le plan chlordécone et à mettre en face les crédits nécessaires.

Je me permets d'y insister. S'agissant d'un cofinancement, une part provient de l'État par le biais de tel ou tel ministère et une autre – qui peut représenter 40 % ou 50 % du total – est fournie par les fonds européens et les collectivités. Un mauvais couplage des deux financements provoque un ralentissement de l'opération prévue. Il faut donc sécuriser aussi bien les fonds locaux que les fonds d'État. En application du principe de libre administration des collectivités locales, nous ne pouvons pas dire à un président de collectivité qu'il est obligé de consacrer une somme précise à l'opération. Cependant, la part des fonds européens doit être garantie.
Si on laisse à une collectivité l'initiative d'accorder ou non un financement, cela peut être désastreux. C'est ce qui se passe en Martinique – je ne connais pas la situation en Guadeloupe. Quand la participation de l'Europe à un projet est de 50 % et qu'elle n'arrive pas, nous ne pouvons que le constater en bout de course. Dans ces conditions, il est normal d'en arriver à une sous-consommation des crédits. Il y a un blocage qui ralentit le projet mais on n'a pas le courage de le dire.
Il faudrait peut-être prévoir une sorte de système de préemption obligatoire des fonds européens dans la loi de finances, compte tenu de la gravité du sujet. Il faudrait prendre une mesure de séquestration d'une partie de la somme destinée au financement du plan chlordécone quand des gens refusent de participer en arguant que c'est l'affaire de l'État. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, c'est notre affaire.
Vous avez tout à fait raison, monsieur le président. Les relations entre l'État et les collectivités territoriales, c'est un sujet. La partie européenne, c'est un autre sujet. Cela étant, je signale que les doubles ou triples financements n'empêchent pas l'action. Nous n'avons jamais arrêté une action sous prétexte que le partenaire manquait sinon ce serait catastrophique. C'est important de le dire. Tout ce qui peut permettre que tous les acteurs soient mobilisés est absolument indispensable.

Je vais prendre un exemple précis. Pour les terrains du programme JAFA, l'État finance les prélèvements et les tests. Pour les terrains hors programme JAFA, la charge est supportée par le propriétaire et les fonds européens. La structure qui organise ces prélèvements et accompagne les agriculteurs n'a pas reçu les aides liées aux fonds européens. Ces prélèvements sont bloqués. En même temps, les cartographies des sols pollués dépendent de ces prélèvements et de ceux qui sont réalisés dans le cadre du programme JAFA ou autres. C'est le chien qui se mord la queue : le blocage des fonds empêche la réalisation de prélèvement dont dépend la cartographie ; or la cartographie est nécessaire pour mener les politiques publiques. Voyez l'incohérence de ce système.
Je suis partisan d'une grande rigueur budgétaire. Le programme JAFA étant totalement entre les mains des ARS, j'ai demandé à ces dernières d'augmenter la dotation. Le nombre d'interventions a beaucoup progressé et les gens sont très contents.
Cela étant, nous devons tous être très attentifs au suivi régulier des plans. Pour ma part je préside tous les plans. Je le fais en lien avec le préfet de Martinique qui préside le comité de pilotage local. Selon lui, les élus doivent demander régulièrement des comptes sur l'état d'avancement du plan. Les acteurs de l'État doivent aller dans les communes discuter avec les élus et la population. Ce qui fonctionne le mieux, ce sont ces réunions locales.
La réunion s'achève à dix-sept heures vingt.
————
Membres présents ou excusés
Réunion du jeudi 11 juillet 2019 à 15 h 25
Présents. – Mme Justine Benin, Mme Annie Chapelier, M. Serge Letchimy, Mme Cécile Rilhac, Mme Hélène Vainqueur-Christophe