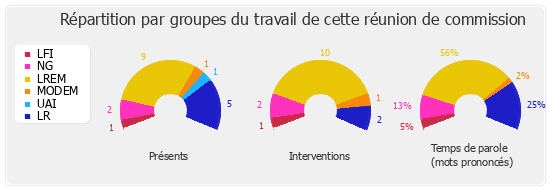Commission d'enquête chargée d'examiner les décisions de l'État en matière de politique industrielle, au regard des fusions d'entreprises intervenues récemment, notamment dans les cas d'alstom, d'alcatel et de stx, ainsi que les moyens susceptibles de protéger nos fleurons industriels nationaux dans un contexte commercial mondialisé
Réunion du mercredi 13 décembre 2017 à 17h00
Résumé de la réunion
La réunion
La séance est ouverte à dix-sept heures.

Nous accueillons aujourd'hui M. Arnaud Montebourg, ancien ministre du redressement productif, puis ministre en charge de l'économie du redressement productif et du numérique, fonction qu'il a occupée jusqu'à son départ du Gouvernement à la fin du mois d'août 2014.
Il va sans dire que cette audition est très importante pour notre commission d'enquête, puisque vous avez eu à connaître, monsieur le ministre, de nombreux dossiers sensibles et à rebondissements, depuis le dossier ArcelorMittal et votre volonté de nationaliser les hauts fourneaux de Florange, jusqu'à PSA que vous avez défendu avec succès
Les observateurs politiques et économiques convergent pour vous reconnaître un incontestable volontarisme en matière de politique industrielle ; chacun peut avoir un avis sur les résultats ou sur l'opportunité même de cet interventionnisme mais personne ne peut vous reprocher d'être resté passif. Votre passage à Bercy aura notamment été marqué par la prise d'un décret, le décret du 14 mai 2014 dit décret « Montebourg » précisant la liste des investissements étrangers, soumis à autorisation préalable, dans le prolongement du décret Villepin. Ce décret a néanmoins été pris dans l'urgence lorsque vous avez découvert le projet de vente d'Alstom à son concurrent américain General Electric (GE).
C'est sur ce dossier très emblématique que nous vous auditionnons aujourd'hui. Nous aimerions vous entendre, dans une triple perspective, la première étant celle de l'« affaire Alstom » proprement dite, telle que vous l'avez vécue à Bercy jusqu'en août 2014 – je rappelle, en effet, que ce n'est pas vous mais votre successeur qui a formellement donné l'autorisation d'investissement en novembre 2014.
Quels ont été, monsieur le ministre, les acteurs gouvernementaux qui, outre vous-même, ont été directement impliqués dans ce dossier, notamment en ce qui concerne l'appréciation des enjeux en termes de sécurité nationale et de défense ?
Une polémique vous a opposé à M. Patrick Kron, alors P-DG d'Alstom. Il aurait, selon vous, engagé des négociations avec GE avant de prévenir le Gouvernement. Avec le recul, pensez-vous qu'il aurait pu prévenir en amont d'autres autorités mais en oubliant de vous en faire part ? Nous interrogerons évidemment M Kron à ce sujet.
Quel a été, selon vous, le poids des procédures américaines anti-corruption dans la décision des dirigeants d'Alstom ? Sur ce point, disposiez-vous à Bercy d'une cellule de suivi de ce type d'affaires qui, s'agissant d'Alstom, était très ancienne, et avez-vous par exemple été alerté qu'un cadre dirigeant d'Alstom était incarcéré aux États-Unis depuis le mois d'avril 2013 ?
Sur le fond du dossier, y avait-il urgence à vendre Alstom au regard des informations en votre possession quant à sa situation industrielle, commerciale ou financière ?
Il existait, semble-t-il, un plan B avec Siemens, qui, dès 2003-2004, lorsqu'Alstom avait connu les problèmes de trésorerie que l'on sait, avait manifesté son intérêt pour la branche « Énergie ». Quels sont les arguments qui vous ont été opposés pour rejeter cette solution, laquelle aurait pour le coup pu constituer un deal entre égaux, et de surcroît entre Européens, Alstom cédant ses activités « Énergie » à Siemens et Siemens cédant ses activités « Transport et Signalisation » à Alstom ? Cette solution a-t-elle, selon vous, été suffisamment explorée.
Enfin, pourrez-vous nous éclairer sur les conseils extérieurs auxquels l'État a eu recours, dès lors notamment qu'il a disposé des actions de Bouygues, pour le conseiller sur ce dossier ?
La deuxième perspective dans laquelle nous aimerions vous entendre est plus générale. À partir du cas d'Alstom et des autres dossiers que vous avez eu à traiter à Bercy, avez-vous le sentiment qu'il y existe dans notre pays, notamment depuis la disparition du ministère de l'industrie, une politique industrielle claire, élaborée par le ministère de l'économie ?
L'État dispose-t-il d'un système de veille stratégique pour nos entreprises et nos filières les plus exposées ? Jugez-vous satisfaisant le processus de contrôle des investissements étrangers, non seulement au regard des textes en vigueur, mais également des pratiques en la matière, Bercy ou l'Elysée opposant souvent le secret des affaires aux tentatives d'investigation sur les dossiers ?
Vous aviez annoncé, lors de la publication de votre décret, la fin du « laisser-faire » : considérez-vous que ce « laisser-faire » était et reste une pratique courante du ministère de l'économie dans ce genre de dossiers ? Existe-t-il à Bercy, une culture de la négociation, voire du rapport de force pour tout ce qui a trait aux investissements étrangers ? Enfin, les Américains disposent avec le Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) d'un système de contrôle et de blocage très abouti ; que vous inspire en comparaison notre dispositif ?
Nous souhaiterions en dernier lieu vous entendre sur l'évolution de la situation depuis l'accord formel donné par l'État en novembre 2014 à la vente d'Alstom « Énergie » à GE. Pouvez-vous nous rappeler de façon précise quelles conditions étaient posées par l'État dans le protocole d'accord que vous avez vous-même signé le 21 juin 2014 ? Ce protocole prévoyait que l'État accorderait son autorisation d'investissement définitive sous réserve de la signature d'accords détaillés confirmant et précisant les engagements prévus dans ce protocole du 21 juin, pour ce qui concernait notamment les questions touchant à la sécurité nationale : estimez-vous que cet ensemble – composé, me semble-t-il, de quatorze contrats et lettres d'engagement – a été élaboré par votre successeur conformément au protocole d'accord général du 21 juin ?
Vos successeurs vous semblent-ils, par ailleurs, avoir fait correctement usage des pouvoirs qui leur étaient donnés pour s'assurer du respect des différents contrats et lettres d'engagement, sachant que le sujet n'est pas épuisé puisque les conseils d'administration des trois joint ventures siègent encore régulièrement ?
La création des 1000 emplois promis par GE sur le périmètre des activités industrielles en France, ainsi que sa promesse de ne fermer aucun site de fabrication avant novembre 2018 ne sont-elles pas une compensation bien illusoire ? En la matière, ce qui est en train de se passer à Grenoble avec les activités hydroélectriques nous laisse pour le moins perplexes.
Enfin, quel regard portez-vous sur le renoncement de l'État à entrer durablement au capital d'Alstom en rachetant par exemple les actions de Bouygues ? D'un côté, M. Bruno Le Maire nationalise temporairement STX, de l'autre, il renonce à toute participation nationale dans Alstom, ce qui implique une perte de contrôle sur les trois joint ventures qui ont été créées mais aussi sur Alstom Transport.
Monsieur le ministre, vous témoignez devant une commission d'enquête parlementaire. Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je dois donc vous demander de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire : « Je le jure. »
(M. Arnaud Montebourg prête serment.)
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, pour être emblématique, l'« affaire Alstom » ne peut se résumer à un symbole. Elle concerne un pan très important de notre activité industrielle, qui plus est dans des secteurs stratégiques, puisque l'entreprise fournissait les turbines de nos sous-marins nucléaires, mais également les îlots conventionnels de nos centrales nucléaires, dont Alstom assure par ailleurs la maintenance globale, ce qui lui donne en partie la main sur notre indépendance énergétique. Si l'on y ajoute les milliers de turbines qu'Alstom a réussi à vendre dans le monde, la branche « Énergie » d'Alstom, Alstom Power, était – je parle à l'imparfait car il serait temps de regarder le présent avec lucidité – un outil industriel stratégique, notamment pour la construction du futur et la transition énergétique. Je rappelle qu'Alstom était leader mondial, avec 25 % des parts du marché des barrages hydrauliques et des turbines, et que le groupe avait investi dans l'offshore avec des turbines de haut niveau, ce qui en faisait l'un de nos acteurs industriels en mesure de relever le défi de l'indépendance dans la transition énergétique, capable en d'autres termes de contribuer à la construction d'un système énergétique destiné à succéder à celui de l'après-guerre.
J'ajoute qu'Alstom était un conglomérat, c'est-à-dire qu'il regroupait des activités disparates, sans nécessairement de lien entre elles, issues de l'ancienne Compagnie Générale d'Électricité (CGE), comme le ferroviaire, les transports et l'énergie. Or, si l'on compare ce que peut être le destin des conglomérats à celui de ce que les financiers appellent les pure players, c'est-à-dire les entreprises centrées sur un seul métier et qui servent souvent de jouets aux banquiers d'affaires, qui adorent découper les entreprises pour les vendre en pièces détachées, parce que cela nourrit leur activité, on constate que les pure players ont tendance à disparaître dès que s'amorce un cycle économique défavorable dans leur secteur, alors que les conglomérats savent compenser ces cycles grâce à leur polyvalence. La CGE n'était d'ailleurs rien d'autre que le Siemens, le General Electric, le Mitsubishi des années quatre-vingt-dix, avant d'avoir été démantelé en de multiples activités, lesquelles ont fait l'objet de ventes par appartement, entraînant d'ailleurs la disparition de certaines d'entre elles.
En matière de transport comme en matière d'énergie, la France disposait du contrôle des centres de décision d'Alstom et pouvait orienter comme elle le voulait ses ressources en matière de R&D ou ses investissements à l'étranger – je souligne ce point dans la mesure où la commande publique est un élément déterminant pour piloter une entreprise qui, en l'occurrence, n'était pas sans lien avec nos intérêts nationaux.
Cette histoire n'a donc rien d'anecdotique, et ce fut évidemment une très grande surprise pour le gouvernement auquel j'avais l'honneur d'appartenir de découvrir que le Board d'Alstom et ses actionnaires avaient déjà ficelé un accord dans notre dos.
J'ai lu depuis lors à peu près tout ce qui a été publié sur l'affaire, je me suis renseigné avec les moyens du citoyen ordinaire que je suis redevenu, et rien ne me permet aujourd'hui de retirer un mot des déclarations que j'avais faites à l'époque devant la représentation nationale. Le Gouvernement a bel et bien été pris par surprise, alors que certains signaux d'alerte laissaient entrevoir qu'Alstom ne pourrait pas demeurer éternellement un loup solitaire dans la consolidation mondiale que connaissaient les activités ferroviaires et énergétiques. Il devenait nécessaire que l'entreprise trouve des alliés et construise des stratégies mondiales devant permettre à la France de continuer sa course dans un monde en mutation.
J'avais d'ailleurs, en février 2014, commandé une étude au cabinet Roland Berger pour éclairer le Gouvernement. Ce document, que je pourrai vous remettre, daté du 19 février et intitulé « Projet Almaconfidentiel » établissait qu'Alstom n'était pas en situation d'urgence et qu'il existait de multiples possibilités permettant d'éviter un rachat, une OPA ou la vente d'actifs, par exemple en nouant une alliance soit avec une entreprise nationale – je pense notamment à Thales et à ses activités de signalétique dans le ferroviaire : l'État, présent des deux côtés, aurait ainsi pu construire une stratégie mondiale à partir de nos seules ressources – soit avec des entreprises asiatiques, européennes ou américaines, ce qui nous aurait permis de consolider notre conglomérat ferroviaire et énergétique.
D'autres options moins précipitées existaient donc, mais il n'a jamais facile d'en discuter avec Patrick Kron, personnage doté d'un fort caractère. On ne peut certes en vouloir à un chef d'entreprise d'avoir du caractère et de dire « non » à l'État, tout comme l'État peut lui dire « non »; l'essentiel est que les deux parties puissent se parler, ce qui n'a pas été le cas.
Je me souviens notamment d'un voyage présidentiel à Abou Dhabi à l'hiver 2013-2014 auquel nous participions tous les deux et au cours duquel, à la faveur d'une réception à l'ambassade, je me suis isolé avec M. Kron pour l'interroger sur ses projets d'alliance et sa stratégie, sachant que Bouygues, l'actionnaire majoritaire, manifestait une certaine impatience à se désengager ; je n'obtins aucune réponse sinon qu'Alstom trouverait une solution et que l'État n'avait pas à s'en préoccuper. Je rappelle que nous parlons là d'une entreprise dont les rapports avec l'État ne datent pas d'hier et qui a été sauvée en 2004 par M. Sarkozy– ce dont il faut lui savoir gré.
Lorsque le dirigeant d'une entreprise, qui fait en quelque sorte partie des bijoux de famille, vous assure que rien ne sera fait sans que vous en soyez averti et qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, vous avez donc toutes les raisons de croire.
Malheureusement, M. Kron n'était sans doute pas en mesure d'agir avec transparence, et le gouvernement français a été pris par surprise par ce que je qualifierais de stratégie de dissimulation. De même, nous avons été surpris par l'ampleur des procédures engagées contre Alstom et certains de ses cadres dirigeants par le Department of Justice américain (DOJ).
Nous étions au courant, naturellement, des difficultés américaines d'Alstom et de l'arrestation de l'un de ses cadres, mais je dois dire que, dans le traitement de cette affaire, le Gouvernement a fait preuve d'une grande naïveté, le Quai d'Orsay se bornant à agir comme il l'aurait fait pour n'importe quel citoyen lambda emprisonné aux États-Unis. Notre système interministériel d'intelligence économique n'a pas fonctionné, dans la mesure où les signaux d'alertes ne sont même pas parvenus jusqu'à moi.
Rétrospectivement, je comprends mieux dans quelle situation se trouvait M. Kron et les raisons pour lesquelles il avait pratiqué la dissimulation pour mettre le Gouvernement, les salariés et les syndicats devant le fait accompli, en ayant pris soin au préalable de verrouiller les positions de son conseil d'administration pour que toute discussion soit impossible et qu'on ne puisse pas revenir en arrière. On aboutissait ainsi à cette situation inouïe : la branche « Énergie » d'Alstom, soit environ 10 milliards d'actifs, si impliquée dans le fonctionnement de notre parc nucléaire ou dans celui de notre marine nationale, allait être vendue à des Américains sans que nous en ayons été informés. Sans doute M. Kron était-il lui-même sous la pression judiciaire des États-Unis pour en être arrivé là. Si vous souhaitez en savoir davantage, je pourrai fournir des détails susceptibles d'éclairer la représentation nationale, mais je ne souhaite pas le faire publiquement, dans la mesure où certaines procédures sont encore en cours.
Vous m'avez également interrogé sur l'existence d'un plan B. Il y a toujours une autre solution, à condition qu'elle soit crédible, avantageuse et qu'elle porte en elle les fruits de l'avenir. Or, selon moi, l'accord avec General Electric ne pouvait pas être un bon accord, mais je n'avais pas d'autre solution que de négocier dans le cadre qui m'avait été fixé. J'ai donc eu recours à toute l'ingénierie politique et juridique dont je disposais pour obtenir un changement d'attitude. Au mois d'avril, il n'y avait pas de négociation possible avec M. Immelt, président de GE mais, lorsque, le 14 mai, nous avons sorti le décret, la météo a subitement changé : l'État s'était armé, et des gens qui ne nous parlaient pas ont commencé à vouloir discuter et se sont montrés prêts aux premières concessions.
J'ai donc donné un mandat de négociations au directeur général de l'Agence des participations financières de l'État (APE), David Azéma, lequel s'est entouré de ses conseils, avocats ou banquiers d'affaires. Je prenais moi-même conseil auprès de M. Arié Flack, un banquier d'affaires, qui nous a beaucoup aidés à construire la contre-offensive face à GE et à trouver les moyens d'empêcher qu'une entreprise pesant 250 milliards d'euros n'en dévore une pesant dix fois moins, c'est-à-dire 25 milliards. Sans compter que nous avions en face de nous des Américains, se présentant avec des moyens sans commune mesure avec ceux des Allemands que nous étions pourtant allés chercher dans l'espoir de trouver un accord qu'ils souhaitaient depuis longtemps. Notre tentative a malheureusement échoué car non seulement Siemens était dans une situation difficile sur le marché européen mais la mésentente était totale entre M. Kron et M. Kaeser, comme entre les organisations syndicales. Sachant que les élus de Belfort et du pays de Montbéliard étaient eux-mêmes en désaccord avec leurs homologues allemands, il était clair que la solution européenne serait difficile à atteindre. Cela demandait du temps, car un bon accord réclame de la patience et de la subtilité.
Les Allemands ayant refusé nos conditions, seule demeurait la solution radicale de bloquer la vente.
Le Président de la République, M. Hollande, ne le souhaitant pas et le Premier ministre ne me soutenant pas sur cette option, j'ai donc été contraint d'agir par la négociation, sachant que, si l'issue des discussions était déjà écrite, il me fallait néanmoins préserver au mieux les intérêts français.
Je voudrais ici vous dire deux mots de cet accord, au sujet duquel on a beaucoup écrit mais dont je considère qu'il pouvait avoir pour notre pays des aspects positifs.
GE avait donc décidé de couper Alstom en deux, d'acheter sa branche « Énergie » et de laisser le ferroviaire. Nous avons alors fait savoir à M. Immelt qu'on ne pouvait abandonner ainsi un pan de notre industrie sur lequel reposait pour partie notre souveraineté, et avons décidé d'opposer aux Américains notre propre « CFIUS », en publiant le décret du 14 mai, grâce auquel j'ai pu exiger et obtenir, au terme d'une négociation interminable et difficile, que le nucléaire soit isolé du reste de l'activité « Vapeur » rachetée par GE, Nous avons également pu obtenir un droit de véto au bénéfice du gouvernement français, ainsi que la nomination, parmi les cinq administrateurs français, d'un administrateur représentant l'État et assumant en quelque sorte les fonctions de « surveillant général » pour la nouvelle co-entreprise nucléaire, ce qui devait permettre de protéger les intérêts français. J'admets que c'était un pis-aller, puisque, normalement, une industrie de cette nature n'aurait pas dû être vendue.
Ces intérêts sont-ils réellement défendus ? Je l'ignore. Il faudrait interroger l'administrateur de la Direction générale des entreprises (DGE), placé sous les ordres du ministre de l'économie : assiste-t-il aux conseils d'administration ? Pose-t-il des questions ? Enquête-t-il ? Je rappelle par ailleurs qu'un expert indépendant devait être nommé, en l'occurrence Vigeo, une agence d'évaluation des entreprises spécifiquement désignée dans l'accord dont je vous remettrai un exemplaire, ce qui vous permettra de constater à quel point il est précis et original.
Cet expert était supposé suivre l'activité en temps réel et remettre chaque année un rapport sur la bonne exécution des clauses de l'accord. J'ignore si ces rapports ont été demandés et s'ils ont été lus après mon départ de Bercy. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'ils n'ont jamais été acceptés par les dirigeants d'Alstom pour la bonne et simple raison que ces derniers étaient absolument opposés au fait que nous nous battions pour conserver, malgré la défaisance, un tant soit peu de souveraineté sur les activités énergétiques d'Alstom.
Nous avions donc contre nous, les gens d'Alstom que l'on voulait sauver malgré eux, M. Kron, M. Bouygues, qui arguait d'un accord l'obligeant à aligner son vote sur celui du PDG d'Alstom, M. Jean-Martin Folz, président du comité des administrateurs indépendants d'Alstom, qui avait déjà décidé que la vente était faite, et enfin M. Poupart-Lafarge, qui parlait, quelque temps après la signature de l'accord, de « ce qu'il restait d'Alstom »… Mais, ce qu'il restait d'Alstom, c'était trois co-entreprises, pesant des milliards, un droit de véto du gouvernement français et le ferroviaire.
Pourtant, dans l'esprit de M. Poupart-Lafarge, le nouveau P-DG d'Alstom, il n'était plus que le dirigeant d'une entreprise ferroviaire, ce qui le conduisait à déclarer dans Le Figaro, en 2016, que les co-entreprises qui regroupaient les anciennes activités « Énergie » seraient vendues : cela n'a suscité aucune réaction chez personne, alors qu'il s'agissait de nos turbines, de nos îlots conventionnels, du Charles-de-Gaulle et de la plupart des bâtiments de notre marine nationale !
Je suis pour ma part extrêmement choqué par cette absence de réaction tant du côté d'Alstom que du côté du Gouvernement. Peut-être ne sais-je pas tout de ce qu'a fait alors le Gouvernement ? Quoi qu'il en soit, la manière dont il s'est exprimé publiquement sur le sujet a sans aucun doute contribué à réduire considérablement la portée de l'accord qui avait été signé.
Les activités liées aux énergies renouvelables et à la transition énergétique avaient été regroupées dans l'une des trois co-entreprises – GE « Renewable. » Dans la mesure où il s'agissait d'industries d'avenir, nous avions fait en sorte qu'Alstom puisse les racheter. Car vous devez savoir que, si Alstom peut vendre, elle peut également, pendant une durée de cinq années après la signature de l'accord, c'est-à-dire jusqu'en 2019, racheter « GE Renewable », à laquelle appartient l'entreprise de Grenoble GE « Hydro » et qui pèse aux alentours d'un milliard d'euros.
L'entreprise GE « Hydro », à Grenoble, en fait partie. Je me suis d'ailleurs rendu sur place à la demande des organisations syndicales. Elles ne connaissaient pas l'accord et je le leur ai donc donné. Je leur ai dit que j'avais des comptes à rendre sur ma gestion et qu'il était donc normal que je les rencontre, même si je ne suis plus ministre, ni élu. J'ai apporté publiquement des réponses, en présence de tous les salariés. J'ai expliqué qu'Alstom pourrait racheter et que le Gouvernement pourrait se débrouiller pour récupérer les outils industriels de la transition énergétique.
Comme il ne faut jamais venir sans idées nouvelles, j'ai une proposition à vous faire. J'ai des idées de l'ancien monde pour le nouveau. (Sourires). Je propose que l'État se débrouille pour conclure un accord de place avec l'ensemble des investisseurs afin de racheter ces entreprises très profitables, au lieu qu'elles soient vendues par GE à des Chinois, car c'est ce qui se prépare, après le dégraissage de l'entreprise de Grenoble. C'est pour moi inadmissible, car cette entreprise gagne de l'argent. Elle est parfaitement rentable et répond avec succès à des appels d'offres internationaux. C'est elle qui a réalisé les turbines du barrage sur le Yang-Tsé-Kiang. Elle représente 25 % du marché mondial. Ce n'est donc pas une petite affaire et nous avons tout intérêt à en garder la maîtrise dans le cadre de la transition énergétique.
Je voudrais maintenant élargir mon propos, comme vous m'y avez invité, à la politique industrielle.
Dans la mondialisation, je pense que les États mènent une guerre économique à travers leurs entreprises. Il existe des alliances entre elles et l'État en Allemagne, au Japon ou encore aux États-Unis. Tous les pays industriels ont des alliances « public-privé » pour défendre leurs intérêts stratégiques. En revanche, le public et le privé sont extrêmement divisés dans un pays : la France. On considère que l'État est la cause des problèmes. On ne veut donc pas qu'il se mêle d'industrie ! On pense qu'il y a un problème avec la puissance publique, jugée tantôt excessive, tantôt trop faible, et la conception de la politique industrielle est instable, alors qu'il faudrait établir des alliances durables et transpartisanes.
C'est une question sur laquelle on doit dépasser les clivages politiques et qui doit être traitée dans la durée. Je ne comprends pas que l'on puisse changer de politique industrielle à chaque changement de ministre : on devrait poursuivre le même effort sur une décennie. Après les dégâts considérables qui ont été causés par la crise de 2007-2008, il faudrait mener la même politique pendant dix ou quinze ans afin de retrouver notre niveau de production industrielle. Je ne comprends pas comment on peut faire disparaître le ministère de l'industrie, ni pourquoi il n'y a plus personne dans les cabinets ministériels pour s'intéresser au sujet. S'il n'est pas traité par l'État, entre quelles mains se trouve-t-il ? Celles des marchés et des banques d'affaires. C'est une question qui me préoccupe, même si d'autres gouvernements ont procédé de la même manière.
Dans la panique des années 2012 et 2013, c'est-à-dire pendant la deuxième rechute industrielle, nous avons monté une équipe très forte afin de lutter contre toutes les faillites. Pardonnez-moi de parler un instant de politique, mais les libéraux considèrent qu'une entreprise en faillite est condamnée et qu'il ne faut surtout pas la soutenir. C'est comme si on disait que les malades doivent être abattus à l'entrée des hôpitaux parce qu'ils prennent le sang des autres. C'est un peu l'état d'esprit. Pour ma part, je crois que certains malades peuvent survivre. C'est le travail du médecin que de faire un tri et un sauvetage. On a fait de la médecine de catastrophe dans les années 2012 et 2013 avec les commissaires au redressement productif et la cellule « Restructurations ». Quand je me rends dans nos territoires, je suis assez fier que l'on me dise encore : « heureusement que vous l'avez fait, car ça a fonctionné ici ».
C'est possible quand on s'en occupe, quand on mobilise les ressources humaines, intellectuelles, économiques et financières. La Banque publique d'investissement (Bpifrance) a été créée dans ce but et c'est aussi un motif de fierté pour moi. Je crois que nous pouvons avoir une politique industrielle qui traverse le temps, qui est constante et qui permet d'obtenir des résultats. La fin du laisser-faire est une question de désir et de volonté. Mais on peut aussi être aveuglé par l'idéologie et considérer que se mêler de politique industrielle revient d'abord à s'exposer. C'est vrai : cela revient à s'exposer au mécontentement, à l'inquiétude et au désespoir des salariés, des territoires, des élus, des sous-traitants et des petits patrons. Ces gens existent. Ce sont des hommes et des femmes qui souffrent. Il faut donc s'en occuper. On peut considérer que l'on n'a pas à le faire et alors on n'en parle jamais. Je pense le contraire. Cela suppose d'avoir un outil puissant, constitué de l'Agence des participations de l'État (APE), de Bpifrance, de cerveaux – une administration peut se réarmer – et d'outils réglementaires pour les investissements étrangers.
Vous me demandez si l'État dispose d'une veille stratégique : elle n'existe pas. Nous-mêmes, dans le dossier Alstom, avons fait appel à des cabinets extérieurs. Il y a bien sûr du personnel de très haut niveau, mais l'État n'a pas été organisé comme il le faudrait pour répondre au besoin d'expertise quand il s'agit de prendre de bonnes décisions industrielles d'une telle nature. Il faudrait créer l'équivalent du MITI japonais, ce qui intéresserait d'ailleurs beaucoup de hauts fonctionnaires qui se spécialiseraient dans ce type de travaux. On disposerait ainsi des outils nécessaires à la décision.
En ce qui concerne le contrôle des investissements étrangers, j'ai toujours été frappé d'entendre de nombreuses entreprises étrangères, notamment de grands groupes américains, qui représentent une véritable puissance d'investissement sur notre territoire, nous expliquer qu'elles vont dans les pôles de compétitivité et qu'elles aiment beaucoup nos clusters parce qu'elles peuvent y faire leur marché, leur shopping. Il y a un vrai sujet de perte de substance, y compris s'agissant des « pépites » technologiques, parce que nous ne savons pas les financer. Nous avons les ressources, mais nous n'avons pas décidé d'agir. La France a l'un des taux d'épargne les plus élevés au monde, mais on ne flèche pas l'épargne vers ces entreprises. Il y a donc un travail à faire sur la question du financement de notre avenir. Il est industriel, et pas seulement numérique.
Existe-t-il une culture du rapport de force ? C'est tout l'art du ministère de l'économie que d'être à l'écoute, mais aussi de savoir dire « non ». C'est une dialectique délicate, digne d'un équilibriste : vous recevez les dirigeants du CAC 40 et, en même temps, vous ne leur permettez pas de faire n'importe quoi.
On aurait ainsi pu éviter l'alliance entre Technip et FMC. Technip est une entreprise extrêmement prospère. Présente au CAC 40, elle emploie des dizaines de milliers d'ingénieurs dans le monde. Issue de l'Institut français du pétrole (IFP) et bénéficiant des brevets que la puissance publique lui a permis d'obtenir, cette entreprise est l'une des toutes premières en matière d'équipement pour le pétrole et le gaz. Technip a fusionné avec FMC, entreprise texane quasiment en faillite, et nous avons maintenant un outil industriel très abîmé. Il aurait été normal que Technip rachète FMC, mais l'entreprise a au contraire déménagé son siège social à Houston, après avoir distribué au conseil d'administration de quoi obtenir son silence. Il n'y a donc pas que la question des banquiers d'affaires qui se pose, mais aussi celle des conseils d'administration. Vous pourriez vous demander qui en est membre et qui prend ce type de décisions.
Quand l'État peut dire « non », grâce à un décret, ou « oui, mais » sous un certain nombre de conditions, vous êtes plus forts que si vous n'avez pas les moyens d'intervenir. La fin du laisser-faire est entre les mains de ceux qui laissent faire ou ne laissent pas faire. Tout un dispositif est à reconstruire. La culture du rapport de force est nécessaire. On doit y aller avec le sourire, mais le faire quand même.
J'en viens à l'évolution de l'accord entre Alstom et GE, dont j'ai déjà dit un mot tout à l'heure.
Cet accord comportait un certain nombre d'éléments originaux. Avec le décret du 14 mai 2014, nous avons imposé, pour la première fois, la création de coentreprises, le maintien de sièges sociaux mondiaux en France et la désignation des dirigeants par GE après consultation d'Alstom. Néanmoins, si Alstom est aux abonnés absents et ne cherche pas à faire vivre l'accord, celui-ci n'a aucune suite et c'est ce qui s'est passé. Le fait que GE ait désigné un Américain de son choix et qu'Alstom n'ait rien eu à redire a eu beaucoup de conséquences sur ce qui s'est produit ensuite dans l'entreprise. Ce sont les syndicats qui l'expliquent – ils ont dû vous en parler lorsque vous les avez auditionnés. Si Alstom est combatif, défend sa marque, ses usines, ses salariés, ses technologies et ses brevets, la situation est différente. Mais Alstom n'a pas fait ce travail.
C'est pourquoi j'avais arraché au Président de la République la nationalisation d'Alstom, partielle, à hauteur de 20 %, avec la reprise des parts de la famille Bouygues, qui détenait une partie du capital. Cette prise de contrôle permettait de faire face à une alliance qui n'était pas égalitaire entre GE et Alstom – il y avait d'un côté 250 milliards d'euros et, de l'autre, 12 milliards. Il était nécessaire que l'État soit là. M. Immelt comme M. Flannery, aujourd'hui, respectent l'État puisqu'ils vivent de lui au travers des commandes publiques…
Cet accord n'avait pas seulement pour originalité la création de coentreprises, avec des possibilités de rachat, notamment pour la coentreprise « Renewable ». Pour la première fois, on a aussi prévu une sanction en cas de non-respect des engagements en matière d'emploi. M. Immelt est arrivé avec Marilyn Monroe sur le capot de sa Buick ! Il a descendu les Champs-Élysées et il nous a fait un grand numéro de charme. Tout le monde a succombé. Mais nous lui avons dit que nous voulions des garanties.
C'est la première fois qu'un accord prévoyait une sanction. Elle est symbolique : 50 000 euros par emploi non créé, avec une limitation fixée à 50 millions d'euros. Mais cela aurait pu servir pour d'autres accords. Quand il y a un décret permettant de refuser des investissements, on peut imposer des sanctions. Pour aller plus loin, il faudrait imposer, la prochaine fois, la nullité de l'accord à titre rétroactif, comme le permet le droit des affaires. Cela fait partie des propositions que je peux formuler à ce stade de la réflexion collective sur la perte de nos outils industriels.
Je ne peux pas considérer que l'accord a été respecté puisqu'il y a déjà des pertes d'emplois. Le Gouvernement doit faire respecter les engagements et il peut faire racheter par Alstom la partie « Renewable ». Au lieu d'envoyer deux personnes au conseil d'administration, l'État aurait mieux fait de nationaliser vraiment et de se faire prêter des parts, afin d'être présent au Board. Il fallait procéder comme dans le cas de Peugeot, lorsque l'alliance avec Dongfeng a été construite. La famille Peugeot était à 37 % ; quand on est entré au capital pour sauver l'entreprise, cette part est passée à 14 %, l'État a pris 14 % aussi et on a laissé aux Chinois le même pourcentage. Cet équilibre fragile nous a permis d'avoir Louis Gallois comme président du conseil de surveillance et de procéder à un très bon recrutement en la personne de Carlos Tavares, qui a fait redémarrer l'entreprise.
Après la nationalisation d'Alstom, on pouvait imaginer qu'un scénario de même nature nous permette de défendre nos intérêts de souveraineté, de nous battre pour racheter tout ce que nous pouvions, pour avoir les éléments d'une reconstruction du patrimoine industriel, et d'être présents sur le volet du renforcement et de la consolidation du secteur ferroviaire. Dans l'agrément que vous pourrez lire, GE s'est engagé à nous vendre son entreprise de Signalling aux États-Unis, afin qu'Alstom puisse entrer sur ce marché. Je note que GE n'a jamais respecté cet accord : il y a aujourd'hui un conflit avec Alstom sur ce terrain. M. Immelt nous a donc raconté des menteries quand il est venu à l'Élysée, dans mon bureau et à chaque fois que nous avons eu une discussion.
Les accords exécutés avec déloyauté doivent faire l'objet d'une sanction. L'État en a les moyens. Il faut juste accepter de se brouiller avec quelques personnalités de l'Establishment mondial. Je pense que c'est possible. De qui s'agit-il ? De tous ceux qui vivent de ces entreprises et qui ont des intérêts. Cela fait partie du métier de ministre de l'économie : il ne faut pas être dans les mondanités, mais plutôt dans les usines.

Merci pour cet exposé, émaillé de quelques propositions. Je me réjouis que le président de la commission des affaires économiques soit présent pour les entendre. Je pense notamment à ce qui concerne notre organisation en matière de veille et de pilotage de la politique industrielle – sans vouloir anticiper sur les conclusions de la commission d'enquête, je crois que ce sujet pourrait faire l'objet d'un consensus.
Une de vos propositions est qu'Alstom exerce son call sur la branche « Hydro », comme le prévoit l'accord que vous avez signé le 21 juin 2014. Malheureusement, j'observe que cela donnerait à GE la possibilité de faire jouer son propre call sur les activités nucléaires : on perdrait totalement le contrôle de ce secteur. En réalité, il faudrait donc un tour de table plus complet, à supposer que les différents protagonistes y soient prêts.
La valeur de la parole publique est un sujet important. On fait toujours des annonces mirifiques et rassurantes pour l'opinion : selon les communiqués de presse, on crée de nouveaux Airbus…
Lorsque vous vous êtes exprimé devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, le 24 juin 2014, soit trois jours après la signature du protocole d'accord – vous assuriez en quelque sorte le service après-vente –, vous avez déclaré avoir confié au directeur général de l'APE, qui était alors M. Azéma, un mandat de négociation visant à conclure une alliance, au lieu d'un rachat pur et simple d'Alstom. Avec le recul, n'était-ce pas une vision un peu optimiste ?
Vous avez également déclaré qu'au sein de la coentreprise GEAST, en charge des activités nucléaires, l'État disposerait d'une « action spécifique, appelée golden share, qui impose la présence dans le conseil d'administration, en plus des cinq administrateurs d'Alstom et des cinq administrateurs de GE, d'un représentant de mon ministère ». C'est faux : en réalité, le représentant de l'État est choisi par les cinq administrateurs d'Alstom. Il y a donc un administrateur pour l'État, quatre pour Alstom et le reste pour GE, c'est-à-dire que l'on arrive à la parité moins un. Cela fait donc deux approximations. J'aimerais que vous reveniez sur ces déclarations.
Autre question, également très précise, j'ai lu avec attention la tribune que vous avez publiée dans Le Monde, il y a quelques semaines, au moment de la cession de la branche « Transport » à Siemens. Vous avez écrit que l'accord définitif a finalement été conclu dans le Salon vert de l'Élysée, le 21 juin 2014, devant le Président de la République et en présence du secrétaire général de l'Élysée. Or le 21 juin est le jour où vous avez signé le protocole d'accord. J'ai du mal à y voir clair en ce qui concerne le calendrier : j'imagine que le feu vert pour signer le protocole d'accord a été donné par la Présidence de la République auparavant. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est ?
Vous déclarez aussi que vous avez reçu dans votre bureau Joe Kaeser, le patron de Siemens, qui vous a proposé le deal suivant : lui vendre l'énergie, sauf le nucléaire, en contrepartie de quoi il céderait le ferroviaire et l'activité Signalling. Aujourd'hui, toute l'argumentation de M. Poupart-Lafarge pour justifier la vente de la branche « Transport » consiste à dire que l'accord n'était pas possible à l'époque car les Allemands refusaient de vendre leur activité Signalling. Qui faut-il donc croire dans cette affaire ?
Je reviendrai d'abord sur ce que vous appelez des approximations.
J'ai relu mes déclarations pasées devant la commission des affaires économiques, avant de venir devant vous, et je n'ai pas un mot à retirer. Il y a peut-être l'interprétation que j'ai faite – c'est un autre sujet –, mais en ce qui concerne le représentant de mon ancien ministère, dont je vous ai suggéré tout à l'heure de regarder s'il participe et ce qu'il fait, je souligne qu'il ne s'agit pas d'un représentant d'Alstom : c'est lui qui dispose des pouvoirs de l'État et qui exerce les droits de véto en notre nom, c'est-à-dire celui de la nation. Je ne vois donc pas où se trouve l'approximation.
L'alliance, telle que nous l'avions conçue, en était-elle une ? Elle aurait pu le devenir, je le crois. C'est le sens que je donne à la volonté qu'Alstom aurait pu avoir et à celle de l'État, qui aurait pu prendre le contrôle de cette entreprise. Je pense que nous aurions pu avoir une alliance. Si nous l'avions imaginé, c'est qu'une autre alliance a fonctionné : celle concernant les moteurs que Safran et GE construisent depuis près d'un demi-siècle, avec un succès extraordinaire sur le plan mondial. Ces deux entreprises sont à « 50-50 » si mes souvenirs sont bons – mais je ne voudrais pas être approximatif sur ce point. Lorsque nous avons construit les coentreprises, nous avions en tête ce précédent entre Safran, anciennement SNECMA, et GE, dont nous avions célébré à Washington le quarantième anniversaire avec le Président de la République. Cela veut dire que c'est possible, que ça fonctionne, mais il faut que chacun en ait envie.
Ma vision était certainement optimiste, au regard de mes anticipations. Je pensais que l'État serait à la tête d'Alstom, et non M. Poupart-Lafarge. Il considère qu'il dirige une grande entreprise ferroviaire, sans maintien de l'activité énergétique. Il faisait partie du Board, du Comex qui a pris la décision de s'en séparer. Il y a un problème : on n'a pas nationalisé Alstom, comme le prévoyait le dispositif d'ensemble tel que nous l'avions conçu à l'époque.
M. Fasquelle m'avait alors interrogé sans complaisance – c'est le moins que l'on puisse dire –, comme il le fait toujours et je l'en remercie, car cela fait partie de votre travail. Il m'avait dit qu'il s'agissait d'un « habillage ». Je lui avais répondu que la condition était que l'État s'en mêle, sinon cela ne marcherait pas. C'est malheureusement ce qui s'est produit.
Ma vision était optimiste au regard de ce qui s'est produit par la suite : j'étais fondé à penser que la nationalisation aurait lieu et que nous aboutirions ainsi à une situation beaucoup plus intéressante.
En ce qui concerne le 21 juin 2014, je ne peux pas être formel sur la date, mais tout s'est noué en l'espace de quelques heures. Était-ce sur deux jours ou un seul ? Je sais que tout s'est décidé au dernier moment, car nous avions besoin de temps. Nous avons comprimé la discussion finale au moment du conseil d'administration d'Alstom, si mes souvenirs sont bons. Je me rappelle avoir attendu sur le trottoir, en bas du cabinet Bredin Prat, qui représentait Alstom, me semble-t-il, alors que MM. Immelt et Kron m'attendaient en haut : il fallait que les derniers éléments du protocole d'accord, notamment s'agissant de la sanction en matière d'emploi, figurent noir sur blanc – les dirigeants eux-mêmes n'en voulaient pas. C'était une période extrêmement agitée : je me souviens que tout s'est déroulé en environ vingt-quatre heures, mais je ne saurais pas vous dire si la conclusion a eu lieu le matin ou l'après-midi. En tout cas, il n'y a pas de violence contre la vérité dans l'erreur, s'il y en a une.
M. Kaeser ne voulait pas : c'est pourquoi personne n'était convaincu par un accord avec Siemens. Néanmoins, ma conviction était que si nous avions bloqué la vente avec GE et repris le dossier, nous serions parvenus à un accord franco-allemand. Je vais vous dire pourquoi j'ai défendu cette position : nous avons des cordes de rappel avec nos amis allemands, nous sommes capables de discuter et de nous entendre. C'est préférable à des accords avec des territoires lointains qui ne sont pas parties aux multiples questions que nous avons à négocier avec nos partenaires européens. Il est toujours préférable de conclure un accord avec un voisin, même si c'est plus difficile. Un deuxième sujet était extrêmement délicat : l'accord avec Siemens signifiait 3 000 emplois en grave difficulté. Les élus et les syndicats étaient donc tous hostiles, des deux côtés du Rhin. La situation n'était pas facile.
L'accord actuel entre Alstom et Siemens nous prive des capacités de maîtriser la suite des événements – même si c'est plus facile avec les Allemands qu'avec les Américains. Le résultat est que nous avons perdu le contrôle de deux industries en l'espace de trois ans. Or je crois que nous avons besoin de les maîtriser. Des générations de Français ont travaillé dans ces entreprises et les ont bâties patiemment. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus savoir ce qu'il en adviendra – en tout cas, nous aurons du mal.
Il était parfaitement réaliste et possible de gagner du temps, de rester seul et de construire une stratégie avec d'autres alliés. Une solution faisant appel à Mitsubishi avait été envisagée. C'était la meilleure car il n'y avait pas de doublons. Nous étions présents sur le champ européen mais aussi asiatique, avec la possibilité d'un accord mondial très fort dans le domaine de l'énergie. Il y avait d'autres solutions sur la table, mais il aurait fallu être capable de dire « non » à nos amis américains. M. Kron est venu me voir pour me dire que si je n'acceptais pas l'accord avec GE, il me faisait immédiatement un plan social concernant 5 000 personnes. Voilà comment se comportent les dirigeants d'entreprise à l'égard du Gouvernement. Il faut que vous le sachiez.

Je vous remercie de votre présence pour répondre aux questions de la représentation nationale.
Tout d'abord, qu'est-ce qu'une entreprise stratégique ? La question peut paraître triviale, mais elle est en réalité beaucoup plus complexe que l'on croit. Nous avons eu des réponses très différentes à chaque audition. Si l'on demandait aux députés ici présents d'établir une liste des entreprises stratégiques, nous n'aurions pas deux fois la même copie. Et si on les mettait toutes bout à bout, on obtiendrait probablement l'ensemble des entreprises du CAC 40, de l'énergie à l'agroalimentaire en passant par la santé, l'industrie lourde, les transports, l'eau ou encore la défense. Or, si tout est stratégique, rien ne l'est. Définir des entreprises stratégiques impose de faire des choix. D'où ma question : qu'est-ce qu'une entreprise stratégique ? La définition évolue-t-elle dans le temps ? Est-elle aujourd'hui la même qu'il y a quelques années ?
J'en viens au plan B et à votre métaphore du médecin. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait dans cette salle des médecins altruistes d'un côté et, de l'autre, des croque-morts égoïstes. Le monde, qu'il soit ancien ou nouveau, n'est pas forcément binaire. Il y a ici des députés qui veulent unanimement soutenir notre industrie, qui en sont fiers, qui ont de beaux succès dans leur circonscription, avec aussi des investisseurs étrangers, et qui souhaitent protéger la souveraineté, le savoir-faire et les compétences de notre industrie.
Quel « Plan B » le médecin peut-il proposer ? Dans certains cas, ne s'agit-il pas d'acharnement thérapeutique ? Vous avez dit qu'à l'époque, vous étiez seul à soutenir votre position, contre la volonté de tous ; l'ensemble même du management de l'entreprise était défavorable à votre proposition. Dans ces conditions, que peut faire le politique ? Quelles sont les options une fois que l'on a dit que l'on ne voulait pas d'un investisseur étranger ? Qui finance ? Qui remplit le carnet de commandes ?
Ma troisième question porte sur le principe même des investissements étrangers en France. Tout comme le président de notre commission, je suis attentif aux prises de parole publiques, aux communiqués et aux postures médiatiques des uns et des autres. Pour certains, le rachat d'Alstom par GE ne convenait pas parce qu'il s'agissait d'une entreprise américaine ; un « territoire lointain », comme vous avez dit. Mais s'il s'était agi de Siemens, entreprise allemande, ça allait ! Aujourd'hui, quand Alstom est racheté par Siemens, ça ne va plus. De même, le rachat des Chantiers de Saint-Nazaire par STX n'est pas satisfaisant parce que ce sont des Coréens – la Corée, un autre « territoire lointain » !. Puis quand des Italiens se présentent, on considère que, finalement, les Coréens, c'était mieux.
Ma question est un peu provocatrice : ces paroles publiques, ces postures médiatiques, ne masquent-elles pas parfois un vrai problème de principe à l'égard de l'investissement étranger en France ? Ne dissimule-t-on pas ainsi les nombreux investissements de Français à l'étranger, dont on parle peu mais qui sont très nombreux, et les investissements d'étrangers en France – provenant de « territoires lointains » ou de notre voisinage immédiat – qui ne posent souvent aucun problème, pour la préservation des emplois, des savoir-faire, des compétences et de la souveraineté nationale ?
Ces questions de principe sont fort intéressantes.
Qu'est-ce qu'une entreprise stratégique ? Il faut d'abord définir les secteurs stratégiques – c'est ce que nous avons fait dans le décret du 14 mai 2014. Il y a le transport, qui assure la vie en commun de notre société – ne pas le maîtriser est donc très embêtant –l'énergie, les télécommunications, la défense, l'eau et la santé.
Au sein de ces secteurs, toutes les entreprises ne sont pas de même importance : la réponse doit être pratique et pragmatique. Ainsi, il n'est pas gênant qu'une PME sous-traitante d'un grand groupe fasse l'objet d'un rachat, dans la mesure où l'on sait que les technologies qui fonctionnent très bien participeront toujours des marchés sur le territoire national. En revanche, la fabrication des turbines nucléaires, la maîtrise de nos technologies énergétiques et de transport sont des secteurs indéniablement stratégiques, comme tout ce qui concerne la protection de nos intérêts.
D'ailleurs, tous les États définissent leurs intérêts stratégiques. J'avais fait réaliser une étude des décisions du CFIUS : les cent vingt-cinq entreprises étrangères qui ont investi sur le territoire américain ont fait l'objet de mesures drastiques de la part de ce comité, dont les décisions relèvent en dernier ressort du Président des États-Unis, sans voie de recours. On trouve beaucoup de choses dans cette liste, c'est un bric-à-brac dans lequel on trouve parfois l'intérêt du congressman qui est allé alerter le CFIUS. Au Japon, l'État a nationalisé une entreprise de semi-conducteurs. Est-ce stratégique ? Pour eux, oui. Pour nous aussi, d'ailleurs, avec STMicroelectronics. Les Chinois, quant à eux, considèrent que tout est stratégique, du reste c'est l'État qui contrôle l'ensemble de l'industrie. Certes, nous ne sommes pas tous ici des lecteurs assidus des minutes du congrès du Parti communiste chinois, qui a une vision très volontariste de ce que doit être l'industrie. Néanmoins, nous avons beaucoup de choses à apprendre d'eux, parce que nous les avons face à nous.
Cela m'amène à la réciprocité, qui est ma réponse à votre question, monsieur le rapporteur. Nous devons avoir le même niveau de protection. Les États-Unis sont un pays ultra-protectionniste, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas l'être, au même niveau. C'est d'ailleurs ce que nous disions à M. Immelt : que se passerait-il si l'opération se faisait dans l'autre sens ? D'ailleurs, Thales a fait de telles opérations de rachat. Car plutôt que d'investissements – c'est souvent un euphémisme – il faut parler de rachats. Un investissement, c'est lorsque la participation est minoritaire, c'est un placement. Mais, en cas de prise de contrôle, il y a des conséquences : cela peut être un succès ou une catastrophe pour le pays. Il y a en effet des investissements qui sont catastrophiques pour l'entreprise. J'en connais un paquet, car chaque fois que l'on perd le centre de décision, ce n'est plus l'intérêt national qui est privilégié. L'intérêt est ailleurs. Parfois c'est bon, parfois c'est mauvais.
Soyons pragmatiques, interrogeons-nous sur notre intérêt. Parfois, on a intérêt à passer une alliance, à avoir un investisseur minoritaire étranger qui nous permet d'avoir accès à des marchés. Parfois, on n'a pas du tout intérêt à se faire racheter, ni par un Chinois ni par un Américain. Parfois, on est en mesure de conduire des alliances avec grand succès. J'invite donc à examiner les choses sans parti pris, à les regarder froidement, et à organiser la protection de nos intérêts. Mais pas en se fondant sur des communiqués, ou des accords qui durent trois ans : il faut organiser la pérennité des intérêts industriels français. Nous ne pouvons plus nous permettre, dans la situation de défaisance industrielle dans laquelle nous nous trouvons depuis dix ans, d'accepter de vendre très facilement nos entreprises. Il n'en reste plus beaucoup… Après Lafarge, Alstom, Technip, nous ne pouvons plus continuer sur cette voie. Regardez-les dégâts que cela a commencé à faire ! Ce ne sont pas de bonnes opérations pour nous. En effet, je préfère que ce soit Technip qui rachète FMC et Alstom qui rachète Siemens, plutôt que l'inverse. Parce que c'est mieux pour la France. Chacun voit la France comme il veut, moi je vous ai dit comment je la voyais.
Certes, il y a des accords intelligents – j'ai lu ce que vous ont dit les syndicats à propos de STX : le droit de reprise en main est intelligent, c'est astucieux. Mais on ne peut pas faire ce genre de chose dans tous les cas, surtout quand on est placé devant le fait accompli par des dirigeants.
J'en viens au « Plan B » du médecin. Une politique industrielle, c'est garder ce que l'on a, rapatrier ce que l'on a perdu et créer ce que l'on n'a pas. Surtout quand l'industrie représente 11 % de la richesse nationale. Si nous étions à 23 %, comme les Allemands, ou à 19 % comme les Italiens, 15 % comme les Anglais ou les Espagnols, il y aurait moins de problème.
L'esprit du mercantilisme, la tradition de ses théoriciens, de Colbert aux représentants du Gaullisme, est de vendre le plus cher possible aux autres le prix de notre travail national, obtenu de notre sueur. Voilà ce qu'est le mercantilisme. Dans la division internationale du travail et la mondialisation, nous avons intérêt à être très forts, pas à nous désarmer.
J'observe précisément que toutes les entreprises s'adossent à des intérêts étatiques, et que les États sont adossés à de grandes entreprises pour mener des opérations de conquête industrielle.
Que croyez-vous que fassent le Department of Justice ? Que recouvrent les écoutes de la National Security Agency (NSA) ? Ce sont elles qui ont permis de doper les procédures du DOJ contre les entreprises européennes. Je vous rappelle que selon les révélations d'Edward Snowden et de Wikileaks, la France a été espionnée à hauteur de 70 millions d'e-mails ou de conversations téléphoniques par la NSA. Combien d'entreprises ont été ciblées par ces écoutes illégales, contre lesquelles je n'ai pas entendu de grandes protestations nationales ? C'est un point auquel il faut être attentif, car des États utilisent aujourd'hui leurs moyens d'espionnage au bénéfice d'intérêts industriels et économiques. Il va falloir que nous nous organisions un minimum. Je déconseille la naïveté en la matière.

Dans ce dossier, je suis à la fois triste et en colère car, malheureusement, nous avions craint tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous l'avions d'ailleurs annoncé lors de différentes auditions, dont certaines auxquelles vous aviez participé. Nous avions dénoncé un habillage, un beau paquet cadeau. Les entreprises de communication sollicitées alors ont très bien fait leur travail et ont dû gagner beaucoup d'argent pour vendre aux Français une histoire à dormir debout. On nous a fait croire qu'Alstom « Énergie » ne disparaissait pas, que c'était un formidable mariage avec GE. On voit ce qu'il en est aujourd'hui !
Vous avez parlé à plusieurs reprises de volonté politique. Elle a manqué hier – et vous n'êtes pas en cause – et elle manque aujourd'hui. Vous avez dessiné d'ailleurs quelques solutions s'agissant de ces coentreprises. Quand on parle de volonté politique, on parle aussi de responsabilité politique : une commission d'enquête à l'Assemblée nationale a aussi vocation à établir les responsabilités des uns des autres dans ce fiasco, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Il y avait au départ une entreprise française en bonne santé, qui certes avait à imaginer son avenir avec des partenariats, mais il n'y avait aucune raison de la vendre en deux morceaux comme cela a été fait, un à GE et l'autre à Siemens. On savait très bien que, contrairement à ce qui nous avait été dit, Alstom Transport ne pourrait pas rester seul. On nous a raconté des histoires en expliquant qu'on allait sauver Alstom Transport en vendant la branche « Énergie » d'Alstom. Nous avions répondu que les choses ne se passeraient pas comme cela.
S'agissant des responsabilités politiques, que s'est-il passé ? Vous n'êtes pas en cause, je sais que vous vous êtes battu et nous vous avions soutenu à l'époque. D'ailleurs, contrairement à ce que l'on a pu dire, il y a eu parfois entre majorité et opposition du soutien et des points d'accord. Moi, je suis un gaulliste, j'ai toujours soutenu vos efforts en tant que ministre de l'industrie pour mettre en place une politique industrielle ou défendre un certain nombre de nos entreprises, dont Alstom. Il n'empêche qu'il y a eu des arbitrages, que vous avez perdus.
Qui a penché dans la balance à un moment pour vous faire perdre ces arbitrages ?
Celui qui est devenu ensuite ministre de l'économie, et qui a signé finalement l'arrêt de mort d'Alstom « Énergie » quelques mois après, était juste avant secrétaire général adjoint de l'Élysée et aurait dit au cours d'une réunion que la France n'était pas le Venezuela, contribuant à vous faire perdre cet arbitrage. Donc, quelle est la responsabilité de M. Macron, secrétaire général adjoint de l'Élysée puis ministre de l'économie, dans ce fiasco ? Je pense qu'il porte une part de responsabilité très importante. On constate d'ailleurs aujourd'hui que la volonté politique manque toujours pour défendre ce qui reste d'Alstom « Énergie ».
Deuxième question, quel était le poids des procédures aux États-Unis ? On sait que General Electric est coutumier du fait. Les entreprises étrangères déstabilisées à la suite de procédures deviennent des proies faciles pour les grands groupes américains. General Electric en était, je crois, à son cinquième rachat à la suite du même procédé. D'ailleurs, comme par hasard, au lendemain de la vente, l'affaire s'est réglée devant les tribunaux américains. C'est extrêmement révélateur de ce qui s'est passé. Ne faisons-nous pas preuve de naïveté ? Quelles sont vos propositions pour que demain, nous soyons moins naïfs et nous puissions mieux nous défendre contre ces procédures ? MyFerryLink, ex-SeaFrance, a été déstabilisé de la même façon à partir d'une action engagée devant la Competition and Markets Authority (CMA), l'autorité de la concurrence britannique. Répondant à une question au Gouvernement, M. Macron avait répondu qu'on ne pouvait rien faire. C'était faux, nous aurions parfaitement pu défendre MyFerryLink. ! Que peut-on faire demain pour mieux se défendre face à des pays qui n'hésitent pas à utiliser tous les moyens pour déstabiliser nos grandes entreprises afin de les racheter ensuite ?
Dernière question, vous avez beaucoup parlé de la politique industrielle française mais ne manque-t-il pas, surtout, une politique industrielle européenne ? En tant que ministre, avez-vous eu des contacts avec vos homologues en Europe ? Ne faut-il pas revoir la politique européenne de concurrence et permettre l'émergence de champions européens ? L'Europe ne joue-t-elle pas contre nous en nous empêchant de mettre en place une politique industrielle à l'échelle de l'Europe ?

Lors de nos auditions, les organisations syndicales nous ont fait part à plusieurs reprises de la passivité de d'Alstom dans les coentreprises, la qualifiant d'actionnaire dormant, alors que sa position dans le capital de ces coentreprises est absolument déterminante, et peut être porteuse d'avenir d'un point de vue stratégique. Quel est votre sentiment sur la façon dont Alstom intervient aujourd'hui ? Quelles sont les décisions qu'il serait judicieux de prendre ? Votre avis sur le sujet sera d'autant plus intéressant que nous allons auditionner M. Poupart-Lafarge demain.
Par ailleurs, les marchés de la turbine vont considérablement se développer dans les années qui viennent, ce sont des marchés en croissance, particulièrement en Chine et en Russie. Il existe des accords sur la turbine Arabelle, puisqu'elle fournit notamment les centrales russes. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?

Je voudrais revenir sur des questions factuelles. Vous avez dit que vous n'étiez pas informé de la procédure de corruption, mais que d'autres l'étaient ailleurs. Qui ? Où ?
Vous étiez venu nous alerter très tôt, devant la commission des affaires économiques, de la déloyauté de M. Kron et de votre surprise d'apprendre par Bloomberg une opération de cette nature. Est-ce qu'au sein de l'État, d'autres étaient informés des intentions de General Electric ou d'Alstom ?
Aujourd'hui, vous nous dites que ce n'était pas un bon accord, vous l'avez écrit à juste titre, et nous l'avons toujours su, mais c'est vous qui l'avez signé et qui étiez venu nous le présenter comme une alliance. Aujourd'hui, avec le recul, considérez-vous qu'on vous a laissé dire qu'on cherchait un « plan B » – et le chercher vraiment – comme pour agiter l'existence d'une autre option, tandis qu'au sommet de l'État, d'autres, depuis le début, avaient décidé que cette opération se ferait et que l'action du ministre de l'industrie permettrait d'obtenir une ou deux concessions de-ci de-là, pour montrer que le Gouvernement avait fait quelque chose ? Autrement dit s'agit-il d'une sorte de Florange bis ?
De par votre expérience, que pouvez-vous nous dire plus généralement sur la mécanique de décision au sein de l'État concernant la politique industrielle, entre le ministre, le Premier ministre, le Président de la République ?
Alors que je préparais un rapport sur l'industrie automobile, j'avais constaté que c'était un exemple très frappant de la possibilité, pour l'État, de déployer une politique industrielle – en l'occurrence vous êtes à l'origine d'une belle réussite avec PSA. Tous les industriels considèrent néanmoins qu'en France, si l'on compare notre mode de fonctionnement avec celui des Allemands ou des Japonais, la multiplicité des interlocuteurs et le jeu d'acteur des uns et des autres conduit au ralentissement des décisions, et à l'absence de clarté des orientations.

Je suis très heureux de votre présence pour éclaircir, dans un cadre plus formel que la presse et les documentaires de la Chaîne parlementaire, des événements qui ont beaucoup compté pour l'avenir de l'industrie française. Après avoir été à l'origine de nombreuses déclarations spectaculaires, ils vont désormais faire l'objet d'un travail sérieux au sein de cette commission. Nous allons auditionner d'autres acteurs tout au long des semaines à venir, nous entendrons des versions différentes et il faudra démêler tout cela entre nous. Peut-être pourrons-nous raconter l'histoire telle qu'elle s'est vraiment déroulée, mais surtout comprendre ce qui s'est passé pour tirer des enseignements sur l'avenir de notre politique industrielle.
Je voudrais vous parler des 2,5 milliards de personnes qui vont habiter dans des nouvelles villes d'ici à 2050 ; pas en France ni en Europe, mais dans les pays émergents, en Chine et en Inde.
J'aimerais vous entendre sur les moyens de s'organiser pour bénéficier de ces vagues porteuses, au-delà de la défense tout à fait souhaitable des intérêts stratégiques que vous avez mentionnés. Comment mener une politique industrielle certes protectrice, mais aussi porteuse pour créer les emplois et les richesses de demain ? Comment prendre cette grande vague d'urbanisation qui va concerner tous les secteurs stratégiques : énergie, transport, santé. Sur toutes ces thématiques, il faut nous positionner dans une logique protectrice, mais aussi offensive. Comment nous organiser, au-delà de la marinière, pour porter un drapeau européen qui nous permettra de bénéficier pleinement de ces opportunités qui vont se développer à l'échelle du monde ?
En 2014, il n'a pas été possible, pour des raisons que vous avez évoquées, de créer un champion européen. Je le regrette, et je note qu'en 2017, dans deux secteurs importants – les chantiers navals et le transport – nous sommes en train d'essayer de les créer, avec les alliances STX-Finmeccanica et Alstom-Siemens. Au-delà des intérêts de personnes, je me demande si parfois, il n'y a pas une perception différente de ce que doit être le rôle de l'État dans une politique industrielle entre la France et un certain nombre de voisins européens. Y a-t-il parfois un peu de méfiance sur notre manière d'intervenir très française, et pas toujours très compatible avec la vision d'un certain nombre de nos partenaires ?
Dans l'histoire de GE et Alstom, il semble, à vous croire, que l'État américain a joué un vrai rôle stratégique sans dépenser un seul dollar. Selon vous, qu'est-ce qu'une politique stratégique dans un monde globalisé où 2,5 milliards de nouveaux citoyens vont apparaître dans les grandes villes ? Cela ne relève pas d'une approche capitalistique traditionnelle, et j'ai peur qu'on échoue. Et ce, pour deux raisons essentielles. Je pense tout d'abord que l'État n'est pas le meilleur opérateur des trains, des avions et des turbines. Certes, il peut être un actionnaire, un intervenant capitalistique, mais je ne suis pas sûr qu'il doive être un opérateur. Il y a par ailleurs le financement. Comment financer toutes ces opérations ? Il y a un seul mot que je n'ai pas entendu dans votre intervention, c'est celui de prix. Or toutes ces interventions ont un coût, et ces entreprises très profitables, il faut pouvoir se les offrir, les acheter à un prix raisonnable.
J'ai eu le bonheur d'être un investisseur global public canadien pendant huit ans, puisque je travaillais à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à Montréal.
Ce n'est pas une mauvaise maison !
Nous allons voir si elle ne vous a pas déformé !

Je donne toujours le même exemple, mais je pense qu'il est pertinent. Il y a un an et demi, une très grande entreprise française – Suez Environnement – a décidé de faire l'acquisition d'une filiale de General Electric, GE « Water ». L'eau, comme vous l'avez mentionné, est un des secteurs stratégiques de l'avenir de ce monde globalisé dans lequel nous souhaitons être un champion, et pas seulement un défenseur. Eh bien pour financer cette opération, Suez est allé chercher un investisseur de long terme au Canada – au Québec en l'occurrence – parce qu'il n'y en avait pas en France. Il y a un vrai problème de disponibilité du capital en France, sur lequel, je l'espère, nous allons travailler dans le cadre de cette législature. Aujourd'hui, je considère que nous n'avons pas les moyens de nos ambitions. J'aimerais vous entendre aussi sur ce sujet.

D'ailleurs, sans État, il n'y aurait jamais eu de turbines nucléaires, cela aurait été beaucoup plus simple !

Monsieur le ministre, vous avez dit qu'en prévoyant les coentreprises dans l'accord, vous aviez en tête l'accord entre Safran et General Electric à 5050. Mais les coentreprises sont à 5149, comment penser qu'il y a alliance quand l'un peut décider de tout et que l'autre ne peut décider de rien ?
Vous avez évoqué la question des turbines nucléaires, notamment militaires, qui équipent le Charles-de-Gaulle ou nos sous-marins lanceurs d'engins. Le ministère de la défense a-t-il été partie prenante de cet accord ? A-t-il été consulté ?
De la même manière, dans un livre plutôt bien documenté sur l'affaire, il est noté que vous aviez saisi la DGSE sur cette question, et qu'il vous avait été répondu qu'elle n'était pas compétente. N'est-ce pas une faillite de l'État que notre principal service de renseignement ne soit pas compétent sur une question d'intelligence économique ?
Je ne reviendrai pas sur la question de Mme Batho sur les alertes que vous avez évoquées, et qui ne sont pas arrivées jusqu'à vous, mais j'attends avec impatience votre réponse.
Enfin, vous avez dit que M. Kron n'était pas en mesure d'être transparent face à l'État français. Pouvez-vous aller plus loin ou faudra-t-il que nous vous auditionnions à huis clos pour avoir une réponse précise sur cette question ?
Monsieur Fasquelle, ça n'aurait pas été une difficulté pour moi de reconnaître que j'avais été abusé. Mais je reste convaincu, trois ans après, que ce n'était pas une histoire à dormir debout. Je maintiens la position que j'avais exprimée ; j'ai relu mes déclarations pour voir si j'étais toujours en accord intellectuel et sentimental avec elles : je n'ai rien à en retirer. Je pense que cette alliance pouvait vivre et se déployer si l'État avait été très présent et si Alstom avait été dirigé par d'autres.
Pour moi, la nationalisation d'Alstom était une des clés de la réussite de cette affaire. La bataille à l'Élysée a eu lieu sur ce point. Et j'ai gagné mon arbitrage ce jour-là. En effet, on m'a dit que nous n'étions pas au Venezuela – vous avez cité l'auteur de ces propos, c'était le secrétaire général adjoint de l'Élysée, Emmanuel Macron, avec qui d'ailleurs j'entretenais d'excellentes relations. Nous étions rarement d'accord, mais il y avait de l'estime réciproque. Certes, nous n'étions pas au Venezuela, mais eu égard au poids de l'un et de l'autres – 250 milliards pour GE et moins de 10 pour Alstom – GE ferait ce qu'il voudrait si l'État français était absent. C'est ce qui s'est passé.
Qui n'a pas mis en oeuvre la solution que j'avais arrachée à Jean-Pierre Jouyet, François Hollande et Manuel Valls ce jour-là ? Mon successeur ! Pour moi, il fallait se battre pour qu'Alstom soit sous contrôle étatique et, si on s'en était tenu à cette position, on n'aurait pas eu le même destin – on n'aurait même pas eu la suite ferroviaire qu'on connaît.
On dit que les Allemands ne veulent pas de l'État, mais chez eux, l'État est partout, car ils savent très bien mettre en oeuvre des accords public-privé – seulement, ils le font d'une autre manière que nous, qui nous lançons dans de grandes tirades politiques, qui nous engueulons et sommes incapables de nous entendre : eux, ils n'ont pas besoin de faire de politique, ils sont tous alignés sur les intérêts industriels, ce qui est beaucoup plus facile ! C'est pareil pour les Japonais et, d'une manière générale, pour tous les pays holistiques, qui ont compris que l'outil industriel constitue un point de consensus national.
Dans les pays individualistes, c'est la bagarre ! Nous sommes dans cette catégorie plus que dans celle des pays holistiques, et chez nous le patriotisme économique n'existe que par construction. Vous parliez tout à l'heure de ma marinière, monsieur le président : c'est une symbolique qui signifie que nous devons nous entendre sur les questions touchant à nos outils de travail, à ce qui donne du travail aux Français, ce qui fait leur pain quotidien. Ce n'est pas un luxe, mais une nécessité pour survivre dans la mondialisation cruelle et impitoyable, eu égard aux monstres que nous devons affronter, avec des États qui veillent derrière leurs entreprises. Quand ces entreprises nous envoient des représentants de commerce, des managers aux dents blanches, nous devons nous méfier des apparences !
À qui incombe la responsabilité de ce qui s'est passé ? Pour moi, l'arbitrage a été collectif. J'ai défendu la solution Siemens jusqu'à ce que le Premier ministre de l'époque, M. Valls, me lâche. Or, si j'ai commencé par aller chercher Siemens, c'est qu'au début je n'avais pas de décret, je n'avais rien ! La pression était forte pour que je signe l'accord de cession avec General Electric, je n'avais plus qu'à dire : « c'est d'accord, monsieur Immelt », et c'était fait ! Je n'avais même pas à donner mon avis : ils refusaient de me prendre au téléphone ! En fait, les dirigeants d'Alstom et de General Electric, Patrick Kron et Jeffrey Immelt, s'étaient déjà mis d'accord et avaient acheté toutes les agences de communication, tous les cabinets d'avocats et les banques d'affaires de Paris – Lazard, Rothschild, etc. – dans la perspective de la cession, qu'il n'y avait plus qu'à entériner.
Dans cette situation, il ne nous restait qu'une possibilité, faire en sorte que l'État reprenne ses droits, et c'est ce que nous avons fait avec la signature de ce décret permettant à l'État de bloquer le rachat d'entreprises françaises par des investisseurs étrangers. Pour ça, j'ai réussi à trouver un avocat d'affaires encore libre, et je peux vous dire que nous étions très heureux d'avoir pu prendre ce décret. Je ne regrette qu'une chose, c'est qu'il n'ait servi qu'une seule fois, dans le dossier Alstom : de ce fait, il risque de se produire ce qu'on appelle une « perte de sens » en jurisprudence, et il serait bon d'utiliser à nouveau ce décret, de le faire vivre, afin d'en réactiver la portée.
Le Président de la République de l'époque, M. François Hollande, ne voulait pas s'affronter aux Américains – c'était son choix politique. Quant au Premier ministre, après m'avoir plus ou moins encouragé dans la solution franco-allemande, qui semblait convenir à ses convictions, il m'a lâché au moment crucial. Il est beaucoup plus difficile de dire non que de dire oui et, si je voulais bien être le bad boy, celui qui dit non, il fallait quand même que je sois soutenu… et c'est au moment où j'aurais dû l'être que le Premier ministre a abandonné son ministre de l'industrie, seul face à ceux qui ne voulaient pas nationaliser, ceux qui ne voulaient de la solution allemande, et ceux qui voulaient qu'on signe avec General Electric sans faire d'histoires. C'est un fait, un ministre a des chefs… Cela dit, je reste assez fier d'avoir réussi à créer un rapport de forces et d'avoir obtenu ce décret.
Mme Batho, M. Fasquelle et M. Lachaud m'ont interrogé au sujet de la procédure de corruption. Si j'accepte volontiers de m'exprimer à ce sujet, car je n'ai rien à dissimuler à la représentation nationale, je souhaite cependant que cela se fasse à huis clos, en raison des procédures en cours et des intérêts en cause. À l'heure actuelle, certains de nos compatriotes sont en prison alors qu'ils ne le méritent pas : ils y sont à cause de l'affaire Kron. Je souhaite donc pouvoir exprimer la vérité afin que nul n'en ignore, et vous en ferez ce que vous voudrez une fois que ce sera dans votre rapport : reconvoquez-moi à huis clos, monsieur le président, et je répondrai à toutes vos questions sur la DGSE, le ministère de la défense, M. Kron, et les personnes qui, au sein de l'État, étaient informées de la procédure de corruption.
M. Fasquelle m'a demandé ce qu'on pouvait faire pour se protéger contre les tentatives de certains États étrangers de déstabiliser nos grands groupes en engageant des poursuites judiciaires contre leurs dirigeants, en faisant notamment référence au rôle joué par le Department of Justice (DOJ) américain. La première chose à faire en pareil cas, c'est de sortir les dirigeants mis en cause – car, à défaut, ils constituent à l'évidence un point faible. Dans l'affaire qui nous intéresse, il est à noter qu'une pression physique s'est exercée sur M. Kron, sous la forme d'une menace d'arrestation : plusieurs de ses cadres ont été interpellés à l'aéroport JFK de New York et immédiatement incarcérés à la demande du procureur – et si lui a été laissé libre de ses mouvements, c'était pour lui permettre d'aller négocier la vente d'Alstom ! On voit bien ici la collusion entre les intérêts de la justice et les intérêts économiques de l'entreprise General Electric.
Je le répète, quand des dirigeants sont mis en cause dans le cadre d'une procédure américaine, il faut se dépêcher de les remplacer. À cet égard, je salue la décision prise par Tom Enders, le patron allemand d'Airbus, de ne pas briguer un nouveau mandat à la tête de l'avionneur européen, qui se trouve actuellement pris dans un scénario similaire.
Ensuite, il ne faut pas hésiter à ouvrir nous-mêmes des procédures en France, afin que les procédures ouvertes à l'étranger ne nous soient pas opposables. Bien sûr, c'est un dilemme, parce que cela implique d'ouvrir des procédures contre nos propres entreprises – ce que nous n'avons jamais voulu faire. Nous avons les mêmes textes que les Américains, mais pas le même système judiciaire. Comment le DOJ est-il devenu un outil de prédation économique et industrielle mondiale sur l'économie, notamment européenne ? J'ai fait mes calculs, je crois qu'on n'est pas loin de 15 milliards d'amendes distribuées en moins de dix ans. Si cela vous intéresse, vous trouverez tous les chiffres dans le rapport sur l'extraterritorialité de la législation américaine rédigé par Mme Karine Berger en 2016, dans le cadre d'une mission d'information présidée par M. Pierre Lellouche. On assiste à une montée en puissance du nombre et de l'impact des procédures américaines, depuis que la NSA a organisé l'écoute du reste du monde. Il y a là un vrai sujet de protection de nos intérêts et de nos entreprises contre l'espionnage mondial de la NSA – en attendant que les Russes et les Chinois s'y mettent à leur tour, ce qui ne saurait tarder. Défendre la souveraineté fondamentale de notre pays, c'est l'une des trois propositions que je vous fais.
M. Fasquelle m'a également demandé si nous pourrions mieux nous armer en matière de politique européenne. Sur ce point, j'estime que nous devons conclure des alliances. J'ai mené pour cela un combat très difficile quand j'étais ministre : j'avais pris un lit de camp à Bruxelles pour être présent sur place, et j'ai ainsi réussi à ce que la France construise une alliance à treize, comprenant tous les pays du Sud, la Belgique, et une partie des pays de l'Est, contre le Royaume-Uni, qui menait le combat contre le volontarisme industriel au sein de mon conseil, celui des ministres de l'industrie de l'Union européenne. Mme Batho, qui siégeait à la même époque au sein du conseil des ministres de l'environnement, se souvient sans doute de l'affrontement entre le bloc des pays menés par la France et le bloc des pays menés par les Britanniques – avec l'Allemagne et l'Autriche au milieu.
Il est faux de prétendre qu'il existe un couple franco-allemand : en fait de forces en présence, vous avez les Britanniques contre les Français, et au milieu les Allemands, qui ne prêtent main-forte à leurs alliés que de temps à autre. En dépit de cette situation, on a quand même construit une stratégie visant à réduire le contrôle de la Commission européenne sur les aides d'État. Ce n'était pas facile dans un contexte où on estime qu'il faut combattre la constitution d'oligopoles – dont nous avons pourtant besoin pour faire face au reste du monde – et où on en est encore à croire qu'il faut appliquer au sein de l'Union européenne les principes ayant fondé la construction du Marché unique, alors que l'Union européenne a aujourd'hui besoin de se défendre, et même d'être offensive, face au reste du monde : en d'autres termes, nous devons construire des champions européens, éventuellement binationaux ou trinationaux – et c'est ce que nous finirons par faire.
J'avais affaire à un commissaire européen à la concurrence, M. Joaquin Almunia, qui était un véritable taliban vis-à-vis des aides d'État : à chaque fois qu'il entendait ce mot, il faisait un bond et envoyait des armées d'inspecteurs pour nous contrôler et nous sanctionner. En 2013, pour éviter l'effondrement de la banque PSA Finance, l'État a dû signer une garantie de 7 milliards d'euros : ça ne l'a pas empêché de nous mettre une procédure sur le dos ! Je suis allé le voir en lui disant : « Mais vous voulez donc la fin de PSA, alors même que vous avez des usines PSA en Espagne ! », et comme il me répondait : « Ici je ne suis pas espagnol, mais européen ! », j'ai dû lui dire qu'il était idiotement européen, car laisser s'abîmer l'industrie en pourchassant la bonne volonté politique, c'est le meilleur moyen de détruire l'Europe ! Nous avons eu des débats durs, mais décomplexés, et le plus déconcertant pour moi était sans doute de devoir combattre un socialiste espagnol, qui utilisait des armes les plus terribles des libéraux pour nous empêcher d'être socialistes. Cela a été vraiment été un crève-coeur pour moi.
Aujourd'hui, tout est à reconstruire en matière de politique de la concurrence et d'aides d'État, et le Parlement français s'honorerait à faire des propositions dans ce domaine. Beaucoup de choses ont été écrites à ce sujet, et il se trouve encore à Bercy de nombreux fonctionnaires ayant travaillé là-dessus, qu'il faudrait solliciter à nouveau, car ils ont des choses à dire à un moment où la France doit être force de proposition sur la mutation de l'Union européenne et sa nouvelle vision.
Le président de la commission des affaires économiques, M. Lescure, a évoqué le rôle de l'État face aux pays émergents, se demandant quand on cessait d'être défensif pour devenir offensif. Je commencerai par dire qu'il est excessif de considérer que l'État est un mauvais opérateur : partout où l'État a été présent, l'économie a résisté. Je ne suis pas sûr qu'on aurait encore Renault Nissan, numéro un mondial, si l'État n'avait pas été au capital de Renault. Cela s'explique par le fait que l'État est long termiste alors que les marchés sont court termistes, mais aussi par le fait qu'il a une préférence patriotique, à la différence des entreprises, qui sont transnationales ; enfin, l'État défend des intérêts qui ne sont pas forcément économiques, ce qui permet d'équilibrer les choses. Renault n'est pas le seul exemple : si l'État n'était pas actionnaire d'Orange, rien ne garantit que cette entreprise n'aurait pas fait l'objet d'une OPA, qu'elle n'aurait pas été rachetée et découpée en morceaux.
Si l'État est un facteur de stabilité, on peut se demander s'il est un mauvais actionnaire. J'ai envie de vous dire qu'il a appris, qu'il a parfois tiré des leçons de ses propres erreurs et échecs. Aujourd'hui, quand l'État peut prendre le contrôle d'une entreprise comme PSA en devenant l'un des actionnaires de référence, mais en laissant le management travailler, ce qui constitue une situation d'équilibre, il fait son boulot. Quand il siège au conseil de surveillance, qu'il joue en quelque sorte le rôle de surveillant général en corrigeant les abus, les excès, il est tout à fait dans son rôle.
En revanche, quand il est lui-même opérateur, je ne pense pas qu'il soit compétent, et c'est tout le problème. Pour les entreprises comportant une fraction de capitaux publics, la question du choix des dirigeants d'entreprises est d'ailleurs un sujet fondamental, sur lequel il faut travailler. Aujourd'hui, l'article 13 de la Constitution donne ce pouvoir au Président de la République, qui est totalement incompétent en la matière et ne fait que subir l'étiquette « Louisquatorzième » de la Ve République ainsi que les conséquences de la courtisanerie et des copinages de promotion. Le résultat de ce système, c'est l'effondrement de bon nombre d'entreprises publiques au cours des quinquennats et septennats qui se sont succédé – en la matière, je ne serai pas avare de compliments : tout le monde y a droit ! Il faut réfléchir à la façon de retirer au Président de la République les attributions qui sont actuellement les siennes en la matière et de revenir à des procédures de nomination beaucoup plus rationnelles sur le terrain économique, ce qui nécessite de modifier la Constitution. J'ai moi-même essayé de faire bouger les choses dans ce domaine, en proposant au Président de la République que l'on fasse appel à des chasseurs de têtes pour dénicher les dirigeants des entreprises publiques, plutôt que de confier celles-ci aux visiteurs du soir, qui se présentent à la porte du Salon doré de l'Élysée et que l'on fait passer dans le Salon vert : en d'autres termes, il ne faut pas choisir les gens pour leurs accointances, mais en fonction de leurs compétences et de leur motivation – étant précisé qu'il serait bien sûr revenu au Président de la République de choisir qui, parmi les trois candidats sélectionnés par le chasseur de têtes, devait être finalement retenu.
Bien entendu, ma proposition n'a pas été acceptée, ce qui fait que le problème reste entier. Nous nous serions épargné de graves difficultés, notamment celles auxquelles Areva est aujourd'hui confrontée, en évitant que les nominations ne se politisent de façon excessive sous plusieurs quinquennats – je préfère ne pas donner de nom, c'est plus prudent pour moi et pour vous.
Nous disposons cependant de ressources : inspirons-nous de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Les Japonais, par exemple, ont un accord de place de l'ensemble du secteur bancaire et des grands fonds d'investissement, et se mettent d'accord pour contrôler le capital de leurs grandes entreprises : pourquoi ne ferait-on pas la même chose, – comme je l'ai d'ailleurs également proposé ? Pour ce qui est de STX, par exemple, les syndicats que vous avez entendus vous ont bien dit que personne ne s'y était intéressé. Pour ma part, je suis persuadé qu'il aurait été possible d'attirer des fonds d'investissement, à condition qu'un leader leur dise : « Cette boîte est formidable, et elle va gagner de l'argent pendant dix ans. Si nous y entrons de façon minoritaire, à hauteur de 5 %, voulez-vous y entrer en tant qu'actionnaires majoritaires ? ». Nous avons actuellement 125 milliards dans les fonds de retraite et les mutuelles : pourquoi n'investit-on pas cet argent dans nos industries, au lieu de le laisser placé à Singapour ou je ne sais où ? Qu'est-ce qu'on attend ?
M. René Ricol – que je cite volontiers bien qu'il soit un ami de M. Sarkozy, car c'est aussi, comme M. Fasquelle, un gaulliste à l'esprit transpartisan – a remis à François Hollande un excellent rapport sur la question. Je vous invite à en prendre connaissance : vous constaterez qu'il y a aujourd'hui 125 milliards disponibles, qui peuvent servir à empêcher toute OPAbilité de notre CAC 40. Bien sûr, pour drainer cet argent vers notre industrie, il va falloir se brouiller avec deux ou trois personnes, mais c'est votre boulot en tant que responsables publics, et ça ne me paraît pas insurmontable !
Enfin, M. Lescure m'a demandé si, avec cet argent, nous ne pourrions pas imaginer de bâtir des alliances pour faire face aux besoins des pays émergents. Je crois qu'on le peut : il y a toujours eu des alliances dans l'histoire de l'économie, et il vaut bien mieux les construire que les subir. Le rapport sur Alstom que m'a remis le cabinet Roland Berger énonçait d'ailleurs, en février 2014, soit deux mois avant le déclenchement des hostilités, toute une série de propositions d'alliances dans le monde, ayant pour objet de nous permettre de ne pas rester seuls, tout en nous laissant maîtres de notre destin.
C'est pourquoi, quand on voit arriver un gros Chinois, il ne faut pas se précipiter de tout vendre de crainte d'être dévorés : en procédant de la sorte, nous sommes sûrs de tout perdre avant même que les Chinois se soient vraiment intéressés à nous ! Je pense que nous pouvons avoir les moyens de notre force, et que notre pays dispose de ressources, qu'il suffit d'orienter différemment. En disant cela, je ne pense pas à la Bpifrance, qui doit se consacrer à son métier, qui est de rebâtir le tissu industriel constitué par les PME, qui a pris très cher au cours des dix dernières années.
Mme Batho m'a demandé si le dossier Alstom pouvait être vu comme une sorte de Florange bis, dans lequel j'aurais moi-même été manipulé pour faire croire qu'il existait d'autres solutions que celle ayant en réalité été décidée depuis longtemps. Cela nous conduit à nous interroger sur les personnes qui étaient informées du vrai projet. À l'occasion de la visite d'État de François Hollande, reçu par le président Obama à Washington en février 2014, une visite à laquelle je prenais part, Mme Clara Gaymard, qui représentait les intérêts de GE en France, m'a demandé un rendez-vous. Lors de notre rencontre, elle m'a déclaré que son groupe était intéressé par Alstom – ce à quoi je lui ai répondu que nous n'étions pas à vendre. Après cela, je n'ai plus eu de nouvelles, et rien n'a pu me laisser penser que d'autres que moi étaient informés – ce qui, évidemment, ne permet pas d'exclure que certaines personnes aient su ce qui allait se passer.
La solution Siemens était-elle un vrai plan B, ou n'avait-elle pour objectif que d'amuser la galerie et de faire ainsi accepter plus facilement la décision finale ? Si je suis moi-même allé chercher Siemens, c'était précisément pour avoir une solution de rechange et gagner du temps car, à défaut, le conseil d'administration aurait voté tout de suite, dès les premiers jours du mois d'avril, la vente à General Electric. J'ai obtenu du commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) qu'il adresse au conseil d'administration d'Alstom la recommandation de ne pas prendre la décision de vendre tout de suite, car une autre solution se présentait. Comme vous le voyez, j'ai dû recourir à une solution bricolée de toutes pièces pour obtenir le délai qui me permettait de construire une autre solution – à part ça, nous n'avions rien qui puisse nous permettre de résister et de gagner du temps.
Après quoi, nous nous sommes efforcés de mettre au point, tant bien que mal, la solution reposant sur un accord faisant intervenir Mitsubishi et Siemens. Je dois vous dire que, pour moi, le Président de la République avait déjà tranché et, si le Premier ministre a été plus délicat, rétrospectivement je pense qu'aucun des deux n'avait le désir d'affronter les Américains, pour des raisons géopolitiques et géostratégiques – de la même manière, ils ne l'avaient pas fait dans l'affaire Snowden, ni au sujet du massacre de la Ghouta en Syrie.
Je me rappelle que, lors de la rencontre de Washington de février 2014, le président Obama a plaidé sans complexes, devant le Président de la République et tout le Gouvernement français, pour l'optimisation fiscale des GAFA, en nous disant : « Vous ne pouvez quand même pas augmenter les impôts ! » – et j'insiste sur le fait que c'était le président Obama, pas Trump, si vous voyez ce que je veux dire ! Bref, je crois qu'il avait été décidé assez tôt, pour des raisons stratégiques, que la vente se ferait avec les Américains.
Ai-je été en mesure d'obtenir des délais et des moyens pour tenter d'infléchir le cours des choses ? C'est un fait, le Premier ministre a signé le décret du 14 mai 2014, ce dont on peut le remercier. Bien sûr, ce n'était pas suffisant, mais peut-être l'était-ce à ses yeux et à ceux du Président de la République, à qui revenait la décision finale. Sans doute avaient-ils en tête le cas Florange à ce moment, car je leur avais dit que, si je n'obtenais pas la nationalisation d'Alstom, je ne vendrais pas cet accord, qui pour moi n'était pas viable. Une personne l'avait compris : le secrétaire général de l'Élysée, M. Jouyet, qui avait pris mon parti dans la discussion, en désaccord sur ce point avec son adjoint de l'époque, M. Macron. J'avais bien insisté sur le fait que, pour que l'alliance en soit vraiment une, il fallait qu'Alstom soit entre les mains de l'État. Je leur ai dit très clairement : « Si vous ne m'accordez pas ça, alors vous ferez sans moi !».
Je rappelle que dans l'affaire Florange, j'avais eu le soutien de tout le monde. La majorité parlementaire et le gouvernement de l'époque, mes collègues, et même l'opposition, avec M. Bayrou, M. Baroin, M. Borloo, M. Breton – dont on reparle ces jours-ci –, M. Mélenchon, Mme Le Pen, tout le monde était d'accord en France ! Manque de pot, les deux seuls qui n'étaient pas disposés à me suivre, c'était M. Hollande et M. Ayrault ! Au coeur de cette espèce de consensus républicain, le Président de la République et le Premier ministre avaient finalement décidé de ne pas donner suite… autant vous dire que je n'avais pas oublié cet épisode, et que je n'avais nulle envie de le revivre.
Après la signature du décret, les événements politiques ont voulu que je sois remplacé par quelqu'un qui n'était pas d'accord avec cette orientation. Il était de la responsabilité du Président de la République et du Premier ministre, restés en place, de veiller à ce que la nationalisation se fasse comme prévu, mais je ne pense pas qu'ils aient beaucoup insisté pour ça – j'espère que je suis clair.
Pour répondre à M. Lachaud, je dirai que l'alliance entre Safran et General Electric a permis de développer les usines aux États-Unis et en France, et d'obtenir à l'échelle mondiale les marchés de Boeing et d'Airbus. C'est une réussite industrielle extraordinaire : toutes les deux secondes, il y a un moteur, développé par Safran Aircraft Engines et GE, qui atterrit ou décolle quelque part dans le monde ! La part de chaque société au sein de la structure commune n'a pas été un problème, elles ont réussi à s'entendre sur ce point.
Le vrai problème était ailleurs, comme je l'ai compris lors d'une conversation avec M. Kron : les choses ne pouvaient pas fonctionner, dès lors qu'on cherchait à imposer à Alstom des alliances – avec Siemens, puis avec General Electric. Effectivement, en pareil cas on doit faire face à un problème de gouvernance qui, de mon point de vue, ne peut se régler qu'en dégageant le dirigeant et en prenant le contrôle de la société. Il ne faut avoir aucun complexe à mettre l'État au milieu du village France, car c'est notre ADN. Sans État, vous n'avez rien, et chacun continue à faire ce qu'il veut dans son coin. Avec l'État, vous avez un minimum de structuration – c'est ce qu'ont compris les dirigeants depuis des siècles dans d'autres pays, quelle que soit la forme du régime. J'insiste sur le fait que nous avons besoin d'assumer ce rapport à l'État, et je pense que nous pouvons tous nous mettre d'accord là-dessus. Pour ma part, j'ai toujours milité en faveur d'une stratégie basée sur une position transpartisane.
Je crois avoir répondu à la question de M. Sommer au sujet du fait qu'Alstom est actionnaire dormant au sein des coentreprises. Le PDG d'Alstom lui-même, M. Poupart-Lafarge, a exprimé publiquement sa volonté de se séparer des coentreprises et, aussi étonnant que cela puisse paraître, personne ne s'en est jamais offusqué – j'espère que vous allez le sermonner quand vous le verrez, monsieur le président : je vous confie ce mandat, si j'ai encore le pouvoir de le faire !

Si personne dans cette salle ne pense que l'État n'a aucun rôle à jouer dans la stratégie industrielle de la France, à votre avis, monsieur le ministre, quel rôle peut-il jouer dans un monde globalisé, où le capital est rare et cher et dans lequel nos concurrents – à part peut-être les Chinois – utilisent visiblement d'autres moyens ?

Je promets à monsieur Lachaud que nous procéderons à une autre audition de M. Montebourg, peut-être à l'occasion d'une réunion consacrée à la défense.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire part de votre sentiment à la suite des déclarations de Jean-Claude Juncker sur l'idée d'un cadre européen, en tout cas d'un cadre de l'Union européenne sur l'examen des investissements ?
Par ailleurs, estimez-vous que, lorsqu'une entreprise publique étrangère souhaite acquérir un port stratégique ou une infrastructure énergétique en France, elle ne devrait pouvoir le faire qu'à l'issue d'un examen approfondi et d'un débat ? Pensez-vous qu'une telle acquisition puisse être une bonne chose, ou qu'elle amoindrisse forcément notre souveraineté nationale ? En l'occurrence, pensez-vous que General Electric aurait pu racheter la branche énergie d'Alstom ?

Il est question dans l'accord signé entre l'État et GE de la nomination d'un organe de contrôle indépendant, en l'occurrence Vigeo. Ce dernier peut-il être révoqué et existe-t-il une date butoir pour sa nomination ?
J'entends que vous préférez témoigner à huis clos en ce qui concerne certains points, et notamment la manière dont les signaux d'alerte ont circulé, puisque vous affirmez savoir vers qui ils sont allés, sans jamais parvenir jusqu'à vous : nous aimerions vraiment vous entendre sur ces questions.
Que pensez-vous par ailleurs de l'idée de notre président selon laquelle Alstom n'est pas en mesure de racheter l'éolien et l'activité hydro ?
J'aimerais enfin vous entendre, si vous le voulez bien, sur l'initiative « la Ceinture et la Route » qu'a relancée la Chine, lors du 19e congrès du parti communiste. Il s'agit d'un programme d'infrastructures, le long de la « nouvelle Route de la soie », destinées à consolider les relations commerciales de la Chine sur trois continents – l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Ce projet prévoit la construction de routes, de ports, de lignes de chemins de fer et de plusieurs parcs industriels, dans soixante-cinq pays pour plus de 1 000 milliards de dollars. Selon vous, quelle position doit adopter la France face à ce projet ?

Nous assistons actuellement non pas à la mort lente d'une entreprise mais à celle de notre filière industrielle. Le dernier et tout récent rapport national sur l'emploi en France d'ADP Research Institute évalue à 100 000 les créations d'emplois nouveaux en France, tandis que la seule filière qui détruit de l'emploi est la filière industrielle, qui a perdu plus d'1,4 million d'emplois sur ces vingt-cinq dernières années. Nous devons donc réagir et renouer avec une véritable ambition industrielle pour notre pays.
Nous avons évoqué Alstom et la situation de nos entreprises françaises, j'aimerais que nous parlions également des entreprises étrangères présentes en France qui créent et génèrent sur notre territoire des emplois directs ou indirects chez les équipementiers et les sous-traitants français. Je pense en particulier au Canadien Bombardier, implanté dans les Hauts-de-France d'ailleurs non loin d'Alstom : ses difficultés se répercutent sur l'ensemble de la filière en amont, qui se trouve menacée. J'aimerais votre sentiment sur ce point, d'autant que vous nous avez dit avoir arraché un arbitrage sur Alstom mais que, faute de volonté politique, votre successeur n'avait pas été au bout de la démarche, ce qui a conduit au fiasco que nous connaissons aujourd'hui. Peut-on considérer qu'un tel fiasco est celui d'une unique entreprise française où qu'il pourrait se reproduire et mettre en péril toute une filière, à savoir la filière ferroviaire ?

Je souhaiterais profiter de votre présence aujourd'hui pour avoir votre appréciation, au-delà du cas particulier d'Alstom que nous avons largement évoqué, sur le dispositif interministériel de détection des opérations sur les entreprises stratégiques. Autrement dit, je souhaiterais déplacer légèrement le débat et savoir si Bercy possède les outils, mais aussi la culture pour détecter de manière systématique ou quasi-systématique les opérations sur ces entreprises que le ministère considère comme stratégiques.

Je voudrais d'abord, vous remercier, monsieur le ministre, puisque grâce à vous, à Frangy-en-Bresse et au vin rouge, est advenue la situation que nous connaissons : vous êtes en somme l'initiateur de ce nouveau monde. (Sourires.)
Il doit m'en rester une bouteille…

Aujourd'hui, Alstom a pour principal concurrent un géant chinois qui a émergé en très peu de temps. À l'époque où vous étiez à Bercy aviez-vous déjà dans le viseur l'émergence de ce géant chinois ?
Considérez-vous le décret Montebourg comme une arme efficace ou s'agit-il surtout d'une arme de dissuasion ?

Merci, monsieur le ministre, de nous avoir dévoilé l'envers du décor de ce gâchis industriel. En ce qui concerne la filière hydro, qui est, comme vous l'avez dit, stratégique pour la réussite de notre transition énergétique, vous nous avez fait part de son rachat possible par Alstom, qu'il faut effectivement envisager.
Plus largement, on a l'impression que l'on nous ressert depuis des décennies les mêmes éléments de communication sur ces fusions d'entreprises, qui seraient des alliances entre partenaires garantissant le maintien de l'emploi et permettant l'émergence d'un champion industriel. En vérité, la fin est toujours la même : un plan social. Et l'une des deux parties l'emporte toujours sur l'autre.
Comment expliquez-vous que l'on soit assez naïf pour laisser ainsi l'histoire se répéter ? Quelles propositions auriez-vous à faire pour que nous puissions enfin tirer les leçons du passé et qu'un véritable contrôle soit mis en place sur le respect des partenaires engagés dans ces rapprochements ?

Le mot naïveté a été prononcé à plusieurs reprises, mais pouvait-on anticiper en 2014 le regroupement des deux géants chinois du ferroviaire, le retournement du marché du gaz et le blocage du projet d'éoliennes offshore, suite à l'action des associations de protection de l'environnement ?
Lorsque le marché se durcit, quelles sont les solutions qui s'offrent à une entreprise qui n'a ni la taille critique ni la capacité de financement pour attendre un retournement de cycle ? On a évoqué la possibilité de nouer des alliances – de préférence au niveau européen – ou de nationaliser. Avait-on les moyens à l'époque de nationaliser Alstom, compte tenu de l'importance de notre dette et du niveau de pression fiscale qui pesait déjà sur les Français ?
D'autres facteurs ont sans doute également joué dans la vente d'Alstom, et notamment la procédure engagée contre l'entreprise par le DOJ. Aviez-vous à ce moment-là connaissance du montant de l'amende que risquait Alstom et des échéances qui lui étaient imposées, lesquelles pouvaient conduire à sa fin précipitée ? Dans ces conditions, avait-on le temps de mettre en oeuvre le plan B, en l'occurrence le rapprochement avec Siemens ?
Ce sont autant de questions motivées par une lecture de cette affaire dans laquelle il est évident que l'État a manqué d'anticipation, non seulement en ce qui concerne l'évolution d'un marché de plus en plus concurrentiel, qui se restructurait, depuis le début des années deux mille autour de quelques grands acteurs industriels, mais également au plan juridique, face à l'évolution des procédures judiciaires dont faisait l'objet Alstom. Cette absence d'anticipation n'est-elle pas la principale cause du défaut de stratégie qui a conduit l'entreprise là où elle est ?
Mme El Haïry m'a posé la question du transfert des mécanismes de contrôle au plan européen. Vu l'état de dysfonctionnement du système politique européen et son excès de bureaucratisation, je suis conduit à me méfier. C'est peut-être compliqué en France, mais on sait prendre des décisions en vingt-quatre heures quand il le faut. Sur le plan européen, je n'ai aucune confiance dans le dispositif. Peut-être qu'il changera, mais vous savez d'expérience ce qui se passe : on dépouille les États de leur souveraineté pour la transférer à une entité non-démocratique qui prétend l'exercer de manière partagée. En conséquence, on ne peut plus agir à titre national et on ne le fait pas davantage sur le plan européen. Les citoyens entrent en rébellion contre l'Europe et contre leurs dirigeants, ce qui donne le populisme que nous connaissons, ou plutôt l'extrémisme à tous les étages. Je suis donc très réservé. On peut être plutôt optimiste ou plutôt pessimiste, selon les sensibilités. Pour moi, c'est : méfiance !
Mme Kerbarh m'a interrogé sur Vigeo. Je vais remettre à la commission d'enquête l'Agreement que j'ai signé au nom du Gouvernement français. C'est un protocole d'accord à parfaire. On m'a demandé si j'avais anticipé : vous verrez qu'un document du 19 février 2014 traitait de l'affaire chinoise et des difficultés liées à la solitude d'Alstom, mais concluait qu'il n'y avait pas urgence à agir. Un mois plus tard, on était sur le gril, avec des dirigeants qui avaient trahi la France, selon moi – je le leur ai d'ailleurs dit. Vigeo a été mandaté, vous verrez que cela figure dans l'accord. Il serait intéressant de savoir ce qui s'est produit ensuite, mais ma situation actuelle ne me permet pas de poser des questions : je ne suis qu'un citoyen français parmi 67 millions d'autres, et c'est bien normal.
Vous avez aussi évoqué la route de la soie. Il va falloir remplir les trains repartant vers la Chine. Vous savez que les bateaux arrivant en Europe repartent à vide, exception faite des grumes de chêne avec lesquels on fabrique en Chine du parquet qui est ensuite revendu aux Français. Vous voyez à quel point la situation est devenue absurde. Il va falloir que les Européens vendent des produits aux Chinois. C'est l'enjeu de ces infrastructures de transport.
M. Dive m'a questionné sur les entreprises étrangères en France. Il n'y a pas que Bombardier : deux millions de personnes sont employées par des entreprises étrangères dans notre pays, ce qui fait beaucoup. La France est un pays ouvert. Elle ne peut donc pas avoir une politique radicale en matière de protection, mais une politique de réciprocité, idée que j'ai toujours défendue. Face à un investisseur américain, la question est de savoir comment les États-Unis se comportent à notre égard sur leur territoire : ils ont le CFIUS et l'on doit passer sous les fourches caudines d'une commission quand on investit. On doit faire de même en France. Même raisonnement pour les Chinois, qui imposent la règle des « 51-49 % », comme les Algériens. Pourquoi ne pas faire de même ? Avec le décret, on le peut. C'est une question de réciprocité. Si on démantèle en face, nous pouvons être beaucoup plus aimables. Une telle politique a le mérite de l'intelligence : il s'agit de comprendre qui est l'autre quand il vient vers nous.
La filière est évidemment en consolidation et en difficulté. On a connu la même situation dans l'aéronautique et vous savez comment la décision a été prise. Il y avait une myriade d'entreprises dont on a fait Airbus, ce qui nous a permis de devenir un acteur mondial. Il faudra que la Commission européenne accepte, à un moment donné, que Bombardier fasse l'objet d'une décision à l'égard de la nouvelle entité européenne constituée de Siemens et d'Alstom. Il y aura une décision à prendre. Se posera la question des doublons, qui avait été analysée avant le déclenchement des hostilités, avec le sujet des stratégies et des alliances possibles dans le reste du monde. Cela dit, le rapport est historiquement daté, puisque le paysage a radicalement changé.
Monsieur Kervran, les outils sont normalement interministériels, ce qui présente des avantages, mais pose aussi un problème : les résultats sont adressés au Président de la République et au Premier ministre. En réalité, ce sont les « soupentistes » des cabinets qui reçoivent les télégrammes et n'avertissent pas le ministre compétent. La concentration du pouvoir nuit à son exercice. C'est une leçon qu'il faut méditer en toutes circonstances. En conséquence, nous nous sommes trouvés peu ou mal organisés face aux attaques du DoJ contre Alstom. Les institutions ont fonctionné normalement, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas fonctionné en réalité. Il y a eu un rapport qui est resté sur une pile, à dormir.
Le décret du 14 mai 2014 est une arme – je réponds à M. Adam, qui voudrait certainement recevoir une caisse de la cuvée du redressement. (Sourires.)
Nous l'avons bue avec plaisir !
Le décret constitue une arme de prévention. Pour tout investissement étranger dans les secteurs prévus, il y a normalement une déclaration au Trésor. Interrogez le chef de bureau compétent – je ne sais pas de qui il s'agit aujourd'hui. Demandez-lui comment l'instruction est réalisée, dans quel but, et quelles sont les instructions du ministre. Ce chef de bureau relève du directeur du Trésor, lequel reçoit des instructions du ministre.
Comment utiliser le décret ? On peut poser des questions : quels emplois allez-vous créer ? Quelle est votre ligne de production ? Pouvez-vous laisser M. Untel dans votre conseil d'administration ? On peut tout faire avec cette arme phénoménale, mais elle n'a d'intérêt que si l'on s'en sert, à titre préventif ou curatif. Je vous incite donc à poser des questions.
Je vous confirme que l'on avait vu le problème chinois. C'est dans le rapport dont vous pourrez prendre connaissance. La question des Chinois se pose dans tous les secteurs, comme celle des Américains. C'est la « Chinamérique » : la Chine et les États-Unis sont les deux empires dans le monde. Il n'est pas très malin de se dire qu'il faut se jeter dans les bras des Américains face aux Chinois. On doit plutôt construire l'Union européenne : notre avenir est là.
Madame Battistel m'interroge sur notre naïveté, et les accords que nous avons conçus.
Parmi les solutions qui peuvent être esquissées, je propose qu'à chaque fois que des accords sont signés entre des entreprises et l'État, ils prennent la forme de contrats, pas de communiqués de presse ou de déclarations unilatérales. Il faut des contrats, dont le non-respect soit sanctionné par la nullité de l'accord.
De tels contrats doivent être également signés avec des entreprises françaises. En effet, M. Drahi a pris des engagements qu'il n'a jamais respectés. D'ailleurs, je n'ai pas soutenu le rachat à effet de levier (LBO) de M. Drahi pour une raison simple : je ramassais tous les jours à la petite cuillère des LBO dans l'économie française ! Trop de dettes tuent l'entreprise. Il m'a répondu que ce n'était pas un LBO : voyez ce qui est en train de se passer, c'est un LBO mondial avec 50 milliards de dettes. À l'époque, son entreprise était étrangère, et le décret n'existait pas.
C'est ainsi que l'État français doit se réarmer. Demandez au Gouvernement de faire des contrats avec des clauses résolutoires. Les acteurs concernés fileront doux et vous aurez des gens pour répondre aux problèmes.
Madame Pouzyreff, avons-nous les moyens de nationaliser ? Nous avons mis 800 millions dans Peugeot-PSA : regardez ce que ça rapporte. C'est un très bon placement pour les contribuables. Pour moi, ce n'est pas un coût mais un investissement.
On peut d'ailleurs faire évoluer les participations. Faut-il garder autant chez Engie ? Nous pouvons très bien diversifier les participations et faire évoluer le portefeuille. Cela se discute publiquement devant l'Assemblée nationale, le Sénat et l'opinion publique. Est-il par exemple utile de garder notre participation dans la Française des Jeux ? Ne pourrions-nous l'investir ailleurs ?
Bien sûr que nous avons les moyens ! Je rappelle que nous avons un fonds souverain de 100 milliards d'euros, plus les 100 milliards que je suggère de mobiliser. En outre, l'État n'est pas obligé d'arriver seul, il peut fédérer des investisseurs privés avec un état d'esprit patriotique, et mettre 5 % tandis qu'ils fournissent le reste. Ainsi, on peut arriver à construire des alliances entre public et privé, autour de l'intérêt de la nation, de ses intérêts industriels.
Sur le montant de l'amende, nous ne le connaissions pas à l'époque. L'amende est apparue dans le fil de la négociation. Cela en est même devenu un enjeu lorsque M. Kron a annoncé son montant et que les Américains ont dit qu'ils en paieraient une partie. Ils savaient et ils avaient tout prévu.

Les articles 151-3 et suivants du code monétaire et financier, qui ont servi de base légale à votre décret, prévoient un pouvoir de sanction en cas de non-respect des obligations. Le ministre peut prononcer des amendes qui vont jusqu'au double du montant des investissements, ou prononcer le désinvestissement. Mais comme il n'y a pas de contrôle effectif, ces mesures ne sont pas prises au sérieux.
Monsieur le ministre, votre audition était très attendue. Je vous remercie pour votre liberté de parole et pour la transparence dont vous faites preuve envers la représentation nationale. Une grande part de la suspicion et de l'inquiétude qui entourent ces sujets vient du fait que lorsque des engagements sont pris, ils ne sont jamais publics, la représentation nationale n'y est jamais associée, tout cela est traité dans une sorte d'entre soi. Nous y verrions un peu plus clair si la représentation nationale était associée et cela éviterait peut-être les dérives possibles de l'entre soi, pour reprendre une expression utilisée récemment par l'inspection générale des finances dans un rapport interne.
Merci pour les documents que vous nous avez remis, et pour les suggestions issues de votre expérience.
La séance est levée à dix-neuf heures vingt-cinq.
Membres présents ou excusés
Réunion du mercredi 13 décembre 2017 à 17 heures
Présents. - M. Damien Adam, Mme Delphine Batho, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Michèle Crouzet, M. Julien Dive, Mme Sarah El Haïry, M. Daniel Fasquelle, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Loïc Kervran, M. Bastien Lachaud, Mme Laure de La Raudière, M. Roland Lescure, M. Olivier Marleix, M. Hervé Pellois, Mme Natalia Pouzyreff, M. Frédéric Reiss, M. Denis Sommer
Excusés. - M. Éric Girardin, M. Fabien Roussel
Assistait également à la réunion. - M. Guillaume Larrivé