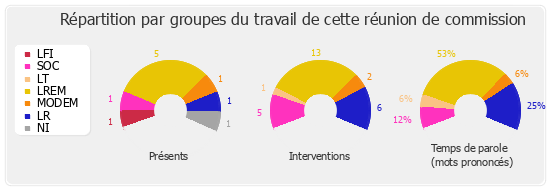Commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire
Réunion du mercredi 29 janvier 2020 à 15h30
La réunion
La séance est ouverte à 15 heures 35.
Présidence de M. Ugo Bernalicis, président.
La commission d'enquête entend M. Stéphane Noël, président du tribunal judiciaire de Paris.
Mes chers collègues, nous commençons aujourd'hui les auditions de la commission d'enquête en recevant M. Stéphane Noël, président du tribunal judiciaire de Paris, juridiction nouvelle, née le 1er janvier 2020 de la fusion du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance de Paris.
Cette audition est publique, ouverte à la presse et diffusée en direct sur le site internet de l'Assemblée nationale.
Avant de commencer, je précise que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
(M. Stéphane Noël prête serment.)
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, c'est un honneur pour moi de me présenter devant vous aujourd'hui.
Quelques mots, tout d'abord, de mon parcours professionnel varié ou un peu atypique. J'ai toujours exercé des fonctions de magistrat, du siège et du parquet. J'ai été en poste au sein de l'administration centrale et dans des juridictions. J'ai exercé mes fonctions en province et à Paris, ou en région parisienne, au sein de juridictions de taille modeste ou importante.
J'ai également connu deux expériences professionnelles un peu particulières : la première assez longuement au sein de l'inspection générale des services judiciaires, aujourd'hui dénommée inspection générale de la justice ; la seconde pendant plusieurs années en cabinet ministériel. J'y ai notamment servi trois gardes des Sceaux successifs, ce qui n'est pas si fréquent dans l'histoire du fonctionnement de nos institutions.
L'intérêt que vous portez à la question de l'indépendance du pouvoir judiciaire est consubstantiel de l'approche que l'on peut avoir de l'institution judiciaire depuis 1958. Comme vous le savez, les institutions de la Ve République ont en effet attribué à l'autorité judiciaire une place – une reconnaissance – particulière. Mais je suis toujours étonné que l'on se focalise toujours sur le juge judiciaire, sans intégrer la justice administrative dans les enjeux des rapports entre le justiciable, c'est-à-dire nos concitoyens, et la justice. Or pour un grand nombre d'administrés, les rapports avec l'État, les collectivités locales, les préfets ou les autorités administratives passent par la justice administrative.
Je trouve donc, même si c'est parfaitement légitime, que l'on accorde toujours beaucoup d'attention à l'autorité judiciaire, sans s'interroger sur le fonctionnement de la justice administrative au regard de principes directeurs, notamment la notion d'indépendance.
Cela étant, dans l'exercice de mes fonctions, notamment au sein de l'inspection générale, mais également en tant que chef de cour, comme procureur général près la cour d'appel de Bourges pendant trois ans et demi, j'ai été très attaché à l'appréciation du fonctionnement de services de la justice qui participent, eux aussi, à l'autorité judiciaire, à savoir les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes qui sont composés non pas de magistrats professionnels, mais de juges élus. Dans le périmètre de la notion d'indépendance de l'autorité judiciaire, quel regard portons-nous sur l'indépendance des juges qui composent les tribunaux de commerce ou les conseils de prud'hommes eu égard aux impératifs que l'on assigne légitimement aux magistrats de l'ordre judiciaire ?
Pour s'assurer du bon fonctionnement de l'institution judiciaire, il importe de prendre en considération deux notions : celle, bien évidemment, d'indépendance, qui relève du statut, lui-même découlant de la Constitution et de la loi organique, mais également celle d'impartialité, qui relève davantage de la déontologie et de l'éthique du juge. Ces deux notions ont évolué et progressé depuis le début de la Ve République et depuis que le recrutement et la formation des magistrats sont assurés par l'École nationale de la magistrature. Elles font désormais partie du corpus des magistrats et sont bien maîtrisées, même si elles font toujours l'objet, compte tenu de leur importance, d'interrogations de la part tant des observateurs que de la communauté des juges eux-mêmes.
Eu égard aux fonctions de président du tribunal judiciaire de Paris que j'exerce actuellement, j'insisterai davantage sur le regard que les magistrats du siège peuvent porter sur ces notions. Certaines déclinaisons ou appréciations de ces dernières peuvent varier en effet selon qu'on est au siège ou au parquet.
S'agissant des conditions de nomination des magistrats du siège, vos premières interrogations concernent le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Son évolution, notamment dans sa composition et dans son rôle, a atteint un point d'équilibre. Une des évolutions les plus importantes que nous ayons connues ces dernières années a trait à sa composition : les magistrats professionnels n'y sont plus majoritaires. Les personnalités extérieures, ou les « laïcs » dans le jargon des juristes et des magistrats, sont désormais majoritaires au sein du Conseil.
Cette évolution ne fait plus l'objet de critiques virulentes : une sorte de maturité a été atteinte, grâce notamment à l'ouverture de la magistrature, élément important pour assurer le lien avec nos concitoyens. Cette nouvelle composition du CSM constitue donc une avancée importante.
On peut, en revanche, relever que les attributions du CSM lui permettent de continuer à prêter une attention particulière aux conditions de nomination des magistrats du siège et du parquet. Vous m'interrogerez certainement sur ce que je peux penser de l'évolution du statut du parquet. Je réponds par avance et franchement : il est important que tous les travaux parlementaires en cours dans le cadre de la navette du projet de loi constitutionnelle aboutissent enfin à faire évoluer le statut du parquet. La nomination des magistrats du parquet après l'avis conforme du CSM ? Il appartient à la représentation nationale de le décider et à l'exécutif de convoquer le Congrès afin de faire adopter cette réforme qui est attendue par la communauté des magistrats.
Si je m'en réfère à mon expérience, une évolution des fonctions du CSM est également envisageable s'agissant de l'intégration dans la magistrature. Comme vous le savez, la tradition républicaine veut que l'on entre dans la magistrature par concours. Mais depuis de nombreuses années, l'institution judiciaire s'étant ouverte, il est désormais possible de l'intégrer en présentant un dossier de candidature, et après avoir été entendu par des chefs de juridiction ou de cour ainsi que par les membres de la commission d'avancement qui est composée exclusivement de magistrats professionnels.
Le CSM pourrait se voir reconnaître la décision d'intégrer des magistrats. De même, il pourrait revenir au CSM d'assurer la promotion des magistrats au travers notamment de l'inscription sur la liste d'aptitude. Le CSM validerait en quelque sorte les premières années de carrière professionnelle dans le second grade et permettrait l'accès au grade supérieur.
De même, les contestations des décisions de la commission d'avancement, qui dispose d'une compétence d'évaluation des magistrats, pourraient être portées devant le Conseil supérieur de la magistrature. Cela permettrait d'étendre ses missions en termes de gestion des ressources humaines. L'un des enjeux de l'évolution du CSM tourne en effet autour de la gestion du corps.
L'étude du fonctionnement et de la composition du CSM impose également de se pencher sur son mode de renouvellement, en intégralité, tous les quatre ans. Ceci peut nuire à l'efficacité comme à l'engagement d'une équipe qui, pendant la durée du mandat, s'est investie, a procédé à de très nombreuses auditions, a visité des juridictions, s'est intéressée au fonctionnement de l'institution judiciaire et a pu apprécier les enjeux liés à la formation. Il est peut-être dommage qu'au terme de quatre ans, cette connaissance se perde, seul le secrétariat général du CSM étant à même d'assurer la continuité entre les équipes. C'est une bonne chose, mais il ne dispose pas de la même légitimité que les membres du CSM.
Pour autant, ces derniers ne siègent pas à plein temps. Ils ont, par ailleurs, une occupation professionnelle, soit en tant que magistrats, soit en tant qu'universitaires, ou fonctionnaires issus d'autres administrations. Pour la formation du parquet, ils siègent un jour par semaine, et deux jours pour la formation du siège.
Il est certain qu'une extension des compétences du CSM nécessiterait de la part de ses membres une disponibilité beaucoup plus grande : ce serait une autre approche de leur mandat.
Depuis un certain nombre d'années, des débats portent sur le fait de reconnaître ou non la vocation du CSM à devenir un conseil de justice, c'est-à-dire une autorité exerçant davantage de missions dans la gestion de la justice voire une fonction d'inspection des cours et des tribunaux et d'appréciation des procédures administratives. Le sujet est difficile car, au-delà de l'aspect ayant trait aux ressources humaines, il y a aussi des enjeux budgétaires.
J'avoue être un peu plus réservé sur cette évolution : elle imposerait en effet de repenser complètement le périmètre d'intervention du Conseil en termes de durée de mandat et de disponibilité pour l'exercer. En outre, l'architecture administrative du ministère de la justice est devenue extrêmement complexe. On pourrait cependant concevoir que le Conseil supérieur de la magistrature dispose d'un « droit de tirage » sur les missions confiées à l'inspection générale de la justice qui dépend actuellement du garde des Sceaux. Dans cette hypothèse, l'inspection ne rendrait compte qu'au conseil.
Le CSM exerce aussi une compétence en matière disciplinaire : dans ce domaine également, les choses ont culturellement évolué. Cette compétence a constitué une révolution culturelle désormais parfaitement intégrée : les chefs de cour pourront vous présenter, en termes de sanctions ou de suites disciplinaires, certains éléments quantitatifs et qualitatifs.
Vous auditionnerez sûrement la première présidente de la Cour de cassation et le procureur général, qui vous présenteront l'organisation mise en place pour traiter les requêtes des particuliers, ce qu'elles représentent en nombre et en contenu. Ils vous indiqueront également qu'il est important que le CSM engage régulièrement un dialogue nourri notamment avec la direction des services judiciaires ainsi qu'avec le ministère en général : c'est globalement le cas puisque le directeur des services judiciaires est son interlocuteur privilégié s'agissant des nominations de magistrats.
Je vous ai franchement indiqué ma position concernant les conditions de nomination des procureurs. S'agissant des missions du CSM, on peut envisager certaines évolutions qui sont cependant conditionnées à une redéfinition de la durée du mandat et des missions de ses membres, afin qu'elles s'exercent avec davantage de continuité dans le temps.
Vous m'avez également interrogé sur le point de savoir si les allers-retours entre le siège et le parquet étaient susceptibles de nuire à l'indépendance de la justice : très franchement, je pense que non. Bien au contraire.
Une autre de vos questions porte sur le fort corporatisme qui marquerait aujourd'hui l'institution judiciaire et qui alimente certaines critiques. On pourrait y répondre par une boutade : qui n'est pas corporatiste dans notre pays ? Au-delà du corporatisme, il faut éviter l'isolement ou le repli du juge, notamment du juge du siège. Il est donc important qu'au cours de sa carrière professionnelle un magistrat, quelle que soit son affectation, puisse bénéficier d'une ouverture. Je n'ai jamais entendu des magistrats du siège passés par le parquet regretter ce type d'expérience – et inversement. De tels allers-retours entre le siège et le parquet représentent forcément un enrichissement professionnel. Je ne crois pas qu'ils puissent être perçus comme une atteinte à l'indépendance.
Lorsque vous siégez au parquet, les missions de l'action publique sont certes particulières mais elles correspondent à des enjeux fondamentaux du fonctionnement de la justice. De même, l'acte de juger n'a rien à voir avec l'acte de poursuivre : ils nécessitent cependant tous deux de s'approprier les enjeux de l'ensemble du procès judiciaire.
Une des évolutions importantes, désormais très marquées, que j'ai mentionnée précédemment, a trait à l'ouverture du corps des magistrats. Il y a plus de vingt ans, seuls des étudiants sortant des facultés de droit ou des instituts d'études politiques devenaient magistrats et faisaient toute leur carrière au sein de la magistrature. Désormais, un nombre non négligeable de personnes dites extérieures, c'est-à-dire ayant eu une carrière professionnelle dans un autre secteur, soit au sein des professions judiciaires – comme la protection judiciaire de la jeunesse ou l'administration pénitentiaire – ou juridiques, soit parfois dans le secteur privé, intègre la magistrature.
Ayant été chef de cour et étant actuellement encore chef de juridiction, je mesure la richesse et le caractère précieux de leur apport : il oxygène en quelque sorte la maison justice au sens le plus large. Cette ouverture est donc une bonne chose.
L'unité de la magistrature entre le siège et le parquet, qui fait notre spécificité, constitue un très fort élément de notre identité institutionnelle – le corps des magistrats y est d'ailleurs très attaché. Je réponds catégoriquement que ces allers-retours entre le siège et le parquet ne portent pas atteinte à l'indépendance de la magistrature : il faut simplement veiller – et les conditions statutaires sont bien déterminées – que l'on ne passe pas de l'un à l'autre dans la même juridiction, voire dans la même cour, et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté en termes d'apparence vis-à-vis du justiciable.
Il reste, mais cet aspect relève de la déontologie – le recueil des obligations déontologiques le rappelle et les chefs de cour et de juridiction doivent y veiller –, qu'il ne faut pas que le justiciable puisse avoir le sentiment qu'il existe une trop grande proximité ou une connivence entre le siège et le parquet. Il est vrai qu'ils travaillent tous deux au sein des juridictions, et que parfois, dans celles de taille modeste, ils partagent les mêmes couloirs. Cependant, à l'audience, on veille à ce que les magistrats ne fassent pas leur entrée ensemble et à ce qu'ils n'échangent pas au cours des suspensions. De même, avant une affaire, on évite de déjeuner ensemble pour ne pas donner le sentiment qu'il peut exister une proximité entre des acteurs judiciaires qui, au moment du procès, ne représentent pas les mêmes intérêts dans l'issue du litige. Cela me paraît très important.
Sur la question de la mobilité géographique, beaucoup d'éléments sont à souligner. Premièrement, le corps de magistrats est marqué par une très grande mobilité : chaque année plusieurs centaines de magistrats changent d'affectation.
Cette mobilité s'explique tout d'abord parce qu'à la sortie de l'école, les jeunes magistrats commencent principalement leur carrière soit dans le Nord, soit dans l'Est, soit dans le centre de la France, régions, où du fait de difficultés particulières, il est plus difficile de pourvoir certains postes, alors que les magistrats sont plutôt issus des grands pôles urbains et des grandes métropoles régionales. Il existe donc une mobilité liée à l'âge ainsi qu'à la géographie.
Le second élément tient à l'existence d'une magistrature régionale : les carrières se déroulent essentiellement au sein des grandes cours d'appel. Il est rare, en effet, qu'au cours de sa carrière, un magistrat soit affecté successivement à Boulogne-sur-Mer, Toulon et à Clermont-Ferrand puis qu'il revienne à Avesnes-sur-Helpe pour terminer à Toulouse ou à Bordeaux.
Ainsi les magistrats originaires du Sud-Ouest regagnent-ils très vite leur région d'origine pour y rester. En termes de proximité géographique, ce phénomène peut parfois, au travers de pressions ou d'une trop grande connaissance de l'environnement, soulever une difficulté. Il est donc nécessaire à mon sens de bien veiller à ce qu'au-delà de l'inamovibilité du magistrat du siège, principe fondamental pour garantir son indépendance, il n'existe pas de trop grande proximité géographique entre les juges et leur environnement que certains d'entre eux peuvent connaître depuis trop longtemps.
Je vous livre deux anecdotes. J'ai été pendant un peu plus de deux ans président du tribunal de grande instance de Belley, petite juridiction dans le sud du département de l'Ain. Mes collègues de l'époque et moi-même, en l'absence de restaurant administratif, déjeunions dans le petit restaurant ou le café du coin. Or à l'époque, ce tribunal exerçait une compétence commerciale : il devait de ce fait juger toutes les difficultés rencontrées par les commerçants. Nous avons vite compris que nous allions sans doute parfois déjeuner chez des restaurateurs qui se trouvaient en redressement judiciaire. Devions-nous déontologiquement continuer à le faire ? Pouvions-nous accepter qu'on nous offre un café ? Même s'il n'était question ni de pression ni d'atteinte à notre indépendance, il était nécessaire de prendre du recul.
Cela signifie que, lorsque vous évoluez dans un environnement que vous connaissez trop, la distance, qui est absolument essentielle dans l'exercice des fonctions de magistrat, n'est pas toujours facile à conserver dans la durée.
Seconde anecdote, lorsque j'étais procureur général près la cour d'appel de Bourges, j'ai mesuré la réalité de l'existence d'une magistrature régionale. Les magistrats qui y étaient en poste avaient effectué leur carrière entre Bourges, Châteauroux, Nevers et parfois, mais très peu, Orléans et Clermont-Ferrand. Cette situation faisait que les membres de la communauté professionnelle rassemblant magistrats, avocats, notaires, huissiers et milieux économiques se connaissaient nécessairement. Je m'interrogeais régulièrement pour savoir si nous étions suffisamment attentifs aux conséquences déontologiques que cela pouvait engendrer.
La mobilité géographique doit donc être également perçue comme une garantie de l'indépendance du juge. Il n'existe cependant pas, dans le statut de la magistrature, d'obligation de mobilité géographique.
Actuellement, certaines fonctions spécialisées, comme les juges d'instruction ou les juges des enfants, doivent respecter une obligation statutaire et ne pas être exercées plus de dix ans. Pour les chefs de cour et de juridiction, la limite a été fixée à sept ans. Ces obligations ont fait suite aux conclusions de la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau, mais la mobilité géographique n'a fait l'objet d'aucune réflexion particulière. Certes, elle peut constituer un handicap car une trop grande mobilité désorganise les juridictions. Mais une trop grande stabilité dans un même lieu peut faire naître des interrogations quant à l'indépendance du juge. Même si je n'ai pas d'idée arrêtée sur le sujet, à la lumière de ce que j'ai pu connaître, je m'interroge, sous l'angle de l'impartialité.
L'appartenance syndicale d'un magistrat peut-elle nuire à son indépendance ? La question du syndicalisme dans la magistrature est difficile, et elle est régulièrement posée. Se syndiquer, adhérer à une organisation professionnelle représentative est désormais un droit acquis pour les magistrats, reconnu par les dispositions statutaires et figurant dans les recommandations du Conseil de l'Europe.
Je n'ai pas le sentiment que le fait pour un magistrat d'appartenir à une organisation syndicale nuise à son indépendance. La nécessité de conserver une certaine distance par rapport à toute forme d'engagement ou d'adhésion est un principe déontologique qui vaut aussi pour l'appartenance syndicale. Cet impératif doit être rappelé.
Recevoir une décoration est-il, pour un magistrat, compatible avec l'exigence d'indépendance ? Je porte aujourd'hui la mienne, honoré de la distinction que la République a bien voulu me reconnaître. L'institution judiciaire mérite d'être distinguée au même titre que les autres grandes institutions de la République, et l'engagement de celles et ceux qui s'investissent dans le fonctionnement de la justice mérite d'être reconnu.
Ce n'est pas parce qu'on est distingué par une décoration que l'on est davantage susceptible d'allégeance vis-à-vis de celui qui vous l'a obtenue ou qui vous la remet. À nouveau, cela relève de l'éthique du juge, et jamais je n'ai constaté autour de moi que la remise d'une décoration ait pu porter le discrédit sur l'indépendance d'un juge. En préparant cette audition, je me suis d'ailleurs demandé si on se posait la même question pour les universitaires. Je ne pense pas qu'un universitaire décoré perd sa liberté intellectuelle dans la façon d'appréhender un débat. La maturité républicaine de notre société est telle que ceux qui sont distingués par la République savent faire la part des choses entre une distinction officielle et l'engagement professionnel au quotidien.
En revanche, j'ai été confronté indirectement à des comportements susceptibles de porter atteinte à l'indépendance de la justice à l'occasion des contrôles effectués lorsque j'étais à l'inspection générale sur le fonctionnement des tribunaux de commerce ou des conseils de prud'hommes. Ces instances présentent deux difficultés d'ordre déontologique : la proximité géographique et l'élection. Compte tenu de ce mode de désignation et de renouvellement de mandat, les conditions de nomination et d'exercice des fonctions y sont différentes des juridictions de droit commun.
Dans certains conseils de prud'hommes, on assiste à un rapport de force extrêmement tendu entre le collège salarié et le collège employeur, et la distance requise par rapport au milieu professionnel qui les a élus n'est pas toujours respectée par les juges, ce qui pénalise le fonctionnement de l'institution judiciaire.
Assez récemment, lors de la prestation de serment des nouveaux conseillers prud'homaux devant le tribunal de grande instance de Créteil, j'ai fait un discours assez musclé de mise en garde : tout en reconnaissant la valeur de leur engagement syndical, de leurs années de militantisme, je leur ai rappelé qu'ils avaient désormais pour fonction de juger, et que l'exigence déontologique propre à cette fonction requérait un effort intellectuel particulier pour se détacher de ce patrimoine et changer d'habit afin de se mettre au service de la cause de la justice.

Monsieur le président, je vous propose de répondre aux deux dernières questions relatives au respect des obligations déontologiques.
En matière de déontologie, nous avons connu ces dix dernières années une véritable révolution culturelle.
Celle-ci touche tout d'abord la formation initiale des magistrats qui, jusqu'à récemment, ne comportait pas d'enseignement sur la déontologie. Il se trouve que je suis aujourd'hui régulièrement invité à l'École nationale de la magistrature (ENM) pour assurer en formation initiale une conférence générale intitulée « Savoir et être » sur les fondamentaux de la déontologie. Des séminaires autour de cas pratiques mettent par ailleurs les jeunes magistrats dans des situations qui renvoient à des principes déontologiques. Le programme pédagogique de la formation initiale fait donc une place importante à la déontologie, et c'est une des priorités de l'École.
Ensuite, les nouveaux magistrats doivent désormais remplir une déclaration d'intérêts lorsqu'ils arrivent en juridiction. Lors de la remise de cette déclaration, ils sont reçus par le président de la juridiction pour un entretien déontologique. Celui-ci s'enquiert notamment de leur connaissance du recueil des obligations déontologiques des magistrats, désormais largement diffusé par l'ENM sous différents supports, et des formations qu'ils auraient suivies en la matière.
J'assure la diffusion et la connaissance de ce recueil au travers de l'entretien déontologique. Il m'arrive parfois aussi, lorsque des événements me sont signalés par des plaintes de particuliers ou par des courriers d'avocats, de reprendre les magistrats concernés sur le respect de la politesse, de la délicatesse et de certains principes fondamentaux dont l'application a pu s'émousser dans un contexte particulier. Il s'agit de comportements qui appellent non pas une sanction disciplinaire mais un rappel sur la déontologie.
Ces pratiques sont désormais bien instituées : ce qui pouvait jadis être toléré par habitude ou parce qu'il n'était pas d'usage d'y prêter attention fait désormais l'objet d'une considération beaucoup plus sérieuse de la part des chefs de juridiction.
Il n'y a pas de magistrat référent en matière de déontologie au tribunal judiciaire de Paris, où je n'occupe mes nouvelles fonctions que depuis deux mois. Toutefois, pour être franc avec vous, je n'avais pas désigné de référent durant mes quatre années de présidence de juridiction à Créteil.

J'aimerais tout d'abord préciser que la justice administrative est incluse dans le périmètre de la commission d'enquête et que des auditions sont prévues sur le sujet. En revanche, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes ne le sont pas : ne disposant que de six mois pour établir notre rapport, nous avons été contraints d'en circonscrire le périmètre. Nous serons peut-être amenés à l'élargir à mesure de l'avancée de nos travaux.
Votre parcours n'a rien d'anodin : vous êtes de ces magistrats qui ont servi à la fois au siège et au parquet, qui ont eu des responsabilités politiques dans les cabinets ministériels et sont passés par l'inspection générale des services judiciaires. Vous avez une belle carrière et vous occupez aujourd'hui un poste à responsabilité. Pensez-vous que le fait d'occuper un poste de magistrat à l'administration centrale de la justice (MACJ) pose un problème d'indépendance ? Les magistrats qui occupent ces postes bénéficient en effet d'un avancement plus rapide que ceux qui restent en juridiction.
Le passage en administration centrale est précieux pour la culture du magistrat, en ce qu'il lui permet incontestablement de s'ouvrir sur la société, et d'apprécier comment l'institution judiciaire s'y insère. C'est aussi le moyen de voir quelle est la place du ministère de la justice dans le fonctionnement de l'État, au travers des enjeux interministériels, et de prendre la mesure des enjeux budgétaires propres à l'institution judiciaire.
Lorsqu'un magistrat est en administration centrale, il n'est plus juge : il ne participe plus à l'activité juridictionnelle. Je ne pense pas qu'à son retour en juridiction son indépendance soit entamée. Jamais je n'ai constaté, de la part des collègues que j'ai pu accueillir en juridiction de retour d'un passage en administration centrale, une quelconque dégradation de la qualité d'appréciation, de l'impartialité ou de l'indépendance. J'ai même trouvé chez ces magistrats une certaine gourmandise professionnelle à retrouver le cœur de métier après dix années dans l'administration centrale finalement perçues comme une parenthèse.
Ces expériences n'en restent pas moins précieuses. Voici un exemple très concret : une magistrate, passée par la direction des affaires criminelles et des grâces, était une spécialiste de la coopération internationale. Elle avait mené des négociations avec Bruxelles et des échanges bilatéraux avec certains États. Nommée juge d'instruction dans le Val-de-Marne, à Créteil, elle a été d'une aide précieuse pour moi-même et mes collègues juges d'instruction pour rédiger une commission rogatoire internationale, la diffuser et en assurer l'exécution. Elle disposait de relais institutionnels pour faciliter le dialogue avec l'administration centrale, ce qui ne constituait nullement une atteinte à son indépendance, et qui d'ailleurs n'était perçu comme telle ni par elle-même, ni par ses collègues.
J'aurais de multiples exemples à vous donner. Le dernier en date est celui d'une magistrate que nous avons accueillie au tribunal de Paris, qui était à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et qui s'était beaucoup investie dans la réforme de l'ordonnance de 1945. J'ai considéré qu'elle était pour le service une personne ressource dans l'appréhension de l'ensemble du travail préparatoire réalisé par le ministère, certainement en lien avec la commission des Lois de votre assemblée, et dans la compréhension des enjeux de la refonte de ce texte réglementaire. Il ne me semble pas que ce soit là une atteinte à son indépendance.
Vous m'avez interrogé sur la possibilité d'obtenir un avancement plus rapide en passant par l'administration centrale de la justice. Un élément objectif pourrait aller dans ce sens : il est acquis que l'on est plus vite inscrit au tableau d'avancement, ce qui permet de passer plus rapidement au premier grade.
Je le répète : le passage en administration centrale constitue pour le magistrat un enrichissement personnel pour l'exercice de ses fonctions futures. Il permet de concevoir l'institution judiciaire non plus exclusivement dans le périmètre classique et très noble du prétoire ou du jugement d'une affaire, qui est le cœur du métier, mais dans son environnement, dans son travail avec les divers partenaires que sont les professions judiciaires et juridiques, les autorités préfectorales, les élus, les acteurs de la protection de l'enfance, et d'acquérir ainsi une culture administrative.

Pour vous, le fait de passer par l'administration centrale ou par un cabinet ministériel, c'est-à-dire d'être au cœur même de l'exécutif, ne poserait donc pas de problème d'indépendance. Ne peut-il pas y avoir dans certains cas une forme d'acculturation des magistrats à une pensée conforme qu'on pourrait attendre d'eux ?
Je pense par exemple à la circulaire de politique pénale adressée au parquet sur le traitement judiciaire des infractions commises en lien avec le mouvement des « gilets jaunes ». Comment expliquez-vous que des magistrats du siège, qui sont censés être parfaitement indépendants statutairement, aient strictement suivi les préconisations du parquet en la matière en appliquant, pour des faits identiques, des sanctions plus lourdes qu'habituellement ?
Permettez-moi de vous objecter, monsieur le président, que tous les magistrats qui ont jugé des affaires impliquant des « gilets jaunes » ne sont pas nécessairement passés par l'administration centrale. J'ajoute qu'un juge du siège n'est pas là pour appliquer des circulaires. Engager l'action publique, c'est le rôle du ministère public. Le juge a pour fonction quant à lui d'apprécier individuellement les situations qui lui sont soumises, d'établir la matérialité des faits, de considérer les éléments constitutifs de l'infraction, la personnalité de l'auteur, l'objectif de réinsertion notamment, pour individualiser la peine et son application.
Vous affirmez que les peines prononcées ont dépassé les réquisitions ou ce qui pouvait être attendu ; je ne peux me prononcer sur ces situations individuelles. Ce que je peux vous affirmer avec certitude, et je suis catégorique sur ce point, c'est que le passage en administration centrale n'obère pas l'indépendance du juge.
On pourrait éventuellement soutenir que les fonctions de magistrats sont incompatibles avec celles exercées au ministère de la justice ou celles de membre d'un cabinet. Christian Vigouroux, conseiller d'État, a écrit un très beau livre sur les cabinets ministériels dans lequel cette question est posée. Or, si les magistrats de l'ordre judiciaire ne participaient pas à la vie du ministère ou à celle des cabinets, ce serait alors des administrateurs civils, des membres des tribunaux administratifs ou du Conseil d'État – lesquels participent déjà beaucoup à l'activité ministérielle –, qui porteraient leur appréciation sur le fonctionnement de la justice.
Il me paraît souhaitable au contraire que des magistrats familiers du fonctionnement de l'institution judiciaire apportent aussi leur concours au bon fonctionnement du ministère ou leurs conseils à un garde des Sceaux, et cette mobilité ne me paraît pas nuire à l'image de l'institution judiciaire. Nous sommes désormais nombreux à avoir occupé de telles fonctions, en particulier à Paris, sous l'autorité de directeurs ou de gardes des Sceaux de sensibilités différentes, et il serait infondé d'accuser les uns ou les autres de partialité ou d'atteinte à l'indépendance.

Vous avez évoqué dans votre propos liminaire les évolutions possibles du Conseil supérieur de la magistrature, notamment de sa composition, et fait état de la volonté de certains d'évoluer vers un véritable conseil supérieur de justice, plus étoffé, avec plus de compétences ; c'est la position que je défends.
Verriez-vous d'un bon œil que, sur le modèle des jurés de cours d'assises, des citoyens tirés au sort et formés pour l'occasion siègent au sein d'un conseil supérieur de la magistrature rénové ? La maxime selon laquelle les jugements sont rendus au nom du peuple français trouverait ainsi une déclinaison par le droit de regard du peuple français sur une magistrature qui, sans cela, fonctionne complètement hors sol et en vase clos, comme vous sembliez le reconnaître tout à l'heure.
Je n'y suis pas opposé sur le principe, mais l'expérience que je tire des jurés de cours d'assises me laisse penser que ce serait peu réaliste en pratique. Garantir la disponibilité des jurés quinze jours durant pour une session est déjà très difficile compte tenu de leurs obligations professionnelles ou familiales. Je doute que des citoyens tirés au sort accepteraient de s'engager sur un mandat long de plusieurs années, à plein temps, pour exercer au sein du Conseil supérieur de la magistrature des missions qui sont très particulières.
On peut bien sûr défendre la conception idéale d'une représentation nationale au plus près du citoyen. Il demeure que l'essentiel des fonctions au sein du CSM relève de la gestion des ressources humaines et du management de carrière d'une profession bien spécifique qui suppose, en particulier en matière disciplinaire, une parfaite connaissance des obligations des magistrats. Le savoir-faire intellectuel et technique requis pour cet exercice ne serait à mon avis pas garanti par le tirage au sort.

J'aimerais revenir rapidement sur plusieurs éléments.
S'agissant du Conseil supérieur de la magistrature, serait-ce pour vous un gage d'indépendance si le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat n'avaient plus le pouvoir de désigner certains de ses membres ?
Ce serait en effet envisageable. Désormais, vous le savez, les personnalités dont la nomination est proposée en qualité de membre du CSM doivent être auditionnées par la commission des Lois de chaque assemblée, qui s'exprime par un vote sur ces propositions. Il appartiendra à l'exécutif et à la représentation nationale d'apprécier, le moment venu, l'opportunité d'une nouvelle évolution de ces conditions de nomination, et je n'ai pas à me prononcer en la matière.

Vous avez assez largement abordé les problématiques liées à la mobilité fonctionnelle, entre le siège et le parquet, d'une part, et, d'autre part, vers l'administration centrale et les cabinets ministériels.
Vous avez également évoqué la question de l'intégration dans le corps judiciaire. Sans entrer dans le détail des dispositions organiques relatives au statut de la magistrature, il faut préciser que cette possibilité concerne essentiellement les avocats ou les fonctionnaires de corps régaliens tels que la police et la gendarmerie. Est-ce suffisant selon vous pour enrichir le corps judiciaire, ou pourrait-on ouvrir cette posibilité à des personnes issues de la société civile dans un sens plus large ? Le cas échéant, quelles en seraient les conditions ? L'examen du dossier par la commission d'avancement et le stage probatoire en juridiction seraient-ils des modalités suffisantes ?
La direction des services judiciaires pourrait vous donner précisément l'origine professionnelle des personnes intégrées dans la magistrature. Parmi celles-ci, les avocats sont nombreux, et il y a également quelques policiers et gendarmes. J'ajouterai à ces professions les travailleurs sociaux, ainsi que des personnes issues du secteur privé, de directions juridiques, des professionnels du droit bancaire ou du contentieux bancaire. L'intégration s'est donc déjà beaucoup élargie.
Concernant les conditions d'intégration définitive, il ne faut pas négliger le stage en juridiction, qui permet d'apprécier les capacités intellectuelles dans l'appréhension de toutes les composantes d'un litige, notamment la capacité à rédiger et à tenir un raisonnement juridique. Avoir un intérêt pour la chose judiciaire, avoir le sens de l'écoute, de l'empathie pour son prochain sont des compétences nécessaires pour la qualification professionnelle, mais il est aussi essentiel de maîtriser la technique du jugement, la rédaction d'un réquisitoire, d'une ordonnance, parfois dans l'urgence.
Le stage probatoire a vocation à devenir un moment essentiel de l'intégration, et je serais d'avis d'en étendre la durée.

Vous avez largement abordé la question de la mobilité des magistrats, une autre garantie de l'indépendance des juges qui s'ajoute, pour les juges du siège, à l'inamovibilité. Selon les exigences statutaires actuelles, la durée de certaines fonctions hiérarchiques, comme celle de chef de cour, est limitée à sept ans, et celle des fonctions spécialisées, telles que juge d'instruction, à dix ans. Ce sont des périodes assez longues, notamment au regard d'autres corps d'État tels que celui des préfets, dont le rôle est différent mais dont la charge régalienne est également importante.
Les exigences de mobilité sont-elles à vos yeux suffisantes, y compris en région, où vous avez laissé entendre qu'on peut parfois passer sa carrière dans une seule cour à condition de ne pas trop monter dans la hiérarchie, ou voyez-vous, à l'appui de votre expérience, d'autres règles, plus strictes ou plus novatrices, qui pourraient être appliquées pour garantir l'indépendance ?
La règle des dix ans ne s'applique que pour les fonctions spécialisées et elle n'est pas assortie d'une obligation de mobilité géographique. Un magistrat qui a exercé la fonction de juge d'instruction pendant dix ans au sein d'une juridiction peut ensuite devenir juge au tribunal.
La durée de dix ans me paraît être une limitation suffisante, et que la personne réintègre ensuite la juridiction est raisonnable. Imposer une mobilité géographique serait beaucoup trop contraignant et pourrait être perçu comme une sanction.
Le statut a d'ailleurs évolué en matière de mobilité géographique : pour accéder à un emploi hors hiérarchie, de mémoire, il faut avoir exercé au minimum deux fonctions dans deux cours différentes. On pourrait le concevoir aussi pour le passage au premier grade, pour lequel il faut justifier de sept années d'ancienneté, sans condition de mobilité géographique.

Il faudrait donc concilier le souci d'évolution professionnelle et des contraintes minimales de mobilité.
Oui, mais l'élément déterminant de l'évolution de la carrière d'un magistrat, en particulier pour le passage au grade supérieur, reste la compétence professionnelle ; ce n'est pas la mobilité géographique. Ce sont avant tout les acquis professionnels et la diversité des fonctions exercées qui doivent conditionner l'évolution d'une carrière.

J'aimerais enfin vous interroger sur la déclaration d'intérêts que doivent remettre les magistrats et sur l'entretien déontologique qui s'ensuit avec le chef de juridiction. Premièrement, cet entretien est-il obligatoire ?

Deuxièmement, une simple déclaration d'intérêts vous paraît-elle suffisante ? Les parlementaires, par exemple, sont soumis à un contrôle qui dépasse de loin la simple déclaration d'intérêts. Pourrait-on envisager de renforcer ce contrôle ou les dispositions actuelles vous paraissent-elles suffisantes pour garantir l'indépendance des magistrats, notamment au plan financier ? Il me semble que l'ouverture à des personnes venant du secteur privé donne à cette déclaration une importance accrue.
Lorsque la déclaration d'intérêts a été adoptée pour les magistrats de l'ordre judiciaire – elle existait alors déjà pour les magistrats de l'ordre administratif et les magistrats financiers –, la question s'est posée de l'étendre à leur patrimoine, mais cela n'a pas été fait.
La déclaration d'intérêts me paraît suffisamment détaillée. Le document que le magistrat doit remplir est très précis, il concerne à la fois sa propre personne et son conjoint, son engagement associatif ou politique. L'entretien associé est par ailleurs formel et structuré.
Le fait de renseigner ce document ne m'a pas paru poser de difficultés aux magistrats concernés. Certains se sont interrogés sur la pertinence d'une rubrique sur leur compte bancaire et leurs éventuels crédits, mais cette déclaration n'a pas suscité d'indignation ou d'opposition. Tous ont estimé que c'était une bonne innovation, en particulier parce qu'elle conduisait le magistrat à s'interroger sur la possibilité que son environnement personnel entre en opposition avec l'exercice de ses fonctions.

Merci, monsieur Noël, de répondre aux questions de cette commission d'enquête qui concerne l'autorité judiciaire, et non le pouvoir judiciaire comme l'indique son titre.
Vous parliez à l'instant de la déclaration d'intérêts. À qui est-elle adressée : au Conseil supérieur de la magistrature, aux chefs de cour, au ministère ?
La déclaration d'intérêts est un document écrit, renseigné par le magistrat et remis à son chef de juridiction. Lors d'un entretien avec le magistrat concerné, le chef de juridiction apprécie cette déclaration et passe en revue les différentes rubriques pour évaluer l'existence d'un risque de conflit d'intérêts.
Ce document est ensuite placé sous pli et reste confidentiel. Il est adressé à la direction des services judiciaires. Une fois la déclaration d'intérêts établie, une fiche navette est produite, dans laquelle le chef de juridiction explique avoir reçu le magistrat en entretien individuel, précise s'il a délégué ou non cet entretien et s'il a été nécessaire de saisir le collège de déontologie. Une copie de cette fiche navette est jointe au dossier administratif du magistrat, tandis que l'original est envoyé avec la déclaration d'intérêts à la direction des services judiciaires.

Votre parcours est très intéressant : vous avez été parquetier et magistrat du siège à un haut niveau. Avez-vous été témoin, notamment en tant que procureur, de pressions directes ou indirectes de la part du personnel politique ?
Il est heureux que des magistrats travaillent en administration centrale, vous venez de le justifier, mais certaines fonctions, au cœur du dispositif ministériel, sont particulières. Vous avez ainsi été directeur de cabinet de Rachida Dati. Si elle venait à être élue maire de Paris, pourriez-vous encore être président du tribunal judiciaire de Paris en toute indépendance ? Quel regard porterait le justiciable sur cette proximité issue de vos fonctions précédentes ? Pensez-vous que cela puisse poser problème ?
Pour être précis, j'étais directeur-adjoint de cabinet auprès de Rachida Dati.
En réponse à votre première question, au cours de mon expérience professionnelle, je n'ai jamais rencontré d'élus qui se seraient manifestés afin d'exercer une pression sur le président ou le procureur général.
Au-delà des cérémonies républicaines d'audiences de rentrée, j'ai toujours eu à cœur d'informer et d'associer les élus au fonctionnement du tribunal. Lorsque j'étais président à Créteil, avec la procureure, nous avons reçu les commissions des Lois de l'Assemblée nationale et du Sénat, les parlementaires du Val-de-Marne ont été invités à réaliser un stage pour s'immerger dans les services, et nous avons accueilli des administrateurs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous partions en effet du constat que fréquemment, les élus n'ont pas une très bonne connaissance du fonctionnement de notre institution. Nous n'avons jamais ressenti de pressions ou d'atteintes à l'indépendance dans ce cadre.
Votre seconde question peut susciter un débat, mais un chef de juridiction n'est pas en contact régulier avec le maire ou avec les élus. La situation est légèrement différente pour les procureurs, car ils sont impliqués dans la conduite de politiques publiques ou de partenariat. Lorsque j'étais en poste à Créteil, sans être en contact régulier avec le maire Laurent Cathala, je participais à des rencontres sur des sujets techniques : enjeux de stationnement, accès du justiciable, signalisation du tribunal à la sortie du métro, nom du parvis devant le palais de justice ou manifestations dans le cadre du jumelage. Que ce soit à Créteil, Bourges ou Belley, en aucun cas il n'y a eu d'interventions de maires portant sur l'activité juridictionnelle. Déontologiquement, il serait insensé de penser que nous puissions avoir une oreille attentive à ce type de propos.

Avant d'être directeur-adjoint du cabinet de Mme Dati, vous y avez été conseiller chargé de la carte judiciaire. Même dans ces fonctions, vous n'avez subi aucune pression politique à propos de la fermeture de tribunaux ? Cela me semble invraisemblable, mais nous ne mettons peut-être pas la même chose derrière le terme « pressions ».
Si vous le souhaitez, je peux vous parler de la réforme de la carte judiciaire ; ce sera très long. Les travaux ont été complexes et difficiles. En tout cas, le conseiller d'un ministre sur un sujet qui concerne l'organisation d'un service public n'exerce pas de fonctions juridictionnelles. Il accompagne un garde des Sceaux dans l'exercice de ses fonctions régaliennes de chef d'une administration, et n'évoque en aucun cas des procès ou des affaires individuelles s'il se retrouve avec des élus.
C'est un euphémisme de dire qu'il y a eu des relations difficiles entre les élus et Mme Dati et son cabinet au sujet de la réforme de la carte judiciaire. En l'occurrence, le conseiller du ministre est dans le cadre d'une logique institutionnelle, administrative, à propos de l'organisation d'un service public qui a un impact dans les territoires. Cela n'entre pas dans le périmètre de l'acte de juger dans un prétoire.

En tant que président du tribunal judiciaire de Paris, vous avez des attributions spécifiques dans les cas de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes et délits, fraude fiscale et terrorisme. Le procureur de Paris, Rémy Heitz, a classé sans suite l'enquête pénale visant les journalistes de Disclose qui avaient révélé des informations confidentielles sur l'utilisation d'armes françaises dans la guerre au Yémen. Il estime cependant que l'infraction de violation du secret-défense est caractérisée et enjoint les journalistes à se conformer à la loi à l'avenir.
La plainte émanait du ministère des armées. Le procureur de Paris a-t-il eu des échanges officieux avec les cabinets ministériels pour rendre une décision équilibrée et politiquement acceptable, ou la séparation est-elle parfaite ?
Le secret-défense est-il l'arme absolue de l'exécutif lorsqu'il souhaite s'opposer à une procédure judiciaire ? Le juge Van Ruymbeck a déploré, en son temps, que le secret-défense l'ait empêché de mener à bien un certain nombre d'affaires. Quel est votre avis sur cette question ? Le secret-défense est-il un frein au bon ouvrage de la justice en France ?
Je suis président du tribunal judiciaire de Paris, je ne peux donc pas me substituer au procureur pour apprécier les circonstances dans lesquelles il a pris une décision. Vous pourrez lui poser cette question lors de son audition.
S'agissant du secret-défense, je n'ai pas l'expertise technique suffisante pour vous répondre en cet instant. C'est bien sûr un obstacle aux investigations que les juges d'instruction ou les enquêteurs peuvent mener, à l'instar du secret bancaire dans un autre domaine. Pour la manifestation de la vérité, les juges d'instruction ont des pouvoirs et mènent des investigations, mais on peut leur opposer un certain nombre de principes, dont celui du secret-défense. Le juge d'instruction peut alors demander la levée de ce secret-défense à une commission ad hoc. Je ne peux pas vous répondre de manière plus précise. J'en suis désolé.

J'ai écouté avec attention votre exposé sur l'ouverture du corps de la magistrature, et j'aimerais que vous développiez les règles et procédures en vigueur pour prévenir le risque de conflit d'intérêts et d'atteinte à l'indépendance des juges en lien avec les carrières antérieures. Par hypothèse, un juge pourrait avoir eu connaissance, dans son métier précédent de l'une des parties d'une affaire dont il est saisi, ou de l'objet du litige. Des obligations de déport sont-elles prévues et comment sont-elles appliquées ?
Lorsqu'un magistrat non spécialisé est nommé dans une juridiction, le président a l'obligation de l'affecter dans un service. Cette affectation se fait en fonction des compétences acquises, des envies, des évolutions professionnelles, et fait l'objet d'une discussion entre le président et le magistrat. Le président doit apprécier l'évolution du parcours professionnel et de l'environnement individuel du magistrat pour déterminer s'il n'y a pas de difficultés à l'affecter dans un service donné, et cela s'applique évidemment pour ceux qui viennent du secteur privé.
Par exemple, un ancien cadre au service contentieux d'une banque ne va pas rejoindre la chambre bancaire du tribunal, car il pourrait avoir des difficultés à trouver l'objectivité suffisante pour juger les contentieux qu'il aura connus sous un autre angle particulier quelques années plus tôt. De même, un ancien huissier de justice n'est pas forcément le plus apte à exercer dans le domaine des voies d'exécution, car il gardera peut-être inconsciemment des réflexes dans sa façon d'exécuter les recouvrements de créances.
De plus, il est possible que le magistrat connaisse directement ou indirectement une affaire ou l'une des parties. Il a alors l'obligation déontologique de se déporter. S'il a eu le temps d'examiner le dossier, il se déporte avant le procès. Mais il peut aussi ne découvrir qu'à l'audience, s'il n'a pas eu connaissance du dossier en tant qu'assesseur, que la victime est un commerçant de sa rue, ou un voisin, ou qu'elle a des liens de parenté avec des proches. Il pourra alors se déporter le jour même de l'audience.
Les parties peuvent également demander la récusation du juge si elles considèrent qu'il n'offre pas toutes les garanties pour juger en toute impartialité. Cela fait l'objet d'une appréciation par le chef de juridiction et le chef de cour.

Vous avez parfaitement raison, des situations concrètes peuvent placer le magistrat, qu'il l'ait prévu ou non, dans une situation délicate. Existe-t-il un registre des déports, une règle particulière qui normalise cette question qui relève de la conscience individuelle de chaque magistrat ? C'est le cas au Parlement.
Pour ma part, je n'ai jamais recensé ces situations. Elles ne sont pas fréquentes et ne portent pas atteinte au bon fonctionnement de la juridiction, puisque dans les grandes juridictions, des juges de permanence sont prêts, en cas de difficultés pour la composition d'un tribunal en raison d'une absence, d'un retard ou d'un problème d'ordre déontologique, à venir compléter la juridiction.
Ce n'est pas une source d'incidents majeurs, car comme je le dis mes collègues, il vaut mieux anticiper les difficultés et révéler toute forme d'incompatibilité pour siéger dans une affaire, même si les liens avec l'une des parties ou l'objet du litige sont très éloignés, afin d'éviter toute difficulté.
Je n'ai jamais effectué ce type de recensement, et je n'en ai jamais eu connaissance dans mes fonctions d'inspecteur général.

Vous avez plaidé pour un rôle accru du Conseil supérieur de la magistrature en matière de promotions, peut-être à l'image de ce qui se passe pour les sections du Conseil national des universités. Il y a 9 000 magistrats en France, ce serait un travail considérable. Pensez-vous que ce soit possible ?
Cette proposition a-t-elle pour objet de contrer un certain localisme ? C'est la critique qui est parfois adressée au CNU concernant les promotions des professeurs et des maîtres de conférences dans les universités.
L'organisation du corps des magistrats est divisée en trois grades. La carrière commence au second grade, puis l'on passe au 1er grade, et l'on peut accéder ensuite à la « hors hiérarchie », pour les postes les plus élevés. Il y a une liste d'aptitude – une inscription au tableau – lorsqu'après les premières années de fonction, on considère que le magistrat a fait preuve de suffisamment de compétence pour accéder au premier grade. Cette inscription au premier grade relève aujourd'hui de la commission d'avancement. Par mes propos, je suggérais que ce pouvoir pourrait relever du Conseil supérieur de la magistrature, étant entendu que cette inscription au tableau se fait sur les propositions des chefs de juridiction et des chefs de cour qui, au regard des compétences acquises, considèrent qu'un magistrat peut accéder au premier grade. Je n'ai pas les statistiques en tête, mais, actuellement les personnes sont inscrites et réalisent ce passage de grade dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle ou géographique au bout de cinq ou sept ans.
Une avancée pourrait consister, pour l'accès à la « hors hiérarchie », à poser des critères de compétences au regard du parcours professionnel, de la mobilité géographique, éventuellement du détachement ou de l'acquisition d'autres expériences professionnelles. Les fonctions hors hiérarchie correspondent de plus en plus à des fonctions d'encadrement – supérieur ou intermédiaire. Or je suis convaincu qu'il faut d'autres acquis professionnels que le simple exercice de l'activité juridictionnelle pour assurer, notamment dans les plus grandes juridictions ou cours d'appel, des fonctions d'encadrement intermédiaire.
Le nombre de 8 500 ou 9 000 magistrats est à relativiser au regard de ces deux étapes, qui pourraient constituer une approche d'une nouvelle gestion du corps des magistrats.

S'agissant des passages par l'administration centrale, il me semble que les fonctions en direction centrale exercées par des magistrats doivent être distinguées de celles en cabinet, qui sont bien plus proches du pouvoir politique, particulièrement les cabinets du Président de la République, du Premier ministre ou du garde des Sceaux.
Ce n'est pas la capacité des magistrats concernés à exercer leurs fonctions de manière neutre et détachée de leurs engagements précédents qui est en question, mais le regard que porte la société sur ce phénomène. Un parallèle pourrait être fait avec le pantouflage, qui créé une présomption de confusion d'intérêts. Nos concitoyens souhaitent avoir la certitude que le magistrat exercera des fonctions dans lesquelles les liens qu'il a précédemment noués n'auront pas de conséquences.
Pensez-vous que l'on puisse imposer que les magistrats sortant de cabinet soient affectés à des fonctions au siège, et non au parquet ? C'est souvent sur les magistrats du parquet que pèse le soupçon de politisation. Cette distinction vous paraît-elle pertinente ?
Les fonctions en cabinet sont toujours examinées avec beaucoup d'intérêt par les observateurs, et avec beaucoup de rigueur et d'attention par la direction des services judiciaires et le Conseil supérieur de la magistrature. Les sorties de cabinet trop lisibles sur certaines fonctions ne recevraient pas nécessairement l'accord du Conseil supérieur de la magistrature, et il n'est pas évident que les magistrats sortant de cabinet obtiennent toujours le poste qu'ils désiraient.
Si je vous ai bien compris, vous estimez qu'il serait préférable d'accéder, dans cette hypothèse, à des fonctions de magistrat du siège plutôt que du parquet, pour éviter de travailler dans le prolongement de l'activité de l'exécutif au sens le plus large. D'expérience, c'est l'inverse qui se produit : les magistrats qui sortent de cabinet partent très fréquemment vers des fonctions au parquet, en respectant l'éthique et la déontologie du ministère public dans l'exercice de leurs fonctions.
Si de telles contraintes devaient être imposées, elles devraient être prévues par la loi organique, ou faire partie des règles non écrites du Conseil supérieur de la magistrature. Celles-ci sont toujours définies a posteriori. Il vaudrait mieux les connaître avant.

Quelle est votre appréciation de la réforme constitutionnelle de 2008, qui a ouvert la possibilité au justiciable de saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature ? Le bilan quantitatif des premières années d'application de cette mesure est assez décevant : en 2013, on a compté à peu près 300 saisines, dont presque 250 étaient irrecevables et 47 infondées ; seules 5 ou 6 ont été examinées. Cette évolution, qui a suivi les conclusions de la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau, n'a pas porté les fruits espérés à l'époque.
Ces chiffres montrent aussi que notre institution judiciaire ne fonctionne pas si mal ! Les justiciables ne sont pas nombreux à se plaindre.
Parmi eux, on trouve les plaignants d'habitude, qui écrivent presque quotidiennement à toutes les institutions de la République y compris au CSM. Beaucoup de justiciables mécontents d'une décision qui a été rendue saisissent aussi le CSM pour s'en plaindre, avant ou après avoir utilisé les voies de recours à leur disposition. Ils contestent la décision rendue en invoquant de manière plus ou moins bien articulée les insuffisances professionnelles ou déontologiques du magistrat qui a rendu ladite décision.
La première présidente de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation pourront vous donner plus de précisions sur le contenu et l'analyse qui est faite de ces décisions. Le rapport annuel d'activité du CSM revient chaque année sur ces éléments. Les parties aux litiges et les avocats ont maintenant bien intégré la possibilité de saisir le CSM en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire. Le nombre limité de saisines traduit donc selon moi le fait que les justiciables ne sont pas si mécontents du fonctionnement de l'institution.

En tant que parlementaire, je suis frappé par le peu d'occasions d'échanges entre le service public de la justice et la société. Les parlementaires ont le privilège d'être invités à une audience solennelle de rentrée. Ils écoutent un discours sans pouvoir prendre la parole. Et tous les cinq ou dix ans, une commission d'enquête se penche sur le fonctionnement de la justice.
Cette absence d'échanges me semble source de maux dont la justice est sans doute la première victime. Ainsi, elle se plaint à juste titre de son manque de moyens, mais elle a rarement l'occasion de porter ce débat dans la sphère politique.
Au-delà de vos fonctions de président du tribunal judiciaire de Paris, vous qui connaissez intimement le fonctionnement de la justice, quelles solutions vous semblent envisageables ? Pourrait-on imaginer une instance dans chaque département, rassemblant des représentants des citoyens, et devant laquelle les deux chefs de juridiction viendraient rendre compte de l'action de la justice dans le département et participer à des débats, notamment pour expliquer les classements sans suite et les raisons pour lesquelles l'application du code pénal varie de manière aussi sensible d'un département à l'autre ? Je sais que je vous demande de sortir de votre rôle actuel, mais partagez-vous ce constat ?
Je partage votre analyse. Il ne faut pas confondre indépendance et isolement, et la grande difficulté, pour l'institution judiciaire, est de rompre son isolement. Si elle y parvenait, la confiance entre la justice, les autres institutions de la République et nos concitoyens en serait renforcée.
Je conviens que les audiences de rentrée sont un exercice de style qui ne répond plus aux enjeux d'une communication institutionnelle. Pour ma part, j'ai toujours veillé à entretenir des relations régulières avec les parlementaires ou les principaux maires de mon ressort au moyen de rencontres bilatérales. Les stages sont un moyen offert aux parlementaires de découvrir de l'intérieur le fonctionnement de l'institution judiciaire en fonction de leur domaine d'intérêt : droit de la famille, droit pénal, droit économique ou autre.
On peut également s'engager, au-delà de la question de la politique pénale, dans des politiques de juridiction. Celles-ci peuvent être partagées avec les élus. Dans le Val-de-Marne, nous nous étions fortement engagés dans deux domaines : l'accès au droit et les violences conjugales, qui ont fait l'objet de réunions avec le secteur associatif mais aussi avec les parlementaires – nous avons toujours veillé, avec Mme la procureure, à les y convier. Ils étaient présents, toutes tendances politiques confondues, aux réunions où nous présentions ce que nous faisions.
On a tendance à créer des structures nouvelles qui aboutissent à un millefeuille administratif. Il existe déjà ce type d'instances – au minimum deux et même trois si on prend en compte la politique pénale.
La première instance est le conseil départemental de l'accès au droit (CDAD), qui est présidé par le président de la juridiction et coprésidé par le procureur. Le préfet et les élus en sont membres. C'est un élément très important. On oublie trop souvent tous les enjeux relatifs à l'accès au droit. Or c'est aussi un aspect important pour le ministère de la justice, qui correspond, dans le cadre de la loi de finances, au programme 101. Beaucoup de moyens sont consacrés à cette question, notamment pour que les plus démunis bénéficient de lieux de proximité où ils peuvent obtenir des conseils juridiques au sens le plus large du terme.
Le CDAD, qui existe dans chaque département, est souvent le moyen, pour la juridiction, en lien avec le secteur associatif – notamment –, de travailler sur toutes les politiques qui peuvent être menées, en particulier celles qui concernent le droit de la famille, le droit des personnes et souvent, dans les zones urbaines, le droit des étrangers, et le droit du logement. Ce sont des sujets qui concernent nos concitoyens, dans leur vie quotidienne. Au-delà des procès et des instances civiles, il y a une volonté d'aider le justiciable dans les litiges. Par ailleurs, c'est souvent le CDAD qui permet de développer les actions menées en matière d'aide aux victimes et en faveur du développement de la conciliation et de la médiation.
Il existe aussi, depuis la loi « J21 », des conseils de juridiction. Ce sont des instances qui permettent de réunir les chefs de juridiction et les élus – plutôt les maires – pour voir comment une juridiction, dans son ressort, peut conduire avec les élus des politiques partenariales. On y retrouve généralement certains sujets : l'accessibilité du palais de justice, l'accès au droit ou les actions qui peuvent être menées pour préparer un procès retentissant. Il y a souvent des échanges nourris, dans le respect des compétences de chacun, non pas à propos des affaires individuelles – ce n'est pas un prétoire – mais des problématiques judiciaires qui ont une résonance politique au sens le plus noble du terme.
En matière pénale, les procureurs de la République s'investissent beaucoup dans la prévention de la délinquance – c'est une des caractéristiques de leurs fonctions. Le conseil départemental de prévention de la délinquance et les déclinaisons qui peut exister dans certaines communes est souvent l'occasion pour les procureurs de rencontrer non seulement les élus mais aussi, parfois, les administrés, pour évoquer les enjeux de la délinquance dans un territoire.
Des instances existent déjà. Il faut les faire vivre. Les chefs de cour et de juridiction ont la responsabilité d'être dans une posture d'ouverture. Je souscris pleinement à cette démarche, et j'ai essayé de le montrer autant que possible.

J'ai participé aux trois derniers conseils de juridiction qui ont eu lieu dans ce qui est désormais le tribunal judiciaire de Lille. Cet exercice, qui se déroule une fois par an, s'apparente plutôt à une grand-messe de deux heures et demie ou trois heures, au cours de laquelle sont livrées les statistiques du tribunal, comme à l'audience solennelle, suivie d'une discussion générale. Nous avons un projet de palais de justice, qui servira de norme dans le pays : il en est un peu question, mais en réalité on survole à peu près tous les sujets sans aller au fond de ceux-ci. Je pense que les logiques partenariales se développent grâce à des contacts bilatéraux, avec tel maire ou telle intercommunalité, plutôt que dans le cadre du conseil de juridiction. Il faut faire attention, à mon avis, à ne pas créer des structures qui visent à dire qu'on communique, alors qu'on survole, en fait, à peu près tous les sujets.
Je partage l'avis exprimé par Olivier Marleix : il faudrait associer un peu plus les citoyens. On pourrait imaginer que les conseils de juridiction soient filmés et rendus publics, pour ceux qui veulent les regarder et qui s'intéressent à la justice dans leur secteur.
Je partage tout à fait votre constat. Il est vrai que le justiciable est bien loin dans ce type de rencontres. Mon expérience m'a montré, néanmoins, que ceux qui prennent la parole dans le cadre d'instances plus largement ouvertes à nos concitoyens ont souvent des litiges en cours et ils évoquent leur affaire individuelle. Quand on rappelle qu'on ne peut pas aborder les situations individuelles, parce que la justice est rendue ailleurs que dans ces réunions, cela crispe beaucoup les débats et les rend quasiment impossibles. On est obligé de prendre de la distance, de faire comprendre qu'on est là pour échanger sur des problématiques judiciaires et non sur des situations individuelles. Même dans les conseils départementaux de prévention de la délinquance, il est souvent très délicat de ne pas faire des « focus » sur des situations individuelles. La frontière est parfois ténue.

Un secret partagé est possible dans certains cadres, notamment les conseils locaux de la sécurité et de la prévention de la délinquance.
Je propose de passer aux questions relatives aux moyens budgétaires, qui sont importantes, notamment dans vos fonctions actuelles. Il n'est pas évident pour tout le monde de se dire que les moyens budgétaires alloués aux tribunaux peuvent être une question qui touche à leur indépendance. Vous sentez-vous conditionné par les moyens budgétaires au tribunal judiciaire de Paris ? Concrètement, n'y a-t-il pas une question d'indépendance, d'impartialité ou de capacité à rendre des jugements sans être sous la pression rebutante de piles de dossiers qui s'entassent dans un certain nombre de contentieux, quand on vous demande d'aller vite, que ce soit du côté du siège, pour le jugement, ou du parquet ? Je rappelle que vous êtes notamment en charge de l'allocation des moyens au tribunal. Le traitement en temps réel, par exemple, permet-il d'assurer une bonne justice ?
Les moyens attribués à la justice, qui font l'objet de questions récurrentes, ne conditionnent pas nécessairement, selon moi, le respect de l'indépendance de l'institution judiciaire mais plutôt son bon fonctionnement. C'est une évidence : tout ce qui concerne les ressources, au sens le plus large du terme, a trait à la garantie – ou non – du bon fonctionnement de l'institution judiciaire.
Les crédits de la justice sont en progression depuis plusieurs années – à peu près une dizaine d'années. C'est un acquis important. Vous êtes bien placés, mesdames et messieurs les députés, pour savoir que la contrainte budgétaire est une réalité qui pèse sur les décisions qui sont prises. Depuis plusieurs années, néanmoins, le ministère de la justice est plutôt privilégié – je ne dirais pas qu'il est sanctuarisé, mais les retombées sont là.
Une évolution s'est dessinée cependant : le budget de l'administration pénitentiaire est désormais le budget principal du ministère de la justice. C'était une nécessité, compte tenu de l'état du parc pénitentiaire. Il était tellement dégradé qu'il était nécessaire de prévoir des moyens pour améliorer la prise en charge des détenus. C'est un sujet compliqué et essentiel. Vous savez que, du fait de ses insuffisances, la France a souvent été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne les conditions de détention.
S'agissant des services judiciaires, on est au rendez-vous en matière de ressources pour ce qui est des magistrats et des fonctionnaires, mais aussi en ce qui concerne les budgets globaux de fonctionnement. Il est peut-être plus difficile pour le ministère d'assurer la prévisibilité des besoins en matière de ressources humaines à moyen terme. Je suis toujours frappé par les trous qui peuvent exister dans l'activité des juridictions parce que la gestion des évolutions des effectifs de magistrats ou de greffiers se fait un peu en accordéon, compte tenu du temps nécessaire pour la formation des arrivants.
Je crois qu'il est essentiel d'appeler votre attention sur un point : les fonctions support sont le nerf de la guerre du bon fonctionnement de la justice – il y a bien sûr la question des magistrats et des fonctionnaires, mais nous améliorerons la qualité de la réponse judiciaire lorsque les fonctions support, notamment les équipements informatiques et numériques, auront un niveau de développement et d'efficacité à la hauteur des enjeux de l'administration du XXIe siècle. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Au lieu d'avoir des applications ou des outils informatiques performants, à la hauteur des enjeux, on est plutôt dans la « maison du bricolage ». Trop souvent, les juges et les greffiers peinent au quotidien à faire fonctionner des applications informatiques qui ne sont pas adaptées ou des outils numériques qui ne sont pas à la hauteur des enjeux que nous devons traiter. C'est impressionnant : je crois que les parlementaires et les élus qui viennent en stage dans des juridictions sont frappés par cette réalité.
Je tiens néanmoins à souligner, parce que je veux être objectif, que la dernière loi de programmation qui a été adoptée en faveur de la justice a considérablement augmenté les moyens. Je crois que 500 millions d'euros sont prévus en ce qui concerne l'informatique et le numérique, ce qui est loin d'être négligeable. J'espère que le niveau de consommation et le développement des outils seront au rendez-vous – c'est un enjeu important.
S'agissant du budget de fonctionnement des juridictions, je n'ai pas constaté de contrainte budgétaire dans mes deux derniers postes – j'ai été nommé récemment à Paris, mais j'ai veillé à faire le point sur ce sujet en vue de mon audition : nous avons les moyens budgétaires de fonctionner. Nous ne sommes pas en difficulté pour assurer le paiement des factures, l'entretien des juridictions ou l'exécution du budget courant. Cela vaut pour Créteil, mais aussi pour l'exercice budgétaire 2019 au tribunal de Paris.
Il y a eu une évolution sur un point en matière de gestion, c'est le recours à des marchés régionaux qui échappent à la compétence des chefs de juridiction. Lorsqu'il s'agit d'organiser le gardiennage ou la surveillance, le lavage des vitres et l'entretien des bâtiments, ce type de marchés peut tout à fait se concevoir : ce n'est pas, en soi, une difficulté.
En ce qui concerne le budget de fonctionnement classique, les moyens sont au rendez-vous. Le point sur lequel je trouve que nous sommes peut-être un peu en décalage avec les objectifs de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) – je m'exprime sous réserve de l'appréciation que le ministère pourrait formuler – est qu'on ne demande pas – de présenter des politiques de juridiction pour lesquelles des moyens seraient fournis. En ce qui concerne, par exemple, les violences conjugales ou l'accès au droit – j'ai indiqué que les crédits étaient au rendez-vous –, on pourrait se placer dans le cadre d'objectifs ou de politiques de juridiction auxquels des moyens seraient consacrés.
Je sais, par ailleurs, qu'il n'y a pas de marge de manœuvre dans certaines cours d'appel ou dans certaines juridictions pour les dépenses non obligatoires, c'est-à-dire les moyens à la disposition des chefs de cour et de juridiction pour changer le matériel, refaire des peintures ou modifier l'organisation de certains services afin de les rendre plus fonctionnels, de les adapter au public ou aux personnes qui travaillent dans ces services.
On se situe dans une logique de reconduction des crédits permettant d'assurer le fonctionnement des juridictions : on s'inscrit un peu moins dans des ambitions à plus long terme, dans le cadre de politiques de juridiction et en ce qui concerne les dépenses non obligatoires.

Vous conviendrez que si le budget est en augmentation, il est essentiellement consacré à l'administration pénitentiaire. Pour l'exercice 2020, l'augmentation prévue pour le programme 166, qui concerne la justice judiciaire s'élève à 0,6 %, ce qui est bien en deçà de l'inflation. Il est probable que vos dépenses augmentent un peu, mais les crédits ne suivent pas nécessairement. Je pense que vous aurez à faire quelques économies pour la fin de l'année – vous avez des dépenses obligatoires et vous êtes tenu par les marchés passés. Par ailleurs, vous êtes tributaires d'un partenariat public-privé qui contraint largement votre exercice budgétaire : vous avez peu de marges de manœuvre.
Vous dites que vous avez les moyens de fonctionner. Pensez-vous que c'est aussi l'avis des personnels de greffe du tribunal ? On entend souvent leurs représentants syndicaux dire que l'on manque de greffiers pour assurer le bon fonctionnement de la justice, pour permettre aux magistrats d'exercer correctement, du côté du parquet et du siège. Partagez-vous cette analyse ?
Je ne connais pas la situation de Paris, mais à Lille le manque de moyens, s'agissant des juges aux affaires familiales, par exemple, conduit à une augmentation des délais de jugement et à des situations ubuesques. Des demandes de garde alternée des enfants se heurtent au fait que le magistrat observe que cela fait sept mois que les enfants sont chez leur mère – il a fallu sept mois pour avoir un rendez-vous – et il n'accorde pas la mesure souhaitée, au nom de l'intérêt supérieur des enfants. Les moyens ont un impact sur la manière dont les magistrats prennent leurs décisions. Êtes-vous en dehors de ces cas de figure et tout se passe-t-il bien, dans le meilleur des mondes, au tribunal judiciaire de Paris ?
Non, le premier élément de ma réponse concernait les budgets de fonctionnement – le paiement de l'électricité, par exemple…
Pour ce qui est de la ressource en matière d'équivalents temps plein de magistrats et de greffiers, il est bien évident que des tensions subsistent, d'une manière qui peut être aiguë dans certaines juridictions – j'en ai parfaitement conscience. Nous avons souvent été en difficulté dans le Val-de-Marne et il y aussi un décalage au tribunal de Paris entre les besoins théoriques de la juridiction, tels qu'ils sont affichés par le ministère, et la gestion réelle des effectifs – ceux que nous avons. Une tension demeure, même si elle a peut-être tendance à diminuer par rapport à ce que nous avons connu il y a quelques années.
Je voudrais ajouter qu'une des difficultés qui existent pour l'institution judiciaire est d'apprécier, avec le plus de rigueur de possible, l'impact des réformes votées. Il y a souvent des évolutions de périmètres d'activité à moyens presque constants. Lorsqu'on réalise des projections de besoins particuliers, les moyens ne sont pas adaptés. Je pourrais citer trois exemples.
Je pense notamment à la mise en œuvre, récente, des pôles sociaux dans les juridictions : non seulement on a procédé à moyens constants, ou presque, mais s'y ajoutait un enjeu très difficile qui était l'intégration, ou non, de personnels des caisses primaires d'assurance maladie. Cela nécessitait de mettre en place une ingénierie extrêmement complexe. La situation est encore extrêmement difficile dans les juridictions – cela représente des milliers de procédures qui concernent la vie quotidienne des gens.

Les pôles sociaux sont un exemple très intéressant. La réforme a été problématique dans tout le pays. Pourtant, la décision a été prise en 2016 et elle était applicable au 1er janvier 2019. On a eu donc deux ans et demi pour appliquer la réforme. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Deux ans et demi, c'est bien plus que le temps laissé à la plupart des autres administrations pour conduire des réformes. Elles ont plutôt trois ou quatre mois.
Tout a été difficile dans cette réforme, y compris l'appréhension des nouveaux périmètres de contentieux. Comment allait-on juger, selon quelles règles de procédure ? Qu'en était-il des applications informatiques et des trames de jugement ? Il y a des questions de base telles que la compatibilité des applications informatiques et la gestion des personnels de la caisse primaire d'assurance maladie. Il n'y avait souvent pas de réponses précises, ce qui a créé beaucoup d'incertitude et de dégradation des conditions de travail. Les services judiciaires devaient reprendre tout le contentieux. Des effectifs y étaient certes dédiés, mais ils n'ont pas été à la hauteur des milliers de procédures en stock.
En 2018, on a malheureusement dû gérer par anticipation les problèmes sans avoir beaucoup de lignes directrices, puis on a mis les choses en place en 2019 en faisant un peu de bricolage dans les juridictions pour essayer d'apporter la meilleure réponse possible. Début 2020, la question des pôles sociaux n'est toujours pas réglée. Le tribunal judiciaire de Paris n'est pas en mesure de traiter le contentieux de l'incapacité, qui représente à ce jour 7 000 procédures.
Je pourrais vous donner d'autres exemples, qui concernent notamment le développement des compétences des juridictions interrégionales spécialisées et l'anticipation de la réforme de l'ordonnance de 1945 : ce sont des sujets qui ont de forts impacts en matière d'activité et qui nécessitent beaucoup d'anticipation dans la mise en œuvre.
Un autre exemple – c'est une de nos difficultés en ce début d'année – est relatif à la réforme de la procédure civile. La mise en œuvre de l'assignation avec prise de date, qui est une technique de procédure pour enregistrer une demande en justice a été reportée au 1er septembre 2020 car le ministère n'était pas en mesure de fournir l'application informatique nécessaire. Je me suis rapproché du ministère il n'y a pas très longtemps. J'ai souligné qu'il fallait, pour réussir cette réforme qui n'est pas contestée sur le fond, développer et tester l'application informatique prévue avant qu'elle ne soit opérationnelle. Il y a trop fréquemment des décalages dans ce domaine, ce qui nuit, bien sûr, au bon fonctionnement des services.

Je comprends tout à fait cette discussion sur la situation financière des juridictions, les budgets de fonctionnement et ceux d'investissement, mais je ne vois pas le lien avec la question de l'indépendance du corps judiciaire, de la justice ou du pouvoir judiciaire dans son ensemble. Vous avez dit qu'il ne fallait pas confondre indépendance et isolement, et vous avez raison. De même, je ne suis pas sûr que l'on doive confondre indépendance et moyens budgétaires en général.
Vous avez rappelé que la situation des tribunaux avait connu des évolutions positives à la suite de la loi du 23 mars 2019. La situation financière actuelle des juridictions a-t-elle une quelconque conséquence sur le mode de fonctionnement de la justice, s'agissant de son indépendance ? Avez-vous connaissance, en tant que président du tribunal judiciaire de Paris, d'un exemple dans lequel vous vous êtes trouvé, vous-même ou les magistrats sous votre autorité, en situation de dépendance du fait des conditions matérielles dans lesquelles vous exécutez vos tâches ?
Je dirais que les contraintes budgétaires peuvent peser sur l'activité d'une juridiction et conduire à ce qu'elle travaille en mode dégradé, ce qui peut avoir des conséquences sur les conditions dans lesquelles l'acte de juger est réalisé. Est-ce une atteinte directe et sensible à l'indépendance du juge ? Je n'irais pas jusque-là.

Je rejoins la question posée par notre rapporteur. Le manque de crédits budgétaires – je ne dis pas la pénurie financière – fait qu'on est bien obligé de faire des choix. Ces choix résultent d'une politique fixée par la garde des Sceaux – je ne remets pas cet aspect en question. En regard de votre indépendance, comment vivez-vous ces priorités ? Des questions extrêmement importantes peuvent se poser.
La garde des Sceaux ne donne pas d'instructions aux chefs de cour ou de juridiction, pour les questions d'administration ou d'organisation. La garde des Sceaux peut définir une politique pénale et la décliner par des circulaires, mais elle ne dit pas aux présidents des tribunaux la façon dont ils doivent organiser leur juridiction, et selon quelles priorités. Le président du tribunal fait des choix, en lien avec la communauté judiciaire.
On retrouve le même schéma partout : deux domaines sont toujours sanctuarisés, par rapport aux contraintes que l'on peut rencontrer en matière d'organisation : le droit de la famille et le traitement des affaires pénales, notamment celles où il y a des victimes.

Peut-être que nous ne nous entendons pas bien sur le terme d'indépendance, mais quand la garde des Sceaux dit que sa priorité est l'accueil convenable, dans chaque juridiction, des femmes victimes de violences – c'est d'ailleurs ce que demande le texte débattu en ce moment dans l'hémicycle –, vous n'êtes tenu à rien en la matière : vous êtes complètement indépendant en ce qui concerne votre organisation judiciaire ?
Complètement.
Nous avons appris, à l'issue du Grenelle sur les violences conjugales, que la juridiction de Créteil était retenue en tant que juridiction pilote, mais nous n'avons pas été associés à ce choix, je vous l'assure – j'ai prêté serment. Nous l'avons appris à la lecture du communiqué de presse.
La juridiction de Créteil s'était engagée dans cette problématique depuis de très nombreuses années, bien avant mon arrivée : j'ai développé et valorisé cette orientation qui était déjà consubstantielle à la culture judiciaire du Val-du-Marne. Nous en avons fait, collectivement, une des priorités de la politique de juridiction. Nous avons valorisé cela auprès des parlementaires et du secteur associatif. Le ministère est venu voir ce que nous faisions, comment nous nous y prenions. Mais à aucun moment, on ne m'a mis en demeure de dire qu'il fallait s'engager sur la question des violences conjugales. Il n'y a pas eu d'atteinte à l'indépendance administrative, si j'ose dire – c'est-à-dire en matière d'organisation.

Le mode de fonctionnement que vous décrivez entre le tribunal de Créteil et la chancellerie me paraît tout à fait sain. J'ai en tête l'exemple du tribunal judiciaire de Dijon, qui s'est engagé depuis longtemps dans la voie du travail d'intérêt général et des nouvelles manières d'aborder la peine et qui a, lui aussi, été désigné comme juridiction pilote sur ces questions. Une telle situation me paraît tout à fait saine : en effet, l'indépendance n'exclut pas le partenariat. Cela renvoie à l'observation de notre collègue Olivier Marleix sur la nécessité, pour la justice, de s'ouvrir à des partenaires extérieurs. Dès lors qu'un président de juridiction a la volonté politique, comme vous l'avez eue à Créteil, de privilégier certaines actions, il est tout à fait logique que la chancellerie lui renvoie la balle. Je ne vois pas en quoi cela pourrait nuire à l'indépendance de la justice. C'est, au contraire, une manière tout à fait saine de fonctionner.

Je suppose néanmoins que lorsqu'on est passé par l'administration centrale, il est plus simple de diriger un site pilote, puisqu'on se conformera plus naturellement aux objectifs définis par la chancellerie.
Monsieur le président, je ne sais pas quoi dire…

Je suis un peu provocateur, mais il y a bien deux façons de voir les choses. Certains tribunaux peuvent accepter et se réjouir d'être désignés comme site pilote sur une action qu'ils ont eux-mêmes mise en avant. Mais une telle désignation peut aussi être une contrainte pour d'autres tribunaux qui ont d'autres priorités, par exemple la lutte contre la délinquance ou les affaires civiles. Ils se retrouvent dans l'œil du cyclone et sont contraints d'avoir des résultats dans des domaines qui ne faisaient pas partie de leurs objectifs.
Je crois que les choses ne se passent pas de cette manière.

Pour prolonger ce débat, j'aimerais revenir sur la question des effectifs. Si, demain, le législateur, veut accroître les moyens budgétaires de la justice, notamment le nombre d'ETP, comment s'assurer que ces moyens supplémentaires bénéficieront aux politiques que les juridictions définissent elles-mêmes, et qui sont parfois limitées dans le temps ?
Aujourd'hui, la souplesse du système repose sur les magistrats placés, que la cour d'appel peut allouer à certains tribunaux judiciaires en manque d'effectifs. Ces moyens sont-ils suffisants ? Peut-on envisager, demain, dans le respect du statut des magistrats, d'assouplir encore le système afin qu'une juridiction dispose, pour une politique particulière et limitée dans le temps, de moyens humains supplémentaires ?
Si j'ai bien compris votre question, monsieur le député, vous me demandez de quelle marge de manœuvre la cour et les tribunaux disposent pour apporter la meilleure réponse, à un moment donné, à l'accroissement du nombre de contentieux.

Par exemple avec le mouvement des « gilets jaunes » qui a conduit à un accroissement de l'activité judiciaire.
Il y a eu un accroissement de l'activité judiciaire dans certains ressorts de tribunaux. C'est très net pour le tribunal de Paris mais, à quelques kilomètres de là, dans le Val-de-Marne, la crise des « gilets jaunes » n'a pas eu d'impact sur l'activité pénale. Le seul fait notable, y fut, pendant quinze jours, des manifestations de lycéens extrêmement fortes, qui se sont traduites par un accroissement de l'activité du tribunal pour enfants.
Pour revenir à la question de M. le député Olivier Marleix, en l'état, les chefs de cour ont à leur disposition la ressource des magistrats et des greffiers placés qui ont, statutairement, vocation à jouer le rôle de « Samu judiciaire ». La direction des services judiciaires a tendance à renforcer les effectifs des magistrats placés pour donner plus de souplesse aux chefs de cour. Il existe une autre possibilité, la délégation des magistrats et des fonctionnaires, sur la base du volontariat. Un magistrat peut être délégué dans une autre juridiction que celle où il exerce habituellement ses fonctions, pour un temps donné et sur des contentieux précis. Mais c'est très peu pratiqué.

Le cadre juridique actuel vous semble-t-il suffisant ou pensez-vous qu'il faille le modifier ?
Dans les plus grandes juridictions, celles du groupe 1, si tous les postes étaient effectivement pourvus et si l'on pouvait compter sur les magistrats placés, les choses se passeraient correctement, mais on en est loin.

J'aimerais revenir rapidement sur le CSM. Considérez-vous que la réforme du CSM, telle qu'elle a été envisagée en 2016 et telle qu'elle est actuellement proposée par le Président de la République, garantira effectivement l'indépendance des nominations ? Les magistrats du parquet et ceux du siège devraient désormais être nommés selon les mêmes modalités , ce qui est une bonne chose, mais le fait que les propositions continuent d'être faites par le garde des Sceaux ne limite-t-il pas la liberté de nomination du CSM ?
La disposition qui est en débat devant le parlement porte sur l'avis conforme du CSM pour la nomination des magistrats du parquet. Pour les chefs de cour ou des chefs de juridiction, le Président de la République nomme par décret des magistrats choisis par la formation du CSM compétente à l'égard des magistrats du siège. Pour les magistrats du parquet, en revanche, c'est la direction des services judiciaires qui propose des noms, et la formation du CSM compétente à l'égard des magistrats du parquet ne fait que donner un avis, qui n'est pas contraignant.

Le CSM, qui est une autorité indépendante, ne pourrait-il pas faire lui-même des propositions de nomination, au lieu de les attendre du garde des sceaux. Puisque vous proposez, et je trouve que c'est très intéressant, que le CSM gère aussi la promotion et la carrière des magistrats, ne vous semblerait-il pas normal qu'il décide lui-même des nominations, sans attendre des propositions venues de l'extérieur ?
Même pour les magistrats du siège du second et du premier grade, les nominations se font aujourd'hui sur la base de propositions préparées par la direction des services judiciaires, qui sont ensuite appréciées par le CSM. Vous suggérez que le CSM fasse lui-même des propositions de nomination, aussi bien pour le siège que pour le parquet. Cela reviendrait à transférer les compétences de la sous-direction des ressources humaines de la magistrature et de la direction des services judiciaires de l'administration centrale au CSM. Cela supposerait de transformer l'organisation du CSM pour que ses membres aient le temps pour ce travail de gestion des ressources humaines. La direction des services judiciaires, qui s'en occupe actuellement, a des effectifs adaptés. Ceux du CSM, en revanche, sont extrêmement limités.

Nous y reviendrons lorsque nous recevrons les membres du CSM.
Je propose que nous en venions aux questions relatives à la conduite des enquêtes. Quand on parle de l'autorité, voire du pouvoir judiciaire, comme nous l'avons fait de façon un peu provocatrice dans la dénomination de cette commission d'enquête, on pense notamment à la police judiciaire, qui conduit les enquêtes. Diriez-vous que vos relations avec le ministère de l'intérieur sont satisfaisantes, notamment durant la phase de l'instruction ? Les moyens alloués à la conduite des enquêtes sont-ils suffisants ? Si tel n'est pas le cas, en quoi cela peut-il avoir un effet sur votre indépendance ?
Je ne suis pas en mesure de me prononcer sur les moyens que le ministère de l'intérieur alloue à la police judiciaire pour répondre aux mandats judiciaires qui lui sont donnés, soit sous l'égide du ministère public, soit sous l'égide des juges d'instruction. Ce que je peux dire, c'est qu'il arrive que certaines enquêtes, et plus encore certaines commissions rogatoires, soient retardées parce que les services en charge de l'enquête sont surchargés. Cela peut poser des problèmes et, en l'état, l'autorité judiciaire n'a pas la compétence de procéder à des arbitrages pour donner la priorité à certaines enquêtes ou à certaines investigations : c'est effectivement un sujet important.
Dans le même ordre d'idées, il peut sembler étrange que la direction générale de la gendarmerie nationale, pour sa mission de police judiciaire, et la direction centrale de la police judiciaire, au sein du ministère de l'intérieur, ne soient pas dirigées par des magistrats. Il fut un temps, désormais lointain, où la gendarmerie nationale était dirigée par un magistrat. L'important, c'est que les officiers de police judiciaire, qui exercent sous mandat judiciaire (OPJ), reçoivent une habilitation de la part de l'autorité judiciaire : c'est elle qui contrôle le niveau de compétence et d'engagement des officiers de police judiciaire, et elle peut les sanctionner. Un officier de police judiciaire qui n'est pas compétent ou qui ne fait pas preuve de rigueur dans le traitement de la procédure pénale peut se voir retirer son habilitation.
Pour revenir à la tutelle du ministère de l'intérieur sur l'institution judiciaire dans la conduite des enquêtes et sur le contrôle des actes de procédure pénale pris par les OPJ, je rappellerai que les magistrats instructeurs et les parquetiers regardent cela de très près. C'est d'ailleurs le quotidien aussi bien dans les permanences de parquet que dans la conduite des enquêtes par les juges d'instruction. Il y a des liens très forts entre les magistrats instructeurs et les enquêteurs : ils font équipe dans la conduite des enquêtes. La direction et le contrôle de l'enquête, c'est l'affaire du juge d'instruction, et le travail opérationnel, c'est l'affaire des OPJ. J'ai été juge d'instruction pendant quatre ans : ce travail de directeur d'enquête avec des OPJ était extrêmement précieux et, au quotidien, je ne ressentais pas du tout la hiérarchie administrative du ministère de l'intérieur dans la conduite des enquêtes. Par ailleurs, dans l'exercice de mes fonctions de chef de juridiction, je n'ai jamais entendu un juge d'instruction se plaindre d'interférences susceptibles de porter atteinte au bon déroulement des enquêtes.

Au cours de votre carrière, vous n'avez jamais été dans un rapport de force avec le ministère de l'intérieur ? Vous n'avez jamais manqué de moyens, ni dans votre expérience au parquet, ni en tant que juge d'instruction ?
Je vais plus loin. La circulaire du 31 janvier 2014 a mis en lumière les remontées d'information au sein du ministère de la justice, et les a encadrées. Mais qu'en est-il des remontées d'information au sein du ministère de l'intérieur ? Elles ne font l'objet d'aucune circulaire, alors qu'elles sont peut-être plus efficaces que celles qui ont lieu au sein du ministère de la justice et qu'elles peuvent nuire, aussi bien au secret de l'instruction qu'à l'indépendance de la justice.
Les rapports de force avec le ministère de l'intérieur et la gendarmerie dans la conduite des enquêtes ou sur la priorité à donner à telle enquête plutôt qu'à une autre font partie du quotidien. Il peut arriver qu'un juge d'instruction rencontre des difficultés dans la gestion de son propre cabinet et que des affaires ne progressent pas, parce que les commissions rogatoires ne « rentrent pas », comme on dit dans le jargon. Les services de gendarmerie ou de police lui répondent en général qu'ils sont saturés ou en manque d'effectifs. Cela étant, si un juge d'instruction est en charge d'une affaire particulièrement sensible et s'il demande aux services de gendarmerie ou de police de traiter prioritairement une commission rogatoire, il sera généralement entendu. Mais il est vrai qu'à grande échelle, c'est effectivement un enjeu, où se joue un rapport de forces.

Au cours de votre carrière, avez-vous eu connaissance de remontées d'information au sein du ministère de l'intérieur, qui auraient porté préjudice à l'enquête ?
De mémoire, je dirais que cela m'est arrivé une fois, dans mes fonctions de procureur général, lors d'une enquête conduite dans le département de la Nièvre. Des informations étaient remontées au sein du ministère de l'intérieur, avant que le ministère public en ait pris connaissance. J'ai convoqué le responsable de la compagnie et l'OPJ en charge de cette enquête pour lui rappeler qu'il était soumis à un certain nombre d'obligations et que son habilitation et son évaluation relevaient du procureur général.

J'aimerais revenir sur ce qui est au cœur de notre commission d'enquête : l'indépendance de la justice. Nous ne sommes pas dans un monde virtuel ou fictif. Notre organisation actuelle repose sur une police judiciaire, c'est-à-dire une police, qui dépend, dans son action judiciaire, de l'autorité judiciaire. C'est d'ailleurs pourquoi l'officier de police judiciaire est sous l'autorité directe du procureur de la République et sous le contrôle du procureur général : les règles sont particulièrement claires en la matière.
Qu'il existe un système parallèle de remontée d'information ne me paraît pas, en soi, remettre en cause l'indépendance de la justice. Ce qui serait problématique, c'est par exemple qu'une personne tenue au secret professionnel divulgue des informations dans la presse, en violation de l'article 11 du code de procédure pénale. Il me paraît tout à fait normal, en revanche, que le ministère de l'intérieur jette un œil sur l'action de la police judiciaire. Ce qui serait problématique, aussi, c'est que le ministère de l'intérieur ou la chancellerie déroge aux règles habituelles et se mette dans une situation, disons, de prévalence politique. Monsieur le président, percevez-vous les choses de cette manière ? Est-ce que cette situation, en elle-même, menace l'indépendance de l'autorité judiciaire ?

Voilà une parfaite transition avec le sujet des fuites dans les médias et du secret de l'instruction. Je rappelle que notre rapporteur est l'auteur d'un rapport d'information sur le secret de l'enquête et de l'instruction.
La question est complexe. Dans la mesure où les officiers de police judiciaire agissent dans le cadre d'un mandat judiciaire, on pourrait considérer que la loyauté leur impose de ne faire remonter l'information que par le canal judiciaire. Mais il se trouve que le traitement de l'information n'est pas le fait du seul OPJ : elle revient à une administration qui n'est pas celle du ministère de la justice. Il est bien évident que la remontée de l'information peut se faire plus rapidement le long de cette ligne de fonctionnaires appartenant au ministère de l'intérieur que par le canal judiciaire, qui est moins rectiligne.

J'aimerais revenir avec vous sur la loi du 25 juillet 2013 et sur la circulaire d'application du 31 janvier 2014, qui ont introduit dans notre droit un principe nouveau, celui de l'interdiction des instructions individuelles. Cette disposition a renforcé l'indépendance des autorités judiciaires, notamment du parquet, par rapport au pouvoir politique. À de nombreuses reprises, la ministre de la justice a rappelé devant le Parlement qu'elle s'interdisait de formuler des instructions individuelles et qu'elle respectait strictement cette règle, comme c'est son rôle.
Mais il ne faut pas confondre les instructions individuelles et la remontée d'information qui, elle aussi, est très encadrée par la circulaire de 2014. L'affaire impliquant l'ancien garde des Sceaux, M. Jean-Jacques Urvoas, a mis en lumière l'importance de la remontée d'information pour le ministère de la justice. Il est apparu qu'elle était nécessaire au pouvoir politique, qui l'utilise par exemple pour formuler des directives générales – et non plus individuelles – en matière de politique pénale, sachant qu'elle est très encadrée, puisque la remontée de pièces est exclue et que le garde des Sceaux ne peut recevoir aucune information sur les suites qui peuvent être données à une procédure en cours.
La situation actuelle vous paraît-elle satisfaisante au plan juridique ? En matière d'indépendance – pour revenir, une fois encore, à ce qui fait le cœur de notre commission d'enquête – voyez-vous des évolutions possibles ?
Comme vous le savez, je ne suis plus au ministère public depuis plus de huit ans. Ce que je peux dire avec assurance, c'est que les dispositions de la loi de 2013 et de la circulaire de 2014 étaient attendues et qu'elles constituent un progrès incontestable. La communauté des procureurs, d'après ce que j'ai pu observer, se satisfait de cette avancée et n'en réclame pas d'autre.
Par ailleurs, le nombre d'affaires signalées a considérablement baissé au cours des dernières années. Lorsque j'étais procureur général, on qualifiait volontiers d'affaires signalées des faits divers qui avaient défrayé la chronique mais qui, en fin de compte, n'intéressaient en rien l'administration centrale ou le garde des Sceaux. La remontée d'information se concentre aujourd'hui sur des affaires plus sensibles, par leur gravité ou par leur nature. La délinquance financière, par exemple, est beaucoup plus suivie que les affaires de droit commun, qui ne constituent plus des affaires signalées.

L'hommage que vous avez rendu, monsieur le président Noël, à l'efficacité de la circulation de l'information au sein du ministère de l'intérieur a répondu à ma question.

Pensez-vous que la loyauté que l'on attend des officiers de police judiciaire soit une garantie suffisante ?
Disons qu'un excès de déloyauté se traduirait, ou devrait se traduire, par un retrait de l'habilitation à exercer au sein de la police judiciaire. La difficulté, c'est qu'il faut pouvoir établir la responsabilité d'un OPJ dans une remontée d'information par un canal parallèle à celui de l'autorité judiciaire.

Il ne fait pas de doute qu'il y a, au ministère de l'intérieur, une culture de la remontée d'information, y compris chez les agents qui ne sont pas sur le terrain. Pour y avoir été fonctionnaire, je peux en attester.

J'aimerais revenir sur le secret de l'instruction, qui est régulièrement bafoué. À l'occasion du procès de M. Jean-Jacques Urvoas, nous avons entendu des magistrats dire que toute action de rétorsion, et même toute enquête sur la violation du secret de l'instruction, était vaine et vouée à l'échec. Pensez-vous que l'existence de canaux d'information au sein du ministère de l'intérieur et de celui de la justice soit, structurellement, la raison de votre impuissance à préserver le secret de l'instruction ?

Permettez-moi une précision qui ne change rien au sens de cette question : M. Jean-Jacques Urvoas n'a pas été condamné pour violation du secret de l'instruction, mais du secret professionnel.

Ma question ne concerne pas M. Urvoas en tant que tel. Elle porte sur la difficulté, voire l'impuissance, des magistrats à protéger le secret de l'instruction.
Monsieur le rapporteur, j'ai lu attentivement votre rapport d'information sur le secret de l'enquête et de l'instruction. Vous y montrez très bien que la violation du secret de l'instruction est consubstantielle au secret de l'instruction lui-même, dans la mesure où il s'agit de concilier des principes contradictoires : la protection de la présomption d'innocence et du secret de l'enquête, d'une part, et le besoin d'informer et de communiquer, d'autre part. Ce besoin d'informer prend deux formes. C'est d'abord le travail des journalistes, qui est essentiel dans une démocratie, et qui inclut la protection des sources. C'est aussi la possibilité, pour les avocats de la défense, de communiquer sur certains éléments, au nom des droits de la défense. Toute la difficulté consiste à trouver le juste équilibre. Or je crois que vous l'avez trouvé, en disant qu'il faut continuer à communiquer sur l'instruction.
Si l'on veut préserver le secret de l'instruction d'une manière stricte, il faut décider qu'absolument personne ne peut communiquer sur l'instruction et instaurer un système fermé. Il me semble préférable, comme vous le préconisez, de conserver un système partiellement ouvert. Il existe des moments dans la procédure, au cours desquels celle-ci peut être davantage rendue publique qu'au stade de l'instruction. Cette nécessité de concilier des intérêts contradictoires, c'est toute l'équation juridique de l'expression des libertés publiques. J'ai relu vos recommandations : certaines sont faciles à mettre en œuvre, d'autres le sont moins.

Le système américain garantit beaucoup plus de transparence, tout au long de la procédure. S'il n'est pas capable de garantir le secret de l'instruction, le législateur ne devrait-il pas envisager de donner davantage de publicité à certains actes de procédure ? Par exemple, ne faudrait-il pas rendre public le fait qu'une personne est entendue comme témoin dans une enquête ? D'après votre expérience, ou par comparaison avec d'autres systèmes judiciaires, n'y aurait-il pas une marge de progression de ce côté-là ?
Je vais terminer cette audition par des propos un peu révolutionnaires. Selon moi, si les conditions de nomination du ministère public évoluent, comme je le souhaite, et si le parquet européen voit ses représentants émerger dans la procédure pénale française – c'est l'objet d'une directive européenne qui doit bientôt être transposée –, vous aurez inévitablement à vous prononcer, non plus sur le statut du parquet, mais sur le maintien ou non de la fonction de l'instruction.
Si les prérogatives du ministère public sont renforcées, grâce à un nouveau statut du parquet et à un nouveau mode de nomination, l'enquête pourra être menée par le ministère public. Et, pour certains actes particulièrement coercitifs, on recourra au juge des libertés et de la détention, qui devra en débattre contradictoirement avec les parties. Et qui dit débat contradictoire dit, en principe, débat contradictoire public. Voilà une évolution possible, qui pourrait se profiler assez vite. Je ne dis pas que cela sera facile à gérer, car nous aurons des phases de secret de l'enquête et des phases d'ouverture qui anéantiront le secret antérieur.
Rappelez-vous le rapport de Mireille Delmas-Marty : avec l'émergence du juge des libertés et de la détention, elle avait déjà fixé un certain nombre de lignes directrices de l'évolution de la politique pénale. Ces grands sujets fondamentaux pour l'exercice des libertés publiques sont à nouveau devant nous.

C'est dans les périodes de tensions et de crises que nous pouvons mettre à l'épreuve nos fondamentaux et nos principes républicains. On assiste en ce moment à une grève très suivie des avocats, qui ont demandé le renvoi de nombreuses affaires. Or une polémique est née du fait que l'administration centrale a communiqué à tous les présidents de tribunaux et de cours d'appel la procédure à suivre pour refuser ces renvois. Cela vous inspire-t-il des commentaires sur l'indépendance dont jouissent les présidents de juridiction ?
Monsieur le président, au risque de paraître insoumis, ce que je ne suis pas, je n'ai pas eu connaissance de l'instruction que vous mentionnez. En tout cas, je ne l'ai pas adressée aux magistrats du tribunal de Paris.
Je n'ai pas reçu l'instruction dont vous parlez, ou alors j'ai manqué d'attention en lisant les mails que la cour d'appel a pu m'adresser à ce sujet. Notre priorité, depuis le départ, a été de garantir la continuité du service minimum des services judiciaires et la sérénité de la communauté judiciaire. Or, depuis plusieurs semaines, on assiste à des tensions extrêmement vives dans les juridictions et dans les prétoires.
La règle, lorsque des avocats participent à des mouvements de revendications qui peuvent se traduire par des demandes de renvoi, est que, sauf impératif lié notamment à la détention ou à des circonstances particulières concernant la situation des parties, ces renvois sont acceptés, et cela ne crée pas d'incident. Sur certains types de contentieux, notamment en matière pénale, les magistrats sont parfois obligés de faire valoir les circonstances exceptionnelles pour refuser un renvoi, par exemple lorsqu'une remise en liberté serait préjudiciable à la bonne administration de la justice. Mais je répète que je n'ai pas donné l'instruction aux magistrats de repousser les demandes de renvoi formulées par les avocats.
Nous avions déjà connu un mois de décembre très compliqué dans les juridictions, du fait de la grève des transports : de nombreuses demandes de renvoi avaient été présentées, parce que les justiciables ou leurs avocats ne pouvaient pas rejoindre le tribunal et, depuis le mois de janvier, nous constatons des tensions extrêmement fortes dans certains services.

Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire : c'est écrit dans notre Constitution. Très récemment, il a pourtant fait une déclaration au sujet de l'affaire Sarah Halimi, qui a suscité un communiqué de presse de la Cour de cassation. Celle-ci a rappelé que les magistrats de la cour devaient pouvoir juger en toute sérénité et que le Président de la République n'avait pas à interférer dans les affaires en cours. Quel commentaire cela vous inspire-t-il ?
Je crois que ce sont les chefs de la cour d'appel de Paris qui ont réagi aux commentaires du Président de la République, puisque la décision qui a été rendue l'a été par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris…
Je crois que les magistrats étaient dans leur rôle et que c'était leur devoir de le faire. Il y a quelques années de cela, le Conseil supérieur de la magistrature a indiqué que les chefs de cour et de juridiction devaient communiquer lorsque l'institution judiciaire était critiquée ou qu'elle faisait l'objet d'attaques. Il fallait une réponse institutionnelle pour préserver la qualité et la sérénité des débats judiciaires qui ont entouré cette affaire.

Une dernière question : Avez-vous encore des contacts informels avec Mme Rachida Dati, aux côtés de qui vous avez travaillé ?
Je n'ai plus de contacts avec Mme Dati depuis plusieurs années. J'ai servi la République en travaillant au sein de son cabinet ministériel de 2007 à 2008. Depuis cette date, je n'ai plus exercé de fonctions de ce type : j'ai poursuivi une carrière de magistrat en province, à l'inspection générale, en région parisienne et aujourd'hui à Paris. J'ai mis mes compétences au service d'une activité ministérielle à un moment donné, et c'est terminé.
La séance est levée à 16 heures 30.
Membres présents ou excusés
Présents. - M. Ugo Bernalicis, M. Vincent Bru, Mme Nadia Hai, M. Olivier Marleix, M. Sébastien Nadot, M. Didier Paris, M. Bruno Questel, Mme Laurianne Rossi, Mme Cécile Untermaier
Excusés. - M. Ian Boucard, M. Dimitri Houbron