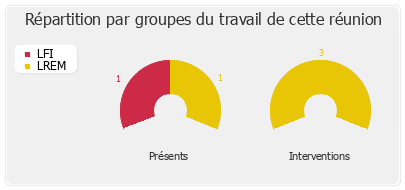Commission d'enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences
Réunion du jeudi 27 mai 2021 à 13h00
Résumé de la réunion
La réunion
COMMISSION D'ENQUÊTE relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intÉRÊts privés et ses conséquences
Jeudi 27 mai 2021
La séance est ouverte à 13 heures.
(Présidence de Mme Mathilde Panot, présidente de la commission)
La commission d'enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences, procède à l'audition de M. Marc Laimé, journaliste spécialisé et conseil sur les politiques publiques de l'eau auprès de collectivités territoriales

La commission d'enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences poursuit le cycle de ses auditions. Cette onzième session d'auditions sera largement consacrée aux tenants et aboutissants de l'offre publique d'achat (OPA) de Veolia sur Suez. Elle sera l'occasion, pour les acteurs principaux de la gestion privée de l'eau et de l'assainissement, de justifier du bien-fondé de leur modèle économique.
Nous accueillons tout d'abord M. Marc Laimé, journaliste spécialisé et conseil sur les politiques publiques de l'eau auprès de collectivités territoriales. Ses ouvrages et son blog Les eaux glacées du calcul égoïste font figure de référence pour comprendre l'emprise des acteurs privés sur l'eau.
Monsieur Laimé, je vous remercie de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations.
L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».
M. Marc Laimé prête serment.
La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi Sapin, unanimement vantée par tous les acteurs du secteur, n'est pas un gage de transparence et d'équité, loin de là. Au contraire, elle constitue le principal véhicule de l'appropriation de la gestion de l'adduction d'eau, de l'assainissement et, plus généralement, des multi-utilités (déchets, chauffage, propreté, restauration collective, transports, etc.), qui représentent chaque année des marchés de plusieurs dizaines de milliards d'euros.
La loi Sapin du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques fait suite aux grandes lois de décentralisation de 1981 et 1983, qui ont rendu aux collectivités locales la capacité de s'administrer librement. Jusqu'en 1979, un contrôle préfectoral s'exerçait ex ante sur les contrats types de délégation de service public (DSP), mais de 1985 à 1995, le nombre de DSP dans le domaine de l'eau a été multiplié par quatre en France, en faveur de la seule Générale des eaux, devenue Veolia.
Parallèlement, la période a été entachée par divers scandales liés au financement de la vie politique (les affaires Carignon, Boucheron ou Urba-Graco, par exemple). Il apparaissait donc urgent de légiférer.
Avant la loi Sapin, aucune limitation de durée n'existait s'agissant des DSP, lesquelles ne faisaient d'ailleurs pas l'objet d'appels d'offres. Par ailleurs, des droits d'entrée étaient perçus. Jusqu'en 1995, il n'était pas obligatoire de présenter un compte rendu financier de la délégation. Cependant, une forme d'assistance aux collectivités était dispensée par les anciennes directions départementales de l'équipement et de l'agriculture. De plus, un groupe national de gestion des services publics de l'eau a existé jusqu'au 1er janvier 2015.
La loi Sapin avait pour objectif d'éclaircir les comptes des partis politiques, de réglementer les prestations de publicité et de limiter la durée des contrats de DSP, en instituant une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable. La loi Sapin n'a jamais prévu d'imposer un comparatif entre la gestion publique et la gestion privée. Son but était d'organiser la concurrence entre les grandes entreprises privées qui aspiraient à signer un contrat de DSP.
Ainsi, la loi Sapin a introduit un protocole extrêmement codifié et contraignant. La procédure dure environ un an. Dès lors, les collectivités locales ont eu tendance à se concentrer sur le respect de la procédure et des délais, au détriment du fond, par crainte de recours de la part des candidats écartés.
D'après mon expérience, je constate que la loi Sapin assure la promotion exclusive de la gestion privée. Elle se contente d'organiser la concurrence entre les candidats à la DSP. La gestion publique est donc exclue, par principe. Les deux modes de gestion ne font pas l'objet d'analyses comparatives. Le primat absolu est accordé à la négociation que conduit la collectivité avec les entreprises, épaulée par son assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO).
Ainsi, la mise en œuvre de la loi Sapin a donné naissance à un domaine d'activité parfaitement délétère, à savoir celui des bureaux d'étude spécialisés. Avant la loi nᵒ 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, le secteur comptait une centaine de bureaux d'études spécialisés, y compris de petites structures. Même si la mise en œuvre de la loi NOTRe a pris du retard et qu'une part importante des transferts prévus par la loi NOTRe a été repoussée par les élus à après 2026, le mouvement de concentration des services a entraîné une division par dix du nombre de contrats à auditer et à accompagner dans le cadre des missions d'AMO.
Lorsqu'une collectivité lance une procédure « loi Sapin », elle n'est pas obligée de demander un audit à un bureau d'étude, mais cette pratique s'est répandue au fil du temps, tellement les critiques et les contentieux étaient nombreux. Le mandatement d'un AMO apparaît comme une bonne pratique pour les collectivités. Celles-ci se retrouvent donc à lancer un marché public pour se doter d'un AMO. L'AMO est supposé se livrer à une analyse technique, juridique et financière, mais, selon la taille des collectivités, le travail est plus ou moins bien fait. Dans ce cadre, la collectivité demande généralement à son AMO de procéder à une analyse comparative des modes de gestion. Cependant, l'activité des bureaux d'études n'étant pas encadrée, chacun agit à sa guise.
Le rapport établi par un AMO pour une collectivité, à l'appui de la procédure « loi Sapin », sert à alimenter les réflexions de la collectivité et à guider son choix, à travers un rapport qu'établira le président. Deux points posent cependant problème.
D'abord, quelle que soit la taille de l'AMO, celui-ci établit une grille d'analyse comparative des mérites supposés de la gestion privée et de la gestion publique. Or il s'avère que la gestion privée reçoit systématiquement la meilleure notation, assortie d'affirmations fantaisistes, quand elles ne sont pas fallacieuses, voire mensongères. Par exemple, les AMO mettent en avant le fait que le recours à la DSP permet de transférer les risques à l'opérateur privé. Quand la gestion est transférée à un délégataire, celui-ci la reçoit effectivement à ses risques et périls, mais uniquement en termes financiers et pas en termes de responsabilité juridique. Les tableaux comparatifs sont bâtis sur des abus de langage de ce type. Pour un lecteur non averti, les rapports des AMO laissent penser que la gestion privée présente tous les avantages.
Par ailleurs, les rapports des AMO contiennent des plans prévisionnels financiers d'exploitation. Là encore, la gestion privée se révèle systématiquement moins chère que la gestion publique, grâce à un certain nombre de subterfuges.
Selon moi, cette situation s'apparente à de l'abus de confiance. Généralement, le rapport établi par le président de la collectivité, sur la base du rapport de l'AMO, conduit la collectivité à conserver le principe de la gestion privée ou à faire semblant de lancer un audit public en cours de procédure. En somme, les rapports des AMO oblitèrent les capacités des élus à fonder un jugement éclairé, d'autant que les élus ne disposent généralement que d'une synthèse succincte, transmise la veille de la réunion de l'assemblée délibérante. Dans ces conditions, les élus ne peuvent pas aller contre les orientations telles qu'elles ont été décidées.
J'ai élaboré, avec certains de mes collègues, des propositions pour tenter de faire obstacle à ces dérives systémiques.
Bien entendu.
Les collectivités qui souhaitent passer en gestion publique n'ont aucune obligation légale de lancer une procédure « loi Sapin ». Dès lors qu'une procédure « loi Sapin » est lancée, il s'avère que, dans 95 % des cas, le contrat est reconduit avec le même opérateur privé. Autrement dit, la concurrence n'existe pas.
L'une de nos propositions consisterait à établir, deux ans avant la fin de chaque contrat de concession, un protocole de fin de contrat, qui permettrait de décider du sort des biens et des personnels avant la fin du contrat, de façon à éviter toute contestation. Selon moi, il faudrait rendre obligatoire l'établissement d'un tel protocole.
Par ailleurs, je préconise d'obliger le concessionnaire à établir des comptes rendus financiers qui respectent les principes du plan comptable général. Alors que les normes du plan comptable général s'imposent à tous les services en gestion publique, ces entreprises ont réussi à y échapper. Les comptes qu'elles produisent ne correspondent donc à aucune forme connue dans le domaine public et s'avèrent parfois fantaisistes.
En outre, les appels d'offres des collectivités devraient respecter un modèle type de contrat, validé par les pouvoirs publics. La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) a élaboré un modèle type de contrat d'audit en 2010, mais il n'est malheureusement pas utilisé.
Un contrôle de validation des études préalables au choix du mode de gestion et du rapport du président de l'exécutif devrait être instauré. Ce contrôle serait assuré par une mission conjointe de la direction régionale des finances publiques (DRFIP), de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et de la chambre régionale des comptes (CRC). Voilà qui contribuerait à éviter de nombreuses dérives.
Il serait également bon d'organiser un débat public annuel, devant la représentation nationale, sur l'état et les évolutions de l'ensemble des concessions de service public en France.
En avril 2016, la France a transcrit la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, qui a considérablement modifié les fondements et le mode de fonctionnement des contrats de concession. Depuis lors, il n'est plus possible d'appeler « DSP » ou « affermage » les dispositifs existants auparavant.
Les nouveaux contrats de concession établissent une frontière. Ainsi, en dessous d'une durée de cinq ans, aucune justification n'est demandée au concessionnaire, alors que, pour un contrat de concession de plus de cinq ans, le futur concessionnaire doit justifier de la durée de ses amortissements, laquelle doit être cohérente avec la durée du contrat. De plus, dorénavant, les contrats de concession prévoient d'emblée que si des innovations techniques, qui n'existaient pas au moment de la signature du contrat, apparaissent en cours de concession, un droit d'avenantage est ouvert au concessionnaire privé. Les élus, qui ont cru signer une concession de sept ou huit ans, peuvent donc se voir imposer par l'entreprise une prolongation du contrat par voie d'avenant. Les collectivités n'ont pas encore pris conscience de cette disposition.
Enfin, je suis farouchement partisan de la création d'une haute autorité de régulation. Depuis une quarantaine d'années, tous les anciens grands monopoles publics ont été libéralisés tour à tour, dans l'énergie, les télécommunications, etc.). Ce mouvement s'est accompagné de la création d'une autorité de régulation, ayant des pouvoirs de contrôle et de sanction. Or le domaine des multi-utilités a toujours échappé à toute forme de régulation. Il s'agit d'une véritable anomalie structurelle. Cependant, aucune majorité parlementaire n'acceptera jamais la création d'une telle autorité. Il est question de politiques publiques essentielles et de marchés représentant des dizaines de milliards d'euros, mais ce secteur n'est pas régulé.

Selon vous, quel est, de la DSP ou de la régie publique, le système le plus efficace pour gérer l'eau ?
Il est impossible de comparer ces deux types de gestion, car ils s'inscrivent dans des cadres fiscaux et financiers radicalement différents.
Je suis un tenant de la gestion publique. Dans le cadre de mon activité professionnelle, je préconise ce mode de gestion.
Il est courant de considérer les problématiques de gestion publique-privée à travers les seules missions d'adduction d'eau et d'assainissement. Or, les collectivités locales françaises sont aujourd'hui à la croisée des chemins. Il leur faudra se réinventer et se restructurer, pour prendre en compte de nouvelles missions (gestion des milieux naturels, protection des captages, gestion des eaux pluviales, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). Ces missions supposent que les collectivités se dotent de nouvelles compétences en interne.
L'enjeu de l'eau et de l'assainissement est lié aux décisions prises en matière d'urbanisme, de voirie ou encore d'aménagement du territoire. Les collectivités doivent donc réincorporer en leur sein des capacités en matière d'ingénierie et de politiques publiques, lesquelles avaient disparu ces trente dernières années, à l'initiative des gouvernements successifs. Si les collectivités ne disposent pas, en interne, des moyens et des personnels nécessaires pour articuler ces différentes politiques, elles seront confrontées à de graves problèmes dans les années à venir.
Malheureusement, non. Seule la dimension métropolitaine permet de disposer, en interne, de moyens humains, techniques et financiers à la hauteur de l'expertise du secteur privé. En dessous de 50 000 habitants, les collectivités ne peuvent pas disposer de tels moyens.
La question de la mutualisation des moyens et du transfert d'expériences, qui existaient auparavant dans le domaine public, se pose ainsi de manière renouvelée. Par le passé, chaque département comptait un service d'assistance technique aux exploitants de station d'épuration (SATESE), ce qui représentait sept cents ingénieurs et techniciens, mais au début des années 2000, un lobbying a été exercé, dans le but de faire disparaître cette institution. Le même phénomène a concerné les laboratoires publics départementaux d'analyse de la qualité des eaux.
Aujourd'hui, les missions d'analyse de la qualité des eaux en France sont sous-traitées par les agences régionales de santé (ARS) à deux multinationales privées, ce qui pose un certain nombre de problèmes. En effet, ces deux multinationales, en position dominante, font en sorte de rester en bons termes avec l'État. Elles ne sont donc pas forcément enclines à émettre une alerte en cas de pollution. Ce problème se manifestera vraisemblablement dans les années à venir, car la qualité des eaux se dégrade. Il s'agit d'un point de vigilance.

Comment serait-il possible de s'assurer que l'exercice de la gestion de l'eau en DSP défende l'intérêt général ?
Une dynamique proactive des pouvoirs publics, pour former les élus et les techniciens des collectivités locales, est essentielle.
Jusqu'à présent, cette formation était dispensée par les partis politiques, mais la réforme de la formation change la donne. Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ne remplit pas cet office. En outre, les personnes susceptibles de bénéficier d'une formation dans ce domaine sont plutôt des cadres de catégorie A. Il existe donc une carence en la matière.

En moyenne, 1,8 candidat se déclare pour chaque procédure de mise en concurrence. Est-ce suffisant ? Le risque de retour en régie suffit-il à limiter l'inflation des prix ?
Selon moi, le retour en régie n'est pas un risque. Cette décision appartient à la collectivité locale et à son exécutif.
Je considère que la concurrence n'existe pas. Lorsqu'une collectivité a délégué un service sur une longue durée, l'exécutif en place n'est généralement pas celui qui a signé le contrat. En outre, plus la durée du contrat est longue, moins la collectivité est capable de contrôler quoi que ce soit. Malheureusement, une pratique consistant à confier un service à un opérateur privé, sans plus s'occuper de rien ensuite, s'est instaurée dans les petites collectivités. Cette situation entraîne une perte de connaissances et de mémoire au sein de la collectivité, alors même que les enjeux de digitalisation des services sont de plus en plus importants.
En fait de concurrence, les opérateurs privés tirent profit de leur présence déjà ancienne dans les territoires. Lorsqu'une collectivité a signé de multiples contrats de DSP avec le même opérateur (eau, déchets, propreté, transports, etc.), elle se trouve dans une situation d'emprise, même si elle n'est pas satisfaite de son concessionnaire. Les opérateurs exercent une forme d'emprise sur les collectivités locales, grâce à leur présence de longue date sur les territoires. Ils collectent ainsi un volume de données invraisemblable, qui, au-delà des dérives de la loi Sapin, leur garantit, d'obtenir le renouvellement des contrats.
Cette emprise s'exerce au travers d'une forme d'échange de bons procédés. Sans rien laisser paraître de ses intentions, l'opérateur qui détient plusieurs contrats propose à la collectivité de lui faire un « cadeau » dans un autre domaine d'intervention. Ce système est devenu une norme de fonctionnement, que personne ne remet en cause. Toutefois, cela pose problème en matière de contrôle et de bonne gestion des deniers publics.

Vous avez qualifié l'offre publique d'achat (OPA) de Veolia sur Suez « d'affaire d'État ». En quoi l'État est-il impliqué dans le déroulement de cette affaire ? Comment analysez-vous la partition jouée par l'État et ses représentants ? Quel a été le rôle de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ?
Selon moi, depuis la création de la Générale des eaux en 1853, ces entreprises ne sont pas totalement distinctes de l'appareil d'État et de l'action des pouvoirs publics. Pourtant, il ne s'agit plus d'entreprises françaises depuis longtemps. En effet, le capital de Veolia est détenu par des fonds d'investissement étrangers à hauteur de 60 %.
Voilà quelques mois, la société Veolia a cru que j'étais payé par Suez pour la critiquer, mais elle m'a finalement présenté ses excuses.
Ces entreprises ne sont pas des entreprises comme les autres. Elles ont toujours eu un lien organique avec l'appareil d'État. L'affrontement public-privé a connu de grands cycles historiques depuis Napoléon III et des retours de balanciers tous les trente ou quarante ans. Je pense que nous sommes aujourd'hui à l'orée d'un retour vers la gestion publique. Ces vingt dernières années, Veolia et Suez ont perdu 20 % de leurs clients français, en nombre d'usagers desservis. Voilà 20 ans, les trois majors desservaient 80 % des Français, contre 60 % aujourd'hui. Une forme de paix armée s'est instaurée entre les opérateurs privés et les opérateurs publics. S'agissant de l'assainissement, la gestion publique domine.
Il me semble que l'équilibre actuel n'évoluera que peu dans les années à venir, car l'essentiel des relais de croissance de Veolia et Suez se trouve à l'étranger. La majeure partie de leur chiffre d'affaires s'effectue aujourd'hui hors des frontières françaises. Voilà qui explique l'opération conduite par M. Antoine Frérot. En effet, Veolia était en difficulté dans certains pays et dans certains métiers.
Voilà quelques années, Suez a racheté General Electric Water, l'un des plus grands acteurs américains, ce qui lui a donné le primat dans la gestion de l'eau industrielle. S'agissant de l'eau potable, Suez desservait également davantage de clients que Veolia. En outre, Veolia accusait un certain retard en termes de digitalisation. La conjonction de ces différents facteurs a conduit Antoine Frérot à agir. S'il ne l'avait pas fait, Veolia aurait pu se trouver en difficulté, alors que Suez innovait dans le domaine des eaux industrielles et des smart cities.
À ce propos, la maîtrise des données apparaît comme un enjeu majeur pour les années à venir. J'ai été stupéfait de découvrir que M. François Rebsamen, à Dijon Métropole, et M. Christophe Béchu, à Angers Loire Métropole, avaient confié la gestion de tous les flux numériques de leur ville à Suez. L'enjeu est considérable en termes de politiques publiques et de respect de la vie privée. La gestion des données est un axe de développement essentiel, me semble-t-il.
Il existe deux enjeux principaux à l'échelle mondiale, à savoir le numérique et le changement climatique. Or Suez et Veolia n'étaient pas au même niveau sur ces enjeux. Veolia accusait un certain retard dans un certain nombre de domaines d'avenir, ce qui l'a incité à lancer cette opération brutale, dont nul ne sait comment elle se terminera. En effet, au-delà de l'autorité de régulation en France et des autorités de régulation étrangères, il reste de nombreux obstacles à la validation définitive de l'OPA.
Nous assistons au déroulement d'une opération prédatrice, qui supposera, pour aller à son terme, que Veolia vende des actifs à des acteurs étrangers. Alors que M. Frérot vantait la construction d'un géant mondial, pour pouvoir défendre les entreprises françaises que sont Veolia et Suez des appétits imaginaires des opérateurs chinois, nous assistons à une forme de dépeçage de deux grandes entreprises, dont la pérennité, en l'état, n'est pas du tout assurée. Parmi les opérateurs qui reprendront l'entreprise Suez reconfigurée figurent Meridiam et Global Infrastructure Partners (GIP), un fonds d'investissement américain. Le fondateur de GIP est un oligarque nigérian, mais j'ignore d'où proviennent les fonds lui ayant permis de constituer son fonds d'investissement.
Les engagements formalisés dans le cadre de l'OPA – garantir l'emploi, par exemple – sont sans valeur. Si l'OPA aboutit, nous assisterons à un grand jeu de bonneteau. Pour comprendre les fondements de cette opération et le rôle de l'État, il faut savoir que celle-ci s'inscrit dans un vaste jeu de construction, initié par M. Emmanuel Macron. Tout à sa soif de réformes, tel Guizot sous Napolépon III, M. Emmanuel Macron veut reconfigurer le tissu industriel français et nos champions nationaux. La « saga » Veolia-Suez s'inscrit dans ce cadre. Elle n'est qu'un élément visant à la reconstitution d'un nouveau tissu industriel français, que MM. Emmanuel Macron et Alexis Kohler considèrent comme absolument indispensable pour affronter les enjeux du nouveau monde, notamment celui du changement climatique. L'OPA menée par Veolia sur Suez n'est qu'un effet collatéral d'une entreprise plus vaste. Il est important d'inscrire l'affaire Veolia-Suez dans ce contexte plus général.
Veolia est entré dans un cycle de financiarisation croissante. Cette entreprise devra porter un endettement colossal, puisqu'elle était déjà endettée à hauteur d'une douzaine de milliards d'euros et qu'il faudra y ajouter huit à dix milliards d'euros supplémentaires. Il ne sera pas possible de se défaire du poids de cette dette uniquement en revendant des actifs. Voilà qui fragilise l'avenir du nouveau Veolia.
En outre, Veolia reste un acteur minuscule au niveau international. Même avec les actifs arrachés à Suez, Veolia ne pèsera que 4 ou 5 % au niveau mondial dans ces nouveaux marchés. Il n'est pas le géant annoncé.
Compte tenu des mutations extrêmement importantes que connaîtra ce type d'entreprise – du fait des effets cumulés du changement climatique et de la digitalisation – j'estime que de nombreuses incertitudes demeurent sur la pérennité de Veolia et de ses actifs. À cet égard, je rappelle que Veolia (et la Générale des eaux auparavant) a construit son empire avec l'argent des usagers de l'eau et de l'assainissement. La pérennité du nouveau modèle voulu par M. Frérot pose question. Veolia s'éloigne de ses fondamentaux et les financiers feront la loi.
De nombreux problèmes se poseront en France en termes de libre concurrence entre les entreprises. D'ailleurs, que fera le Syndicat des eaux d'Île-de-France (SEDIF), qui vient de décider de confier un nouveau contrat au secteur privé ? Un semblant de concurrence est indispensable. Or, le nouveau Suez, réduit aux acquêts, est un attelage singulier. En effet, le fonds Meridiam est le fruit de conflits d'intérêts incessants. M. Thierry Déau, qui a commencé sa carrière dans le bureau d'études spécialisé de la Caisse des dépôts et consignations, a construit Meridiam, qui n'avait, jusqu'alors, aucune expérience de la gestion des services publics délégués dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. En outre, le retrait d'Ardian a été compensé par la présence extrêmement importante au capital de la Caisse des dépôts et de CNP. S'y ajoutent GIP, dont j'ignore d'où proviennent les fonds. Un tel attelage remplace une entreprise plus que centenaire, qui avait des capacités éminentes sur les volets techniques, juridiques et financiers. Elle se trouve aujourd'hui reprise en mains, en termes capitalistiques, par des acteurs sans expérience probante dans ce domaine.
Pour information, Ardian était auparavant Axa Asset Management, qui avait été malmené lors d'une énième opération de reprise avec procédure d'achat à effet de levier – leveraged buy-out (LBO) et avait perdu un milliard d'euros. Il est donc compréhensible qu'Ardian ait renoncé à prendre part à l'opération.
En définitive, nous connaîtrons bientôt une nouvelle configuration en France, reposant sur un acteur majoritaire et sur Suez. Celle-ci ne favorisera pas une meilleure concurrence et ne sera pas gage de transparence, au contraire. Paradoxalement, je suis convaincu que cette situation accentuera le mouvement en faveur de la gestion publique.
Plutôt que de chercher à savoir quel est le degré d'implication de M. Alexis Kohler, je préfère me concentrer sur l'analyse des logiques structurelles, dans un contexte complexe. Ces entreprises sont tout à fait particulières, parce qu'elles ont introduit en France le modèle de la common law à l'anglo-saxonne. Dès lors, l'État ne joue plus le rôle d'administrateur ni de régulateur.

En octobre 2020, vous avez écrit dans le Monde diplomatique, dans l'article « Veolia-Suez : genèse d'une affaire d'État », que Veolia, par l'intermédiaire de ses juristes et experts financiers, opérait des montages fiscaux en Belgique, afin de payer moins d'impôts. Avez-vous connaissance de tels montages en France ?
Depuis que j'ai révélé cette affaire, voilà plusieurs années, M. Antoine Frérot refuse de me parler. J'ai publié, preuves à l'appui, tous les dispositifs mis en place à Bruxelles permettant, grâce aux « notionnels », d'y localiser une fausse banque, censée distribuer de l'argent à toutes les filiales européennes. Chaque année, ce dispositif permettait à Veolia de soustraire 500 millions d'euros au montant de l'impôt sur les sociétés. En ayant connaissance de telles pratiques, nous ne pouvons qu'être dubitatifs s'agissant des promesses de transparence de Veolia.
Il convient de prêter une attention constante aux volets juridiques et financiers. Une entreprise comme Veolia est capable de mobiliser des experts de très haut niveau, face à des collectivités locales démunies. C'est la raison pour laquelle il est absolument nécessaire de refonder des structures d'ingénierie publique, qui doteront les collectivités locales des compétences requises, pour pouvoir affronter ces ingénieries financières.
Pour revenir au SEDIF, celui-ci conclura deux contrats de concession et il mettra en œuvre une nouvelle méthodologie de traitement des eaux extrêmement sophistiquée, dont personne n'a réellement besoin. En effet, dans le document qui a été présenté aux élus ce matin, M. André Santini affirme que l'eau du SEDIF est déjà la meilleure de France. Dans ce cas, pourquoi investir un milliard d'euros pour l'améliorer encore, d'autant qu'aucun document annexe reposant sur une base scientifique n'a été présenté pour justifier la pertinence de cet investissement ?
L'investissement sera porté à 35 % par le SEDIF et à 65 % par Veolia. Cependant, l'amortissement de caducité permettra à Veolia de défalquer les 700 millions d'euros investis de son impôt sur les sociétés. Il s'agit d'un point de vigilance. Le SEDIF est une vitrine, qui permettra à Veolia de faire payer à l'usager francilien, qui n'en a nul besoin, une technologie dont personne ne sait si elle fonctionne vraiment.
C'est la raison pour laquelle il est indispensable d'accroître, de façon proactive, les actions de formation des élus et de reconstituer une ingénierie publique, dont les collectivités locales pourront bénéficier.

Je vous remercie, monsieur Laimé. Nous attendons désormais vos réponses écrites aux questions qui vous ont été communiquées.
La réunion se termine à quatorze heures dix.