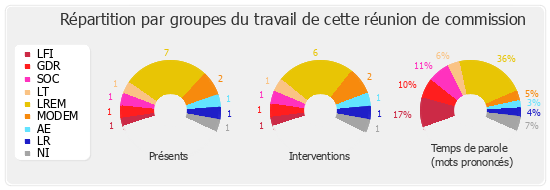Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du mercredi 31 mars 2021 à 11h00
La réunion
La commission entend M. Jean Arthuis, président de la commission sur l'avenir des finances publiques

Chers collègues, je souhaite la bienvenue à Jean Arthuis, dont chacun sait qu'il a présidé la commission sur l'avenir des finances publiques. Celle-ci a remis il y a une dizaine de jours un rapport au Gouvernement. Un rapport de la Cour des comptes est également attendu, ce qui prouve la sensibilité et l'importance de la question de l'état de nos finances publiques et de la stratégie à adopter en la matière au lendemain de la crise – notre pays ne saurait effectivement se contenter de contempler un mur de dette. Ce rapport vient enrichir notre propre réflexion sur la trajectoire des finances publiques et fait écho à nos propres préoccupations ; je vous rappelle que le rapporteur général Laurent Saint-Martin et moi-même allons bientôt déposer une proposition de loi organique tendant à modifier la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Nous espérons qu'elle pourra être examinée avant la fin de la législature.
Au fond, tout cela va dans le même sens. Il s'agit de répondre aux impératifs auxquels nous sommes soumis en matière de finances publiques, non des impératifs comptables, contrairement à ce que certains sous-entendent, mais une condition de notre souveraineté et une exigence de responsabilité à l'égard de notre propre génération et des générations suivantes.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les députés commissaires aux finances, j'ai donc à vous rendre compte des travaux de notre commission, instituée par le Gouvernement et installée le 4 décembre – vous-même, monsieur le président, monsieur le rapporteur général, étiez présents. Lui était assignée l'objectif d'établir un diagnostic et d'éclairer les évolutions possibles de nos finances publiques, au sortir de la crise de la covid-19, et de proposer de nouvelles règles de gouvernance et de nouveaux outils de pilotage afin d'assurer la soutenabilité des comptes publics sur le long terme. Pour atteindre cet objectif, nous avons procédé à plus de cent auditions, nous avons organisé des conférences entre économistes, nous avons demandé à la direction générale du trésor des analyses de trajectoires de finances publiques reposant sur des hypothèses macroéconomiques diverses. Nous avons également fait procéder à une enquête par les services du trésor de huit pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), pour l'essentiel des pays membres de la zone euro. Nous avons également fait procéder à des analyses d'opinion, qui ont été conduites par l'institut Ipsos, qui font apparaître que 83 % des Français sont inquiets de la situation des finances publiques et que 73 % estiment être mal informés de celle-ci.
Je voudrais faire devant vous le point sur nos principaux constats, qui nous ont amenés à tenter de définir une stratégie et, finalement, à proposer une transformation radicale de la gouvernance budgétaire.
Commençons par les constats. Personne n'a mis en cause le bien-fondé de l'action des pouvoirs publics face à la crise. Il s'agissait d'assurer la sécurité des Français et d'éviter le collapsus économique et social. Des masses de fonds publics, d'un niveau inédit en temps de paix, ont été mobilisées. Cette mobilisation a suscité au moins trois questions. Premièrement, d'où cet argent venait-il ? Deuxièmement, l'État pouvait-il continuer ainsi à s'endetter ? Troisièmement, dans quelle mesure une telle situation était-elle soutenable ?
Les fonds ont été abondants, mais ce n'est pas de l'argent magique ; l'État s'est endetté. Quant à la question de la capacité de la France à s'endetter, il n'y a pas eu de problème : les émissions du Trésor ont été l'objet de souscriptions surabondantes, tout s'est donc bien passé. Il est vrai que la Banque centrale européenne (BCE) a engagé des programmes de rachat sans précédent – il faut avoir à l'esprit que pratiquement 80 % des dettes émises par le trésor public français en 2020 se retrouvent aujourd'hui dans les livres de la Banque centrale européenne ou ceux d'autres banques centrales. Autrement dit, c'est plus que le déficit de l'année 2020 qui a ainsi été repris par les banques centrales. Il est clair que les taux d'intérêt sont historiquement bas, notamment en raison d'une épargne mondiale surabondante, et cette situation va sans doute durer. Aujourd'hui, sur des maturités de dix ans et même au-delà, les taux sont pratiquement négatifs.
Si la mobilisation d'argent a été facilitée par les programmes de rachats non seulement pour l'Europe mais pour le monde entier, le soutien de la BCE a été, il faut bien le reconnaître, tout à fait exceptionnel. Toutefois, cette aide de la BCE n'a pas vocation à durer : si l'inflation revient, il sera mis un terme à ces programmes exceptionnels.
En outre, cette situation ne doit pas masquer les problèmes structurels de nos finances publiques. Contrairement à d'autres pays, voisins, il faut bien reconnaître que depuis 1974 nous n'avons jamais équilibré nos comptes publics. Ainsi, la dette publique n'a cessé de progresser, représentant 20 % du produit intérieur brut (PIB) en 1980, 40 % en 1990, 60 % en 2000, 80 % en 2010 et pratiquement 100 % à la veille de la crise du Covid. Ces déficits constatés depuis 1974 s'inscrivent malheureusement dans un contexte de baisse tendancielle de la croissance du PIB. En effet, depuis les années soixante-dix, de décade en décade, les taux de croissance n'ont cessé de baisser pour atteindre, dans les années 2010, 1 % à 1,5 %.
Nous abordons cette crise avec un niveau de dépenses publiques particulièrement élevé et sensiblement plus élevé que celui des pays voisins. Elles représentent pratiquement 56 % du PIB, alors que la moyenne des vingt-sept États membres de l'Union européenne s'établit à 47 % et que les dépenses publiques de l'Allemagne sont plutôt de 42 % du PIB. La croissance de nos dépenses publiques entre 2005 et 2019 a été largement tirée par le secteur local et la sécurité sociale.
Sans orientation nouvelle, l'endettement public continuera d'augmenter dans le long terme. Nous avons étudié différents scénarios : tout laisse à penser que, autour de 2030, nous aurons peut-être une stabilisation, peut-être autour de 125 %, si tous les facteurs favorables sont réunis, mais rien n'en donne l'assurance. Dans ces conditions, nous devons être conscients également des faits et des risques les plus préoccupants, par exemple celui d'une hausse des taux d'intérêt. Leur hausse d'un point signifierait, au bout de dix ans, une augmentation de la charge de la dette de pratiquement 30 milliards d'euros. La dynamique de l'endettement est également plus que préoccupante car elle nous expose précisément au risque d'une remontée des taux d'intérêt. Elle fait également peser un risque sur la stabilité de la zone euro. Le bouclier de la monnaie unique nous a permis d'affronter la crise de 2008, crise internationale en même temps que crise des dettes publiques, dans des conditions à peu près satisfaisantes. Dans quelles conditions la France accéderait-elle, aujourd'hui, aux marchés financiers si elle n'était membre de la zone euro. Les règles que celle-ci s'est données ont été suspendues mais, n'en doutons pas, au sortir de la crise, elles seront rétablies, certes sans doute sous une forme différente, mais nous n'en serons pas moins rappelés à l'ordre si nous nous laissons aller à la progression de notre endettement. Il est à redouter que la zone euro n'entre alors en crise. Par ailleurs, troisième facteur, la mondialisation nous fait encourir des risques de crises. Que se passerait-il si, demain ou après-demain, ils se réalisaient ? Nous avons également conscience des investissements à opérer dans la transition écologique, et il faudra peut-être que notre protection sociale protège d'un cinquième risque : la dépendance.
Ayons donc conscience de la situation de nos finances publiques pour faire face à ces risques.
Il fallait essayer de définir une stratégie. Nous pensons que certaines pistes qui émergent aujourd'hui dans le débat public doivent être écartées. La première d'entre elles, c'est d'effacer tout ou partie de la dette publique. S'il s'agit des dettes détenues par le système des banques centrales, celles-ci versent des dividendes aux actionnaires que sont les États, fruit des intérêts qu'elles perçoivent ; c'est donc un jeu à somme nulle. En ce qui concerne un pays comme la France, dont la dette publique est détenue majoritairement par des investisseurs étrangers, ce serait un très mauvais signal que d'effacer la dette. Le recours à une dette perpétuelle nous paraît également devoir être écarté ; ce ne peut être une solution que de manière tout à fait marginale. Certes, les maturités de la dette britannique atteignent dix-huit ans, alors que les maturités de la dette française – pourtant les plus élevées de la zone euro – sont en moyenne d'un peu plus de huit ans, c'est parce qu'il y a au Royaume-Uni un système de fonds de pension qui n'existe pas en France,
Un cantonnement de la dette résultant de la crise de la covid est-il une solution ? Pour ma part, j'ai l'expérience d'un cantonnement de dette. Alors que j'étais ministre des Finances, à l'été 1995, s'est posée pour la première fois la question de savoir quoi faire de la dette sociale. Il n'y avait à l'époque pas encore de loi de financement de la sécurité sociale et, à la suite de la récession de 1993, la dette sociale s'élevait à 250 milliards de francs environ. Avec Alain Juppé, nous sommes convenus de placer cette dette dans un fonds dédié : la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES). Pour en assurer le remboursement, nous avons institué la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), et il était entendu qu'à partir de cette reprise de la dette sociale il n'y aurait plus de déficit de la sécurité sociale et que la CADES disparaîtrait au bout de quinze ans. En fait, celle-ci est devenue la voiture-balai des déficits chroniques de la sécurité sociale. D'ailleurs, elle a été mobilisée pour le cantonnement de la « dette sociale covid » constatée et à venir. Fallait-il aller plus loin ? Nous avons considéré qu'un cantonnement devait être adossé à une ressource spécifique, donc à un impôt ou une cotisation sociale nouvelle. Nous considérons que cela n'apporte pas grand-chose, que la dette résultant de la covid s'ajoutera à la dette globale, et chacun sait qu'en fait on ne rembourse jamais la dette : lorsque les maturités viennent à échéance, on souscrit des titres pour le même montant – ce qu'on appelle « rouler la dette publique ».
Nous avons donc estimé qu'il n'y avait pas d'intérêt à cantonner la dette Covid, qu'elle pouvait en revanche être isolée et qu'il était nécessaire d'informer l'opinion publique. Encore faut-il se donner les moyens d'évaluer précisément ce que sera cette dette Covid. Elle peut être estimée par différence avec ce qu'aurait été la dette sans la crise exceptionnelle que nous traversons – dont la vaccination nous permettra de sortir.
Dans cette nouvelle stratégie, il convient de ne pas renouveler les erreurs du passé, c'est-à-dire de ne pas consolider trop rapidement les finances publiques – ce qui s'est passé au lendemain de la crise financière internationale de 2008 et 2009. Nous estimons que les efforts accomplis aujourd'hui doivent se poursuivre, il s'agit de maintenir le « quoi qu'il en coûte » en veillant toutefois à ce qu'il s'agisse de dépenses exceptionnelles qui disparaîtront au lendemain de la crise et à éviter d'ouvrir la voie à des dépenses structurelles qui affecteraient nos finances publiques au-delà de cette crise.
La nouvelle stratégie doit aussi tenir compte de notre impossibilité d'augmenter les prélèvements obligatoires, la France faisant déjà partie des « champions » en la matière. Ils s'élèvent ainsi à 46,5 % du PIB, contre 40,5 % dans la zone euro.
Cette piste figurait dans sa feuille de route, mais notre commission – dont la composition était très diverse, avec des économistes français et étrangers, des responsables des secteurs public et privé, ainsi que d'anciens ministres de convictions politiques différentes – a convenu que le levier de l'augmentation des prélèvements obligatoires ne réglerait pas les problèmes de nos finances publiques.
Si nous devions nous en tenir à des pratiques qui ont prévalu jusqu'à maintenant, il n'est pas douteux que nous ne parviendrions pas à mettre un terme à cette lente mais régulière progression de la dette fondée sur des déficits chroniques. La stratégie appelle donc la maîtrise dans le temps des dépenses publiques.
Notre gouvernance, trop « court-termiste », est mal adaptée pour affronter le défi de la dette. Les règles budgétaires européennes ont pratiquement fait office de règles de gouvernance budgétaires jusqu'à présent, comme si la France n'avait pas été capable d'avoir ses propres règles. L'on a pu critiquer la limitation du déficit public à trois points de produit intérieur brut (PIB), mais convenons qu'il était presque devenu un objectif, au détriment de la recherche d'un équilibre dans la durée, qui devrait être la règle ; avec un déficit à hauteur de trois points de PIB, de manière chronique, la dette publique augmente forcément. Nous avons adressé chaque année un programme de stabilité (PSTAB), toujours trop optimiste, à la Commission européenne, en application du pacte de stabilité et de croissance (PSC) de 1997 et ne l'avons jamais respecté. Cela n'a conforté ni le crédit de la France auprès de ses partenaires européens, ni son autorité.
Nos prévisions vont rarement au-delà de cinq années, quand d'autres pays membres de l'OCDE vont jusqu'à vingt ou trente ans et quelquefois bien au-delà.
Par ailleurs, nos finances publiques sont fragmentées ; nous n'avons pas d'image globale de leur situation et cette complexité nuit considérablement à leur pilotage, à leur lisibilité, à leur compréhension et à leur appropriation par l'opinion publique. Les flux financiers entre les budgets de la sécurité sociale et de l'État sont multiples, et l'on dénombre parmi eux une quarantaine de taxes affectées, ce qui ne facilite pas la lisibilité ; il faudrait revenir à l'universalité. La gestion publique territoriale, elle aussi, est éclatée, avec 93 700 gestionnaires contre 15 000 en Allemagne : cela doit nous amener à réfléchir.
Cinq lois de programmation des finances publiques (LPFP) ont été adoptées depuis 2009. Couvrant théoriquement de quatre à six années, elles ont dans la pratique une durée de deux ans en moyenne et ont été peu respectées : cette caducité précoce ne peut pas durer.
Dans le calendrier contraint de l'examen des LPFP, il faut un échange approfondi au Parlement, ainsi qu'avec les représentants des élus locaux et des organismes de protection sociale. Leur insuffisante appropriation peut contribuer à expliquer leur suivi insuffisant.
Il faut aussi une stratégie de long terme, et donc une institution budgétaire indépendante, au mandat large qui lui permette d'exercer son autorité. Nous avons observé ce qui se pratique dans la plupart des pays de l'OCDE et constatons que la France s'est dotée d'une institution, le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dont l'autorité est reconnue mais dont le champ de responsabilité est tout de même très limité. Ses homologues sont chargés de l'analyse de la soutenabilité budgétaire de long terme, de la production de prévisions budgétaires et macroéconomiques distinctes de celles du Gouvernement – aujourd'hui, le HCFP se prononce après la fixation des hypothèses par l'exécutif –, d'un soutien direct au Parlement, de l'évaluation du coût des réformes, voire, dans certains pays, des programmes des candidats aux élections, et, enfin, du contrôle du respect des règles budgétaires.
Nous pensons nécessaire de très profondément et radicalement transformer la gouvernance budgétaire et y voyons une condition de la réussite de notre stratégie de redressement des finances publiques. Cette transformation est fondée sur trois piliers.
Le premier pilier est de créer une norme de dépense pluriannuelle pour toutes administrations publiques, ainsi qu'un niveau plancher de dépenses d'avenir. Selon nous, la LPFP devrait définir à chaque début de mandat un objectif de dépenses qui concernera l'ensemble des administrations publiques : l'État, les collectivités territoriales et la sécurité sociale. Il serait décliné pour chacun de ces sous-secteurs et le respect de cette trajectoire serait suivi chaque année au moyen d'un compteur des écarts afin d'éviter que la maîtrise des dépenses se fasse au détriment de celles favorables à la croissance de demain. Le plancher de dépenses d'avenir engloberait des dépenses d'investissement, mais également de fonctionnement : nous avons eu de multiples débats, mais il existe des investissements sans effet sur l'avenir, au contraire, incontestablement, de certaines charges de fonctionnement.
La déclinaison de cette norme dans les différentes sphères publiques prendrait la forme, pour l'État, de contrats pluriannuels entre les principales directions d'administration centrale et le ministère chargé des comptes publics – sur le modèle de ceux expérimentés avec l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et la direction générale des finances publiques (DGFiP) –, de sorte qu'un directeur sache à quoi s'en tenir non seulement au cours de l'année qui vient mais aussi sur une période suffisamment longue pour entreprendre une véritable réforme de l'administration dont il a la charge, pour les administrations de sécurité sociale (ASSO), d'un élargissement du périmètre de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) au régime d'assurance chômage et aux régimes de retraite légalement obligatoires, sans toutefois modifier leurs règles de gouvernance, et, pour les collectivités territoriales – en tenant bien sûr compte de leur autonomie de gestion –, par une extension des contrats dits de Cahors, lesquels ont, semble-t-il, donné des résultats tout à fait satisfaisants.
Le deuxième pilier est d'instituer une vigie budgétaire à l'approche de long terme. Les membres de cette institution indépendante exerceraient à temps plein et seraient à la fois des experts issus de nos administrations, comme la direction générale du trésor, la Banque de France, la Banque centrale européenne (BCE) et la sécurité sociale, mais aussi des économistes. Nous suggérons qu'elle soit rattachée au Parlement, à l'image du Congressional budget office (CBO) aux États-Unis ; il y a eu de tels projets dans les années passées, mais le Parlement n'a pas encore manifesté de véritable intérêt en ce sens. Si tel n'était pas le cas, alors deux voies seraient possibles : le renforcement du HCFP ou la création de l'équivalent de l' Office for budget responsibility (OBR) britannique, avec un mode de désignation de ses dirigeants sur le modèle de celui applicable à ceux du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).
Le troisième pilier est d'accroître les prérogatives du Parlement. Au lendemain du renouvellement de l'Assemblée nationale, avant même le vote de la première loi de finances et de la première LFSS, le Parlement se mobiliserait avec le Gouvernement pour établir la LPFP couvrant la législature : dans ces conditions, il faudrait veiller à fixer le rythme de la stabilisation puis du reflux du ratio de la dette publique rapportée au PIB, en jouant donc aussi sur le paramètre de la croissance et en intégrant un plancher de dépenses d'avenir dans cet arbitrage. Sans doute une telle disposition n'est-elle pas facile. Je connais les interrogations du président Woerth sur sa faisabilité – comment trouver le temps entre une élection qui a lieu au mois de juin et un examen du projet de loi de finances (PLF) qui doit débuter au plus tard le 13 octobre pour respecter les soixante-dix jours prévus par l'article 47 de la Constitution ? – et sans doute échangerons-nous nos arguments dans un instant. Ce moment solennel en début de législature serait gage de crédibilité.
Peut-être faudrait-il aussi revoir le temps que le Parlement consacre à l'examen des PLF : sommes-nous sûrs que les cinq semaines qui y sont consacrées à l'Assemblée nationale puis les trois semaines au Sénat soient marquées par une vraie valeur ajoutée parlementaire ? N'est-ce pas plutôt un moment où les arbitrages du Premier ministre peuvent être plus ou moins contournés par voie d'amendement – certains ministres se prêtant quelquefois à ce jeu ? C'est pour cela que nous avons osé imaginer que le budget soit défendu par le seul ministre chargé des comptes publics et qu'en revanche le temps économisé soit mis à profit pour le « printemps de l'évaluation » : que les ministres chargés de la dépense publique viennent s'expliquer et, sans doute, imaginer avec la représentation nationale des réformes structurelles de nature à réduire son niveau.
Il faut aussi une conférence nationale sur les finances et la dette publiques, ainsi qu'une présentation globale et synthétique de l'ensemble des recettes comme des dépenses par nature, de telle sorte que les citoyens puissent s'approprier la situation et participer à la réflexion sur l'urgente nécessité de sa maîtrise.
Nous avons également posé le principe que, désormais, l'évolution des dépenses publiques devait être inférieure à celle des recettes publiques.
Enfin, je voudrais rappeler que nous sommes, dans la zone euro et que cette dernière a été instituée pour mettre un terme aux dévaluations compétitives qui ruinaient la croissance et entraînaient le chômage. D'ailleurs, les règles européennes ont survécu aux alternances. En 1997, était sur la table, à la veille des élections consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale, le projet du PSC. J'entends encore M. Lionel Jospin dire que, s'il devait être à la tête d'une majorité nouvelle, il ne le signerait pas en l'état. À peine celle-ci était-elle en place qu'elle le faisait sans rien y modifier, parce qu'elle avait compris que, grâce à lui et à la monnaie unique, les taux d'intérêt baissaient d'une manière considérable et que la remise en cause de ses dispositions allait entraîner une explosion de ces taux. Le même phénomène s'est produit en 2012, lorsqu'était évoqué un resserrement du PSC au moyen du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (TSCG). Je me souviens de M. François Hollande avançant que, s'il était élu Président de la République, il ne serait pas question de ratifier ce traité. Tel a pourtant été le cas car, une fois encore, la sanction eût été une hausse considérable des taux d'intérêt.
Je ne dis donc pas que les règles anciennes doivent être rétablies en l'état lorsque nous serons sortis de cette crise – elles ont été suspendues et tous les pays de la zone euro ont augmenté leurs dépenses publiques et assuré la sécurité des citoyens en tentant de prévenir l'effondrement économique et social –mais elles reviendront : la Commission européenne fera des propositions au lendemain des élections fédérales allemandes, qui auront lieu à la fin de l'année. Je ne peux pas préjuger de leur teneur, mais si, en tout cas, la France veut faire partager ses préoccupations avec ses partenaires européens, il est important qu'elle définisse d'abord ses propres règles, marquées du sceau de la responsabilité. L'Europe a joué la carte de la solidarité : j'ai dit ce que nous a apporté la BCE avec son pandemic emergency purchase programme (PEPP) en rachetant de la dette publique d'une manière aussi systématique, et il y a également ce projet d'un emprunt commun de 750 milliards d'euros, qui constitue une sorte de cantonnement européen, parmi lesquels la France bénéficiera de 40 milliards d'euros de subventions, sans doute pour des investissements dans la transition énergétique. Cependant, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de gouvernement économique, financier et budgétaire de la zone euro, ces règles reviendront : nous avons donc intérêt à définir les nôtres si nous voulons qu'elles marquent de leur empreinte les règles européennes.

Je relève beaucoup de convergences entre votre diagnostic ou vos propositions et des sujets déjà évoqués devant notre commission, à la faveur de prises de position personnelles, qui dépendent naturellement de l'opinion politique de chacun, ou en particulier avec la proposition de loi organique que le rapporteur général et moi-même allons déposer.
Vous insistez sur la pluriannualité, sans laquelle, évidemment, aucune visibilité n'est possible. Elle ne saurait être sérieuse sans mesures de contrainte claires, permettant un véritable débat sur les écarts par rapport aux engagements : nous sommes malheureusement habitués à ce que la règle soit devenue le non-respect de ces derniers.
Vous proposez des mesures en régulation de la dépense et de la dette : je préfère parler de dépenses d'investissement plutôt que de dépenses d'avenir. Il est plus facile d'exprimer ce qu'est l'investissement pour les collectivités territoriales que pour l'État, mais toutes les dépenses d'aujourd'hui pèsent sur l'avenir, alors que très peu augmentent le potentiel de croissance sur plusieurs générations.
Je partage votre opinion quant au « printemps de l'évaluation ».
Pourquoi pas, évidemment, une extension du champ de la LFSS ? Nos collègues de la commission des affaires sociales y réfléchissent...
Quant à la création d'une institution budgétaire indépendante, j'ai davantage de réserves. Il suffit, au fond, de modifier les modalités d'intervention de la Cour des comptes et du HCFP.
La proposition de décaler le calendrier d'examen du projet de loi de finances lors de la première année de la prochaine législature m'intrigue. Pourquoi pas, mais comment respecter alors les délais constitutionnels d'adoption de la loi de finances initiale ?

Les travaux de la commission recoupent en partie ceux de la mission d'information relative à la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances (MILOLF), dont une partie des conclusions nourriront les dispositions de la proposition de loi organique que nous allons déposer.
Je souscris particulièrement à vos propos sur la nécessité d'inverser les volumes de temps consacrés respectivement à l'autorisation et à l'évaluation budgétaires. Cette question relève toutefois de dispositions constitutionnelles – nous avons tenté, sans succès, de les modifier à l'été 2018, mais il faudra y revenir lors d'une prochaine législature.
L'une des principales qualités de votre rapport est de démontrer qu'en France nous ne définissons pas suffisamment les trajectoires d'évolution des finances publiques. Par ailleurs, quand bien même nous adoptons des lois de programmation des finances publiques, nous ne parvenons pas à respecter les trajectoires que nous nous fixons. Je souscris à une grande partie des propositions d'outils institutionnels que vous faites. Je crois également que nous pouvons tous nous entendre sur la nécessité de maîtriser notre endettement. Ce sont ensuite les voies et moyens qui peuvent faire l'objet de discussions et de propositions divergentes.
Le président Éric Woerth et moi-même proposons de définir des objectifs pluriannuels de dépenses en valeur, par sous-secteur d'administration publique, en tenant compte le cas échéant des mesures nouvelles en recettes. Estimez-vous que ces modalités de calcul sont pertinentes ? Quelles sont selon vous les conditions nécessaires au renforcement du caractère contraignant des lois de programmation ?
Comme le président Woerth, je préfère la notion de « dépenses d'investissement » à celle de « dépenses d'avenir ». Comment trouver un consensus sur la détermination du plancher de dépenses à fixer en début de législature, et comment pouvons-nous définir une règle de différenciation entre les dépenses relevant du fonctionnement et de l'investissement ?
Je ne suis pas opposé à la création d'une institution budgétaire indépendante. La question est de savoir comment la culture de l'évaluation peut en premier lieu être davantage développée au sein du Parlement.
Enfin, je suis favorable à l'élargissement du domaine des lois de financement de la sécurité sociale, qui renforcerait le rôle du Parlement, mais pas à une remise en cause du paritarisme comme pilier de la gouvernance des finances sociales. Quel chemin permettrait d'articuler ces deux éléments ?

Des réformes ont été engagées avant la crise sanitaire et doivent, selon moi, être préservées. Par exemple, la réforme engagée en 2019 par la direction générale des finances publiques vise à modifier son réseau de proximité, à rapprocher les agents des citoyens et à renforcer son rôle de conseil auprès des exécutifs et organes délibérants des collectivités locales.
Concernant plus spécifiquement les conclusions formulées dans le cadre de votre rapport, quelle est la méthode la plus efficace pour conduire une transformation radicale de la gouvernance des finances publiques ? Je suis également favorable à l'organisation d'un débat parlementaire en début de législature permettant de définir une vision à long terme des finances publiques. La mise en œuvre de cette préconisation dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2023 vous semble-t-elle réaliste ?

Je tiens à signaler que le non-respect des trajectoires d'évolution des finances publiques ainsi que des dispositions du pacte de stabilité et de croissance (PSC) constitue désormais un non-évènement –selon moi, c'est extrêmement grave.
Quelle est votre analyse sur le niveau du déficit structurel et du déficit conjoncturel en France ? Et estimez-vous qu'engager une réforme des retraites est obligatoire pour envisager une diminution des dépenses publiques ?
Vous proposez de définir un nouveau contrat pluriannuel avec les collectivités locales, au moyen d'une extension des contrats de Cahors. Néanmoins de nombreuses collectivités ont perdu en autonomie, et ne peuvent investir qu'au moyen de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) ou de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR). Votre proposition n'entraînerait-elle pas la fin de la libre administration des collectivités territoriales ?

Je tiens à souligner que les Français s'intéressent à la question de la maîtrise des finances publiques, et plus que nous ne l'imaginons.
J'estime qu'il manque à votre rapport un axe portant sur la déconcentration et la décentralisation, dont l'analyse est nécessaire pour apprécier la pertinence de la dépense publique. Il conviendrait également d'approfondir l'analyse sur le paritarisme et, plus largement, les finances sociales, afin de formuler davantage de propositions concernant la gouvernance de ces dernières.
Je suis également favorable à la proposition de notre collègue Laurent Saint-Martin concernant la prise en compte des prélèvements obligatoires pour analyser l'évolution de la dépense. Quelle est votre position à cet égard ?

Je regrette que le débat portant sur l'avenir des finances publiques ait été « cadenassé » par la lettre de cadrage que vous a adressée le Premier ministre. La possibilité d'instaurer une contribution exceptionnelle n'a ainsi pas été abordée. D'un point de vue formel, si la commission que vous présidez est paritaire, seules quatorze des cent deux auditionnés sont des femmes, ce qui est révélateur des inégalités persistantes dans l'ensemble des secteurs que vous avez pu solliciter – vous n'y êtes, certes, pour rien.
J'ai par ailleurs été déçue par les propositions du rapport. Je regrette que le sujet de l'annulation de la dette, ou de sa transformation en dette perpétuelle, ait été écarté ; dette et monnaie ne sont que des outils techniques au service d'objectifs politiques. Je rappelle que si le franchissement du seuil d'une dette représentant 100 % du produit intérieur brut (PIB) a été agité comme un chiffon rouge pendant de nombreuses années, nous constatons aujourd'hui un niveau de 120 % de dette par rapport au PIB sans que le pays se soit effondré. Le rapport fait l'impasse sur les moyens d'augmenter le niveau de la croissance et se concentre sur le niveau de dépenses publiques, sans tirer les leçons de la crise de 2008. Les États-Unis étaient à cette époque, grâce à une relance budgétaire substantielle, parvenus à sortir bien plus rapidement de la crise, et ont bénéficié sur la dernière décennie d'un taux de croissance cumulé bien supérieur à celui de l'Europe. J'estime que le rôle de la France pourrait être de proposer une relance similaire en Europe, axée sur des secteurs stratégiques : la souveraineté alimentaire, le climat ou encore la santé.
Le rapport se conclut par le souhait – non explicitement formulé – d'un retour à l'austérité budgétaire… tout en demeurant par ailleurs muet sur la nature des dépenses qu'il conviendrait de réduire. Nous ne préconisons évidemment pas cette voie.
Devons-nous donc nous focaliser sur la dette, alors que nous sommes en train de manquer la relance ? Et estimez-vous, à l'instar de Jean Pisani-Ferry, que la réforme de l'assurance chômage doit être abandonnée ?

Je souscris à vos propositions, portant notamment sur le renforcement de la pluriannualité des finances publiques et l'opportunité de déterminer un plancher de dépenses d'avenir. La mise en œuvre de ces mesures, outre le fait de doter l'État d'une stratégie de moyen terme plus robuste, permettrait à nos concitoyens de mieux appréhender la manière dont sont mobilisés les deniers publics.
Vous indiquez qu'une part supérieure à 50 % de la dette française est détenue par des non-résidents. Cela constitue-t-il un risque pour notre souveraineté, et serait-il possible d'imaginer un système favorisant l'acquisition d'obligations souveraines françaises par les résidents français ?

Je vous fais part, de manière courtoise, de mon profond désaccord avec les conclusions de votre rapport. Vous écrivez, monsieur le président Arthuis, que les dépenses devront, dans les années à venir, augmenter moins vite que les recettes. Cela signifie que pour résorber la « dette covid », il faudra être à l'équilibre budgétaire, ou en excédent. Or vous écartez toute hausse de recettes fiscales et considérez donc qu'il faudra réduire nos dépenses publiques, ce qui est la définition même de l'austérité – même si vous récusez ce terme.
Nous avons pourtant d'autres solutions : vous indiquez dans votre rapport que la dette covid de la France est détenue à 80 % par la BCE ou les banques centrales nationales ; la banque de France en possède ainsi 400 milliards d'euros. Cette dette n'est plus détenue par les marchés mais par nous-mêmes. Il n'y aura donc pas de défaut sur les marchés si nous annulons cette dette. Vous dites qu'il y a des risques que nous ne touchions pas nos propres dividendes : je ne pense pas que ce risque soit plus grave que celui de connaître des années d'austérité.
Vous parlez également des risques d'inflation mais ce risque est très incertain. Vous vous fondez sur la hausse de l'inflation aux États-Unis mais je vous rappelle que le plan de relance de Joe Biden, d'un montant de 1 900 milliards de dollars, est près de trois fois supérieur à celui de l'Union européenne. Si 1 % d'inflation correspond à 30 milliards d'euros de charge de la dette en plus, est-ce que ces 30 milliards valent des années d'austérité ?
Enfin, vous parlez d'une menace sur la crédibilité de l'euro, sans apporter de preuve.
Je relève donc que nous avons, d'un côté, concernant l'annulation de la dette, des risques, des « si » et, de l'autre, des certitudes sur la baisse des dépenses publiques. C'est cette baisse des dépenses publiques, notamment des dépenses de l'hôpital public ou des services publics, qui explique aussi que nous avons tant de mal à répondre à la crise actuelle.
Vous écartez également la dette perpétuelle. Or elle existe déjà, puisque nous ne remboursons que les intérêts de notre dette, jamais le capital. Nous parlons souvent du remboursement de la dette pour imposer des réformes structurelles telles que la réforme des retraites ou des allocations-chômage.
Enfin, je suis très inquiet de la proposition que vous faites concernant la mise en place d'une norme de dépenses pluriannuelles supervisée par le Haut Conseil des finances publiques, qui je le rappelle, est une émanation du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG). Notre souveraineté est déjà corsetée par la règle d'or européenne et vous estimez qu'il faudrait une règle d'or supplémentaire, qui reléguerait le Parlement à un rôle de contrôle. J'ajoute par ailleurs que je suis très inquiet à propos de la proposition de loi organique visant à modifier la LOLF qui sera déposée prochainement. Je crains qu'elle ne reprenne une partie de vos propositions.

Le constat auquel vous êtes arrivé était attendu : il y a trop de dépenses publiques et c'est sur ce levier qu'il faut agir. Je regrette toutefois que ce constat ne soit pas étayé puisque le rapport ne fait que compiler, sans grande analyse, des comparaisons entre pays. J'ai également trouvé que les différentes alternatives – l'annulation des dettes, l'allongement des maturités ou le financement direct auprès de la BCE – étaient balayées assez rapidement, ce qui n'est finalement pas très convaincant. Votre préconisation selon laquelle les dépenses doivent croître moins vite que leur rythme tendanciel est finalement symptomatique d'une approche purement néolibérale.
Toutes vos propositions se fondent sur une approche budgétaire, et vous négligez totalement les aspects économiques et politiques. La preuve en est que vous considérez que la politique budgétaire que vous recommandez n'aura pas d'impact sur la situation économique, alors que la baisse de la dépense publique a des conséquences sur la situation économique. Les politiques budgétaires ne sont pas neutres.
Je suis moi aussi très dubitatif sur la loi pluriannuelle.
Réduire la dépense n'est pas neutre : il y a des gagnants et des perdants. Il faudra qu'un jour les adeptes de la baisse des dépenses publiques nous disent clairement et précisément quelles dépenses ils souhaitent réduire : faut-il, par exemple, encore contraindre les dépenses de santé ? Les préconisations de ce rapport sont dans la droite ligne de l'approche libérale des dernières années, qui n'a jamais marché et pourrait être dangereuse dans la période actuelle.
Je pense que ce rapport est très incomplet, sur la question des recettes supplémentaires qui pourraient être mobilisées aujourd'hui. Par exemple, pourquoi écartez-vous toute contribution exceptionnelle des grosses entreprises distribuant des dividendes puisque certaines se sont nourries de cette crise ?

Votre rapport pose de bonnes questions : comment cela a-t-il été possible de trouver de l'argent public en contexte de crise ? Quelle est notre capacité à nous endetter ? Notre dette est-elle soutenable à moyen et long terme lorsque nous sommes endettés à 115 % du PIB ? La France connaît déjà un niveau élevé de prélèvements obligatoires, entre 48 % et 49 % du PIB, il semble donc peu probable que nous puissions nous financer en augmentant les impôts. L'État peut couper dans les dépenses publiques mais on ne peut ignorer que certains secteurs comme la santé sont en manque de personnel. Quelles sont vos pistes de réflexion pour rendre notre dette soutenable et quelles sont les solutions éventuelles qui vous sembleraient pertinentes ?
J'ai bien noté que vous étiez pour un retour à l'universalité budgétaire de façon rigoureuse – ce n'est pas mon avis sur le sujet des transports.
J'ai également bien noté votre proposition de transformer la gouvernance de nos finances publiques avec la création d'une vigie budgétaire. Je pense que la commission des finances a aujourd'hui suffisamment de moyens. J'aimerais plus de précisions sur cette vigie, notamment sur sa composition.

J'ai plusieurs questions qui concernent votre proposition de création d'une vigie budgétaire. Pensez-vous qu'il faille séparer le Haut Conseil des finances publiques de la Cour des comptes dont il utilise les locaux et les équipes, équipes dont le nombre a doublé en passant de trois à six avec la loi de finances pour 2021 ? Quel type de profils composant cette vigie budgétaire envisagez-vous ?
Vous préconisez également un élargissement des missions du Haut Conseil aux types de missions qu'exercent des institutions similaires des pays de l'OCDE mais pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez inclus des missions supplémentaires, plus rarement exercées par les institutions budgétaires indépendantes, telles que le soutien direct au Parlement pour l'analyse budgétaire, l'évaluation du coût des réformes ou la production de prévisions alternatives ?
Sur un autre sujet, vous concluez dans votre rapport que la hausse continue de la dette est intenable car elle expose la France au risque d'une remontée des taux d'intérêt. Plutôt que d'en conclure qu'il faut diminuer le taux d'endettement en faisant croître les dépenses moins vite que les recettes, ne peut-on pas envisager qu'il faudrait apprécier la hausse de l'endettement au regard de l'évolution anticipée des taux d'intérêt et de l'inflation ? L'exemple de l'Italie qui dégage un excédent primaire depuis vingt ans mais augmente son niveau endettement à cause de la hausse de la charge de sa dette ne suggère-t-il pas qu'il faut se fixer des objectifs en fonction du coût de l'endettement plutôt de se concentrer sur l'excédent primaire ?

Vos conclusions ne sont pas surprenantes. Contrairement à ce que le Gouvernement laisse penser, il s'agit ici d'un sujet éminemment politique et non technique. Si vous vous opposez au cantonnement de la dette, pour des raisons divergentes des miennes, je rappelle que c'est cette solution qui a été partiellement retenue au mois de juillet dernier en faisant peser 150 milliards d'euros de dette covid sur le contribuable par le biais de la prorogation de la contribution au remboursement de la dette sociale.
Je souhaite alerter mes collègues sur votre recommandation de confier la fixation de la norme de dépenses à une institution extérieure au Parlement, qui est antinomique avec votre volonté annoncée de renforcer les pouvoirs du Parlement ; elle me paraît même contraire à notre Constitution. À l'instar du président Éric Woerth, je considère que les prérogatives du Haut Conseil et de la Cour des comptes peuvent être renforcées mais en aucun cas dépasser les pouvoirs du Parlement.
J'ai entendu que vous souhaitiez baisser la dépense publique, un vœu difficile à réaliser en période de crise sociale. J'ai compris – tout le monde l'a compris – que vous étiez opposé à toute hausse de la fiscalité mais j'aimerais avoir votre avis sur la problématique des niches fiscales, qui échappent à tout pilotage budgétaire, notamment sur celle, énorme, que constitue l'absence de fiscalité sur les produits financiers des grandes entreprises.

Nous sommes nombreux à approuver les mesures techniques que vous proposez. Nous devons cependant revenir sur les défis qui vont se poser à nos finances publiques, notamment le financement des dépenses sociales qui sont amenées à s'accroître structurellement du fait du vieillissement de la population. Quelles sont vos propositions pour encadrer ces dépenses, sans diminuer le pouvoir d'achat ? De la même manière, les dépenses environnementales sont structurellement à la hausse. Comment équilibrer notre solde budgétaire alors que ces facteurs sont sources de nouvelles dépenses considérables et difficilement maîtrisables ? La réforme du Haut Conseil des finances publiques et la revue des lois de programmation ne vous semblent-elles pas insuffisantes pour répondre à ces enjeux ?

Votre rapport préconise de créer une institution budgétaire indépendante dont le rôle serait de procéder à des projections budgétaires à long terme et de porter une appréciation sur la soutenabilité des projets du Gouvernement ou du Parlement. Quelle serait la plus-value de cette nouvelle institution par rapport au Haut Conseil des finances publiques et par rapport au Parlement, instance de contrôle de l'action publique ?
Notre action pour stabiliser la dette doit s'inscrire dans un cadre européen : la crise causée par la pandémie a contraint les institutions européennes à soutenir l'endettement massif des États membres, d'une façon inédite en temps de paix. Comment envisagez-vous l'évolution des règles européennes pour accompagner cette stabilisation ?

Pour certains, les choses sont faciles, il suffit de décider d'un prélèvement spécifique pour gérer la dette. J'aimerais avoir votre avis concernant la disproportion entre le rendement susceptible de provenir de nouvelles taxes et le volume de la dette.

Notre dette est détenue à plus de 50 % par des investisseurs étrangers. La question de la souveraineté de notre dette ne mérite-t-elle pas un débat plus transparent ? Pouvez-vous nous préciser qui sont les détenteurs de cette dette ?
D'un point de vue général, je souhaite préciser que l'assiduité des membres de notre commission a été extraordinaire. La diversité de la composition de notre commission et notre lettre de mission nous interdisaient d'interférer dans le champ politique. Nous avons voulu rester dans un champ méthodologique procédural que pourrait s'approprier tout parti politique ou majorité qui aurait à exercer des responsabilités budgétaires. Nous nous sommes donc interdit d'indiquer les réformes politiques à mener.
Quand on parle de gouvernance budgétaire, on parle de gouvernance en général. Plusieurs d'entre vous m'ont interrogé sur les dépenses de santé. Croyez-vous que l'amélioration du système de santé et son efficacité dépendent exclusivement de crédits budgétaires ? Je préside encore le conseil de surveillance de l'hôpital de Château-Gontier, ville dont j'ai été maire pendant trente ans, et il m'arrive de penser qu'il existe des marges de progression dans la gouvernance des hôpitaux. Ne faudrait-il pas une meilleure coordination, au niveau d'un territoire, entre la médecine de ville – ou de campagne – et les hôpitaux publics ? Il s'agit d'un sujet de gouvernance en général, les solutions ne sont pas uniquement budgétaires. Cela vaut aussi pour les dépenses d'éducation. Ce sont des dépenses d'avenir, mais cela ne veut pas dire qu'on pourrait améliorer la qualité de l'enseignement uniquement en prévoyant quelques milliards d'euros supplémentaires. Le budget ne règle pas tout.
Le budget et la dette publique sont des éléments de souveraineté. Croyez-vous qu'un État endetté soit complètement souverain ? C'est peut-être le cas lorsqu'il s'agit de la Chine ou des États-Unis d'Amérique, mais souvenons-nous de ce qui s'est passé en Grèce en juin 2015. Le Premier ministre grec, M. Alexis Tsipras, refusait le protocole que lui soumettaient ses créanciers, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Il a organisé un référendum pour en appeler au peuple grec, qui lui a donné raison. Pourtant, en dépit du fait que le résultat du référendum lui demandait de ne pas ratifier le protocole, il a été contraint de s'y résoudre huit jours plus tard. Le surendettement d'un État l'expose à être dépendant de ses créanciers. Il est vrai que certains États sont en capacité d'engager des programmes de relance budgétaires conséquents – on le voit aujourd'hui aux États-Unis –, mais c'est plus facile lorsque le niveau d'endettement public est inférieur à 40 % du produit intérieur brut. Dans les moments de crise, on peut en effet injecter de l'argent public pour relancer l'économie, mais à un niveau d'endettement public, de dépense publique et de prélèvements obligatoires comparables à ceux de la France aujourd'hui, les marges de manœuvre sont extrêmement étroites. Si nous voulons retrouver de l'agilité, il est impératif de mieux maîtriser la dépense publique.
Vous m'avez interrogé sur les dépenses d'avenir. Au sein de la commission, le débat est resté ouvert. La position exprimée par le président Woerth et le rapporteur général Saint‑Martin est que qu'il s'agit plutôt de dépenses d'investissement. Il est vrai que, lors du lancement du premier programme d'investissements d'avenir, auquel on avait demandé à deux anciens premiers ministres de travailler, on s'était rendu compte qu'il était souvent plus facile de réduire les investissements que les dépenses de fonctionnement, pour lesquelles on continuait à emprunter. Il faudra donc trouver un mode opératoire. Le plus lisible est incontestablement l'investissement, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a ici aussi des dépenses de fonctionnement, même dans la formation professionnelle ou la recherche. Peut‑être la recherche devrait-elle apparaître comme de l'investissement ? C'est une option.
La commission ne prône pas l'austérité. Est-ce que rechercher l'équilibre des finances publiques, c'est de l'austérité ? Est-ce que de la bonne gestion publique, c'est augmenter systématiquement le déficit public et emprunter toujours plus pour financer des dépenses de fonctionnement ?
On s'est beaucoup interrogé sur le chiffre mystérieux d'un déficit public limité à 3 % du produit intérieur brut. Dans les années 1990, au moment où nous préparions le pacte de stabilité et de croissance, conséquence du traité de Maastricht ratifié par le peuple français, le chiffre de 3 % avait été avancé pour signifier que si la dette publique représentait 60 % du produit intérieur brut, la charge de la dette avec un taux d'intérêt de 5 % était de 3 % du budget. Par conséquent, en limitant le déficit public à 3 %, le budget devait s'équilibrer en dépenses primaires.
Vous vous interrogez aussi sur la possibilité d'une annulation des dettes publiques détenues par la Banque centrale européenne. En effet, pourquoi ne pas considérer que toutes les créances détenues par la banque centrale au titre de la « dette covid » pourraient être annulées ? Il s'agit d'un sujet européen. Il est inimaginable que la Banque centrale européenne procède à une telle annulation sans l'accord de l'ensemble des membres de l'Eurogroupe, et je doute fort que la question fasse l'unanimité. Cette voie ne nous paraît pas réaliste.
Nous avons fait des propositions qui relèvent de la loi organique. Il s'agirait notamment de se doter d'un objectif pluriannuel en dépenses, pour constituer une boussole de nos finances publiques. Nous proposons aussi d'organiser la préparation du cadre pluriannuel des finances publiques en début de législature. Il s'agit d'un sujet délicat ; toutefois, lorsque le Parlement vote le premier projet de loi de finances d'une législature, celui qui suit l'élection, il est préférable de le voter avec une vision pluriannuelle. Ainsi, on pourrait voter de manière concomitante le projet de loi de programmation pluriannuelle et le premier projet de loi de finances de la législature. Il pourrait en être de même pour le premier projet de loi de financement de la sécurité sociale de la législature.
Cela n'est pas simple. Cela suppose un important travail aux mois de juillet, août et septembre. Il faut sortir de la confusion qui, parfois, imprègne ces premiers mois d'une législature pour mettre de la méthode et se projeter dans l'avenir. Y aurait-il un inconvénient à ce que les députés nouvellement élus s'imprègnent pendant quelques semaines des questions budgétaires ? À l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que tous les députés y soient bien préparés.
Lorsqu'on parle d'améliorer la gouvernance, il faut aussi s'intéresser à la gouvernance du Parlement. Il n'est pas certain que la hausse du nombre d'amendements examinés par le Parlement s'accompagne d'une réelle valeur ajoutée. S'agissant des finances publiques, il faudrait rationaliser notre démarche. Nous sommes toujours vertueux lorsqu'on parle de finances publiques, mais terriblement dépensiers lorsqu'on parle de politiques sectorielles. Parfois, il m'arrive de penser que même les ministres demandent à des députés de déposer des amendements qui remettent en cause les arbitrages budgétaires décidés par le Gouvernement.
Nous avons tous les moyens pour que les choses évoluent, mais rien ne change. On n'y arrive pas. De temps en temps, on donne un coup de rabot, mais il s'agit d'un instrument redoutable et parfois dangereux, un instrument arbitraire – et, en général, les coups de rabot ne tiennent pas dans la durée : dès l'année suivante, on revient ce qui a été fait. C'est une révolution culturelle que nous appelons de nos vœux.
Concernant la vigie que nous appelons à mettre en place, c'est-à-dire un observateur extérieur qui tire la sonnette d'alarme, nous pensons qu'il ne s'agit pas ici du rôle de la Cour des comptes. Dans la plupart des pays de l'OCDE, il y a une distinction entre les auditeurs – ce qu'est la Cour des comptes, qui audite a posteriori les exécutions budgétaires – et les organismes qui évaluent ex ante et font des prévisions sur le très long terme avec des économistes. Aujourd'hui, dans l'opinion publique, le Haut Conseil des finances publiques est trop souvent confondu avec la Cour des comptes, puisque le président du Haut Conseil est le premier président de la Cour des comptes. Or le Haut Conseil est et doit être une institution indépendante.
Donner un rôle plus important au Haut Conseil des finances publiques ne signifie pas nécessairement accroître considérablement ses dépenses. L' Office for budget responsibility britannique, créé en 2010, fonctionne avec trente personnes à temps plein, et son autorité est considérable auprès de l'opinion publique, du Gouvernement et du Parlement. C'est le modèle qui nous a le plus impressionnés. Quant au Congressional budget office (CBO) américain, il est rattaché au Congrès, et lui aussi est bien différent de la Cour des comptes française. En outre, il y a, en France, beaucoup d'organismes qui font de l'évaluation et de la prévision. Ne faudrait-il pas mettre un peu d'ordre dans tous ces organismes ? Il faut éviter la fragmentation qui nuit à la clarté des messages qu'on essaye de transmettre à l'opinion publique.
Faudrait-il instaurer une règle d'or qui s'imposerait aux lois de finances ? Cela nécessiterait une réforme constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, lorsqu'il constaterait que le Parlement a voté une loi de finances non conforme à la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques, censurerait le budget. Sur ce point, notre commission estime qu'il serait difficile de faire aboutir une telle réforme constitutionnelle, qui suppose de faire adopter un texte en des termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat. Un vote identique avait eu lieu à la suite du rapport Réaliser l'objectif constitutionnel d'équilibre des finances publiques remis par le groupe de travail présidé par Michel Camdessus en 2010, mais le président de la République avait estimé qu'il n'y aurait pas de majorité des trois cinquièmes au Congrès.
De surcroît, il serait dangereux d'instaurer une règle d'or absolue. J'ai peur que, dans le contexte mondialisé, la crise ne devienne la norme. Or, dans les situations exceptionnelles, il doit être possible de desserrer l'étau des règles budgétaires. C'est ce qui s'est passé en Allemagne, où les règles de rigueur budgétaire ont été suspendues en raison de la gravité de la crise de la covid. Nous n'avons donc pas prévu ce dispositif. C'est le Parlement lui-même qui doit être chargé du respect de ses engagements et veiller à l'équilibre.
Ce n'est pas si évident, mais un acte solennel en début de législature pourrait aider à la maîtrise des finances publiques. Le Parlement gagnerait à ce qu'une vigie indépendante, comme je l'évoquais précédemment, évalue de manière indépendante la situation des finances publiques pour lui permettre de procéder aux arbitrages nécessaires, pour dégager des économies dans certains domaines et trouver les moyens de respecter les engagements pris en début de législature. Cela éviterait les propositions qui semblent procéder d'un concours Lépine de l'innovation politique, sans souci des conséquences budgétaires.
Cette vigie, il ne faut pas en redouter les conséquences. Toutefois, je le répète, elle ne peut être la Cour des comptes, qui fait de l'audit. L'évaluation des finances publiques, c'est le Haut Conseil des finances publiques. Nous avons proposé plusieurs formules. La première consisterait à le rattacher au Parlement, comme le CBO. La deuxième consisterait à accroître ses missions. La troisième, plus novatrice, serait d'en faire une instance indépendante, avec un processus de nomination comparable à celui du Conseil constitutionnel ou celui du Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est à vous qu'il appartient de trancher entre ces trois options.
Vous avez évoqué la décentralisation et la déconcentration. La commission ne s'est pas penchée sur ces points. Toutefois, n'y a-t-il pas aujourd'hui un excès de centralisme, une « sur-administration » et un « sur-contrôle », qui entraînent un climat de défiance à tous les étages ? Il faut responsabiliser les acteurs au plus près du terrain. Par exemple, peut-être pourrait-on éviter de définir un protocole de vaccination en soixante pages ? Il faudrait aller vers des formes de délégation plus larges et de responsabilisation des acteurs locaux.
Nous n'avons pas voulu interférer sur la nature des réformes. Nous avons simplement souligné que c'est en matière sociale que la dépense publique de notre pays atteint les niveaux les plus élevés. Quand on parle des dépenses sociales, on inclut nécessairement les retraites. Les retraites font partie des domaines sur lesquels il va falloir que le Parlement se penche pour peut-être trouver des économies et mieux maîtriser la trajectoire des finances publiques. Nos propositions, notamment celles qui relèvent de la loi organique, rejoignent très largement les propositions du président Woerth et du rapporteur général Saint‑Martin. Sur ces voies, je pense qu'il y a une assez large convergence.
Quant à ceux qui nous soupçonnent de prôner l'austérité, je le répète, équilibrer les comptes publics, ce n'est pas de l'austérité, c'est simplement de la responsabilité. Il n'existe pas de politique durable qui se finance exclusivement par la dette. On peut recourir à la dette pour financer des dépenses exceptionnelles, qui ne sont pas des dépenses courantes. Encore faut-il être capable de maîtriser cette dette pour ne pas être entre les mains des créanciers. On peut, certes, citer le cas du Japon, mais la dette publique japonaise est détenue à plus de 90 % par les Japonais eux‑mêmes. Peut-être nos concitoyens pourraient-ils participer davantage au financement de la dette publique ? Ils le font déjà largement, notamment à travers l'assurance-vie, qui privilégie les titres de dette publique.
S'agissant des prélèvements obligatoires, il n'est pas question de les augmenter et d'accroître encore le pourcentage qu'ils représentent par rapport au produit intérieur brut. Toutefois, on peut imaginer, à l'intérieur des prélèvements obligatoires, des mutations. Par exemple, si on baisse un impôt de production, il faut en parallèle augmenter un autre impôt, sur le revenu, le patrimoine, la consommation ou d'autres ressources. Désormais, toute baisse d'impôt doit s'accompagner d'une compensation par des recettes de substitution. Le jour où nous aurons pu réduire la dette publique de manière significative, peut-être pourrons-nous procéder à de réelles baisses d'impôt.
J'ajoute que les baisses d'impôts intervenues ces dernières années étaient des baisses d'impôts locaux, qu'il a fallu compenser par des ressources de l'État, et qui étaient peut-être en contradiction avec les principes de décentralisation et de libre administration des collectivités territoriales. Il est vrai que les collectivités territoriales prennent leur part dans les dépenses publiques. Plus de 70 % de l'investissement public vient des collectivités, mais l'État peut, par ses subventions et par le contrat, orienter la destination des investissements et des opérations engagées par les collectivités.

Merci beaucoup pour ces propos très engageants, qui entrent en résonance avec beaucoup des préoccupations des membres de la commission des finances mais aussi, plus largement, du monde politique.
Un mot encore, sur la détention des dettes publiques, par des fonds d'investissement, largement, mais aussi par des banques centrales étrangères. Avec le franc, la monnaie serait à la merci de dévaluations. Les investisseurs étrangers n'accepteraient de financer les dettes publiques qu'avec des taux d'intérêt qui constitueraient pour eux des primes d'assurance considérables.

Il y a au moins une diversification des propriétaires de la dette française.
À propos de votre allusion à la formation budgétaire des députés, la commission des finances avait organisé un cycle de formation des commissaires en début de législature, également ouvert aux membres des autres commissions. Il est vrai que c'est un sujet en tant que tel.
En termes de gouvernance, je sais, en tant qu'ancien membre du Parlement européen, que des progrès considérables ont été accomplis, notamment à l'Assemblée nationale. Je crois néanmoins que nous restons prisonniers de procédures terriblement conservatrices, à l'instar du clivage entre la commission des affaires sociales pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale et la commission des finances pour le projet de loi de finances. Il serait bon de donner l'exemple en soutenant une réforme permettant d'améliorer la valeur ajoutée des travaux des députés. Dans la sphère publique, les marges de progression sont considérables – c'est là la marque de mon optimisme

Voilà, en effet, une parole de conclusion optimiste que je partage. Merci, cher Jean Arthuis, pour cette audition passionnante, même si certains ne s'y retrouveront pas.
Information relative à la commission
La commission a désigné Mme Mathilde Panot rapporteure sur la proposition de loi visant à l'instauration d'une taxe sur les profiteurs de crise (n° 4020).