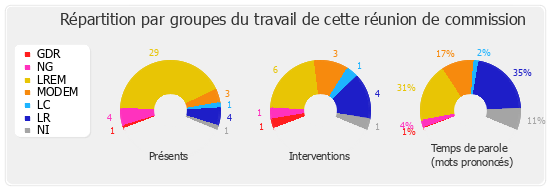Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du mercredi 20 septembre 2017 à 11h05
La réunion
La commission entend M. Anthony Requin, directeur général de l'Agence France Trésor.

Sera sans doute soulevée, lors de l'examen du projet de loi de finances et des débats portant sur les finances de l'État, la question du financement de sa dette, financement que l'Agence France Trésor est chargée d'organiser. Il me semblait donc utile que nous entendions son directeur général, afin qu'il nous expose le mode de fonctionnement de l'agence, à l'heure où nous sommes confrontés à des enjeux très importants.
Je suis très honoré d'être présent parmi vous aujourd'hui pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur la manière dont la dette de l'État français est gérée. Auparavant, je me propose de vous présenter l'Agence France Trésor et la manière dont le marché de la dette négociable de l'État est structuré et organisé.
La dette publique, au sens du traité de Maastricht, se compose de la dette de l'État proprement dite, de celle des administrations de sécurité sociale, de celle des autres administrations centrales et de celle des administrations locales. L'Agence France Trésor ne s'occupe que de la dette de l'État central et, plus particulièrement, de sa dette négociable, c'est-à-dire celle qui s'échange sur les marchés. Cette dette, qui est passée d'environ 950 milliards d'euros en 2007 à 1 710 milliards en 2016, représente 80 % du total. Cette relative centralisation ne se retrouve pas dans tous les pays de la zone euro : en Allemagne, par exemple, la dette de l'État fédéral ne représente que 50 % de la dette publique.

La dette de l'État, qui s'élevait à 1 683 milliards à la fin juillet 2017, a trois composantes : des obligations à moyen et long terme – c'est-à-dire des titres d'une maturité résiduelle supérieure à deux ans et qui peut aller jusqu'à cinquante ans –, pour un montant de 1 338 milliards d'euros, soit environ 80 % de la dette négociable de l'État ; des obligations indexées sur l'inflation française et européenne, pour environ 200 milliards, soit un peu plus de 11 % du total ; enfin, des bons du Trésor à court terme, d'une durée comprise entre trois et douze mois, pour un montant de 150 milliards, soit un peu moins de 10 % du total.

Le profil de remboursement de la dette, année après année – car nous réémettons chaque année – est détaillé dans le graphique ci-dessous.
La maturité moyenne de la dette française est de 7,5 années.
L'Agence France Trésor (AFT), chargée de gérer cette dette négociable, n'est pas dotée de la personnalité morale ; nous agissons pour le compte de l'État. C'est un service à compétence nationale, rattaché auprès de la direction générale du Trésor, et donc du ministre de l'économie et des finances. L'AFT est une petite structure : elle comprend quarante personnes, plutôt jeunes et aux profils variables – fonctionnaires, contractuels du secteur privé... –, organisées en trois cellules opérationnelles et six cellules support.
La mission de l'Agence est double puisqu'elle consiste, d'une part, à gérer la trésorerie de l'État et, d'autre part, à émettre et à gérer sa dette. Comme son nom l'indique, sa fonction première est de gérer les flux de trésorerie, en encaissements et en décaissements. Elle doit garantir que l'État est en mesure d'honorer, en tout lieu et à tout moment, sa signature et les engagements qu'il a pris au cours du temps. La mission de gestion de la dette, quant à elle, s'est développée plus tardivement, lorsqu'il est apparu que les recettes encaissées ne suffisaient pas à financer l'ensemble des dépenses et des engagements. Mais c'est celle qui, en raison de l'accumulation des déficits sur plus de trente années, est devenue prépondérante et qui est la plus connue du grand public.
Pour accomplir cette double mission, l'Agence est placée, au sein de Bercy, à la confluence de tout un réseau d'information auprès des différentes directions, ce qui lui permet, d'une part, d'effectuer des prévisions de trésorerie glissantes sur douze mois et, d'autre part, de recueillir des informations sur le contexte macroéconomique, les réformes et la politique budgétaire, afin de répondre aux questions que les investisseurs acheteurs peuvent nous poser sur la situation de la France et de sa dette.
L'AFT est très contrôlée. Elle est en effet soumise, tout d'abord, à un contrôle interne, qui s'inspire de l'organisation qui prévaut en la matière au sein des établissements de crédit et qui est confiée à une cellule spécifique. Ce contrôle interne est en outre exercé, du fait de la dichotomie ordonnateur-comptable, par le comptable budgétaire ministériel. Mais l'Agence est également soumise à toute une série de contrôles externes : ceux de la Cour des comptes, dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l'État – revue intermédiaire et revue finale – et les audits externes requis par la loi de finances dans le cadre de la certification des comptes de l'État et de l'évaluation de la politique prudentielle de l'Agence, et qui donnent lieu à un rapport transmis à votre commission une fois par an. S'y ajoutent, le cas échéant, différentes missions d'audit qui peuvent être déclenchées en opportunité par l'Inspection générale des finances ou la Cour des comptes.

Le marché de la dette négociable de l'État est organisé de manière duale, puisque nous vendons des titres à des intermédiaires, les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT), qui sont chargés de les revendre sur le marché secondaire auprès des investisseurs et d'assurer la liquidité de cette dette. Je précise que 95 % de nos opérations d'émission sont réalisées sous forme d'adjudications, d'enchères à prix multiples, de sorte que nous servons les prix les plus élevés, donc les taux d'intérêt les plus faibles, pour le plus grand bénéfice du contribuable.
Le rôle des SVT est central. Au nombre de seize, ils ont le privilège d'être les seuls à pouvoir acheter des titres aux adjudications de l'État français ; en contrepartie, ils sont contraints d'acheter une certaine quotité de chacun des titres que nous émettons sur le marché et d'assurer l'équité de la dette, ce qui signifie qu'ils ont l'obligation de coter de manière continue tous les titres de notre dette. Les relations entre ces SVT et l'Agence sont codifiées dans une charte, révisée tous les trois ans. De même, les SVT sont renouvelés tous les trois ans et choisis par un comité de sélection au sein duquel siège un représentant de chacune des deux commissions des finances du Parlement.
Quels sont nos principes d'action ? Comme tous les grands émetteurs des pays développés, l'AFT est un émetteur régulier, transparent et flexible. La régularité et la transparence sont assurées par l'établissement d'un calendrier d'adjudications connu du marché. Ainsi, nous émettons, tous les lundis, des bons du Trésor à court terme – de trois mois à un an –, le premier jeudi de chaque mois, des titres à long terme, c'est-à-dire d'une maturité résiduelle supérieure à sept ans, et, le troisième jeudi de chaque mois, des titres compris entre deux et sept ans ainsi que des titres indexés sur l'inflation. De ce fait, le marché n'est jamais surpris ; qui plus est, nous nous efforçons de venir sur le marché pour des tailles à peu près comparables d'un mois sur l'autre. Il est absolument nécessaire, compte tenu de la dimension de notre programme de financement, de procéder ainsi pour éviter des à-coups dans les conditions d'emprunt et bénéficier d'une exécution la plus lisse possible.
L'AFT est, par ailleurs, un émetteur flexible car elle doit pouvoir s'adapter à tout moment à des changements de la demande exprimée par les investisseurs. Nous annonçons ainsi des montants d'émission avec une fourchette de 1 milliard d'euros : jeudi prochain, par exemple, nous allons émettre entre 7,5 et 8,5 milliards d'euros. Les SVT nous indiquent, une semaine avant l'adjudication, quels sont les titres demandés par le marché, et nous prenons en compte ces avis pour décider de ceux que nous émettons. Ainsi que je vous l'ai indiqué, 95 % de nos émissions se font sous forme d'adjudications, les 5 % restants étant réalisés sous forme de syndication.
J'ajoute que les investisseurs connaissent, outre le calendrier, le montant de notre programme de financement pour l'année à venir.

Deux éléments font la qualité de la dette française. Le premier est la qualité de crédit. Il s'agit, pour l'agence, d'une donnée exogène car elle résulte de la politique budgétaire de la nation et des structures économiques du pays, des réformes qui sont, ou non, engagées. Actuellement, nous bénéficions, pour la première fois depuis décembre 2011, d'une notation stable auprès des quatre grandes agences reconnues par l'eurosystème : trois d'entre elles nous attribuent la note « AA », la troisième la note « AAA ». Je précise, à ce propos, que nous sommes chargés de transmettre aux agences de notation les informations dont elles ont besoin pour noter la dette française.
Le second élément qui permet d'apprécier la qualité d'une dette est sa liquidité. Celle-ci dépend de la capacité pour un investisseur de céder un actif, d'une taille éventuellement importante, sans provoquer de brusques et fortes variations sur le prix de cet actif. L'Agence peut influer sur cette variable par la manière dont elle s'adresse au marché. Ainsi, pour que notre dette soit reconnue comme très liquide, nous montons, pour chaque souche – 51 titres d'obligations assimilables du Trésor (OAT) négociables et 16 titres indexés sur l'inflation –, un encours important, compris entre 20 et 40 milliards d'euros. Pour ce faire, nous utilisons la technique de l'assimilation, puisque nous vendons des obligations assimilables du Trésor. Cela signifie que nous allons créer une souche à un instant T, que nous allons réabonder les mois suivants. Les obligations ont toutes les mêmes caractéristiques, qu'il s'agisse de leur date de maturité ou des coupons. C'est le prix que nous récupérons lors de l'adjudication qui nous permet de tenir compte des variations de taux d'intérêt qui peuvent intervenir entre-temps.
La liquidité est également assurée par les engagements que prennent les SVT, qui sont soumis à l'obligation de coter de manière assez serrée. La qualité d'une dette se mesure, en outre, au volume de transactions quotidiennes qui peuvent s'y dérouler – 10 à 15 milliards d'euros s'agissant de la dette française.
J'en viens au coeur du sujet : le financement des besoins de l'État. Ceux-ci sont constitués par deux grandes lignes : le refinancement de la dette qui arrive à maturité et le financement du déficit budgétaire. Dans l'article d'exécution de la loi de finances que vous votez chaque année, nous vous demandons l'autorisation d'émettre un montant net de rachats. Une fois que ce montant est voté, nous nous efforçons de l'exécuter. Pour l'année 2017, par exemple, nous devons lever 185 milliards d'euros de dettes sur les marchés.

Ce tableau retrace la manière dont nous l'exécutons, de manière régulière, au cours de l'année ; par la technique de l'assimilation, nous réabondons les différentes souches pour répondre à la demande des investisseurs et nous en créons de nouvelles. À ce jour, nous avons émis 144 milliards d'euros, soit un taux d'exécution du programme de 80 %, comparable à celui des années précédentes. Le tableau ci-dessous détaille toutes les nouvelles souches que nous avons créées cette année.

En conclusion, quels sont les grands enjeux, à court et moyen terme ? J'en distingue trois.
Le premier est lié à la remontée attendue des taux d'intérêt. Tous les acteurs s'attendent à ce que la Banque centrale européenne (BCE) réduise le montant des achats de titres publics sur le marché, de sorte que nous allons voir disparaître – le plus progressivement possible, nous l'espérons – un acteur important du marché de la dette française. Comment les taux d'intérêt vont-ils réagir à ce retrait et comment allons-nous nous adapter à cette situation ?
Le deuxième enjeu réside dans la taille du programme de financement. Nous abordons une phase dans laquelle nous allons devoir refinancer les montants importants émis après la crise financière : entre la première partie des années 2000 et les années postérieures à 2008, la taille de notre programme d'émission a fortement augmenté. Or les dettes créées durant cette période arrivent en refinancement, de sorte que les montants à refinancer augmentent tendanciellement. Parallèlement, il faudrait que le déficit budgétaire soit sous contrôle et, si possible, qu'il évolue en sens inverse pour pouvoir stabiliser le montant total des dettes émises.
Le troisième enjeu est celui du rating, de la notation de la France. Elle est aujourd'hui stabilisée. La question qui se pose est celle de savoir à quel horizon on peut espérer, si la réduction du déficit se poursuit et si les réformes économiques sont engagées, un rehaussement de la notation de la France et, pourquoi pas, retrouver la note « AAA », qui est toujours celle de notre grand voisin, l'Allemagne.

La loi de finances initiale pour 2017 a prévu une charge de la dette et de la trésorerie de l'État de 41,5 milliards d'euros. Compte tenu de l'évolution des taux et du contexte macro-économique que vous venez d'évoquer, cette prévision vous paraît-elle toujours pertinente ? Sur le moyen terme, pourriez-vous présenter les conséquences probables sur la charge de la dette de l'État d'une normalisation progressive de la politique monétaire accommodante actuellement menée par la Banque centrale européenne ?
Les primes d'émission nettes et les décotes ont atteint des niveaux élevés en 2015 et 2016, avec respectivement 22,7 et 20,8 milliards d'euros. Quelles sont les estimations de l'Agence France Trésor pour l'année 2017 ?

Vous avez rappelé que la durée maximale d'émission aujourd'hui pratiquée est de cinquante ans, avec une maturité moyenne de sept ans et demi. Des pays tels que l'Irlande, la Belgique et l'Autriche, et même de grandes entreprises françaises, émettent des obligations à cent ans. Ce qui est mis en avant est l'opportunité de sécuriser la situation de taux d'intérêt faibles dont on bénéficie actuellement, grâce à des émissions avec des maturités extrêmement longues. Que pensez-vous de cette stratégie ? La France a plutôt rejeté cette idée pour le moment, mais une évolution de la doctrine est-elle à envisager dans les années à venir ?

Ma première question concerne l'organisation des séances d'adjudication. Vous avez évoqué le nombre de SVT et la manière dont ils sont sélectionnés. Je voudrais réagir sur quelques points soulevés par la Cour des comptes : elle a considéré que l'organisation des séances d'adjudication était globalement fiable, mais a relevé certains points de faiblesses et notamment recommandé de sécuriser la gestion des soumissions tardives et celle des contacts entre la Banque de France et les SVT, ainsi que la procédure de soumission en mode dégradé. Des actions ont-elles été menées dans ce sens ? D'autres sont-elles prévues ?
On peut effectivement s'étonner de la maturité moyenne de sept ans et demi, à la fois au regard du niveau de la dette et de notre capacité – en l'occurrence notre incapacité – actuelle à la rembourser, et compte tenu de la remontée des taux d'intérêt dont il est question depuis quelques mois et qui semble maintenant se dessiner.
Avez-vous des modes d'action sur la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) ? On sait que des tours de passe-passe comptables existent : comment pouvez-vous intervenir à ce niveau ?

Un tableau extrêmement intéressant sur le site de l'Agence France Trésor montre que la part des titres de la dette nationale détenus par des non-résidents était de 57,7 % au premier trimestre 2017, contre 63,9 % à la même période de l'année 2015. Comment interprétez-vous cette évolution et quelles en sont les conséquences ? Pouvez-vous aussi nous donner quelques détails sur les pays qui détiennent une partie de notre dette aujourd'hui ? Quels sont ceux qui ont réduit leur part sur les deux dernières années ?
Les investisseurs ont désormais la possibilité d'orienter leurs choix sur des produits financiers « verts », les green bonds, qui permettent de dédier des fonds à des projets environnementaux positifs. Cette option est-elle couramment choisie ? Que représente-t-elle à l'AFT et quelle est la part globale des green bonds en France ?

Je souhaitais également vous interroger sur le dossier des obligations « vertes ». La France a frappé un grand coup, si je puis dire, en ouvrant la voie à un véritable marché des emprunts d'État en faveur de l'environnement, ce qui a permis de récolter 7 milliards d'euros. Quelles sont les dépenses d'ores et déjà identifiées ? Vous paraît-il possible et souhaitable d'étendre le fléchage de ces fonds aux énergies renouvelables ? Un nouvel abondement est-il prévu ? Le cas échéant, à quelle hauteur et selon quel calendrier ?
Enfin, que représenterait une augmentation de 1 % des taux sur la charge de la dette ?

Un mot sur les détenteurs de la dette : une mission d'évaluation et de contrôle de la commission des finances a montré que ce sujet était relativement peu connu. Quel est votre degré d'information ? Quels sont les types d'investisseurs et les zones géographiques ?
S'agissant de la CADES, qui est aussi l'un des grands émetteurs français de dette, je crois savoir que ses équipes se rapprochent de celles de l'AFT, mais que les techniques d'émission sont différentes : y a-t-il une volonté d'aller vers des techniques identiques ou bien n'est-ce pas souhaitable ?
Merci pour ce florilège de questions très variées.
La charge de la dette avait été évaluée à 41,8 milliards d'euros en loi de finances initiale, puis elle a été révisée un peu à la hausse, à 42,4 milliards, dans le cadre du programme de stabilité, afin de tenir compte d'une hausse des taux un peu plus rapide que nous ne l'avions anticipé au premier trimestre, du fait du contexte préélectoral que vous connaissez.
L'évolution des taux d'intérêt depuis la présentation du programme de stabilité a été plutôt favorable : après être remontés à environ 1,15 % au mois de février, les taux à dix ans sont redescendus à des niveaux beaucoup plus faibles, aux alentours de 0,70 %. Nous procéderons à un affinement de la charge budgétaire qui en résultera à l'occasion de la présentation du projet de loi de finances initiale et du projet de loi de finances rectificative. Il est probable que nous revenions à un niveau plus proche de celui qui était mentionné dans la loi de finances initiale, mais je ne veux pas déflorer le sujet. Les montants prévisibles de la charge de la dette pour 2017 et 2018 figureront dans la prochaine loi de finances.
S'agissant des risques liés à l'évolution des taux d'intérêt, le « bleu » du programme 117 Charge de la dette et trésorerie de l'État présente une analyse de ce que pourrait produire une augmentation uniforme de 100 points de base sur l'ensemble de la courbe des taux au fil du temps. La métrique est en charges maastrichtiennes et non en comptabilité budgétaire, mais les deux sont proches.

C'est presque indolore la première année, où seuls les titres à court terme, renouvelés rapidement, subissent le plein effet de l'augmentation des taux d'intérêt. Mais ensuite, la charge de la dette augmente au fur et à mesure du renouvellement du stock : on passe de 2,1 milliards d'euros de coût supplémentaire dans un premier temps à une vingtaine de milliards d'euros au bout de dix ans. Ce graphique peut facilement effrayer si l'on n'a pas en tête d'autres éléments. On ne regarde ici que le poste de charges, si l'on peut faire cette comparaison avec les entreprises, et par ailleurs les taux d'intérêt n'augmentent pas sans raison.
À cet égard, il faut distinguer deux situations très différentes.
Les taux d'intérêt peuvent augmenter parce que la croissance est plus élevée et que l'inflation repart. Dans cette situation, favorable, les recettes de l'État vont aussi réagir immédiatement au contexte, ce qui signifie plus de recettes fiscales du côté des « produits ». Alors que la dette de l'État n'est renouvelée que tous les sept ans et demi, si l'on peut dire, les recettes fiscales réagissent immédiatement à une amélioration de la conjoncture. Dans ce scénario, et pour autant que les dépenses soient contenues et que l'on continue les efforts structurels qui ont pu être engagés depuis une dizaine d'années, une augmentation de 100 points de base des taux qui serait le reflet d'une amélioration de la conjoncture économique se traduirait, de manière agrégée, par une baisse du déficit public. Il n'y aurait donc pas à s'inquiéter.
Mais il y a une autre configuration un peu moins favorable : celle où l'augmentation des taux ne résulte pas d'une amélioration de la conjoncture économique – un redémarrage de la croissance et de l'inflation – mais d'une augmentation de la perception du risque de crédit, parce que les actions nécessaires ne sont pas menées, que les déficits s'accroissent et que les investisseurs sont donc un peu plus inquiets sur la dette. Dans ce cas, vous ne bénéficiez pas de l'effet favorable sur la partie « produits » du compte de résultat, mais vous supportez tout de suite les effets négatifs liés à l'augmentation des charges. Il ne faut donc pas regarder uniquement la partie « charges », de manière un peu hémiplégique, en ne prenant pas en compte la partie « produits ».
L'autre élément sur lequel je voudrais insister est la très grande inertie de la charge de la dette. Dans le tableau qui suit, nous avons essayé d'évaluer le coût apparent de la dette de l'État en stock.

Du fait de la baisse des taux depuis une dizaine d'années, le taux apparent est ainsi passé de 4,7 % à 2,2 %. Partant de là, nous nous sommes livrés à un double exercice. Pour commencer, nous avons essayé de projeter l'évolution du taux apparent de la dette française en utilisant le scénario de taux retenu dans le cadre de la loi de finances et de la loi de programmation des finances publiques : nous avons repris ici le taux du programme de stabilité du printemps 2017. Ce scénario repose sur une normalisation progressive de la politique monétaire des banques centrales dans le monde, au-delà de la seule BCE, et sur une amélioration du contexte économique. À long terme, cela conduit à une augmentation régulière des taux, à une vitesse d'à peu près 75 points de base par an. Dans cette première hypothèse, nous terminerions l'année 2018 avec un taux de 2,45 % sur les taux à dix ans, contre 0,70 % aujourd'hui, pour converger en 2021-2022 vers un taux de 4 %. Quand on applique ce scénario, que l'on peut considérer comme prudent, à celui des finances publiques qui figure dans le programme de stabilité, on aboutit à la courbe bleue du graphique : le taux apparent de la dette française continue de diminuer jusqu'en 2018-2019, en dépit de la hausse progressive des taux d'intérêt, et ce n'est qu'à l'horizon 2021-2022 que l'on assiste à un ressaut.
Dans un second scénario, en sus de cette augmentation tendancielle des taux à long terme, nous avons appliqué un choc supplémentaire de 100 points de base. Dans ce scénario dit « stressé », l'évolution du taux apparent de la dette française est représentée par la courbe rouge. Or même dans ce scénario, on observe une très grande inertie : le coût apparent met beaucoup de temps à se redresser.
J'en viens au sujet des primes et décotes à l'émission, en vous remerciant de l'avoir évoqué car il a donné lieu à un certain nombre d'incompréhensions dans le passé. Les primes et décotes à l'émission résultent de la technique de l'assimilation, qui est au coeur de la gestion moderne des dettes publiques : nous créons un titre à l'instant T, avec le taux le plus proche de celui du marché, puis nous réabondons le titre régulièrement. Le problème est que les taux d'intérêt ne sont pas stables : si le niveau de coupon attaché à l'obligation est totalement aligné sur les taux d'intérêt au moment où nous créons notre nouvelle souche, il y aura presque automatiquement une divergence avec le taux d'intérêt du marché au fil du temps. C'est ce différentiel que les primes et décotes vont permettre de neutraliser. Si les taux d'intérêt baissent, le prix de l'obligation, à terme remboursée à 100 « au pair », va monter : elle vaudra plus que 100. On va donc l'émettre pour une valeur supérieure à 100. L'investisseur aura le droit de percevoir un coupon plus élevé que le taux de marché, mais paiera en contrepartie un montant en trésorerie plus important ; c'est ainsi que l'on génère des primes à l'émission. À l'inverse, quand les taux augmentent, le prix de l'obligation passe en dessous de 100 et l'on génère alors des décotes.
Les primes et décotes à l'émission, comme vous l'avez souligné, ont été très importantes ces dernières années : elles ont représenté à peu près 22 milliards d'euros en 2015 et 20 milliards en 2016. Pour l'année 2017, à peine 7 milliards d'euros de primes ont été générés à ce stade, soit un montant beaucoup plus faible. C'est le reflet de l'augmentation des taux par rapport à la fin de l'année dernière, où ils avaient atteint un plancher historique : le 29 juillet 2016, les taux à dix ans étaient passés à 0,20 %, ce qui nous a permis d'avoir un taux moyen d'endettement de 0,37 % en 2016 pour les titres à plus d'un an. Les taux à dix ans sont aujourd'hui à un niveau plus élevé – 0,70 % – et le montant des primes à l'émission est donc plus faible.

Le phénomène des primes à l'émission n'est pas propre à la France. Tous les grands pays émettant de la dette de la même manière que nous, c'est-à-dire en essayant d'être réguliers et transparents, de favoriser la liquidité et d'alimenter des souches de titres obligataires, sont confrontés à la même réalité. Le graphique ci-dessus, réalisé par Eurostat, compare la génération de primes à l'émission dans plusieurs pays et montre qu'à l'exception peut-être de l'Allemagne, on retrouve partout la même configuration : une forte génération de primes en 2015, puis une diminution au cours de l'année 2016, et un montant qui sera encore plus faible en 2017.
Le graphique ci-dessous montre bien la forte corrélation entre le niveau des taux d'intérêt à dix ans, représenté par la courbe noire, et la génération de primes ou de décotes : plus les taux baissent, plus on a tendance à générer des primes à l'émission. Comme nous continuons à reprendre d'anciennes souches, nous allons sans doute générer encore un peu de primes dans les années à venir, mais beaucoup moins qu'auparavant, compte tenu de la remontée des taux et du fait que les nouvelles souches auront un taux d'intérêt proche de celui du marché.

S'agissant des émissions à cent ans, un certain nombre de pays ont effectivement répondu à une demande ponctuelle d'investisseurs. Dans le cas de la Belgique et de l'Irlande, il s'agit de placements privés, pour des montants faibles – de quelques centaines de millions d'euros. Par « placements privés », on entend une dette qui n'est pas liquide sur le marché, ce qui ne correspond pas à notre approche et à notre technique de grand émetteur. Il y a une exception très récente, puisqu'elle date d'il y a deux semaines : l'Autriche a émis un titre à cent ans, avec une taille que l'on peut considérer comme étant de référence, de 3,5 milliards d'euros, et un taux de 2,17 %, me semble-t-il. Toutefois, les informations dont je dispose me conduisent à dire qu'il ne s'agit pas d'un titre liquide. Ce serait d'ailleurs un des éléments qui ont conduit certains investisseurs à s'en tenir à l'écart.
Cela étant, il ne faut jamais rien exclure, et nous étudierons toutes les configurations possibles, mais la question pour nous restera de savoir si une telle maturité peut être créée avec les mêmes engagements de liquidité. Rien ne serait pire que d'annoncer aux investisseurs que l'AFT va émettre un titre à cent ans s'ils découvraient ensuite qu'il n'a ni la même profondeur ni la même liquidité que les autres OAT de la courbe d'État française.
Une question m'a été posée sur les séances d'adjudication et les recommandations de la Cour des comptes, qui se préoccupait plus particulièrement du cas des heures tardives. Nous adjugeons nos titres entre dix heures cinquante et onze heures les premier et troisième jeudis de chaque mois. Les SVT soumettent des offres anonymes en suivant une grille, qui comporte une heure limite. Pour des raisons de connexion informatique, il se peut que des ordres soient reçus deux, trois ou quatre secondes après dix heures cinquante. Nous avons une certaine tolérance et nous décidons si nous intégrons ces ordres – anonymes, nous n'en connaissons pas les caractéristiques – dans la grille d'adjudication. Nous souhaitons conserver cette flexibilité qui ne nous a jamais été préjudiciable.
Nous avons recours à une procédure en mode dégradé si les systèmes informatiques que nous utilisons – en l'occurrence une plateforme hébergée par la Banque de France – tombent en panne. Jusqu'à présent, nous suivions une procédure un peu plus lourde, susceptible de nous faire perdre du temps dans la réalisation des adjudications ; mais, depuis à peu près six mois, la Banque de France a développé pour nous une plateforme de secours dont les performances sont à peu près les mêmes que celles de notre logiciel d'adjudication traditionnel. Ces évolutions me paraissent satisfaisantes, et de nature à répondre aux remarques que la Cour des comptes a pu faire, sous réserve évidemment des vérifications auxquelles elle viendra procéder.
La durée moyenne de la dette de l'État s'est allongée au cours des dernières années Dans un environnement de taux normal, la pente de la courbe des taux étant ascendante, plus vous allez loin dans la courbe, plus les taux tendent à augmenter. Dans le contexte monétaire et macroéconomique actuel, la France, comme d'autres États, a réussi l'exploit d'allonger la maturité moyenne de la dette de près de six mois tout en continuant de voir le coût moyen de la dette diminuer au cours du temps... Au sein de la zone euro, cette maturité moyenne de sept ans et demi est parmi les plus longues. Les États-Unis sont en dessous, mais en Europe, seule la dette britannique a une maturité sensiblement plus importante : environ le double de la nôtre. Cela s'explique par les spécificités propres au Royaume-Uni, notamment par l'importance de l'industrie des fonds de pension : les engagements pris vis-à-vis des épargnants sont très longs, et la réglementation assurantielle britannique permet d'émettre les titres à maturité longue demandés par ces fonds de pension. En France, c'est plutôt l'assurance vie qui jouerait un rôle comparable, mais les engagements des assureurs vie sont d'une durée bien moindre. Les fonds de pension peuvent acheter des titres à trente ou cinquante ans, tandis que les assureurs privilégient des titres dont la maturité est comprise entre sept et quinze ans. La durée moyenne de la dette est donc plus réduite en France qu'au Royaume-Uni, mais la situation est tout à fait comparable en Italie, en Espagne ou en Allemagne.

Nous avons considérablement allongé la durée moyenne de la dette au cours de ces dernières années. Tout à l'heure, j'évoquais le stock. Le tableau ci-dessus retrace le flux : la maturité moyenne à l'émission, puisque celle-ci est maintenant de treize ans. Le but n'est pas forcément d'atteindre un objectif de durée moyenne de la dette à atteindre. Nous ne sommes pas une compagnie d'assurances qui peut adosser ses engagements de passif sur ses engagements d'actif : pour vendre la dette au meilleur prix, nous essayons de répondre à la demande là où elle se présente. Dans un contexte de baisse des taux, il est clair qu'un certain nombre d'investisseurs ont souhaité des maturités plus longues pour obtenir un rendement supplémentaire ; nous avons répondu à cette demande.

La composition de nos émissions par panier de maturité a évolué, entre les titres de maturité courte, inférieure à sept ans, et les titres de maturité plus longue. La déformation de la structure de nos émissions au fil du temps répond à une évolution de la demande.
Jusqu'à présent, l'AFT siégeait au conseil d'administration de la CADES. Comme vous le mentionnez, monsieur le président, un rapprochement des équipes opérationnelles respectives de la CADES et de l'AFT est en cours. Nos deux structures sont relativement petites – quarante personnes à l'AFT, une dizaine à la CADES – et la CADES est appelée à disparaître à brève échéance. Dans un souci de mutualisation des expertises et de l'expérience, mais aussi pour des raisons de contrôle des risques – le risque dit d'« homme-clé », de voir le capital humain de la CADES céder à d'autres sirènes à mesure qu'elle approche du terme de son existence. Nous avons souhaité consolider cette expérience et la mutualiser en constituant une plateforme d'expertise des missions en titres publics. Les deux entités AFT et CADES continuent d'émettre des titres distincts ; en revanche, les équipes travaillent côte à côte. Cela doit-il forcément nous conduire à changer nos pratiques ? Tout d'abord, certaines pratiques sont communes : AFT et CADES procèdent l'une et l'autre, de temps en temps, à des opérations par syndication et, effectivement, nous pourrons nous appuyer sur l'expertise acquise par les équipes de la CADES. Celles-ci ont également une expérience des émissions en devises mais, à court terme, l'AFT n'envisage pas d'émissions en devises étrangères : les trésors des grands pays – États-Unis, Japon, Chine... – émettent dans leur propre devise. Nous émettons donc dans notre monnaie nationale, autrement dit en euros, et ne voulons pas nous diversifier de ce point de vue. Au-delà de cette question de souveraineté, certes, les émissions en devises permettent certes d'émettre parfois à un coût plus faible en tirant parti des évolutions des taux de change, mais dans des conditions de marché par essence très fluctuantes, ce qui interdit de s'engager vis-à-vis des investisseurs à alimenter un programme d'émission qui favorise la liquidité de la dette. Ou alors, il faudrait émettre deux types de dette : l'une très liquide, l'autre moins liquide. Or l'image de marque de l'État français est d'être un émetteur régulier et transparent de produits de taux liquides en tout point de courbe. En émettant en monnaie étrangère, nous perdrions cette caractéristique aux yeux des investisseurs, ce que nous ne souhaitons pas.

La question a été posée de la détention des titres par des non-résidents.
Effectivement, au cours des dernières années, la proportion de dette acquise par les non-résidents a diminué. Ce phénomène s'explique très facilement par le programme d'achats de titres de la BCE, par elle-même et par son agent, la Banque de France, enregistrée comme un investisseur résident. La rétraction de la part des non-résidents tient essentiellement à l'accroissement de la part des autres investisseurs français, plutôt publics – la Caisse des dépôts et consignations et la Banque de France. Pour l'essentiel, à notre avis, ce sont les achats de la Banque de France qui expliquent l'augmentation de cette détention par des résidents. Mais les données exactes ne sont pas rendues publiques par la Banque de France et la BCE ; la BCE se borne à faire connaître la quotité de titres publics achetés, ce qui peut inclure des titres d'autres agences françaises – UNEDIC, CADES, collectivités locales, établissements publics hospitaliers. Nous sommes conduits à faire des hypothèses ; compte tenu de l'hypothèse que nous retenons en ce qui concerne la part des titres d'État français dans le total des achats de titres publics et de l'hypothèse que nous retenons sur le prix de moyen de marché auquel ces titres sont achetés, nous déduisons que la Banque de France détient à peu près 15 % de notre dette publique négociable.
Pour la première fois, l'AFT a effectivement émis cette année une obligation dite « verte ». Les obligations vertes présentent la caractéristique de devoir être adossées à un certain type de dépenses. Un travail d'identification des dépenses susceptibles d'être retenues a été mené avec les différents ministères ; au total, une dizaine de programmes budgétaires sont concernés, essentiellement des programmes gérés par le ministère chargé de l'environnement et des transports mais également des programmes gérés par le ministère chargé de la recherche et par le ministère de l'agriculture, et des projets entrant dans le cadre des programmes d'investissements d'avenir. Vous pouvez en retrouver tout le détail sur notre site internet.
Notre objectif, tel que nous l'avons annoncé aux marchés, est, après une émission inaugurale de 7 milliards d'euros et un abondement de 1,6 milliard d'euros, d'atteindre cette année jusqu'à un encours de 13 milliards d'euros, puisque tel est le montant des dépenses vertes au titre des budgets 2016 et 2017. Nous menons actuellement un travail d'identification des dépenses éligibles du budget 2018 que nous pourrons adosser à nos futures émissions, afin que l'encours de l'obligation verte atteigne progressivement un montant similaire à celui de nos autres OAT, soit un montant compris entre 20 et 40 milliards d'euros.

Je reviens sur la question des primes à l'émission. Nous avons déjà eu ce débat l'an dernier : nous étions parfaitement conscients du fait que l'écart de taux, dans un contexte de baisse, justifiait une politique de primes à l'émission ; nous savions également que cela se faisait également à l'étranger et qu'il n'y a pas si longtemps, peut-être en 2011, le montant avait atteint une dizaine de milliards d'euros. Pourquoi avons-nous soulevé ce problème ? Parce que brutalement, en l'espace de trois ans, les primes à l'émission ont atteint un montant compris entre 2 et 3 points de produit intérieur brut (PIB). Cela avait évidemment l'avantage pour nous de moins frôler le seuil symbolique des 100 % de PIB, et de ce point de vue, nous pouvions comprendre les motivations du Gouvernement. Mais pourquoi les primes à l'émission se sont-elles brutalement envolées, atteignant le double des maxima historiques ? La Cour des comptes elle-même l'avait souligné, en termes certes plus mesurés que notre commission des finances.
Cependant, l'essentiel n'est peut-être pas là, mais pour la suite. Observez des frais financiers dans le budget de l'État : 37 milliards d'euros en 2002, un peu plus de 41 milliards d'euros aujourd'hui. La dette a pratiquement doublé entre-temps. Toutes les majorités successives ont bénéficié pleinement de cette baisse des taux, toutes ces dernières années – y compris à la fin de la législature 2007-2012, tous les budgets ont été bouclés en loi de finances rectificative grâce à une économie de constat sur les frais financiers. En 2017, pour la première fois, ce ne serait, si j'ai bien compris, pas forcément le cas – il serait bon que vous précisiez ce point. Or le gros inconvénient des primes à l'émission, c'est de renvoyer aux années suivantes une augmentation de la charge financière ; cela ne peut être contesté. Dans cette situation où, année après année, les budgets sont bouclés grâce aux économies sur les frais financiers, cette politique peut se révéler dangereuse. Il est vrai que la dette est un véritable paquebot et que les choses n'évolueront que doucement, mais c'est quand même inquiétant. Comment boucler le budget sans faire déraper le déficit ? Je parle bien en comptabilité budgétaire. Les frais financiers augmentent assez rapidement... Il faudrait d'ailleurs nous donner des chiffres plus précis à cet égard.
Autre sujet de préoccupation : pendant la crise, le déficit public a atteint 130 milliards d'euros. Nous l'avons financé par la dette et, compte tenu de sa maturité moyenne, les prêts alors contractés devront être refinancés prochainement. Nous allons donc nous retrouver avec un besoin de financement qui, alors que nous restions ces dernières années à 100 ou 110 milliards en amortissement et financement, va passer à 140, voire 150 milliards d'euros. Comment allons-nous nous situer par rapport aux autres pays européens ? Notre besoin de financement ne va-t-il pas devenir le premier – et de loin – au sein de la zone euro, ce qui diminuerait la qualité de notre dette, c'est-à-dire la confiance que les investisseurs – en majorité des non-résidents – peuvent avoir dans les titres que nous émettons ?

Selon Wikipédia, le quantitative easing (QE) désigne un type de politique monétaire dit « non conventionnel » consistant pour une banque centrale à racheter massivement des titres de dettes aux acteurs financiers, notamment des bons du Trésor ou des obligations d'entreprise.
Aujourd'hui, sortir du quantitative easing ou maintenir l'assouplissement monétaire, telle est la question que se posent les responsables de la BCE. Une réunion de la BCE s'est tenue hier, lors de laquelle les deux positions se sont opposées : d'un côté, les pays partisans d'un arrêt définitif des achats de titres, comme l'Allemagne, de l'autre, ceux qui voulaient seulement réduire le montant mensuel des achats. Dans ce contexte, il y a fort à parier que la réunion de politique monétaire prévue pour fin octobre va déboucher sur un compromis – qui se traduirait sûrement par une prolongation de la situation actuelle, puisque tel est généralement l'effet d'un compromis en la matière.
Les conséquences d'une éventuelle prolongation ne peuvent être déterminées avec précision dans l'immédiat, ce qui m'inspire deux questions.
Premièrement, les pays de la zone euro se partagent certes la même monnaie, mais en aucun cas les mêmes prix ni la même compétitivité. D'un point de vue macroéconomique, toute l'Europe serait plutôt désavantagée par un renforcement de l'euro. Compte tenu de ces différences de situation, comment peut-on avoir une politique monétaire unique ?
Deuxièmement, la fin programmée du quantitative easing va, de facto, impacter les taux d'intérêt, donc la charge de la dette d'État. Dès lors, comment l'AFT va-t-elle anticiper et arbitrer cette prochaine contraction monétaire ?

Ma première question porte sur les réformes à venir et leur impact sur le fonctionnement de l'AFT. Ces réformes visent à favoriser l'investissement productif, par nature plus risqué, ce qui risque de se traduire par un détournement des investisseurs institutionnels au profit des obligations d'État, donc par une éventuelle remontée des taux d'intérêt. Avez-vous travaillé, en interne, sur une modélisation de cet impact ? Si oui, pouvez-vous nous en faire connaître les grandes lignes ?
Par ailleurs, nous savons que l'entreprise Vinci a été victime, en novembre 2016, d'une usurpation d'identité qui a entraîné de fortes variations du cours de son action. À la suite de cet événement, l'AFT a-t-elle pris des dispositions particulières afin de se protéger d'éventuelles tentatives de piratage sur les marchés ?

Au sujet des primes d'émission, précédemment évoquées par Gilles Carrez, la Cour des comptes a constaté dans son rapport de l'année dernière que ce dispositif avait eu pour effet de freiner la progression de la dette, grâce à des primes ayant atteint le niveau record de 22,7 milliards d'euros en 2015. Avez-vous estimé le risque que peut représenter pour les finances publiques la prolongation de nos dettes à long terme ?
Par ailleurs, le rapport publié en 2016 par la mission d'évaluation et de contrôle de la commission des finances sur la gestion et la transparence de la dette publique proposait que soient étudiés les coûts et avantages de l'introduction de clauses de remboursement anticipé dans les obligations émises par l'État. Elle recommandait de profiter davantage des opportunités de marché pour réduire la charge de la dette sur le long terme et de se préparer à une remontée des taux d'intérêt en sécurisant une plus grande partie de la dette aux taux exceptionnellement bas consentis actuellement et en élaborant des modes de financement moins dépendants des marchés financiers. Avez-vous tenu compte de ces recommandations, et leur avez-vous donné une traduction concrète ?

On ne peut que trouver alarmante la situation actuelle, où la dette représente 98,9 % du PIB – à quand les 100 % ? Certes, la responsabilité de cette situation n'est pas à imputer à l'AFT, mais à nous, les élus, qui laissons chaque année la dette augmenter, alors qu'elle pèse déjà énormément sur les finances publiques. Selon les graphiques que vous avez produits, la remontée des taux d'intérêt qui va inévitablement se produire dans les mois et les années à venir va se traduire par une augmentation de la dette de 15,8 milliards d'euros – une véritable bombe à retardement. Selon vous, comment pourrions-nous anticiper cette augmentation des taux d'intérêt et éviter ainsi l'explosion du montant de la dette ?
Pour répondre à M. Carrez, je commencerai par dire que vous êtes dans votre rôle de contrôle quand vous vous interrogez sur l'apparition soudaine de primes à l'émission qui, en comptabilité maastrichtienne, ont des effets bénéfiques, dans la mesure où, l'année où elles sont enregistrées, la dette publique augmente moins que le déficit budgétaire. Reste à savoir si cela résulte d'un effet fortuit ou d'une intention maligne...
Pour ce qui est du caractère fortuit ou non de ces primes, j'affirme solennellement devant la représentation nationale que, depuis 2012, date à laquelle m'ont été confiées pour la première fois les fonctions que j'ai exercées jusqu'à ce jour à l'AFT sous divers gouvernements et administrations, je n'ai jamais reçu la moindre instruction d'un ministre, d'un directeur de cabinet ou d'un directeur général de l'administration centrale, pour me demander d'émettre des titres assortis d'une prime d'émission. Le choix des titres que nous retenons pour nos adjudications, effectuées par nos seize SVT, se fait en suivant une procédure très précise. Durant la semaine précédant une adjudication, nous réunissons nos seize SVT à Bercy et nous leur demandons de nous rendre compte des demandes sur le marché, ainsi que des titres dont ils ont besoin pour leur activité de teneurs de marché. Sur la base de leurs recommandations – souvent convergentes, mais pas systématiquement –, nous prenons une décision sur la nature des titres à émettre. Pour diminuer la charge d'intérêts et émettre des titres au mieux des intérêts du contribuable, notre fonction première consiste à servir la demande.
Que le titre soit avec décote, avec prime ou surprime, n'entre pas en considération dans la définition de la politique d'émission de l'État : cela n'a jamais été le cas jusqu'à présent et j'espère qu'il en sera toujours ainsi. Si je devais choisir les titres à émettre en fonction de cette caractéristique, je prendrais le risque de retenir un titre qui serait peut-être un gros coupon, mais ne répondrait pas forcément – et peut-être pas du tout – à la demande exprimée : ce titre serait alors émis dans de très mauvaises conditions. Il en serait de même si je devais choisir un portefeuille de titres à émettre dans l'intention de minimiser le montant de primes et décotes.
Il ne faut donc voir aucune intention maligne dans l'apparition des primes à l'émission, dont l'existence s'explique par la technique de réabondement de titres anciens, visant à favoriser la liquidité de la dette française en émettant ce que l'on appelle de « vieilles souches ». De tels titres, qui ne sont pas des titres de référence et portent des coupons élevés dans un contexte de taux bas, représentent 33 % à 40 % de nos émissions certaines années, et seulement 20 % d'autres années. En 2015, nous avons généré beaucoup de primes à l'émission, avec un volume important de titres off the run ; en 2016, alors que le montant de ces titres avait diminué de moitié, nous avons généré des primes à l'émission d'un montant comparable.
L'autre variable jouant sur la génération de primes à l'émission est le contexte des taux d'intérêt : quand les taux baissent, il est parfois impossible de ne pas générer de primes à l'émission. La courbe d'État française, qui correspond à un titre à six ans, est à taux négatif jusqu'en novembre 2023 – par le passé, elle est parfois restée neuf ans à taux négatif. Quand je crée, comme je le fais chaque année, de nouvelles souches de référence – à deux ans, cinq ans, dix ans –, sur les périodes de deux ans et cinq ans, il m'est impossible d'émettre un titre affichant un taux de coupon négatif : le mieux que je puisse faire est de retenir un taux de coupon à zéro. Mais même dans un environnement de taux négatifs, la création d'un titre à taux zéro génère des primes à l'émission. En résumé, ce sont donc les deux variables que sont la demande du marché et l'évolution des taux qui commandent le volume de primes à l'émission ou de décotes qui vont être générées.
Le troisième élément important est l'aspect comptable, sur lequel je n'ai pas non plus la main. La norme comptable, qui conditionne la manière dont le déficit ou la dette maastrichtienne sont comptabilisés, a été établie par les statisticiens européens et s'impose à moi depuis des années.

L'Allemagne a un profil complètement différent, ce qui laisse tout de même penser qu'il y a quelque part une intervention politique... Dans des conditions de marché identiques, l'aspect technique que vous avez exposé devrait conduire à l'apparition de profils pratiquement identiques en France et en Allemagne, ce qui n'est pas le cas – alors que nous avons le même profil que l'Espagne ou le Royaume-Uni. Je me demande comment cette divergence peut s'expliquer, si ce n'est par une intervention du ministre allemand des finances.
Non, je vous confirme que M. Wolfgang Schäuble s'abstient, lui aussi, de toute intervention. Depuis des années, la philosophie d'émission de l'agence de la dette allemande et de l'AFT divergent sensiblement. L'Allemagne tire la qualité de sa dette, non d'une politique visant à favoriser sa liquidité, mais de sa qualité de crédit – résultant de son « triple A », des excédents budgétaires constants et de la maîtrise de sa trajectoire d'endettement – et du fait qu'elle est devenue le marché de référence pour les marchés à terme, que l'on appelle également les marchés futures, ou bond markets, ce qui lui procure une liquidité indirecte.
Si vous interrogez les teneurs de marché au sujet de la liquidité de la dette allemande sur le marché des obligations, ou marché cash, ils vous diront qu'elle n'est pas excellente, précisément parce que, jusqu'à une exception très récente, l'Allemagne n'émettait que des titres de référence, selon un calendrier établi trimestriellement à l'avance : ainsi, le 1er janvier, l'agence de la dette peut indiquer qu'elle émettra le 30 mars un titre à trente ans – sans savoir, et pour cause, ce que sera, trois mois après son annonce, la demande du marché pour les titres à trente ans. Cette approche du marché, seule l'Allemagne peut se la permettre en raison de sa position au sein de la zone euro. Mais cette différence de liquidité se paie : la différence entre une dette liquide et une dette non liquide peut atteindre 20 points de base – on peut le constater quand on compare les conditions d'émission d'une dette d'État et celles d'une dette d'agence, par exemple. Le cas de l'Allemagne est tout à fait spécifique.
Pour ce qui est des conditions comptables, la charge budgétaire de l'État est plus importante dans un environnement où l'on génère des primes et décotes qu'elle ne le serait si l'on pouvait émettre de la dette uniquement au taux de marché. Mais une telle hypothèse n'est que pure fiction, car elle supposerait de créer, à chaque émission, un nouveau titre collé au taux d'intérêt prévalant, en s'interdisant de le réémettre ; il en résulterait une fragmentation complète de la dette française, qui ne permettrait plus l'émission des souches profondes et liquides, appréciées des investisseurs.
J'ajoute que, s'il existe un effet collatéral en matière de mesure comptable du ratio dettePIB, en expression du déficit budgétaire maastrichtien, la génération de primes et décotes est totalement neutralisée, puisque les primes et décotes que nous générons font l'objet d'un étalement sur la durée de vie des titres.
Pour ce qui est de l'augmentation du besoin de financement, nous ne sommes pas le premier émetteur au sein de la zone euro – c'est l'Italie qui occupe cette place, avec une certaine avance. Le mécanisme que vous avez décrit est bien réel : il existe, du fait du refinancement des dettes passées, une pression à la hausse sur le besoin de financement de l'État, qui ne pourra être contrôlée, si l'on tient à ne pas creuser davantage l'écart qui nous sépare de l'Allemagne, qu'au prix d'un effort de réduction du déficit budgétaire. Nous pouvons lisser jusqu'à un certain point le profil de remboursement et diminuer ainsi l'endettement des années à venir, puisque le Parlement nous fixe un plafond d'émission net des rachats, mais cette fonction ne peut aller à l'encontre d'un mouvement structurel d'augmentation du besoin de financement et de hausse des remboursements. Il s'agit là d'une question qui risque de se poser avec insistance au cours des années à venir.
J'en viens à la question portant sur la politique monétaire. Se demander dans quelle mesure il est possible d'appliquer une politique monétaire unique à un ensemble de pays revient à s'interroger sur les zones monétaires optimales. Les États-Unis présentent des situations économiques très variées d'un État à l'autre, ce qui ne les empêche pas d'appliquer une politique monétaire unique à l'échelle fédérale, grâce à des mécanismes de transferts budgétaires fédéraux permettant de faire face aux chocs asymétriques qui peuvent être ressentis par l'application, dans tel ou tel État fédéré, d'une politique monétaire ne correspondant pas à la nature du cycle économique auquel il est soumis. Mettre en oeuvre un mécanisme similaire en Europe nécessiterait de s'interroger au préalable sur un éventuel approfondissement de l'intégration européenne, avec toutes les conséquences que cela implique.
À la question du risque d'éloignement des investisseurs institutionnels que pourrait susciter une modification de l'environnement fiscal en France, je répondrai d'abord que notre dépendance vis-à-vis d'une seule catégorie d'investisseurs est limitée. Notre politique consiste à favoriser la plus grande diversification possible de notre base, à la fois en termes géographiques et en termes de types d'investisseurs. Je pense pouvoir dire que nous y avons largement réussi ; c'est ce qui nous a permis, au cours de ces dernières années, de faire face à des chocs résultant du retrait brutal d'une catégorie d'investisseurs potentiellement candidats à l'achat de titres français. Quand les cours du pétrole s'effondrent, les revenus des pays du Moyen-Orient, donc leurs actifs, sont moins importants et leur appétit pour la dette française peut s'en ressentir fortement. Nous avons pu faire face à cette situation parce que nous disposions d'autres poches d'investisseurs disposés à acheter de la dette française, et capables de le faire.
Oui, les assureurs vie français sont d'importants détenteurs de la dette publique – ils en détiennent environ 20 %, pourcentage plutôt en baisse ces dernières années. Il faut voir comment la fiscalité déterminera des décisions d'investissement ou de désinvestissement en accompagnement d'un univers de taux qui va plutôt se resserrer et des taux qui vont monter.
On m'a demandé si l'on a mis en place des protections contre le risque d'usurpation et de manipulation de marché. Pour éviter en particulier toute « fraude au président », nous avons par exemple anonymisé notre organigramme afin que les agents ne puissent pas être identifiés et être sujets à ce genre de tentative de manipulation. Mais de nombres autres courts-circuits ont été prévus, qui nous protègent.
L'introduction d'une clause de remboursement anticipé s'analyse comme une composante optionnelle qui serait insérée dans l'obligation. Cela nous éloignerait du monde des obligations dites « vanille » que nous émettons aujourd'hui et les investisseurs n'auraient plus le même intérêt. Par ailleurs, il n'y a pas de « déjeuner gratuit », comme on dit : si jamais nous introduisions une telle clause ou si nous souhaitions racheter par anticipation des titres, nous le ferions aux conditions de taux et de prix qui prévalent aujourd'hui. Nous serions amenés à racheter au-dessus du pair des obligations que nous aurions éventuellement émises au pair. Il n'y a pas de gain à faire cette opération de transformation, mais nous essayons de profiter des conditions de taux actuels pour émettre le maximum de dette au taux d'intérêt le plus faible possible.
La trajectoire de la dette est-elle une bombe à retardement ? Si le graphique que je vous ai montré tout à l'heure a peut-être de quoi inquiéter, c'est parce qu'il se focalise uniquement sur la partie charges pour le budget de l'État et pas sur ce qui se passe du côté des produits. Mais suivant l'environnement de marché qui génère cette trajectoire de hausse des taux, vous pouvez avoir en fait une réaction asymétrique avec des recettes fiscales qui réagissent beaucoup plus rapidement. Je dis souvent aux investisseurs : contrairement à ce qu'ils peuvent penser, je souhaite que la hausse des taux intervienne et qu'il y ait une normalisation rapide de la politique monétaire. Ce serait le signe d'un environnement macroéconomique beaucoup plus porteur et les recettes fiscales de l'État réagiront beaucoup plus rapidement et positivement. Normalement, le déficit public se réduirait – pour autant que, j'insiste sur ce point, les dépenses soient tenues.

La dette sociale semble rapporter un peu d'argent. Est-ce à dire que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est meilleure gestionnaire que votre agence ?
Est-il possible et souhaitable que la dette soit davantage détenue par nos compatriotes ou nos organisations financières ? Si c'est souhaitable, cela vient-il en concurrence avec d'autres priorités comme le financement de l'économie ?

Monsieur le directeur général, pour justifier la mise en place de politiques de rigueur, certains ont affirmé que la France était en faillite. Quelle est votre appréciation sur cette affirmation ?

Je veux tout d'abord donner acte à M. le directeur général de l'extrême compétence des agents de l'AFT et de leur aptitude à gérer la dette selon le cahier des charges de l'Agence, c'est-à-dire sur le mode le plus favorable, ou le moins défavorable, aux finances publiques.
Il nous apparaît fondamentalement gênant, pour ne pas dire malsain, que la dette publique puisse servir de fonds de commerce et de matière première, surtout quand on se trouve en position de demandeur face aux investisseurs, même si les mécanismes d'affectation sont parfaitement clairs et ne sont pas en cause. C'est gênant surtout quand on sait que 58 % de la dette négociable est détenue par des non-résidents.
Sur le fond, nous avons le sentiment pénible de nous trouver face à un cercle vicieux, le règlement de la dette en cours appelant sans arrêt de nouveaux emprunts. Ce panorama est d'autant plus inquiétant que les taux vont remonter, ce qui affectera inéluctablement le coût des émissions futures.
La réduction du volume d'endettement constitue indiscutablement une priorité. Comme il apparaît difficile, d'une part de réduire le volume des dépenses et d'autre part d'augmenter à nouveau les impôts, la solution ne peut plus résider que dans une extrême rationalisation des choix budgétaires, en particulier en direction de l'investissement productif. L'idéal est que, à terme, l'Agence puisse devenir une agence d'émission des excédents financiers de l'État. Mais nous n'en sommes pas là.
Serait-il possible de jouer sur la structure des émissions – AOT, bons du Trésor à taux fixe (BTF) – et leur durée de vie ? Y a-t-il une marge de manoeuvre pour obtenir une meilleure adaptation à la future remontée des taux ?

Monsieur le directeur général, je vous vois intervenir avec une certaine sérénité alors que les chiffres devraient plutôt nous inquiéter, la dette publique s'élevant à 71 000 euros par ménage, 35 000 euros par habitant et sachant que notre endettement augmente de 2 665 euros chaque seconde. Je vous laisse calculer notre niveau d'endettement depuis le début de votre audition...
Les transparents que vous avez projetés montrent que la gestion de la dette est compliquée au regard de ce que le nouveau Gouvernement met en oeuvre aujourd'hui. Comment envisagez-vous l'arrêt, en tout cas la diminution de la dette à très court terme ?
Monsieur Alauzet, vous le savez, l'ACOSS n'a pas la capacité d'émettre sur les marchés à un horizon supérieur à deux ans. Elle se situe donc délibérément sur la partie courte de la courbe. La courbe directrice étant la courbe d'État français, à taux négatif, les émissions de dette de l'ACOSS génèrent effectivement un produit. Si vous regardez dans le détail les comptes de l'AFT, vous verrez que les émissions de BTF, c'est-à-dire les émissions de titres à trois, six et douze mois pour un taux de – 0,62 % génèrent aussi des produits : pour cette année, nous devrions atteindre 800 millions d'euros de produits sur nos titres de court terme. Pour autant, cela ne doit pas nous conduire à surémettre. Nous n'émettons qu'à hauteur de nos besoins. Si nous émettions trop, naturellement les conditions de taux dont nous bénéficions se détérioreraient.
La question de la détention de la dette intéresse, outre votre commission, les organismes internationaux comme le FMI ou l'OCDE. Vous me demandez si une forte proportion de détenteurs non-résidents est une source de fragilité pour une dette donnée. J'essaie de convaincre le FMI que ce n'est pas le cas. Je crois qu'il a été traumatisé par la crise des pays asiatiques à partir de 1997, où une dépendance à l'égard d'investisseurs étrangers a pu accentuer les mouvements de marché et générer des crises lorsque l'environnement macroéconomique était bouleversé.
Au-delà de la qualité de résident ou de non-résident, il faut regarder la composition institutionnelle de cette dette. Autrement dit, il ne me gêne pas du tout que 60 % de la dette soit détenue par des non-résidents dans la mesure où plus de 50 % est détenue par des banques centrales. Ce sont des investisseurs buy and hold, autrement dit qui achètent et conservent dans leurs coffres jusqu'à maturité, qui sont davantage attirés par des caractéristiques de crédit et de liquidité de la dette française que par le niveau des taux d'intérêt – ils continuent donc à acheter même lorsque les taux d'intérêt sont très bas. De notre point de vue, ce sont donc de très bons investisseurs, non des gens à qui le papier va brûler les mains et qui, au moindre nuage, s'empresseront de jeter de la dette sur les marchés, ce qui pourrait provoquer effectivement des ajustements.
Je ne vous dirais pas la même chose si je devais constater que 50 % de la dette était détenue par des non-résidents hedge funds, car ce serait effectivement une source de fragilité. Il convient de mener ce travail d'analyse de la qualité ou de la nature des détenteurs pour savoir si la détention de la dette publique par les non-résidents est ou non un facteur de fragilité. Je considère cette base d'investisseurs de banquiers centraux plutôt comme une force.
M. Dufrègne me demande si la France est en faillite ; je ne reprendrai pas cette expression à mon compte parce que j'essaie de convaincre tous les investisseurs que la France est au contraire un excellent risque. La métrique à laquelle il faut se référer est celle du ratio dettePIB et, plus encore, la trajectoire. Je comprends évidemment qu'un ratio de 100 % soit un élément visible et un seuil symbolique ; remarquons toutefois que le fait que la dette espagnole ait franchi la barre des 100 % – cela dépend des trimestres – ne s'est pas traduit par une modification brutale des conditions d'endettement de l'État espagnol. Plus que le chiffre absolu, c'est la trajectoire qui importe, car c'est elle qui détermine la solvabilité d'un pays. Pour ce qui nous concerne, nous n'avons aucun problème à nous financer. Nous ne sommes pas en faillite dès lors que nous pouvons montrer à nos investisseurs que nos déficits se réduisent et que la trajectoire de dettePIB est sous contrôle, qu'elle s'est infléchie et que notre ratio de dettePIB diminue. Un État n'a pas vocation à rembourser sa dette ; il la roule, il la refinance. C'est ce que font les grands États comme le Japon ou les États-Unis. Cela dit, il est important de pouvoir rassurer l'investisseur sur le fait que cette dynamique d'endettement est sous contrôle. De ce point de vue, la métrique absolue est le ratio dettePIB.
Au cours de ces dernières années, nous avons répondu à la demande du marché, qui était d'acheter des titres de plus grande maturité, parce que nous avons eu le sentiment qu'il était de notre intérêt d'allonger la durée moyenne de vie de la dette française, ce qui réduisait notre risque de refinancement ; nous avons donc « cranté » des taux de financement bas pour une longue période de temps. Cela s'est fait via l'augmentation de la durée moyenne à l'émission, qui est passée de huit à treize ans, année après année, et grâce aux primes à l'émission que nous avons générées. Ce sont des ressources de trésorerie excédentaire que nous n'avions pas anticipées. Comme vous avez pu le voir sur le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, le stock de BTF est revenu à un étiage historique autour de 8 %, après avoir atteint 18,6 % de la dette totale. Nous avons donc en proportion moins de dettes à court terme, ce qui signifie que nous sommes moins sensibles à un choc de taux. Cela fait partie des moyens de nous protéger contre l'augmentation du risque de refinancement.
Monsieur Laqhila, vous avez mentionné le montant de la dette publique supportée par chaque Français ; mais on oublie souvent de regarder le patrimoine et la richesse privés. Certes, les Français sont endettés si on rapporte la dette totale à la population française, mais, sur le plan patrimonial, on constate globalement un incroyable enrichissement de la France et des Français – je ne me prononcerai pas sur la répartition.

Monsieur le directeur général, estimez-vous normal que le ministre français ne vous donne pas d'instructions sur la gestion de la dette ? Est-ce le cas dans les autres pays démocratiques ?
S'agissant des primes d'émission, votre défense consiste à dire que vous ne faites que répondre au marché. Mais si votre thèse est exacte, pourquoi les Allemands n'ont-ils pas recours à cette technique ?

Les ministres donnent de moins en moins d'instructions aux administrations. C'est un principe de protection...

Pourquoi, lorsque l'on parle de la dette, n'évoque-t-on pas sa maturité ? Tout le monde se félicite de voir que les Britanniques sont bien meilleurs que nous en ce qui concerne le ratio dettePIB. Mais si j'ai bien compris, ils ont une dette de maturité moyenne deux fois plus élevée.
Comme vous le disiez, je ne reçois pas d'instruction directe tant du ministre que de son directeur de cabinet sur la nature des titres que je dois émettre. Le ministre valide le tableau de financement de l'État qui vous est proposé pour approbation en loi de finances et les principes qui guident la gestion de la dette française depuis la création de l'Agence, au cours d'une expérience pratique qui s'est bâtie au fil des années. Mais je ne doute pas qu'il remettra en question notre manière d'agir s'il estime, notamment à la lumière de rapports que peuvent écrire les corps de contrôle, que ces principes ne répondent pas à l'objectif de minimisation de la charge d'intérêt et des émissions au mieux des intérêts du contribuable. Le ministre et le secrétaire d'État nous ont d'ailleurs fait le plaisir de visiter l'Agence cette semaine, ce qui montre l'intérêt qu'ils portent à ce que nous faisons.
Le ratio dettePIB du Royaume-Uni est à un niveau proche du nôtre, puisqu'il est de 88 % environ. On verra les conséquences du Brexit, mais il semble que les perspectives de diminution des déficits publics sont moins optimistes qu'elles ne l'étaient il y a quelques années.
S'agissant de la structure de la dette britannique et sa maturité moyenne, le Royaume-Uni se caractérise par une spécificité, une idiosyncrasie liée au fait d'une part qu'il a sa propre monnaie, ce signifie que les épargnants sont quelque part captifs, et d'autre part à leur structure du financement des retraites britanniques qui repose sur la capitalisation, et d'une réglementation assurantielle qui oblige les institutions gérant leurs retraites à adosser les engagements très longs à des actifs très longs. C'est ainsi que la dette britannique a une dette de maturité moyenne deux fois plus élevée que celle des autres pays européens.
Membres présents ou excusés
Réunion du mercredi 20 septembre 2017 à 11 heures
Présents. - M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Jean-Louis Bricout, Mme Émilie Cariou, M. Gilles Carrez, M. Michel Castellani, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Philippe Chassaing, M. Charles de Courson, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, M. Jean-Paul Dufrègne, Mme Stella Dupont, Mme Sarah El Haïry, M. Olivier Gaillard, M. Romain Grau, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, M. Alexandre Holroyd, M. Christophe Jerretie, M. Daniel Labaronne, M. Mohamed Laqhila, M. Michel Lauzzana, M. Gilles Le Gendre, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Véronique Louwagie, Mme Marie-Ange Magne, M. Jean-Paul Mattei, Mme Amélie de Montchalin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Hervé Pellois, M. Pierre Person, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Christine Pires Beaune, M. François Pupponi, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, M. Benoit Simian, M. Jean-Pierre Vigier, M. Éric Woerth
Excusés. - M. Jean-Noël Barrot, M. Éric Coquerel, M. Joël Giraud, M. François Jolivet, M. Jean Lassalle, Mme Cendra Motin, M. Jean-François Parigi, Mme Valérie Rabault, Mme Muriel Ressiguier, M. Olivier Serva
Assistaient également à la réunion. - M. Régis Juanico, M. Jacques Marilossian