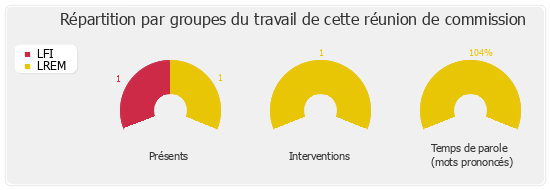Commission d'enquête sur l'alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l'émergence de pathologies chroniques, impact social et environnemental de sa provenance
Réunion du jeudi 28 juin 2018 à 9h15
Résumé de la réunion
La réunion
La séance est ouverte à neuf heures quinze.

Pour la première audition de cette matinée, nous recevons Mme Natacha Sautereau et M. Marc Benoit, tous deux chercheurs en agroéconomie.
Les dimensions économiques, sociales et environnementales de l'agriculture relèvent à l'évidence du champ des réflexions de notre commission. Un travail, publié en 2016, dont vous avez été coauteurs, retient plus particulièrement notre attention. Il s'agit de l'étude visant à « quantifier et chiffrer économiquement les externalités de l'agriculture biologique », réalisée dans le cadre de l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB), avec le soutien de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA).
L'ITAB est un organisme qui, depuis 1982, coordonne la recherche et les expérimentations techniques en agriculture biologique. Il travaille en réseau avec de nombreux acteurs impliqués dans ce domaine. Sans être à proprement parler un organisme public, l'ITAB est néanmoins soutenu budgétairement par l'État, l'Agence nationale de la recherche (ANR) et l'Union européenne.
Les notions d'externalité positive ou négative, que vous avez étudiées, sont complexes et ne peuvent exactement être assimilées aux notions de gain et de perte. Vous voudrez bien nous préciser l'origine et l'objet de cette commande, nous dire quelle a été votre méthode de travail, qui a sans doute reposé sur un état des lieux des connaissances disponibles. Quelles catégories d'acteurs avez-vous interrogées pour ce travail ? Avez-vous eu recours à des modélisations ?
Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire : « Je le jure ».
Mme Natacha Sautereau et M. Marc Benoit prêtent serment.
L'évolution des systèmes alimentaires s'est faite de façon couplée et concomitante depuis une cinquantaine d'années. La triple dynamique – intensification de l'agriculture, développement industriel agroalimentaire, mondialisation croissante des échanges – a conduit à une spécialisation de la production agricole, à sa massification, à sa standardisation et à sa concentration.
Les externalités sont les productions de biens marchands pour lesquelles il n'existe ni rémunération ni taxation. Leur meilleure connaissance représente des enjeux importants, compte tenu de la prise de conscience sociétale et des décisions politiques qui pourraient s'y adosser.
Une expertise collective menée par l'INRA en 2016 a mis en avant les différentes externalités, aussi bien positives que négatives, de l'élevage bovin, sur des territoires denses en animaux et peu herbagés. Les services fournis tiennent à la création d'emplois. Les impacts indirects concernent la consommation d'énergie, liée aux intrants utilisés, l'environnement et les aspects socio-économiques.
Nous avons observé que la concentration des élevages a permis des économies d'agglomération ou de concentration, ainsi que des économies d'échelle, donc des conditions concurrentielles favorables aux éleveurs, avec des approvisionnements à plus faible coût en aliments du bétail. En revanche, la spécialisation et l'augmentation de la taille des élevages ont induit une utilisation accrue de consommations intermédiaires par hectare, et contraint à gérer les pollutions induites. Par ailleurs, la concentration, qui entraîne confinement et mutilations, pose la question du bien-être animal.
Nous avons aussi mené une étude, sur vingt-quatre ans, entre 1990 et 2013, de l'évolution de 90 fermes d'élevage charolais dans la région de Clermont-Ferrand. Nous avons observé une hausse sensible de la taille des fermes – augmentation de 60 % de la surface par travailleur –, ainsi que de celle des troupeaux – augmentation de 60 % de la quantité de viande produite. La simplification des pratiques, due à la diminution du pâturage, a permis cette évolution.
En contrepartie, nous avons observé une augmentation de l'usage de certains intrants, comme les concentrés, ce qui indique une baisse de l'efficience technique. Cela s'est traduit par une hausse de 11 % de la consommation d'énergie, non pas à l'échelle des fermes, mais par kilo de viande produite. Voilà donc un exemple des mécanismes qui peuvent se dessiner dans la production bovine allaitante, mais qui peuvent être absents dans d'autres types de production.
Notre étude sur les externalités de l'agriculture biologique comporte deux volets, la quantification et les chiffrages économiques. Commandée par le ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll, restituée en novembre 2016, elle a été réalisée sur la base d'une bibliographie scientifique internationale. Nous avons été épaulés par un groupe d'expertise, composés de collègues de l'INRA et d'autres instituts de recherche. La direction générale de l'INRA a validé l'ensemble de ce travail.
L'objet de l'étude est de comparer l'agriculture biologique à l'agriculture conventionnelle. Les différences entre les externalités de ces deux modes de production tiennent bien sûr à l'application du cahier des charges : l'interdiction des pesticides et des engrais de synthèse, ainsi que la limitation des antibiotiques et des additifs, permettent d'éviter les pollutions diffuses et les impacts directs ou indirects sur la santé humaine. Elles tiennent aussi aux pratiques mises en oeuvre, qui permettent de générer un certain nombre de services sur lesquels Mme Sautereau reviendra.
Les externalités ont été étudiées dans trois domaines : l'environnement, la santé humaine et le bien-être des animaux, les performances socio-économiques. Pour les externalités négatives, on parlera d'impact, pour les externalités positives, de services à rémunérer.
Dans la mesure où nous souhaitions effectuer un chiffrage économique cumulatif des externalités, le socle commun proposé est un chiffrage rapporté à l'hectare, les grandes cultures, qui représentent 60 % de la consommation de pesticides, ayant une emprise foncière extrêmement importante. Pour ce qui est des externalités négatives liées à l'usage des pesticides, nous avons travaillé sur la base d'un indicateur de fréquences de traitement – IFT –, pour bien faire la part des choses : en France, le niveau de pesticides utilisés en grande culture est beaucoup moins important que le niveau de pesticides utilisés en arboriculture.
Je me propose de vous présenter un panorama des différentes externalités. Notre rapport, plus exhaustif et détaillé, est en ligne sur les sites de l'INRA et de l'ITAB.
S'agissant des externalités dans le domaine de l'environnement, nous nous sommes intéressés à la ressource sols. Il faut rappeler qu'au niveau mondial, un quart des sols sont estimés dégradés, dont près de la moitié sont des sols agricoles. On estime à 3 millions les hectares de terres arables perdus chaque année sous l'action de l'érosion, hydrique ou éolienne. La FAO estime le coût annuel de cette dégradation à 1 milliard d'euros, hors surcoûts corrélés, comme la perte en biodiversité.
La littérature scientifique indique une moindre dégradation chimique, physique ou biologique des sols utilisés en agriculture biologique. Cela signifie une moindre toxification des sols, une moindre érosion et une activité biologique renforcée. Pour autant, il est difficile de proposer une quote-part de ces moindres dégradations et de les évaluer de manière systématique, tant elles dépendent des pratiques mises en oeuvre.
Nous avons estimé les externalités positives, comme la séquestration de carbone dans les sols. Les pratiques en agriculture biologique favorisent davantage les légumineuses dans les successions culturales, réservent une part plus importante aux prairies, avec moins de maïs ensilage. Cela a pour conséquence de générer des stocks de carbone plus importants. On peut le chiffrer économiquement en utilisant la valeur tutélaire du carbone, plus élevée que la valeur marchande du carbone proposée dans le rapport Quinet.
La qualité de l'eau est l'une des valeurs les plus étudiées à ce jour. Il existe un consensus sur la présence de pesticides dans de nombreux cours d'eau et nappes phréatiques. En ce qui concerne les nitrates, des travaux sur de grandes cultures dans le bassin parisien indiquent que la lixiviation par les nitrates est réduite de 30 à 40 % en agriculture biologique. Par ailleurs, un rapport de 2016 du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAER) a conclu que « la gestion curative ne saurait constituer une solution durable ». Cela signifie que, d'un point de vue économique, il est plus onéreux de passer par du curatif que par du préventif.
Si l'on ajoute aux coûts de traitement les coûts d'évitement et que l'on rapporte la somme à l'ensemble de la surface de grande culture française, on obtient un coût de 20 à 46 euros de l'hectare en agriculture conventionnelle. Mais si l'on considère les aires d'alimentation de captage, à enjeux hauts, le coût de la dépollution atteint, selon les situations, entre 49 et 309 euros de l'hectare.
Pour autant, il faut signaler que ces coûts d'installation et de traitement ne seront que partiellement évités, voire pas évités, si les conversions à l'agriculture biologique sont diffuses sur le territoire. Pour obtenir un impact positif sur la qualité de l'eau, un effet masse est nécessaire sur les aires d'alimentation de captage.
Dans le domaine de la biodiversité, on sait que des populations emblématiques, comme les oiseaux et les abeilles sauvages, sont très touchées, certaines ayant subi une diminution de moitié en l'espace de trente ans. Les chercheurs ont étudié les effets directs létaux et non létaux des pesticides sur la faune – ils peuvent affecter les comportements, la reproduction, perturber les populations et à long terme les fragiliser – et leurs effets indirects.
Pour autant, il est difficile d'isoler des facteurs qui se combinent et entrent même en synergie, des populations affaiblies devenant d'autant plus sensibles aux pesticides. On observe des interactions entre stress alimentaires et stress pathologiques, liés à la présence de ravageurs et à la disparition des habitats. Ce déclin est multifactoriel : des thèses en cours à l'INRA cherchent à préciser l'impact de chacun des facteurs.
Pour ce qui est des services rendus, nous avons plus particulièrement regardé la régulation biologique apportée par la faune auxiliaire et la pollinisation. Ces deux services sont supérieurs en agriculture biologique, notamment en grande culture. Un travail de thèse a montré que le rôle de la mosaïque paysagère est prépondérant dans la régulation biologique, avant même celui du mode de production, d'où l'intérêt de la trame verte.
La pollinisation est également favorisée par l'agriculture biologique. Des économistes de l'INRA ont estimé ce service rendu, à l'échelle de l'Union européenne, à 22 milliards d'euros. Cette part est calculée avec des ratios de dépendance à la pollinisation. Les grandes cultures, en l'occurrence, sont peu dépendantes.
Un travail dirigé par Bernard Chevassus-au-Louis en 2009 fait référence. Il a consisté à estimer les consentements à payer, soit le coût consenti pour préserver la vie d'un oiseau ou d'un poisson. La fiabilité d'une telle démarche doit néanmoins être interrogée, dans la mesure où les résultats sont très dépendants des échantillons interrogés, peuvent être biaisés et fort subjectifs. Nous ne sommes donc pas allés plus avant sur l'affectation d'une valeur à la vie de ces différentes espèces.
Concernant les émissions de gaz à effet de serre et la consommation de ressources peu ou non renouvelables, la littérature donne des résultats très variables selon les situations nationales, mais aussi selon les systèmes de production. Ce qu'il faut retenir, c'est le poids très important dans les résultats de l'unité fonctionnelle à laquelle on rapporte ces émissions de gaz à effet de serre. Lorsque les émissions sont rapportées à l'hectare, l'agriculture biologique est mieux placée, avec de moindres émissions. Mais lorsque l'on passe à un indicateur par kilo de produits, le bio devient comparable, voire supérieure, du fait d'un facteur majeur, le niveau de productivité.
L'analyse est la même pour l'énergie, l'unité fonctionnelle joue. Des effets de compensation vont aussi se mettre en place : l'agriculture biologique recourt moins aux fertilisants azotés, dont la production est très gourmande en énergie, mais ses rendements sont plus faibles. L'agriculture biologique consomme moins de phosphore, une ressource qui se raréfie, mais elle reste dépendante des stocks historiques.
La ressource foncière est liée à la question de rendement puisque, pour produire la même quantité, l'agriculture biologique a besoin de plus de surface. À notre sens, et pour de nombreux chercheurs, cette question ne peut se traiter qu'en élargissant le périmètre d'analyse, avec une vision plus systémique des modes de consommation, de la question du gaspillage et des autres usages de sols, notamment d'énergie. Un travail, en cours de publication, indique, à partir de la cohorte BioNutriNet, qu'à régime alimentaire égal, une consommation bio générerait un surcroît de consommation de terre estimé, avec les chiffres de rendement proposés par Solagro, à 18 %. Pour les régimes alimentaires bio, qui intègrent une moindre part carnée, l'occupation des terres est potentiellement diminuée, malgré les rendements plus faibles de l'agriculture biologique.
Le volet santé comporte trois sous-volets : intrants pesticides, intrants additifs et intrants antibiotiques. Sur les pesticides, nos difficultés méthodologiques tiennent à la diversité des expositions, qui peuvent être orales, percutanées, respiratoires, et se combiner. Les effets sont liés à la toxicité aiguë ou à l'exposition chronique. Si, pour la toxicité aiguë, les choses sont plus aisées à quantifier, les effets liés à l'exposition chronique sont bien plus difficiles à évaluer. Il est difficile d'établir des causalités, du fait du caractère multifactoriel des maladies et des effets retard par rapport à la symptologie.
Pour autant, nous avons accompli des avancées considérables ces dernières années. Un rapport de l'Inserm, en 2013, a établi des liens entre une exposition à certaines familles de pesticides et certaines maladies professionnelles. Par ailleurs, en 2014, l'ANSES a mis en évidence, pour la population générale, des risques chroniques pour sept résidus de pesticides et des risques aigus pour dix-sept substances. Depuis, certains de ces pesticides ont été interdits. Des études récentes ont étudié les effets cocktails des molécules qui, mises en synergie, augmentent leur dangerosité respective et les effets, à faible dose, des perturbateurs endocriniens.
Qu'en est-il d'une éventuelle contamination biologique, du fait du moindre recours aux pesticides ? Cela n'entraîne-t-il pas une plus forte présence de mycotoxines, de contaminations microbiologiques ? Le rapport de l'INRA de 2013, qui faisait suite à une demande du CGAER, a conclu qu'il n'y avait pas de différence systématique. Les situations sont variables et on ne peut mettre en évidence un bénéfice de l'agriculure biologique ou de l'agriculture conventionnelle sur ce point.
Pour chiffrer les coûts directs, liés, par exemple, aux maladies des professionnels, nous pouvons utiliser ce que certains économistes appellent la valeur de la vie statistique (VVS), soit ce qu'une société consent à affecter pour éviter un décès. Cette valeur est plus ou moins élevée, mais pèse très fortement dans les calculs, puisqu'elle peut varier, selon les études, entre 3 et 8 millions euros par décès évité.
S'agissant des additifs, rappelons que seuls 50 % des 320 additifs utilisés en agriculture conventionnelle sont autorisés en agriculture bio. Les colorants sont interdits en bio, sauf pour quelques fromages traditionnels. Pour certains de ces colorants, des liens ont été identifiés avec des problèmes sur des enfants souffrant de troubles de l'attention etou hyperactifs. On a aussi observé des réactions allergiques au « beleu patenté » E131. S'agissant des conservateurs, la littérature a montré que le benzoate de sodium E211 avait un effet in vitro sur les adipocytes de souris, avec un impact sur la sécrétion de leptine qui joue dans le phénomène de satiété : la substance serait donc obésogène. Ce mécanisme est également décrit à l'échelle humaine.
Au moins 50 % des antibiotiques sont destinés à l'élevage. La réglementation en bio limite le recours aux antibiotiques. Des études permettent d'identifier que le recours aux traitements allopathiques – antibiotiques – en élevage bovin conventionnel est 3,5 fois plus élevé qu'en élevage biologique.
Au niveau de l'Union européenne, on estime à 25 000 le nombre de morts prématurées liées à l'antibiorésistance, qui est croissante. Si on calcule les coûts directs médicaux, les coûts indirects comme la perte de productivité et que l'on applique la fameuse VVS, alors le chiffrage de cette mortalité augmente. Rapporté à la population française, on parlerait de 10 milliards d'euros par an. Il y a bien un bénéfice de l'agriculture biologique, mais pouvoir le chiffrer en euros est plus difficile, d'autant que le transfert des résistances entre les bactéries humaines et animales existe. Les chercheurs indiquent qu'ils ont du mal à estimer de manière fine l'importance de ce processus de transfert.
Sur la santé, quelles sont les externalités positives, les services rendus par l'agriculture biologique ? Ses produits possèdent des qualités nutritionnelles, grâce aux antioxydants ou aux nutriments, plus nombreux. Dans la cohorte BioNutriNet, unique dans le monde, on observe moins d'obésité et moins de pathologies associées à l'obésité, telles les maladies cardiovasculaires, chez les consommateurs bio. Mais ceux-ci observent des régimes alimentaires plus sains, plus proches des recommandations, ainsi que des modes de vie plus sains. Les chercheurs ont approfondi les résultats de 2013 en publiant l'année dernière un nouvel article : à régime équivalent, l'agriculture biologique a malgré tout un effet positif. L'hypothèse que formulent les auteurs est que cela serait lié aux résidus et aux effets perturbateurs des pesticides de synthèse sur le métabolisme humain.
Un tableau de synthèse permet de rassembler les différentes catégories que nous avons instruites, les externalités environnementales, les externalités liées à la santé humaine et au bien-être animal. Globalement, les bénéfices de l'agriculture biologique sont nombreux, hormis sur l'utilisation des terres, une question qui devrait faire l'objet d'une analyse plus globale, selon un périmètre plus large. La colonne dédiée aux chiffrages économiques laisse apparaître beaucoup de points d'interrogation, et les fourchettes indiquées sont relativement larges.
À l'étude de l'ensemble de la littérature, il nous semble que le soutien à l'agriculture biologique est largement justifié. Pour autant, il est impossible de fonder scientifiquement avec précision cette rémunération sur le calcul de chacune de ces externalités. Il conviendrait peut-être que le soutien public prenne en compte les différentiels de marge.

L'objet de votre travail est bien la production agricole, mais l'alimentation industrielle et l'agriculture sont nécessairement liées, et vous avez étudié l'antibiorésistance et l'impact des résidus dans l'alimentation. Je ne pense pas qu'il soit possible de traiter séparément les deux questions. Il nous a semblé intéressant de voir par où entraient les externalités négatives de l'alimentation.
Peut-on conclure, au vu de votre bibliographie, que le système agriculture biologique est le plus performant en ce qui concerne les externalités positives et l'acceptabilité sociale ?
Nous n'avons pas abordé la question des agriculteurs, qui sont les premiers concernés. L'agriculture biologique représente-t-elle pour eux un intérêt économique en termes d'emplois, de revenu agricole, de valorisation de leur travail ?
Votre tableau laisse penser que l'agriculture biologique est plutôt le bon système. Existe-t-il des blocages socio-économiques qui font que ce que je perçois comme un système plus vertueux ne soit pas généralisé ? Pardonnez cette question iconoclaste, mais n'est-il pas significatif que ce soit l'agriculture biologique qui soit aujourd'hui contrainte à une labellisation coûteuse, alors qu'il s'agit du système le plus vertueux, le plus « normal » ? Ne faudrait-il pas renverser la logique et envisager une labellisation de l'agriculture conventionnelle ? Pourquoi cantonner l'agriculture biologique à une niche ?
L'objet de notre travail n'est pas l'agro-industrie, même si les produits bio transformés existent et constituent, d'ailleurs, un secteur en fort développement dans les grandes et moyennes surfaces.
La plupart des travaux scientifiques présentent, de manière de plus en plus consensuelle, le modèle de l'agriculture biologique comme l'un des prototypes de l'agriculture durable, voire comme son parangon. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un modèle parfait, mais, vous l'avez dit, il est vertueux.
L'agriculture biologique est d'ailleurs le secteur qui se développe le plus et si la consommation de fruits et légumes produits en conventionnel diminue, celle de fruits et légumes bio ne fait qu'augmenter, et de manière assez forte. Il s'agit donc d'un secteur dynamique, porteur, que les chercheurs considèrent comme un prototype.
M. Mesnard vous a parlé des verrouillages sociotechniques. La théorie des transitions est un cadre conceptuel qu'ont utilisé des chercheurs néerlandais, MM. Frank Geels et Johan Schot, qui montre qu'une innovation « percole » dans le régime sociotechnique dominant et qu'il peut se produire des phénomènes de résistance et de difficulté face auxquels il existe trois leviers de déverrouillage : l'offre et la demande sur le marché, la recherche-développement et la mise à disposition de connaissances – la percolation est plus aisée lorsque le degré d'appropriation d'une innovation dépasse 5 % ou 6 % et suscite une familiarité avec le processus – et, naturellement, les politiques publiques. Dans une étude que nous avons réalisée il y a une dizaine d'années sur la théorie des transitions appliquée à l'agriculture biologique en tant que solution alternative en voie d'institutionnalisation, nous avons exploré les différentes manières de favoriser la légitimation de l'agriculture biologique. L'impact des politiques publiques sur le développement de l'agriculture biologique est manifeste : les trois plans successivement mis en place – le plan pluriannuel de développement de l'agriculture biologique (PPDAB) de 1998, le plan « Horizon bio » de M. Barnier en 2008 et le plan « Ambition bio » de M. Le Foll en 2012 – ont produit des effets directs en termes d'accroissement des surfaces. Les plans en question étaient systémiques : ils ne visaient pas seulement l'aide aux agriculteurs, qui est indispensable, mais aussi la formation au moyen de modules bio dans les lycées et les écoles. Le PPDAB ciblait davantage les agriculteurs, pour inciter au développement de l'agriculture biologique, mais les plans sont peu à peu devenus plus systémiques jusqu'à comprendre des mesures relatives à la restauration collective et à la commande publique. Ils ont abordé la question de l'agriculture biologique au moyen d'initiatives territoriales comme les projets alimentaires territoriaux (PAT). En clair, le développement de l'agriculture biologique s'envisage sous plusieurs angles.
L'étude aborde la question de la production des agriculteurs sous trois angles. Le premier a trait aux pesticides, dont la non-utilisation présente un intérêt direct pour les agriculteurs. Deuxième angle : le travail. La charge de travail peut être supérieure dans l'agriculture biologique, quoique cela dépende naturellement des filières et des productions. En revanche, le mieux-vivre au travail est certain, même si la charge de travail est plus lourde : sur le plan psychologique, l'intérêt et la reconnaissance du métier incitent les agriculteurs et les éleveurs à voir les choses d'un bon oeil. Les revenus, enfin : différents travaux récents montrent qu'ils dépendent largement du type de filière et du rapport entre l'offre et la demande. Dans la filière laitière, par exemple, les revenus de l'élevage biologique sont nettement supérieurs à ceux de la filière conventionnelle, et cela s'explique directement par la demande des consommateurs qui tire les prix vers le haut. Se produira-t-il à long terme un ajustement entre l'offre et la demande ? C'est l'élément central du développement de l'agriculture biologique : j'ignore si l'on peut piloter ce rapport entre offre et demande, mais il faudra un ajustement tout en veillant à ce que les prix continuent de tirer vers le haut.
J'en viens à la question du zonage. On pourrait croire, par exemple, que l'agriculture de montagne est naturellement biologique. Au contraire, l'élevage en zone de montagne peut subir des effets indirects difficiles. En effet, les élevages ne peuvent pas y produire de céréales, et les céréales bio vendues sur le marché sont extrêmement coûteuses. De ce point de vue, des études révèlent que l'élevage bio en montagne, ne pouvant assurer son autonomie alimentaire, peut être pénalisé sur le plan économique.
L'exemple de la commune viticole de Correns, dans le Var, est emblématique. Les viticulteurs y faisaient face à des difficultés économiques et, il y a une douzaine d'années, le village a effectué une conversion massive à l'agriculture biologique pour devenir ce que les médias ont présenté à l'époque comme le « premier village bio de France ». Presque l'intégralité des surfaces ont été converties. Or, l'amélioration des pratiques s'est combinée à une embellie des résultats. La montée en gamme des produits s'est donc assortie d'une valorisation économique. On a tendance à faire valoir la prééminence du facteur économique pour que les agriculteurs soient confortés dans leur activité avant d'envisager une quelconque contrainte environnementale, mais Correns apporte la preuve qu'il n'existe pas forcément de contradiction, bien au contraire : c'est précisément le passage à l'agriculture biologique qui a conforté la situation économique des agriculteurs.
Quant à la question de la labellisation des produits biologiques, elle tient surtout au ratio : l'agriculture biologique représente 6 % des surfaces cultivées. De même, on peut regretter que les fruits et légumes biologiques vendus en grande et moyenne surface soient ceux qui sont emballés dans du plastique, mais ils ne représentent qu'un modeste pourcentage de l'ensemble des fruits et légumes qui y sont commercialisés. En somme, cette question de l'étiquetage s'explique à mon sens par la taille encore petite du secteur biologique.

Le ratio est en effet de 6,5 % environ, mais l'objectif est d'atteindre 15 % en 2022. Cela vous semble-t-il réaliste au regard de la dynamique actuelle ? Quelles sont vos préconisations pratiques pour faire augmenter la part des produits biologiques dans les grandes et moyennes surfaces (GMS) et, surtout, la part des surfaces biologiques, car c'est sans doute là que se trouve la clé ? Par ailleurs, j'ai bien entendu votre observation sur l'organisation des filières.
Peut-on facilement doubler les surfaces bio ? Cette question en pose une autre : celle des soutiens à l'agriculture biologique. Quoi qu'il en soit, les programmes de recherche de l'INRA et de l'ITAB seront, au cours des prochaines années, axés sur la question du changement d'échelle. Nous allons revisiter un certain nombre de sujets d'un point de vue technique – le bouclage du cycle des minéraux, par exemple, puisqu'il se produit actuellement un transfert du secteur conventionnel vers le secteur biologique qu'un rééquilibrage pourrait contribuer à réduire, ou encore la question de la régulation des bio-agresseurs à l'échelle des paysages – mais aussi du point de vue de la structuration des filières, car un doublement des volumes produirait des économies d'échelle et s'accompagnerait d'aspects positifs et négatifs. À ce stade, il reste de nombreuses inconnues et il est urgent d'investir sur le changement d'échelle qui fera naître des questions nouvelles auxquelles il faut se préparer.

Puisque nous évoquons le changement d'échelle des surfaces biologiques, l'INRA envisage-t-il de changer d'échelle en ce qui concerne la part des travaux consacrés à l'agriculture biologique ?
Le plan « Ambition bio » a prévu la constitution – qui est en cours – d'un neuvième métaprogramme à l'INRA qui témoigne de la reconnaissance de la nécessité d'investir davantage dans l'agriculture biologique. Un programme existait déjà depuis près de dix-huit ans. Ce nouveau métaprogramme s'accompagnera d'une augmentation des budgets de recherche. À mon sens, son principal enjeu concerne moins la visibilité extérieure des travaux de l'INRA sur le bio que leur visibilité interne, pour attirer de nouvelles équipes de recherche.
Le changement d'échelle et sa temporalité sont des points cruciaux. Vous avez auditionné Solagro sur son scénario « Afterres 2050 ». D'autres travaux existent comme ceux du Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FIBL), l'équivalent suisse de l'ITAB, qui propose un scénario d'une agriculture intégralement biologique à l'horizon 2050 – un scénario construit à partir d'hypothèses de changement des régimes alimentaires, de réduction forte du gaspillage alimentaire et d'impacts du changement climatique sur les rendements, d'où un scénario de 100 % d'agriculture biologique à l'échelle mondiale. Des tensions s'annoncent sur les ressources azotées et, par ailleurs, la question des régimes alimentaires est inextricablement liée à la montée en puissance de l'agriculture biologique.
L'Autriche est un exemple emblématique. Lors de son adhésion à l'Union européenne en 1995, elle a beaucoup misé sur l'agriculture familiale dans le contexte d'une agriculture de montagne soumise à des handicaps naturels. Elle a fortement valorisé l'agriculture biologique grâce à des soutiens publics importants, au point que cette filière a atteint un plafond de 20 % depuis quelques années ; depuis, la croissance est beaucoup plus lente. Cela suscite deux questions : tout d'abord, quelle est la part – un cinquième, un quart – des agriculteurs disposés à accepter une production soumise aux contraintes d'un cahier des charges ? Jusqu'où peut-on pousser ces exigences ? D'autre part, le consentement à payer du consommateur peut-il atteindre un plafond ? Force est de constater que malgré leur politique volontariste en faveur de l'agriculture biologique, certains pays comme l'Autriche connaissent une quasi-stagnation de son développement.
L'objectif de 15 % en 2022 est-il réaliste ? Selon les chercheurs autrichiens avec lesquels nous échangeons, au-delà du caractère atteignable de l'objectif, c'est le signal politique donné qui est intéressant car il indique que ce mode de production sera soutenu même s'il ne se développe plus guère. Cette ambition est une forme de légitimation de l'agriculture biologique par les pouvoirs publics. L'annonce du plan « Ambition bio », par exemple, permet aussi d'encourager ce développement.
Il faut toutefois rester vigilant quant à l'adéquation entre l'offre et la demande. Le secteur laitier a connu dans les années 2000 un développement rapide du bio qui s'est traduit par des déséquilibres et des problèmes de plus-value pour les éleveurs acceptant un cahier des charges contraignant sans bénéficier ensuite de la valorisation économique attendue. Il n'est pas forcément souhaitable que la conversion socioécologique vers l'agriculture biologique soit menée à toute vitesse : il faut organiser cette transition en assurant l'accompagnement des agriculteurs.

Comme de nombreux autres départements, l'Yonne connaît une explosion du nombre de conversions à l'agriculture biologique. Espérons donc que cette transition se fasse, mais qu'elle soit accompagnée de sorte que les agriculteurs soient incités à faire un choix vertueux – il peut en effet être dangereux d'aller trop vite.
Dans un article que vous avez co-écrit en octobre 2016, vous estimiez qu'il est impossible de déduire un effet direct des produits bio sur la santé des consommateurs, tout en précisant que l'analyse de la cohorte BioNutrinet a révélé que les consommateurs réguliers d'aliments bio souffrent moins d'obésité et de pathologies. Pouvez-vous nous expliquer ce paradoxe ? Y a-t-il une étude en cours sur les effets des produits bio sur la santé ? Peut-on d'ores et déjà en tirer des conséquences ? Est-il possible de mesurer les effets de l'agriculture biologique sur le plan nutritionnel ? On entend parfois dire que certains produits bio ne s'accompagnent pas forcément de tous les effets souhaités.
Vous l'avez dit : les pouvoirs publics doivent encourager ce type d'agriculture. Votre document ouvre des pistes d'amélioration des soutiens à l'agriculture biologique. Vous évoquez notamment la mise en place de taxes sur les intrants polluants, c'est-à-dire les pesticides et les engrais chimiques, ou une rémunération des agriculteurs liés aux services environnementaux que rendent leurs exploitations. Pouvez-vous nous en dire davantage et nous éclairer sur la manière dont les parlementaires pourraient exercer une influence en la matière ? Lors d'une précédente audition, par exemple, il a été envisagé de taxer le sel pour en réduire la quantité dans les produits transformés. L'idée d'une taxe sur les intrants a été évoquée lors des états généraux de l'alimentation, sans aboutir. Peut-être d'autres pistes sont-elles à explorer.
Dissipons d'emblée ce paradoxe qui n'en est pas un : s'agissant de la composition nutritionnelle des aliments bio, des travaux indiquent en effet que certains produits bio contiennent davantage d'antioxydants et de polyphénols. Cependant, tous les épidémiologistes confirmeront que l'on ne saurait en conclure à leur effet direct sur la santé, car il faudrait pour cela en consommer des quantités considérables. S'il est utile que ces éléments soient renforcés, le lien direct entre leur consommation et la santé ne peut donc pas être établi. L'enquête BioNutrinet 2013, quant à elle, qui porte sur l'obésité et les maladies cardio-vasculaires, a conclu que le régime alimentaire bio était plus sain, sachant que les consommateurs de produits bio respectent généralement davantage les recommandations alimentaires du programme national nutrition santé (PNNS) : ils consomment davantage de fruits et légumes, moins de produits carnés et moins de sodas. En 2017, les chercheurs ont approfondi leur analyse à partir de leur jeu de données et ont publié une nouvelle étude. Prenons une analogie : il arrive que les agriculteurs passent à l'agriculture biologique pour des raisons économiques mais cela ne me semble pas poser de problème, car cette conversion induit un changement de pratiques. Dans un premier temps, l'exploitant suivra le modèle dit « efficacité-substitution-reconceptualisation » (ESR) en remplaçant des produits non biologiques par d'autres plus favorables sur le plan écotoxicologique puis en reconceptualisant ses pratiques, par exemple en allongeant les rotations, en cultivant des légumineuses, et ainsi de suite. En clair, une reconversion est une trajectoire. Il en va de même pour le consommateur, qui ne se contente pas de remplacer une pizza surgelée conventionnelle par une pizza bio mais recompose ses achats, change parfois de distributeur en ne se fournissant plus en grande surface mais dans une petite supérette spécialisée. Il suit là aussi une trajectoire faite de changements systémiques. L'enquête BioNutrinet 2017 montre bien que l'agriculture bio produit un effet propre et ses auteurs font l'hypothèse que les résidus de pesticides pourraient avoir des effets liés aux perturbateurs endocriniens.
S'agissant des soutiens publics, la théorie de la « tragédie des biens communs » de Garrett Hardin explique comment une personne optimise sa production à court terme et à titre individuel, quitte à entraîner un préjudice sur une ressource dont il a besoin à moyen ou long terme. Une autre théorie économique classique, celle de Paul Samuelson, montre que la contribution volontaire – c'est-à-dire le fameux consentement à payer – ne suffit pas pour protéger les services publics et les biens communs. Vous et moi souhaitons acheter des produits plus bénéfiques à la santé et à l'environnement, mais nous ne pourrons pas consommer plus que ce que nous pouvons consommer à titre individuel. Il faut donc compléter le consentement à payer – qui pose par ailleurs un problème d'équité d'accès aux produits en question – par des politiques publiques visant à préserver ces biens communs. Nous avons donc passé en revue les propositions de différents chercheurs. En 2005, dans le rapport de l'INRA sur les pesticides, des économistes avaient déjà relevé que la mesure la plus efficace consisterait à taxer les pesticides, mais elle est parfois jugée politiquement incorrecte s'agissant d'une profession où 30 % des exploitants ont des revenus inférieurs au RSA. Il est difficile d'annoncer la taxation de personnes dont le revenu est inférieur de 1 000 euros au revenu moyen des Français : la taxation est souvent mal perçue pour une profession déjà stigmatisée. En revanche, la rémunération des services rendus donne une image plus positive de l'acte de production. D'autres mesures sont envisageables pour soutenir ces démarches vertueuses. Du côté des consommateurs, il peut être envisagé d'alléger la TVA sur les produits bio.

Je vous propose de conclure par la question du consentement à payer. S'agit-il du consentement de la société à payer pour des services systémiques, ou d'un consentement individuel ? Faut-il aligner par le bas le prix des produits biologiques sur le « faux » prix des produits conventionnels, qui n'intègre pas toutes les externalités négatives ? Au contraire, faut-il modifier le prix des produits conventionnels en intégrant ces externalités pour que l'on cesse de dire que le bio est plus cher ?
La notion de consentement à payer vise habituellement les consommateurs. Le consentement sociétal est différent : il relève davantage des politiques publiques. La solution pertinente me semble consister à combiner plusieurs outils, pour pondérer les différents éléments.
Les études montrent que, dans certains pays, les consommateurs achètent des produits bio principalement pour protéger leur santé ; en Allemagne et en Scandinavie, leur démarche est plutôt d'ordre environnemental. Le consentement à payer ne repose donc pas toujours sur les mêmes motivations. Si le produit en question possède des caractéristiques qui incitent le consommateur à payer davantage, il s'agit d'un consentement à payer individuel. En revanche, si la démarche du consommateur disposé à payer davantage concerne les biens communs et publics et la préservation des ressources, alors il s'agit plutôt du consentement à payer défendu par les collectivités – région, État ou Union européenne avec le deuxième pilier de la politique agricole commune (PAC), qui vise précisément à accompagner ces démarches vertueuses. En clair, le consentement à payer est individuel ou collectif selon l'objet visé.
Les choses évoluent : en France, les consommateurs privilégiaient traditionnellement la protection de la santé, mais des études montrent qu'ils intègrent de plus en plus des facteurs environnementaux dans leurs actes d'achat.
Le consentement à payer du consommateur me semble devoir être analysé à un instant T, en fonction des connaissances sur lesquelles il appuie son acte d'achat – raison pour laquelle la vulgarisation des données scientifiques, peut jouer un rôle important sur les tendances de consommation, comme l'illustre le cas des pesticides. Le consommateur de demain aura-t-il le même comportement que celui d'hier ?
À titre d'exemple, la commune de Mouans-Sartoux propose des menus 100 % bio aux élèves des cantines scolaires. Or, le coût n'est pas forcément supérieur si un effort de reconceptualisation est engagé, par exemple pour intégrer davantage de protéines végétales. Autre facteur important : les circuits courts et l'approvisionnement chez les producteurs locaux. Une étude de 60 millions de consommateurs concernant les marges dégagées par les distributeurs sur les produits bio a fait quelque bruit. Le consentement à payer est à géométrie variable.
Sans vouloir faire de politique, permettez-moi un clin d'oeil à la fameuse formule « en même temps », qui illustre parfaitement le développement durable : il faut combiner des enjeux économiques, environnementaux et sociaux. Cette conciliation passe nécessairement par des compromis. La démarche favorisant l'agriculture biologique et, plus globalement, l'écologisation des pratiques, requiert une action simultanée sur plusieurs dimensions « en même temps ». On ne saurait se préoccuper exclusivement du seul enjeu climatique, par exemple, en prenant des mesures massives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre par kilogramme de production, car cela pourrait revenir à supprimer des bandes fleuries et autres surfaces d'intérêt écologique. Il faut aborder « en même temps » différents enjeux environnementaux.
Cette action combinée est vertueuse mais elle peut être contreproductive si l'on vise la montée en gamme de l'agriculture française – c'est le sens des états généraux de l'alimentation et du plan « Ambition bio » – tout en ouvrant « en même temps » les frontières à des produits qui ne possèdent pas ces qualités. Les agriculteurs français s'en trouveraient frontalement exposés. Ce serait aussi contreproductif pour les consommateurs : les plus fortunés auront accès à des produits plus sains et les moins fortunés consommeront des produits bas de gamme, et les inégalités sociales s'en trouveront amplifiées. Or, l'alimentation industrielle est un marqueur d'inégalités sociales. Il serait donc perdant-perdant pour l'agriculteur et pour le consommateur d'encourager une montée en gamme tout en introduisant « en même temps » des produits de gamme inférieure. La formule est donc vertueuse mais doit susciter la vigilance.
Une étude nous a été commandée il y a trois ans pour répondre à la question suivante : l'agriculture bio peut-elle nourrir le monde ? La question, selon moi, était mauvaise : on ne saurait la décliner sans prendre en compte l'ensemble des enjeux – alimentation, environnement, emploi. Le scientifique ne peut apporter une réponse globale ; c'est une question de priorités et de cohérence pour adopter les compromis acceptables. Cela pose la question sous-jacente de la temporalité : il faut envisager une temporalité longue alors que les mandats politiques sont relativement courts. Autrement dit, il faut prendre des décisions à long terme malgré des échéances à court terme.
La séance est levée à dix heures vingt-cinq.
Membres présents ou excusés
Réunion du jeudi 28 juin 2018 à 9 h 15
Présents. - Mme Michèle Crouzet, M. Loïc Prud'homme
Excusés. - M. Julien Aubert, M. Christophe Bouillon, Mme Bérengère Poletti