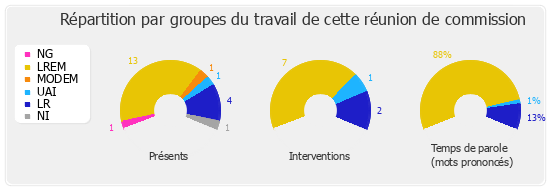Mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique
Réunion du mardi 31 juillet 2018 à 17h00
La réunion
Mission d'information DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS SUR LA RÉVISION DE LA LOI RELATIVE À LA BIOÉTHIQUE
Mardi 31 juillet 2018
La séance est ouverte à dix-sept heures cinq.
Présidence de M. Xavier Breton, président de la Mission
La Mission d'information de la conférence des présidents sur la révision de la loi relative à la bioéthique procède à l'audition de Audition de M. Emmanuel Hirsch, professeur des universités, directeur de l'Espace de réflexion éthique d'Île-de-France, de l'Espace national de réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives et du département de recherche en éthique (Université Paris-Sud Paris-Saclay)

Nous poursuivons les travaux de notre mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique en accueillant aujourd'hui le professeur Emmanuel Hirsch.
Professeur, je vous remercie d'avoir accepté d'échanger avec nous dans un délai très court. L'objectif de notre mission est de nous préparer aux débats à venir en nous informant des enjeux liés à la bioéthique.
Vous êtes professeur d'éthique médicale à la faculté de médecine de l'université Paris-Sud 11, directeur de l'Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France et de l'Espace national de réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives. Votre implication dans les questions à la croisée de l'éthique et de la médecine justifie à elle seule que la représentation nationale puisse bénéficier de votre éclairage et de vos réflexions.
M. Emmanuel Hirsch, professeur des universités, directeur de l'Espace régional de réflexion éthique d'Île-de-France, de l'Espace national de réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives et du département de recherche en éthique de l'université de Paris-Sud Paris-Saclay. Je vous remercie de votre invitation. Le Conseil consultatif national d'éthique (CCNE) a saisi les espaces de réflexion éthique régionaux pour animer le débat sur la bioéthique et en a tiré un rapport. Nous avons de notre côté pris plusieurs initiatives. Ainsi, à la rentrée, nous proposerons une université populaire de la bioéthique ouverte au public. Nous suivrons également les travaux parlementaires dans le cadre des rendez-vous « Bioéthique actu » qui sont déjà programmés. Bref, la réflexion ne fait pour nous que commencer.
Nous sommes très attentifs car on est dans un contexte de rupture et nous avons le sentiment qu'il faut réinventer la bioéthique. C'est pourquoi le quatrième tome de notre Traité de bioéthique s'intitule « Les nouveaux territoires de la bioéthique ». Trois éléments sont à revoir : ce dont on parle, comment on en parle et qui en parle. En effet, la légitimité et les modalités de régulation sont en crise. Je vous adresserai, au début du mois de septembre, ce traité réunissant soixante regards. La créativité en matière de bioéthique, au sens large du terme, étant assez impressionnante, la question est de savoir comment le législateur reconnaîtra une légitimité à ce qui se crée dans le champ universitaire. Je viens d'être nommé président du conseil d'éthique de Paris-Saclay et l'université a maintenant pour mission de former l'ensemble des doctorants aux questions d'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique. Mille doctorants ont participé en mai dernier à cette formation, sans y être contraints.
Il y a donc une demande d'appropriation de ces questions – demande qui ne se limite d'ailleurs pas aux doctorants et qui existe bien en amont. Il y a aussi une capacité de produire de la bioéthique au plus près de la réalité. Nous en avions eu l'intuition quand nous avons forgé en 1995 la notion d'espace éthique. J'ai créé l'espace éthique de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), à l'origine des espaces éthiques régionaux, en m'appuyant sur l'idée que ce sont les gens de terrain et les milieux associatifs qui ont une intelligence du réel. C'est cette intelligence du réel qui doit nourrir la réflexion des décideurs institutionnels et surtout les choix du politique. Nous distinguons l'éthique « d'en haut », un peu théorétique et en surplomb, et l'éthique « d'en bas » qui se construit et observons, déconcertés, l'écart existant entre le discours de la bioéthique et ses réalités concrètes, compte tenu de l'impact de toutes les avancées biomédicales et de toutes les innovations. Lorsqu'on lit le rapport de M. Cédric Villani, qui est pour moi la référence actuellement, on s'aperçoit qu'il est désormais envisagé de mesurer l'impact – notamment sociétal – d'une recherche, en amont d'un travail doctorant. Nous attendons beaucoup du Parlement, bien plus que des instances d'éthique qui font du « copier-coller » de rapports. L'Agence de la biomédecine a publié un rapport selon moi assez important qui disait à peu près tout et dont le contenu a été repris dans différents autres documents. J'espère que les parlementaires auront le courage d'être aussi disruptifs que le sont les inventions scientifiques.
Dans la troisième partie de son rapport de synthèse des États généraux de la bioéthique, intitulée « Enseignements à tirer », le CCNE met en exergue une inquiétude et une attente quant à la place de l'humain au coeur du système de santé. Il ne faudrait pas caricaturer la posture des gens qui ont exprimé leur inquiétude et en faire une opposition déraisonnable et obstinée à toute évolution. M. Jean-Louis Touraine, lors des débats auxquels il a participé, a vu qu'il y avait une intelligence de l'inquiétude et de la retenue qui est un bienfait pour notre démocratie. La prudence est une vertu qu'il ne faut pas négliger dans un contexte de compétition internationale et de dérégulation. Les parlementaires devraient être attentifs au fait que les gens expriment un besoin de repères. Il en va des grands équilibres de notre démocratie.
Il faudrait replacer la bioéthique dans le contexte des innovations disruptives. Il manque une pensée de cette nécessaire reconfiguration, surtout en comparaison d'autres initiatives menées, notamment, dans le champ du numérique. Dans ce domaine, les références pour moi sont le rapport de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et le rapport Villani. J'ai été frappé qu'avant de se lancer dans les États généraux de la bioéthique, on n'ait pas organisé quelques grandes conférences internationales sollicitant l'expertise du monde intellectuel – et pas uniquement celle des sciences humaines et sociales – car il y a dans ce monde intellectuel des compétences auxquelles on n'a pas fait appel en amont. La régionalisation du débat, fort sympathique, a conduit à l'énoncé d'évidences dont je ne vois pas bien l'utilité pour les arbitrages qui seront faits.
Ensuite, comment redéfinir les missions, les enjeux, les méthodes et les modalités de régulation de la bioéthique, non seulement sur le plan hexagonal mais également dans une perspective européenne et internationale ? De même que je suis assez désenchanté de voir le peu d'imprégnation culturelle des 128 avis du CCNE, je suis surpris de la qualité des textes internationaux de l'UNESCO en matière de bioéthique. On refait constamment le monde. Alors que les fondamentaux, débattus de manière passionnante au niveau international, sont là, leur mise en application est de plus en plus mise en péril.
De nouveaux champs de responsabilité émergent : selon quels principes et quels critères exercer cette responsabilité en pratique ? On a quelquefois le sentiment que les comités d'éthique servent à accompagner de manière bienséante la fin de certaines valeurs, un peu comme les soins palliatifs servent à accompagner la fin de vie. On ne peut pas être qu'adaptatif. Quel type de principes intangibles peut-on promouvoir dans une société qui remet en cause la légitimité et qui est fondée sur l'individualisme ? Toute la communication publicitaire des GAFA – Google, Apple, Facebook et Amazon – s'inscrit d'ailleurs dans ce cadre.
S'agissant des mutations observées dans le champ de la bioéthique, on assiste à une démédicalisation et à une socialisation d'enjeux relevant jusqu'ici du biomédical et à une neutralisation de leurs critères de justification. Cela n'est pas uniquement vrai dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation, avec l'ouverture éventuelle de cette assistance à la procréation à des couples de femmes ou à des femmes seules. Paradoxalement, parallèlement à cette démédicalisation, on médicalise de nouveaux territoires livrés à la connaissance et à l'intervention humaine comme les neurosciences. On se demande d'ailleurs si des limites sont encore possibles. Ensuite, l'intelligence artificielle défait ou destitue les médecins de leur autorité, de leur savoir, de leurs compétences et de leur capacité décisionnelle. Quelle autre légitimité mobiliser ?
Quand j'ai créé l'espace éthique à l'AP-HP en 1995, nous étions dans la dynamique très disruptive des « années sida » que M. Jean-Louis Touraine a très bien connue. Au moment où l'on crée à Paris-Saclay le conseil pour l'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique, qui sera à mon avis aussi disruptif que l'avait été l'espace éthique à l'origine, on assiste à une autre disruption dans le domaine numérique : celle de l'intelligence artificielle. Pendant les « années sida », les associations ont été très inventives et productrices de renouveau. C'est dire à quel point les capacités sont là : il faudrait les identifier pour créer les conditions d'un devenir qui soit moins désenchantant que celui que proposent les transhumanistes.
Que faire de l'idéalisation du « pouvoir d'anticiper » ? Lors du débat sur la fin de vie, ont été évoquées les notions de « personne de confiance » et de « directive anticipée ». Si certains considèrent qu'on assiste à une autonomisation de la personne, on assiste aussi à une soumission au devoir de tout anticiper. En matière de génomique, par exemple, les capacités de prédiction et la responsabilisation des personnes malades ou des personnes qui ne le sont pas encore justifieraient une réflexion sur la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades. Ce texte est devenu obsolète et ne concerne plus que les personnes malades : il n'aborde pas la chronicité ni les vulnérabilités. On se focalise en effet sur la bioéthique mais, en matière d'éthique du soin, la loi du 4 mars 2002 doit être revue.
Pour en revenir à la loi de 2011, le concept de bioéthique me semble épuisé, compilant les questions humaines et sociétales les plus complexes, dans un contexte de sécularisation. De nombreuses questions de bioéthique touchent en effet à des convictions et à des sensibilités individuelles, qu'elles soient culturelles, spirituelles ou religieuses. L'intitulé même de la loi de 2011 pourrait être reconsidéré : les termes de « bioéthique, innovations et société » me sembleraient préférable à ceux de « loi relative à la bioéthique » dès lors qu'on ne sait plus ce que recouvre le terme de bioéthique. De même, si le CCNE subsiste – ce que nous souhaitons tous –, il pourrait être rebaptisé comité consultatif de bioéthique comme son homologue belge, créé dix ans après, en 1993. On pourrait enfin modifier le nom des espaces éthiques. Cela n'a l'air de rien mais je le dis car la légitimité d'un comité pour évoquer les questions d'éthique peut se discuter longuement.
Je propose que cet intitulé reprenne les termes de « bioéthique, innovations et société ». Je pense en effet que la notion d'innovation doit figurer dans le titre du texte pour prendre en compte la nécessité de l'implémentation, de l'anticipation et des études d'impact. Quant à la référence à la société et au sociétal, je la suggère parce qu'il en va de la cohésion et des valeurs communes de notre société.
Que nous dit la réflexion éthique des valeurs de notre société et de notre capacité à défendre une visée politique qui soit démocratique et partagée ? Le principe de fraternité, par exemple, a fait irruption dans le débat public il y a quelques semaines. Or, il est en jeu de manière très tangible en matière de bioéthique, notamment avec le prélèvement et la greffe d'organes. C'est une chance pour la démocratie que de pouvoir aborder, frontalement et de manière constructive, les questions de bioéthique. Nous nous sommes rendus, au cours des États généraux de la bioéthique, dans un lycée peu représentatif des établissements privilégiés que fréquente l'élite française. Nous y avons fait travailler les classes de terminale sur la greffe d'organes. Les élèves ont produit une réflexion impressionnante du point de vue philosophique, politique et démocratique sur la solidarité et le don. La notion de bioéthique recouvre un ensemble d'éléments pouvant nourrir une réflexion sur la démocratie, la solidarité et nos responsabilités. La dimension politique ne doit pas être évitée. Où se situent la volonté et la responsabilité politique dans le domaine de la bioéthique ? De quelle manière les affirmer et les consacrer ? Quels arbitrages politiques seront rendus dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique ? Quels seront les renoncements, les acceptations et les restrictions ? À l'aide de quels arguments les justifiera-t-on ? Sera-t-on capable d'un renouvellement du discours et d'une créativité accompagnant l'implémentation sociétale de ces arbitrages ?
Dans la culture médicale, la bioéthique est née en 1947 avec le code de Nuremberg, après la Shoah et un an avant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qu'advient-il de cette Déclaration universelle dans un contexte de production biotechnologique susceptible d'altérer sa signification et de la disqualifier – ne serait-ce qu'au regard de nos devoirs universels ? Qu'en est-il de nos principes à l'épreuve d'avancées biotechnologiques dites disruptives ? Une continuité est-elle possible face aux ruptures systémiques ? Saura-t-on poser et signifier des conditions dans un contexte de relativisme idéologique, d'indifférenciation des repères et de compétitivité transnationale ? Peut-on inventer une démocratie bioéthique ?
Comme je l'ai dit, l'un des textes qui m'ont paru les plus intéressants ces derniers mois est le rapport Villani dont l'intitulé – Donner un sens à l'intelligence artificielle – est en lui-même remarquable. Cet objectif d'intelligibilité doit également être assigné à l'approche de la bioéthique. Faut-il se contenter d'adapter la loi aux évolutions biomédicales ou comprendra-t-on qu'il y a un enjeu supérieur aujourd'hui ? Dans les prolégomènes de son rapport, M. Villani écrit que l'enjeu n'est rien moins que le choix de la société dans laquelle nous devons vivre demain. Lorsque M. Jean-François Delfraissy a annoncé les États généraux de la bioéthique, il a repris une formule un peu analogue en se demandant quel monde nous voulions pour demain. Ces interrogations me semblent tout à fait pertinentes même si elles dépassent la première approche qu'on pourrait avoir d'une révision stricte du texte de la loi de 2011. Voilà des enjeux qui apparaissent dans deux textes et qui devraient animer nos réflexions et inspirer certains choix.
Certains éléments de langage du rapport Villani peuvent être transposés à la bioéthique. Le rapport préconise d'anticiper et d'accompagner la transition, d'intégrer la transformation dans le dialogue social et de créer un écosystème recherche-société, de développer des réseaux interdisciplinaires et de favoriser la créativité et la pédagogie innovante. Enfin, sont préconisées une recherche agile et diffusante et une évolution permettant de passer de la concertation citoyenne à l'évaluation citoyenne. La plupart des gens que nous avons rencontrés au cours des États généraux nous ont dit qu'ils ne voulaient pas être trompés comme ils l'avaient été par la loi Claeys-Leonetti – la concertation de l'époque ayant fait « pschitt » puisque les décideurs politiques ont pensé que la société était plus avancée qu'elle ne l'était réellement.
Un autre texte que je vous invite à lire est le rapport de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de décembre 2017. Son intitulé soulève à lui seul une question de fond : Comment permettre à l'homme de garder la main ? Je citerai quatre extraits de ce rapport.
Première citation : « La réflexion éthique porte sur des choix de société décisifs. » Dans le domaine de la bioéthique, on a de plus en plus le sentiment que les décisions qui sont prises – ou que l'absence de décisions prises – en ce moment sont irréversibles. Alors que la bioéthique d'hier intéressait surtout les médecins et était sans grande portée, elle entre aujourd'hui dans le champ de l'irrévocable. La recherche et certaines pratiques ont un impact qui soulève la question de notre responsabilité vis-à-vis des générations futures, que ce soit en matière génomique ou de tri embryonnaire, notamment. « La réflexion éthique porte sur des choix de société décisifs et ne saurait se construire indépendamment d'une prise en compte de cette dimension pluraliste et collective », nous dit la CNIL.
Deuxième citation : « L'évolution technologique déplace la limite entre le possible et l'impossible et nécessite de redéfinir la limite entre le souhaitable et le non souhaitable. » Le Président de la République apprécie Paul Ricoeur qui, lui, parle du préférable, mais si j'étais parlementaire, je m'interrogerais sur la limite entre le possible et l'impossible, qui est de plus en plus transgressée. Quand on voit les enjeux économiques et financiers qui régulent toute la recherche, on peut s'inquiéter de savoir qui va définir le souhaitable et par rapport à quels intérêts.
Troisième citation : « Les algorithmes et l'intelligence artificielle conduisent à une forme de dilatation de figures d'autorité traditionnelles, de décideurs, de responsables, voire de l'autorité même de la règle de droit. » Les gens ont effectivement un sentiment d'impuissance qui me semble très dangereux tant il jette de discrédit. Si nous ne réconcilions pas notre société avec une science responsable et avec des politiques qui soient en capacité de déterminer certaines orientations, nous irons vers davantage de difficultés que nous n'en avons déjà.
Enfin, je ferai une dernière citation : « Le développement de ces technologies peut affecter l'une des composantes de l'identité et de la dignité humaine, à savoir sa liberté et sa responsabilité. » On est face à une envie profonde de démocratie, bien loin de la caricature qu'on a faite de gens ayant une posture très idéologique, voire religieuse, réfractaire à tout progrès, et à la crainte que cette démocratie soit remise en cause par certains renoncements.

Quelle doit être, selon vous, l'implication des universités face aux nouveaux enjeux de l'intelligence artificielle et de la robotisation ? Faites-vous un travail en commun avec les autres espaces régionaux, au-delà des périodes de révision de la loi de bioéthique ? Enfin, vous avez soulevé la question des principes intangibles de la bioéthique : menez-vous une réflexion sur ces principes qui puisse être prise en compte ?
Pour répondre à votre première question, le Parlement doit s'approprier sans pusillanimité les questions de bioéthique. On a conféré une légitimité à trop d'instances et de structures, et ce, au détriment de la créativité. Vous savez probablement que, conformément au souhait de M. Thierry Mandon, chaque université doit désormais développer des formations à l'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique et instituer des comités de soutien aux chercheurs qui interviennent au début de leur recherche pour identifier les enjeux et impacts éthiques de celle-ci. L'université de Paris-Saclay a donc créé, au niveau de sa présidence, un conseil pour l'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique. Je suis en train, depuis deux ans, de configurer cette structure qui a été créée il y a quelques mois. L'appétence des enseignants chercheurs et des étudiants pour ces questions est impressionnante. C'est la part la plus positive et la plus excitante de ce que j'ai vécu ces derniers mois. Il y a une envie d'éthique – une envie de prendre des responsabilités, de les assumer et de leur donner du sens – qui est indépendante de la course à la publication. Il y a une vraie créativité à l'université et il faudrait peut-être que vous consultiez les différents présidents d'université, chacun proposant une offre spécifique.
Il importe en tout cas de prendre en compte la transversalité de la question éthique, qui est au carrefour entre les sciences dites « dures » et les sciences humaines et sociales. Outre l'interdisciplinarité, il faut aussi prendre en compte l'ensemble des équipes et les étudiants. Cette créativité se retrouve non seulement à l'université mais aussi dans les organismes de recherche et ce dans ce qu'on appelle dans le jargon médical les « sociétés savantes ». Dans le domaine de l'intelligence artificielle, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait une initiative intéressante en matière d'éthique. Dans son rapport, M. Villani préconise la création d'une instance d'éthique chargée de l'intelligence artificielle mais il existe aussi des comités d'éthique dans nombre d'organismes de recherche tels que l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et le CNRS. Le paysage étant très composite, la question est de savoir comment donner de la cohésion et de la cohérence à toutes ces initiatives. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de chef d'orchestre. Ainsi, le CCNE a rendu 128 avis ; or qui connaît la qualité, la diversité et la richesse de ces avis ainsi que celle des rapports du Comité ? Cette intelligence n'est absolument pas exploitée. Le CCNE annonce que les États généraux seront animés par les espaces éthiques alors que selon moi, la mission du Comité était précisément d'organiser ces États généraux, comme l'a fait la CNIL. D'ailleurs, les États généraux qui ont été organisés ne correspondent pas du tout à la définition qui en a été faite par la loi. Bref, il faudrait que vous auditionniez les présidents d'université et que la future loi comporte des dispositions en matière de formation et de sensibilisation. Nous pourrons vous donner des éléments de langage à ce propos, tant nous sommes impressionnés par ce qui se fait – y compris de longue date dans d'autres universités dans le monde. Il faut adopter une démarche de responsabilisation des acteurs.
S'agissant des espaces éthiques régionaux, je ne me prononcerai pas car, du fait d'un concours de circonstances assez inattendu, je suis encore directeur de l'espace éthique de l'AP-HP alors que j'aurais dû interrompre mes fonctions en avril dernier pour ne plus m'occuper que de l'université de Paris-Saclay. J'ai indiqué à l'agence régionale de santé que j'acceptais de rester à l'espace éthique de l'AP-HP pour y réinventer un modèle, le modèle actuel datant de 1995. Il y a, depuis, de nouveaux enjeux et de nouvelles légitimités et le milieu associatif a évolué. Si vous voulez nous auditionner en décembre prochain, nous aurons une proposition à faire sur ce que peut être un espace éthique dans le contexte actuel. Eu égard à la production des espaces éthiques lors des États généraux, je ne me prononcerai que sur la nôtre. Nous avons surtout abordé la thématique biomédicale sous l'angle des nouvelles technologies. Ces États généraux ont été pour nous l'occasion formidable d'organiser des rencontres qui nous ont vraiment enrichis, de créer des réseaux et de penser une évolution disruptive de l'espace éthique d'Île-de-France. Le rapport du CCNE sur les États généraux de la bioéthique est plus intéressant que certaines des conférences organisées par les espaces éthiques régionaux dans des lycées ou des cinémas. Je resterai synthétique dans ma réponse pour ne pas être inconvenant.
Enfin, repenser nos principes intangibles est un enjeu fondamental dont j'ai notamment discuté avec la juriste Valérie Depadt. En tant que citoyen, j'attends de la loi de bioéthique qu'elle rappelle la pertinence de certains principes intangibles – dans une perspective internationale. Sans principes intangibles, ce n'est pas la peine de réécrire ce texte. Je pourrais vous donner des idées mais je n'ai pas légitimité pour intervenir sur ce sujet.

Vous dites qu'il est temps de réinventer la bioéthique. Il est peut-être temps aussi de réinventer la façon dont le Parlement s'approprie cette réflexion. Avec le président Xavier Breton, nous nous sommes dit qu'en plus de la périodicité quinquennale des révisions de la loi de bioéthique, il serait indispensable qu'il y ait une structure parlementaire permanente qui pourrait constamment nourrir sa réflexion et apporter sa compétence à tous les députés qui s'intéressent à la bioéthique. Cela permettrait d'éviter l'alternance entre périodes extrêmement intenses et périodes de latence prolongée. Qu'en pensez-vous ? Par ailleurs, faut-il organiser des États généraux tous les cinq ans ou vous interrogez-vous quant à leur pertinence et à leurs modalités de fonctionnement ?
Vous avez évoqué le sentiment d'impuissance, voire d'inquiétude ou d'angoisse, qui peut engendrer chez certains de la frilosité et de l'immobilisme. On a un peu l'impression d'être passé, en un demi-siècle, des excès du scientisme au refus du progrès dans certains segments de la population. Un fossé s'est creusé entre ceux qui ont confiance en la possibilité de s'approprier positivement l'évolution et ceux qui la redoutent. Pour éviter que ce fossé se creuse encore davantage, ne serait-il pas bénéfique d'assurer une plus grande participation de tous à cette réflexion plutôt que de laisser certains de côté et de susciter des positions antagonistes ? Cette participation concernerait bien sûr tous les professionnels de la santé et de la recherche mais aussi toute la population. Pour l'instant, seule une très faible proportion de nos concitoyens s'implique dans les consultations qui sont organisées. Il est peut-être dangereux que toutes les décisions soient déléguées aux seuls experts. Il faut que la prise de décision reste un processus démocratique et que ce processus, loin de se limiter à l'élaboration des lois, suscite la réflexion personnelle.
Enfin, comment maintenir le doute ? Comment l'entretenir ? Même dans les sciences dures, on constate parfois des erreurs, voire des falsifications. La presse montre régulièrement qu'aucun continent n'échappe à ce risque – omniprésent, a fortiori, dans les sciences humaines. Le doute est donc indispensable mais le député doit malgré tout arbitrer quand il légifère. Faut-il qu'il prenne ses responsabilités tout en ayant à l'esprit l'éventualité que ses décisions soient remises en cause lors de la révision ultérieure des textes ? Quant au médecin, même en cas de doute, il doit décider et être capable de le faire sans hésiter mais il ne doit pas omettre le droit du malade à faire ses propres choix. La loi de 2002 a reconnu des droits que les associations de malades sidéens avaient revendiqués puis conquis. N'est-on pas au milieu du gué ? N'a-t-on pas souvent l'impression que le malade n'est que partiellement entendu par les professionnels de santé ? Comment les droits du malade doivent-ils progresser ? Comment maintenir le doute dans la réflexion des professionnels de santé ?
Je découvre des territoires immenses ! Devant vous, je suis avant tout un citoyen qui partage des doutes, des suspicions et des interrogations.
En premier lieu, il vous faut réfléchir à l'évolution du périmètre du concept de bioéthique. Dans un article rédigé pour Le Figaro au début des États généraux, j'évoquais la bioéthique « d'hier » et celle à inventer. La rupture est fondamentale, et certains concepts de l'éthique doivent être réinventés.
La situation actuelle est disruptive : il va être compliqué de penser intelligemment le futur avec des concepts datés, d'autant plus qu'il est impossible de tout anticiper car le paysage se recompose perpétuellement. Nous sommes dépassés par l'évolution des choses… C'est toute l'intelligence du rapport Villani : il ne s'est pas contenté de confier l'animation à des espaces éthiques, mais a consulté des experts internationaux. La mise en relation des questions et de ces intelligences a produit des repères.
Pour répondre à M. Touraine, s'agissant de la régulation de la bioéthique, je cerne mal ce qui distingue actuellement l'approche française. Nous devons être plus créatifs et nous réinventer, voire surprendre. Pourquoi ne pas repositionner la bioéthique là où elle doit l'être, au niveau politique plutôt que scientifique, par exemple ? Les consultations que vous allez mener doivent vous permettre de produire une intelligence collective.
Je serai inquiet si l'on se limite à adapter une législation déjà tiraillée par les contradictions et qui va finir par imploser. Le numérique est une révolution pour nos modes de vie et dans notre relation à l'autre, à notre histoire et au monde. Si nous n'intégrons pas ces ces profondes ruptures dans nos représentations, nous passerons à côté…
J'ai trouvé surprenant que le rapport Villani soit publié au moment des États généraux de la bioéthique. Je vous ai répondu assez brutalement en estimant que cela avait démonétisé le travail réalisé par les espaces éthiques : quelle que soit la qualité de notre réflexion, elle est relativement inconsistante au regard de l'intelligence produite dans un rapport de cette nature.
La CNIL est également capable d'organiser des débats permettant de produire une intelligence collective et utile : elle a organisé une centaine de débats, en utilisant une méthodologie bien précise, avec des jurys citoyens formés selon des règles extrêmement strictes. Ce type d'approche existe donc et est très satisfaisant. Nous devrions l'intégrer dans notre réflexion sur la bioéthique.
En outre, il me semble fondamental d'anticiper. Quelle instance est capable d'anticiper et peut également prendre la responsabilité de décider ? Réguler, c'est peut-être également évaluer les enjeux industriels, économiques et stratégiques d'un domaine – la recherche médicale par exemple.
Dans le texte que je vous ai adressé, je reviens sur ma principale conclusion des rencontres des derniers mois : les gens se sentent progressivement dépossédés de ce qu'ils sont – leur culture, leur histoire, ce qu'était leur représentation de la vie et de la société. Votre vision de parlementaires est sans doute différente, du fait de votre expertise, mais de nombreux Français se sentent très vulnérables, ont peur et ressentent pleinement la violence de technologies indifférentes au bien commun. Face à cette inquiétude, quels éléments allez-vous produire pour leur permettre de reprendre confiance et leur faire comprendre qu'il y aura un pilote dans l'avion ?
Les responsables d'instances éthiques identifient des thématiques, argumentent mais sont plutôt dans le constat. Ainsi, par exemple, s'agissant de l'utilisation du « ciseau génomique » CRISPR-Cas 9, toute la communauté internationale est mobilisée et, en avril, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a organisé un colloque international. Qu'a-t-on constaté ? Que l'on est dépassé par certaines pratiques, notamment celles de pays qui n'ont absolument pas les mêmes préoccupations bioéthiques, voire éthiques, que nous… Nous devons aussi le prendre en compte. Mais si l'on est trop prudent – les chercheurs vous le diront –, ne passe-t-on pas à côté de belles opportunités, par exemple dans l'intérêt supérieur de la personne malade ?
Monsieur le rapporteur, vous évoquiez l'importance de maintenir le doute. Nous n'avons pas besoin de le maintenir, car nous ne sommes plus que dans le doute et la suspicion ! C'est pourquoi nous avons vraiment besoin de repères, d'horizon et d'objectifs fixés par étapes. Actuellement, les événements semblent nous dominer : chaque jour, chaque heure, une nouvelle information nous déplace, nous détourne et nous fait douter profondément. Mêmes les chercheurs qui étudient des thématiques pointues ne savent plus si elles seront encore pertinentes demain…
Dans ce contexte, la décision politique est extrêmement délicate et aléatoire, mais elle est préférable à l'attentisme ou au transfert de responsabilité vers des comités d'éthique, chargés de produire des textes théoriques qui ne rassurent personne.
Dernier point, la question des droits du malade : elle me semble un peu obsolète puisque les avancées en génomique renouvellent le concept même de malade. Les normes évoluent et une forme de biopouvoir est exercée avant même le début de l'existence, dénotant une volonté de nous « augmenter », mais aussi de nous sélectionner selon des normes et des critères tolérés au nom d'une certaine idée de la science, de ses performances et de ses finalités.
Même si je vous le dis assez maladroitement, ce qui nous manque le plus, ce sont des éclairages épistémologiques : que se joue-t-il derrière ces évolutions ? Sommes-nous prêts à consentir à cette soumission volontaire « pour notre plus grand bien » ?
Pour conclure, je reviendrai aux questions de M. Touraine : la richesse du moment, c'est précisément ces questionnements qui nous touchent et sont de l'ordre du politique, voire de la métaphysique. Serons-nous à la hauteur ? Saurons-nous produire une réflexion digne de ces avancées totalement imprévisibles, voire irreprésentables et inimaginables ?
Il peut être tentant de se laisser bercer par les chants du transhumanisme et de déposer les armes au motif que l'évolution est irréversible. Mais aborder ces questions, c'est être capable de résister, pas uniquement pour des raisons morales ou religieuses, mais au nom de ce que l'humanisme a fait et de nos conquêtes en matière de liberté et de dignité.
Mon texte le souligne : l'enjeu est clairement politique. Si l'on cède aujourd'hui à la tentation d'un ajustement dont on sait qu'il sera très provisoire, dans ce contexte d'évolutivité constante et de domination de certains groupes, il ne faudra plus dire demain que nous sommes encore en démocratie. En la matière, les résolutions européennes mises en oeuvre le 25 mai ne sont pas totalement rassurantes. Nous ne sommes pas assez attentifs aux mouvements tectoniques en cours.
Aurez-vous, ainsi que le Gouvernement, le courage politique de défendre des lignes intangibles et, ce faisant, la démocratie ?

Je vous remercie pour ces premiers échanges sur le cadre et les enjeux de la bioéthique. Je vous remercie également par avance de la note écrite que vous allez nous transmettre, qui développera davantage cette réflexion essentielle.
Ma question intervient dans un champ plus ciblé. Elle est rarement abordée mais importante. Environ 200 enfants naissent chaque année avec un trouble du développement sexuel et génital. On parle d'enfants intersexes. Il s'agit de situations médicales congénitales, caractérisées par un développement atypique du sexe, chromosomique ou anatomique, qui rend impossible la détermination du sexe définitif de la personne.
Or lorsqu'un doute existe sur le sexe d'un nouveau-né, un choix doit être effectué, bien souvent après un traitement ou une intervention chirurgicale qui vise à modifier cette anomalie génitale et sexuelle. Ces interventions font débat car certaines ne répondent pas à un besoin thérapeutique ou médical. Mais, surtout, elles se fondent sur la seule volonté des parents et l'avis d'un médecin, sans le consentement direct de l'enfant.
Les associations de personnes intersexes plaident pour l'inscription d'un sexe à l'état civil dès la naissance, sans que cela soit conditionné par un traitement ou une intervention chirurgicale. Elles réclament le libre consentement de l'individu concerné, une fois atteint l'âge auquel il peut opérer un choix libre et éclairé.
J'aimerais connaître votre avis sur le sujet : appartient-il au législateur de mieux encadrer ces situations, afin de prendre en compte le ressenti des personnes concernées et leur consentement ?
Notre espace éthique a eu à coeur de débattre de l'importante question du transexualisme dès 1996. Nous y avons d'ailleurs réfléchi avec M. Benjamin Pitcho, avocat spécialiste de ce sujet, que vous pourriez utilement rencontrer.
Certes, par rapport aux grandes questions de génomique et à l'éthique « d'en haut », on pourrait considérer que c'est une question anecdotique. Mais, au contraire, c'est une question fondamentale liée aux droits de la personne, à nos attitudes normatives, à nos penchants pour la discrimination et à notre responsabilité éthique.
Sur ce sujet, je partage l'avis que le Conseil d'État a émis dans son rapport. Il me semble extrêmement respectueux de la personne – notamment de l'enfant. Cette attitude prudente et la possibilité de progressivité sont particulièrement importantes.
Vous attendez sans doute une réponse précise de ma part, mais je dois vous avouer que je suis très gêné d'intervenir devant votre mission d'information. J'interviens et rencontre au quotidien des gens qui me posent des questions, et je ne me sens pas légitime, en tant que professeur d'éthique ou responsable d'un espace éthique, pour vous faire part de mes réflexions ou de mes convictions sur ces sujets. Si j'étais parlementaire, je m'exprimerais différemment ! Mes propos peuvent vous paraître quelque peu inconsistants, mais le texte que je vous transmettrai sera plus structuré.
Madame, c'est l'honneur du Parlement que de considérer ces questions comme importantes, tout comme celle de l'intelligence artificielle par rapport aux personnes vulnérables ou atteintes de maladies neurodégénératives. Nous sommes régulièrement confrontés à un dilemme, entre les bienfaits extraordinaires de ces évolutions et une évaluation plus critique de leurs conséquences.

Merci, monsieur le professeur, pour cet éclairage bienvenu. Je voudrais vous interroger sur l'intelligence artificielle et les données de santé.
On avait le sentiment, en France, de disposer d'une base de données – notamment médico-administratives – importante. Mais on s'est rendu compte, par exemple à l'occasion d'un « datathon » organisé par l'AP-HP en janvier, qu'on devait faire appel à des bases de données américaines pour travailler sur des schémas prédictifs ; je pense plus particulièrement à un algorithme visant à de prédire les chocs septiques de certains patients dans les services de réanimation. Ainsi, les données cliniques nécessaires pour travailler sur ce sujet sont venues des États-Unis. De la même façon, un certain nombre de start-up françaises comme Cardiologs, qui traite de la donnée fournie par des électrocardiogrammes pour analyser de façon automatisée des pathologies et l'évolution de l'état de santé de patients, ont dû faire appel à des données d'autres pays.
On peut se demander comment élargir nos sources de données et trouver un équilibre entre la légitime protection de ces données, notamment contre leur utilisation par les assurances, et l'innovation qu'il convient d'encourager, comme le préconise notre collègue Villani, pour faire de notre pays un leader dans ce domaine. Mais pour cela, il faudrait que nous ayons un accès plus large aux données cliniques – et pas seulement administratives – détenues par les hôpitaux, et que les patients acceptent que tout un pan de l'économie ait accès à ces données.
Comment positionner le curseur entre le besoin d'innovation et le besoin de sécurité et de protection des données personnelles ? Pensez-vous qu'on est allé trop loin, ou pas assez ?
Je serai assez rapide, dans la mesure où la réflexion est assez dense en la matière.
On s'est aperçu que, dès le départ, il y avait des biais dans la constitution des bases de données – même dans les grandes bases américaines. Cela a des effets tout à fait péjoratifs.
Je remarquerai ensuite qu'à l'AP-HP certaines explorations basées sur des données ont de quoi surprendre. Je pense à la conclusion d'une étude dont m'a parlé mon épouse – qui est anesthésiste-réanimatrice : lorsque les réanimateurs se parlent entre eux, l'issue est plus favorable pour les malades que s'ils ne le font pas. Avait-on besoin d'exploiter des données pour arriver à ce type de conclusion ? Les données doivent-elles légitimer ce qui relève d'une évidence ? Cela peut paraître anecdotique, mais je ferai une distinction entre ce qui est de l'ordre de l'innovation et le côté naturel des pratiques amont, que les normes et les prescriptions actuelles ont tendance à remettre en cause de plus en plus souvent.
Un débat important a eu lieu, dans le cadre de la loi de modernisation de notre système de santé, sur le cryptage des données de santé et sur la possibilité de lever, dans certaines circonstances, et dans l'intérêt général, la confidentialité de celles-ci.
En tant que citoyen observant la réalité, j'ai le sentiment qu'on n'arrivera pas à préserver la confidentialité de certaines données. Pensez à l'avancée des technologies, au travail des hackers, au piratage de structures américaines par des Chinois pour obtenir des données en cancérologie, etc. Et encore, on ne dit pas tout ! Certes, il est bon d'observer une certaine prudence. Mais c'est comme la notion de secret médical, sur laquelle on peut s'interroger : que respecte-t-on quand on respecte le secret médical ?
Pour ma part, même si cela peut vous paraître maladroit, je ne crois pas qu'il faille être obsédé par cette question, dans la mesure où la bataille est déjà perdue en raison du contexte de dérégulation et de développement des capacités technologiques que nous connaissons. C'est comme pour l'accès à ses origines dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation (AMP) : maintenant que c'est possible, on pourra toujours vouloir réguler…
La vraie question, qui me paraît plus intéressante, est la suivante : si certaines études permettent d'identifier des éléments éventuellement favorables à la santé d'une personne, et que l'on est dans un contexte d'anonymat mais avec une possibilité de réversibilité, utilise-t-on cette possibilité lorsque la personne n'était pas informée que l'on faisait ces études sur ses données personnelles – même si celles-ci sont agglomérées de façon à les rendre indistinctes ?
Cela nous amène, d'une certaine manière, au concept de réciprocité qui a été évoqué dans le rapport du CCNE publié à la suite des États généraux de la bioéthique. Ce concept, qui fait partie des fondamentaux, me semble devoir être exploré. Cela intéressera M. Jean-Louis Touraine, puisqu'il s'agit des greffes d'organes.
Au cours des débats, certaines personnes ont dit que si une personne était inscrite sur le registre des refus, elle ne devrait pas prétendre à bénéficier d'organes. Cela renvoie, dans le domaine de l'éthique de la recherche, à la notion de partenariat, de mutualisation, d'intérêt partagé. De plus en plus de gens sont prêts à transgresser certaines règles dans un souci de solidarité et de réciprocité.
Mais revenons aux données de santé. Pour ma part, j'irai plus loin : en quoi sommes-nous propriétaires de nos données ? Dès lors que l'on bénéficie de recherches qui ont été faites sur d'autres, n'a-t-on pas aussi un devoir de responsabilité ? Je sacralise moins ces questions qu'on ne le fait généralement. Certes, comme on l'a dit, certaines données relèvent du privé, de l'intime. Les assurances, notamment, pourraient en faire un usage discriminatoire. Mais, sur le fond, je considère que je bénéficie à titre personnel de recherches qui ont été faites sur d'autres. Au nom de quelle valeur puis-je refuser de m'inscrire dans cette même solidarité ?
J'ai été frappé lorsque l'on a discuté, à l'occasion de la loi du 4 mars 2002, de l'accès direct au dossier médical : les gens peuvent gérer eux-mêmes un certain nombre de données et les mettre à disposition d'assureurs ; ainsi, ils prennent une certaine responsabilité. Reste à savoir de quel type d'éducation ils ont bénéficié et quelle information on leur a apportée.
Ce sont toutes les questions que je me pose. Mais je suis plus intéressé, en amont, par ce qui peut se pratiquer aujourd'hui dans un contexte non médical car, là aussi, il y a intrusion dans la sphère privée, ou par les pratiques des GAFAM qui exploitent un certain nombre de données dans un contexte totalement dérégulé.
D'un point de vue éthique, j'essaierais de voir quels sont les fondamentaux. Je pense que certaines données nous concernent quand elles touchent au privé, à l'intime, à notre identité. Mais il faut aussi comprendre que nous sommes dans une société et que nous bénéficions mutuellement de la recherche. Tous ces devoirs, toutes ces obligations m'amènent parfois à douter de certaines revendications qui s'appuient sur des droits théoriques.

J'avoue ne pas avoir cerné tous vos propos, parfois allusifs. Peut-être est-ce dû au temps limité ou à une pudeur qui vous honore. Cela étant, j'ai deux questions à vous poser.
Vous avez mentionné à plusieurs reprises la démocratie. Dans leur majorité, les Français seraient favorables à une légalisation de l'euthanasie. C'est en tout cas ce que déclarent les personnes en bonne santé au « café du commerce ». Mais récemment, j'ai visité un institut de cancérologie qui accueille près de 4 000 patients par an et je me suis rendu compte que parmi les personnes concernées concrètement par la fin de vie, une dizaine seulement demandaient un suicide assisté. Quand les soins palliatifs sans acharnement thérapeutique sont mis en place et que la douleur est soulagée, la demande s'estompe. Ainsi, sur le terrain, la démocratie prend une voie tout autre. Prônez-vous une démocratie qui serait fondée sur des sondages mal posés ou sur d'apparentes attentes sociétales ?
Vous avez également évoqué à plusieurs reprises la légitimité, et vous avez dit qu'il faudrait réinventer les espaces éthiques. Considérez-vous que ceux qui s'expriment aujourd'hui sur les questions de bioéthique ne sont pas légitimes, tout comme ceux qui se sont exprimés dans le cadre des États généraux de la bioéthique ?

Monsieur le professeur, vous avez déclaré que les Français avaient de plus en plus besoin d'éthique. Et vous avez dit, à propos des États généraux de la bioéthique, qu'il ne fallait pas tromper les Français. Pourriez-vous développer ces propos ?

Vous avez dit tout à l'heure que certaines personnes seraient « réfractaires au progrès ». Comment envisagez-vous le progrès ? Pensez-vous qu'il soit à sens unique ? Ne sommes-nous pas confrontés aussi à des questions de protection de la vie ?
Par ailleurs, vous avez indiqué à plusieurs reprises dans vos travaux et dans vos publications qu'il y avait une bioéthique « d'hier », et qu'il fallait inventer une bioéthique « de demain ». Vous avez également insisté sur le fait qu'il fallait renouveler les principes. D'où cette question assez simple : selon vous, quels principes doivent prévaloir ?
En préalable, je dirai que la fin de vie ne fait pas partie de la bioéthique. C'est un élément à prendre en compte – c'est pour cela que nous avons des lois à mon sens un peu disparates –, même si, par ailleurs, rien n'indique que la fin de vie n'a pas à se retrouver dans la bioéthique. Tout cela est un peu surprenant, et amène à penser qu'un toilettage législatif serait utile. Mais on peut également être surpris de la façon dont on a souhaité refaire le débat : même si c'était justifié, je ne suis pas certain que le contexte de la révision de la loi bioéthique soit le meilleur.
Pour répondre à votre question, monsieur Bazin, je m'exprime peut-être mal devant une commission parlementaire, mais j'écris de temps en temps des articles. Au moins, je suis clair dans mes positions.
J'ai participé à la création du mouvement des soins palliatifs en France, dont je ne remets pas en cause la démarche. Mais je remets en cause la loi Claeys-Leonetti sur la sédation profonde et continue. C'est le seul point sur lequel on pourra discuter.
Pour moi, la sédation profonde et continue est à ce point l'équivalent d'une forme d'euthanasie qu'il en est résulté une suspicion ainsi que des difficultés dans les pratiques et dans la perception des gens. Encore une fois, ce n'est pas moi qui ai introduit cette notion de « sédation profonde et continue ». Il y avait une véritable stratégie élyséenne pour aboutir à une telle confusion. Donc, soit on revient sur la loi et on supprime la sédation profonde et continue, soit on est honnête et démocrate, et on introduit le mot « euthanasie ». Ma position actuelle est aussi simple que cela.
J'observe, monsieur Bazin, que les gens ne sont pas contraints le jour où ils sont en situation de demander le suicide médicalement assisté ou l'euthanasie. Et, de la même façon que pour rédiger des directives anticipées, ils peuvent s'exprimer à un moment donné dans un sens, puis revenir sur leur position.
La vraie question qui se pose est la suivante : que représente symboliquement, pour une société, le fait de légiférer sur l'euthanasie, avec des conséquences qu'on peut ne pas maîtriser, notamment sur les personnes vulnérables ? Même si je n'ai pas envie de répondre sur le fond, je peux en discuter. J'ai d'ailleurs déjà été reçu par une commission parlementaire pour parler de la fin de vie. Et, encore une fois, je ne suis pas pour la République des sondages : la démocratie, ce n'est pas cela.
On a dit que les espaces éthiques allaient organiser des débats, de la mi-janvier jusqu'à la fin avril, sans qu'on ait mis au point une méthodologie, sans qu'on ait effectué un travail de fond pour permettre aux espaces éthiques, qui ont l'expérience de tel ou tel type de questionnement, chacun dans leur champ d'activité, de donner leur avis sur la façon de procéder et de discuter entre eux.
Je vous suggère de regarder, sur le site internet de l'espace éthique d'Île-de-France, dans la partie « bioéthique », la méthodologie que nous avons suivie : nous avons constitué un groupe, un « conseil d'orientation », mis en place une charte et adopté une méthode – nous nous en sommes tenus aux thématiques de la bioéthique, tout en recherchant une certaine pluridisciplinarité, etc.
Je trouve qu'il y a quelque chose de démagogique et peut-être de pervers à dire : « Venez à nos réunions de bioéthique, on va parler, on fera une synthèse que l'on enverra au CCNE, qui fera son rapport et vous pouvez être certain que votre opinion sera prise en compte. »
Déjà, on n'avait pas besoin d'organiser des États généraux pour connaître l'opinion des gens sur ces questions. Il y a eu d'autres moments dans l'histoire récente, d'un point de vue politique, pour s'en faire une idée.
Ensuite, la démocratie, qui est au coeur de ma préoccupation, consiste à responsabiliser chacun et à associer, dans un processus décisionnel, les compétences et les expertises des uns et des autres. De ce point de vue, puisque vous abordez la question de la fin de vie, pour moi, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs n'a pas toute légitimité à dire ce qu'est une « bonne mort » ni ce qu'est la fin de vie. Il existe d'autres expertises, d'autres compétences, et la société évolue par rapport à ces questions.
Je suis gêné lorsqu'on nous indique quelle est l'opinion de la société sur tel et tel sujet. Cela ne figure pas totalement dans le rapport du CCNE, mais cela aurait pu être une déviance, car celui-ci comprend plusieurs parties : expertises, espaces éthiques, audits et sociétés savantes. Un danger aurait été de dire, à l'occasion des États généraux, quel était le sentiment de l'opinion publique par rapport à ces questions, et de dire qu'il faudrait en tenir compte.
Ce qui manque, c'est un travail en amont, un travail qui aurait permis de répondre à une question qui a déjà été soulevée : quel type d'instance peut assurer l'information des citoyens d'une manière continue et progressive, notamment à travers les médias ? D'ailleurs, quoi qu'on en dise, on n'a pas organisé grand-chose pour préparer ces États généraux – quelques conférences de presse, très peu d'articles de fond dans la grande presse, et très peu d'émissions télévisées.
Vous pourrez lire, dans mon petit texte, ce que je pense de la nécessité de former, d'éduquer, de conscientiser, de responsabiliser, d'inventer de nouvelles modalités de discussion et de concertation. Mais à un moment donné, c'est au Parlement de se prononcer : nous avons une représentation nationale ! Maintenant, sur des domaines aussi sensibles, aussi délicats, comment arriver à prendre des positions parfois transgressives, voire disruptives ?
Vous vous êtes interrogés sur la fin de vie et sur le rôle des sondages par rapport aux attentes sociétales. Je trouve discutable l'exploration que le CCNE en a fait à travers son site : on nous dit que les deux sujets qui ont le plus intéressé l'opinion publique, c'est la fin de vie et les questions autour de la gestation pour autrui (GPA). Or je ne suis pas certain que ce soit très représentatif de ce qu'aurait été l'opinion des gens si l'on avait mené en amont un travail plus intelligent, notamment à travers des colloques, etc. Mais je ne peux pas vous dire ce qui aurait dû être fait puisque je ne suis pas président du CCNE, et qu'on ne m'a pas demandé comment j'aurais fait…
Donc on a fait les choses d'une manière trop rapide, et il n'était pas très sérieux de dire qu'on allait faire des États généraux entre tel jour et tel jour. Ce n'est pas ainsi que l'on peut entendre les choses.
J'en viens au deuxième point de votre intervention, sur la légitimité des espaces éthiques.
Nous n'avons aucune légitimité à nous prononcer sur ces questions : nous en avons une, éventuellement, à identifier un certain nombre de questions. Tout à l'heure, nous parlions des questions relatives aux données personnelles : on ne peut pas dire qu'elles ne soient pas d'actualité, ni que l'on ne les ait pas identifiées. Mais prenez les questions relatives aux vulnérabilités dans les maladies neurocognitives : ce sont des questions intéressantes, qu'on pourrait essayer de faire remonter au niveau de la bioéthique. C'est un peu comme cela que je vois les choses.
Notre légitimité est donc très simple : être présent sur le terrain, créer des réseaux de réflexion, mettre en place des groupes de concertation, et ne jamais se substituer à ceux qui ont une certaine autorité. Jamais, en vingt ans d'espace éthique, je n'ai pris position au nom d'une société savante dans le domaine de la fin de vie. Chacun doit être à sa place.
Nous avons aussi un rôle de transmission des savoirs, à travers l'expertise développée dans les comités des espaces éthiques. Nous avons un rôle d'accompagnement, par exemple, de ce que va être la loi, au fur et à mesure de vos débats.
Donc, nous n'avons pas de légitimité – et je ne suis pas non plus certain que le CCNE en ait une, d'ailleurs il ne le prétend pas – à nous substituer au législateur en ces domaines. Nous pouvons éclairer, nous pouvons être saisis. C'est toute la question de l'expertise qui pourrait alors être posée.
Madame Firmin Le Bodo, comme je l'ai écrit dans Le Figaro, il ne faudrait pas tromper les Français. Je pense qu'on peut effectivement les tromper, c'est-à-dire les trahir. Les milliers de personnes qui ont participé aux États généraux ne sont peut-être pas représentatives de l'ensemble de la société. Mais il ne faut pas les trahir parce qu'elles ont pris cela très aux sérieux. D'ailleurs, comme le dit M. Jean-François Delfraissy, il y a une appétence pour ces rencontres, qui ont eu plutôt du succès.
Un certain nombre de personnes, dans notre société, porteront une grande attention à ce qui « sortira de la boîte ». Ils se sont exprimés, ils ont envoyé des contributions aux espaces éthiques ou au CCNE. Bref, ils ont l'impression que le débat s'est construit d'une manière sérieuse. Et c'est pour cela que je me suis interrogé : « Serons-nous à la hauteur » ? Je précise qu'au moment où j'ai écrit cet article, nous sont parvenus des signaux qui ne sont pas annonciateurs de nouvelles susceptibles de satisfaire ceux qui attendent quelque chose de la révision de la loi de bioéthique.
Pour la révision de la loi de bioéthique, plusieurs scenarii peuvent être élaborés. Mais le scénario le plus crédible, aujourd'hui, c'est qu'on ne fera rien, ou plutôt que l'on fera uniquement des aménagements. À ce moment-là, on n'avait pas besoin de faire les États généraux. Le rapport de janvier 2018 de l'Agence de la biomédecine était en lui-même très éloquent et très intéressant puisqu'il indique, d'un point de vue technique, ce qui pose problème et ce qu'il faut faire. Mais vous me reposerez la question quand la loi sera là. Je vous dirai alors si on a trompé les Français ou non.
Monsieur Hetzel, vous vous demandez si le progrès est à sens unique. Ce sont vraiment des questions de philosophie, et je ne suis pas venu avec ma casquette de philosophe. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est le sens du progrès et ce qu'il apporte véritablement.
Quand on nous parle de transhumanisme, d'hypermodernité, d'hyperhumanisme, enfin de tout ce que l'on retrouve aujourd'hui dans le discours, nous pouvons nous demander en quoi certaines innovations nous sont réellement utiles. On peut faire la distinction entre les innovations qui ont du sens pour la démocratie et l'humanité, et celles qui ne font que nous distraire de ce que devraient être nos exigences et nos préoccupations.
Je considère que nous sommes de plus en plus souvent éloignés de l'essentiel par ce qu'on nous vend comme étant des innovations susceptibles de conditionner le devenir de notre société. De fait, le devenir de notre société s'écrit dans des start-up, selon des critères et des finalités qui sont rarement pesés du point de vue de leur valeur sociétale et de leur apport fondamental.
Cela étant dit, je ne remets pas en cause le fait que des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) bénéficient aujourd'hui de l'intelligence artificielle, qui peut se charger d'un certain nombre de tâches ingrates demandant des compétences que certaines personnes n'ont pas, ni le fait qu'on permette à une personne atteinte d'une maladie neuro-évolutive de pouvoir rester plus longtemps chez elle. Pour moi, c'est très positif en termes de progrès, d'avancées, de liberté, de conquête sur la fatalité. Néanmoins, nous pouvons nous interroger, vous comme moi, sur certaines évolutions ou innovations qui nous sont présentées comme incontournables et impérieuses.
On nous parle de plus en plus des avancées que les neurosciences permettraient dans le domaine de l'éducation. On ne peut que se réjouir de la liberté et de la créativité que l'intelligence artificielle va pouvoir apporter. Mais si l'on est pessimiste, on peut aussi se demander si l'intelligence pratique, la capacité de s'éduquer et de s'approprier des savoirs seront encore respectées, ainsi que l'autonomie de la personne.
Il faut trouver la bonne reconfiguration. Or je vois mal aujourd'hui quelle régulation elle apportera. On peut comprendre que ce que l'on nous « vend » comme un progrès absolument indispensable nous sera utile à certains égards. Mais mon impression est que cela n'a pas été véritablement pensé, décidé, arbitré en amont. A posteriori, c'est ce que vous allez faire si vous intervenez sur certains sujets de bioéthique en cherchant des aménagements qui nous éviteraient « un pire ». J'observe que le pire, au moment de la loi Claeys-Leonetti, c'était l'euthanasie. Et que, pour éviter le pire, on a permis la sédation profonde et continue. Tout cela pour vous dire que ce n'est pas comme cela que je vois les choses. Je pense qu'il manque une intelligence.
Enfin, je tiens à dire que j'ai été frappé par l'absence des intellectuels dans le débat bioéthique de ces derniers mois. Je ne remets personne en cause, mais je remarque que certaines personnalités du monde culturel, intellectuel, qui ont une parole assez constructive, vigoureuse, qui porte du sens, n'étaient pas là. En revanche, certaines instances, comme l'Église catholique, se sont exprimées. Il y a de quoi s'interroger.

Monsieur Hirsch, vous êtes intervenu sur le périmètre des questions éthiques et bioéthiques. Je voudrais vous interroger sur la PMA et son extension à toutes les femmes, couples lesbiens ou femmes célibataires.
Pour vous, ce sujet est-il entré dans le champ des questions éthiques, étant entendu que je considère qu'il y est entré au titre de la suppression d'une discrimination dans l'accès à une pratique médicale fondée sur une orientation sexuelle ou un statut matrimonial.
Je ferai par ailleurs une remarque qui ne s'adresse pas à vous, mais au président de notre mission d'information, notre collègue Xavier Breton.
Monsieur le président, sur le site de la Manif' pour tous, en Charente, un article, publié le 26 juillet, vous prête des propos qui me concernent directement. Je les cite : « On voit bien qu'il est animé par une détestation de la famille, qu'il compte atteindre ou détruire à tout prix. » Confirmez-vous ces propos ? Si tel était le cas, je me permettrais deux remarques.
Premièrement, je ne crois pas que de tels propos contribuent à des échanges apaisés dans le cadre de la mission que vous présidez.
Deuxièmement, je condamne formellement ces propos – si tant est qu'ils aient été tenus – qui s'apparentent à de la diffamation. Je ne compte pas, bien évidemment, détruire la famille. Bien au contraire, je souhaite en affirmer les richesses et la diversité, et je refuse que l'on cherche à faire des différences de structures familiales une sorte de pyramide hiérarchisée avec un « modèle roi », et d'autres modèles qui seraient moins honorables.
En d'autres termes, indépendamment du nombre de personnes qui les composent et du statut matrimonial et des orientations sexuelles des uns et des autres, je reconnais pleinement et je défends les familles, leur émancipation et leur bien-vivre. C'est peut-être ce qui me différencie de certains. Je l'assume pleinement, et je voulais le rappeler ici.

Avant de donner la parole à mes autres collègues, je tiens à préciser que je ne connais pas ce site. Je vous invite donc à me transmettre ses coordonnées. J'ai effectivement répondu à des questions de journalistes. Si des interviews ont été publiées et que je n'y retrouve pas mes propos, je ferai un démenti.
Il ne s'agit pas d'une interview directe, et j'aimerais bien savoir quelle en est la source. J'ai fait effectivement des commentaires, mais pas dans ces termes exactement. Avant d'en juger, encore une fois, je souhaite connaître le site et la référence.

Monsieur le professeur, j'ai été particulièrement intéressée par votre hauteur de vue, dont je vous remercie vivement.
Vous avez mentionné à plusieurs reprises les craintes des Français, alors qu'on a souvent tendance à les oublier. Je vous en remercie, ainsi que d'avoir fait remonter les attentes de nos compatriotes, au-delà des éclairages techniques dans lesquels on se perd. Les Français ont vraiment l'impression d'être à la traîne, de suivre bon gré mal gré le progrès et, finalement, de ne pas avoir le choix. Comment nous, les Français, pouvons-nous nous emparer sereinement ces sujets ?
Faut-il « forcer » les avancées pour constater, dans le meilleur des cas, qu'elles sont bénéfiques pour l'homme ? Vous avez vous-même parlé d'avancées imprévisibles, irréversibles, incontournables et impérieuses ? Ou faut-il, comme vous le laissez entendre, freiner ces avancées scientifiques qui nous embarquent on ne sait où, afin que tout un chacun puisse en intégrer progressivement les différentes implications ? De fait, on a l'impression que la science se déploie inexorablement sans rencontrer d'entraves, peut-être aux dépens de l'homme.
Cela m'amène à reprendre l'une des questions que vous avez très judicieusement posée : vers quelle société, vers quelle humanité souhaitons-nous aller ?
L'un des problèmes de la bioéthique est que l'on fait souvent appel à une somme de revendications personnelles, de désirs venant des uns et des autres, qui varient en fonction de l'histoire et du vécu de chacun. Cela rend très difficile tout positionnement, lequel est potentiellement mal perçu par ceux qui attendent les avancées permises par les sciences. De fait, si l'on s'interroge, si l'on montre quelque réticence à l'égard de ces avancées scientifiques, on est très souvent accusé d'être archaïque ou rétrograde.
Faut-il choisir entre la science qui supplanterait ce que vous avez appelé les grands principes intangibles, et ces grands principes qui empêcheraient la science d'avancer ? Comment concilier les avancées reconnues de la science avec les grands principes intangibles dont notre société, notre humanité ont également besoin ?

Monsieur le professeur, je voudrais vous interroger sur des sujets dont vous avez l'expertise : les neurosciences et la bioéthique.
L'article 45 de la loi de 2011 relative à la bioéthique admet le recours à l'imagerie cérébrale dans le cadre de l'expertise judiciaire. Je m'interroge cependant sur les progrès scientifiques de l'imagerie cérébrale et sur son encadrement. En effet, alors que l'on contrôle aujourd'hui – ou que l'on tente de contrôler – l'immense avancée de la génétique, on semble oublier que les données issues de l'imagerie cérébrale soulèvent tout autant de questions éthiques fondamentales et pourraient présenter des risques pour les droits de la personne humaine.
Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer mes propos. Si une lésion ou une tumeur cérébrale m'est diagnostiquée, suis-je toujours responsable de mes actes ? Lors d'un examen médical du cerveau, peut-on indiquer à un patient qu'il peut développer une maladie neurodégénérative ? Jusqu'où peut-on changer ou influencer nos comportements en stimulant des parties de notre cortex ? Dans ce type de situations, suis-je toujours la même personne ? Je vous rassure : je ne vous demanderai pas de répondre à ces questions.
En revanche, suite aux rencontres autour des neurosciences que vous avez organisées le mois dernier avec d'éminents scientifiques tels que MM. Luc Buée et Marc Lévêque, je souhaiterais vous voir préciser votre position sur l'élargissement du champ de compétences de l'imagerie cérébrale dans la loi de bioéthique. Le « neuro-droit » existe timidement. Doit-on aller plus loin ? Doit-on encadrer les données sensibles et personnelles issues de cette imagerie cérébrale ?
Si j'avais su que j'aurais autant de questions, peut-être ne serais-je pas venu… Ou peut-être me serais-je davantage préparé ! (Sourires.) Mais il y a une réponse à toutes les questions que vous posez dans le Traité de bioéthique.
Vous m'avez d'abord interrogé sur la PMA. Pour ma part, j'ai été très attentif au fait qu'un groupe politique ait souhaité en faire une loi spécifique. On pouvait dire que c'était une stratégie politique, mais je ne suis pas certain que la question ne se pose pas également lorsqu'elle est intégrée dans une loi de bioéthique. Ce qui est sûr, c'est que l'on a « démédicalisé », et donc « socialisé » ce qui tourne autour de la PMA.
Cela m'amène à m'intéresser au rôle de l'expertise. Si l'on reprend les travaux du rapport de M. Guy Braibant, le premier rapport du Conseil d'État qui a préfiguré ce que pourrait être la bioéthique, ou ceux du rapport de Mme Noëlle Lenoir, on s'aperçoit que c'étaient les experts qui étaient convoqués, les médecins qui disaient les règles et qui fixaient les normes, puisqu'on était dans quelque chose d'inédit. Ce sont eux qui avaient une certaine légitimité.
Quand vous parlez de neurosciences, je pense immédiatement à des personnes de grande qualité qui allient l'expertise à une grande compétence en matière d'éthique comme M. Hervé Chneiweiss. Et si vous voulez affiner l'analyse, penchez-vous sur des personnalités comme M. René Frydman : quand il a développé toutes ses approches, il a engagé une sorte de consultation pluridisciplinaire avec des psychologues, des anthropologues et des sociologues. Cela ne s'est pas fait de n'importe quelle manière, mais avec une expertise assez transversale. Et à l'époque, quand il fallait prendre position, j'imagine que la commission parlementaire recevait surtout les experts.
La vraie question, qui à mon avis justifie un débat, est la suivante : est-ce la PMA, du fait de ses implications sociétales, relève encore, au sens propre, de la bioéthique ? C'est pour cela que je suis très gêné qu'on ne définisse pas mieux ce qu'on appelle la bioéthique et ce qu'est une loi de bioéthique.
On peut dire qu'un certain nombre de thématiques doivent être abordées d'un point de vue sociétal. De la même manière, certaines thématiques gagneraient en pertinence, en lisibilité et en prégnance si elles étaient intégrées dans une loi que je n'appellerais plus « loi relative aux droits des malades », mais qui aborderait de nouvelles questions – par exemple, la prédictivité. On voit tout ce qui se met en place quand on redéfinit les concepts de maladie et de soins.
Madame Brocard, j'ai été invité par l'un de vos collègues – et cela répondra peut-être à vos interrogations – à une réunion organisée par La République en Marche, et je me suis exprimé sur la légitimité et la pertinence des arguments qu'on peut produire.
Je vous invite à regarder le travail remarquable qui a été réalisé par le lycée Henri-IV. À mon avis, l'éducation devrait s'approprier les questions de bioéthique et les intégrer dans les formations. C'est un enjeu fondamental, et peut-être ferez-vous des propositions en ce sens.
Tout à l'heure, j'ai évoqué le lycée Pierre-Gilles-de-Gennes et le côté excitant qu'il y a à travailler sur les greffes d'organes. De la même façon, nous avons travaillé avec l'académie de Créteil et avec des enseignants sur l'AMP et sur l'intelligence artificielle : le matin, la transmission d'un certain nombre de savoirs ; l'après-midi, des ateliers. C'était plus intéressant que certains débats que nous avions organisés nous-mêmes !
Ces productions de savoir et d'intelligence ont pour moi une certaine légitimité. Les enseignants peuvent être les vecteurs de la réflexion, en organisant, par exemple, des études de cas. Il y a vraiment un travail de fond, et l'Éducation nationale est très demandeuse. Et, pour répondre à votre question : pour moi, ce n'est plus une question.
En revanche, j'ai été frappé de constater que les associations LGBT avaient été très peu présentes dans les réunions des États généraux. Cela m'a d'ailleurs valu une polémique, au cours de la réunion que j'avais moi-même organisée : un de leurs leaders nous a dit à cette occasion qu'il ne viendrait pas aux réunions parce qu'il savait qu'il ne serait pas audible, et qu'il irait donc directement voir les parlementaires. En quelque sorte, pour lui, les États généraux étaient inconciliables avec une certaine idée de la dignité des personnes LGBT.
Plus généralement, j'ai constaté qu'un grand nombre de personnes abordent aujourd'hui les différentes thématiques de la bioéthique en revendiquant certains droits, en mettant en avant la souffrance personnelle, les problèmes de discriminations et le manque de compréhension d'une société en pleine mutation. De fait, il n'y a pas que des mutations scientifiques. Dans notre société, la famille a évolué, et tous les grands spécialistes, les sociologues, les anthropologues ou les psychanalystes qui travaillent sur le sujet ont pris des positions assez précises qui n'incitent pas à être « rétentif » par rapport à cette évolution. J'ai d'ailleurs du mal à comprendre au nom de quoi on pourrait refuser cette évolution. Et c'est un peu la même chose pour l'accès aux origines : pourquoi s'y opposer, puisque l'évolution est déjà là ?
Maintenant, est-ce que le législateur doit valider ou cautionner une évolution, qu'elle ait lieu dans notre société ou dans des pays voisins ? C'est un problème d'ordre philosophique. D'ailleurs, en préalable à la révision, il aurait pu être intéressant d'organiser des rencontres internationales – ou, au moins, européennes – car certains pays ont déjà fait preuve d'intelligence, de lucidité, de courage et de réalisme en la matière.
J'ai été heureux d'être le contemporain des belles avancées suscitées par les « années sida ». Nous en avons parfois discuté avec M. Touraine : il s'agissait d'une véritable tragédie humaine, mais également d'une formidable période de transformation de la société. Les évolutions législatives ont été provoquées par l'action de militants, dans la déréliction, représentant une marginalité sociale inconciliable avec les valeurs de certains, qui n'agissaient pas uniquement pour honorer leurs choix personnels ou des droits contestés.
Votre deuxième question est presque philosophique. Honnêtement, j'aurai du mal à vous répondre. Vous posez d'importantes questions ! Si vous ne deviez en retenir qu'une, quelle serait-elle ?

Peut-on concilier les avancées de la science et les grands principes fondamentaux dont vous avez parlé ?
J'ai le sentiment que la communauté des chercheurs comme la communauté médicale, que j'ai aussi fréquentée, l'attendent. Il faut rappeler ces principes intangibles, qui donnent du sens, une signification démocratique et une certaine transcendance à leur travail. On ne doit pas renoncer à avoir le courage de cette parole, qui ne doit pas être morale, mais politique. Je suis laïque, j'ai évolué dans un contexte sécularisé, et il me semble que seul le politique est légitime pour redéfinir un certain nombre de principes, ne serait-ce que pour faire accepter des évolutions incontournables.
Il faut repenser le contexte et évaluer le type de vigilance à mettre en place. D'ailleurs, le rapport Villani parle de loyauté et celui de la CNIL de vigilance. Quelle pourrait être l'approche éthique des institutions ? Comment être vigilants ensemble ? Quelles précautions mettre en place, qui soient compatibles avec les avancées de la recherche ? Une société qui se veut émancipatrice peut difficilement être réfractaire à ces avancées – j'emploierai ce terme plutôt que celui de « progrès », un peu éculé.
La réflexion doit donc se situer bien en amont de débats sur la bioéthique. Ainsi, de façon assez surprenante, le CCNE a consacré l'un de ses récents avis aux migrants. Dans le cadre des États généraux de la bioéthique, nous avons également organisé un colloque sur le même thème avec Médecins du monde et différents partenaires. Cela nous permet de réappréhender certains fondamentaux. Nous avons aussi organisé un colloque au ministère de la santé sur les maladies neurocognitives au regard de la bioéthique.
Il faut faire preuve d'inventivité. On ne peut s'en remettre aux instances religieuses, mais elles ont des choses importantes à nous dire. On ne veut souvent pas les écouter, tandis que d'autres instances, qui devraient s'exprimer, ne le font pas car elles pensent que cela pourrait être mal interprété. Je suis de confession juive, et les discours de l'Église catholique et du Président de la République aux Bernardins m'ont beaucoup impressionné. On ne peut systématiquement refuser ces éclairages, cette pensée, cette richesse qui font partie de notre culture.
Malheureusement, la référence aux valeurs morales et aux traditions est souvent perçue comme moraliste, passéiste, voire proche des extrémismes religieux. En conséquence, la tentation est grande d'oublier nos principes et nos convictions et de s'abandonner au mouvement des choses.
Vous parliez de démocratie et de démagogie : je ne comprends pas que certaines instances nous incitent à renoncer à nos principes sans réflexion de fond. Si l'on prétend être une instance d'éthique, il faut aller plus loin. Avec le responsable d'une instance éthique nationale, j'ai récemment évoqué la position de cette dernière concernant M. Vincent Lambert. Je lui ai demandé si un membre du comité s'était déplacé à Reims pour rencontrer la famille et témoigner d'une présence et d'une proximité. Cela peut paraître anecdotique, mais on ne peut faire d'éthique sans être engagé, impliqué, et prendre des risques.
S'il s'agit uniquement d'ériger des barrières protectrices, de faire de l'éthique « de précaution » en expliquant que toutes les instances ont été consultées et que l'on ne peut rien faire, c'est une trahison : c'est tromper l'opinion. Je le dis peut-être avec une forme de maladresse, mais j'exprime aussi toute la complexité qu'il y a à aborder des questions qui touchent à nos représentations du monde, de l'humanité, de la spiritualité, voire de la métaphysique. Les transhumanistes sont d'ailleurs dans ce registre.
Lors des deux réunions préparatoires avec le président du CCNE, nous l'avons interrogé sur la possibilité d'associer les instances religieuses à nos débats sur la dimension philosophique et spirituelle du rapport. Il a été embarrassé. Pourtant, le pluralisme, la démocratie, la laïcité, c'est aussi de ne pas renoncer à ces intelligences, à ces valeurs et à ces traditions. Malheureusement, quand on l'exprime, on est tout de suite considéré comme réfractaire à une certaine idée du progrès. Or, quand on étudie de manière non dogmatique le discours des uns et des autres, il est beaucoup moins intégriste et plus ouvert qu'on ne le pense. On ne peut rester dans l'homéopathie ou le symbolique. À titre de comparaison, la CNIL a convoqué toutes les compétences et expertises compétentes en matière d'intelligence artificielle.
S'agissant de votre question sur l'imagerie, je vous enverrai début septembre le cahier n° 7 de notre espace éthique, consacré à ce sujet. À partir de la rentrée, nous mettrons également en place une université populaire de la bioéthique et, le 12 novembre, un séminaire abordera les neurosciences et l'innovation, avec la thématique suivante : « Déjouer les prédictions : l'enjeu éthique de l'anticipation ». Je vous enverrai le programme si vous le souhaitez.
Actuellement, l'imagerie médicale, c'est certes l'intelligence artificielle, les incidentalomes et tout ce que l'on est capable de dévoiler, mais cela pose aussi des questions éthiques en matière de génétique et, en amont, une question philosophique : que faire d'un savoir dont on ne sait rien faire ? Nous cumulons de plus en plus de savoirs – le big data y contribue – mais comment discriminer ce qui a du sens et ce qui n'en a pas, ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas ? Et d'un point de vue éthique, comment fait-on pour accompagner la personne qui découvre d'une manière inattendue quelque chose qu'elle ignorait – et, quelquefois, une maladie à un stade très avancé ?
En la matière, nous sommes un laboratoire d'excellence et travaillons avec l'équipe du professeur Philippe Amouyel sur l'anticipation des traitements de la maladie d'Alzheimer. En France, on ne peut pas encore le faire, mais, aux États-Unis, on met à disposition de personnes dotées de certains marqueurs prédictifs – donc susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer – des molécules qui n'ont pas d'efficacité si on les donne trop tardivement. Avec une équipe de psychologues, nous nous interrogeons sur la meilleure façon d'accompagner les chercheurs dans l'anticipation de cet impact.
Toutes les innovations sont « accompagnables » d'un point de vue éthique. Je vous transmettrai ce document, qui sera notre contribution complémentaire. Par ailleurs, trois chapitres du traité de bioéthique sont consacrés à ces questions.

Dans quelle mesure et dans quels domaines vous inspirez-vous de nos voisins européens ? Cela pourrait-il utilement nous éclairer ?
Pendant des années, on nous a parlé d'une bioéthique « à la française ». Cela a une signification. Quand des réfugiés politiques ou des migrants vous expliquent qu'ils sont venus en France parce que c'est la patrie des droits de l'Homme, cela nous confère une responsabilité, y compris dans le domaine de la bioéthique. La dimension internationale du rapport Villani est évidente. Il a d'ailleurs été écrit en sollicitant toutes les compétences, de manière transnationale.
Actuellement, les personnes sont humiliées, y compris quelquefois du fait de choix politiques discutables. Nous devons donc profiter de la révision de la loi de bioéthique pour rappeler les fondamentaux auxquels notre culture démocratique est attachée et son enracinement dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je le répète, cette culture me semble quelquefois menacée par certaines avancées qui remettent stratégiquement en cause ce que nous sommes, notre identité, nos espérances, nos capacités de transcendance et qui s'attaquent aussi à nos vulnérabilités.
Les réactions internationales face aux États généraux de la bioéthique soulignent cette attente de signaux forts. Notre Président de la République incarne également une forme de modernité et un renouvellement du discours politique. Cette révision n'intervient pas dans n'importe quel contexte : le président d'un certain grand État remet régulièrement en cause, quant à lui, la science et ses vérités pour imposer ses modèles, ses normes et son idéologie, avec violence et une certaine forme de tyrannie politique…
Ce débat sur la bioéthique, qui concerne aussi l'environnement, nous interroge sur notre capacité et notre envie de vivre selon nos propres normes, actuellement et à l'avenir, car le présent va conditionner notre devenir. Il ne faut donc pas négliger certaines thématiques qui semblent légères mais sont fondamentales, comme la confiance en la société ou encore les EHPAD. Plus largement, il faut répondre à quelques questions simples : comment être sensible à l'homme dans ses vulnérabilités ? Comment éviter que la société ne se désintègre ? Comment permettre aux gens vivant à sa marge d'être reconnus et considérés ? Il faut tenir le cap d'une bioéthique « à la française » et avoir l'ambition, le courage de ne pas forcément accepter ou tolérer ce que d'autres acceptent ou tolèrent.
Je serai également attentif à la pédagogie de la loi : il est essentiel que les articles qui la composent découlent d'une volonté politique préalable et soient l'expression d'un certain nombre de principes fondamentaux qu'il faudra rappeler.
Il est intéressant d'analyser ce que les autres pays européens ont mis en place, mais nous devrions surtout – et je n'ai pas l'impression que ce soit le chemin que nous avons suivi pour le moment – redéfinir la bioéthique et affirmer clairement ce qu'est une bioéthique moderne. C'est fondamental pour être crédible, avoir une démarche constructive mais aussi affirmer les valeurs constitutives de notre démocratie, de responsabilité vis-à-vis de l'autre et des générations futures.
J'étais attentif à ce que les textes importants de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) évoquent les droits de l'homme et la bioéthique. Cela ne m'aurait pas choqué que la notion de droits de l'homme soit reprise dans un texte français relatif à la bioéthique.
Je vous remercie d'avoir organisé cette rencontre. Je me serais probablement préparé un peu différemment si j'avais ancitipé la précision de vos questions ! Je m'en enrichirai et ne modifierai rien au texte que j'avais préparé et que je vais vous envoyer.
Je présente par avance mes excuses aux gens que j'aurais pu blesser par mes propos parfois entiers. Ils le sont car on ne peut plus se satisfaire d'allusions et de langue de bois si l'on veut être crédible. J'admire le travail besogneux des espaces éthiques, mais ne suis pas convaincu de la pertinence de ce qui a été produit. Nous verrons comment cela sera mis en oeuvre.
En tant que citoyen, j'attends beaucoup de vous. Je serais déçu si vous vous contentiez d'aménagements. Vous devez être prêts à accompagner les décisions, même si elles vous paraissent contraires à vos convictions. Une éthique responsable et politiquement démocratique ne doit pas se contenter de débattre, mais soutenir les choix du Parlement et du Gouvernement. Tout ce qui sera lié à la formation, à la sensibilisation, à la concertation, et plus largement à la démocratisation de la bioéthique est attendu.

Je vous remercie. Nous reprendrons nos travaux le jeudi 6 septembre 2018. J'invite mes collègues à faire leurs devoirs de vacances et peut-être à lire, entre autres, le rapport du CCNE ou l'avis du Conseil d'État !
L'audition s'achève à dix-neuf heures dix.
Membres présents ou excusés
Mission d'information de la conférence des présidents sur la révision de la loi relative à la bioéthique
Réunion du mardi 31 juillet 2018 à 17 h 00
Présents. – Mme Emmanuelle Anthoine, M. Joël Aviragnet, M. Philippe Berta, M. Xavier Breton, Mme Blandine Brocard, Mme Samantha Cazebonne, M. Guillaume Chiche, M. M'jid El Guerrab, Mme Élise Fajgeles, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Patrick Hetzel, Mme Caroline Janvier, Mme Brigitte Liso, M. Jean François Mbaye, M. Thomas Mesnier, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Agnès Thill, M. Jean-Louis Touraine, Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon
Assistait également à la réunion. – M. Thibault Bazin