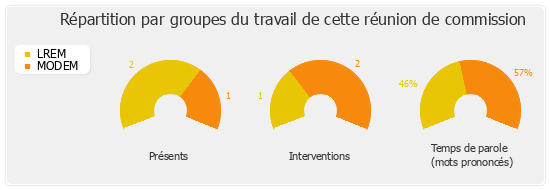Commission d'enquête sur l'évaluation des politiques publiques de santé environnementale
Réunion du mercredi 18 novembre 2020 à 16h00
La réunion
L'audition débute à seize heures.

M. André Cicolella, chimiste et toxicologue, ancien conseiller scientifique de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) préside le Réseau environnement santé (RSE). Cette association généraliste en santé environnementale a été fondée en 2009. Elle vise à mettre la santé environnementale au cœur du débat et des politiques publiques, en particulier en ce qui concerne l'impact des pollutions et des stress environnementaux sur la santé et les écosystèmes. Nous souhaitons connaître l'appréciation du Réseau environnement santé sur la mise en œuvre des politiques de santé environnementale en France et sur les priorités qui doivent les animer.
(M. André Cicolella prête serment.)
La crise sanitaire actuelle amène à repenser la santé environnementale d'une façon différente de celle qui prévalait voici encore quelques mois. L'enjeu est le lien avec les maladies chroniques. Nous devons poser la santé environnementale comme une réponse à la croissance des maladies chroniques qui constituent une véritable pandémie.
Nous avons communiqué sur le thème « Une pandémie peut en cacher une autre. » Cette pandémie de covid était prévisible puisqu'il s'agit de la maladie X décrite dans un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2018. Elle était alors décrite comme une nouvelle maladie qui émerge, puis se propage rapidement et silencieusement sur la planète. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) avaient déjà donné des indications sur les causes environnementales d'une telle pandémie.
Une publication de février 2018 avançait le concept de « One Health » en suggérant de l'élargir à la prise en compte des maladies chroniques. C'est le constat qu'a fait le directeur de l'OMS Europe dans une tribune publiée dans le Lancet : « La pandémie de covid-19 a eu de nombreux effets sur la santé, révélant la vulnérabilité particulière de ceux qui souffrent d'affections sous-jacentes. La prévention et le contrôle de l'obésité et des maladies non transmissibles sont essentiels pour se préparer à cette menace et aux menaces futures pour la santé publique. »
Le constat fait actuellement par le réseau Sentinelles sur un échantillon représentatif des services de réanimation est que le covid est, certes, une question d'âge, mais surtout d'âge et de comorbidités. Nous trouvons des comorbidités dans 88 % des cas en réanimation et dans 94 % des décès. Ces comorbidités sont principalement l'obésité, l'hypertension, le diabète ainsi que les pathologies cardiaques, pulmonaires, rénales, l'immunodépression et le cancer.
Le constat est identique en Grande-Bretagne dans une très grande étude menée sur plus de 5 000 décès. Elle montre le lien avec l'âge, mais, après ajustement sur l'âge, elle constate un excès de décès en cas de maladies cardiaques, pulmonaires, rénales, de cancer, d'obésité, de démence. Cette étude met de plus en évidence un lien avec la pauvreté et des facteurs ethniques. Nous ne les mesurons pas en France, mais nous pouvons penser qu'ils jouent également un rôle dans notre pays.
Nous constatons en France une croissance des maladies chroniques. D'après le rapport que la caisse nationale envoie chaque année aux députés pour préparer le plan de financement de la sécurité sociale, la prévalence des maladies cardiovasculaires, du diabète et des cancers a été multipliée par 2 entre 2003 et 2017, alors que la population n'a augmenté que de 8 %. Pour les maladies cardiovasculaires et le diabète, nous sommes passés de 3 millions de personnes concernées à 6 millions. Si cette pandémie avait eu lieu en 2003, nous aurions donc eu grosso modo moitié moins de décès. Comme le principal critère pour gérer la crise est l'occupation des lits de réanimation, nous voyons bien la nécessité de nous attaquer au problème sous-jacent de cette croissance des maladies chroniques.
Nous pourrions nous réjouir de l'augmentation des maladies chroniques en disant que le phénomène est provoqué par la diminution de la mortalité. C'est en partie le cas, mais l'autre élément à prendre en considération est la croissance de l'incidence. Le nombre de nouveaux cas ne devrait refléter que l'augmentation de la population. Or, pour les personnes de 60 à 74 ans par exemple, nous constatons bien l'effet du baby-boom avec une augmentation de 37 % de l'effectif de cette population, mais nous constatons aussi une augmentation de 119 % de ces trois pathologies. Même chez les moins 60 ans, le nombre de cas augmente de 50 % alors que la population n'a progressé que de 1 %. Ces chiffres signifient que la progression des maladies chroniques continuera. Nous constatons déjà des progressions de l'ordre de 50 % dans les tranches d'âges les plus jeunes sur une période aussi courte que 2003-2017. Le vieillissement n'est donc pas la seule explication et est même une explication minoritaire. Il se produit une croissance intrinsèque des maladies chroniques et le phénomène doit être lié à la santé environnementale, prise au sens le plus large.
Le rapport de la caisse nationale donne également une projection des dépenses occasionnées par cette croissance des maladies chroniques au niveau national pour le régime général. Une augmentation de 120 milliards d'euros est prévue en 2023 par rapport à 2012. Compte tenu de la tendance, nous ne sommes pas arrivés à un plateau et cette progression continuera si nous n'engageons pas une action construite et sérieuse pour arrêter la progression de ces maladies chroniques. L'enjeu est la saturation du système de soins par cette croissance des maladies chroniques, surtout en période de pandémie.
Une approche régionale est de plus nécessaire. En effet, la tendance générale est la même dans toutes les régions pour ces pathologies, mais il existe des différences régionales, par exemple avec des taux d'obésité différents dans la région parisienne et dans le nord de la France. Il faut faire des diagnostics de santé environnementale dans chaque région et même à l'échelle locale.
Sur l'obésité qui joue un rôle particulier dans cette crise, nous voyons de plus un effet générationnel. La génération née entre 1918 et 1924 a atteint le taux de 10 % d'obèses à 76 ans tandis que la génération née entre 1980 et 1986 a atteint ce taux à 28 ans.
L'étude NutriNet vient de montrer une diminution de 35 % du risque de diabète chez les consommateurs d'aliments biologiques par rapport aux consommateurs d'aliments non biologiques. Ceci montre que notre vision de l'environnement pour comprendre cette épidémie doit intégrer l'alimentation. Nous ne pouvons pas gérer l'alimentation de façon différente de l'environnement et le lien devrait être mieux pris en considération.
L'étude NutriNet constate également un lien entre l'alimentation ultra-transformée et le cancer du sein, les maladies cardiovasculaires, l'asthme, la dépression. Ces grandes maladies sont liées à l'alimentation. D'autres facteurs jouent également, comme les perturbateurs endocriniens.
Vous avez fait référence à notre campagne sur l'interdiction des biberons au bisphénol, un plastique alimentaire contenant une hormone de synthèse. Le vote des députés puis l'extension à l'ensemble de l'Union européenne de cette décision montrent que nous pouvons faire changer la situation, à condition de mettre dans le débat public ces données scientifiques.
Sur l'obésité et les maladies métaboliques, tous les grands perturbateurs endocriniens interviennent : bisphénol A, phtalates, perfluorés. Il existe des substances obésogènes, diabétogènes selon une terminologie créée en 2006 qu'il faut intégrer aujourd'hui dans la réflexion politique car le fondement scientifique est maintenant suffisamment solide.
La répartition régionale de ces pathologies doit être étudiée. L'Île-de-France est la première région de France pour le cancer du sein et la ville de Paris est encore plus impactée. Il existe une différence très marquée notamment avec les Antilles. La France se situe au quatrième rang mondial du point de vue du cancer du sein d'après les données du centre international de recherche contre les cancers. Notre taux est presque deux fois plus élevé que celui des Japonaises et 20 fois plus élevé que celui du Bhoutan. Nous voyons bien que l'environnement au sens le plus global du terme doit expliquer une grande partie de cette différence. Nous pourrions attendre des gains importants de la compréhension de ces phénomènes d'où l'intérêt de la recherche.
Nous avons aussi les données du Cecos de Paris sur la baisse de la qualité du sperme. En 1995, le Cecos de Paris avait déjà montré une diminution de 50 % de la concentration spermatique chez les donneurs de sperme en 17 ans. Au niveau national, l'étude de Santé publique France a rajouté 30 % de baisse et nous en arrivons finalement au fait qu'un homme de 30 ans a perdu deux spermatozoïdes sur trois. Cette réalité varie selon les régions, Toulouse étant la plus impactée. Nous avions d'ailleurs organisé en 2018 un colloque sur le thème « Y aura-t-il encore des petits Occitans en 2040 ? » Effectivement, en prolongeant la courbe, nous arrivons à 0 en 2040. Ma collègue Shanna Swan qui avait fait le rapport sur le sujet pour l'Académie des Sciences aux États-Unis prépare un livre intitulé Compte à rebours pour lequel nous cherchons un éditeur en France. Elle fait ce même calcul que, en 2040, nous arriverons à ce niveau inacceptable. Nous avons toutes les données et nous ne pouvons pas faire l'impasse.
Ces quelques exemples apportent un éclairage du problème. Nous devons repenser la santé environnementale comme une politique prioritaire et non comme une politique sympathique, mais toujours un peu à la marge. Le constat est international. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU), qui constitue le plus haut niveau de décision politique, a repris l'objectif défini en septembre 2018 de diminuer de 30 % la mortalité par maladies chroniques d'ici 2030, d'arrêter la progression de l'obésité et du diabète. Ce sont les malades les plus touchés par le covid.
À ma connaissance, aucun pays ne s'est vraiment emparé de ces objectifs et n'a construit de politiques pour y répondre. Il sera très compliqué d'y parvenir, mais le Green Deal de l'Union européenne est un signal d'espoir qui reprend cet objectif de zéro pollution en 2030. Nous sommes particulièrement sensibles à cette proposition puisqu'il a été fait référence dans les documents du Parlement européen à la campagne « Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens » que nous menons pour mobiliser la population sur ce sujet à travers les collectivités locales. Le comité des régions a également pris position.
Voici donc ce que je voulais dire pour préciser la façon dont nous souhaitons que soit abordée la santé environnementale. Il s'agit de répondre à la crise sanitaire dans toutes ses dimensions. Avec la question de la reproduction, l'enjeu est l'avenir même de l'espèce humaine. Le covid pose évidemment la question du lien avec la santé de l'écosystème, avec la biodiversité. Il faut situer cette réflexion dans la crise écologique dans son ensemble et voir la santé environnementale comme un quatrième pilier du développement durable.
Depuis le sommet de Rio en 1992, la définition du développement durable contient environnement, social et économie, mais pas la santé. Nous voyons pourtant que nous ne pouvons pas construire un développement durable sans intégrer la santé. L'une des conséquences de cette crise est donc de faire « monter en grade » la santé au niveau de la crise écologique, comme un quatrième pilier du développement durable. Nous attendons des pouvoirs publics que ce soit traduit en actes politiques.

Je vous remercie pour cet exposé très synthétique des problématiques. Nous partageons un grand nombre de ces constats.
Ma première question est d'ordre méthodologique. Vous avez dit que le fondement scientifique de ces données est suffisamment établi pour passer aux actes. Or, les politiques se heurtent justement à la difficulté de s'orienter dans les discours des scientifiques et à la façon dont les lobbies traduisent ces connaissances scientifiques. Les politiques ont besoin de s'appuyer sur des connaissances scientifiques, mais il faut que les prises de position soient en harmonie et que nous ayons une certitude absolue.
Nous avons reçu des représentants de l'Union des industries de la protection des plantes (UIPP) et de France Chimie qui se sont réfugiés dans des considérations sur les incertitudes scientifiques pour dire qu'ils attendent d'avoir plus d'assurances sur ces données scientifiques pour se sentir concernés. Ils ont notamment parlé de « l'effet cocktail » qui, méthodologiquement, est assez difficile à déterminer et à analyser. Comment pouvons-nous remonter depuis toutes ces données et ces constats que vous avez partagés avec nous pour identifier l'origine de chacun des problèmes puisque « l'effet cocktail » est difficilement quantifiable ?
Quels sont les fils rouges que vous pourriez nous proposer, à nous politiques, pour que nous nous construisions un argumentaire suffisamment solide face à ces prises de position de gens qui n'ont pas intérêt à remettre en question leur production ?
Permettez-moi de rebondir sur cette dernière phrase. Je suis chimiste de formation et j'ai une très haute idée des chimistes. J'ai donc un conflit d'intérêts. Je pense que l'industrie chimique doit se refonder sur un autre modèle. Le modèle de l'après-guerre est dépassé. Nous voyons bien à quoi il a mené.
L'interdiction du perchloréthylène dans les pressings que nous avons obtenue en 2012 a mis fin à quarante années d'utilisation du perchloréthylène. Vous avez remarqué que nous continuons pourtant à nettoyer les vêtements. Savez-vous par quel solvant a été remplacé le perchloréthylène ? Nous l'avons remplacé par un excellent solvant, vieux comme le monde : l'eau. Nous supprimons ainsi un risque de cancer bien avéré pour les travailleurs des pressings ainsi que la contamination de l'eau par le perchloréthylène.
Lorsque nous avons discuté la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, j'avais demandé et obtenu que soit créé un volet « innovation et santé ». Je pense que l'enjeu est là et il faut également repenser nos institutions par rapport à cet enjeu, notamment les centres techniques professionnels. Ces centres sont des créations de l'après-guerre. Ce volet d'innovation devrait faire partie de leurs missions et je ne suis pas convaincu que ce soit le cas. L'innovation doit être conjuguée avec la santé, car nous ne pouvons pas concevoir une innovation qui se traduise par un impact sanitaire négatif.
Vous évoquez les incertitudes scientifiques. Elles existeront toujours. L'enjeu de recherche est considérable. Nous ne sommes pas armés – mais peu de pays le sont – pour répondre à cet enjeu de la compréhension du lien entre santé et environnement. J'ai par exemple évoqué les disparités en matière de cancer du sein. Il n'existe aucun programme de recherche international sur la question. Il serait tout de même intéressant de comprendre pourquoi le Japon et la France ont une différence très nette alors que ces deux pays ont le même niveau de développement, le Japon étant même encore plus urbain que la France. Quant au Bhoutan, n'en parlons pas ! Pourtant, il faudrait analyser la situation au Bhoutan car un rapport de 1 à 20 n'est vraiment pas négligeable.
Nous plaidons pour la création d'un groupe d'experts type « GIEC » de la santé environnementale. Je pense que la France devrait prendre l'initiative de coordonner les efforts au niveau international pour faire le point sur l'état des connaissances à un moment donné. Qu'avons-nous fait sur le changement climatique ? Nous sommes loin d'avoir tout compris. Nous n'avons pas non plus tout compris sur la biodiversité. Il faut un effort international pour établir un constat faisant consensus de façon très large. Sur le climat, cela a permis de marginaliser les climatosceptiques. Il restera toujours des incertitudes, mais l'existence des incertitudes ne nous condamne pas à ne pas agir. C'est cette logique qui a conduit à l'épidémie mondiale de maladies chroniques. La maison brûle et nous regardons ailleurs actuellement.

Que proposez-vous concrètement pour protéger les lanceurs d'alerte ? Quelles sont les relations de votre association avec les pouvoirs publics, les ministères, les élus locaux ? Quels sont les outils de communication à votre disposition ? Avez-vous l'objectif d'intégrer une vision politique de la santé environnementale au sein du débat ?
Oui, cela fait bien évidemment partie de nos objectifs en prenant le mot « politique » au sens le plus noble du terme, celui de la gestion de la cité. Nous avons un système de santé construit sur le modèle de l'après-guerre, c'est-à-dire que c'est un système de soins. Nous avons beaucoup progressé parce que les progrès médicaux ont été considérables, mais nous avons eu tendance, petit à petit, à croire que nous allions tout régler par ces progrès médicaux.
Lorsqu'arrive une pandémie telle que celle-ci, nous faisons face, mais nous n'avons pas la solution immédiatement. Il faut traiter le problème en amont. Nous avions autrefois à résoudre des problèmes de baignoire et de robinet. Lorsque nous ne fermons pas le robinet, la baignoire finit par déborder car elle est limitée et nous sommes dans cette phase.
Le système de santé doit reposer sur deux piliers. S'intéresser à la maladie lorsque les gens sont malades et les soigner est bien, c'est un système de soins. Toutefois, il faut aussi s'intéresser à la maladie en amont, c'est-à-dire à la santé environnementale. Il s'agit de repenser la santé publique dans cette optique comme nous l'avions fait au XIXe siècle lorsque nous étions confrontés aux pandémies de grandes maladies infectieuses. Lorsque les gens mouraient massivement du choléra ou de la tuberculose, nous avons transformé les villes. Nous avons ramassé les déchets et je rends hommage au préfet Poubelle. Nous avons réalisé des adductions d'eau, Paris est devenu une ville avec de grandes artères. Nous avons donc transformé l'environnement et fait de la santé environnementale, y compris en éduquant la population dans ce sens, ce qui est une dimension importante. Les droits sociaux ont permis aux gens de mieux maîtriser leur propre environnement. Je pense qu'il faut partir de cet exemple, dans un contexte différent, mais qu'il faut une deuxième révolution de la santé. L'objectif est de refonder notre système de santé, nos institutions de prévention.
Regardez les changements de paradigme d'aujourd'hui. Les perturbateurs endocriniens jouent un rôle, mais le concept de l'origine environnementale de la maladie est un concept plus large. La protection de la grossesse et de la petite enfance est une question centrale aujourd'hui et c'est un changement de paradigme, car la politique de santé publique n'a pas été construite sur cette idée. Elle l'était en 1945, lorsque la protection maternelle et infantile (PMI) a été créée pour faire reculer les maladies infectieuses. Aujourd'hui, votre collègue, Mme Michèle Peyron, a réalisé un rapport pour dire que la PMI est en danger. Cette institution doit être refondée autour de cet enjeu qui est sa raison d'être : la question de la grossesse et de la petite enfance. Nous savons bien que l'action des perturbateurs endocriniens, mais plus largement les stress chimiques, nutritionnels et même psychoaffectifs affectent la santé de l'enfant, du futur adulte et ce, sur plusieurs générations.
Les perturbateurs endocriniens et l'ensemble des stress agissent sur plusieurs générations : nous en avons la preuve scientifique. Il s'agit de savoir comment agir maintenant, sachant qu'une grande partie de nos réglementations reposent sur un paradigme ancien qui est aujourd'hui dépassé. Il faut revoir les règles, compte tenu de la science d'aujourd'hui et il me semble qu'il vaut mieux que la réglementation soit basée sur la science d'aujourd'hui que sur une science datant de 50 ans.
C'est le cas pour l'eau en particulier. Les critères utilisés pour définir l'eau potable sont devenus pour l'essentiel obsolètes. Nous avons fait un colloque sur ce sujet voici deux ans et personne ne nous a contredits. En matière de perturbateurs endocriniens, nous ne pouvons pas juger la qualité de l'eau comme nous le faisions jusqu'à présent. Il faut intégrer un indicateur qui permette de dire ce qu'est une eau potable du point de vue des perturbateurs endocriniens.
Le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne fait des propositions très précises en matière d'indicateurs biologiques. L'enjeu de la refondation de notre système de santé est aussi de refonder les normes et le fondement scientifique sur lequel elles reposent.

Au niveau opérationnel, de multiples acteurs et de multiples facteurs interviennent. La santé n'est actuellement pas une compétence bien définie. Elle ne relève pas des régions. Vous avez parlé de la PMI qui relève des départements et certaines communes s'approprient des sujets en contractualisant un contrat local de santé avec l'ARS.
À votre avis, avons-nous des marges de progrès pour agir ?
Nous avons une marge considérable de progrès !
Nous avons actuellement de multiples plans. Prenons le cas par exemple du plan cancer qui est presque une caricature. J'attends le bilan du plan cancer. Certains cancers régressent, mais d'autres progressent comme les cancers hormonodépendants. Les cancers de l'enfant progressent de 1 % par an depuis quarante ans et nous n'arrivons manifestement pas à résoudre ce problème. Nous comptons tout de même 3 000 cas par an.
Côté institutionnel, il faut développer des systèmes de registres qui nous manquent encore assez largement. Il est anormal que nous ayons une différence de 20 % du nombre de cancers entre ce que dit le Centre international de recherche contre le cancer (CIRC) et ce que dit l'Institut national du cancer (INCa), les méthodes n'étant pas les mêmes.
De la même façon, en ce qui concerne le nombre d'obèses en France, l'OMS dit 23 % tandis que Santé publique France dit 15 %. S'il s'agissait d'une différence au troisième chiffre après la virgule, cela n'aurait aucun sens, mais ces différences sont importantes et nécessitent d'être clarifiées.
Nous avons besoin d'un institut de veille environnementale qui rassemble les données de l'environnement et les traite. Nous avons aussi besoin d'un opérateur de recherche en santé environnementale. Regardez la stratégie nationale de recherche dans le programme de l'Agence nationale de la recherche (ANR). Il s'y trouve un petit paragraphe sur les perturbateurs endocriniens. C'est assez pathétique. La santé environnementale n'apparaît quasiment pas dans ce programme.
Il faut qu'un acteur politique ordonne tout ce système et soit chargé de cette refondation. Est-ce au niveau ministériel ? Je serais assez favorable à une mission interministérielle. Je crains qu'elle n'ait pas le poids politique pour bousculer les habitudes, mais la période le permet. Si vous ne prenez pas les décisions nécessaires, la prochaine épidémie peut être encore plus violente. Tous doivent prendre cette responsabilité et je pense que la société est mûre pour comprendre cet enjeu. Il faudrait donc avoir un opérateur politique qui ne soit pas purement administratif. Nous sommes bien dans le domaine de la politique au sens le plus noble du terme et nous avons besoin d'une politique de santé environnementale.
Je plaide aussi pour que ces changements se fassent après un débat. Je pense qu'il faut un grand débat national dans la société. Un grand débat a eu lieu après la crise des Gilets jaunes, sur lequel je ne porte pas de jugement, mais cette formule du débat national me semble importante, que ce soit sous la forme d'une conférence de citoyens ou de façon plus décentralisée. Il faut en tout cas faire émerger ces réformes de façon à ce que les réformes institutionnelles soient comprises et qu'elles ne paraissent pas être seulement une histoire technocratique.
Je vois bien l'attente dans la société. J'écrirai la préface du livre sur les parents d'enfants cancéreux de la fédération Grandir sans le cancer. En lisant les témoignages, nous sentons bien l'attente. Je suis en contact également avec des parents d'enfants autistes. L'autisme progresse actuellement à une vitesse incroyable. Les Américains ont un enfant autiste sur 45 et la France n'en est pas très loin. Que faisons-nous ? Pas grand-chose, nous gérons les conséquences.
Il faut que nous rassemblions nos forces, que nous ayons l'outil, une stratégie. Nous avons des objectifs pour 2030 avec le Green Deal qui permet aussi de se positionner.

Nous voyons votre schéma de pensée. Nous avons bien compris que vous souhaitez une mise à plat de cette problématique, que la société se l'approprie et puisse donner son avis, au-delà des choix politiques faits à l'échelle nationale. Toutefois, nous voyons bien que toutes ces pathologies chroniques sont le produit d'une dynamique pathogène multifactorielle. Par où commencer ?
Je ne vous cache pas que la grande idée de faire un grand débat à l'échelle de la France, peut-être un GIEC à l'échelle internationale, prendra certainement du temps. Quelles sont donc les mesures qui vous sembleraient prioritaires ?
Nous avons bien compris que la protection des futurs citoyens, de la grossesse et de la petite enfance, est pour vous la démarche à porter en urgence.
Nous avons lancé la charte « Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens » parce que cette charte s'adresse aux collectivités locales et, aujourd'hui, un Français sur deux est dans une collectivité locale qui a signé la charte. Six départements et quatre régions l'ont signée. D'autres signatures sont en cours, même si le covid nous freine un peu.

Nous avons donc une stratégie territoriale avec cette charte. Avez-vous des retours ? Pouvez-vous nous dire en quoi consiste cette charte et quelles sont les collectivités territoriales qui sont les cibles prioritaires pour protéger la population ?
La charte est une charte d'engagement, ce n'est pas un label. Le premier niveau, peut-être le plus important, est que nous faisons une signature publique, lorsque la collectivité locale signe la charte. Nous en parlons, des articles sont publiés dans la presse locale, régionale et municipale. La dernière signature a eu lieu à Sotteville-lès-Rouen et la mairie avait publié un dossier dans le journal municipal et un article dans la presse spécialisée pour les agents municipaux. Il est déjà très important que chaque citoyen s'approprie ce changement de paradigme, comprenne qu'acheter un shampoing est un acte banal, mais n'est pas banal, si ce shampoing contient des phtalates.
Lorsque nous nous préoccupons des perturbateurs endocriniens, nous nous intéressons à la santé de l'enfant, du futur adulte et de ses descendants. Nous avons des résultats pour la santé de l'enfant, lorsque nous éliminons les sources identifiées, parmi lesquelles les phtalates. Nous avons donc lancé la campagne « Zéro phtalates ».
Les phtalates sont des plastifiants. Les sols en polychlorure de vinyle (PVC) sont composés de 20 à 40 % de phtalates, essentiellement du phtalate de dihexyle (DHP), une substance classée « extrêmement préoccupante » par l' European chemicals agency (ECHA). Nous les remplaçons petit à petit, mais personne ne se soucie vraiment de remplacer tous ces sols en PVC qui sont une source majeure de contamination de l'enfant. Nous avons identifié huit maladies infantiles qui leur sont liées. L'une d'entre elles est l'asthme : une grande étude suédoise notamment montre un taux d'asthme doublé, lorsque le sol de la chambre des parents est en PVC. Cela signifie que nous pourrions diminuer l'asthme de l'enfant d'un facteur 2 en mettant par exemple des sols en caoutchouc naturel. L'hyperactivité, l'obésité, l'hypothyroïdie sont d'autres maladies liées aux phtalates.
Ainsi, en protégeant la grossesse de ce facteur, nous pouvons déjà diminuer toutes ces grandes maladies infantiles que nous savons soigner, mais que nous ne guérissons pas. Nous devons former les professionnels de santé. Une institution s'est créée, qui me semble être le bon lieu pour porter ces questions : ce sont les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). L'ensemble des professionnels de santé s'y trouve, par exemple des orthophonistes dont tout le monde sait qu'ils sont débordés. Toutefois, il est moins connu que nous avons la preuve que la contamination maternelle par des phtalates se traduit par des troubles du langage à l'âge de deux ans. Une action coordonnée et ciblée sur ce type de problème est possible, si les professionnels de santé disposent de la grille de lecture pour agir.
Nous avons le temps d'intervenir, car deux ans est une durée très courte même dans le temps du mandat politique. C'est ce que nous dirons aux candidats aux élections départementales et régionales ainsi qu'aux municipalités : il est possible d'obtenir des résultats, dans le domaine de la santé de l'enfant, dans le temps du mandat politique. Je suis convaincu que nous aurons des résultats car ce n'est pas si compliqué. Par ailleurs, les sols en PVC sont souvent les sols des HLM et le gradient social dans ces maladies infantiles y est lié.

Quels sont les leviers d'action majeurs pour accélérer la conscience des méfaits des pesticides sur la santé des citoyens ? Comment améliorer l'action politique pour une meilleure concertation, une meilleure sensibilisation ?
Il faut replacer la question dans le bon contexte. Lorsque nous appelons une substance « pesticide », l'espèce humaine dit que c'est un pesticide en fonction de l'usage qu'elle en fait. Les espèces vivantes ne les reçoivent pas comme des pesticides, mais, principalement, comme des perturbateurs endocriniens, des substances toxiques.
« L'effet cocktail » a été clairement démontré avec un phtalate, deux pesticides et un médicament. Par ailleurs, certains pesticides sont utilisés en agriculture biologique. C'est plutôt le type du pesticide qui pose problème, en fonction de son mode d'action, pas le fait que ce soit un pesticide.
Une réponse au problème est le développement de l'agriculture biologique. La dernière étude NutriNet parue le 9 novembre montre que le fait de consommer biologique diminue de 35 % le risque de diabète. Il faudrait regarder de plus près quelle est l'influence du bio et quelle est l'influence du mode de vie des gens qui mangent bio, mais, incontestablement, manger biologique va dans le bon sens. L'enjeu est l'alimentation ultra-transformée qui provient elle-même de cette agriculture ultra-productiviste. La contamination a lieu lors de la production agricole, du stockage et de la transformation.
Il faut promouvoir l'alimentation biologique, développer un autre modèle agricole que celui qui est actuellement dominant et pose trop de problèmes par ses impacts sanitaires et ses impacts sur l'écosystème. Nous devons nous engager dans la voie de l'agroécologie.

Nous avons compris qu'il faudrait selon vous procéder à une véritable révolution de notre notion même de la santé, de notre système de santé. Je ne sais pas si nous pourrons mettre en place le grand soir…
Pas le grand soir, disons des états généraux de la santé environnementale.

Quelle serait à votre avis la meilleure des gouvernances dans le meilleur des mondes possibles ?
Vous avez beaucoup parlé des actions à l'échelle des territoires et de la ruralité. Comment verriez-vous l'organisation générale de la gouvernance de la santé ? Au niveau du territoire, quel serait le bon niveau de portage ? Parlez-nous aussi de cette proposition d'états généraux développée par le Réseau environnement santé.
Un des enjeux dans cette discussion porte sur les compétences des collectivités locales. Nous voyons bien que le régalien ne peut pas assumer toutes les responsabilités à ce niveau.
Déclarer qu'une substance est un perturbateur endocrinien n'est certes pas une question locale car ce serait assez surprenant qu'une substance soit déclarée perturbatrice en Bretagne, mais pas en Pays de la Loire. Le niveau européen est ici le bon niveau d'ailleurs.
Par contre, les problèmes de santé environnementale ne peuvent pas être gérés de la même façon en Seine-Saint-Denis ou dans les Yvelines. Je fais donc référence aux CPTS, comme premier niveau de prise en charge de la santé environnementale, parce que l'ensemble des professionnels de santé s'y trouve. C'est le lien avec la population au niveau local.
Le niveau départemental est l'enjeu d'institutions comme la PMI. Cette institution doit être refondée autour de ce qui est son objectif historique, mais par rapport aux enjeux sanitaires actuels. Il faut aussi travailler la santé scolaire ; nous ne pouvons pas faire reculer l'obésité infantile et les troubles du comportement sans repenser la santé scolaire.
Un autre enjeu est la santé au travail ; le modèle de la santé au travail date de 1945 en séparant le travail de l'environnement et ce n'est pas pertinent. La période sensible est celle de la grossesse, mais personne ne s'occupe vraiment du fœtus lorsqu'il va sur le lieu de travail. Si le fœtus est impacté par une exposition au travail, il aura du mal à se faire reconnaître en maladie professionnelle. Cela paraît absurde alors que c'est un enjeu. Je pense donc qu'il faut sortir la santé au travail de son ghetto. Les normes en matière de santé au travail peuvent être dans un rapport de 1 000 à 20 000 entre la norme environnementale et la norme professionnelle.
J'imagine personnellement des agences régionales de santé environnementale pour regrouper les moyens, donner plus de pouvoir au niveau régional en lien avec les collectivités locales. Il faut un certain niveau de regroupement pour avoir la compétence technique. Le niveau régional est certainement le bon niveau. Les conseils régionaux auraient un rôle important à jouer. La mise en œuvre se ferait au niveau local avec les CPTS, en lien avec les collectivités locales.
Il faut également développer des métiers nouveaux. Je me flattais d'avoir lancé en 1998 un réseau santé et environnement intérieur pour regrouper tous ceux qui travaillent sur le sujet en France. Je suis passé au journal de TF1 parce que nous avions mis en évidence le fait que l'environnement intérieur était plus pollué que l'environnement extérieur, ce qui est aujourd'hui une banalité. Il faut sortir l'environnement intérieur de sa marginalité ; beaucoup de phénomènes se jouent à ce niveau. La fonction de conseiller médical en environnement intérieur a été créée voici une dizaine d'années et elle doit s'intégrer dans les CPTS pour qu'un professionnel fasse le lien entre les professionnels de santé et la dimension santé environnementale.
Il ne faut pas oublier de définir ce qu'est un professionnel de santé : nous confondons professionnel de santé et professionnel de soin. Pour moi, un ingénieur chimiste est, d'une certaine façon, un professionnel de santé. Il construira un environnement favorable ou défavorable. J'ai fait ce matin une réunion avec les urbanistes de l'école des ingénieurs de la ville de Paris : ils n'ont pas de formation en santé environnementale. Cette vision doit être portée dans toutes les professions. Si les ingénieurs chimistes, qui ont mis au point le polycarbonate à base de bisphénol et étaient très fiers d'avoir inventé un plastique alimentaire pour les biberons, avaient eu quelques connaissances, ils nous auraient évité de faire ce choix.
Je vois les états généraux comme le moment d'une discussion. Il faut les préparer pour savoir de quoi discuter. Il ne faut pas des cahiers de doléances. Il faut que la réflexion et les attentes de la population se soient manifestées dans des rencontres assez décentralisées et que l'ensemble se traduise en objectifs institutionnels et politiques. J'ai par exemple évoqué un opérateur dédié à la recherche en santé environnementale qui serait en fait la transformation de l'Initiative française pour la recherche en environnement-santé (IFRES). L'IFRES est actuellement une coordination des alliances, mais il faudrait un véritable opérateur chargé de la recherche en santé environnementale, de coordonner et de lancer des programmes par exemple sur l'exposome, avec un financement adapté.
Nous avons un programme de recherche sur les perturbateurs endocriniens qui n'est pas financé d'une année sur l'autre. Ce n'est pas possible ! Une stratégie de recherche se construit sur le moyen terme, à l'échéance de cinq à dix ans. Nous ne pouvons pas douter aujourd'hui de la nécessité de le faire. Nous ne pouvons pas prendre une décision politique qui risque d'être remise en cause d'une année sur l'autre.

Quelles sont les premières réactions du Réseau environnement santé à la lecture du projet de document du PNSE 4 ?
Comme son nom l'indique, le PNSE 4 vient après les trois premiers PNSE. La démarche logique consiste à faire le bilan de ces PNSE. Je pense que la forme choisie pouvait se comprendre à une époque où il fallait faire l'état des lieux et rassembler tout ce que nous pouvions trouver sur le sujet. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une démarche structurée différemment. Le PNSE 4 est un catalogue. Toute action de ce catalogue est intéressante, mais nous n'avons pas d'indicateurs.
Quel bilan avons-nous fait du PNSE 3 ? Comme l'ont dit les inspections générales ou le Haut Comité de la santé publique, il faut une autre logique. Je pense que l'enjeu est d'avoir une réflexion institutionnelle pour refonder la santé environnementale autour d'un enjeu prioritaire qui est la protection de la grossesse et de la petite enfance. C'est l'état de la science aujourd'hui et nous ne pouvons pas faire l'impasse sur les connaissances que nous avons maintenant.
La dimension institutionnelle est totalement absente dans le PNSE. Une institution comme la PMI qui doit être centrale n'est pas évoquée. Le pouvoir des collectivités locales en matière de santé environnementale n'est pas évoqué alors que c'est un vecteur extrêmement important de prise de conscience, d'actions et de résultats. Je pense que ces points devraient faire partie des états généraux, mais il faut une expression la plus large possible.
Nous ne pouvons pas réunir 300 000 personnes sur la place de la Concorde. Il faut synthétiser et nous nous enrichirons de ces débats. Je ne prétends pas avoir réponse à tout et nous nous enrichirons des attentes des différentes composantes de notre société. Je pense que l'attente est très forte et qu'une annonce politique forte dans ce domaine sera comprise de la population. Je ne crois pas que les gens iront sur les ronds-points pour contester une politique de santé environnementale.

Une catégorie qui risque d'être sur les ronds-points pour contester est celle des agriculteurs !
Ils sont eux-mêmes victimes de leur propre modèle. Regardez par exemple la répartition de la maladie de Parkinson. C'est compliqué de sortir de ce modèle, mais ce n'est pas possible de continuer à travailler dans des conditions comme les leurs. Il existe des solutions de remplacement. Il faudra du temps, mais les viticulteurs qui font du vin bio par exemple s'en sortent très bien et sont très contents. C'est la production qui progresse le plus, tout le monde apprécie et ce n'est pas forcément beaucoup plus cher.
Il existe un modèle vertueux qu'il faut faire émerger et qui donnera satisfaction même à l'industrie chimique. Je reste en contact avec ce milieu que je connais. J'y vois des gens qui ont envie de construire des procédés innovants dans ce domaine. Nous ne sommes pas obligés de penser la chimie comme nous la pensions dans l'après-guerre. Nous faisons aussi évoluer l'énergie, la voiture… en tenant compte des enjeux écologiques.
Dans les pressings, le procédé à l'eau a remplacé le perchloréthylène. C'est formidable !

Je ne sais pas si les fabricants de perchloréthylène ont été tellement ravis de perdre ces marchés pour un produit nettement moins cher.
Il se produit des ajustements, bien sûr.

Nous avons reçu les représentants de France Chimie et nous n'avons pas eu l'impression d'une véritable volonté de progresser. Leur réaction était de dire qu'ils appliquaient la réglementation, mais peut-être existe-t-il des courants internes.
C'est évident et la formation dans les écoles d'ingénieur évolue. De jeunes ingénieurs font le choix de ne pas travailler dans une entreprise qui ne contribue pas à la lutte contre le réchauffement climatique. La pétition a réuni 30 000 personnes ce qui est rarissime dans ce milieu.
L'image de la chimie est très abîmée, mais elle peut être refondée. J'ai l'habitude de dire que la chimie est le problème, mais qu'elle est aussi la solution.

Nous terminons sur cette parole positive à laquelle nous ne souhaitons qu'adhérer, en espérant qu'elle se confirmera assez vite. Nous vous remercions pour cet échange très instructif. Je pense que vous officialiserez votre position concernant le PNSE 4 et ferez des propositions constructives qui pourront faire évoluer la façon d'aborder la santé environnementale.
L'audition s'achève à dix-sept heures cinq.