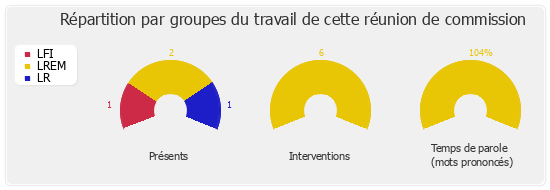Commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire
Réunion du mercredi 4 mars 2020 à 16h30
Résumé de la réunion
La réunion
La séance est ouverte à 16 heures 30.
Présidence de M. Ugo Bernalicis, président.
La Commission d'enquête entend M. Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d'État, M. Jean-Denis Combrexelle, président de la section contentieux, et M. Thierry-Xavier Girardot, secrétaire général.

Nous recevons à présent MM. Bruno Lasserre, Jean-Denis Combrexelle et Thierry-Xavier Girardot.
L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».
(MM. Bruno Lasserre, Jean-Denis Combrexelle et Thierry-Xavier Girardot prêtent successivement serment.)
Monsieur le président, je souhaiterais tout d'abord rappeler quels sont les quatre métiers, les quatre fonctions du Conseil d'état. Le Conseil d'État est le juge suprême dans l'ordre administratif. La section du contentieux juge entre 10 500 et 11 000 requêtes par an. Elle peut être saisie, premièrement, en cassation des arrêts rendus par les huit cours administratives d'appel, qui statuent elles-mêmes en appel des jugements des tribunaux administratifs. Deuxièmement, le Conseil d'État peut être saisi en appel, par exemple pour des litiges liés aux élections municipales. Dans ce cas, le Conseil d'État est directement saisi en appel des jugements des tribunaux administratifs en première instance. Troisièmement – c'est un point important et original en Europe –, le Conseil d'État peut aussi être saisi en premier et dernier ressort, ce qui concerne 15 % des affaires portées devant le Conseil d'État, pour des litiges liés à des actes réglementaires, des décisions des ministres – une circulaire récente l'a montré –, des décisions des autorités administratives indépendantes (AAI) et des affaires dont la portée est nationale. Nous tenons à garder ce contrôle direct sur des grandes décisions publiques. Nous pouvons ainsi mener un contrôle étendu en droit et en fait. Il est bénéfique que le juge suprême puisse se saisir d'affaires où il peut « mettre les mains dans le cambouis » et ainsi régler intégralement le litige porté devant lui.
La deuxième fonction du Conseil d'État est consultative ; elle trouve directement sa source dans la Constitution. Nous sommes obligatoirement saisis pour les projets de loi et d'ordonnance. Nous examinons aussi un grand nombre d'autres textes, dont les textes règlementaires les plus importants, ce qui représente un total de 1 300 textes par an. S'ajoutent des demandes d'avis et de conseils adressés par le Gouvernement. Un petit nombre d'entre eux sont rendus publics, ceux qui concernent les projets de loi. Depuis 2015, la coutume veut en effet que les avis soient rendus publics pour les projets de loi, avis généralement examinés le jeudi après-midi en assemblée générale.
La troisième fonction, qui est également importante et que je souhaite renforcer, est la fonction de diagnostic, d'étude et de proposition. Que ce soit de sa propre initiative ou par des commandes du Gouvernement, le Conseil d'État doit aussi être une force de proposition sur la gouvernance publique et la conduite des politiques publiques. Nous tenons à ce rôle. Notre double expérience de juge et de conseiller nous autorise à donner ces conseils sur l'action publique. Chaque année, trois ou quatre études sont rendues. Elles portent sur la technique de l'action publique : par exemple, l'étude annuelle de 2020 porte sur l'évaluation des politiques publiques, pour renforcer son efficacité. Une étude récente porte sur l'expérimentation, afin d'en faire un levier d'innovation dans la conduite des politiques publiques. Nous rendrons prochainement une étude sur le traitement du contentieux concernant les étrangers, pour le simplifier et le fluidifier.
La quatrième fonction du Conseil d'État est la gestion de la juridiction administrative, puisque le Gouvernement a délégué au Conseil d'État la gestion de toute la chaîne de la juridiction administrative : elle comprendre 42 tribunaux administratifs, huit – bientôt neuf en 2021 – cours administratives d'appel et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui est, en nombre de juges, de personnels et d'affaires, la juridiction la plus importante dans l'ordre administratif.
Nous allons parler essentiellement de cette première fonction juridictionnelle. Dans la délibération qui est à l'origine de la création de votre commission d'enquête, j'ai lu que la justice administrative était incluse dans le champ de vos réflexions. Nous avons préparé des réponses détaillées à la vingtaine de questions que vous nous avez adressées par écrit. Nous avons rempli notre copie ! Peut-être pourrons-nous enrichir notre réponse en fonction du débat et de vos questions de cet après-midi. Dans tous les cas, nous rendrons notre copie en temps utile. Il nous est aussi utile d'être stimulés par les questions des parlementaires.
J'en viens à des définitions. Je souscris sans réserve au terme d'indépendance, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour la notion de pouvoir judiciaire. Nous sommes les serviteurs de la Constitution et de la loi. Je lis la Constitution telle qu'elle est écrite, et j'y lis les mots « autorité judiciaire ». J'espère que vous me le pardonnerez. Nous pouvons faire du pouvoir judiciaire un vœu, mais je suis juriste et je lis les textes tels qu'ils sont rédigés.
Je souhaiterais revenir sur la signification du mot indépendance pour un juge, singulièrement pour la justice administrative, au sein de laquelle le Conseil d'État joue un rôle particulièrement important. L'objet même de l'indépendance est de garantir à ceux qui saisissent le juge et à ceux qui l'observent que l'issue du litige sera déterminée, dans l'exercice de la fonction juridictionnelle, sans aucune influence directe ou indirecte de tiers qui n'auraient aucun lien avec le procès.
Ce terme d'indépendance inclut deux dimensions. La première dimension, fonctionnelle, implique que le procès et l'organisation même de la justice doivent garantir que ceux qui rendent la justice – cela vaut évidemment pour la justice administrative – ne reçoivent ni pressions ni instructions dans l'exercice des fonctions juridictionnelles. La deuxième dimension, externe, de l'indépendance de la justice s'exprime par rapport aux autres pouvoirs, qui sont extérieurs aux juges. L'indépendance de la juridiction administrative implique que ni le pouvoir législatif ni le pouvoir exécutif ne viennent s'immiscer dans l'exercice de ses fonctions. Voilà la plus simple expression du principe de séparation des pouvoirs. Voilà les deux dimensions les plus classiques de l'indépendance de la justice.
Je souhaiterais insister sur deux autres dimensions. L'indépendance est aussi une obligation qui s'entend à l'égard des parties, et rejoint donc l'exigence d'impartialité, qui est davantage liée à la manière dont la juridiction est organisée, à son fonctionnement, ainsi qu'aux qualités personnelles du juge. Le juge doit être, mais doit aussi apparaître aux yeux du justiciable, le plus neutre et le plus impartial possible.
Enfin – et l'un de mes prédécesseurs le disait souvent –, l'indépendance est aussi une dimension personnelle. Le juge doit la faire vivre et se protéger lui-même. La plus grande tentation d'atteinte à l'indépendance est de faire passer ses convictions, ses passions et ses croyances avant son devoir d'impartialité. L'indépendance est aussi une obligation, pour le juge, de s'extraire de ses propres appartenances, déterminismes et convictions, pour raisonner en droit et de manière impartiale. Le juge doit s'arracher à ce qui le détermine comme individu et citoyen.
J'insisterai sur trois points. Premièrement, l'indépendance n'est pas seulement une question de textes. Nous avons beau être protégés par les meilleures garanties inscrites dans les textes, l'indépendance est une conquête de tous les jours, une manière d'être, un comportement. Les garanties sont une condition nécessaire, mais non suffisante. L'indépendance est une manière d'être, pour le juge, dans le prétoire, mais aussi à l'extérieur. Nous devons donner à voir cette indépendance et la faire vivre tous les jours.
Deuxièmement, il ne peut y avoir d'indépendance sans obligation de rendre des comptes. L'indépendance est une obligation et une exigence qui doivent habiter les juges, mais elle n'est pas l'irresponsabilité. Le juge doit aussi rendre des comptes à ceux qui lui ont donné ce pouvoir ou ce privilège. La justice administrative est responsable de ses actes, et doit rendre des comptes non seulement en tant qu'entité collective, mais aussi individuellement, au niveau de chaque juge.
Troisièmement, l'indépendance n'est pas le repli sur soi, le recroquevillement et l'autisme, la coupure du monde et la tour d'ivoire. L'indépendance suppose aussi des juges éveillés, curieux des choses du monde et en prise avec la société. Le juge, qu'on le veuille ou non, est un acteur de la vie administrative, économique et sociale. Il doit s'informer, s'intéresser aux conséquences concrètes de ses décisions. Il doit tester en permanence, avec pragmatisme, si les solutions adoptées sont praticables. Cela n'est pas faire preuve de complaisance, mais, dans l'œuvre de justice, derrière les décisions des juges, les conséquences sont importantes pour l'administration, le citoyen, les entreprises, les associations, les syndicats, etc. Le juge doit mesurer concrètement les enjeux que portent les litiges qu'il tranche.
Comment se structure l'indépendance pour la justice administrative ? Comment cette exigence est-elle née ? Comment est-elle organisée par les textes ?
Je me permets un bref retour en arrière historique, nécessaire à la compréhension de la naissance de la justice administrative et de son indépendance. Tout est parti de la Révolution française. En 1790, les constituants révolutionnaires ont souhaité mettre un terme aux incursions des parlements de l'Ancien régime dans la vie de l'administration. Ils ont poussé la séparation des pouvoirs tellement loin qu'ils ont exclu explicitement la possibilité, pour les tribunaux, de connaître des agissements de l'administration. Paradoxalement, la juridiction administrative est née du rejet, par les révolutionnaires, de ces pratiques de l'Ancien régime, dans lesquelles les parlements se substituaient à l'action de l'exécutif et de l'administration. Cette conception révolutionnaire de la séparation des pouvoirs allait très loin, était extrême. Pour éviter que la justice ne puisse intervenir dans les affaires de l'exécutif, ce dernier jouissait alors d'une sorte d'immunité juridictionnelle.
En 1799, le génie de Napoléon, en recréant le Conseil d'État qui existait déjà sous l'Ancien régime, est d'avoir modernisé et profondément transformé cette institution. Cependant, le Conseil d'État napoléonien n'avait que des attributions consultatives, y compris en matière juridictionnelle. Le ministre était juge de droit commun des litiges qui s'élevaient entre l'administration et les citoyens. Les décisions pouvaient être contestées, le litige était alors soumis au Conseil d'État qui émettait un avis. In fine, il revenait au chef de l'État de suivre ou de ne pas suivre cet avis. Voilà la raison pour laquelle, dans le langage courant, nous parlons encore beaucoup des avis du Conseil d'État, qui renvoient à une époque révolue. Pendant tout le XIXe siècle, la figure du chef de l'État a pris des formes très différentes, mais il a toujours suivi les avis du Conseil d'État – les exceptions se comptent sur les doigts d'une main –, y compris Napoléon.
Sous la IIIème République, tout change. La République naissante fait voter le 24 mai 1872 une loi « révolutionnaire », dirais-je, qui a imprimé un très profond changement, et qui réorganise le Conseil d'État. Cette loi marque l'abandon de la théorie du ministre juge, au profit d'une justice déléguée. On inscrit alors dans le marbre que le Conseil d'État statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative. La loi délègue au Conseil d'État le soin de prendre des décisions juridictionnelles qui s'imposent à tous, et non plus des avis émis à l'intention du chef de l'État. Cette loi de 1872 est déterminante : le Conseil d'État s'est alors mis à rendre des décisions en matière juridictionnelle, « au nom du peuple français », formule qui n'existait pas au XIXème siècle, sinon au cours du petit intermède de la IIème République. Cette théorie fonde aussi le recours pour excès de pouvoir. Je ne citerai pas l'un de mes lointains prédécesseurs, Édouard Laferrière, qui a théorisé le rôle du Conseil d'État comme juge administratif et la différence entre la responsabilité de l'administrateur et la responsabilité du juge. Cette période de la IIIème République a été incroyablement féconde : elle a fondé tous les grands principes – recours pour excès de pouvoir, contrôle de légalité, etc. –, l'effervescence contentieuse qu'elle a connue a fait naître tous les fondements du droit public et du droit administratif, et elle a installé le juge administratif et le Conseil d'État dans les institutions de la République. Cette époque va aussi conduire à la création, surtout après la Seconde Guerre mondiale, des principes généraux du droit, qui sont la colonne vertébrale de l'État de droit. Le Conseil d'État s'installe comme un garant de l'État de droit, protecteur des libertés individuelles, et le juge administratif tranche de manière impartiale les litiges entre l'administration et les citoyens.
Beaucoup de progrès ont été réalisés depuis 1872 au regard des garanties inscrites dans les textes qui fondent l'indépendance du Conseil d'État et de la juridiction administrative, dans la double dimension structurelle et personnelle que j'évoquais.
D'un point de vue structurel, la Constitution française ne cite le Conseil d'État que trois fois : à propos de la consultation obligatoire du Conseil d'État sur les projets de loi, à propos de la consultation obligatoire du Conseil d'État sur les projets d'ordonnance, et enfin à propos de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), comme filtre obligatoire, au même titre que la Cour de cassation, pour le renvoi au Conseil constitutionnel. Il n'est pas fait état, dans la Constitution, du rôle du Conseil d'État ou de la juridiction administrative en tant que juge. Le principe d'indépendance n'est pas inscrit formellement dans la Constitution. Cependant, le Conseil constitutionnel a symétrisé la situation de l'autorité judiciaire et la situation du juge administratif dans une fameuse décision de 1980, dans laquelle il considère que c'est la Constitution qui fonde l'indépendance de l'autorité judiciaire, mais que l'indépendance est aussi un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui s'applique à l'autorité administrative. C'est le Conseil constitutionnel qui tire de toute la tradition républicaine, ininterrompue depuis 1872, le principe d'indépendance de la juridiction administrative, qui a la même valeur qu'une disposition textuelle de la Constitution et qui ne pourrait être modifié que par un changement de la Constitution. Cette décision de 1980 rappelle qu'en vertu de cette indépendance, il n'appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans les jugements des litiges relevant de leur compétence.
L'indépendance personnelle, attachée à la personne du juge, a aussi fait l'objet de garanties inscrites dans les textes.
La première garantie est l'inamovibilité des membres de la juridiction administrative. Ils sont des magistrats de carrière et ne peuvent faire l'objet d'aucune mutation d'office, même en avancement. Ce principe est garanti de manière explicite par la loi, s'agissant des magistrats administratifs, mais l'inamovibilité est aussi installée pour les membres du Conseil d'État par la coutume constitutionnelle ; elle est vécue comme une règle tout aussi contraignante. Tout cela s'explique par l'histoire de cette institution, que j'ai résumée à grands traits. Un certain consensus existe : la naissance et l'histoire du Conseil d'État ne rendaient pas nécessaire l'inscription dans le marbre législatif de ce principe d'inamovibilité. Il a été reconnu comme existant de fait par la Cour européenne des droits de l'homme, qui attache une égale importance aux textes et à la coutume.
La deuxième garantie est celle de l'avancement à l'ancienneté, selon l'ordre du tableau. Au Conseil d'État, il s'agit d'une coutume, qui est scrupuleusement respectée. Les promotions de grade sont exclusivement fondées sur un critère d'ancienneté. Nous faisons aussi intervenir le choix au mérite pour l'accès à toute une série de fonctions à l'intérieur ou à la tête des juridictions. Il est normal que nous recherchions les profils les plus adaptés à ces fonctions. Ce choix est alors entouré de garanties, comme la consultation obligatoire de la Commission supérieure pour les membres du Conseil d'État ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTACAA) pour les magistrats administratifs.
La troisième garantie, dont j'aurais pu parler en premier, concerne le recrutement des membres de la juridiction administrative : la grande majorité des membres du Conseil d'État et des magistrats administratifs est recrutée sur concours, à savoir par le concours de l'ENA et par le concours complémentaire des tribunaux et des cours. Dans ce système du concours, méritocratique, ce sont les lauréats qui choisissent eux-mêmes leur affectation, selon leur classement. Ce système peut être critiqué, mais il a l'immense mérite de parer à la tentation de la cooptation, dans un système dans lequel c'est l'institution qui coopte ses membres, en choisissant souvent ceux qui ressemblent à ceux déjà installés. Le concours, par définition, obéit à une autre logique, qui est méritocratique. Si chacun a les mêmes chances de participer aux épreuves et de les réussir, les meilleurs choisissent l'institution qu'ils veulent rejoindre.
Le vrai tour extérieur – il y a les « vrais » et les « faux » tours extérieurs – concerne environ 20 % des membres du Conseil d'État. L'institution comprend entre 340 et 345 membres, dont 230 en activité. Les 110 et 115 restants sont essentiellement des membres en position de détachement, et pour une petite partie d'entre eux, en disponibilité. Le vrai tour extérieur permet au Gouvernement, au grade de maître des requêtes ou de conseiller d'État, de nommer des personnes extérieures à la juridiction. Cette respiration est très utile, elle est une ouverture à des talents qui ne sont pas forcément présents au sein de l'institution. Ainsi, nous restons ouverts à l'extérieur et nous pouvons nous enrichir d'expertises et d'expériences qui peuvent nous aider à réaliser notre travail de juge et de conseiller. Des garanties ont été apportées : des garanties de fond existent, et les nominations sont soumises à l'avis du vice-président, qui consulte aussi les présidents de section. Cet avis a toujours été suivi, à une exception près, relativement ancienne. Dans mon expérience de vice-président, je n'ai jamais eu à émettre un avis négatif ou, du moins, un avis qui n'aurait pas été suivi par le Gouvernement.
Les membres issus du tour extérieur sont soumis aux mêmes obligations d'indépendance et d'impartialité que les autres membres issus de l'auditorat, et donc de l'ENA. Surtout, le principe fondamental du Conseil d'État est la collégialité. Un membre issu du tour extérieur n'exerce pas un pouvoir seul. Il n'est pas pensable qu'il puisse, à lui seul, juger une affaire. Il statue toujours au milieu et avec d'autres personnes ; sa voix ne compte pas plus que ceux qui siègent avec lui. Ce principe de collégialité, à 3, 5, 9 ou 15 juges ou plus en fonction des formations, fait que le tour extérieur ne permet de faire entrer dans l'institution que des talents extérieurs qui vont être confrontés à d'autres opinions, à d'autres voix, notamment celles issues de l'auditorat.
Je termine par quelques mots sur l'impartialité, dont l'importance est majeure. L'impartialité exige que le juge ne puisse pas apporter de solution à un litige qui s'appuie sur une intime conviction autre que celle qui procède de l'application de la loi. De grands progrès ont été réalisés depuis 1872. Les obligations déontologiques des membres du Conseil d'État et de la juridiction administrative ont été explicitées, dans la loi et dans une charte de déontologie. Un collège de déontologie a été institué, pour guider l'application de ces principes ; il conseille à la fois les magistrats et les chefs des juridictions. Certes, la justice des hommes ne sera jamais la justice divine, la justice parfaite. Elle sera toujours le reflet d'hommes et de femmes qui se réunissent pour essayer de trouver la meilleure solution compatible avec le droit qu'ils appliquent. Appliquer le droit, dans une démocratie, implique d'appliquer les textes, la Constitution et la loi tels que votés par les autorités démocratiquement investies. Dans cette tension, les juges poursuivent leurs interrogations, leurs doutes et la confrontation de leurs opinions avec celles des autres. Voilà le propre d'une justice humaine qui n'est pas parfaite, mais qui, au jour le jour, dans cette recherche de l'indépendance et de l'impartialité, va s'extraire de ce que pense chacun, pour, en conscience, essayer de trouver la solution la plus conforme au droit, la plus juste et la plus équitable pour résoudre le litige porté devant elle. Je pourrai revenir au cours de notre échange sur la charte de déontologie et sur les solutions qu'elle apporte. Elle règle notamment la question de la dualité de fonction confiée au Conseil d'État, celle de juge et celle de conseil, en prévoyant des cloisons très claires et étanches entre les fonctions, pour préserver l'impartialité du juge, qui, in fine, décide.
Je terminerai par trois réflexions. Premièrement, ce chantier de la déontologie, dont j'ai brièvement parlé et qui a commencé au début des années 2000, avec l'adoption de la charte et la création du collège, est essentiel. À l'époque où les garanties juridiques de l'indépendance de la juridiction administrative sont toutes acquises, ce chantier témoigne du fait que la juridiction administrative est en permanence à la recherche du bon équilibre, d'une amélioration concrète, constante, de ces garanties d'impartialité. La déontologie est une manière de progresser, en s'adressant directement aux membres de la juridiction, en incitant à réfléchir à ce que le métier exige de manière concrète.
Deuxièmement, la juridiction administrative est en mouvement. Je suis pour la réforme. Je ne m'arc-boute pas sur la défense de l'existant. Vous m'adresserez sans doute des questions sur la mission Thiriez et ses conséquences sur le Conseil d'État. Je vous ferai part des convictions qui m'animent. Comme toute la haute fonction publique, le Conseil d'État et la juridiction administrative doivent ressembler davantage à la France d'aujourd'hui et refléter sa diversité sociale et géographique. Des choses, sans doute, sont à faire et à changer. En tant que responsable de cette institution, je suis du côté de ceux qui pensent qu'une réforme est sans doute nécessaire, à condition qu'elle préserve trois valeurs essentielles, dont la première est la jeunesse et la présence de jeunes. Le Conseil d'État est une institution dans laquelle toutes les générations sont présentes. Le fait d'accueillir chaque année quatre, cinq ou six jeunes, qui nous apportent le vent d'une société qui bouge, qui nous stimulent, qui nous bousculent au bon sens du terme, qui nous forcent à voir les choses d'une manière différente, est une garantie essentielle. Nous ne sommes pas une institution de vieux qui arrivent au Conseil d'État en fin de carrière pour se mettre à l'abri pour le restant de leurs jours. Viennent au Conseil d'État des personnes qui aiment le droit, sans quoi ils seront malheureux, mais qui aiment aussi l'action, et qui vont, à un moment de leur vie, s'exposer aussi à la prise de responsabilités, qui vont sortir de leur zone de confort, qui vont s'exposer, au bon sens du terme. Ce point est essentiel. Pour bien juger et bien conseiller l'administration, il faut connaître les tensions de l'action publique. On ne peut le faire seul dans sa chambre, en lisant les livres. Il est très bénéfique que la jeunesse soit présente au Conseil, au même titre que toutes les autres générations. La deuxième valeur est l'indépendance, je n'y reviens pas. L'indépendance est consubstantielle à l'œuvre de justice et est la condition même de la légitimité de la juridiction administrative. La troisième valeur est l'ouverture, à la fois en accueillant des talents extérieurs, en faisant respirer cette institution qui en sera ainsi enrichie, et en favorisant la mobilité des membres du Conseil d'État, qui, à un moment de leur carrière, serviront en administration active, dirigeront des établissements publics et des AAI, et agiront sur les territoires, avant de revenir exercer leurs fonctions de juge et de conseiller avec un regard nouveau, enrichi par cette expérience dans l'administration active.
Ma troisième conviction est que la juridiction administrative doit être protégée non seulement par des règles et des coutumes, mais aussi par des manières d'être et de vivre. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, je pense aussi que la meilleure manière de ne pas porter atteinte à l'indépendance de la juridiction administrative reste encore, pour les autres pouvoirs publics, de faire preuve de respect et de retenue. La séparation des pouvoirs repose sur des textes, mais aussi sur des comportements et des pratiques. Chaque pouvoir doit respecter les autres.

Merci, monsieur le vice-président. Quelle est la différence de statut entre membres Conseil d'État et membres des juridictions administratives, qu'il s'agisse des tribunaux administratifs ou des cours administratives d'appel ? Ne serait-il pas plus simple de disposer d'un corps unifié, puisqu'il est de coutume de dire que les membres du Conseil d'État sont des fonctionnaires non-magistrats ? Pour garantir leur indépendance, ne serait-il pas plus simple qu'ils soient magistrats ?
C'est un choix politique, un choix issu de la loi. Nous sommes les serviteurs de la loi, tel est le choix du législateur et nous le respectons. Dans l'absolu, une autre organisation serait possible. Cependant, ce choix est lié à l'histoire et à la manière dont s'est construite la juridiction administrative.
Quelles sont les raisons de ce choix ? Premièrement – cela est très important –, le Conseil d'État, au sein de la juridiction administrative, exerce des fonctions particulières, ce qui est très différent de la Cour de cassation par rapport aux cours d'appels et aux tribunaux judiciaires. Nos collègues du Conseil d'État sont à la fois juges et conseils, ce qui n'est pas le cas dans les tribunaux et les cours, qui sont essentiellement centrés sur la fonction juridictionnelle. Le Conseil d'État exerce quatre métiers différents ! L'unité de la juridiction administrative existe bien, mais doit-elle nécessairement passer par l'unité du corps et des règles de fond ? Nos métiers ne sont pas les mêmes.
Deuxièmement, le Conseil d'État, étant donné son positionnement, doit aussi respirer. Cette institution ne peut être seulement constituée de magistrats qui font le choix de la magistrature de carrière, dès le début de leur vie professionnelle. Dans nos fonctions de conseil et de proposition, comme dans nos fonctions juridictionnelles, nous avons besoin, sur beaucoup de sujets, d'expertises extérieures, par exemple pour la responsabilité hospitalière, l'urbanisme ou la construction, les questions de santé et d'environnement, qui sont souvent très complexes. Le fait de bénéficier du regard qu'apportent les spécialistes, un professeur hospitalier, un spécialiste de la santé et de l'environnement, etc., nous aide considérablement. Le Conseil d'État doit ainsi avoir présentes en son sein des personnes qui n'ont pas fait le choix d'origine de la magistrature de carrière.
Enfin, je serai très honnête avec vous…
Je le suis de manière générale, mais tout spécialement dans la réponse à cette question ! Cette modification n'est pas demandée. En tant que responsable du Conseil d'État, je serais évidemment à l'écoute s'il s'agissait d'une revendication de mes collègues et des membres de l'institution. Cela est presque une fierté de dire que nous sommes indépendants sans avoir besoin de l'écrire. D'ailleurs, les personnes extérieures le voient et le respectent. Nous avons le sentiment que nous n'avons pas besoin de nous draper derrière des garanties textuelles, si nous vivons, faisons percevoir et sentir cette indépendance par notre manière d'être et notre manière d'exercer notre métier. En interne, il n'existe pas de demandes tendant à la reconnaissance du statut de magistrat ou l'inscription dans les textes d'une telle garantie d'inamovibilité.
Enfin – il me semble que voici la meilleure réponse –, je voudrais vous lire ce qu'a écrit la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une cour exigeante pour les États membres et qui garantit la Convention européenne des droits de l'homme. Elle s'est intéressée, comme vous le savez, à des pays comme la Hongrie, la Pologne ou d'autres encore, pays qui ne remplissent pas tous les critères de l'État de droit. Dans un arrêt Sacilor-Lormines c/ France du 9 novembre 2006, ainsi que dans un arrêt Kress c/ France du 7 juin 2001, la Cour écrit qu'elle a clairement reconnu que si l'inamovibilité des membres du Conseil d'État n'était pas prévue par les textes, elle se trouvait garantie en pratique, comme est assurée leur indépendance, par des usages anciens tels que la gestion du bureau par le Conseil d'État, sans ingérence extérieure, ou l'avancement à l'ancienneté, garant de l'autonomie tant à l'égard des autorités politiques qu'à l'égard des autorités du Conseil d'État elles-mêmes. Tel est notre brevet européen, qui est on ne peut plus clair. L'indépendance n'est pas seulement une question de texte, mais de comportement. C'est une conquête de tous les jours. Le Conseil d'État peut être fier d'avoir conquis cette indépendance, non pas de manière textuelle, mais de manière concrète. Voilà qui est unanimement reconnu.

D'autres pays européens ont déjà garanti cette indépendance dans leurs textes. Si cela est déjà acquis dans les pratiques et dans la coutume, vous ne verriez sans doute aucun inconvénient à ce que cette garantie figure en dur dans les textes, puisque cette garantie est intéressante du point de vue de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà qui serait plus clair pour tout le monde : pour vous-mêmes, pour le législateur, pour le citoyen et pour les futurs présidents de la République, qui pourraient être tentés d'entraver les coutumes.
Il est plus difficile de changer une coutume qu'un texte. La coutume résulte d'un constat, d'une tradition républicaine ininterrompue. L'inscrire dans la loi donnerait le sentiment de la réversibilité, alors que le constat d'une coutume est presque plus irréversible.

Je trouve assez cocasse que, en tant que vice-président du Conseil d'état, vous défendiez la coutume plutôt que la loi !
Le principe d'indépendance figure en toutes lettres dans l'article L. 131-2 du code de justice administrative, qui énonce les obligations qui s'imposent aux membres du Conseil d'État : « Les membres du Conseil d'État exercent leur fonction en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité, et se comportent de manière à prévenir tout doute légitime à cet égard. » Derrière l'énoncé de ces obligations se trouvent en réalité les mêmes obligations que celles qui s'imposent à ceux que la loi qualifie expressément de magistrats. Il me semble que le fond est plus important que l'appellation.

Je m'interroge quant au cloisonnement que vous dites avoir en interne entre les conseillers et les juges. Quelles sont les règles du cloisonnement ? Les membres du Conseil d'État intègrent l'institution à la sortie des concours interne, externe et troisième voie, à l'issue du tour extérieur, certains ont une vie professionnelle antérieure, certes principalement dans l'administration. Si un nouveau membre du Conseil d'État a travaillé au ministère des armées, comment gérez-vous la situation au contentieux ou dans la section administrative ? Pourra-t-il travailler sur des sujets qui auront trait à la défense ? Comment s'effectuent les roulements internes ? Pourra-t-il imaginer s'intéresser cinq ou six ans plus tard à un domaine de compétences qui a trait à son ancien ministère ? Monsieur le vice-président, vous disiez qu'avoir en votre sein un ancien directeur d'hôpital est une bonne chose, car il peut faire valoir des compétences utiles. Cependant, ne risque-t-il pas d'être à la fois juge et partie, de par son ancien environnement professionnel ?
En matière de cloisonnement, il nous faut distinguer deux choses. Des pare-feu, issus des textes, existent. Ainsi, les fonctions juridictionnelles et consultatives sont respectées, en toute indépendance l'une par rapport à l'autre. Un décret de 2008 a formalisé cette distinction ; il conduit aux pratiques suivantes. La première pratique, qui existait en coutume depuis la Libération, a été ainsi inscrite dans un texte : un membre du Conseil d'État qui a pris part à un avis sur un texte ne peut pas siéger en tant que juge si ce texte est contesté, ou même lorsque la légalité de ce texte est invoquée par voie d'exception à l'occasion d'un litige individuel. Voilà pour la dualité de fonction. Inversement, les membres du Conseil d'État qui statuent dans une formation de jugement ne peuvent pas avoir accès à l'avis quand il n'a pas été rendu public par le Conseil d'État, et donc ne peuvent pas s'inspirer de l'avis ou de ce que disent les travaux préparatoires à l'avis pour formaliser la décision à laquelle ils vont concourir. Enfin – je parle sous le contrôle de M. Combrexelle –, alors qu'autrefois, dans les formations de jugement les plus importantes, notamment pour les chambres réunies ou la section du contentieux, des représentants des sections administratives étaient obligatoirement présents, ce n'est plus le cas. Elles sont composées exclusivement de membres affectés à des fonctions juridictionnelles.
Votre question portait aussi sur les garanties concernant l'intégration de personnes, par exemple issues de l'administration active, préfets, ambassadeurs, directeurs d'hôpital, officiers généraux, ingénieurs, etc. La première garantie s'impose à tous les membres du Conseil d'État : nous avons une obligation de déclaration d'intérêts, qui doit être remplie dans les deux mois qui suivent l'entrée en fonction, et qui doit être renouvelée et actualisée à chaque changement d'affectation, d'attribution, etc. Surtout, la remise de cette déclaration d'intérêts s'accompagne d'un entretien déontologique avec le président de la section ou de la chambre, qui va lire la déclaration et commenter avec l'intéressé tous les problèmes potentiels que peut susciter l'exercice d'activités passées, encore en cours, ou même les activités exercées par le conjoint. C'est au cours de ce dialogue que nous réglons les cas où l'intéressé devra s'abstenir de siéger pour certaines affaires, aussi bien pour les formations consultatives que juridictionnelles. Si un doute existe, nous pouvons saisir le collège de déontologie, qui va émettre un avis et préciser les règles du jeu. Par exemple, l'habitude a été prise de ne pas affecter une personne issue du tour extérieur dans une chambre qui va juger les affaires du département ministériel dont il relève. En formation consultative, il ne pourra pas prendre part à une délibération concernant une direction qu'il a occupée. Tout est formalisé entre le président et l'intéressé et, si nécessaire, explicité par un avis du collège de déontologie. Ces pratiques sont mises en place et surveillées de manière extrêmement vigilante et attentive. Nous pourrons vous donner quelques exemples dans les réponses aux questions écrites. Le collège de déontologie a eu à régler toute une série de questions concrètes liées à l'intégration de nouveaux membres. Il en va de même si des membres du Conseil d'État sont membres d'une association ou d'un parti politique. Nous sommes attentifs au fait qu'ils ne puissent pas siéger en tant que juge ou conseiller sur une affaire qui pourrait faire suspecter leur impartialité. Voilà qui est vécu comme une vraie exigence, à laquelle la collectivité du Conseil d'État et le bureau sont particulièrement attentifs.
Cette exigence est totalement intégrée par les membres du Conseil d'État. La règle du déport veut que, si une personne estime qu'elle a eu à connaître directement ou indirectement une affaire, elle se déporte. Par expérience, comme président de la section du contentieux, les collègues ont une pratique extrêmement large du déport. Si un membre a eu à connaître de près ou de loin une affaire, par exemple par relation associative ou familiale, le collègue se déporte sans motivation expresse. Cette pratique est très courante dans les formations de jugement, quel que soit le niveau de la chambre.

Quand vous dites qu'une personne ayant exercé des fonctions antérieures ne peut pas exercer au sein du Conseil d'État dans le même domaine, est-ce ad vitam aeternam ? Existe-t-il un délai qui lui permette de revenir vers son domaine de compétences ?
Par ailleurs, des désignations de membres du Conseil d'État ont lieu pour un certain nombre d'organismes. Comment gérez-vous ces désignations, d'autant plus qu'elles sont accompagnées de rémunérations. Comment faites-vous la part des choses ? Comment gérez-vous les compétences, en lien avec la déclaration d'intérêts ? Sont-ils désignés exclusivement en dehors de leur domaine de compétences ? S'ils exercent dans un organisme, cela les empêche-t-il d'exercer ensuite au contentieux dans un domaine donné ? Ou, au contraire, sont-ils sollicités pour une formation consultative particulière ?
Se déporter n'est évidemment pas une obligation ad vitam aeternam, mais elle s'applique aussi longtemps que l'impartialité pourrait être suspectée. À titre d'exemple, la charte de déontologie fixe une période d'environ deux ans, période précisée avec le président de chambre ou le chef de la juridiction dans les tribunaux administratifs ou les cours administratives d'appel, pendant laquelle il est demandé au membre intéressé de s'abstenir de participer au jugement des litiges, concernant les décisions prises par l'autorité auprès de laquelle il exerçait précédemment. Évidemment, si vous avez pris la décision vous-même, dans le cas où vous avez été directeur d'administration centrale, vous devez vous abstenir de siéger pour tous les litiges qui concernent cette décision, y compris si elle date de dix ou quinze ans. Par définition, si vous êtes l'auteur de la décision, un déport perpétuel s'impose. À l'inverse, si je suis sous-directeur au ministère de l'économie et des finances, si le litige porte sur des décisions que je n'ai pas prises, mais qui ont été prises par l'administration ministérielle dont je relevais, le délai indicatif de deux ans joue alors, telle une période de sas qui permet de s'éloigner progressivement de ses fonctions antérieures.
Votre autre question est relative aux activités qui peuvent être confiées aux membres du Conseil d'État à l'extérieur de l'institution. Très souvent, c'est la loi qui prévoit ces missions : elle indique que telle autorité ou telle mission consultative doit comporter la présence de conseillers d'État, qui sont soit désignés par le vice-président, soit élus par l'assemblée générale, en fonction des organismes concernés. Ces fonctions doivent obligatoirement figurer dans la déclaration d'intérêts, qui doit être actualisée chaque fois qu'une nouvelle activité est confiée. Ainsi, le membre doit s'abstenir de siéger lorsque le litige concerne l'organisme dans lequel il sert à titre accessoire.
En matière consultative, notre appréciation est plus souple. Nous ne jugeons pas des actes, mais émettons un avis sur la conformité au droit de normes, telles que les lois organiques, les lois ordinaires, les ordonnances et les textes règlementaires. Le curseur est adapté au cas par cas. Quand la question est très sensible, notamment pour les demandes d'avis, nous voyons avec l'intéressé s'il peut ou non siéger. Cependant, la notion de litige n'existe pas, il ne s'agit que d'émettre un avis sur des questions de droit.

Je vous remercie de vos propos liminaires, pour leur clarté et leur vertu pédagogique, qui est très utile. Dans certains domaines, il n'est pas toujours facile de s'appuyer sur des points de repères limpides. Par ailleurs, nous ne pouvons que vous accompagner dans votre souhait de jeunesse pour l'institution.
Le Conseil d'État a un rôle tout à fait majeur au sein de nos institutions, aussi bien pour les sections consultatives que contentieuses. Il ne se passe pas une journée sans qu'un avis ou une décision du Conseil d'État fasse l'objet d'un traitement important par la presse. Vos avis et vos décisions ont aussi une grande importance pour le Parlement. Comment gérez-vous ce poids de la presse, des médias et de l'opinion publique ? Par exemple, votre récente décision sur les zones de non-traitement (ZNT) a eu un très grand retentissement, sans parler de décisions encore plus récentes. Comment gérez-vous ces questions au sein même de l'institution, car cette pression s'exerce aussi sur son indépendance ?
L'indépendance n'est pas le recroquevillement sur soi, ce n'est pas l'autisme, mais l'obligation de rendre des comptes, d'expliquer ce que faisons et de faire de la pédagogie autour de nos décisions et nos avis. Le Conseil d'État dispose d'un service de communication, qui gère cette relation avec les journalistes et les médias. L'une de mes ambitions, en tant que vice-président – je ne le cache pas – est d'ouvrir davantage la maison du Conseil d'État à l'extérieur, par exemple aux parlementaires. Nous avons invité les parlementaires – j'espère que la commission des lois a déjà saisi cette offre, comme d'autres commissions – à découvrir les métiers du Conseil d'État et à assister à une séance de référé au contentieux, à dialoguer avec la section administrative correspondante, à entendre une présentation de la gestion de la juridiction administrative, et même à participer à une assemblée générale consacrée à l'examen d'un projet de loi, pour comprendre comment nous travaillons et délibérons. Ces nouvelles habitudes ont rencontré un très grand succès, à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Nous allons continuer, car nous n'avons rien à cacher. Au contraire, nous voulons montrer ce que nous sommes et comment nous travaillons concrètement.
Pour la communication, nous établissons une différence entre les décisions juridictionnelles et les avis, qui eux sont transmis à un autre pouvoir, à l'exécutif ou au Parlement. La communication ne peut être la même pour une décision dont nous sommes l'auteur ou pour un avis qui est rendu à une autre autorité.
Pour les décisions qui ont le plus de sensibilité médiatique ou d'intérêt juridique, nous rédigeons des communiqués de presse. Nous recevons parfois des journalistes, quand ils souhaitent mieux comprendre la portée d'une décision. Pour l'affaire Lambert, qui a été scrutée avec beaucoup d'attention et a suscité un immense intérêt, nous avons par exemple tenu un point presse pour expliquer nos décisions et répondre aux questions de journalistes. Cela va dans le sens d'une bonne pédagogie.
Pour les avis, c'est plus difficile. Nous rendons des avis à une autorité qui est maîtresse de sa diffusion. Pour les avis sur les projets de loi, l'ancien Président de la République François Hollande a décidé, depuis 2015, sans texte, de rendre publics les avis du Conseil d'État ; cette coutume présidentielle n'est inscrite dans aucun texte. Nous la respectons. Quand le Conseil des ministres se réunit le mercredi sur un projet de loi qui a été examiné par le Conseil d'État, l'avis est publié sur le site Legifrance et sur le site du Conseil d'État, dès le mercredi après-midi. Cependant, nous ne commentons pas cet avis, c'est à l'autorité destinataire de cet avis de le faire, si elle le souhaite. Nous sommes heureux quand nos avis, qui constituent une littérature relativement longue et austère, sont lus. Cela nous fait plutôt plaisir – en tout cas, cela ne nous fait pas de peine. La publicité des avis n'a rien changé à notre métier de fond. Nous nous exprimons avec la même franchise et la même impartialité que par le passé. Cependant, cela nous oblige à rédiger nos avis en sachant qu'ils seront publics et que, par conséquent, leur résonance médiatique sera plus grande. Cela ne change rien sur le fond, mais, par exemple, nous expliquons désormais les points d'accord, et non plus seulement les points de désaccord. Lorsque nous adressons une note au Gouvernement, nous passons en revue tous les points importants d'un projet, y compris quand une disposition particulière ne soulève pas d'obstacle juridique de notre part. En revanche, nous sommes parfois invités par les commissions parlementaires pour expliquer nos avis ; nous n'acceptons pas ces invitations, car nous ne souhaitons pas être en porte-à-faux par rapport aux avis rendus collégialement. Nous pourrions alors être interrogés sur des amendements ou des modifications qui pourraient être introduites. Nous ne commentons pas, nous ne faisons pas de service après-vente, qui consisterait à expliquer nos avis devant la représentation parlementaire. Les avis doivent se suffire à eux-mêmes pour comprendre notre position.

Le conseil de déontologie a-t-il rendu des avis sur des questions liées directement à l'indépendance des membres du Conseil d'État ?
Par ailleurs la différence est assez sensible entre l'autorité judiciaire – je parle bien d'autorité judiciaire, tout comme vous, monsieur le vice-président – et le Conseil d'État.
Les premiers présidents et présidents devaient être soumis non pas seulement à une déclaration d'intérêts, mais aussi à une déclaration de patrimoine. Que pensez-vous d'une telle mesures pour les membres du Conseil d'État et, le cas échéant, pour les autres membres de la justice administrative ?
Je ne crois pas que le collège de déontologie se soit prononcé sur des cas mettant en lumière des atteintes à l'indépendance de l'institution ou des interventions intempestives de tiers ou d'autorités publiques.
À l'inverse, des avis portent sur l'impartialité et les exigences de probité et d'intégrité qui s'imposent aux juges administratifs. Par exemple, un magistrat administratif peut-il exercer des activités d'enseignement rémunérées au bénéfice de cabinets d'avocats ? La réponse est non, car cela placerait l'intéressé dans une situation de dépendance vis-à-vis de ce cabinet. La question a aussi été posée – vous allez sourire – de savoir si un rapporteur public pouvait se voir offrir un cadeau en remerciement de ses conclusions. La réponse a été évidemment non. En tant qu'auditeur – j'étais alors tout jeune –, une personne, très satisfaite de mes conclusions, avait souhaité m'abonner pendant un an au Progrès de Lyon. J'ai dû lui faire comprendre que, même si ce journal m'intéressait beaucoup, je ne pouvais bénéficier d'une telle faveur. Nous avons aussi connu le cas d'un conseiller d'État en service extraordinaire qui était le mari d'une ministre en fonction. Le collège a émis un avis sur le point de savoir s'il pouvait exercer les fonctions principales du Conseil d'État. D'autres questions peuvent survenir, comme pour un conseiller d'État qui aurait exercé des fonctions antérieures au sein d'un cabinet ministériel. Sur toutes ces questions, qui portent plus sur l'impartialité que sur l'indépendance, des avis sont rendus et sont publiés sur le site internet du Conseil d'État.
Par symétrie avec la loi du 20 avril 2016 pour les juridictions administratives, la loi organique du 8 août 2016 prévoyait effectivement qu'un certain nombre de juges, à la tête des juridictions judiciaires, devaient, en sus de la déclaration d'intérêts qui s'impose à tous, remplir des déclarations de situation patrimoniale. Cette loi a été déférée au Conseil constitutionnel, qui, dans une décision du 28 juillet 2016, a jugé que le législateur organique, s'agissant de l'obligation qui pesait notamment sur le premier président de la Cour de cassation et sur les présidents de chambre, ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, réserver l'obligation de déposer une déclaration de situation patrimoniale aux seuls premier président et présidents de chambre de la Cour de cassation, ainsi qu'au procureur général et premiers avocats généraux près la Cour de cassation, aux présidents et procureurs généraux des cours d'appel et présidents de tribunaux judiciaires et procureurs de la République. Du coup, le décret d'application nécessaire à l'application de la loi du 20 avril 2016 sur ce point n'a pas été pris, le Gouvernement ayant considéré que cette décision du Conseil constitutionnel, prise au nom du principe d'égalité devant la loi, valait autant pour les juridictions judicaires que les juridictions administratives. L'obligation n'est pas entrée en vigueur, faute d'un décret qui lui-même se confronte à l'inconstitutionnalité de la loi sur le fondement de laquelle il devait être pris.

Je vous remercie de cette importante précision.
Nous avons procédé avant votre audition à celle des membres de la Conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires. Ils établissent un lien direct entre la notion d'indépendance et leurs moyens budgétaires, faisant une différence sensible – ce sont leurs propos, non les miens – entre la situation de la juridiction judiciaire et celle de la juridiction administrative, qu'ils considèrent comme beaucoup mieux dotée, notamment car, selon eux, vous disposeriez de moyens de prévision budgétaire qu'ils n'ont pas. Vous pourriez mieux prévoir vos budgets, et les crédits, une fois votés, ne pourraient vous être retirés. La mécanique budgétaire vous donnerait une sécurité budgétaire bien supérieure. Cette question est un peu abrupte, mais quel est votre sentiment sur votre exercice budgétaire, puisque vous être chargé de l'administration de l'ensemble de la chaîne juridictionnelle administrative française ? Les conditions budgétaires ont-elles une incidence sur les garanties d'indépendance que nous vous devons ?
Premièrement, c'est le Parlement qui vote les budgets, que ce soit celui de la justice, en tant qu'il finance le fonctionnement des juridictions judiciaires, ou celui de la juridiction administrative, qui figure dans le programme 165 de la mission « Conseil et contrôle de l'État ». Nous ne pouvons dépenser que ce que le Parlement nous attribue, et nous remercions le Parlement de voter ce budget chaque année. Je constate que les rapports parlementaires qui accompagnent les discussions de ce programme 165 soulignent l'efficacité de la juridiction administrative et le fait que cet argent est bien dépensé, et surtout que ce budget pourrait être plus important. La juridiction administrative dispose d'un seul budget, qui est fongible, alloué à l'ensemble de la juridiction administrative.
Je passe désormais la parole à M. Girardot, secrétaire général, qui répartit ce budget entre toutes les juridictions, c'est-à-dire entre les 42 tribunaux administratifs, les huit cours administratives d'appel, la CNDA et le Conseil d'État. M. Girardot est un peu le ministre du budget de la juridiction administrative, charge dont il s'acquitte très efficacement ! À l'automne, il tient des conférences budgétaires avec chaque chef de juridiction, dans lesquelles ils discutent des besoins et des objectifs de la juridiction. Il s'intéresse aux indicateurs d'activité dont la juridiction doit rendre compte. Ces conférences conduisent à l'attribution d'une masse budgétaire pour chaque juridiction, accompagnée de lettres de cadrage pour fixer le cadre de fonctionnement de chaque juridiction.
Le total du budget de la juridiction administrative est de 440 millions d'euros en 2020, fongibles dans un seul budget. Le Conseil d'État gère toutes les fonctions support : immobilier, ressources humaines, paiement des salaires des magistrats, informatique, lancement des chantiers numériques, etc., en liaison avec les équipes des tribunaux et des cours. Tout est mis en commun. Notre administration est commune pour toutes les fonctions support.
Je cède donc la parole à M. Girardot, sur la question de la prévisibilité ou de la protection dont nous jouirions contre les à-coups budgétaires ou les gels ou reprises de crédits. Je ne suis pas sûr que nous soyons plus favorisés que d'autres sur ce point.
J'agis par délégation du vice-président. Le vice-président est le responsable du programme, c'est plutôt lui qui est l'équivalent du ministre, si je puis me permettre.
Le mode de gestion du budget de la juridiction administrative fait que nous entretenons une discussion directe avec le ministère du budget pour préciser les besoins et la demande de budget que nous faisons. Je ne suis pas sûr que cela nous permette d'obtenir davantage que si nous passions par l'intermédiaire d'un ministre. Ce sont bien le ministre du budget et le Gouvernement qui présentent le projet de loi de finances au Parlement, lequel fait ensuite les arbitrages.
La différence se situe plutôt au niveau de la gestion du budget, une fois que ce budget est voté. Notre programme 165 est unique. Ce budget est réparti par le biais de conférences de gestion que je tiens avec chacun des chefs de juridiction aux mois d'octobre et de novembre. Nous passons alors en revue l'activité de chaque juridiction, ses besoins en effectifs, en immobilier et en dotations de fonctionnement. Nous attribuons ensuite les moyens en fonction de ces besoins.
La différence, peut-être, avec la juridiction judiciaire est que le budget est géré à plus petite échelle. Nous organisons une réunion directement avec chaque juridiction, parce qu'elles sont beaucoup moins nombreuses. Dans l'ordre judiciaire, une partie de la gestion est déléguée au niveau de la cour d'appel. Dans la juridiction administrative, les juridictions sont moins nombreuses, beaucoup ont une petite taille et n'ont pas la capacité de gérer elles-mêmes les fonctions support. Ainsi, la plupart des fonctions support et des moyens budgétaires sont centralisés au Conseil d'État, et font l'objet de ce dialogue de gestion avec chacune des juridictions pour déterminer leurs besoins. Cela ne nous met pas à l'abri des mesures de gel budgétaire, même si nous avons des négociations en cours d'année budgétaire pour obtenir des levées partielles du gel, lorsque nous arrivons à convaincre les autorités financières. En revanche, il est vrai que nous disposons d'une assez grande autonomie sur l'attribution des moyens à l'intérieur même de la juridiction.

Monsieur le vice-président, je partage votre point de vue. Il semble primordial de rendre la justice administrative plus proche sociologiquement de la population française. L'image d'une justice de classe ne peut qu'être entretenue quand on analyse les données annuelles des concours de l'ENA. La diversification du recrutement doit donc être poursuivie. Justement, comme vous l'avez dit, une réforme de la haute fonction publique est en cours. L'idée du rapport présenté par M. Thiriez est de refondre les épreuves des différents concours pour les rendre moins académiques, moins discriminants sociologiquement et plus opérationnels.
Une vingtaine de nouvelles classes préparatoires « égalité des chances » seraient également créées sur le territoire, à raison d'une classe au moins par région, et les actuels deuxième et troisième concours, ainsi que le tour extérieur, seraient remplacés par une nouvelle voie d'accès professionnelle, unique, lisible et plus accessible à un plus grand nombre de professionnels. Que pensez-vous de ces préconisations du rapport de M. Thiriez au regard de la diversité sociologique du recrutement des futurs magistrats administratifs ?
Ma deuxième question porte également sur cette mission Thiriez, qui a examiné la faisabilité d'une hypothèse consistant à « fonctionnaliser » les grands corps. Cette transformation en emplois fonctionnels des postes permanents du Conseil d'État, de la Cour des comptes et des services d'inspection impliquerait donc de supprimer les corps concernés, de nommer des cadres supérieurs de l'administration pour exercer, pour une durée limitée, des fonctions de contrôle ou juridictionnelles. Si une telle réforme peut se concevoir pour des corps d'inspection, elle se heurte en revanche à des obstacles constitutionnels et conventionnels s'agissant des corps juridictionnels que sont le Conseil d'État et la Cour des comptes, car le processus de désignation serait contraire aux principes d'indépendance et d'inamovibilité. Pourriez-vous ainsi nous donner votre avis sur ce point ?
Voilà une question intéressante et d'actualité. Je le dis et je le répète, la juridiction administrative, pour être tout simplement légitime, doit ressembler à la France. Elle doit accueillir en son sein tous ceux qui, au nom de l'égalité des chances, ont le mérite pour la rejoindre, notamment dans l'accès en amont au concours, qui permet d'intégrer la juridiction administrative.
Cependant, n'ayons pas une approche trop naïve. Nous ne pouvons faire porter sur les seules écoles de formation à la haute fonction publique l'obligation de cette diversité, notamment sociologique. Toute la chaîne de l'enseignement doit l'assurer, de la maternelle jusqu'au lycée, aux classes préparatoires et à l'université. (M. le président Ugo Bernalicis acquiesce.) L'université aussi, pour son accès, comporte des biais sociologiques qu'il faut combattre. Nous ne pouvons faire porter une responsabilité peut-être trop vaste sur l'ENA. Le même reproche pourrait être fait à Polytechnique, à HEC ou à l'ESSEC, celui qui consiste à dire que les élèves ne ressemblent pas suffisamment à la France. Pourquoi ? Peut-être que notre système éducatif, dans son ensemble, ne garantit pas suffisamment cette égalité des chances, notamment pour les enfants ou les jeunes issus des quartiers défavorisés et des zones de revitalisation rurale, qui affrontent ces difficultés au sein du système éducatif. Beaucoup est fait, mais c'est un combat de tous les jours. Je vous le dis très clairement, je souscris pleinement à toutes les recommandations de la mission Thiriez pour démocratiser l'accès à la haute fonction publique : 20 classes préparatoires à l'intégration, très bien ! Quotas dans les classes préparatoires au concours de la fonction publique, très bien ! Le tutorat, qui consiste à parler du service de l'État dans les collèges et les lycées, très bien ! On ne parle que trop peu du service de l'État, de sa noblesse et de son ambition. Nous devons éveiller la curiosité des élèves au service de l'État, mais aussi à la fonction de juge judiciaire ou administratif.
Soyez certaine qu'en tant que vice-président du Conseil d'État et responsable de la juridiction administrative, et en tant que président du conseil d'administration de l'ENA, puisque j'exerce cette fonction de droit, je vais dans ce sens. Nos efforts doivent être concrets, pour aller plus loin.
Concernant la sortie de l'ENA, le classement et un potentiel mécanisme à l'amiable d'affectation, je n'ai pas d'idée préconçue. Le Gouvernement doit faire ce choix. Le classement a au moins un mérite, il est objectif. Nous devons veiller à ne pas retomber dans la pratique qui était celle en vigueur avant la création de l'ENA en 1945, où chaque institution cooptait ses futurs membres en fonction d'un certain profil. C'est alors que nous avions affaire à des dynasties d'inspecteurs des finances et de conseillers d'État. Nous choisissions ceux qui avaient les codes, ceux qui ressemblaient à ceux qui décidaient. Le concours est une conquête républicaine, démocratique, à condition que l'égalité des chances soit une vraie réalité, et à condition que les épreuves de classement soient les bonnes. De ce point de vue-là, je souscris aussi à l'ambition de transformer les épreuves académiques en épreuves qui soient plus proches du terrain. Ce que nous demandons aux hauts fonctionnaires, ce n'est pas seulement de savoir rédiger la note parfaite au ministre, voire de rédiger la circulaire qui va interpréter la loi récemment votée, c'est de conduire, collectivement, avec d'autres formations et d'autres origines, des projets et de changer la réalité du terrain. Cela ne s'apprend pas dans les livres, il ne s'agit pas de techniques de rédaction, mais de techniques de conduite de l'action publique et de projets collectifs. Le directeur actuel de l'ENA a cette même ambition, et il oriente plus la scolarité vers l'acquisition de compétences dans ce domaine. Voilà qui va dans le bon sens.
Vous évoquez aussi un autre débat, qui me semble avoir été clos par la mission Thiriez, l'idée selon laquelle nous pourrions « fonctionnaliser » les grands corps. Cette « fonctionnalisation », qui implique la suppression des corps et la substitution d'une collection d'emplois fonctionnels qui pourraient être pourvus par des décisions de l'État, se heurte, pour les juridictions, à un obstacle constitutionnel et conventionnel. Peut-on imaginer que la juridiction administrative, qui juge notamment les décisions de l'État, puisse dépendre, pour la carrière de ses membres, de décisions prises par l'État, dont nous jugeons les décisions ? Un magistrat administratif pourrait se poser la question de savoir si telle annulation d'une décision d'un ministre ou d'un préfet pourrait rejaillir défavorablement sur son prochain emploi. Ce serait la fin de l'indépendance. Une juridiction, par définition, ne peut être une collection d'emplois fonctionnels pourvus par l'État au gré de sa propre appréciation. Le Conseil constitutionnel l'a dit lui-même, tout comme la Cour européenne des droits de l'homme : l'indépendance juridictionnelle exige qu'une part importante des membres de la juridiction appartienne à une magistrature de carrière, à laquelle ils dédient l'essentiel ou la plus grande partie de leur vie professionnelle.
Pour les corps d'inspection, certes l'indépendance n'est pas une exigence constitutionnelle, mais il peut être utile pour les ministres d'avoir autour d'eux des personnes capables de leur donner un langage de vérité, de leur dire non, et d'inspecter sans complaisance ni concession des services placés sous l'autorité du ministre. Cela semble être favorable à la gestion de l'action publique. Même si la source de ces exigences n'est pas la même, il y a matière à réflexion : ne faut-il pas, autour des ministres, des personnes fonctionnellement indépendantes, pour les aider dans leurs diagnostics, dans la gestion de crise et pour apprécier en toute indépendance les services placés sous l'autorité ministérielle ? Je vous parlais de trois valeurs : jeunesse, indépendance et ouverture. Au titre de la seconde valeur, qui est essentielle à la juridiction administrative, nous refusons toute « fonctionnalisation » de la juridiction administrative.
Je souhaiterais me faire le porte-parole d'un certain nombre de collègues, sur la question de la diversité sociale au Conseil d'État. Certes des pistes de progrès sont nécessaires. L'une des particularités du Conseil d'État est sa diversité sociale et sociologique. Au Conseil d'État, certains viennent des quartiers défavorisés, d'autres ont des parcours très atypiques. Il se pourrait même que le président de la section du contentieux corresponde à cette situation. De grâce, n'ayons pas une vision un peu déformée de cette institution ! Les parcours familiaux, sociaux et professionnels sont très différents. Pour juger et rendre des avis, nous avons besoin de cette diversité. Ne croyons pas que le Conseil d'État, parce qu'il est une des grandes institutions de la République, est socialement homogène. Je parle au nom de beaucoup de membres du Conseil d'État.
Cela est d'autant plus important que la justice administrative est la justice du quotidien des Français. Les litiges portés devant le Conseil d'État concernent le refus d'une allocation sociale comme le RSA, l'inscription à Pôle emploi, le refus ou l'attribution d'un permis de construire à un voisin, la contestation d'un impôt, le droit au logement opposable, le statut des étrangers, le droit au séjour, etc. Nous sommes les juges du quotidien des Français. Le juge doit non seulement accepter cette réalité, mais aussi montrer qu'il comprend les enjeux concrets des litiges qu'il tranche. Voilà un point très important de sa légitimité.

Ma question suivante porte sur la discipline. Avez-vous l'équivalent d'un Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ? Êtes-vous bien les responsables, en appel, des décisions du CSM ? Comment gérez-vous cette interaction, êtes-vous beaucoup saisis ? Comment en va-t-il dans l'autre sens ? Le CSM juge-t-il en appel vos décisions ?
Au sujet de la discipline des membres de la juridiction administrative, deux instances disciplinaires existent. Pour le Conseil d'État, la commission supérieure est composée du bureau du Conseil d'État, de membres élus aux différents grades et de trois personnalités qualifiées, dont l'une est désignée par le président de l'Assemblée nationale, et qui apportent donc un regarde extérieur. Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le CSTACAA joue ce même rôle. Il est aussi tripartite. Je le préside, avec le secrétaire général, et il inclut un président de la mission d'inspection, un représentant du ministère de la justice, etc. Sont présents des magistrats élus à tous les grades et trois personnalités qualifiées, dont l'une est également désignée par le président de l'Assemblée nationale. Aucune procédure disciplinaire, au-delà en tout cas des deux premiers niveaux que sont l'avertissement et le blâme, ne peut aboutir à une sanction sans consultation de ces instances, qui font alors une proposition qui lie l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. L'autorité disciplinaire est bien le vice-président du Conseil d'État.
Pour le CSM, le Conseil d'État n'intervient pas vraiment en appel, puisqu'il est possible de contester directement la légalité de la décision du CSM devant le Conseil d'État.
Relativement peu de cas de contestations sont portés devant nous. Le nombre de sanctions est faible. Nous sommes saisis d'une dizaine d'affaires environ par an concernant des décisions prises par le CSM. Une chambre plus spécialisée dans ces questions est saisie, l'instruction est très complète, puis la décision est prise. Dans certains cas, nous pouvons connaître des annulations pour vice de forme ou de procédure et, plus rarement, pour des questions d'appréciation.
Nous n'avons aucun secret sur le nombre d'affaires !

Quant à vos décisions, qui sont donc des sanctions administratives, sont-elles susceptibles d'appel ?
Je me permets de préciser la procédure, pour éviter les erreurs. La situation n'est pas absolument symétrique entre le Conseil d'État et les tribunaux et les cours. Pour le Conseil d'État, l'autorité disciplinaire est le vice-président et l'instance disciplinaire qui doit être consultée pour les sanctions au-delà d'un certain niveau est la commission supérieure. Pour les tribunaux et les cours administratives d'appel, le CSTACAA joue à la fois le rôle d'instance disciplinaire et d'autorité, c'est à dire qu'elle prend collectivement les décisions les plus importantes. Dans les deux cas, c'est devant le Conseil d'État que ces sanctions peuvent être contestées. Évidemment, ceux qui ont participé à l'avis et à la proposition et qui ont entendu l'intéressé ne peuvent pas siéger ; des juges extérieurs à l'instance disciplinaire prendront nécessairement la décision finale.
Statutairement, le président de la section du contentieux est en dehors de toutes ces instances disciplinaires.
Le vice-président aussi. Il ne siège pas dans la commission disciplinaire, pour lui laisser un recul suffisant.

Vous avez parlé du « vrai » tour extérieur, qu'en est-il du « faux » ? Par ailleurs, un tiers des membres du Conseil d'État exerce à l'extérieur de l'institution. Ce chiffre est-il normal ? Connaît-il une évolution ? Voilà qui me semble être une particularité au sein de nos institutions françaises. Certains membres du Conseil d'État sont même au Parlement.
(Les regards amusés se tournent vers M. Guillaume Larrivé.)
Je vous réponds au sujet du « faux » tour extérieur. À côté du tour gouvernemental, c'est-à-dire de la prérogative qu'a le Gouvernement de nommer des personnes extérieures aux grades de maître des requêtes et de conseiller d'État, existent d'autres voies d'entrée au Conseil d'État, à différents âges de la vie professionnelle, voies qui ne sont pas organisées de la même manière. Par exemple, chaque année, nous intégrons deux conseillers de tribunaux administratifs au grade de maître des requêtes, et en général un autre membre de ce corps au grade de conseiller d'État, soit trois membres en tout. Le Conseil d'État décide alors. Il en va de même pour des maîtres des requêtes en service extraordinaire, qui sont par exemple administrateurs civils, magistrats judiciaires ou professeurs d'université, qui servent pendant quatre ans au Conseil d'État, aussi bien dans les formations contentieuses qu'administratives. À l'issue de ces quatre ans, nous pouvons intégrer les meilleurs d'entre eux. La sélection est réalisée par un jury interne au Conseil d'État, qui décide. Voilà ce que nous appelons le « faux » tour extérieur : il est extérieur, car nous nous enrichissons de talents qui ne sont pas présents au Conseil d'État, mais la décision appartient non pas au Gouvernement, mais au Conseil d'État lui-même.

Ma seconde question portait sur le nombre de membres du Conseil d'État, soit un tiers d'entre eux, exerçant à l'extérieur de l'institution.
Ce nombre est à peu près stable. Toutefois, les 230 membres en activité au Conseil constituent un nombre assez élevé ; il fut parfois inférieur. Le président de la section du contentieux n'a jamais assez de membres pour juger. En interne, nous pouvons parfois connaître des périodes en tension, l'activité n'est pas toujours la même, mais nous avons les moyens suffisants pour traiter l'ensemble des missions assurées par le Conseil d'État. Ces 110 ou 115 personnes ne sont pas toutes dans la même position. La plupart d'entre elles sont en détachement, dans l'administration active : préfet, directeur d'administration centrale, etc. Ils restent dans le service public et quittent temporairement le Conseil d'État pour exercer des responsabilités dans l'administration active. J'ai moi-même exercé tous les métiers à l'intérieur du Conseil d'État, mais je suis parti deux fois douze ans à l'extérieur, comme directeur général des télécoms – j'ai beaucoup travaillé dans ce secteur – et comme président de l'Autorité de la concurrence. J'ai fait des allers et retours et je suis revenu après avoir quitté le Conseil d'État. Je pense que ces expériences m'ont aidé à exercer les métiers internes au Conseil. Le président Combrexelle a été directeur général du travail pendant de longues années. Il est l'un des meilleurs spécialistes des relations du travail. M. Girardot a aussi exercé des responsabilités à l'extérieur : conseiller juridique à la représentation française à Bruxelles, directeur juridique au ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur et numéro deux du secrétariat général du Gouvernement. Nous avons tous, aussi, été rapporteurs publics dans des contentieux très engagés. En interne comme en externe, nous avons essayé de nous confronter à des défis, de nous challenger, de nous mettre en situation d'apprendre dans les différents métiers que nous avons exercés. Cela est bon pour le Conseil d'État, pour sa respiration, pour sa capacité à comprendre la société et les enjeux concrets des décisions et avis que nous prenons.
Il faut ensuite faire revenir ces personnels. Il ne peut s'agir que de mobilités. Nous devons être en mesure de proposer, à certains moments, des postes attractifs, pour qu'existe une alternance entre les fonctions exercées à l'intérieur et à l'extérieur.
Une petite partie de ces 110 à 115 membres du Conseil d'État, moins d'une vingtaine, sont en disponibilité, pour exercer d'autres fonctions : dans le privé – cette position statutaire est permise par le statut général de la fonction publique –, au sein d'entreprises, pour leur propre compte ou comme avocats, ou en tant qu'élus. Cette règle est désormais appliquée aux parlementaires. Ces membres en disponibilité ne participent pas du tout à la vie du corps ; ils lui sont extérieurs. Nous nous côtoyons évidemment dans certains événements, mais ils n'influent en rien sur les avis et les décisions du Conseil d'État. Certains reviennent, et nous en sommes heureux, et d'autres, au bout de dix ans, durée maximale autorisée pour les disponibilités, ne reviennent pas et démissionnent. Je serai très ferme quant au point suivant ; autant le Conseil d'État encourage parfois les mobilités et les détachements, qui sont utiles au corps, autant nous ne promouvons pas les disponibilités, qui ne relèvent que d'un choix personnel, dont nous ne faisons que prendre acte.
Non, dans la mesure où cela est un droit reconnu par le statut général de la fonction publique, auquel nous ne pouvons pas nous opposer. Cependant, nous ne l'encourageons pas et nous ne promouvons pas les activités en disponibilité. Nous prenons acte de choix personnels qui peuvent être faits par nos collègues au cours de leur vie professionnelle.

Je vous remercie pour l'ensemble de vos réponses. J'en viens à une question plus particulière. Je cherche à savoir depuis deux ans et demi pourquoi les programmes budgétaires portent les nombres qu'ils portent. Le programme 165 « Justice administrative » semble avoir un lien avec le programme 166 « Justice judiciaire », mais personne n'a pu m'apporter de réponse sur les règles qui ont prévalu à leur numérotation.
Je poserai la question. Parmi les membres du tour extérieur – nous nous en félicitions –, nous avons un ancien directeur du budget, qui d'ailleurs réussit très bien. Je lui poserai la question dès ce soir et vous transmettrai la réponse.

Concernant vos missions d'étude, de diagnostic et de prospective, nous devrons sans doute avoir un débat prochain sur le chevauchement entre le droit administratif et le droit judiciaire, que ce soit en matière civile ou pénale. En effet, de plus en plus de dispositions se chevauchent, notamment dans le droit du travail, où les juridictions administratives sont de plus en plus saisies sur des dispositions liées à cette matière, en plus de dispositions des prud'hommes et de dispositions en matière civile. Il serait louable de mieux coordonner l'ensemble, pour rendre des jugements plus logiques et conformes les uns aux autres.
Concernant le droit du travail, les administrations ont réalisé de gros efforts pour créer des blocs de compétences. Il existe un bloc de compétences « juge administratif » pour les plans de sauvegarde de l'emploi, un autre bloc « juge judiciaire » en matière de rupture conventionnelle, etc. Comme le disait le vice-président, il existe un problème de proximité vis-à-vis des salariés. Nous devons éviter qu'ils ne soient perdus. Nous essayons de faire en sorte que les règles et la répartition des compétences soient les plus claires possible.

J'aurai pu étendre ma question à l'antiterrorisme. De nombreux domaines existent où des superpositions entre les domaines judiciaire et administratif pourraient être revues. Messieurs, je vous remercie de vos réponses précises, claires et étayées.
La séance est levée à 18 heures 30.
Membres présents ou excusés
Présents. - M. Ugo Bernalicis, Mme Émilie Guerel, M. Guillaume Larrivé, M. Didier Paris
Excusé. - M. Ian Boucard