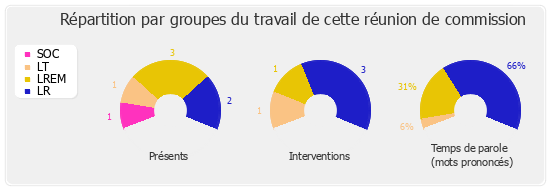Mission d'information sur l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l'épidémie de coronavirus-covid 19 en france
Réunion du mercredi 23 septembre 2020 à 16h00
Résumé de la réunion
La réunion
Mission d'information de la conférence des Présidents sur l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l'épidémie de Coronavirus-Covid 19
Présidence de M. Julien Borowczyk, président de la mission d'information

Mes chers collègues, nous auditionnons le professeur Jean-Yves Blay, président du réseau UNICANCER, fédération hospitalière nationale dédiée à la cancérologie, et Mme Sophie Beaupère, déléguée générale.
La nécessité de libérer les lits d'hospitalisation et de réanimation pour l'accueil des malades du covid-19 au pic de l'épidémie et la mise en place du plan blanc ont conduit à déprogrammer des interventions non urgentes. Par ailleurs, les patients ont pu refuser de se rendre dans les établissements de soins, voire dans les cabinets médicaux, par crainte d'être contaminés. On constate donc une mauvaise prise en charge des pathologies, ou du moins des retards dans les soins, avec des conséquences potentiellement graves pour les personnes atteintes de cancer, dont plusieurs études ont montré qu'elles présentaient plus de risques de développer une forme sévère de covid-19.
L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».
(M. Jean-Yves Blay et Mme Sophie Beaupère prêtent serment.)
Durant cette période, nous avons tenu des réunions très régulières afin de coordonner efficacement les actions au sein de notre fédération.
Un premier chapitre a été ouvert autour de l'anticipation, alors qu'il apparaissait assez objectivement que les patients atteints de cancer étaient susceptibles de présenter des complications graves dans certaines circonstances. La nécessité de travailler très précocement sur la mise à disposition du personnel et des patients d'équipements de protection individuels (EPI) s'est très tôt fait sentir. La fédération et les établissements se sont mis en ordre de marche pour acquérir ces équipements, qui étaient parfois difficiles à obtenir par les circuits habituels.
La fédération a également élaboré des recommandations pratiques facilitant l'accueil et la poursuite de la prise en charge des patients, en lien étroit avec de nombreuses ARS, sachant que les traitements en oncologie ne peuvent, dans leur grande majorité, être différés.
Ce travail d'anticipation a été accompagné de manière assez collégiale par les établissements publics et privés avec lesquels nous travaillons en réseau au niveau régional. Très rapidement, il a été admis qu'il était possible de sanctuariser la prise en charge des patients recevant des traitements systémiques dans les centres de lutte contre le cancer (CLCC).
Nous avons souhaité que la gouvernance de la crise soit à la fois resserrée et collaborative, tant avec les ARS et les structures de proximité qu'au sein de la fédération UNICANCER. Nous nous sommes fixé plusieurs objectifs.
Le premier a été de rassurer les patients, très inquiets. Tant au niveau des établissements qu'à l'échelle d'UNICANCER, nous avons cherché à rassurer les patients suivis et connus en utilisant tous les moyens – hotlines, mails, courrier papier, puisque 50 % de la population reçues dans nos établissements ne dispose pas d'adresse électronique – pour les joindre et les inviter à venir en consultation, dans des conditions de protection maximale. À l'évidence, la protection des soignants, des médecins et des patients était congruente et nécessaire pour diminuer au maximum le risque de contamination des patients. Les résultats ont été probants pour la plupart des centres.
Comme vous le savez, les taux d'incidence et de prévalence des infections graves se sont révélés très hétérogènes, et certains CLCC, dans le Grand Est et en Île-de-France, ont été davantage impactés. Fin mars, début avril, leurs services de réanimation ont dû accueillir des patients non atteints de cancer, faute de places ailleurs, ce qui a décalé un certain nombre d'interventions chirurgicales nécessitant de placer les patients en réanimation. Un travail a alors été réalisé entre les établissements locaux et au sein de la fédération UNICANCER pour partager les moyens, les ressources humaines – notamment les anesthésistes – et, lorsque cela se révélait nécessaire, adresser des patients à d'autres sites moins touchés par la pandémie.
Alors que les connaissances sur la pandémie évoluent chaque semaine, nous avons souhaité participer de manière proactive à la production du savoir, dans deux directions.
Nous nous sommes d'abord attachés à collecter des informations épidémiologiques fiables sur les patients atteints de cancer, ce qui a abouti à la constitution d'une base de données, en cours de publication. Deux informations importantes en ressortent. L'une est déjà connue, c'est l'importante mortalité des patients atteints de cancer en cours de traitement actif et infectés de manière documentée par le covid-19. L'autre sera probablement débattue dans la littérature scientifique : nous avons constaté une mortalité également accrue de patients atteints de cancer et présentant des symptômes de covid-19, sans que l'infection ait été confirmée par des tests – dont la sensibilité a par ailleurs été pointée du doigt.
Nous nous sommes ensuite employés à mener des études cliniques thérapeutiques. L'excellente interaction entre l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et les pouvoirs publics nous a permis de les mettre en œuvre dans des délais incomparables : entre six et quinze jours ont suffi pour lancer les trois études promues par UNICANCER, alors qu'il faut généralement une année pour activer une étude clinique en cancérologie. Pour autant, ces études n'ont pu être terminées, faute de patients. C'est un fait général : la décrue qui a suivi, fort heureusement, le pic épidémiologique a interrompu ces études – elles sont actuellement réactivées.
Ce fut donc une période complexe, qui a compris plusieurs éléments clés : l'organisation et la prévision ; le travail collaboratif au sein des établissements et entre les établissements sur les territoires régionaux ; le lien important avec les ARS ; notre capacité à nous mobiliser collectivement au sein des établissements, dans la mesure où la quasi-totalité des traitements ne peuvent être différés.

Vous vous êtes exprimé à de nombreuses reprises sur le retard de prise en charge thérapeutique. Qu'en est-il de la prise en charge diagnostique ? Vous estimiez qu'au sortir du confinement, nous assisterions probablement à un rebond d'activité de l'ordre de 20 % en cancérologie. Cela a-t-il été le cas ?
Au-delà, quelles sont vos préconisations ou vos réalisations pour améliorer la prise en charge diagnostique ? Certaines méthodes de téléconsultation ont été mises en place pour privilégier une prise en charge la plus précoce possible, dont on sait qu'elle est primordiale en cancérologie.
Il faut distinguer deux situations assez différentes. Les CLCC se consacrent exclusivement à la prise en charge des patients atteints de cancer, et leur position est différente de celle des CHU ou des hôpitaux privés. Les patients savent pourquoi ils sont hospitalisés et connaissent l'importance du calendrier : seule une petite minorité d'entre eux a repoussé la date du rendez-vous alors que le diagnostic était posé. Nous avons su les faire revenir par des stratégies de communication directe et, comme vous le souligniez, en organisant des téléconsultations. Un chiffre parle de lui-même : dans les huit semaines précédant le confinement, l'établissement dans lequel j'exerce avait effectué 24 téléconsultations ; dans les huit semaines qui ont suivi, nous en enregistrions plus de 5 000.
En revanche, nous n'avons pas su prendre en charge les patients que nous ne connaissions pas encore, ceux qui étaient chez eux, sentaient une boule mais attendaient la fin du confinement ou un rendez-vous, dans les conditions de sécurité qu'ils estimaient optimales, chez leur médecin traitant.
Nous avons tenté de mesurer ce phénomène, ce qui n'est pas si aisé, en opérant des comparaisons avec les années précédentes, sur la même période. Après l'avoir fait sur quasiment la moitié des CLCC, nous observons une situation assez disparate selon les centres. La diminution du nombre de nouveaux diagnostics varie de 9 % à 50 %, sans qu'il y ait de lien avec l'incidence du covid-19 sur le territoire. Nous avons aussi relevé une grande disparité selon les pathologies au sein même d'un établissement, sans pouvoir nous prononcer sur le caractère systémique de ce phénomène. Nous avons calculé que le nombre de nouveaux diagnostics posés durant cette période était en moyenne inférieur de 20 % à 25 %.
Il faut donc rattraper ce retard. Les centres s'y sont employés durant tout l'été, alors que l'activité diminue généralement en juillet et en août. Cela contribue d'ailleurs à la fatigue du personnel, alors même que la seconde vague commence à poindre.
Je ne dispose pas d'éléments chiffrés permettant de dire si nous avons rattrapé le retard. Ce travail ne peut se limiter à une seule fédération, même si elle prend en charge plusieurs centaines de milliers de patients chaque année. Il conviendrait de travailler à l'échelle nationale et, surtout, le faire de manière intégrée.
La mesure de l'impact sur la survie sera sans doute très difficile à mettre en évidence avant plusieurs mois, voire plusieurs années. Pour une jeune patiente, pour laquelle le diagnostic d'une maladie de Hodgkin a été posé avec trois mois de retard, et qui est passée du stade 2 au stade 4, le pronostic vital sera moins bon, mais dans cinq ou dix ans. C'est sur le long terme que nous pourrons mesurer ces effets.

Vous indiquiez dans un entretien paru le 3 juin que l'on pouvait redouter 5 000 à 10 000 décès en raison des retards de prise en charge diagnostique et thérapeutique du cancer. Confirmez-vous ce chiffre ? Dans les colonnes de Nice Matin vendredi dernier, le professeur David Khayat a avancé le chiffre terrifiant de 30 000 morts supplémentaires dans les mois et les années à venir. Cela vous paraît-il crédible ? Comment l'interruption des soins et le ralentissement des procédures de dépistage auraient-ils pu être évités ?
À Nice, le centre Antoine Lacassagne fonctionnait au ralenti alors que la ville n'était pas particulièrement touchée par la pandémie. Le remède n'était-il pas pire que le mal ? Comment éviter de se trouver à nouveau confrontés à cette problématique dans le cadre de la seconde vague ?
L'estimation de 5 à 10 000 décès supplémentaires a été calculée sur la foi de deux articles britanniques reposant sur des observations réalisées dans un système de santé assez différent du nôtre. Leurs auteurs s'appuyaient sur les données de non-fréquentation au moment du diagnostic initial mais aussi de non-consultation de la part de patients connus, pour déboucher sur une estimation plus élevée, de 16 000 à 20 000 décès supplémentaires.
Les chiffres que nous avons proposés se fondaient aussi sur les données recueillies par la fédération. Nous les estimons assez représentatives de ce qui se passe sur le territoire, même si la marge d'erreur est sans doute non négligeable.
Il ne s'agit que d'estimations. Les chiffres évoqués par le professeur Khayat dans Nice-Matin font partie de l'intervalle de confiance présenté par nos collègues britanniques, dans les hypothèses plus négatives en termes de prévalence et d'incidence de ces pathologies au sein de la population et, évidemment, d'utilisation du système de santé. Ces données présentent une certaine fragilité.
Comment aurait-on pu faire ?
Tout d'abord, toutes les manières de diagnostiquer les tumeurs ne requièrent pas le même niveau de technicité et ne seront pas pénalisées de la même manière par la crise sanitaire. Pour détecter le cancer du sein, un équipement radiologique et éventuellement une biopsie, pratiquée en ambulatoire, sont nécessaires. Pour détecter le cancer du côlon, l'une des maladies néoplasiques cancéreuses les plus fréquentes en France, il faudra procéder à une coloscopie. Or le nombre de coloscopies de diagnostic et de dépistage a considérablement chuté pendant cette période, sous le coup de la réorganisation des soins, de la priorisation des patients infectés par le coronavirus, et de l'indisponibilité des anesthésiques nécessaires à ce type d'intervention.
Je souligne à nouveau la stratégie qui a été développée au sein d'UNICANCER et dans les établissements. Seules les interventions non-urgentes, ne concernant pas le cancer, comme une reconstruction mammaire, ont été décalées et différées. Les interventions sur la tumeur primitive ont été maintenues.
Quand on regarde la littérature mondiale sur la mesure de l'impact du retard sur la survie, on est frappé par l'hétérogénéité des études et par la difficulté à obtenir des chiffres fiables. Les chiffres varient selon les maladies, les tumeurs, les procédures. Sans verser dans la caricature, on peut dire que pour certaines maladies, trois mois de retard équivalent à une réduction des chances de guérison de 5 % à 10 % sur le long terme ; pour d'autres, l'impact sera probablement nul ; pour d'autres encore, il sera bien plus lourd. Ce ne sont que des moyennes. La méthodologie est compliquée et la seule manière fiable de mesurer l'évolution d'une maladie serait d'attendre trois mois sans agir, une fois le diagnostic posé – ce qui est bien évidemment inimaginable.
Que faire dans la situation actuelle ? Il faut avant tout rassurer les patients sur le fait que consulter dans un établissement hospitalier ne constitue pas un facteur de risque. Nous avons pu le prouver et nous avons communiqué à ce sujet. Certains établissements ont mis en place des stratégies de dépistage, de diagnostic, d'analyse sérologique qui montrent que les patients qui consultaient n'encouraient pas plus de risques, voire moins, que la population générale. En revanche, il est certain que ne pas se rendre à une consultation de diagnostic est risqué. C'est donc auprès de cette population de sujets qui ne se savent pas encore patients et qui restent chez eux qu'il faut insister et communiquer pour minimiser les risques.
Enfin, alors que nous n'avons pas encore absorbé le retard, il ne faut certainement pas désarmer les services de soins de cancérologie. Ces traitements, qui ne peuvent être différés, doivent être absolument sanctuarisés.

Vous avez dit que la pénurie de médicaments anesthésiques avait retardé des interventions. Le directeur général du centre Antoine Lacassagne a signé une tribune dans Le Monde dénonçant la pénurie et soulignant qu'en Italie, en Suisse ou en Allemagne, ses confrères ne rencontraient pas les mêmes problèmes d'approvisionnement. Comment est-on arrivé à une telle situation ?
Comment avez-vous vécu, durant la seconde période, la réquisition par l'État de ces produits, afin d'en réguler la distribution sur le territoire ? Quel est le degré de dépendance de la France par rapport à l'étranger ? Faut-il constituer des stocks stratégiques plus importants dans les établissements ?
La réponse à cette question complexe varie selon les régions. Dans certains endroits, les stocks de curare ou de propofol ont été entièrement mobilisés pour les patients placés en réanimation, si bien que les ressources se sont révélées insuffisantes pour les actes chirurgicaux « non urgents ». L'impact sur les procédures de diagnostic est saillant, mais les coloscopies, par exemple, ne requièrent pas l'usage de ces médicaments.
Cela a-t-il engendré un retard dans la prise en charge chirurgicale de cancers qui auraient dû être opérés ? D'autres phénomènes ont pu jouer, comme le retard dans le diagnostic et l'occupation des lits de réanimation. Sachant qu'un patient opéré pour un cancer du pancréas a 10 % de risque de se retrouver en réanimation, les chirurgiens ont pu choisir de différer l'opération.
Les producteurs de ces médicaments nous ont expliqué que leurs usines fonctionnaient sur la base des trois huit et qu'ils n'étaient pas en mesure d'accroître leur production à un niveau tel que celui demandé – ce qui signifie qu'en période normale, l'importation compense les besoins.
Nos collègues italiens, et dans une moindre mesure les espagnols, avaient appelé notre attention sur ce risque et nous avaient invités à anticiper, car la pénurie s'est fait sentir en Lombardie et dans la région de Rome plus tôt en mars. Ce phénomène est tout de même lié au pic de l'épidémie : lorsqu'il est étalé, la production a pu suivre.
Pour les CLCC, les réquisitions de ces médicaments ont été moins pénalisantes que le manque d'EPI, auquel nous avons été confrontés pendant plusieurs semaines au mois de mars. Nous avons dû réaliser un énorme travail pour obtenir des équipements et pour cela le soutien des préfets a été essentiel.
S'agissant des réquisitions, nous avons été impliqués puisque nous disposons d'une centrale d'achats pour l'ensemble des centres et qu'à la demande du ministère, son responsable a été détaché pour récupérer le maximum de médicaments, grâce à nos multiples contacts avec les laboratoires.
Bien évidemment, quelques problèmes de référence se sont posés, les médicaments n'étant pas toujours adaptés aux habitudes des praticiens. La situation était hétérogène selon les régions et certains centres se sont trouvés davantage confrontés à la pénurie de curares. Dans la plupart des régions, nous avons pu disposer de médicaments permettant d'assurer la continuité de la prise en charge, mais nous avons également connu quelques situations spécifiques.
Cela pose plus généralement la question de la relocalisation de la production de certains médicaments. Le contexte était tel que nous n'arrivions pas à bénéficier des médicaments produits en Inde notamment, car nous ne passions pas en priorité. Se pose également la question de la pénurie de médicaments anticancéreux pour les patients de cancérologie en ville – la Ligue contre le cancer a fait une communication sur ce sujet. L'accès aux médicaments, en tant que priorité de santé publique, est un problème plus large.
Un exemple illustre le type de problèmes auxquels nous avons été confrontés. Lorsque, le 31 mars, les services de réanimation des CLCC ont été ouverts pour accueillir les patients Covid-19, le directeur de l'hôpital Roussy m'a appelé pour me dire qu'il avait besoin de curares, sans quoi les patients reçus dans le service de réanimation ne pourraient être pris en charge. Nous avons immédiatement donné une semaine de consommation de curares du centre Léon Bérard, un centre de taille assez importante. Sa réponse a été : « Merci, mais cela représente une journée pour un malade en réanimation. » Nous étions sur des chiffres vraiment logarithmiques.
Je tiens à appuyer les propos de Sophie Beaupère : les carences en médicaments ne sont pas apparues avec cette crise, les pays occidentaux y sont régulièrement confrontés et les Américains en font souvent état. Certains médicaments, qui ne sont pas très onéreux et sont produits dans un nombre restreint de pays, se trouvent fréquemment en rupture. Ce peut être des antibiotiques, mais aussi des anticancéreux.

Nous avons bien compris les conséquences de cette pandémie sur la cancérologie. Il a fallu déprogrammer des interventions, libérer des lits et la crainte des patients d'être contaminés a entraîné une baisse importante de l'activité des cabinets médicaux, j'en ai souvent parlé avec mes confrères.
Cela explique les chiffres dont vous nous avez fait part concernant les retards de diagnostic. Vous avez évoqué une baisse des diagnostics de l'ordre de 20 à 25 %. Pourriez-vous nous livrer une cartographie plus fine de ces chiffres ?
L'importance de la télémédecine a été mise en avant, mais cette dernière ne présente pas la même efficacité partout. Je pense notamment aux territoires ruraux. L'incidence a-t-elle été plus marquée sur certains territoires ?

Tous les territoires ont été confrontés à la pénurie de médicaments. Alors que nous abordons la seconde vague, avez-vous le sentiment que les stocks ont été reconstitués, et pour combien de temps ?
Fort heureusement, la période de mars-avril est derrière nous et les leçons ont été tirées. Les stocks disponibles dans les établissements de la fédération UNICANCER permettront largement de faire face, y compris en cas de deuxième vague. L'état des stocks en EPI, masques, solutions hydroalcooliques ainsi qu'en médicaments ne nous inquiète pas. Le pharmacien de mon établissement, avec qui j'ai fait le point il y a quelques heures, m'a assuré que nous avions, s'agissant du stock de masques, une avance par rapport à une situation d'utilisation normale. Face à une situation anormale, elle serait moindre, mais la marge existe.
En ce qui concerne la cartographie, nous avons colligé les informations sur neuf régions – donc neuf centres de cancer – seulement, et de manière parfois incomplète. La granularité ne nous permet pas d'étudier les zones impactées par territoires ruraux ou urbains. Il est surprenant de constater qu'il n'y a pas de lien entre l'incidence de la pathologie et la diminution du nombre de consultations pour nouveau diagnostic. L'échantillon n'est peut-être pas de taille suffisante, mais il est malgré tout assez conséquent pour en conclure qu'il n'existe pas de lien évident. Ainsi, lors de la première période, des personnes ont retardé leur consultation à Bordeaux, alors que l'incidence du covid-19 sur cette zone était relativement faible.
Il faut souligner que les téléconsultations ne sont pas une solution puisque, par définition, nous ne connaissions pas les personnes concernées. Il est arrivé, mais cela reste anecdotique, que des patients appellent car ils avaient une boule, mais demandent une téléconsultation car ils craignaient d'être contaminés en venant consulter.
Un autre point méritera d'être mesuré, celui de l'adressage à un centre expert. Comme vous le savez, ces centres experts jouent un rôle majeur dans l'accueil de pathologies compliquées. Cette mesure sera très importante car elle permettra de savoir si les patients ont consulté dans le centre idoine ou s'ils se sont dirigés vers un centre plus proche de chez eux. Cela nécessite un travail très difficile et il faudra du temps pour répondre à ces questions. Pour l'instant, l'approche est globale, non par pathologie.
Je dois avouer que je n'aurais pas parié là-dessus, mais objectivement, les pathologies à risques ou très menaçantes, comme le cancer du pancréas, ont juste connu une légère baisse de prise en charge. Globalement, c'était assez équilibré, mais imprévisible selon les régions. Dans telle région, nous avons observé une diminution de la prévalence des cancers du sein alors que les cancers du pancréas restaient stables, dans d'autres, c'était l'inverse. Cela dépend de l'impact sur les filières de recrutement, la disponibilité ou l'organisation des soins sur le territoire. C'est une simple observation, nous ne pouvons pas expliquer la mécanique du phénomène.

En tant que professionnelle de santé, je me suis intéressée au parcours des patients atteints de cancer en Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'ai pu remarquer que les hôpitaux de jour avaient continué de fonctionner, y compris ceux de niveau 3, ce qui a évité de longs trajets aux patients. Quelques difficultés sont apparues au départ avec les transports par véhicule sanitaire car les règles sanitaires n'étaient pas toujours claires et les EPI parfois insuffisants. À Toulon et à Marseille, les interventions chirurgicales d'urgence programmées par les cancérologues n'ont pas été repoussées du fait d'un manque de curare, elles sont demeurées prioritaires.
S'agissant de l'accompagnement des enfants atteints de cancer, la fermeture des maisons d'accueil des familles dans les hôpitaux de référence a posé des problèmes importants dans la mesure où les hôtels étaient eux aussi fermés par décision administrative. Avez-vous pris position sur ce sujet ou laissez-vous les fédérations d'associations de parents d'enfant atteint de cancer se saisir de la question ?

Vous l'avez dit, la pénurie de médicaments est assez récurrente, y compris en dehors de la crise du coronavirus, mais je n'avais pas connaissance que ce fût à ce point. Il est important que cette assemblée puisse l'entendre.
S'agissant des chiffres et des évaluations que vous êtes en mesure de produire, pouvez-vous dire combien de personnes dont l'état requérait une prise en charge urgente, que ce soit à titre diagnostique ou thérapeutique, n'ont pas eu accès à un traitement ?
Vous avez évoqué une étude montrant qu'au-delà de trois mois de retard dans la prise en charge, il existait un impact sur la durée de vie. Avez-vous des exemples de personnes qui ont connu des retards de prise en charge thérapeutique ? Ces retards allaient-ils jusqu'à trois mois ou étaient-ils de l'ordre d'un mois, d'une semaine, de quinze jours ?
Enfin, quelle est la part de patients qui ont retardé leurs rendez-vous ? On sait que des personnes qui présentaient une douleur thoracique ne se sont pas rendues à l'hôpital ; la situation était-elle la même en cancérologie ? Des personnes ont-elles refusé de venir, alors que vous les sollicitiez, pour suivre leur traitement ? Avez-vous une idée de la part que ce phénomène a pu représenter pendant la période la plus aiguë de la crise ?
Les chiffres sont fragiles, nous l'avons dit. Les retards de prise en charge de patients connus et non traités en temps et en heure sont marginaux. Ils sont de l'ordre d'une semaine, de quinze jours, voire d'un mois, mais dans l'intervalle, nous avons eu recours à une solution alternative thérapeutique. Ainsi, face à une tumeur pulmonaire qui aurait dû être opérée, nous avons pu opter pour un traitement de chimiothérapie permettant d'attendre. À long terme, les résultats seront les mêmes et il n'y aura pas eu de perte de chance. Pour les patients connus, l'impact est donc très modeste.
Les cas où des patients ont refusé de venir par crainte d'être contaminés sont exceptionnels. Personnellement, je ne me souviens que d'un seul, pour lequel nous avons trouvé une autre solution. Nous nous sommes attachés à communiquer avec nos patients et à les rassurer. Et de fait, les hôpitaux de jour étaient quasiment pleins : dans mon établissement, nous sommes passés de 170 à 140 prises en charge thérapeutiques quotidiennes. Parallèlement, les prises en charge en hospitalisation à domicile ont augmenté dans les mêmes proportions.
L'impact a été plus important pour les personnes qui auraient dû consulter pour une suspicion de tumeur, mais ne sont pas venues mais il sera très difficile de mesurer l'ampleur de ce phénomène.
À combien de décès liés au retard de prise en charge il fallait s'attendre : 5 000, 10 000 ou 30 000 ? Dans l'étude que nous avons conduite sur neuf centres, nous restions sur un chiffre minimaliste de 5 000 décès. Nous ne pourrons vérifier ces chiffres que dans quelques années. Pour l'instant, nous constatons des retards de plusieurs mois. Aujourd'hui, nous voyons arriver des patients qui éprouvaient des symptômes déjà au mois de mars et qui n'avaient pas encore consulté. Mais c'est aussi un phénomène fréquent en cancérologie : les personnes retardent la consultation par peur du diagnostic.

Vous dites que les retards dans la prise en charge de pathologies urgentes sont marginaux et que, globalement, il n'y a pas eu de perte de chance. Les chiffres de 5 000, 10 000 ou 30 000 décès supplémentaires seraient principalement liés au fait que, les personnes n'ayant pas consulté, le diagnostic n'a pas été posé. Si je comprends bien, vous avez pu convaincre les patients que vous connaissiez déjà de venir consulter, mais ceux que vous n'aviez pas encore rencontrés ne sont pas venus à l'hôpital, par crainte de la contamination.
Il serait présomptueux de dire que nous avons rattrapé tous les patients que nous connaissions déjà, mais cela a été le cas de la majeure partie d'entre eux ! Tous les centres ont constaté que la hotline avait été très occupée au cours des trois premières semaines. Après un pic, les patients savaient, avaient leurs recommandations et n'avaient plus besoin de l'interroger.
L'oncologie pédiatrique concerne des pathologies rares. L'accueil des parents a représenté un enjeu mais fort heureusement, dans de nombreux centres d'oncologie pédiatriques, les maisons d'accueil et de voisinage sont restées ouvertes.
Indiscutablement, cela a représenté une difficulté. Dans la plupart des centres pédiatriques, des exceptions de visite ont été accordées aux familles, mais il est certain que la crise a eu un impact sur la capacité de ces centres à recevoir les parents dans des conditions normales. Par ailleurs, il faut souligner un moindre diagnostic de ces pathologies au cours de cette période, ce qui est tout de même très surprenant.
Membres présents ou excusés
Mission d'information sur l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l'épidémie de Coronavirus-Covid 19
Réunion du mercredi 23 septembre 2020 à 16 heures
Présents. - M. Julien Borowczyk, M. Éric Ciotti, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Sereine Mauborgne, M. Bertrand Pancher, M. Boris Vallaud
Assistaient également à la réunion. - M. Nicolas Démoulin, M. Jean-Jacques Gaultier