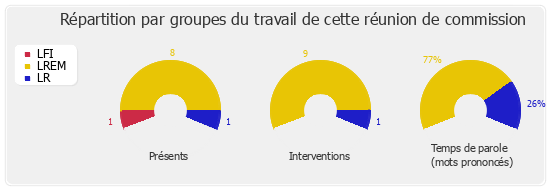Mission d'information sur le suivi des négociations liées au brexit et l'avenir des relations de l'union européenne et de la france avec le royaume-uni
Réunion du jeudi 15 mars 2018 à 14h30
Résumé de la réunion
La réunion
La réunion commence à 14 h 35.
Présidence de Mme Marie Lebec, membre de la mission d'information
La mission d'information organise une table ronde sur les conséquences du Brexit sur les activités financières et bancaires, avec la participation de M. Édouard Fernandez-Bollo, secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au sein de la Banque de France (ACPR), Mme Marie-Anne Barbat-Layani, directrice générale de la Fédération bancaire française, accompagnée de M. Olivier Mittelette, directeur du département Banque d'investissement et de marché, et de M. Nicolas Bodilis-Reguer directeur du département Relations Institutionnelles France, Mme Verena Ross, directrice exécutive de l'Autorité européenne des marchés financiers (European securities and markets authority, ESMA) et M. Arnaud de Bresson, délégué général de Paris Europlace.

Chers collègues, mesdames, messieurs, je vous prie tout d'abord d'excuser le président François de Rugy, qui ne peut être présent.
Les effets du Brexit sur le secteur financier et bancaire suscitent de nombreuses interrogations, mais nous avons déjà quelques certitudes. Ainsi, les services financiers ne devraient pas être intégrés à l'accord final. Comme l'a rappelé Michel Barnier, ils n'entrent dans le champ d'aucun accord de libre-échange de l'Union européenne jusqu'à présent. De même, les acteurs financiers de la City ne disposeront pas du passeport financier qui ouvre les portes du marché unique, car il faut, pour en bénéficier, respecter l'ensemble des quatre libertés – Mme Theresa May en a pris acte dans son dernier discours sur le Brexit.
Subsistent cependant un certain nombre de questions et nous espérons, mesdames, messieurs, que vous pourrez nous éclairer. Quel sera l'impact de la sortie du Royaume-Uni sur l'ensemble des marchés financiers européens ? Immédiatement après le référendum, le cours de la livre sterling a chuté, et il n'a toujours pas retrouvé son niveau antérieur face à l'euro. Qu'en est-il des effets à long terme ? Nous nous intéressons en particulier à la structuration du marché financier européen. Une fois que le Royaume-Uni sera sorti, le scénario d'un secteur à plusieurs têtes est-il envisageable ? Quant à l'attractivité de la France et de la place de Paris, quels sont les atouts, notamment culturels et sociaux, de la région parisienne ? Je songe aussi à la nouvelle chambre internationale de la cour d'appel de Paris, dont les audiences pourraient se tenir en deux langues.
Monsieur Édouard Fernandez-Bollo, vous êtes secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) au sein de la Banque de France. Madame Marie-Anne Barbat-Layani, vous êtes directrice générale de la Fédération bancaire française. Madame Verena Ross, vous êtes directrice exécutive de l'Autorité européenne des marchés financiers (en anglais, European Securities and Markets Authority, ESMA). Monsieur Arnaud de Bresson, vous êtes délégué général de Paris Europlace.
Nous sommes heureux de vous entendre présenter chacun les enjeux de la question avant de vous interroger.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, je suis très honoré de vous présenter l'état des réflexions et actions menées par l'ACPR en lien avec le reste de la Banque de France, avec tous nos partenaires européens et toutes les structures auxquelles nous participons – la Banque centrale européenne (BCE), l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP ; en anglais, European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA). Notre objectif spécifique est d'essayer de gérer les conséquences sur la stabilité financière de cette décision tout à fait unique en son genre du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne.
C'est un dossier aux multiples facettes, mais nous avons deux préoccupations. À court terme, nous voulons que la stabilité financière soit préservée de ce que l'on appelle souvent un effet de falaise, c'est-à-dire une coupure brusque aux effets imprévus qui provoquent des dysfonctionnements soudains du système financier. À moyen et long terme, nous voulons faire en sorte que cette évolution permette un renforcement de la résilience globale du marché unique et de sa capacité à financer les économies de l'Union.
Nous entreprenons des actions qui visent ces deux objectifs.
À court terme, dans nos domaines de compétences – banque, assurance, fintech –, nous essayons de pousser l'ensemble des intermédiaires financiers à se préparer aux conséquences de la perte du passeport, plus précisément la perte du droit à l'établissement et à la libre prestation de services (LPS). Cette perte nous affecte dans les deux sens. Au Royaume-Uni, l'activité de banques françaises, notamment BNP Paribas et la Société Générale, est très importante. Cependant, les effets sont assez asymétriques. Il y a beaucoup plus de libre prestation de services entrante, du Royaume-Uni vers la France, que de libre prestation de services sortante, de la France vers le Royaume-Uni. Nous avons ainsi reçu plus de 5 000 notifications de LPS entrante, alors que nous n'avons pas tout à fait 1 000 notifications de LPS sortante ; le rapport, dans notre secteur, est de un à cinq. Le choc de falaise sera donc asymétrique, plus important pour le Royaume-Uni que pour nous. Cependant, comme les intermédiaires concernés ont des clients en France, nous devons nous en occuper. Il faut éviter que des assurés français soient indirectement affectés par le choc subi par les intermédiaires britanniques. Nous avons aussi la responsabilité de préparer les Français au changement de leurs conditions d'activité au Royaume-Uni, mais je pense qu'ils sont mieux préparés que les Britanniques.
Aujourd'hui, je crains un peu que l'annonce d'une probable période de transition ne conduise à ralentir les préparatifs. Pour notre part, nous considérons qu'il est certains domaines dans lesquels il ne faut absolument pas ralentir le tempo. S'il y a une période de transition, tant mieux, mais nous devons nous préparer à la possibilité d'un effet de falaise dans un an. Si les clients français doivent être affectés par la perte du passeport, ce n'est pas à la dernière minute qu'il faut les prévenir : il faut leur donner le temps de prendre des dispositions. Quel que soit le résultat des négociations, qui échappe très largement à l'action de l'autorité de contrôle, nous incitons fortement les intermédiaires, en particulier les intermédiaires anglais ayant une présence en France, à bien préparer la transition au profit des clients français.
Quant à la stabilité financière à moyen et long terme, question plus structurelle, nous avons trois considérations essentielles.
Premièrement, nous sommes vraiment convaincus qu'il faut assurer la présence au sein de l'Union de ce qui est nécessaire pour bien gérer les risques potentiellement systémiques. C'est ainsi que nous abordons la question de la localisation des chambres de compensation. Nous tenons très fermement à ce que les conditions de gestion du risque systémique soient bonnes ; à cet égard, la Commission envisagerait une relocalisation des chambres de compensation dans le territoire de l'Union européenne. À un niveau plus « micro », nous refusons l'implantation dans l'Union de pures « coquilles vides », qui seraient destinées à recevoir un agrément pour des activités qui demeureraient, pour l'essentiel, effectuées au Royaume-Uni. Nous estimons pour notre part que des établissements agréés en Europe doivent disposer de tous les instruments et moyens de gestion de risques là où ils sont agréés.
Deuxièmement, il faut, bien sûr, assurer un bon niveau de coopération avec le Royaume-Uni, qui restera, quelle que soit la nature précise des arrangements qui seront conclus par l'Union européenne et le Royaume-Uni, un partenaire très important dans le secteur financier. Cela suppose en particulier que nous nous donnions les moyens d'un suivi attentif des questions, qui se poseront nécessairement, d'équivalence de la réglementation mais aussi de la supervision effective telle qu'elle sera pratiquée par le Royaume-Uni, une fois celui-ci sorti de l'Union européenne.
Troisièmement, il faut vraiment se saisir de l'occasion pour approfondir le marché unique dans le secteur financier. C'est une démarche plus générale, que nous relayons très fortement. Il faut renforcer l'intégration de l'Union européenne après la sortie du Royaume-Uni, non seulement parce qu'il sera peut-être plus facile de trouver des points communs entre ceux qui seront restés mais surtout parce qu'il faut renforcer et créer un écosystème dont l'unification sera l'un des atouts pour que la principale place financière de l'Union européenne ne soit pas en dehors de l'Union. L'approfondissement de l'unification dans le domaine financier est donc, pour nous, un enjeu absolument essentiel.
Vous avez évoqué, madame la présidente, la possibilité d'une structure polycentrique. Telle sera effectivement la réalité des relocalisations. Notre participation à la BCE nous donne une bonne vue de ce qui se passe dans l'ensemble des pays de la zone euro, où auront lieu l'essentiel des relocalisations. Comme il s'agit de s'adapter dans l'urgence, les relocalisations ont lieu là où les entreprises avaient des filiales. Ainsi, de nombreuses activités britanniques avaient des filiales en Irlande. C'est donc là qu'elles se relocalisent. D'autres vont à Francfort, à Amsterdam, en France… La relocalisation des sièges sera donc polycentrique, mais cela ne préjuge pas de l'évolution à moyen terme de l'activité économique, qui peut très bien se dérouler ailleurs que là où est établi le siège. C'est d'ailleurs le cas actuellement : BNP Paribas et la Société Générale ont une très forte activité à Londres, tout en ayant leur siège à Paris. De même, ce n'est pas parce qu'un siège est à Dublin que les activités de marché ne sont pas à Paris. L'effet de coalescence et les économies d'échelle seront très importants, mais la situation de départ sera polycentrique. Quelle direction suivrons-nous ? C'est une histoire qui reste à écrire, et la meilleure plume pour le faire est celle de l'unification du marché européen.
Je remercie tout d'abord le Parlement, très mobilisé sur la question du Brexit. Déjà auditionnés, notamment au mois de juillet 2016, nous constatons, mesdames et messieurs les députés, que vous en faites un suivi très attentif. Nous en sommes évidemment très heureux et sommes très honorés de vous présenter aujourd'hui notre vision.
La Fédération que je dirige représente l'ensemble des banques installées en France – aujourd'hui, 347 entreprises bancaires –, y compris les banques dont le siège est à l'étranger. C'est pour nous un atout très important pour travailler sur les enjeux d'attractivité auxquels vous vous intéressez. Nous comptons effectivement en notre sein un « groupe des banques sous contrôle étranger », qui a participé très activement à notre réflexion sur les moyens de renforcer l'attractivité de la place de Paris.
Le secteur bancaire français représente 2,7 % de la valeur ajoutée totale en France. Quatre des neuf plus grandes banques de la zone euro sont françaises ; ce sont également quatre des vingt plus grandes banques internationales. L'un des atouts de la place de Paris est que nous avons déjà en France le secteur bancaire le plus important du continent européen et l'un des plus importants en Europe. Cela explique sans doute au moins partiellement la décision de relocaliser à Paris l'Autorité bancaire européenne. Les banques françaises portent dans leur bilan près de 2 300 milliards d'euros de crédits, donc de financement de l'économie, et représentent aujourd'hui 370 000 emplois directs sur notre territoire – et, selon les propres estimations du Gouvernement, pour un emploi direct, il y a trois emplois induits. L'attractivité, les relocalisations et les développements d'activités sont donc des enjeux très importants en termes d'emploi – on parle beaucoup de relocalisations, mais il faut aussi parler de développements d'activités. Notre ministre de tutelle, le ministre de l'économie et des finances, l'a très clairement indiqué.
J'aborderai trois points : l'attractivité de la place de Paris ; la stabilité financière ; la question de l'égalité de concurrence dans le cadre des futures relations avec le Royaume-Uni. Ce sont là les trois grands enjeux du Brexit pour le secteur bancaire. Nous y travaillons en interne, avec nos adhérents. Nous y travaillons aussi avec d'autres fédérations professionnelles au niveau national et au niveau européen. Nous sommes effectivement membres de la Fédération bancaire européenne, qui a mis en place une task force dédiée au Brexit ; nous y siégeons, comme, d'ailleurs, nos collègues britanniques.
Commençons par l'attractivité, sujet auquel nous avons travaillé dès 2016, notamment avec les banques étrangères déjà localisées en France. Nous avons identifié un certain nombre de points pour lesquels il nous faut progresser : le coût du travail, le droit du travail, l'attractivité globale de Paris pour les expatriés. Je n'entrerai pas dans le détail de ce qui a été fait, que vous connaissez parfaitement, puisque la plupart des décisions ont été prises dans le cadre de lois de finances. La profession a salué la très large mobilisation des pouvoirs publics. Il était très important, notamment vis-à-vis de nos collègues étrangers, qu'à la fois le Gouvernement, le Parlement, la région Île-de-France, la ville de Paris et la métropole du Grand Paris se mobilisent et viennent expliquer à l'occasion de différents colloques et événements tout ce que Paris fait pour attirer les activités en France.
L'image est un élément clé. Sachez, pour l'anecdote, que l'on nous interroge sans arrêt sur la taxe à 75 % sur les revenus supérieurs à 1 million d'euros. Nous expliquons à nos collègues étrangers qu'elle n'a jamais vraiment été appliquée et que ce dispositif n'existe plus, mais, à certains moments, des signaux négatifs ou contradictoires ont pu être donnés. Depuis plusieurs années, au contraire, nous assistons à une mobilisation très proactive des pouvoirs publics et des acteurs de la place. Notre ministre Bruno Le Maire a repris le flambeau, de manière très proactive également, réunissant encore récemment le comité Place de Paris 2020, qui travaille à ces questions d'attractivité parfois extrêmement concrètes. Par exemple, le fait que des transports efficients permettent de gagner les aéroports nous crédibilise beaucoup en tant que hub à partir duquel les équipes installées à Paris peuvent rayonner vers l'ensemble des places économiques européennes. En tant que hub aéroportuaire, nous sommes probablement sans équivalent. Encore faut-il pouvoir aller à l'aéroport sans reperdre tout le temps qu'on a gagné, des dossiers comme celui du Charles-de-Gaulle Express sont évidemment très importants pour l'attractivité de la place de Paris.
Je ne reviens pas sur toutes les importantes mesures prises en loi de finances et en loi de financement de la Sécurité sociale.
Parmi les derniers problèmes soulevés par nos collègues, notamment étrangers, reste, lorsqu'il s'agit de choisir entre Paris et Francfort, l'absence de plafonnement des charges sociales patronales en France, qui crée des différences substantielles de coût du travail pour certaines catégories de salaires. Évidemment, c'est un sujet complexe, nous en sommes parfaitement conscients, mais c'est l'un des points sur lesquels nous sommes encore en difficulté.
Il faut bien distinguer différents cas. Les banques françaises et celles dont le siège principal est en France n'ont évidemment pas de problème, à la suite du Brexit, pour disposer d'un passeport européen puisqu'elles sont déjà localisées à Paris. Comme elles sont également très présentes à Londres, cela entraînera des reports d'activité vers le continent. Les banques françaises ont indiqué que leurs relocalisations se feraient à Paris – selon nous, cela représentera 1 000 emplois. Soyons cependant clairs : Londres est la première place financière mondiale. Les banques françaises y resteront donc présentes pour traiter les clients britanniques – les banques suivent leurs clients. Les clients britanniques seront traités depuis Londres, mais pas seulement eux, Londres restant une grande place financière internationale. Ce sont principalement les activités qui concernent des clients de l'Union à vingt-sept qui seront relocalisées. Les banques étrangères qui n'étaient présentes qu'à Londres devront, pour leur part, établir un siège quelque part dans l'Union européenne pour bénéficier du passeport. Quant aux banques étrangères déjà présentes dans l'Union européenne, la grande banque sino-britannique HSBC a déjà annoncé qu'elle pourrait relocaliser jusqu'à un millier de personnes à Paris.
Dans tous les cas, les mesures prises en faveur de l'attractivité, le positionnement des pouvoirs publics, c'est-à-dire le souhait exprimé de récupérer ce type d'emploi plutôt chez nous, et les choix réglementaires importent particulièrement. L'hypothèse d'une réglementation aux exigences très faibles, qui permettrait de n'établir que ce que les superviseurs appellent des « banques boîtes aux lettres », est déjà écartée. Reste à savoir jusqu'où iront les exigences réglementaires en matière de relocalisation.
Je suis convaincue qu'il ne faut pas voir cette question uniquement sous un angle réglementaire. Pour développer la place de Paris, les perspectives de développement d'activités et l'ambition que nous nous donnerons au niveau européen, notamment en ce qui concerne les marchés de capitaux, seront également très importantes. La Commission européenne actuelle avait fait de l'Union des marchés de capitaux l'un de ses grands projets, et un certain nombre de mesures ont été prises, ce dont nous pouvons nous féliciter. Force est cependant de constater que la relance de cette union et une méthode plus ambitieuse sont cruciales, pour toutes sortes de raisons, notamment le développement d'activités dont nous pouvons espérer que la place de Paris bénéficierait beaucoup compte tenu de son positionnement.
La Fédération bancaire française propose d'ailleurs qu'un groupe de sages, comme il y en a déjà eu en cette matière, essaie de développer une vision plus ambitieuse. C'est tout à fait essentiel : c'est ce qui pourra amener les grands acteurs mondiaux à se dire qu'il est important de se localiser sur le continent européen ; ensuite, chacun jouera sa carte au sein de l'Union européenne. Il faut, pour que celle-ci devienne un lieu attractif, qu'elle se donne de grandes ambitions. Nous avons beaucoup d'atouts : une épargne abondante, un marché de la dette – publique ou privée – dynamique… Il importe que les centres de décision en matière de traitement et d'usage de cette épargne dans le financement de l'économie soient chez nous plutôt qu'ailleurs.
C'est peut-être le seul point sur lequel mon point de vue diverge de celui d'Édouard Fernandez-Bollo. La localisation des sièges est importante car il existe malgré tout un biais national dans les choix d'allocation que font les gestionnaires d'actifs – l'Association française de la gestion financière a évalué le phénomène de manière relativement scientifique. Il est tout à fait légitime de se demander où seront établis les sièges car les choix faits auront un effet majeur sur l'orientation des flux d'épargne massifs du continent européen.
Nous faisons un certain nombre de propositions au-delà de la constitution de ce comité des sages.
Soyons également vigilants dans la mise en oeuvre de certaines réglementations et de certains projets qui pourraient être un handicap pour le développement des marchés de capitaux. Un grand enjeu sera la transposition en Europe de la réforme actée par le « comité de Bâle » à la fin de l'année 2017, notamment la façon dont seront traités les risques de marché – ce que nous appelons dans notre affreux jargon FRTB (pour Fundamental Review of the Trading Book). Il a été acté, d'ailleurs, qu'il fallait veiller attentivement à une mise en oeuvre aux États-Unis comme en Europe. C'est très important pour la compétitivité des marchés de capitaux en Europe.
Je me dois aussi de dire que l'idée d'une taxe sur les transactions financières appliquée par quelques États au sein de l'Union européenne ne serait évidemment pas favorable à la place de Paris, surtout si la France fait partie de ces États. Nous nous sommes beaucoup exprimés à ce propos.
Édouard Fernandez-Bollo a évoqué les chambres de compensation. Leur régulation et leur localisation sont des enjeux régaliens, en termes de stabilité financière et de politique monétaire, mais l'enjeu est également important pour le développement des activités financières. Ces chambres cristalliseront autour d'elles la présence de tous ceux qui travaillent avec elles. Or, aujourd'hui, 80 % ou 90 % de la compensation sur les dérivés de taux sur la monnaie euro, activité très importante, se fait à Londres.
Édouard Fernandez-Bollo a déjà beaucoup parlé de la stabilité financière. C'est évidemment l'un des grands enjeux pour les banques. La situation est aujourd'hui extraordinairement incertaine : comme tout le monde, nous essayons d'y voir clair dans les échanges entre le négociateur européen et les pouvoirs publics britanniques. À quel moment les règles seront-elles donc définies ? Par définition, ces situations d'incertitude ne sont pas très agréables ni très bien vécues par les marchés. L'un des problèmes du Brexit pour les activités financières est que nous ne savons pas dans quel cadre ces activités s'exerceront dans les prochaines années.
Cependant, je peux vous rassurer quant à la stabilité financière stricto sensu. En tant que secteur bancaire, nous dialoguons avec nos superviseurs, et il a été demandé aux banques de présenter d'ici à la fin du mois de juin 2018 des plans de continuité qui tiennent compte de tous les scénarios possibles, y compris le scénario le plus complexe, dit de hard Brexit, qui pourrait, sans accord au niveau européen, se réaliser dès le mois mars 2019. Nos adhérents y travaillent bilatéralement avec leurs superviseurs et des travaux de place sont également menés au niveau national ou au niveau de la Fédération bancaire européenne.
Le troisième grand enjeu est celui de l'égalité de concurrence. La définition des futures règles du jeu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne peut avoir un impact très important sur les enjeux concurrentiels. Après une période de flottement, dans le discours aussi bien des pouvoirs publics britanniques que des négociateurs européens, il est désormais clair que des entités situées hors de ce que seront demain les frontières de l'Union européenne n'auront pas de passeport financier. C'est un point évidemment très important et structurant pour nous. Pour le reste, les choses sont beaucoup moins claires aujourd'hui. Les services financiers seront-ils inclus dans un futur accord de libre-échange ou non ? Cela ne nous semblerait pas parfaitement approprié. Les pouvoirs publics européens ont été très clairs mais la revendication britannique est différente. Où le curseur sera-t-il placé ? Nous ne le savons pas.
La négociation ne doit pas s'orienter vers la création d'ersatz de passeport. La possibilité est évoquée, notamment par les autorités britanniques, d'une forme d'équivalence globale pour les services financiers, ou de reconnaissance mutuelle globale. Il s'agirait de dire que, grosso modo, les règles britanniques et européennes sont équivalentes et qu'elles produisent des résultats analogues. Cependant, notre secteur est extraordinairement régulé et extraordinairement supervisé. Les distorsions de concurrence peuvent donc résider dans les détails. Les règles générales – qui figurent dans les directives et les règlements – peuvent très bien rester exactement les mêmes, mais n'oublions pas les règles dites « de niveau 2 », arrêtées par les autorités comme l'Autorité bancaire européenne ou l'ESMA. Évidemment, si un acteur accède au marché dans les mêmes conditions que les autres sans être obligé d'appliquer les règles de niveau 2, cela peut créer des distorsions majeures de concurrence.
Au-delà, la façon dont les autorités de supervision interagissent avec les acteurs est tout à fait essentielle. Nous le voyons bien avec l'Union bancaire, instaurée en 2014. Bien que les règles de base soient les mêmes au sein de l'Union européenne, bien qu'une convergence des pratiques des superviseurs ait été organisée entre autorités de niveau 2, ce n'est au fond que maintenant que nous avons le même superviseur à Francfort dans la zone euro que l'on voit véritablement converger la supervision avec, parfois, des enjeux concurrentiels très importants. Comme souvent, le diable peut donc être dans les détails et, si des équivalences doivent être accordées, il faudra vérifier que les règles sont pareillement appliquées. Selon nous, les équivalences ne peuvent être que sectorielles et adaptées. Aujourd'hui, les directives ouvrent un certain nombre de possibilités d'équivalences mais elles n'ont pas du tout été conçues pour tenir compte d'un marché aussi important – en réalité, un marché dominant – que le marché britannique des services financiers. Une revue de ces règles d'équivalence sera donc nécessaire. Il faudra aussi une mobilisation très forte des autorités européennes et probablement, en l'occurrence, de la Commission pour s'assurer ensuite que l'équivalence reste réelle. Il faudra également que les règles prévoient le cas où l'équivalence cesserait et les conséquences qui en découleraient.
Vous le voyez, nous sommes à la fois face à des enjeux très stratégiques – l'Union des marchés de capitaux, l'ambition que doit se fixer l'Europe, y compris pour assurer son indépendance, puisque le développement de marchés de capitaux en Europe est nécessaire au financement de l'économie – et face à des questions très précises et très fines de réglementation et de supervision, potentiellement très importantes pour les conditions de concurrence.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, je vous remercie d'inviter l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) à contribuer à cette table ronde sur l'impact potentiel du Brexit sur les marchés financiers.
Créée en 2011, dans le cadre d'une réponse commune de l'Union européenne à la crise financière, l'ESMA est une autorité indépendante de l'Union européenne, qui contribue à garantir la stabilité de son système financier et dont les bureaux sont situés à Paris. Ayant pour mission d'améliorer la protection des investisseurs et de promouvoir la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financier, elle est régie, sous la direction du président Steven Maijoorn, par un conseil des superviseurs composé de responsables des vingt-huit autorités nationales de surveillance des marchés financiers de l'Union européenne, notamment le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et le président du superviseur britannique, la Financial Conduct Authority (FCA). La participation du Royaume-Uni au conseil des superviseurs ainsi qu'aux groupes d'experts sera évidemment différente lorsque ce pays ne fera plus partie de l'Union européenne. Nous travaillons en étroite collaboration avec les deux autres agences de supervision financière – l'Autorité bancaire européenne établie à Londres, qui veut déménager à Paris, et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, établie à Francfort – mais aussi avec d'autres instances européennes, tels la Banque centrale européenne et le Mécanisme de surveillance unique, établis à Francfort, ainsi que les institutions bruxelloises, en particulier la Commission, le Parlement et le Conseil.
L'ESMA effectue un travail important à mesure que nous approchons du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, événement historique et unique. Notre rôle est de nous préparer à cet événement et d'en réduire les effets néfastes pour les marchés financiers européens. Le Brexit les affectera, mais ses effets restent incertains à l'heure actuelle, car ils dépendront en grande partie du résultat des négociations politiques et de la forme que prendront l'accord final de retrait de au Royaume-Uni et le futur accord commercial.
La décision du Royaume-Uni de se retirer de l'Union européenne a déjà un impact important sur le secteur financier, rendant nécessaire d'établir des plans d'urgence, de revoir le modèle économique, de reconsidérer les relations contractuelles avec les homologues britanniques, de restructurer, etc. Du point de vue de la réglementation et de la surveillance des marchés, le travail de l'ESMA, compte tenu des incertitudes d'un processus politique qui ne s'éclaircira probablement que très tard, s'est fondé jusqu'à présent sur le scénario le plus défavorable : ni disposition transitoire mise en place au 29 mars 2019, ni décision d'équivalence prise par la Commission. Une part importante de nos travaux a porté sur la convergence des pratiques de surveillance, dans le souci d'éviter que la liberté d'établissement des entreprises individuelles au sein de l'Union européenne ne conduise les entreprises financières britanniques à décider de leur relocalisation vers l'Europe des vingt-sept en se fondant sur un arbitrage entre les différentes réglementations et supervisions des États membres. Pareil arbitrage serait préjudiciable à court ou moyen terme à la stabilité financière et à la protection des investisseurs. La question fondamentale est la suivante : comment s'assurer que les superviseurs nationaux prennent, du point de vue des intérêts communs européens, les meilleures décisions possibles en matière de supervision financière ? Nous avons très tôt considéré que le Brexit représentait un défi au regard de notre objectif de cohérence en matière de supervision européenne. Dans ses avis rendus publics aux mois de mai et juillet 2017, l'ESMA a donc rappelé d'importants principes généraux sur les autorisations, la supervision et les mesures de sanctions applicables dans les domaines de la gestion d'actifs des entreprises d'investissement et sur les marchés secondaires, ceci afin de préserver une certaine cohérence en cas de relocalisation. Nous considérons que nos avis sont parfaitement conformes à la législation européenne en vigueur et ne portent en aucun cas atteinte au principe fondamental de liberté d'établissement de l'Union européenne. Ils ne représentent toutefois qu'une partie de nos efforts pour préserver la convergence en matière de surveillance de secteurs financiers.
Nous avons également décidé avec les superviseurs nationaux de mettre en place un comité de coordination. Grâce au partage d'informations et à la promotion des pratiques convergentes, ce comité est l'un des moyens par lesquels l'ESMA vise à réduire le risque d'arbitrage entre les juridictions de l'Union européenne. Il offre une tribune où les experts seniors des autorités compétentes peuvent discuter les dossiers d'autorisation en cours impliquant des entités britanniques souhaitant transférer leurs activités dans l'Union Européenne des Vingt-Sept.
Nous le savons tous, le Brexit peut également exposer la stabilité financière à des risques importants, en particulier dans le cas où le Royaume-Uni quitterait l'Union européenne sans qu'aucun arrangement ait été conclu – scénario de hard Brexit. Nous surveillons attentivement le risque d'effets de falaise et envisageons un tel scénario avec toutes les autorités nationales de surveillance et, plus généralement, avec les autres autorités financières. Même si nous espérons que ce scénario ne se réalise pas, il est de notre devoir, en tant que régulateur et superviseur, de nous y préparer et d'évaluer ses éventuelles répercussions. Par exemple, comment les activités transfrontières des entreprises et les relations entre les entreprises et leurs clients pourraient-elles être affectées ? Que peuvent faire les entreprises et, potentiellement, les autorités pour en atténuer les pires effets ? L'ESMA examine notamment avec beaucoup d'attention la question de la continuité des contrats. Les acteurs de marché pourraient relocaliser certaines activités dans l'Union européenne et recourir à d'autres stratégies. Chacune d'entre elles soulève des questions juridiques, réglementaires et de supervision.
Permettez-moi de dire un mot des entités que nous supervisons directement : les agences de notation et les référentiels centraux. Nous maintenons un dialogue continu avec eux et nous leur avons demandé de fournir le plan d'urgence envisagé en cas de hard Brexit. Nous voulons nous assurer que la réorganisation qu'ils envisagent leur permette effectivement de respecter la législation en vigueur demain et, donc, de poursuivre leurs activités au sein de l'Union à vingt-sept.
Dernier point, et non des moindres, nous effectuons une analyse détaillée de l'impact opérationnel du Brexit sur l'ESMA en tant qu'organisation. Nous examinons notamment ses répercussions sur le personnel de nationalité britannique, sur le système informatique de partage de données entre les autorités et ses implications budgétaires.
Comme vous pouvez le voir, la question du Brexit et de ses éventuelles implications est une préoccupation centrale de l'ESMA. Elle le restera probablement à court et moyen terme.
Je sais gré au Parlement de se mobiliser autour des réformes et du Brexit, et je remercie les organisateurs de cette réunion.
Paris Europlace est l'organisation chargée de développer et de promouvoir la place financière de Paris. Elle se caractérise par une particularité qui la différencie d'autres organisations comparables, notamment la City de Londres : elle rassemble en son sein l'ensemble des acteurs, au premier rang desquels les grandes entreprises industrielles cotées et, de plus en plus, les petites et moyennes entreprises, les établissements de taille intermédiaire et les très petites entreprises qui participent à nos travaux, notamment en matière d'innovation et de développement des start-ups, ainsi que les grandes banques de la place, les investisseurs et les pouvoirs publics – qu'il s'agisse des autorités de régulation comme l'Autorité des marchés financiers, la Banque de France et la direction générale du Trésor, ou des collectivités locales incarnées par la maire de Paris et la présidente de la région Île-de-France, qui siègent au conseil d'administration de Paris Europlace, lequel est présidé par un chef d'entreprise, actuellement Gérard Mestrallet, président d'Engie. Je rappelle systématiquement cette caractéristique tenant à la présence de grandes entreprises industrielles au sein de Paris Europlace car elle constitue un facteur différenciant le projet de Paris comme place financière par rapport à d'autres, Londres notamment. D'emblée, nous avons refusé d'être un club de banquiers – malgré toute l'admiration que j'ai pour le secteur bancaire – et préféré rassembler les acteurs de l'économie réelle et montrer que la place financière, c'est-à-dire les banques et les investisseurs, servent les intérêts de leurs clients dans cette économie réelle. Depuis la crise financière, cette approche nous a permis de signer des accords de coopération dans le monde entier avec les places financières émergentes pour contribuer au développement d'un modèle de place financière plus résistante face aux crises et capable de justifier son rôle.
J'en viens brièvement aux questions que vous nous avez posées en commençant par l'impact du Brexit sur les marchés financiers européens, l'incertitude qu'il suscite et la difficulté de prévoir l'évolution subséquente des marchés financiers. La réaction des établissements financiers de Londres s'est déroulée en trois étapes. Juste après le référendum, tout d'abord, nos interlocuteurs étaient d'avis qu'un retour en arrière était possible : business as usual, donc. Le meilleur scénario, selon eux, consistait à ce que rien ne bouge, car il est tout à la fois lourd et coûteux de déplacer des personnes.
Cette étape n'a guère duré : dès les annonces, en octobre 2016, de Mme Theresa May sur l'hypothèse d'un hard Brexit, les choses se sont accélérées. Poussés par les autorités de régulation, les établissements financiers ont dû envisager la réorganisation des legal entities, leurs entités juridiques, pour au moins couvrir le territoire européen continental au cas où les difficultés se préciseraient. Depuis le mois d'août 2017, un certain nombre d'annonces ont donc été faites dont bon nombre, reconnaissons-le, en faveur d'Amsterdam et de Francfort, compte tenu de la proximité de la Banque centrale européenne, mais aussi en faveur de Paris où de nombreuses entreprises disposaient déjà d'entités juridiques.
Nous entamons désormais une troisième étape – j'ai peut-être sur ce point une légère divergence avec les intervenants précédents – d'accélération des plans. Pour revenir de Londres et y retourner lundi prochain avec Valérie Pécresse, je crois que le sentiment général qui y prévaut est celui d'une grande fragilité politique, ce que la City de Londres a elle-même affirmé publiquement il y a quelques jours. Dans ce contexte, les grandes entreprises internationales accélèrent leurs réflexions voire leurs décisions. Depuis octobre ont donc fleuri les déclarations de grandes banques internationales, notamment américaines, au-delà du seul cas de HSBC qui a annoncé il y a un an créer mille emplois à Paris, cette banque étant déjà fortement implantée avec le Crédit commercial de France (CCF) : Bank of America installera 400 traders et a réservé un immeuble pouvant accueillir mille personnes dans la rue La Boétie ; JP Morgan augmente ses effectifs de 25 % et projette d'aller beaucoup plus loin ; Citigroup a décidé d'implanter son unité de courtage en services bancaires – broker-dealer – à Francfort mais installera ses équipes de service de clientèle – front – à Paris, soit deux cents à deux cent cinquante personnes. En tout, nous évaluons à quelque trois à quatre mille les premiers emplois annoncés ; ce niveau n'est pas encore significatif et est à peu près équivalent au niveau annoncé à Francfort, mais supérieur à celui des autres capitales – Dublin et Luxembourg. Le nombre total de ces emplois déplacés, de l'ordre de dix à douze mille, est encore assez modeste, bien loin des trente voire soixante-dix mille emplois prédits, qui pourraient venir.
La situation pourrait cependant s'accélérer, surtout si les négociations restent difficiles. Dans le secteur bancaire, des décisions et des schémas sont déjà très avancés et pourraient prendre encore plus d'ampleur dans les semaines et les mois à venir, avec une possible relocalisation de pans entiers d'activité. Il faudra alors être prêt à présenter une offre compétitive. Les acteurs d'autres secteurs où nous avons des atouts à faire valoir comme la gestion d'actifs, le capital-investissement, l'assurance, où les mouvements ont déjà commencé, mais aussi la fintech et la finance environnementale pourraient être intéressés par une relocalisation vers l'Europe en raison de la perte du passeport et de l'incertitude qui en découle.
Derrière tout cela se pose la question du rééquilibrage des activités financières de la City qui, finalement, était une bulle, en quelque sorte, car son rôle en Europe était totalement surpondéré par rapport aux capitales européennes. Cet objectif de rééquilibrage est souhaitable. Contrairement au raisonnement trop souvent tenu sur la fragmentation et la masse critique, je crois qu'une répartition plus équilibrée des activités financières entre les places européennes – Paris, Francfort et d'autres – est souhaitable tant il est important que les banques, les établissements financiers et les investisseurs se trouvent près de leurs clients, et que les différents pays participent à cette industrie, y compris pour en surveiller les modes de fonctionnement et la régulation. Il est donc essentiel que nous y participions pour faire valoir les priorités et les axes stratégiques de la place de Paris, notamment le développement des start-ups, le financement des petites entreprises et le développement de la finance durable, qui intéresse plusieurs personnes dans cette salle.
Cet objectif de rééquilibrage passe par la création de l'Union des marchés de capitaux. Sur ce point, concrètement, lors de la dernière rencontre annuelle entre les chefs d'entreprise français et allemands voici quelques semaines à Évian, le sujet de la finance et des marchés financiers a été abordé pour la première fois : si le Royaume-Uni quitte l'Union, ont estimé ces patrons, il se produira un effet de rétrécissement de la place européenne. Pour l'éviter, il faut accélérer la création de l'union des marchés de capitaux, c'est-à-dire donner la possibilité aux entreprises, y compris les PME, d'accéder à des canaux de financement diversifiés. Nous travaillons actuellement à formuler des positions communes avec nos partenaires européens à ce sujet.
Nous présentons habituellement les atouts de la place de Paris en quatre chapitres. Rappelons tout d'abord que la place de Paris et la région Île-de-France sont la seule ville globale d'Europe comparable à Londres. C'est un élément central pour les investisseurs internationaux. Le projet de Grand Paris renforce naturellement cette caractéristique. La place de Paris s'appuie sur la cinquième économie mondiale et constitue une région économique au sens fort, comme l'est la région du Grand Londres. C'est un facteur d'attractivité qui attire beaucoup les investisseurs mondiaux.
Deuxième atout : Paris est la première place financière d'Europe continentale, à parité avec Francfort ou presque, mais elle est beaucoup plus diversifiée en matière de canaux de financement et d'activités de marchés. Tout d'abord, les Français sont performants dans ce secteur – ce qui explique leur nombre important à Londres et à New York. Ensuite, la place de Paris compte parmi ses principaux clients soixante-dix à quatre-vingts grandes entreprises très actives sur les marchés. Le patron de HSBC justifie d'emblée son choix de s'implanter à Paris par la priorité que constitue pour une grande banque internationale la présence des clients ; or, en Europe, les clients sont à Paris – ce sont les grandes entreprises françaises et internationales. Autre argument : la force des banques françaises, qu'il faut saluer, car c'est un facteur qui pèse dans les choix des grandes entreprises internationales. En outre, la place de Paris est en pointe dans le secteur de la gestion d'actifs, dans le domaine de l'assurance et dans celui de la fintech.
Le troisième atout a précisément trait au développement de l'innovation et des fintechs qui sont dans une spirale de développement très vigoureuse dans tous les domaines de l'innovation financière et des technologies, depuis le crowdfunding et le blockchain jusqu'à la finance durable. Dès le début des années 2000, la place de Paris s'est fortement engagée dans le domaine de la finance environnementale : vous aurez constaté l'effort que nous avons consenti en la matière à l'occasion de la COP21 avec tous les acteurs concernés et avec l'appui des pouvoirs publics, de même qu'en matière de développement des start-ups de haute technologie.
J'en viens enfin à notre atout le plus important pour vous : l'environnement réglementaire et fiscal s'est nettement amélioré, les premières initiatives en ce sens ayant été prises avant même l'élection de M. Macron. M. Valls, notamment, avait participé à nos rencontres financières, entouré d'Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, pour annoncer les premiers signaux dans le contexte du Brexit : c'était essentiel pour commencer à changer la perception de la France. Les réformes concernant le droit du travail et la fiscalité – qui sont les deux éléments principaux de la comparaison avec nos concurrents – s'accélèrent. Je tiens néanmoins à souligner qu'il reste beaucoup à faire en la matière, car le coût du travail demeure problématique par rapport à nos concurrents européens. Nous sommes à votre disposition pour en reparler. De même, nous participons activement aux travaux relatifs au plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) afin de favoriser le développement de l'épargne longue orientée vers le financement des entreprises ainsi que la diversification des canaux de financement et le développement de nouveaux outils de financement de l'innovation.
Ce matin même, je rencontrais la patronne d'une très grande banque internationale qui me tenait le discours suivant : la place de Paris possède déjà les atouts nécessaires, mais pourquoi n'insistez-vous pas davantage sur le message à faire passer ? La France est la deuxième économie européenne, le pays le plus jeune d'Europe après l'Irlande et le pays le plus éduqué ; en outre, elle dispose du panel le plus large de grandes entreprises qui sont les clients de l'industrie financière. Tels sont nos atouts vus par la cheffe d'une grande entreprise étrangère implantée à Paris.
Un dernier point sur la négociation : je partage les propos qui ont été tenus et, en tout état de cause, nous n'intervenons pas en première ligne. Comme chacun, cependant, nous sommes préoccupés par la période de transition qui, selon nous, ne devrait pas dépasser le calendrier prévu par la Commission, c'est-à-dire fin 2020. En effet, toute prolongation de l'incertitude présenterait un problème pour le monde des entreprises. Autre question importante : la notion de substance – je salue à cet égard les travaux effectués par l'ESMA –, car l'implantation et la relocalisation des activités est un sujet majeur et il faut éviter de créer un effet de contournement de la perte du passeport. De même, comme l'a rappelé le ministre, pour les professionnels des services financiers de la place de Paris, y compris les représentants d'entreprises internationales, le régime d'équivalence constitue à nos yeux la seule solution valable. Il conviendra que ce régime ne soit ni global, ni permanent, ni fondé uniquement sur les principes, car cela équivaudrait là encore à la perte du passeport. Il ne s'agit pas de punir la City de Londres mais de préserver l'avenir de l'Europe et de veiller à ce qu'un pays qui décide d'en sortir ne puisse pas être traité de la même manière que les pays qui continuent de prendre le risque du projet européen – et de bénéficier de ses avantages.
Je suis naturellement à votre disposition pour évoquer la stratégie de la place de Paris car notre projet est devant nous. Avec le ministre de l'économie et des finances, nous avons relancé le comité Place de Paris 2020 en fixant des priorités claires en matière de stratégie industrielle. Notre projet est de faire de Paris la place du futur en Europe.

Pourquoi n'est-il pas possible, souhaitable, stratégique, opportun ou intéressant d'inclure les services financiers dans le futur accord de libre-échange ? Autre question, plus technique : quel est l'impact du Brexit sur l'application des accords Bâle III ?

Dans un discours prononcé le 6 mars, Mme Theresa May a souligné la volonté du Royaume-Uni d'intégrer les services financiers dans un futur accord de libre-échange avec l'Union européenne. Elle souhaiterait que Londres et Bruxelles concluent un accord qui conserve les mêmes objectifs réglementaires en matière financière grâce à un mécanisme de consultation entre les deux parties. À quoi correspond ce mécanisme ? Il semble qu'un mécanisme de même nature soit d'ores et déjà envisagé dans l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Pourquoi l'Union renoncerait-elle à une telle option avec le Royaume-Uni alors qu'elle semble l'avoir acceptée avec les États-Unis ?

Vous avez souligné l'importance de travailler en vue de l'union des marchés financiers et d'aboutir rapidement à des accords en ce sens. Quelles sont les étapes à franchir selon vous pour parvenir à cette unification ?

Suite à la crise financière de 2008, la Banque centrale européenne a mis en place un mécanisme de rachat massif d'actifs « pourris » de certaines banques dans l'ensemble des places financières pour assainir le monde bancaire et lui donner les moyens d'honorer ses engagements à l'égard de l'économie réelle et d'assurer son développement sur les marchés. Ce mécanisme de rachat massif prendra fin en octobre, aucune information n'ayant apparemment été fournie concernant la prolongation éventuelle par la BCE de son action en ce sens. La fin de ce mécanisme parallèlement au Brexit ne va-t-il pas influer sur la stabilité financière et affecter le fonctionnement du système bancaire européen ?

Quel est le risque d'un dumping réglementaire organisé par le Royaume-Uni ? Des incitations pourraient-elles exister en ce sens ou des mesures de prévention seront-elles au contraire négociées dans l'accord ?
D'autre part, la presse semble indiquer que certaines chambres de compensation se maintiendront au Royaume-Uni, ce qui pourrait présenter quelques problèmes. Quelle capacité l'Union européenne a-t-elle d'intégrer l'ensemble des chambres de compensation dans le territoire européen ?
La Commission européenne a en effet présenté une proposition visant à répartir les chambres de compensation en trois catégories : les chambres de compensation sans impact systémique, celle qui peuvent en avoir un et celles dont l'impact systémique est le plus fort. Les chambres relevant de la première catégorie peuvent être maintenues hors de l'Union européenne dans le cadre des accords de reconnaissance existants. Ensuite, il est nécessaire de conclure des accords renforcés permettant un véritable accès aux chambres relevant de la deuxième catégorie. Dans le troisième cas, il faut, comme le propose avec vigueur la Banque de France, imposer la relocalisation dans l'Union européenne. Songez que 97 % des swaps en euros sont conclus au Royaume-Uni : compte tenu de l'importance de ce marché, notamment du point de vue des titres qui sont au fondement de la politique monétaire, nous pensons que le fait d'en maintenir une telle proportion en-dehors de l'Union à vingt-sept n'est pas assez sûr.
J'en viens aux questions monétaires. En effet, la BCE a consenti une facilité de financement gérée par les banques centrales nationales. Cependant, les actifs visés n'étaient pas « pourris » mais simplement des actifs dont les conditions d'éligibilité étaient plus relâchées que celles des actifs ordinaires ; précisons qu'il n'y a pas eu de pertes sur ces actifs, contrairement à d'autres banques de pays tiers qui sont encore en cours de liquidation après avoir constaté des pertes au titre de ces actifs. Il s'agit d'un mécanisme de sortie, sachant que le contexte géopolitique et monétaire est extrêmement lâche. C'est pourquoi la fin de ce mécanisme monétaire particulier, monsieur Girardin, dans un contexte général d'abondance de liquidités en Europe, ne nous semble pas en l'état présenter de problème structurel pour la stabilité financière.
Pourquoi l'immense majorité des accords de libre-échange conclus par l'Union européenne n'intègrent-ils pas les services financiers, notamment celui qui est en cours de négociation avec les États-Unis ? Ce sont précisément les États-Unis qui ont demandé que ces services soient exclus du champ de l'accord car ils entendent conserver une capacité de régulation autonome et faire en sorte que seule la loi américaine s'applique aux services financiers fournis aux États-Unis. C'est donc le caractère historiquement régulé de ces services qui explique pourquoi un accord visant en réalité à abaisser les barrières tarifaires n'inclut pas des services relevant d'un domaine réglementaire.
Enfin, monsieur Marilossian, l'accord Bâle III s'applique en-dehors de l'Europe ; il n'existe donc pas en soi de problème de principe. Notons cependant que le Royaume-Uni n'adoptera pas la transposition européenne de Bâle III mais conservera son autonomie de transposition dans le nouvel accord.
En règle générale, en effet, les accords de libre-échange ne comportent pas les services financiers ; c'est notamment le cas de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis. Quant à l'insertion d'un mécanisme de consultation entre les parties dans un accord global, madame Tanguy, il ne me semble pas du tout adapté. En particulier, j'ai beaucoup insisté sur la question de l'égalité de concurrence : le secteur bancaire est très réglementé, et les juridictions compétentes pour juger de la bonne application de ces réglementations jouent un rôle majeur. Derrière des règles qui sont en apparence appliquées et sanctionnées de la même manière pour tous peuvent s'immiscer des distorsions de concurrence.
La seule solution satisfaisante semble consister à instaurer des régimes d'équivalence ciblés au cas par cas, prévus par des textes spécifiques et adaptés à la situation propre au Royaume-Uni – en effet, il existe déjà des régimes d'équivalence avec des pays tiers mais leurs services financiers sont beaucoup plus modestes – et, surtout, dont la mise en oeuvre bénéficiera d'un réel investissement des autorités européennes pour veiller à ce qu'une équivalence accordée à telle date ne soit pas maintenue dès lors que les conditions la justifiant ne prévalent plus. D'autre part, il faut prévoir un régime de sortie réaliste : comme pour le Brexit lui-même, les fameux effets de falaise font peur à tout le monde. Il ne faudrait donc pas que les régimes d'équivalence qui seront sans doute mis au point dans les années à venir – sauf en cas de Brexit dur – soit tels que la menace de leur retrait ne soit pas réaliste, provoquant d'interminables négociations. Le mécanisme de consultation, par exemple, prend forcément du temps : il faut d'abord présenter les arguments des uns et des autres et, pendant ce temps, les distorsions de concurrence s'installent et les marchés s'éloignent.
Il faut donc procéder avec beaucoup de prudence. Le risque de dumping réglementaire existerait si nous préservions un accès maximum moyennant des conditions réglementaires différentes. Dans ce cas, non seulement la place de Londres ne diminuerait pas mais elle croîtrait même jusqu'à devenir une place offshore encore plus importante qu'aujourd'hui en matière de financement de l'économie européenne. Ce n'est certes pas le scénario le plus probable, et ce n'est pas du tout celui que prônent les négociateurs européens, mais il faut rester vigilant.
J'en viens à la question de l'Union des marchés de capitaux, qu'il est difficile d'aborder en quelques mots. Tous les acteurs européens conviennent qu'il est nécessaire de développer les marchés de capitaux en Europe, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la réglementation post-crise que, pour l'essentiel, les banques ne contestent pas, exerce une très forte pression sur les bilans bancaires. Or, le crédit bancaire est de très loin le premier mécanisme de financement de l'économie européenne, non seulement des ménages mais aussi des entreprises, puisqu'il représente 75 % du financement des entreprises présentes sur le continent européen. Il faut que cette situation évolue, mais son évolution ne peut être rapide et il est indispensable d'exercer la plus grande vigilance : les grandes entreprises ont déjà développé leur accès direct aux marchés – ce qui explique pourquoi en France, où elles prennent une place importante dans l'économie, le crédit bancaire ne finance que 60 % des besoins des entreprises tandis que les marchés en financent 40 % – mais il faut absolument veiller à préserver la capacité des banques à financer l'économie par le bilan, car le jour où les TPE pourront se financer directement sur les marchés est encore lointain. Nous voulons donc conserver toute la gamme des financements possibles, y compris le financement par le bilan, pour répondre aux besoins de tous les clients d'un réseau qui se caractérise par sa capillarité, en particulier les TPE et les PME.
Pour autant, il faut développer les marchés de capitaux à l'européenne : c'est l'un des principaux enjeux de la réflexion qui doit selon nous être conduite par un comité des sages. L'Europe n'a pas la même vision du traitement des clients et des épargnants, lesquels n'ont pas la même vision du risque que certains marchés internationaux très développés comme les États-Unis. Il nous faut donc trouver une voie européenne afin de recycler notre matière première, l'épargne, qui est très abondante en Europe et que nous avons intérêt à garder sur le continent en veillant à ce qu'elle finance en partie l'économie « réelle » européenne. Il n'existe pas de solution miracle. La Commission a mené de nombreux travaux passionnants sur le concept de titrisation à l'européenne, qui n'a rien à voir avec la titrisation qui existait avant la crise financière : il s'agit d'une titrisation sûre et labellisée, entre autres. Nous en sommes encore loin, cependant, et il faut une vision stratégique permettant de développer ces marchés, indispensables pour prendre le relais des bilans bancaires qui ne pourront pas assurer durablement une part aussi importante du financement de l'économie européenne. Cette évolution doit se produire en respectant toutes les spécificités européennes, qu'il s'agisse des valeurs ou des acteurs financiers.
S'agissant du contrôle des chambres de compensation, qui règlent actuellement à Londres les comptes d'un grand nombre d'entreprises européennes, la Commission a en effet présenté une proposition de texte législatif qui étendrait considérablement les pouvoirs de l'AEMF en tant qu'autorité de régulation afin qu'elle s'assure que les chambres de compensation de pays tiers dont l'activité relative aux entreprises européennes est importante soient correctement supervisées dans les mêmes conditions que les chambres de compensation européennes. L'objectif est de mettre les unes et les autres au même niveau. Selon nous, c'est extrêmement important car in fine, une fois la décision prise d'instaurer un régime d'équivalence, les acteurs du pays tiers pourront exercer dans l'Union européenne exactement dans les mêmes conditions que les acteurs européens. Il faut donc qu'ils soient contrôlés dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles.
Nous prônons d'ailleurs l'introduction de ce type de mécanismes dans d'autres domaines de la législation européenne où l'harmonisation d'un secteur à l'autre entre les régimes d'équivalence et les régimes applicables aux pays tiers fait encore défaut. Nous estimons qu'une fois prise, la décision d'instaurer l'équivalence doit être correctement suivie. Là encore, la Commission a formulé une proposition dans son rapport sur les autorités européennes de surveillance, dont l'AEMF fait partie. Il est proposé que nous endossions un rôle plus important de suivi de la manière dont évoluent les règles de régulation et de surveillance dans les pays tiers. Nous estimons qu'il serait très utile d'y ajouter la capacité d'une surveillance directe des pays tiers dans certains domaines – marchés des changes, plateformes d'échanges et autres infrastructures essentielles.
À l'évidence, il est indispensable de renforcer l'Union des marchés des capitaux de l'Union à vingt-sept car, dans de nombreux domaines, nous dépendons encore fortement des marchés britanniques. La Commission a présenté de nombreuses initiatives en ce sens concernant la titrisation ou encore le remplacement de la directive Prospectus, notamment, et réfléchit à la réduction des barrières à la distribution transfrontière des fonds d'investissement. À mon sens, il est important qu'elle poursuive également ses initiatives concernant les chambres de compensation et, plus généralement, l'examen des autorités européennes de surveillance, car c'est la seule manière de renforcer davantage les marchés des capitaux européens.
S'agissant de l'union des marchés des capitaux, je crois comme Mme Barbat-Layani qu'il est très important de diversifier les canaux de financement des entreprises européennes pour favoriser l'emploi, faciliter l'accès des entreprises aux marchés et stimuler la croissance. Mme Ross a rappelé les premières étapes de ce processus, qui sont assez modestes – prospectus, titrisation, barrières applicables aux gestionnaires d'actifs – mais l'objectif est d'aller plus loin. Au fond, dans ce domaine comme pour ce qui concerne le plan d'action de la place de Paris, les objectifs sont les mêmes : développer et harmoniser les instruments d'épargne longue au niveau européen et les orienter vers le financement des entreprises, y compris les PME et les TPE, ouvrir de nouveaux circuits de financement des entreprises, par exemple des fonds d'investissement d'accompagnement – un sujet qui intéresserait certainement le dialogue franco-allemand sur l'accompagnement des PME et des TPE – mais aussi développer le capital-investissement et le financement de l'innovation à l'échelle européenne, enfin, favoriser le développement des start-ups et de la nouvelle économie.
Dans ce domaine, il est essentiel de multiplier les partenariats entre pays européens, à commencer par la France et l'Allemagne, afin d'accélérer la réalisation de l'union des marchés des capitaux. Nous sommes déjà en contact avec les institutions européennes, l'objectif étant au moins de remettre une feuille de route à la prochaine Commission qui sera constituée après les élections européennes. La sortie de Londres, en effet, doit nous inciter à développer les moyens de doter l'Europe à vingt-sept d'une plus grande autonomie financière pour garantir son indépendance dans le monde globalisé de demain, face aux États-Unis, à la Chine et à un Royaume-Uni dont les velléités seront croissantes.

Je vous remercie. Je vous informe que la commission des finances a créé un groupe de travail sur l'impact du Brexit sur le secteur financier, qui adressera un rapport à notre mission d'information.
La seconde table ronde commence à seize heures cinq.
La mission d'information organise ensuite la table ronde sur les conséquences du Brexit sur le budget de l'Union européenne, avec la participation de MM. Jean Arthuis, président de la commission des budgets au Parlement européen, Silvano Presa, directeur général adjoint du budget à la Commission européenne et M. Thomas Ossowski, représentant spécial du ministère allemand des affaires étrangères pour le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne et directeur pour les politiques de l'Union européenne.

Je souhaite de nouveau vous présenter les excuses du président François de Rugy pour son absence cet après-midi. Cette seconde table ronde est consacrée à l'impact du Brexit sur le budget de l'Union européenne, plus particulièrement sur le prochain cadre financier pluriannuel (CFP), pour la période 2021-2027.
Les négociations sur ce CFP devraient être âpres, en grande partie à cause des conséquences que fait peser le départ du Royaume-Uni sur les discussions. L'Union européenne perd un contributeur net, malgré le fameux rabais britannique. La perte de ressources est évaluée autour de douze à treize milliards d'euros. Le Royaume-Uni s'est engagé à tenir ses engagements financiers jusqu'en 2020, si l'on en croit les documents de la négociation. Mais qu'en sera-t-il après ? Quelle forme prendra le futur CFP ?
La Commission européenne va bientôt faire des propositions, en mai prochain. Les scénarios sont encore flous, mais la prise en charge par l'Union d'un certain nombre de politiques lourdes financièrement, telles que la gestion des migrations, la lutte contre le terrorisme ou encore la recherche et l'innovation, pourrait plaider pour un budget renforcé. La proposition de résolution du Parlement européen, présentée par Isabelle Thomas et Jan Olbrycht le 10 janvier 2018, souhaitait ainsi porter le plafond des dépenses après 2020 à 1,3 % du revenu national brut (RNB) de l'Union européenne. Pensez-vous ce scénario réaliste ? Quelles sont les autres options sur la table et quel impact le Brexit aura-t-il sur la nouvelle répartition des budgets européens ?
Enfin, le départ du Royaume-Uni peut être aussi l'occasion de réfléchir aux ressources de l'Union européenne, ou « ressources propres ». Celles-ci reposent aujourd'hui majoritairement sur des contributions nettes des États membres et non sur des taxes affectées. De nombreuses réflexions sont en cours, impliquant un prélèvement unique sur les recettes de la taxe à la valeur ajoutée (TVA), une partie du produit d'une éventuelle taxe sur les transactions financières ou encore un impôt européen, voire mondial, sur les géants du numérique. Pensez-vous que l'ensemble des mécanismes de correction dont bénéficie le Royaume-Uni, mais aussi un certain nombre de nos partenaires, pourrait être revu à l'occasion du Brexit ? Je rappelle à toutes fins utiles que la France est le premier contributeur, si l'on peut dire, au rabais britannique.
Pour évoquer l'ensemble de ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir trois intervenants, MM. Jean Arthuis, président de la commission des budgets au Parlement européen, Silvano Presa, directeur général adjoint du budget à la Commission européenne et Thomas Ossowski, Représentant spécial du ministère des affaires étrangères allemand.
Je vous remercie de nous accueillir. C'est un privilège pour un parlementaire européen élu en France de pouvoir ainsi rencontrer les députés français, hors du cadre de la semaine interparlementaire, qui garde un caractère, avouons-le, assez formel. Je peux seulement souhaiter que nous ayons des relations plus permanentes.
Le Parlement européen a adopté hier matin en séance plénière une résolution relative au Brexit. Cette résolution constate que la Commission a mis au point un projet de convention relatif au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, où sont prises en compte les conséquences financières, les préoccupations des citoyens européens présents au Royaume-Uni et des citoyens britanniques présents dans l'Union européenne et la question de la frontière entre la République d'Irlande et l'Ulster – de façon à ne pas mettre en cause, dans cette dernière région, la mise en oeuvre des accords dits du Vendredi saint.
M. Michel Barnier a présenté un projet d'accord de retrait le 28 février 2018 approuvé par le Parlement européen. La résolution contient des réflexions sur le type de partenariat qui pourrait s'établir entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ce n'est pas simple, car l'interlocuteur a des positions qui ne sont pas claires : sur les conditions du retrait, il n'a pas encore pris position.
Fin 2017, on a néanmoins estimé qu'on avait suffisamment avancé sur ce point pour commencer à parler des conventions réglant les relations postérieures. Le Royaume-Uni pourrait-il être maintenu dans le marché unique ? Pourrait-il bénéficier de conventions du type de celles qui ont été nouées avec la Norvège, la Suisse, l'Islande ou le Liechtenstein ? Dans toutes ces conventions, qui permettent aux partenaires de bénéficier du marché intérieur, il y a des contreparties financières.
Le retrait du Royaume-Uni privera l'Union européenne de la contribution nette de ce pays, car il fait partie des contributeurs nets. Il existe en effet deux types de pays en Europe : ceux qui contribuent plus au budget de l'Union européenne qu'ils ne reçoivent et ceux qui reçoivent plus qu'ils n'y contribuent. Alors que les premiers sont plutôt mesurés s'agissant de l'évolution du budget, les seconds sont plus allants quand il est question de relever les plafonds de dépenses.
Par ailleurs, il y a une différence entre le Parlement européen et les parlements nationaux, sur le plan budgétaire. Le Parlement européen ne vote en effet que les dépenses, non l'impôt, car il n'a pas de prérogatives en matière de recettes. Il est donc dans la main du Conseil, s'agissant des ressources. Pensant sans doute que le Parlement européen est peuplé d'hystériques de la dépense publique, chaque Conseil a enfermé le budget dans un cadre pluriannuel de sept ans qui comporte des plafonds annuels très rigides et n'autorise qu'une flexibilité très marginale. Lorsqu'une crise se produit, on est donc incapable de trouver dans le budget européen les ressources nécessaires pour y faire face. Cela oblige à créer des instruments financiers, des trust funds, des « satellites budgétaires ». Difficilement lisible, le budget prend ainsi une allure de galaxie.
Le Royaume-Uni participe à tous ces financements. Nous avons vécu un moment d'incertitude, puisqu'il doit sortir de l'Union européenne le 29 mars 2019. Cette perspective mettait en péril le budget 2019 avant même qu'on évoque le prochain CFP qui commencera le 1er janvier 2021. Mais, dans les esquisses d'accord en cours, le Royaume-Uni accepterait de contribuer au budget, à titre transitoire, sur la base de ses engagements actuels en 2019 et en 2020. Ces deux budgets annuels ne seront donc pas remis en cause.
Le problème financier causé par le retrait britannique se pose ainsi à partir du 1er janvier 2021. Il manquera dans les caisses entre douze et quatorze milliards d'euros. Or, nous n'avons pas l'équivalent en recettes. Mais je fais l'hypothèse que le Royaume-Uni finira pas accepter des conventions s'inspirant au moins en partie de celles passées avec la Suisse ou la Norvège. En ce cas, des ressources de plusieurs milliards d'euros seront forcément disponibles. La Norvège et la Suisse versent en effet respectivement à l'Union européenne une contribution équivalant à 174 euros et à 77 euros par habitant. Si le Royaume-Uni versait 100 euros par habitant, sa contribution s'élèverait à six milliards. Cela atténuerait le choc de la perte…
Sur le CFP, le Parlement européen est à l'oeuvre. Vous l'avez rappelé, Jan Olbrycht, élu du parti populaire européen (PPE) en Pologne, et Isabelle Thomas ont présenté un rapport d'initiative, qui a été adopté en plénière. Il propose de relever à 1,3 % du produit intérieur brut (PIB) la contribution des États membres au budget de l'Union européenne, contre 1 % aujourd'hui. Cela permettrait de maintenir les crédits de la politique agricole commune (PAC) et des fonds de cohésion, tout en autorisant une augmentation d'autres programmes, notamment un triplement des crédits du programme Erasmus, pour lequel les demandes en partie insatisfaites sont aujourd'hui nombreuses. La Commission européenne fera connaître le 2 mai 2018 sa position, avant que le Conseil ne fasse de même.
Le processus aboutira-t-il avant les prochaines élections européennes ? Cela pose un problème démocratique. Les électeurs européens comprendront-ils qu'ils élisent des représentants alors que le budget européen est déjà fixé jusqu'en 2027 ? En outre, une progression jusqu'à 1,3 % du PIB est intéressante, mais, en 2027, je ne suis pas sûr qu'un budget de cette taille permette à l'Union européenne de faire face aux défis de la mondialisation et de s'affirmer comme la puissance que certains appellent de leurs voeux.
En tout état de cause, le CFP doit prendre en compte la moins-value résultant du départ du Royaume-Uni, soit un montant oscillant entre 10 et 14 milliards, mais également de nouveaux enjeux, tels que les migrations, une avancée dans la défense, une avancée dans l'économie numérique, les dispositions à prendre en faveur du climat, pour tirer les conséquences de la COP21, ou encore la prévention du terrorisme mondialisé.
L'Europe ne pourra pas rester en marge de ces enjeux. Or, il est manifeste que les États, à l'échelon national, n'ont plus tout à fait les moyens d'assumer seuls la plénitude de leurs prérogatives de souveraineté. C'est pourquoi je veux croire que les États membres mettront à disposition du budget européen des montants équivalents à ce qu'il leur en coûte d'exercer encore telle ou telle de ces compétences.
Nous ferions alors la démonstration que le budget de l'Union européenne relevé au-delà de 1,3 % n'est pas synonyme d'une hausse des dépenses publiques en Europe, car une baisse des dépenses adviendrait à due concurrence au niveau national. L'Europe montrerait ainsi qu'elle a une valeur ajoutée dans l'exercice de ces biens communs européens, biens communs qui ne peuvent plus être totalement assurés à l'échelon national.
J'en viens à la question de la dette du Royaume-Uni. Après plus de quarante ans de vie commune, un patrimoine commun s'est constitué. Il faut chiffrer les dettes et les engagements, y compris les engagements latents, le passif potentiel. Toutes ces questions sont actuellement étudiées.
J'appelle votre attention sur le fait qu'il y a toujours un décalage entre l'engagement des programmes et leur réalisation, c'est-à-dire la liquidation des dépenses correspondantes et leur paiement. En ce moment, il y a environ 200 milliards de restes à liquider, pour des opérations sur lesquelles l'Europe s'est engagée, sans que les bénéficiaires aient encore concrétisé. Au 31 décembre 2021, ce montant oscillera entre 200 et 250 milliards.
Je pense qu'un accord sera trouvé avec le Royaume-Uni pour étaler dans le temps, au fur et à mesure des décaissements, les factures correspondant à la contribution du Royaume-Uni. Au total, on peut considérer qu'il participera à hauteur de 40 ou 50 milliards. Il y a également le problème des retraites et pensions des fonctionnaires et parlementaires européens de nationalité britannique. Ces questions devront être réglées sur la base de données factuelles, sous l'autorité de la Cour des comptes européenne et des auditeurs que reconnaîtront les autorités britanniques.
Je vous remercie de m'avoir convié à votre table ronde, à ce moment crucial de la préparation du prochain CFP, qui doit prendre en compte les conséquences du retrait britannique.
Permettez-moi un rappel du processus de discussion et de réflexion lancé à ce sujet par la Commission européenne. Il a commencé avec le Livre blanc : en juin 2017, dans un document de réflexion sur l'avenir des finances de l'Union, la Commission a présenté quelques orientations de principe.
Premièrement, l'Union doit se concentrer sur la valeur ajoutée européenne par rapport à des investissements nationaux. Deuxièmement, il faut réorienter les dépenses et, partant, la structure du budget européen. Troisièmement, une flexibilité budgétaire accrue doit permettre de mieux répondre aux crises éventuelles, point évoqué par le président Arthuis et sur lequel nous avons dû jusqu'ici faire preuve de beaucoup d'imagination. Quatrièmement, la gouvernance économique et la cohésion de l'Union doivent être renforcées, en articulant les investissements financés par le budget européen avec le processus du semestre européen relatif à la gouvernance macro-économique ; à cet égard, de nouveaux outils doivent être créés pour donner aux États membres des incitations à réformer. Cinquièmement, il faut simplifier davantage la mise en oeuvre des politiques européennes en regroupant les instruments de dépenses et d'intervention.
Au total, il faudra trouver un équilibre entre les différentes politiques, pour que le nouveau CFP reçoive l'aval de tous les États membres, qui se prononcent en effet à l'unanimité, ainsi que du Parlement européen.
S'agissant du calendrier, le commissaire Oettinger, en charge du budget, pousse pour qu'un accord intervienne avant les prochaines élections européennes, qui coïncide plus ou moins avec le retrait du Royaume-Uni. Cela montrerait que l'Union européenne est capable d'agir à 27, tout comme cela laisserait le temps nécessaire pour préparer de nouveaux programmes, comme ceux du fonds social européen ou des fonds de cohésion de la politique régionale européenne.
Car nous payons encore aujourd'hui, dans la mise en oeuvre de ces programmes, le retard avec lequel l'actuel CFP fut approuvé, à la fin de 2013. En 2018, nous ne sommes même pas encore en régime de croisière, alors que les besoins sont criants.
Je préciserai maintenant en quelques mots les termes de l'accord provisoire avec le Royaume-Uni, qui pourrait avoir des conséquences sur le futur CFP. Devons-nous prendre comme hypothèse de travail l'accord de décembre ? Il contient en tout cas cinq éléments du point de vue financier.
Premier élément, pour la période qui s'étend de fin mars 2019 à fin décembre 2020, le Royaume-Uni participera aux dépenses et aux bénéfices du CFP actuel comme s'il était encore membre de l'Union européenne, c'est-à-dire en respectant les procédures communautaires sous le contrôle de la Cour des comptes de l'Union.
Deuxième élément, il contribuera aux prêts à long terme de la Banque européenne d'investissement (BEI) et du Fonds européen pour les investissements stratégiques, encore appelé « Fonds Juncker », jusqu'à la date d'entrée en vigueur du retrait, soit le 30 mars 2019, date qui servira de base pour calculer et définir les droits et obligations du Royaume Uni, à savoir sa participation aux garanties de prêts et au passif éventuel de toutes les opérations engagées jusqu'à sa sortie, mais aussi aux éventuels retours et profits de ces opérations jusqu'à leur amortissement ; ensuite, sur une période de douze ans, le capital versé par le Royaume-Uni à la BEI lui sera rendu.
Troisièmement, le Royaume-Uni, qui contribuera au budget en 2019 et en 2020, restera aussi redevable de sa part du reste à liquider accumulé jusqu'à sa date de sortie de l'Union européenne : les paiements seront effectués au fur et à mesure des dépenses effectivement encourues.
Quatrième élément, pendant la période transitoire, le Royaume-Uni continuera de payer sa quote-part des engagements comme s'il était encore État membre. Cette quote-part sera calculée en fonction de la quote-part des ressources propres versées par les autres États membres. C'est la moyenne de ces quotes-parts sur la période 2014-2020 qui sera utilisée.
Enfin, le Royaume-Uni continuera de participer à des instruments hors budget, comme le Fonds européen de développement (FED), qui existe sous la forme d'un accord intergouvernemental depuis des décennies. Le Royaume-Uni restera redevable de sa quote-part à ce fonds. Il en ira de même pour la facilité financière accordée en faveur des réfugiés en Turquie, constituée par une contribution de l'Union européenne et des États membres. Il en ira aussi de même de sa participation à l'Agence européenne de défense.
Voilà les éléments factuels sur la base desquels sera réglé le volet financier du règlement de la sortie du Royaume-Uni.
M. Thomas Ossowski, représentant spécial du ministère des affaires étrangères allemand pour le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne et directeur pour les politiques de l'Union européenne. Je vous remercie de me permettre de vous présenter aujourd'hui le point de vue de Berlin sur cette situation cruciale pour l'Europe. Comme cela a été dit, le départ du Royaume-Uni est en effet le départ d'un important contributeur net de l'Union européenne.
En parallèle, les mouvements migratoires, les relations entre l'Union européenne et la crise économique et financière posent autant de défis à l'Europe. Cette situation réclame de l'Union européenne une réponse crédible.
Pour l'Allemagne, l'intégration européenne relève de la raison d'État. Elle constitue l'un des piliers de notre politique étrangère. Depuis hier, l'Allemagne a un nouveau gouvernement, dont l'existence repose sur un accord de coalition contenant des positions pro-européennes. Vous pouvez donc compter sur elle pour relever les défis qui se posent à l'Europe.
Elle est l'un des plus importants contributeurs au budget de l'Union européenne. En termes absolus, elle est même le plus important puisque sa contribution nette au budget de l'Union s'élève, en 2018, à 31 milliards d'euros. Avec le départ du Royaume-Uni, sa part de financement de l'Union passera mécaniquement de 21 % à 25 %, soit, en prix courants, de 31 à 40 milliards en 2021, dans l'hypothèse où les contributions des États membres continuent de représenter 1 % du produit intérieur brut.
C'est donc une question qui fait partie du débat public comme du débat politique en Allemagne. Il ressort de l'un comme de l'autre que tant l'opinion publique que le monde politique sont disposés à ce que l'Allemagne assume sa part du budget européen à l'avenir.
À la lumière du départ du Royaume-Uni, il apparaît nécessaire de moderniser le budget européen. C'est même, à notre sens, une nécessité très urgente. On ne peut continuer avec des discussions de marchands de tapis ; il faut réfléchir à une modernisation, à une flexibilisation et, dans une certaine mesure, à une conditionnalisation du budget européen, pour qu'il soit en mesure de garantir l'avenir de l'Union.
Le budget européen doit donc faire ressortir la valeur ajoutée que l'Union apporte en termes de biens publics européens. Car la protection de la frontière extérieure en Grèce, en Bulgarie et en Italie est un bien public de tous les Européens, puisqu'elle profite aussi aux États nordiques, à l'Allemagne ou à la France. Nous devons donc réfléchir aux moyens de financer les biens publics européens.
S'agissant des objectifs généraux, la déclaration de Rome de 2017 nous montre le chemin vers l'avenir : l'Europe aura une valeur ajoutée si elle est une Europe qui protège – comme l'a dit votre président –, qui a une dimension sociale, et qui joue un certain rôle dans le monde.
Que devons-nous faire pour donner à l'Union européenne les outils pour remplir ces missions ? Les dépenses traditionnelles de l'Union européenne se concentrent sur la PAC et les fonds de cohésion. Il convient de mener une réflexion sérieuse sur la modernisation de ces différentes politiques. Par exemple, la PAC doit répondre aux défis du changement climatique et de la protection de l'environnement.
Les fonds de cohésion doivent servir à égaliser les conditions de vie, mais aussi à fournir aux collectivités territoriales le moyen de faire ressortir la valeur ajoutée de l'Union européenne. Par exemple, beaucoup de collectivités se sont engagées pour gérer les conséquences des flux migratoires. Les fonds européens devraient pouvoir les soutenir dans cette entreprise, en finançant un recours accru à leurs hôpitaux et à leurs systèmes d'enseignement.
En même temps, les fonds structurels devraient être utilisés de manière plus ciblée que par le passé. Tous les États membres sont confrontés aux changements démographique et numérique, comme au défi climatique. L'Union européenne doit accompagner ces changements que nos sociétés connaissent. Nous y voyons sa valeur ajoutée.
La question de la solidarité au sein de l'Union est souvent soulevée au niveau politique, en particulier en lien avec les flux migratoires. Nous considérons pour notre part que la solidarité est une voie à double sens et que l'Europe doit être un cadre de solidarité mutuelle.
Le futur CFP doit enfin permettre à l'Union européenne de renforcer sa place dans le monde, en lui donnant les moyens de gérer les missions qu'il lui incombe.
Voilà les quelques principes et axes d'action qui guideront Berlin dans son approche du prochain CFP. Nous attendons le projet de la Commission, qui doit paraître à la mi-mai. Puisse-t-il être à la hauteur des défis qui se présentent à nous.
Le système des ressources propres permet de réduire la tyrannie du juste retour qui veut que chaque État membre soit tenté de comparer ce qu'il apporte au budget de l'Union européenne avec ce qu'il en retire.
En France, les assemblées adoptent chaque année, à l'occasion du débat budgétaire, un article, placé dans le projet de loi de finances juste avant l'article d'équilibre, qui indique le montant des ressources transférées au budget de l'Union européenne.
Le CFP indique pratiquement à l'euro près la part qui va revenir à chaque État membre au titre de la politique agricole commune et des fonds de cohésion. Chaque État compare alors ce qu'il apporte avec ce qu'il reçoit. Ces chiffres alimentent un débat qui n'est pas tout à fait dans l'esprit de la solidarité européenne.
Or, les seules ressources propres aujourd'hui, alors même que les traités prévoyaient que le budget européen devait être financé par elles, sont les droits de douane. De traité de libre-échange en traité de libre-échange, ils ont cependant fondu comme neige au soleil pour ne plus représenter que 10 % des ressources budgétaires actuelles de l'Union européenne. Partant, les 90 % restants sont apportés par un petit prélèvement sur la TVA et, majoritairement, par le prélèvement sur le revenu national brut.
Le Royaume-Uni avait obtenu sur ce dernier un rabais, pour le financement duquel d'autres États membres avaient eux-mêmes obtenu un rabais… Car, en pratique, les dirigeants politiques des États membres se tournent, en fin de négociation des CFP, vers le président européen en charge de l'exercice. Chaque État membre, y compris le plus modeste, disposant pour ainsi dire d'un droit de veto, sait en jouer pour obtenir des concessions. Ainsi, les Pays-Bas et la Belgique récupèrent 25 % du produit des droits de douane qu'ils perçoivent pour le compte de l'Union européenne. Sur ce chapitre, le Parlement européen n'a, quant à lui, rien à dire.
À l'occasion du départ du Royaume-Uni et de la fin du chèque britannique, tous ces rabais disparaîtront, au profit d'une transparence et d'une clarté accrues dans la répartition des contributions des États.
Il peut y avoir de nouvelles ressources propres. Certains pensent qu'elles viendront en sus des ressources existantes, pour financer de nouvelles actions. M. Mario Monti est l'inspirateur d'une réflexion à ce sujet, puisqu'il a présidé le groupe de haut niveau constitué à cette fin, le CFP – singulièrement rogné par le Premier ministre Cameron – n'ayant été approuvé à l'automne 2013 par le Parlement européen qu'à la condition qu'un groupe soit constitué sur le sujet des ressources propres.
Placé sous la direction de M. Monti, ce groupe constitué de représentants des trois institutions que sont la Commission, le Parlement et le Conseil, a rendu publiques ses propositions au début de l'année 2017. Ce dispositif a fait l'objet d'un rapport d'initiative approuvé hier par le Parlement européen, qui l'a repris.
Se trouvent ainsi évoquées la possibilité d'établir une taxe carbone prélevée aux frontières extérieures, la possibilité d'une taxe sur les transactions financières, un financement issu de la gestion commune du prix de la tonne de carbone, un élément de TVA ou encore une part de l'impôt sur les bénéfices réalisés par les sociétés commerciales collecté par les États membres, à partir du moment où une assiette commune serait en vigueur pour cette imposition. Une taxe sur les géants de l'économie numérique tels que Google, Apple, Facebook, Amazon, encore appelée taxe GAFA, serait également envisageable – actuellement, les États européens sont en effet tellement intelligents qu'ils se concurrencent mutuellement, de sorte que ces entreprises finissent par ne pas payer d'impôt en Europe ; on ne peut que souhaiter qu'ils sortent de ce type de ruling traditionnel et se fixent enfin des règles.
Les ressources propres restent néanmoins dans la main des États membres. Ce n'est donc pas le Parlement européen qui adoptera éventuellement ces dispositions, mais les États membres qui définiront ces ressources dans leur loi de finances – si possible de la même manière ! – et les encaisseront. Dans la mesure où cela passera par les budgets nationaux, je ne suis donc pas sûr que nous puissions ainsi effacer l'effet de la tyrannie du juste retour. Mais cela réduirait du moins la dimension de ce débat.
Plus il y aura de ressources propres, moins seront importantes les contributions au titre du revenu national brut, transférées des budgets nationaux vers le budget européen. Nous devons cependant être conscients que ce n'est pas évident. S'il doit y avoir de nouvelles ressources propres du fait de la création de ces nouveaux impôts, cela passera en tout cas par un accord général, mais aussi par des dispositions adoptées par les parlements nationaux dans les projets de loi de finances. Or il n'est pas sûr que tous les États membres soient prêts à passer à l'acte rapidement ; la mise en oeuvre du mécanisme risque au contraire de prendre quelques semaines.
Il faut également faire très attention à ne pas provoquer ainsi de hausse des prélèvements obligatoires pour les citoyens européens. Ces ressources nouvelles devraient au contraire amener une réduction à due concurrence des contributions des États membres au budget de l'Union et non à un gonflement de ce dernier, concomitant à un gonflement des prélèvements obligatoires qui ne serait pas de nature à rendre l'Europe plus populaire.

Vous nous avez expliqué clairement, mais brièvement, l'impact financier du Brexit : vous avez surtout évoqué de nouvelles propositions, initiatives, perspectives ou solidarités. Doit-on comprendre que le Brexit aura pour première conséquence de permettre davantage de liberté, d'initiative et d'ambition, et que la présence britannique constituait finalement un facteur négatif pour le développement de l'Union européenne ? Par-delà les difficultés de tous ordres qu'entraîne le Brexit, sur les plans humain, financier et économique, peut-on dire qu'il s'agit d'une formidable opportunité pour relancer l'Union européenne ?

Pouvez-vous approfondir ce que vous avez dit de la possibilité d'un budget européen plus important au bénéfice de chaque État, c'est-à-dire ayant une somme positive ? Existe-t-il des études d'impact en la matière ?

Je voudrais revenir sur la contradiction potentielle entre l'importance que revêt le débat démocratique lors de la campagne pour les prochaines élections européennes, lesquelles amèneront un nouveau Parlement européen et une nouvelle Commission, et les impératifs d'efficacité et de rapidité dans la négociation, la finalisation et l'application des grands équilibres du prochain cadre financier pluriannuel.
Ayant siégé au Parlement européen entre 2010 et 2017, je me rappelle très bien le retard que nous avons connu, pour toute une série de raisons, dans l'adoption de l'actuel cadre financier pluriannuel et les conséquences qui continuent à en résulter pour l'attribution et la gestion d'un certain nombre de fonds. Je partage néanmoins les préoccupations, que je sens monter, quant au risque d'escamotage d'un véritable débat démocratique sur les enjeux budgétaires européens, les responsabilités de l'Europe face aux nouveaux défis et ce que cela implique en termes de dépenses budgétaires et de politiques communes. Les exigences de rapidité et d'efficacité ne doivent pas conduire à écraser le temps du débat et de la confrontation démocratiques dans le cadre de la prochaine campagne électorale européenne, dont nous savons qu'elle sera compliquée.
Il y a un paradoxe avec le Brexit. On a l'impression que l'Europe a été façonnée par les Britanniques – le dernier cadre financier pluriannuel a ainsi été raboté par eux. Je fais partie de ceux qui pensaient que la présence du Royaume-Uni exerçait un freinage et que les Vingt-Sept allaient trouver l'embrayage immédiatement après. Il faut reconnaître qu'il y a encore un peu d'inertie dans les mécanismes…
À titre personnel – je suis minoritaire au sein de la commission des budgets, et je me suis d'ailleurs abstenu hier, ce qui est un vrai déchirement pour un président de commission –, je veux souligner que l'on prépare un cadre financier nous engageant jusqu'en 2027 sans avoir déterminé de quelle Europe on parle et ce que nous en attendons. On voit bien que la mondialisation fait naître des menaces que les États nationaux n'ont plus les moyens de prévenir : ils ne pourront retrouver leur souveraineté qu'en assumant certaines prérogatives collectivement, au plan européen. Le vrai travail qui nous attend consiste à identifier les biens communs qui peuvent être efficacement gérés au plan national et ceux qui sont désormais européens.
Vous allez voir la montée en puissance de la question des migrations dans la campagne pour les élections européennes. On installe ici ou là des garde-côtes et des gardes-frontières européens, mais ils conservent leurs uniformes nationaux : il n'y a pas d'uniforme européen. L'Union n'est pas visible dans les contrôles aux frontières extérieures. Il faudrait peut-être prévoir des crédits pour des uniformes européens (Sourires.), mais la question est en réalité politique. L'élection qui aura lieu l'année prochaine doit être le moment d'en parler.
La mondialisation n'avait jamais eu un tel impact jusqu'à présent. On ne peut pas faire un budget business as usual, comme en 2013. C'est pourquoi je me suis abstenu hier : un budget représentant 1,3 % du PIB représente un progrès extraordinaire par rapport à 1 %, mais cela ne permettra pas de progresser beaucoup, car il faut compenser ce qui était versé par les Britanniques. Avec un tel budget, je ne vois pas comment l'Europe contrôlera effectivement ses frontières. Voilà ma préoccupation.
En réponse à Mme Hennion, je dois dire que je n'ai pas d'étude d'impact. Je me place dans la logique qui a prévalu au moment de la décentralisation : quand on a transféré les responsabilités aux départements en matière sociale et aux régions en matière économique, on a cessé d'engager des dépenses dans ces domaines au plan national et on a mis, en principe, les crédits correspondants à la disposition des départements et des régions. On pourrait peut-être s'en inspirer en matière de défense, par exemple. Quand la France adopte une loi de programmation militaire – exercice qui procure toujours beaucoup de bonheur au Parlement, mais qui n'est jamais respecté, en tout cas jusqu'à maintenant –, ne pourrait-on pas prévoir qu'une partie des crédits votés soit gérée au plan européen, en vue d'une plus grande efficacité ? Doit-on continuer à avoir 16 chars différents en Europe ? Je pense qu'il va falloir se poser assez rapidement des questions de ce genre. La logique voudrait que l'on ne dépense pas davantage de crédits publics en Europe, mais qu'une partie de ceux qui sont gérés au plan national le soient désormais au plan européen. C'est un vrai débat qu'il faudrait ouvrir.
Que se passe-t-il quand on adopte tardivement le cadre financier pluriannuel, comme en 2013 ? On doit établir à la fois le volume des crédits et les bases légales, c'est-à-dire les textes nécessaires à l'application des programmes : pour tout nouveau cadre financier pluriannuel, il faut revoir chacun d'entre eux. Leurs destinataires – les régions et les collectivités territoriales, le Fonds social européen (FSE), mais aussi les associations ou les entreprises pour les crédits du programme COSME (Competitiveness of enterprises and small and medium-sized entreprises, soit Compétitivité des entreprises et des PME) – doivent alors se familiariser avec les nouveaux textes. La dernière fois, le vote a eu lieu à l'automne 2013 pour un démarrage au 1er janvier 2014, mais il ne s'est rien passé la première année. Le président de la nouvelle Commission avait beau déclarer que l'Europe souffrait d'un déficit d'investissement, l'instrument correspondant n'a pas été utilisé dans un premier temps. D'ailleurs, cela arrangeait bien la Commission, car il y avait de très nombreuses factures impayées datant de la période précédente. Pendant les deux ou trois premières années, on n'a rien engagé et on a pu éponger les dettes. Cela signifie que si l'on démarre sur les chapeaux de roue au 1er janvier 2021, ce qui est souhaitable, je ne sais pas comment on fera pour payer : tout va arriver massivement en 2019 et 2020. Pour éviter l'inertie, néanmoins, il faudrait se prononcer suffisamment tôt.
Il faudra du temps au nouveau Parlement et à la nouvelle Commission pour s'installer : les commissaires ne seront pas opérationnels dès le deuxième semestre 2019. Il ne restera alors qu'une année avant le 1er janvier 2021. On pourrait peut-être convenir qu'un certain nombre de programmes nécessitent de la prévisibilité, comme la politique agricole commune, les fonds de cohésion et plus particulièrement encore l'accueil des réfugiés, la formation professionnelle et l'apprentissage, ce qui implique de se décider suffisamment tôt. Mais on pourrait aussi prévoir une marge de manoeuvre, sous la forme d'une révision au lendemain des élections. Imaginez qu'il y ait une poussée électorale en faveur de prérogatives nouvelles pour l'Europe, lui permettant enfin d'assumer ses responsabilités, ne serait-ce que sur la question des migrations : une révision devrait alors être possible. Va-t-on expliquer aux électeurs que le budget a déjà été voté, il y a quelques mois, et que l'on aura pour seule mission de vérifier qu'il est bien respecté ? On voit bien que cela n'est pas satisfaisant. Il y a un manque de flexibilité et de légitimité démocratique.
Je le pense. On en reste au rituel business as usual, mais ce n'est pas en reproduisant tout à l'identique que l'Europe va s'en sortir. Néanmoins, je m'exprime à titre très personnel et non en tant que président de la commission des budgets.
Il est certain que le Royaume Uni a été un partenaire difficile au sein de l'Union européenne, mais c'était aussi un allié, notamment pour les questions de libre-échange – la voix britannique est importante dans ce domaine – et pour la politique étrangère commune – le Royaume Uni est notamment un partenaire indispensable pour la politique des sanctions, qui a pris une certaine importance à l'égard de pays tels que la Russie, la Syrie ou encore la Corée du Nord. Nous perdons un partenaire très important, et nous le regrettons. Quand un club perd un membre, que ce soit le Royaume Uni ou un autre pays, cela montre par ailleurs qu'il est en crise : s'il est déserté, il ne doit pas être très attrayant. Il faut ouvrir les yeux : on doit renouveler l'Europe afin qu'elle reste un projet attractif et que d'autres États membres n'aient pas l'idée, dans les années à venir, qu'il est préférable de quitter l'Union. Nous vivons vraiment un moment crucial dans l'histoire de l'intégration européenne.
Le budget doit bien sûr contribuer aux États membres et il faut que cela se voie au niveau des collectivités territoriales. En Allemagne aussi, il est important qu'un agriculteur de la Forêt-Noire puisse voir que l'Union européenne est un avantage pour lui. On ne doit pas seulement en être convaincu dans les capitales : cela doit être perceptible par les citoyens, qui élisent les Parlements nationaux et le Parlement européen. À nos yeux, les politiques traditionnelles de l'Union européenne, comme la politique structurelle, celle de cohésion et la PAC, restent donc des éléments très importants pour l'entreprise européenne, même si nous devons moderniser ces politiques et prévoir des moyens pour répondre aux nouveaux défis.
Je m'associe à ce qui vient d'être dit sur la sortie du Royaume-Uni : on ne peut pas s'en réjouir. C'est une perte, mais la crise est souvent une opportunité à saisir. Les rabais et les rabais sur les rabais ont pour origine le Royaume-Uni. La donne change, ce qui permet de rouvrir des discussions bloquées jusque-là, en l'absence de date d'expiration pour ces dispositifs. Par ailleurs, le lien entre le rabais et certaines politiques de l'Union est remis en question. C'est l'occasion de créer une structure budgétaire davantage tournée vers les défis et les nouveaux équilibres tels qu'on peut les concevoir aujourd'hui.
Il y a aussi un effet budgétaire presque mécanique sur le plan quantitatif. Le Royaume-Uni étant un pays relativement développé, sa contribution au titre du revenu national brut (RNB) est importante. Le manque à gagner conduit à revoir les équilibres au sein du budget européen. En raisonnant à 27 États membres, les dépenses budgétaires actuelles ne représentent plus 1,03 % mais 1,13 %. du RNB. Si l'on veut que les politiques de cohésion sociale, économique et territoriale et la PAC se poursuivent à 27, tout en développant d'autres politiques, il sera difficile d'éviter un niveau de contribution plus élevé qu'aujourd'hui, qu'il y ait ou non de nouvelles ressources.
Y a-t-il des évaluations de l'impact du budget européen ? Pour le calcul annuel des soldes nets, qui est la conséquence du rabais britannique, il a fallu appliquer une méthode comptable : on compare les versements à l'Union européenne et les retours estimés. C'est une méthode qui peut faire l'objet de beaucoup de critiques au plan méthodologique. Les bénéfices sont en réalité bien supérieurs, en particulier dans le cadre du marché intérieur. On aide en effet des pays moins développés dont les marchés sont ouverts aux industries françaises, allemandes ou encore italiennes, ce qui permet à ces dernières de se développer. Les aides apportées à certains pays ont ainsi des retombées ailleurs. La gestion des flux migratoires avec l'assistance de la Grèce – pour gérer les entrées –, ou avec la Turquie, a aussi un impact qui n'est pas facile à quantifier en termes monétaires dans l'ensemble des États membres, en particulier sous l'angle de la capacité d'accueil de ceux qui entrent de manière régulière au sein de l'Union européenne. Il en est de même du changement climatique : quand on arrive à instaurer des politiques de réduction des gaz à effet de serre, ce n'est pas un seul pays qui en bénéficie, mais l'ensemble de l'Union.
Je voudrais rappeler que la Commission a oeuvré pour le débat démocratique depuis le lancement du Livre blanc sur l'avenir de l'Europe : des discussions ont eu lieu dans les assemblées parlementaires de tous les États membres, les commissaires s'y sont investis, et il y a eu des dialogues citoyens et des conférences. Si un accord politique intervient en 2019, cela fera deux ans de débat démocratique. En ce qui concerne le précédent cadre financier, la proposition de la Commission a été faite en juin 2011, mais peu de choses se sont passées la première année : la discussion s'est finalement concentrée sur les six ou neuf derniers mois. Deux années entre le lancement du débat et un éventuel accord suffisent-elles ? On peut en débattre, mais je ne crois pas que l'on puisse conclure que cela ne permet pas un débat démocratique.
On a quand même l'impression à Bruxelles d'avoir mené un débat souvent un peu virtuel. On a bonne conscience car on a fait le tour des popotes, si je puis dire, mais on n'a pas eu de débat avec le peuple. Il n'y a pas d'opinion publique européenne et quel est le message que l'Europe délivre aux citoyens ? Vous avez été députée européenne, madame Le Grip : par rapport aux Parlements nationaux, vous savez que l'on a parfois l'impression de se trouver dans un purgatoire médiatique.
On est un peu dans une bulle à Bruxelles. Il va falloir aller à la rencontre des citoyens à un moment donné, en mettant ces questions sur la table.
Pour bien faire, il faudrait des conventions citoyennes.

Il y aura des initiatives. Une « grande marche européenne » va être lancée, et il sera intéressant d'en regarder les résultats.

Je voudrais revenir sur les rabais dont bénéficient le Royaume-Uni, mais aussi d'autres pays tels que l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas et la Suède. À la suite du départ du Royaume-Uni, pensez-vous que les pays concernés accepteront aisément la disparition de ces mécanismes ?
M. Arthuis a évoqué de nouvelles ressources propres et il a mentionné à ce titre plusieurs pistes de taxes, mais pas celle qui concerne les plastiques – elle pourrait compenser la perte de la contribution britannique.
Le 21 février dernier, le gouvernement britannique a publié un document selon lequel la durée de la période transitoire devrait être simplement déterminée par le temps nécessaire à la préparation et à la mise en application des nouvelles dispositions régissant le partenariat avec l'Union européenne. Ne pensez-vous pas qu'une éventuelle prolongation de la période transitoire pourrait avoir des conséquences sur l'adoption du budget européen et du prochain cadre financier pluriannuel ?
Oui, c'est possible. Et nous n'avons pas évoqué l'hypothèse où il n'y aurait pas d'accord… Je rappelle que le Parlement ne peut que dire « oui » ou « non » et que le Conseil se prononce à l'unanimité. On devrait boucler les discussions fin octobre prochain, mais on est dans le vide s'il n'y a pas d'accord à cette date, et les Britanniques pourraient être tentés de marchander quelque chose. Jusqu'à la fin du mois de mars de l'année prochaine, ils sont toujours au Conseil. Il faut donc se montrer extrêmement vigilant.
On doit garder des relations de partenariat avec les Britanniques, notamment en matière militaire et diplomatique. On a toujours dit qu'il y aurait no punishment. En ce qui concerne l'Horizon 2020, les centres de recherche britanniques perçoivent 25 % des crédits – je m'exprime sous le contrôle de M. Presa.
Je dirais plutôt 16 %.
Je croyais que c'était davantage… Ils perçoivent en tout cas une partie très importante : le Royaume-Uni a des laboratoires très performants. Quant à Erasmus, on ne va pas rompre complètement les liens. Beaucoup de jeunes veulent étudier au Royaume-Uni pour des raisons faciles à imaginer, notamment pour parfaire leur anglais. Il va falloir mettre au point des conventions qui donneront certainement lieu à des contreparties financières. M. Presa a évoqué tout à l'heure l'importance du marché unique : les Norvégiens acceptent de payer pour en faire partie. À la place, les Britanniques disent qu'ils voudraient signer un traité de libre-échange, comme on l'a fait avec le Canada ou d'autres pays, car ce sera gratuit. J'espère que ce sont des éléments de langage pour faire pression dans la négociation : sinon, il faudra renégocier tous les accords commerciaux, ce qui est une perspective terrifiante pour les Britanniques.
J'ai l'impression que l'Europe leur a rendu service. Le fait de contester sans cesse l'Union européenne était une façon de donner un sens à leur engagement politique. On a le sentiment que les Britanniques sont pris de vertige le jour où ils sortent de l'Union européenne : le Royaume Uni n'arrive pas à nous dire s'il est prêt à conclure.
Le Conseil va sans doute adopter le projet de convention de retrait qui a été préparé avec la Commission, en accord avec le Parlement, et il faut noter que les Vingt-Sept sont très unis, alors que l'on aurait pu craindre que les Britanniques jouent les uns contre les autres, avec leur habileté diplomatique habituelle. On a vraiment l'impression qu'il y a une unité et que l'Europe se rassemble bien. Louons les Britanniques qui nous donnent l'occasion de vérifier notre solidarité très forte…
Pour le reste, il y a quand même un certain nombre d'incertitudes. Il est terrible de consacrer tout ce temps et toute cette énergie au Brexit : quand on s'occupe de cette question, on ne travaille pas à l'avenir de l'Union européenne. Il faudrait avancer dans la négociation du Brexit avec méthode et beaucoup d'engagement sans que cela inhibe le débat, nécessaire, sur l'avenir de l'Union européenne.
La taxe sur le plastique est sûrement une très bonne idée. Vous dites que cela représenterait une ressource supplémentaire, mais il faudra bien que quelqu'un paie cette taxe et ce seront les consommateurs : tous les impôts, quels qu'ils soient, finissent par être à leur charge. Soyons donc très prudents en ce qui concerne les nouvelles ressources propres : globalement, cela signifiera davantage de prélèvements obligatoires. Néanmoins, c'est certainement une très bonne taxe. Un certain nombre de pays qui servent de lieux de stockage sont en train de renvoyer nos plastiques.

Cela pourrait avoir une vertu en termes de réduction des déchets, qui ont un coût pour la collectivité.
L'Europe se préoccupe de l'économie circulaire. Des directives existent dans ce domaine.
Il y a une réflexion sur la stratégie et les politiques à adopter à l'égard des matières plastiques : une taxe à la consommation n'est pas le seul moyen d'atteindre l'objectif, qui est de contribuer au recyclage et au développement d'une industrie compétitive. Les recommandations du groupe à haut niveau présidé par M. Monti ont fait référence à une ressource propre, par exemple une taxe, mais pas seulement, qui participerait à la réalisation des objectifs de la politique environnementale. Comme la Commission l'a souligné, c'est une possibilité.
Cela suppose de revoir complètement la nomenclature du budget de l'Union européenne en adoptant une présentation des dépenses selon les objectifs et les grandes causes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui – le budget est complètement illisible pour les contribuables européens. Cela leur permettrait de voir que s'ils paient une taxe sur les plastiques cela peut contribuer à une action efficace pour protéger l'environnement et le climat.

Le Commissaire européen en charge du budget a récemment prévenu qu'il faudra des coupes impressionnantes dans certains programmes après le départ du Royaume-Uni. Le président de la Commission européenne a, quant à lui, fait part de son opposition à des coupes sanglantes, notamment dans les politiques de cohésion, qui soutiennent les régions les plus pauvres, et les fonds agricoles. Dans quels domaines les coupes auront-elles lieu ?
Nous attendons avec fébrilité les propositions de la Commission. Le commissaire que vous citez a déclaré qu'il faudrait raboter un peu et demander de l'argent frais aux États membres, selon des dosages subtils qui relèvent de l'expertise de la Commission. Il y aura probablement un peu des deux. Quelques pays, dont l'Allemagne et la France, sont prêts à mettre la main à la poche, mais il y a parfois un écart entre le discours politique et sa traduction concrète. Tout se déroule au sein du Coreper, le comité des représentants permanents : il m'arrive de penser que le pouvoir est entre les mains des diplomates et que les politiques auraient intérêt à dire plus clairement au Coreper ce qu'ils attendent dans certains cas. On observe parfois des contradictions – je pense à des conciliations budgétaires un peu difficiles.
J'entends des voix politiques s'élever pour dire qu'il n'est pas question de toucher à la PAC. Il faut bien voir que ce n'est pas seulement une affaire de crédits : cette politique vise à assurer la sécurité et la souveraineté alimentaires. On doit assurer des revenus satisfaisants aux agriculteurs, mais il ne sert à rien de verser des subventions à certains éleveurs de bovins si l'on signe en même temps avec le Mercosur, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, de nouveaux accords commerciaux qui les mettent en difficulté. Il serait bon de mettre en cohérence les crédits budgétaires de la PAC avec la politique commerciale et les règles de la concurrence : si l'on n'empêchait pas les regroupements face à des industriels qui, eux, sont très concentrés ou à des distributeurs qui se trouvent bien souvent dans une situation d'abus de position dominante, cela permettrait de rééquilibrer les prix. La PAC devrait tenir compte de ces différentes dimensions au lieu d'en rester à une simple perspective financière. Par ailleurs, il faut certainement revoir les crédits de cette politique : si l'on veut supprimer les glyphosates, la recherche doit mettre au point les produits de substitution, et l'on pourrait utiliser les crédits de la PAC pour y parvenir. Les agriculteurs sont aujourd'hui suffisamment au fait des attentes sociétales en ce qui concerne l'environnement et les territoires pour convenir que la PAC est, au fond, une convention conclue avec les citoyens européens à propos d'un bien commun.
Au Parlement européen, on a tendance à penser que l'on ne doit pas toucher au volume de la PAC, pas plus qu'à celui des fonds de cohésion, et qu'il faudra trouver de l'argent frais pour combler le trou résultant du Brexit et financer de nouvelles actions, par exemple si l'on veut créer un fonds pour la défense qui soit autre chose qu'un élément de langage destiné à la communication institutionnelle. De même, si l'on veut une action forte aux frontières, on doit permettre à Frontex d'avoir des aéronefs, des bateaux et des garde-côtes, et il faut du personnel présent aux frontières afin de contrôler les flux migratoires – ce n'est pas au moyen d'incantations que l'on y arrivera. Nous sommes dans une période où l'Europe doit changer de rythme et de voilure, sans augmenter pour autant la dépense publique en Europe ni, si possible, les prélèvements obligatoires.

Un mot de la cohésion des États membres, qui a été évoquée tout à l'heure : cela correspond à la réalité, car le Royaume Uni n'a pas réussi à enfoncer un coin pour négocier séparément avec certains États. Néanmoins, on observe une montée des populismes. Dans les pays où des partis extrêmes sont arrivés au pouvoir, seuls ou dans le cadre de coalitions, quel est l'état d'esprit pour le vote du budget, sachant qu'il y aura aussi un impact lors des prochaines élections européennes ?
M. Presa a évoqué la conditionnalité. L'Europe ne se résume pas à un budget et à des directives, c'est aussi une charte de valeurs fondamentales. Tout État entrant dans l'Union européenne y souscrit. Ceux qui s'en écartent peuvent-ils prétendre aux mêmes avantages financiers que les autres ? En sept ans, la Pologne a dû percevoir environ 75 milliards d'euros nets, et la Hongrie une vingtaine ou une trentaine. Il faudra clarifier la situation à un moment donné. On dit qu'il faut punir les gouvernements, mais pas les peuples, ce qui est une façon de ne rien faire, en réalité. Il va falloir que l'on trouve le moyen de faire respecter les valeurs fondamentales.
Le risque est qu'un fossé se creuse entre l'Europe de l'Ouest et celle de l'Est. C'est une vraie question : les salaires ne progressent pas dans les pays de l'Europe de l'Est, alors qu'ils connaissent le plein-emploi et qu'ils acceptent bien souvent des travailleurs venant d'au-delà des frontières extérieures de l'Europe – de Biélorussie ou d'Ukraine, par exemple. Il va falloir que l'Europe clarifie sa vision et sa politique.
On est un peu confronté à la quadrature du cercle : comment faire progresser le budget sans augmenter la contribution des États, comment demander plus à l'impôt et moins aux contribuables ? Ce n'est pas facile tous les jours… (Sourires.)
Il est important d'avoir plus fréquemment des échanges entre les parlementaires nationaux et européens. Je ne suis pas sûr que l'on ait toujours une vision claire de ces questions : il y a tous les satellites budgétaires dont j'ai parlé et l'on va mettre dans le budget des éléments concernant la zone euro – je ne sais pas à quoi ça va ressembler ni comment ce sera financé.
À titre d'exemple, il existe un mécanisme européen de stabilisation financière pour mutualiser le surendettement de la Grèce et de quelques autres États, qui va peut-être se transformer en fonds monétaire européen : ses fonds propres, auxquels la France a participé, comme l'Allemagne et tous les autres pays de la zone euro, s'élèvent à 80 milliards d'euros, et l'on a donné des garanties allant jusqu'à 600 ou 700 milliards. Ce mécanisme est bien géré, car un Allemand est à sa tête (Sourires.), mais il n'est contrôlé ni par le Parlement européen ni par les Parlements nationaux.
Tous ces satellites budgétaires échappent au contrôle parlementaire et bafouent un principal fondamental qui est celui de l'unité budgétaire. Quand vous examinez le budget européen, je ne sais pas si vous avez clairement à l'esprit quels montants vont au Trust Fund pour la Syrie, à celui pour l'Afrique ou à la facilité budgétaire pour la Turquie : tout cela devient extrêmement compliqué. Je pense que l'on doit saisir l'occasion qui se présente à nous de revenir à l'unité budgétaire et d'assurer la lisibilité du budget européen.

Merci à tous pour vos interventions enrichissantes. Je suis d'accord avec vous quant à la nécessité de renforcer les liens avec le Parlement européen, et j'espère que nous pourrons continuer à avoir de tels échanges – dans le cadre de la mission Brexit et au-delà – notamment à propos des traités commerciaux, sur lesquels nous nous interrogeons beaucoup en France.
La séance est levée à 17 h 30.
Membres présents ou excusés
Présents. - M. Bertrand Bouyx, M. Alexis Corbière, Mme Christelle Dubos, M. Éric Girardin, Mme Christine Hennion, Mme Marie Lebec, Mme Constance Le Grip, M. Jacques Marilossian, M. Jean-Pierre Pont, Mme Liliana Tanguy
Excusés. - M. Paul Christophe, M. Alain David, M. François de Rugy, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Marietta Karamanli, M. Vincent Rolland, Mme Marielle de Sarnez, Mme Sabine Thillaye