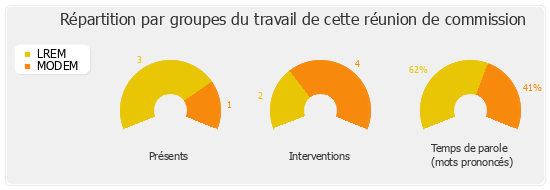Commission d'enquête sur l'évaluation des politiques publiques de santé environnementale
Réunion du mercredi 14 octobre 2020 à 14h00
La réunion
L'audition débute à quatorze heures.

Nous recevons M. Thierry Caquet, directeur scientifique « environnement » de l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE).
Vous êtes titulaire d'un doctorat d'écologie générale. Chargé puis directeur de recherche à l'institut national de la recherche agronomique (INRA), après avoir été, durant plusieurs années, maître de conférences à l'université de Paris Sud, vos fonctions à l'INRA vous ont conduit à diriger le département « écologie des forêts, prairies et milieux aquatiques », le méta-programme « adaptation de l'agriculture et de la forêt au changement climatique » avant de devenir le directeur scientifique « environnement » de cet institut, devenu INRAE, après sa fusion avec l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA).
Vous appartenez au comité de pilotage scientifique de l'alliance nationale de recherche pour l'environnement (AllEnvi), au conseil d'administration de la fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) ainsi qu'au conseil scientifique de l'agence française devenue l'Office français de la biodiversité.
Les travaux réalisés ou coordonnés par l'INRA/INRAE portent en particulier sur l'agriculture, l'alimentation, la forêt, l'environnement, l'eau et la biodiversité. L'institut vient également en appui des politiques publiques à titre d'expert scientifique et technologique. La prise en compte de la biodiversité dans la prévention et la lutte contre les maladies, la prise en compte des risques sanitaires impliquant la faune et la flore sont des thèmes d'intérêt d'une démarche de santé environnementale qui expliquent votre audition.
(M. Thierry Caquet prête serment.)
Le domaine de la santé environnementale est un vaste domaine dont je n'ai pas la prétention de faire le tour en dix minutes.
L'INRAE est né récemment. La fusion de l'INRA et de l'IRSTEA est effective depuis le 1er janvier 2020. C'est un institut jeune, mais riche de l'ancienneté de ses deux « composantes parentales ».
Nous sommes un organisme public de recherche finalisée et nous avons l'ambition de servir l'intérêt général, en nous appuyant sur la génération de nouvelles connaissances scientifiques académiques, mais aussi sur des recherches appliquées qui appellent l'attention de certains secteurs de la société et de certains de nos concitoyens.
Nous avons le souci de l'impact de nos recherches, et cela de différentes façons. En ce qui concerne l'impact scientifique, nous collaborons avec les meilleures équipes des domaines qui nous intéressent, au niveau national et international, ainsi qu'avec des partenaires publics, des partenaires socio-économiques et, de plus en plus, des citoyens. La société a une très forte attente et, en miroir, nos chercheurs souhaitent travailler davantage avec elle sur certains sujets. C'est la science ouverte ou la science citoyenne. Nous accompagnons ce mouvement de fond. Nous sommes aussi toujours soucieux d'innovation, de transfert de nos connaissances vers les utilisateurs.
Notre établissement couvre un champ très large de disciplines scientifiques : les sciences de la biologie, dont l'agronomie qui est l'élément fondateur de l'INRA/IRSTEA, mais aussi les sciences de la Terre, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques, les sciences de la santé. Nous avons aussi des compétences très fortes, souvent méconnues, en sciences humaines et sociales. Pour les sujets de santé-environnement, nous ne pouvons pas concevoir des approches uniquement de manière académique, comme en sciences de la vie ou de la Terre, des approches déconnectées des sciences humaines et sociales. Nous portons assez haut cette ambition de l'interdisciplinarité.
L'un des atouts de l'INRAE tient au fait que nous nous appuyons sur des infrastructures de recherche, qu'il s'agisse d'unités expérimentales de type agronomique ou de plateformes analytiques de très haut niveau pour analyser soit des composés chimiques dans l'environnement soit des composés biologiques dans des tissus humains, animaux ou végétaux. Nous contribuons ainsi au développement de ce qui est appelé la biologie à haut débit, qu'il s'agisse de génomique, de protéomique ou de mesures métaboliques. Ce sont des outils très puissants pour les applications en santé-environnement.
Nous menons nos recherches en métropole, mais aussi en outre-mer. Nous avons une implantation forte en Antilles-Guyane où se posent des questions spécifiques en santé-environnement. Certaines sont liées à la santé au sens classique – parasitoses, maladies émergentes – et d'autres à la présence de contaminants persistants, en particulier la chlordécone. Il s'agit d'un important sujet dans le domaine de la santé environnementale, dans lequel l'INRAE est impliqué en ce qui concerne les suites de cette contamination aux Antilles.
Nous travaillons, au niveau européen, avec de nombreux partenaires et nous sommes très mobilisés sur les questions dites Ecohealth, One Health ou santé globale. Ces notions, si elles sont malheureusement mises à l'agenda à cause de la crise covid, ne sont pas des préoccupations nouvelles pour un organisme comme l'INRAE. Le lien étroit entre la santé animale, qu'il s'agisse des animaux domestiques ou des animaux sauvages, et la santé humaine fait depuis longtemps partie de nos priorités de recherche.
Lors de la fusion entre l'INRA et l'IRSTEA, nous avons beaucoup travaillé sur les complémentarités entre les établissements. Nous sommes convaincus que, dans le domaine général des risques – risques pour la santé ou risques environnementaux –, l'INRAE constitue un organisme beaucoup plus performant et beaucoup plus visible, au niveau international, notamment sur la question des risques en santé-environnement.
Nous avons toujours travaillé, notamment à l'INRA qui est le plus gros des deux partenaires, sur les épidémies de maladies émergentes, parmi les animaux d'élevage ou en lien les populations humaines exposées.
Nous travaillons sur les problématiques de la résistance aux produits antimicrobiens, par exemple pour savoir comment réduire l'utilisation des antibiotiques dans les élevages ou comment s'en passer complètement, lorsque c'est possible.
Nous nous préoccupons de plus en plus de l'utilisation des substances chimiques pour la protection des cultures en plein champ, mais aussi pour la protection des denrées après la récolte. Nous nous préoccupons aussi de tous les rejets involontaires dans l'environnement, de la contamination de l'eau, de l'air, des sols par ces substances.
Nous travaillons également sur les contaminants naturels des produits alimentaires, notamment les mycotoxines. Ce sont des toxines produites par des champignons qui se développent entre autres sur les céréales. Elles peuvent contaminer la chaîne alimentaire et avoir des impacts très forts sur les consommateurs.
Enfin, de plus en plus, nous nous préoccupons des régimes alimentaires, à la fois en ce qui concerne la constitution de ces régimes, notamment leur contenu en additifs, mais aussi en ce qui concerne la façon dont ils influent sur l'environnement. C'est un point auquel même la recherche et les politiques publiques pensent rarement. Nos régimes alimentaires peuvent avoir une influence, notamment, par exemple, sur les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, selon la demande en protéines animales. Cela peut agir sur le réchauffement climatique et, plus généralement, sur la dégradation de l'environnement.
Nos recherches témoignent d'une vision aussi globale que possible de la santé. Nous ne concevons pas de travailler sur la santé humaine sans considérer également la santé végétale, la santé animale et ce que nous appellerons la santé de l'environnement, même s'il existe des divergences d'opinion sur ce qu'est un environnement en bonne santé. Nous sommes persuadés qu'il est impossible d'avancer sur la santé humaine sans avancer sur les autres formes de santé. Nous plaçons ces problèmes assez haut dans notre agenda et notre stratégie de recherche.
Nous essayons de promouvoir des changements des modes de production et de transformation des aliments, en production agricole animale ou végétale. Nous essayons, autant que faire se peut, de sortir de la dépendance aux produits phytosanitaires pour la protection des cultures. C'est la démarche de l'agroécologie que nous avons promue depuis plus de dix ans. Nous essayons d'avancer encore, non seulement en prouvant les concepts, mais aussi en étendant le champ d'application des démarches agroécologiques. Il s'agit de sortir de la dépendance aux intrants, même s'il ne s'agit pas forcément de « zéro pesticide ». Nous essayons également de promouvoir de nouveaux modes de transformation des produits, en particulier face à la crainte, qui monte très légitimement, des impacts sur la santé humaine de la consommation d'aliments ultra-transformés.
Nous travaillons sur la façon dont les consommateurs font évoluer leur régime alimentaire et leurs attentes. En effet, l'ensemble se tient, puisque nous ne produisons que ce qui est transformé, ce qui est consommé. Nous intégrons tout cela dans un système dit « agri-alimentaire », allant de la production jusqu'à la consommation en passant par la transformation de l'aliment.
Pour mettre ces études en pratique, au niveau social, nous devons nous appuyer sur des politiques publiques ou éclairer des politiques publiques qui intègrent les évolutions de la connaissance et des contraintes imposées soit aux actes de production soit aux actes de consommation.
En avant-première, j'évoquerai devant vous nos grands objectifs stratégiques pour les dix prochaines années. Le document d'orientation stratégique 2020-2030 que nous préparons actuellement sera la base du contrat d'objectifs et de performance que l'établissement négociera en 2021 avec l'État. Nous avons actuellement trois priorités scientifiques thématiques.
La première est une priorité transversale, liée à l'organisation en termes d'infrastructures. Il s'agit de renforcer notre capacité à travailler sur l'émergence ou la réémergence de maladies transmissibles. La crise covid n'est pas la seule raison qui nous pousse dans cette direction. Depuis plus de quarante ans, nous savons qu'augmente de façon continue le nombre de maladies émergentes chez l'homme, liées à des transferts de pathogènes depuis la faune sauvage ou domestique. Actuellement, 60 à 70 % des nouvelles maladies émergentes ou réémergentes chez l'homme proviennent du monde animal, au sens large des animaux sauvages ou d'élevage. Même si l'opinion publique en entend moins parler, nous voyons aussi une forte augmentation du nombre de pathogènes dans le monde végétal, sous l'influence du changement climatique, mais aussi des pratiques de transfert de matériel vivant, notamment de plantes, entre différentes parties du globe. Nous voyons ainsi arriver des infestations sur notre territoire : par exemple, l'année dernière, le virus de la tomate a contaminé certaines régions françaises, à partir de plants en provenance des Pays-Bas.
Face à l'augmentation de cette pression, nous essayons, en tant qu'organisme de recherche, de mieux connaître les systèmes, appelés « pathosystèmes », constitués d'un hôte, d'un pathogène, de ses vecteurs et de l'environnement.
Comment revenir ensuite à des pratiques prophylactiques ? Quoi que nous fassions, la meilleure façon de ne pas avoir de problème avec un pathogène est de ne pas y être exposé. La prophylaxie est donc un élément-clé de notre stratégie. Nous proposons, mais c'est plus ambitieux, de contribuer à un réseau, peut-être mondial, de surveillance des émergences et des contaminations, qui permettrait d'anticiper nombre de phénomènes de santé.
Il est pour nous très important de travailler sur les retours d'expériences : tous les organismes, tous les États sont « sur la même longueur d'onde ». Il ne s'agit pas de redécouvrir à chaque crise sanitaire les phénomènes qui se produisent et comment agir. Les retours d'expérience contiennent une grande part de gestion et d'évaluation des risques. C'est extrêmement important dans le cas des crises sanitaires.
Notre deuxième grand axe consiste à intégrer encore davantage le concept d'exposome dans nos recherches. L'exposome est cité dans l'introduction du plan national santé environnement (PNSE3), mais il est difficile de voir comment ce concept est ensuite « mis en musique ». Le terme exposome figure aussi dans la loi sur la modernisation du système de santé de 2016. Rien ne dit comment faire, concrètement, pour travailler sur l'exposome et le caractériser. Nous pensons pourtant que le fait de connaître l'ensemble des expositions chimiques, tous les stress environnementaux et toutes les caractéristiques psychosociales est extrêmement important pour comprendre le déclenchement de certaines maladies.
C'est l'hypothèse de Barker qui énonce que, dès la conception, l'embryon puis le fœtus sont imprégnés par des signaux de l'environnement – signaux chimiques, hormonaux… – qui induiront potentiellement le développement de pathologies à moyen ou à long terme. Certaines pathologies dont nous constatons actuellement l'augmentation, telles que le diabète, pourraient être dues à des expositions très précoces au cours du développement, même si le lien de causalité est difficile à établir. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de données sur l'exposome.
C'est le cas pour certaines substances de type perturbateurs endocriniens – thalidomide, distilbène – mais nous pouvons penser que d'autres contaminants imprègnent l'embryon et peuvent être à l'origine de dysfonctionnements après développement.
Notre objectif est de travailler sur cette notion d'exposome en étudiant en même temps comment les contaminants se répartissent dans l'environnement, quelles en sont les sources, en quantifiant l'exposition. Á l'INRAE, avec d'autres, nous travaillons donc sur la modélisation du devenir des contaminants de l'environnement, sur la mesure de l'exposome et sur la façon de passer de la connaissance de cette exposition et des premières réactions de l'organisme à des effets sur la santé.
Nous travaillons sur des cohortes, en particulier avec nos collègues de l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Ce sont des séries de grande ampleur de plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'individus, comme la cohorte NutriNet-Santé. Nous les utilisons pour interpréter les liens entre l'exposition, éventuellement le régime alimentaire, et les manifestations de pathologies chez l'humain.
Le troisième axe concerne la nutrition. L'INRAE s'intéresse à l'agriculture, l'alimentation, la bioéconomie et l'environnement. Nous souhaitons étudier quelle nutrition est favorable à la fois à la santé publique et à la santé de l'environnement. L'INRA puis l'INRAE se sont toujours définis comme des organismes qui s'intéressent à l'alimentation de la personne saine.
Nous sommes tous différents en ce qui concerne l'alimentation et la santé. Nous avons deux cibles principales de recherche : les seniors et les juniors, plus précisément les enfants en bas âge. Nous étudions en quoi l'exposition périnatale à certains contaminants peut avoir des effets sur le développement des enfants. Nous étudions aussi quelle est l'alimentation adaptée aux personnes âgées, notamment en tenant compte des problèmes de dénutrition fréquents à ces âges.
Nous essayons de comprendre comment articuler choix alimentaires, évolution des filières de production, de transformation, de commercialisation et comment repenser le système alimentaire sur la base d'arguments de nutrition. Nous entendons beaucoup parler de malnutrition, de sous-nutrition dans certains pays du monde, y compris chez nos compatriotes. Une bonne partie de la population est malnutrie ou dénutrie, avec des carences en fer, en zinc, en vitamines parce que les régimes ne sont pas suffisamment équilibrés.
Nous travaillons aussi sur de grands thèmes de recherche fondamentale, en particulier sur les microbiotes, c'est-à-dire le rôle des microbes que nous hébergeons tous sur notre peau, dans notre tube digestif avec le fameux deuxième cerveau situé dans l'intestin. Un être vivant contient finalement plus de cellules microbiennes que de cellules qui lui appartiennent en propre. Cette communauté microbienne qui interagit avec nous – et c'est le même phénomène chez les plantes et les animaux – joue un rôle fondamental dans le bon fonctionnement de l'organisme et dans sa réponse à un certain nombre de stress environnementaux, qu'il s'agisse de contaminants, de carences en nutriments, d'une température trop élevée… Notre microbiote interagit avec l'organisme et l'un des enjeux majeurs est de comprendre comment s'organisent les microbiotes des macro-organismes pour collaborer avec l'organisme.
Parfois, la collaboration se passe mal ; nous parlons alors de dysbiose. Nous pensons que l'augmentation des maladies chroniques inflammatoires de l'intestin telles que la maladie de Crohn sont, pour partie, dues à des dysfonctionnements du microbiote intestinal. Les travaux de l'INRA/INRAE ont contribué à avancer dans ce domaine et ces microbiotes sont pour nous un objet-frontière qui a d'énormes applications potentielles en santé, en protection des cultures et même en biochimie industrielle.
Enfin, les cohortes de santé peuvent être des cohortes de professionnels exposés à des substances comme c'est le cas d'Agrican, une cohorte d'agriculteurs qui manipulent notamment des produits phytosanitaires. L'INRA a beaucoup contribué et contribue encore à la cohorte NutriNet-Santé : les « nutrinautes », inscrits sur la base du volontariat, renseignent en ligne leur régime alimentaire, envoient des échantillons de prélèvements de sang, d'urine qui sont bancarisés et renseignent leur parcours de santé. Cette cohorte comporte actuellement 165 000 personnes environ. Depuis plusieurs années, elles renseignent en ligne ce qu'elles mangent, non au jour le jour, mais en indiquant les grandes tendances de leur régime alimentaire. Elles indiquent leur parcours de santé et peuvent, si elles sont volontaires, envoyer des échantillons à la biobanque. Nous avons actuellement environ 20 000 échantillons et, si nous voyons apparaître un signal de santé dans cette cohorte, nous pourrons réanalyser ces échantillons.
Pour ces analyses, il nous faut des instruments analytiques performants qui permettent, à partir de très petits échantillons, parfois conservés pendant de nombreuses années, de faire des analyses très précises pour identifier des polluants ou des traces de micro-organismes qui auraient pu être en contact avec l'humain, le végétal ou l'animal concerné. L'INRAE contribue, avec des collègues notamment de l'INSERM et du centre national de la recherche scientifique (CNRS), à ces projets de plateformes analytiques hautes performances pour l'étude des problématiques de santé-environnement.

L'INRAE intervient dans de multiples domaines. Nous en viendrions presque à nous demander dans quel secteur vous n'intervenez pas tellement le champ de vos missions est large !
Comment arrivez-vous, si vous y arrivez, à intégrer dans les politiques publiques autant de connaissances ? Ce sont des connaissances dans des champs de recherche extrêmement variés, avec davantage de certitudes dans certains domaines que dans d'autres : parfois encore au stade de la recherche d'informations, avec les plateformes analytiques par exemple, dans d'autres domaines, au stade du démarrage des concepts et des découvertes.
Comment construire des politiques publiques à la disposition des acteurs politiques, souvent non scientifiques ? Comment leur proposer des priorités permettant d'être opérationnels à moyen et long terme ?
Notre mission première est effectivement une mission de recherche finalisée, en appui aux politiques publiques. Historiquement, l'INRA et l'IRSTEA ont toujours eu des liens privilégiés avec certains ministères. Nous sommes sous la double tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et du ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Nous sommes donc encouragés par les tutelles à développer un certain nombre de travaux « actionnables » par les politiques publiques. C'est le cas pour le ministère de l'agriculture et de l'alimentation.
Lorsque nous avons préparé la fusion, à l'origine de l'INRAE, nous avons tenu à avoir une symétrie avec le ministère de la transition écologique sous la forme d'un accord-cadre signé début septembre par Mme Barbara Pompili et par M. Philippe Mauguin, notre président-directeur général. Il s'agit de mettre en place les bons « tuyaux » pour connecter la recherche qui se fait dans nos laboratoires avec les services des ministères, notamment en ce qui concerne les préoccupations de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) au ministère de la transition écologique. La DGPR se préoccupe beaucoup des risques environnementaux au sens large, notamment des risques liés aux substances chimiques dans l'environnement.
Nous avons des échanges réguliers à haut niveau, entre la direction scientifique de l'établissement et les directions générales des deux ministères, pour identifier l'agenda des sujets qui émergent ou qui sont déjà prévus comme par exemple la révision de la stratégie sur la biodiversité. Dans ce premier niveau d'interactions, notre rôle est l'éclairage d'un certain nombre de politiques publiques en cours d'élaboration ou de révision.
Notre deuxième niveau d'interactions avec les ministères consiste à répondre à des saisines. Elles peuvent transiter directement d'un cabinet ministériel à la direction générale de l'INRAE. Elles peuvent être à l'initiative de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST). Certaines saisines sont faites par les inspections générales, en particulier les inspections générales de l'agriculture ou de l'environnement.
Je remarque d'ailleurs que, de plus en plus, ces saisines sont communes à plusieurs inspections générales. Des saisines fréquentes, communes aux inspections générales de l'environnement et de l'agriculture, parfois des finances, parfois de la santé, concernent la santé environnementale ou la gestion de l'eau. Il arrive que quatre inspections générales, même sans faire une véritable saisine donnant lieu à un rapport, nous auditionnent. Elles viennent « se ressourcer » pour savoir ce que la recherche peut apporter pour éclairer les politiques publiques.
En termes d'organisation, nous fonctionnions jusqu'à présent de façon bilatérale, certes avec des conventions, mais nous n'étions pas véritablement outillés pour gérer ces interactions et les faire fructifier. Lors de la fusion, nous avons mis en place une nouvelle direction générale déléguée à l'expertise et à l'appui aux politiques publiques.
Elle met actuellement en place des mécanismes d'appui aux politiques publiques. Cela signifie d'abord contribuer à leur élaboration, en amont, par des interactions sous forme d'auditions et de saisines. Une fois ces politiques publiques formalisées, nous travaillons à la mise en place d'outils d'application et éventuellement d'outils d'évaluation.
Cette nouvelle direction générale est au même niveau hiérarchique que la direction générale déléguée à la recherche et à l'innovation ou la direction générale déléguée aux ressources de l'établissement. Nous avons donc voulu placer « très haut » notre mission d'appui aux politiques publiques.
En plus de cette vision macroscopique au niveau de l'établissement, nous avons, en termes opérationnels, un ensemble de façons de travailler destinées à appuyer les politiques publiques. Nous travaillons avec des agences de l'État comme l'agence de la transition écologique (ADEME), l'observatoire français de la biodiversité (OFB) ou l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Ces agences mettent en œuvre sur le terrain certaines politiques publiques.
Par le biais de ces interactions, nous pouvons faire remonter des résultats de la recherche qui seront ensuite réinjectés dans le processus des politiques publiques.
En ce qui concerne plus particulièrement la santé-environnement, notre partenariat historique avec l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) fait que nous partageons des unités de recherche, notamment à Maisons-Alfort sur des questions de santé vétérinaire et d'épidémiologie. Nous sommes liés par un accord-cadre, renouvelé voici quatre ans, identifiant les sujets de collaboration : santé animale, santé végétale, épidémiologie, appui à l'expertise. Une soixantaine de scientifiques de l'INRAE siègent dans les comités d'experts spécialisés (CES) de l'Anses et une soixantaine également siègent dans les groupes de travail qui les appuient. Notre collaboration étroite avec l'Anses nous permet de contribuer à l'instruction de certains dossiers. Par ailleurs, certains projets de recherche sont financés par l'appel d'offres de l'Anses.
Nous entretenons donc toute une panoplie d'interactions au niveau français et notre ambition est d'agir de façon comparable au niveau européen. Nous aimerions en particulier que des experts INRAE participent à des agences comme l' European food safety authority (ESFA) ou l' European chemicals agency (ECHA) pour l'évaluation des produits chimiques ou phytosanitaires. Nous faisons également une offre de services à la Commission européenne sur certains dossiers que notre délégation générale à l'appui aux politiques publiques peut instruire pour le compte de la Commission, après une procédure d'appel d'offres bien sûr. Les sujets envisagés concernent la politique agricole commune (PAC), la révision de la stratégie européenne de la biodiversité en lien avec la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, prévue en Chine l'année prochaine, des actions sur les sols…
Nous agissons aussi bien à un niveau très opérationnel pour l'évaluation de dossiers que par des interactions à haut niveau entre des directions ministérielles et la direction générale de l'INRAE, avec toutes les implications intermédiaires : projets de recherche communs, infrastructures communes avec l'OFB et l'Anses… Nous mettons notre capacité de travail à la disposition de ces partenariats, ce que nous rendons bien visible avec la création de la direction générale déléguée.

Je fais partie de l'OPECST et nous nous y posons beaucoup de questions lorsque nous travaillons sur des sujets à la frontière entre la décision publique et les sciences.
Dans cette commission d'enquête, nous nous interrogeons beaucoup sur la gouvernance et sur les façons d'améliorer la conduite des politiques publiques. L'INRAE a une direction scientifique « agriculture » dirigée par M. Christian Huyghe. Quelles sont vos relations puisque de nombreux sujets concernent à la fois vos deux directions de l'environnement et de l'agriculture ? À terme, ne faudrait-il pas fusionner les directions ? Cette organisation ne nuit-elle pas à l'efficacité ?
Lorsque l'OPECST a travaillé sur la problématique des inhibiteurs de la succinate déshydrogénase (SDHI) et à d'autres occasions, la question de la nomination des experts et des liens d'intérêts a parfois été interprétée de manière un peu particulière par un certain nombre d'associations et d'organisations. Comment se prémunir contre ces difficultés, assurer l'éthique ? Comment les gens qui travaillent avec vous vivent-ils cette pression des associations, d'où il résulte qu'un expert s'exprimant sur un sujet est immédiatement soupçonné d'être d'accord avec celui qui pose la question ?
Je n'ai pas la prétention de faire la politique de l'établissement à la place de notre président-directeur général.
Il est exact que l'existence de trois directions scientifiques, face aux défis actuels, est une vision « à l'ancienne » de la structuration d'un organisme de recherche.
Je ne suis pas pour autant en train de me saborder. Nous avons hérité d'une structure à cinq ou six directions scientifiques et nous avons simplifié le dispositif au fil du temps, notamment sous l'action de Mme Marion Guillou, pour arriver à ce tripode. Nous sommes partis du principe que ce n'est pas très stable avec deux pieds et un peu bancal avec quatre donc trois paraissait être le nombre d'or.
Il est clair que nous ne travaillons pas en « silos ». Cela tient en partie aux personnes et je suis en interaction permanente avec mes deux collègues, M. Christian Huyghe et Mme Monique Axelos, ne serait-ce que parce que nous siégeons tous au collège de direction de l'INRAE. Nous nous partageons beaucoup de dossiers. Par exemple, les directions scientifiques « agriculture » et « environnement » collaborent sur le chantier de l'agroécologie. Le premier chantier en agroécologie a été piloté par M. Jean-François Soussana qui était à l'époque directeur scientifique « environnement » avec l'appui des divisions de la direction scientifique « agriculture » et j'ai repris ce chantier en collaboration très étroite avec M. Christian Huyghe. Je ne dirais pas que nous sommes interchangeables, mais nous sommes « sur la même longueur d'onde », nous portons le même message et nous partageons les dossiers.
Une façon de travailler différemment, valable également pour les politiques publiques, serait de ne pas aborder les questions par grand thème, par grand secteur : c'est opérant à court terme, mais sclérosant à moyen et long terme. Nous sommes plutôt dans la logique de faire disparaître les cloisons comme vous le verrez dans notre document d'orientation 2020-2030. Nous travaillons de plus en plus sur des nexus. Ils vont d'un nexus « alimentation-santé-environnement » à un nexus « énergie-eau-biodiversité ». Il est possible que, à l'échéance de quelques mois ou années, ces directions scientifiques (DS) « agriculture », « environnement », « alimentation et bioéconomie » soient obsolètes parce que nous ne raisonnons plus ainsi et ne concevons plus les solutions ainsi.
Ces affichages existent mais le fait que cela ne corresponde pas à la réalité du travail fait consensus au sein du collège de direction de l'INRAE. Nous avons des réunions entre directions scientifiques et nos adjoints se voient au moins une fois par mois. Lorsque nous discutons avec des partenaires – ADEME, Anses… –, nous participons tous à la discussion, même si ensuite un chef de file porte le dossier.
La question de l'éthique et des liens d'intérêts est un sujet auquel nous sommes tous très sensibles. Je fais partie de comités Anses et nous sommes effectivement tout de suite suspects aux yeux de certaines personnes. Inversement, d'ailleurs, un chercheur peut aussi avoir des positions personnelles qui le font mettre à l'index d'une partie de la communauté scientifique.
À l'INRAE, nous faisons systématiquement une déclaration non de conflit, mais de liens d'intérêts. Je siège dans un comité pour l'expertise publique et, lorsque nous lançons des expertises scientifiques collectives pour lesquelles un collectif d'experts se réunit, nous demandons à nos collègues de fournir des déclarations de liens d'intérêts.
Il existe deux catégories de personnes : ceux qui le font de manière totalement naturelle et ceux qui s'y refusent un peu, en particulier des chercheurs qui n'ont jamais été confrontés à une telle demande. Ils partent du principe que l'éthique scientifique veut qu'un chercheur soit totalement indépendant dans sa prise de parole et son action.
Ces déclarations sont obligatoires pour tous nos partenaires, actualisées, consultables en ligne. Nous plaidons pour que chacun les remplisse convenablement.
Nous avons aussi une charte de déontologie et de l'expertise, ainsi qu'un comité d'éthique commun à plusieurs organismes. Il a été mis en place initialement par l'INRA. L'IRSTEA, l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) et le centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) s'y sont joints. Nous travaillons avec les autres organismes sur notre charte de l'expertise.
Vous parliez de pressions. Cela existe effectivement et certains de nos collègues excluent désormais de siéger dans un comité d'experts parce que cela devient « intenable ». Je n'accuse personne, je constate simplement.
Il me semble que, pour progresser, nous pourrions avoir un outil commun à tous les organismes dépendant de l'État afin que cette déclaration de liens d'intérêts ne soit réalisée qu'une seule fois. Cela éviterait aux experts souvent sollicités de multiplier de telles déclarations. Cela paraît être du bon sens, mais nous n'y parvenons pas.
Par exemple, lors d'un examen de liens d'intérêts auquel nous avons procédé récemment, l'une de nos collègues nous a donné le lien électronique de sa déclaration faite pour l'Anses, mais nous ne pouvons pas, en tant qu'agent extérieur, accéder à celle-ci. Il faudrait que nous ayons une unique déclaration, remplie et actualisée en temps réel, ce qui permettrait à chacun de travailler plus sereinement.
Toutefois, cela ne changera malheureusement pas le regard que la société ou certaines personnes portent sur l'expertise. Le regard est, soit trop complaisant, soit trop à charge. Sur toutes les questions qui nous préoccupent, un énorme effort de formation et d'information doit être fait pour expliquer ce qu'est le métier d'expert, décrypter qui fait quoi dans la chaîne de décision.
Nous entendons souvent dire « l'INRA/INRAE a décidé d'interdire tel produit » alors que ce n'est pas la réalité. Beaucoup de personnes ignorent ou feignent d'ignorer la façon dont les rôles sont précisés dans la loi. Nous devons clarifier le rôle de l'expert, le rôle de l'institution et où chacun d'entre eux s'arrête.

N'est-ce pas lié au fait que le vivier des experts est relativement limité en France ? Selon une personne auditionnée, les mêmes experts sont toujours sollicités, parce qu'ils sont hyperspécialisés et que n'importe qui ne peut pas se prétendre expert.
L'expertise doit à mon avis être fondée sur une reconnaissance académique. Chacun peut s'autoproclamer expert, mais l'expertise sur les sujets qui nous intéressent ici est, le plus souvent, disciplinaire. Elle se construit par une carrière et ce n'est pas forcément lors de l'embauche dans un organisme de recherche qu'un chercheur peut se proclamer expert. Il faut une certaine maturité qui va de pair avec une reconnaissance par les pairs, donc un dossier scientifique.
La question du vivier est un vrai sujet. Plus les dossiers sont complexes, moins nous disposons d'experts « pointus », nous retrouvons donc toujours les mêmes personnes. Nous avions proposé en 2013, dans les actions conjointes entre l'alliance pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan), l'alliance AllEnvi et l'alliance thématique nationale des sciences humaines et sociales (Athéna), une initiative que le groupe inter-alliances avait baptisée l'Initiative française en environnement-santé (IFRES). Le projet était incarné par Robert Barouki et Éric Vindimian. Il faisait suite à la proposition de créer une fondation de coopération scientifique sur ces questions de santé-environnement, toxicologie et écotoxicologie.
Nous avons présenté cette initiative lors de la conférence environnementale et nous nous sommes justement demandé comment dynamiser les filières de formation dans le domaine de la toxicologie, de l'écotoxicologie, de la santé-environnement. Les chercheurs s'intéressent souvent à ces sujets tardivement, alors qu'ils sont déjà très « pointus » dans un domaine, lorsque leur expertise est sollicitée pour éclairer un aspect d'un dossier. Nous manquons des formations pluridisciplinaires dans ce domaine des risques. Nos propositions n'ont pas été vraiment écoutées.
Le vivier d'experts est par définition restreint et, de plus, dans ce vivier, certains opposent un refus pour ne pas être stigmatisés. Nous avons donc à la fois un problème de flux de nouveaux entrants dans le vivier et un épuisement de ce dernier par les sorties, y compris par départ en retraite.

Pour quelles actions l'INRA a-t-il été partenaire du PNSE3 ? Ont-elles atteint leurs objectifs ? Comment évaluez-vous la participation de l'INRA au PNSE3 ?
En amont de la préparation du PNSE4, un travail de préfiguration a été mené par nos collègues de l'INSERM, notamment Robert Barouki, Rémy Slama, Bernard Jégou… Des collègues de l'INRAE y ont été associés, dont moi-même. J'ai participé à ce travail et le document a ensuite été endossé par l'INSERM. À cette occasion, nous avons fait des propositions, par exemple en ce qui concerne les cohortes. Nous agissons donc en amont, par des propositions qui sont ensuite reprises ou non dans le plan.
J'attendais personnellement beaucoup du PNSE3 sur le thème d'actualité, assez novateur, des relations entre biodiversité et santé. Il a malheureusement fallu attendre la toute fin du PNSE3 pour se rendre compte que ce sujet était resté orphelin. Il a alors été confié à la fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB).
La biodiversité est un révélateur de l'état de l'environnement, des pressions que nous exerçons par la déforestation, la pollution… Le lien entre la biodiversité et la santé humaine est de plus en plus souvent évoqué et je pense que la France aurait pu devenir leader sur certains de ces aspects, mais cela n'a pas été le cas. Je ne désigne pas de responsables mais, sur des sujets peu habituels tels que la surveillance sanitaire, la réduction des pollutions…, nous avons raté une occasion, du point de vue de la recherche. Même si cela n'aurait pas empêché l'émergence du coronavirus, nous aurions mieux maîtrisé le sujet et nous nous poserions moins de questions sur le point de savoir si la biodiversité est favorable ou non à la santé et à l'émergence de nouvelles maladies.
La plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques ( Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) a travaillé cet été sur le sujet et le rapport est en cours de relecture. La littérature existe sur cette question. Les contributeurs sont très peu français alors que, y compris par nos territoires d'outre-mer, nous aurions pu nous y intéresser. C'est le regret que me laisse le PNSE3, avec ma vision venant du monde de l'écologie et de la biodiversité.
J'ai évoqué l'exposome qui est une très belle idée. Si demain nous voulions lancer une grande surveillance de la contamination de nos concitoyens par telle ou telle substance connue, sans même parler des substances que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas la capacité de faire ces analyses dans nos laboratoires. Nous avons certes des laboratoires très performants, mais nous n'avons pas assez de débit. Nous n'avons pas la capacité de traiter un grand nombre d'échantillons avec de bonnes performances analytiques pour un prix acceptable. Nous ne nous sommes pas dotés d'une infrastructure nationale pour « mettre en musique » l'exposome.
Je fais partie d'un petit groupe de travail INSERM/INRAE qui y travaille. L'Europe a avancé, avec le grand projet européen Human biomonitoring for Europe (HBM4EU). C'est un projet à 50 millions d'euros destiné à la définition des marqueurs à mesurer, à la façon de les mesurer… L'INSERM y est très impliqué mais la traduction au niveau national peine à apparaître.
Il existe un projet d'infrastructure européenne porté par la République tchèque mais la France peine à aligner des laboratoires capables d'entrer dans ce consortium européen alors que nous avons des compétences scientifiques. Je constate un hiatus entre la volonté affichée et les actes pour structurer les outils et se doter des outils dont nous avons besoin.
Lors de telles analyses, nous avons besoin d'un appareil dans lequel nous mettons le très petit échantillon à analyser. Nous travaillons sur de microquantités pour ne pas prélever des litres. C'est compliqué mais nous arrivons à le faire en recherche sur 50 ou 100 échantillons. Pour caractériser l'exposome comme envisagé dans le PNSE3, il faut connaître l'exposition tout au long de la vie, depuis avant la naissance jusqu'à l'âge de vingt ou quarante ans, pour des dizaines de milliers de personnes. Cela représente des quantités d'échantillons énormes. Cela ne fait pas partie des missions d'un laboratoire de recherche et il n'en a pas la capacité en volume.
En plus de ce problème du volume d'analyses à réaliser, se pose la question des données. Toutefois, la question des données massives n'est pas propre à ce sujet, nous l'avons déjà en génétique, pour l'observation de la Terre… Des volumes de données considérables arrivent déjà chaque jour sur les serveurs et les organismes de recherche sont capables de les traiter.
Le goulet d'étranglement est de générer la donnée de base, de passer de l'échantillon dans le petit tube à un spectre indiquant toutes les molécules présentes dans l'échantillon. Nous savons le faire relativement facilement en recherche sur quelques dizaines d'échantillons, mais pas sur des milliers chaque jour. Il faut de plus que nous assurions à la fois le volume et la qualité ainsi que le prix. Nous n'avons pas pris la mesure de ce que signifie caractériser l'exposome des citoyens.

Les manques sont-ils plus d'ordre financier ou humain ? Pourriez-vous nous présenter plus en détail la nouvelle direction générale déléguée ? Comment s'intègre-t-elle dans l'ensemble et avez-vous une idée de son enveloppe budgétaire ? Enfin, quelle est votre implication dans les plans régionaux santé-environnement (PRSE) ?
L'INRAE a 12 000 agents, dont 1 500 permanents fonctionnaires. C'est un très gros opérateur de recherche, avec un budget global d'un milliard d'euros.
Les moyens humains sont certes limitants. Les moyens financiers sont limitants et il ne suffit pas forcément d'avoir de nouveaux postes pour attirer de nouvelles personnes. Les carrières dans la recherche ne sont pas les plus attractives, en tout cas dans notre pays. Je participe aux concours de recrutement et il n'est plus rare que nous n'ayons pas de candidat – chercheur ou ingénieur – pour certains postes, entre autres parce que les rémunérations ne sont pas attractives.
Le problème provient pour partie d'un manque de moyens humains et financiers, mais surtout de l'organisation. Je ne suis pas fervent des regroupements. Le regroupement de l'INRA et l'IRSTEA est utile, mais il a demandé un travail très lourd durant deux ans. Sans forcément les regrouper, il faut favoriser la collaboration entre les organismes, et pas seulement entre les organismes de recherche, mais aussi avec les agences.
Par exemple, des plateformes d'épidémiosurveillance ont été mises en place, la dernière en date portant sur les contaminants dans la chaîne alimentaire. Il en existe aussi sur la santé animale et la santé végétale. Ces plateformes sont des consortiums formés de partenaires de la recherche, dont l'INRAE, l'Anses, la direction générale de l'alimentation (DGAL), des opérateurs de terrain qui remontent l'information… C'est un modèle qui permet d'avancer dans la mise en commun de moyens humains et de ressources.
Ce qui s'est souvent fait et se fait malheureusement encore est plutôt de la duplication : plutôt que de mettre en commun des moyens sur une plateforme commune, chaque organisme développe sa propre plateforme, par exemple pour doser les métabolites chez l'homme. Il existe ainsi une plateforme métabolomique à Toulouse pour l'INRAE, tandis que l'INSERM a ses propres plateformes.
Ces plateformes ont vocation à être regroupées dans une infrastructure nationale. Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI) travaille à la nouvelle feuille de route nationale qui sortira en 2021. Nous pouvons penser que la mise en commun d'infrastructures permettra d'avancer.
Nous avons besoin d'une ambition collective. Tous sont pleins de bonnes intentions, disent vouloir travailler sur la connaissance de l'exposome, mais chacun agit dans son coin. J'évoquais la réflexion commune que nous avons eue avec l'INSERM. C'est très bien, mais cela ne se produit qu'une fois de temps et temps. Cela reste basé sur le fait que les gens se connaissent. Il reste d'importantes marges de progrès mais elles nécessiteront un investissement.
Au-delà de l'investissement humain et des frais de fonctionnement, la science avance dans ces domaines et les instruments deviennent vite obsolètes. En génétique par exemple, dans les programmes de séquençage, il faut changer les appareils tous les deux ans et chaque appareil coûte 500 000 euros ou un million d'euros. Une politique d'infrastructure revient donc cher, aux établissements et à la collectivité nationale. Il faut que nous soyons capables de faire des économies lorsque c'est pertinent et de collaborer sur de grands projets.
Je ne connais pas les volumes financiers de la direction générale déléguée à l'appui aux politiques publiques. Elle est organisée en deux grandes directions. L'une des directions existait déjà à l'INRA : la direction aux études, prospectives et expertises scientifiques collectives (DEPE), forte d'une dizaine d'agents permanents. La DEPE est capable de piloter des expertises scientifiques collectives pour des donneurs d'ordres qui peuvent être les ministères, l'ADEME… Les experts scientifiques sont bien sûr dans le laboratoire, mais l'ingénierie de projet est gérée par la DEPE.
Concrètement, nous avons par exemple démarré depuis trois mois une expertise scientifique collective sur l'impact des phytosanitaires sur la biodiversité, financée au titre de l'axe « recherche » du plan Écophyto. Cette étude mobilise une cinquantaine d'experts. Ses commanditaires sont les quatre ministères qui participent au plan Écophyto : l'agriculture, la transition écologique, la santé et les outre-mer.
Nous pouvons donc travailler pour un donneur d'ordres extérieur et nous souhaitons que la DEPE puisse aller vers l'Europe ou l'OCDE. C'est déjà le cas d'ailleurs.
Le deuxième aspect concerne l'appui aux politiques publiques. La direction générale déléguée à l'appui aux politiques publiques (DAPP) est encore plus en prise avec les sujets qui nous intéressent aujourd'hui tandis que la DEPE s'occupe plutôt de veille scientifique et de synthèse scientifique.
La DAPP emploie 20 à 25 agents. L'idée est d'avoir une structure capable d'instruire nos relations avec nos partenaires en appui aux politiques publiques, c'est-à-dire qu'elle gère les relations institutionnelles avec les directions des ministères, avec les agences, avec l'Europe. Ces collègues sont spécialisés dans l'interface entre recherche et politique – science-policy interface, un terme anglo-saxon très utilisé en Europe – pour voir comment mieux adapter l'offre d'expertise de l'INRAE aux politiques publiques et faire connaître ce que nous faisons.
Pendant longtemps, nous n'avions que peu de contenus à destination des décideurs, des parlementaires, ou d'autres personnes en charge des politiques publiques. Nous avons donc mis en place des ateliers d'écriture de synthèses à destination des porteurs de politiques publiques pour présenter les grands enjeux, tels que nous les voyons en tant qu'organisme de recherche, les résultats récents qui illustrent notre action et les exemples que nous avons d'éclairage des politiques publiques. Nous avons commencé par deux sujets : les politiques de biodiversité et la problématique One Health. Le premier document est déjà sorti et j'aimerais d'ailleurs savoir s'il est parvenu jusqu'à vous, le deuxième est presque terminé. Nous essaierons de produire de tels documents à un rythme régulier pour montrer comment la recherche est en train de se faire et comment elle éclaire les politiques publiques.
La DAPP a donc pour rôle de prospecter auprès des pouvoirs publics – ministères, régions, agences de l'eau… – afin de montrer comment notre expertise scientifique peut être mobilisée pour répondre à leurs interrogations.
S'agissant de la déclinaison régionale du PNSE, je n'ai aucune visibilité sur quelque action que ce soit à ce sujet, peut-être parce que je suis trop loin de l'action régionale. Des chercheurs de l'INRAE ont peut-être été mobilisés mais, à ma connaissance, l'INRAE n'a pas été mobilisé en tant qu'organisme.
Nous sommes tout de même très présents dans les régions. L'INRAE a dix-huit centres de recherche et nous sommes l'un des organismes les plus répartis sur l'ensemble du territoire, en métropole et outre-mer, mais nous n'avons pas toutes les compétences partout. Nous pouvons être localement très impliqués mais cela ne signifie pas que nous serons impliqués de la même façon sur le sujet dans toutes les régions.

Comment êtes-vous organisés ? Est-ce une organisation verticale dans laquelle les programmes arrivent « d'en haut » et sont distribués ? Quel dialogue avez-vous avec le territoire, avec vos centres ? Des éléments du territoire peuvent-ils vous remonter ? Comment les traitez-vous ? J'ai bien sûr comme arrière-pensée l'identification d'un risque quelconque que vous pourriez prendre en compte et sur lequel vous pourriez lancer des recherches pour améliorer la sécurité et la santé publique.
L'INRA avait l'image d'un Rubik's cube. C'est encore le cas de l'INRAE. Notre organisation est très matricielle. C'est un défaut parfois reproché aux organisations françaises.
Nous avons donc, en dessous des directions scientifiques, quatorze départements de recherche qui sont organisés soit autour d'objets soit autour de disciplines. Nous avons ainsi un département de santé animale, un département d'alimentation humaine. Ce sont les deux départements qui abritent l'essentiel de nos forces de recherche sur le sujet d'aujourd'hui. Nous avons un département de santé des plantes et environnement…
En raison du poids de l'histoire, tous les départements ne sont pas présents dans tous les centres. L'INRA s'est construit à partir de centres régionaux qui ont fusionnés en 1946. Nous sommes dans une logique de dialogue permanent entre la science, vue comme la brique de base que constitue l'unité de recherche, jusqu'à la direction scientifique et au collège de direction, le département se trouvant entre les deux. Le chef de département interagit avec ses chercheurs qui lui disent ce qu'ils ont envie de faire et négocie les moyens avec la direction générale qui « tient les cordons de la bourse ». Ce dialogue est régulier. Chaque année, tous les départements présentent à la direction générale leur schéma stratégique à cinq ans et expliquent comment ils souhaitent le faire évoluer.
Les demandes locales peuvent donc remonter des unités de recherche mais nous avons aussi des ambassadeurs dans les régions : les présidents ou présidentes de centre. Chacun des dix-huit centres a un président ou une présidente qui est en interaction très étroite avec l'écosystème local. Je parle bien sûr de l'écosystème de la recherche, donc nos partenaires des unités mixtes de recherche (UMR), le CNRS, les écoles vétérinaires, les écoles d'agronomie, les universités qui ont de plus en plus de poids dans le paysage de la recherche ainsi que les élus, les conseils régionaux, les entreprises…
Chaque président de centre établit sa propre stratégie. Ce n'est pas une stratégie scientifique qui relève des départements. Le président de centre est, d'une part, la caisse de résonance, au niveau local, des décisions générales, en termes de politique d'alliances, par exemple, auprès des présidents d'universités, des représentants locaux du CNRS et, d'autre part, il nous fait remonter les signaux issus des élus, des entreprises. Nous coconstruisons alors, entre direction générale, départements et centre une stratégie locale qui tient compte des spécificités des unités de recherche présentes localement.
Nous ne lancerons pas un énorme projet de recherche sur la vigne en Bretagne mais, si nous voyons émerger une transition localement, si un territoire souhaite s'orienter vers de l'agroécologie à grande échelle, par exemple si la région Sud-Ouest souhaite sortir de l'usage des phytosanitaires en viticulture, cela remonte par l'intermédiaire des centres vers la direction générale. Nous commençons alors un trilogue territorial et la direction générale coconstruit avec les directeurs de centres et les chefs de départements la vision à quatre ou cinq ans de nos projets d'actions localement.
Les centres sont tous différents car les régions sont toutes différentes. Chaque centre a trois ou quatre mots-clés qui sont sa carte d'identité. Le contenu du travail, les alliances que nous concluons localement se déclinent au gré de chaque centre. Tout est coconstruit entre le centre, la direction générale et les départements. Nous préparons actuellement les trilogues territoriaux qui auront lieu à partir de fin octobre.
Nous pouvons passer des accords-cadres avec des régions. Il existe par exemple un accord-cadre entre l'INRAE et la région Nouvelle-Aquitaine, entre l'INRAE et la région Bretagne, entre l'INRAE et le Grand-Est. Nous avons un service dédié, qui gère l'interaction avec les partenaires universitaires, les écoles, les organismes de recherche et les soutiens que sont les régions. Nous travaillons ainsi sur la viticulture en Nouvelle-Aquitaine, sur la forêt dans les Landes, sur la forêt aussi dans le Grand-Est mais ce ne sont pas les mêmes questions que dans les Landes… Tous ces sujets qui nous intéressent en commun avec les régions sont instruits par le président ou la présidente de centre et validés en collège de direction.

Votre organisation est lisible et claire pour tous les participants et toute la famille des chercheurs, des scientifiques de terrain.
Vous disiez ne pas connaître le degré d'implication de l'INRAE dans les plans régionaux santé-environnement. Je l'entends comme une dissonance. D'un côté, vous semblez être très au clair de vos priorités de recherche, vos centres d'intérêt à l'échelle des territoires, mais vous ne semblez pas avoir de discussion à cette échelle avec les agences régionales de santé (ARS), les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), ou de façon très variable d'une région à l'autre. Cette gouvernance territoriale semble un peu improvisée en fonction des particularités des thématiques et des priorités de santé publique que vous avez identifiées par région, qui peuvent effectivement être très différentes. Cela donne l'impression d'un potentiel non optimisé de façon organisé à l'échelle d'un territoire bien défini.
Une partie de la confusion peut provenir du fait que je n'ai pas une connaissance exhaustive de tous les dossiers.
Nos dix-huit centres couvrent à peu près tout le territoire, mais toutes les compétences ne sont pas représentées dans chaque centre. Ainsi, les deux départements majeurs pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui sont « santé-environnement » et « alimentation humaine ». Leurs unités de recherche sont à Toulouse avec l'unité Toxalim de toxicologie alimentaire. Celle-ci ne travaille pas avec les ARS des autres régions car ce n'est pas dans leur logique de partenariat : les partenariats se font beaucoup à l'échelle locale. Nous pouvons le regretter effectivement, mais l'INRAE, bien qu'il soit distribué, n'est pas équiréparti et ne peut pas faire tout, partout, tout le temps. Ce n'est pas notre mission.

Il pourrait au moins exister un support pour partager avec les autres régions ce qui fonctionne bien. Toxalim travaille effectivement très bien à Toulouse mais vous pourriez faire profiter d'autres régions de son travail. Que manquerait-il pour arriver à ce partage d'informations et de bonnes pratiques ?
Même si nos chercheurs sont très impliqués dans l'appui aux politiques publiques, leur métier de base est la production de connaissances. Les travaux de Toxalim par exemple ne sont pas forcément repris à l'échelle régionale mais plutôt directement à l'échelle nationale ou internationale. Ce laboratoire est toulousain pour des raisons historiques mais aurait pu se trouver n'importe où.
Il a travaillé par exemple sur l'additif alimentaire E171, le dioxyde de titane. La décision prise en 2019 de suspendre pour au moins un an l'usage du E171 dans l'alimentation provient en grande partie de travaux menés à Toxalim. Ce sont des travaux académiques sur le franchissement de la membrane intestinale, les impacts de l'accumulation dans le foie, la rate. Nous savons maintenant que cet additif passe également la membrane transplacentaire et atteint le nouveau-né. Ce sont des travaux toulousains parce que le laboratoire est à Toulouse mais ils ne concernent pas la problématique toulousaine. Ils ont un impact direct sur les politiques publiques puisque, sur proposition de l'Anses, en attendant une révision par l' European food safety authority (EFSA), un moratoire d'un an a été décidé. Ces recherches ont donc un impact direct sur les politiques publiques sans passer par la déclinaison régionale du plan santé-environnement.
Il peut exister des projets de recherche menés localement avec des ARS, des agences de qualité de l'air, par exemple pour la détection de pesticides dans l'air, mais ce sont souvent des projets de recherche de trois ans, pas une activité structurée.
Peut-être devrions-nous imaginer comment la structurer. Devenons-nous finalement une agence de moyens avec des missions complémentaires en appui aux agences régionales de santé ? Cela peut être discuté, peut-être avec le ministère de la santé.
Nous avons par exemple des plateformes d'épidémiosurveillance, créées grâce à un consortium dans lequel l'Anses et l'INRAE ont beaucoup investi. En contrepartie, cela s'est traduit par l'inscription du soutien à ces plateformes comme une mission pérenne que le ministère de l'agriculture et de l'alimentation finance, en plus du soutien de base accordé à l'établissement.
Nous avons de même une mission sur la conservation des ressources génétiques forestières. C'est un sujet stratégique pour la forêt française, financé y compris par des postes, en dehors de notre soutien de base.
Si la tutelle demande d'envisager parmi nos missions une plus grande interface de surveillance sur telle ou telle question, nous pouvons peut-être l'instruire, mais au titre des missions complémentaires de l'établissement. Cela ne fait pas partie de nos missions de base, prévues dans le décret. Nous produisons de la connaissance – c'est notre mission de base – finalisée – c'est notre deuxième mission – avec une mission d'éclairage et d'appui aux politiques publiques. Nous pourrions imaginer dans cette dernière mission un appui aux politiques régionales de santé, mais cela n'a à ma connaissance pas été décliné jusqu'à présent.
Il est prévu que notre direction générale déléguée rencontre le ministère de la santé pour justement examiner les sujets sur lesquels l'INRAE pourrait lui apporter son assistance. À ma connaissance, peut-être incomplète, cela n'a pas encore été déployé, c'est en cours. C'est plus abouti s'agissant de notre soutien aux expertises de l'Anses.

Que faudrait-il améliorer en matière de gouvernance ? Que faudrait-il améliorer en matière de prévention pour accroître l'efficacité de la politique en santé-environnement ?
Je commencerai par répondre à la deuxième question de façon à expliquer ensuite comment la gouvernance permettrait de le réaliser.
J'ai conduit ma carrière scientifique dans le domaine de l'écotoxicologie, c'est-à-dire l'étude de l'impact des substances chimiques « indésirables » sur les environnements, notamment aquatiques. Lors de l'évaluation de risques, nous étudions les risques induits par telle ou telle substance. Le principe est le même en santé publique.
Les trois grands éléments de l'équation sont, d'une part, le danger intrinsèque de chacune des substances, prise isolément ou en mélange, d'autre part, la caractérisation de l'exposition, c'est-à-dire la présence ou non de la substance, sa quantité et la fréquence d'exposition, enfin la vulnérabilité de « l'enjeu » exposé, qu'il s'agisse d'un être humain, d'un animal ou d'un écosystème. L'ensemble permet l'évaluation du risque. Une très forte exposition à une substance faiblement dangereuse d'un enjeu vulnérable induit par exemple un risque non nul, mais faible.
En prévention, la meilleure façon de ne pas avoir d'ennuis avec une exposition est de faire en sorte qu'elle ne se produise pas. Pour y parvenir, la première méthode est que la substance ne soit pas présente, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas utilisée, qu'elle soit interdite si elle est déjà sur le marché mais cela suppose que nous sachions déterminer la cause initiale des problèmes observés. La deuxième méthode est de diminuer ou de réguler l'exposition, en mettant en place des protections individuelles ou collectives contre l'exposition.
L'une des difficultés majeures résulte du fait que l'interdiction peut être une mesure très symbolique, qui ne supprime pas le problème. Ainsi, le dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) est interdit en France depuis les années 1970, mais toujours présent dans le sol. Le problème est le même avec la chlordécone. L'interdiction d'un produit ne limite donc pas forcément sa présence et l'exposition.
La prévention passe, indépendamment du fait de connaître les substances présentes et leurs dangers, par une meilleure connaissance des voies d'exposition et de la vulnérabilité. Nous ne savons actuellement pas bien identifier toutes les voies d'exposition pour une substance donnée. Les modélisations peuvent nous aider, nous commençons à progresser et, en analyse de sécurité alimentaire, nous modélisons les expositions par l'eau, par les aliments…
La prévention passe à mon avis par l'interdiction des substances les plus dangereuses, une meilleure connaissance de l'exposition pour prendre des mesures de protection – équipements de protection individuelle pour une substance utilisée sur le lieu de travail s'il n'existe pas d'alternative, périmètres non traités… dans le cas d'une substance présente dans l'environnement, des précautions de bonnes pratiques sur le renouvellement de l'air intérieur par exemple – et par la maîtrise de la vulnérabilité. C'est probablement le point sur lequel nous sommes les moins avancés. Nous devons être capables d'identifier les populations ou sous-populations à risques, dans la population humaine ou parmi les espèces les plus vulnérables.
Dans le cas des populations humaines, les cibles classiques de la prévention sont les femmes enceintes, les enfants en bas âge. L'hypothèse de Barker – hypothèse qui est de plus en plus vérifiée – selon laquelle beaucoup de maladies chroniques trouvent leur origine dans des expositions in utero signifie que c'est à ce niveau qu'il faut agir. Les femmes enceintes ou en âge d'avoir des enfants doivent être protégées en priorité. Ensuite, la protection peut être étendue à différentes catégories de population mais, en commençant par cette cible, nous pouvons peut-être limiter une partie des problèmes de santé futurs.
Cet aspect concerne des vulnérabilités physiologiques à un moment clé, avec un passage possible de la mère à l'enfant de certains contaminants, des effets qui peuvent parfois se manifester non pas sur l'enfant lui-même mais sur sa propre descendance, comme dans le cas du distilbène. Ce sont les cellules reproductrices futures de l'embryon qui sont altérées et les enfants issus de mères ayant consommé du distilbène ont des problèmes de reproduction, parfois même les petits-enfants. Nous ne savons pas le nombre de générations sur lesquelles l'effet se transmettra.
Les effets portent aussi sur la bonne santé générale de la population. Une population en bonne santé n'est pas seulement une population non exposée à des contaminants, mais aussi une population dont les régimes alimentaires lui permettent d'être, globalement, en bonne santé, ce qui lui permet d'ailleurs d'avoir un microbiote qui la défend mieux contre les agressions extérieures. Nous « rebouclons » ainsi avec une vision très globale de la santé, qui ne passe pas uniquement par la réduction des expositions et la prévention, mais aussi par le fait que l'organisme exposé soit moins vulnérable parce que globalement en meilleur état physiologique.
Je pense que l'un des enjeux, en tout cas pour l'INRAE, est de démontrer ces phénomènes avec des cohortes et que cela puisse se traduire dans des mesures d'hygiène et de santé publique.
La gouvernance demande d'avoir une centralisation de l'information scientifique sur ces sujets. Il faut considérer le poids de la preuve scientifique par rapport aux pressentiments des gens. Cet aspect est de plus en plus compliqué. Nous avons sur ce point un vrai problème de gouvernance de la donnée et de l'information : comment l'information scientifique fait-elle encore foi ? Il est paradoxal de constater que si nous n'avons jamais eu autant d'informations, autant de données, la défiance vis-à-vis de l'information scientifique n'a jamais été aussi forte, à cause de soupçons de manipulation.
Il ne faut pas seulement que nous nous voyions tous les cinq ans pour faire un bilan. Il faut que nous ayons au fil de l'eau des indicateurs pour voir l'état du système qui nous intéresse, que nous fassions un suivi quasiment en temps réel des contaminations, des épisodes de santé qui apparaissent pour remonter très vite à leurs causes. La réactivité des systèmes d'information est peut-être trop faible à l'heure actuelle.
Je signalais ne pas trop aimer le terme d'« émergence », de « risque émergent ». Le risque n'apparaît pas d'un seul coup. L'émergence est surtout liée au fait que nous avons commencé à regarder là où nous ne regardions pas auparavant, ou avec des techniques qui ne permettaient pas la détection. Si nous n'avons pas cette capacité de veille permanente sur la qualité des milieux, la qualité de la santé, la capacité de croiser l'ensemble, nous perdons du temps dans des décisions de gouvernance publique qui consisteraient à interdire telle substance ou telle pratique à risque.
Un moyen d'avancer, au-delà de la gouvernance et des structures, serait d'agir sur la façon dont ces données sont collectées, mises à disposition et analysées. Nous avons des masses de données biologiques, des masses de données environnementales, d'analyses, nous sommes persuadés que le traitement des données massives en santé publique est un domaine duquel nous ne pouvons pas être absents. J'ai l'impression que nous ne sommes pas encore à la bonne « maille » dans ce domaine.
Cela pose beaucoup de questions de sécurité des données privées, parce que les données de santé publique, à la base, sont des données individuelles donc privées. Comment sont-elles anonymisées, utilisées ? Comment garantir la protection des citoyens, ce qui est un vrai sujet politique ? Comment ces données privées sont-elles utilisées par la puissance publique pour définir des programmes de santé ? Nous le faisons, nous avons des outils, mais lorsque nous parlons de données massives, il s'agit de données qui peuvent être collectées par d'autres informateurs, sur les réseaux sociaux par exemple, et utilisées par des entreprises spécialisées non pas dans la santé mais dans le traitement des données massives. C'est la problématique des géants du Web (GAFA).
Lorsque sont proposés sur Internet des diagnostics personnalisés, en envoyant un échantillon de microbiote par exemple, pour connaître le pourcentage de risque d'avoir telle ou telle maladie, les données échappent totalement à la personne qui a déposé son échantillon. Elles sont utilisées par d'autres, à une échelle mondiale. La gouvernance des données et la transparence de leur usage posent donc question.
Se donner la possibilité d'avoir un vrai système d'information des données de santé publique, qui ne contienne pas seulement des données de santé mais aussi les données permettant de faire le lien avec d'autres paramètres, pourrait permettre de progresser dans le domaine de la santé environnementale.

Le renversement de logique que vous proposez est passionnant. La notion de bonne santé viendrait d'une stratégie consistant à augmenter l'immunité de l'organisme pour le rendre moins vulnérable, plutôt que de courir toujours après le soin, une fois le problème présent. Il s'agirait d'anticiper à la base la résilience de l'organisme à toute atteinte que l'homme aurait paradoxalement créée.
C'est une idée dont nous n'entendons pas parler, si ce n'est par les médecines parallèles et certaines formes d'accompagnement diététique par exemple. Ce n'est pas du tout repris dans les stratégies de santé publique et c'est pourtant d'une réelle actualité comme nous venons de le voir avec la covid. Cette question de l'immunité de ceux qui ont été atteints par la covid se pose justement. Ceux qui ont été malades ont-ils développé une immunité, seront-ils capables d'échapper à une seconde vague, de résister à une autre attaque du même type ? Il me semble que nous avons là un champ d'investigation très intéressant à développer.
Je n'ai volontairement pas utilisé le terme « immunité ». L'immunité est un cas très particulier de réponse à la présence d'un pathogène. Je parlais plutôt de l'état de santé général mais c'est un peu la même idée. Il ne s'agit pas de dire que c'est suffisant et que nous pouvons donc faire n'importe quoi. C'est une façon d'aborder la question de la santé générale et c'est un peu la question que nous portons avec notre projet consistant à étudier comment les régimes alimentaires influent sur la santé de l'ensemble du système de production. Une partie des problèmes que nous voyons dans l'environnement tient au fait que certains régimes alimentaires induisent des demandes très fortes en tel type de protéines par exemple. Leur production a des impacts sur l'environnement.
Le régime alimentaire fait partie des éléments qui constituent l'exposome, avec l'environnement immédiat, avec le niveau social, avec le stress… Il contribue donc à construire ou non la bonne santé de l'organisme. C'est un levier sur lequel nous avons jusqu'à présent assez peu agi, parce que cela est compliqué, que tout le monde n'a pas les mêmes goûts, les mêmes moyens… Les états généraux de l'alimentation ont commencé à avancer dans cette direction mais nous ne sommes pas allés au bout de la démonstration.
Je n'affirme pas que c'est la panacée mais cela mérite de s'y arrêter. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place la cohorte NutriNet-Santé. Comme les données sont assez abondantes, nous commençons à avoir des présomptions. Par exemple, nous soupçonnons une relation entre consommation d'aliments ultra-transformés et cancer.
Ce ne sont que des présomptions. L'épidémiologie est toujours très difficile à moins d'avoir vraiment une manifestation clinique unique, ce qui est rare. Hormis le cas de l'intoxication au plomb et du saturnisme par exemple, il est très difficile d'affirmer que tel agent cause telle pathologie.
Malgré tout, avec de gros volumes de données bien renseignées, nous pouvons commencer à formuler des hypothèses qui poussent à aller plus loin dans la démonstration de la preuve. Nous ne savions pas le faire voici seulement dix ou vingt ans. Les réseaux sociaux et Internet nous permettent de le faire, en renseignant sur la base du volontariat. Il faut certes faire attention aux biais de sélection. Les épidémiologistes sont très prudents mais cela permet d'avancer.
J'ai évoqué les travaux que nous menons sur les microbiotes. Nous constatons, grâce à l'accumulation d'observations et d'expérimentations sur de « vraies gens » et non sur des cohortes numériques, que certains dysfonctionnements du microbiote intestinal sont très fortement associés à l'exposition à certaines substances qui provoquent des réactions et une inflammation intestinale chronique.
La recherche avance grâce à des outils de génétique moléculaire qui nous permettent de faire du séquençage massif et de sortir, à partir d'un seul échantillon, des milliers d'espèces de bactéries. Nous savons ainsi « qui est là ». Nous ne savons pas encore « qui fait quoi », mais nous constatons que certains syndromes sont associés à des anomalies de composition du microbiote dans le tube digestif. Dans certains cas, nous parvenons à remonter à l'exposition à des substances présentes dans l'alimentation, dans les céréales par exemple, avec les mycotoxines. Les intolérances alimentaires telles que l'intolérance au gluten ont-elles une base microbienne ? Nous en sommes de plus en plus persuadés. Ces intolérances alimentaires induisent un mal-être mais parfois aussi des maladies graves.
Nous recherchons donc les intermédiaires entre l'exposition et la réponse, notamment les microbes qui interviennent peut-être. Nous espérons mieux comprendre ces phénomènes et pouvoir les « piloter » par une alimentation adaptée. Je ne fais pas de la publicité pour les alicaments mais savoir restaurer un microbiote peut être un moyen de supprimer certaines pathologies, certaines manifestations indésirables.

Ces interventions doivent être sur mesure et personnalisées. Nous ne pouvons pas tirer une politique publique de ces constats. Comment voyez-vous cette question ?

En travaillant sur la prévention de l'obésité, y compris pour les futures mamans, lorsque nous constatons qu'une personne obèse a un microbiote perturbé, cela fait certainement partie des champs sur lesquels nous pouvons améliorer les politiques publiques, y compris dans le cas du diabète gestationnel.
Même si nous parlons souvent des futures mamans, la qualité des spermatozoïdes intervient aussi et c'est un ensemble dans lequel tout est lié.
Nous pouvons penser aux perturbateurs endocriniens pour lesquels la voie de contamination majeure est l'alimentation. Ces substances peuvent d'ailleurs être d'origine naturelle comme les phytoestrogènes.
Il est clair que l'emphase est mise sur le couple mère-enfant, peut-être parce que le suivi médical est plus institutionnalisé et que nous pouvons plus facilement faire des prélèvements d'échantillons à la naissance, avoir des informations sur la petite enfance. Récupérer le placenta ou le méconium d'un nouveau-né donne énormément d'informations sur ce à quoi la mère et l'enfant ont été exposés durant toute la gestation. C'est un outil de base pour les cohortes.
En ce qui concerne la qualité des cellules reproductrices, cela est effectivement valable pour les femmes comme pour les hommes et il ne faut pas négliger les hommes, bien au contraire. Les premières suspicions de l'impact sur la santé des perturbateurs endocriniens proviennent d'ailleurs de comptages spermatiques, d'études de la mobilité spermatique, au Danemark entre autres.
Il en découle des craintes pour la fertilité et surtout des craintes d'effets à long terme sur la descendance. Lorsque les télomères sont raccourcis, la durée de vie des cellules est modifiée, il peut exister des risques de prolifération cellulaire… Les effets sur l'aspect génétique et surtout épigénétique font penser que des effets transgénérationnels sont possibles sans passer par une mutation de l'ADN, mais simplement par l'état de méthylation de l'ADN, c'est-à-dire le fait que de petits groupements méthyle se fixent sur l'ADN ce qui modifie sa conformation et donc le fonctionnement cellulaire. Cette empreinte peut se transmettre à la descendance.
Nous le savons depuis longtemps et le danger concerne nombre de substances dont certaines d'origine naturelle. Dans le domaine de l'écotoxicologie, il existe des substances d'origine biologique qui sont tout aussi dangereuses que des substances de synthèse. Le débat n'est donc pas là, mais porte sur le type d'effets de la substance. Il existe des substances qui produisent un effet épigénétique, donc transmissible à la descendance, sans impact sur l'organisme parent mais avec un impact sur les enfants et les petits-enfants, réversible ou non selon les cas. Nous connaissons, d'un point de vue expérimental, ce phénomène pour quelques espèces dont des rongeurs, et nous pouvons penser qu'il existe aussi chez l'homme.
L'IFRES est une initiative de recherche en environnement-santé que nous avons portée en inter-alliances. Le domaine environnement-santé est éminemment pluridisciplinaire, puisqu'il concerne la biologie, les sciences de la santé, de l'environnement et les sciences sociales et humaines. Si nous pouvions, en inter-alliance, relancer la réflexion portée en 2013 par l'initiative IFRES, qui est encore d'actualité puisque les sujets n'ont pas énormément évolué, et si nous organisions une coopération efficace des organismes pour travailler sur ces questions, nous progresserions beaucoup.
Il ne s'agit pas de créer une nouvelle alliance mais que des organismes comme l'INSERM, l'INRAE, le CNRS, l'Institut Pasteur se donnent des objectifs communs. Il faut un vrai programme ambitieux en environnement-santé, avec une visée qui dépasse la production de connaissances, qui soit de contribuer aux politiques publiques y compris en termes de propositions d'évolution de la gouvernance.
En ce qui concerne cette dernière, nos collègues des sciences sociales peuvent nous aider car ces politiques publiques ne sont pas qu'une question de biologistes, de médecins, de chimistes… L'INRAE travaille beaucoup sur l'interdisciplinarité, nécessaire pour obtenir des transformations.
Il faut aussi que nous ayons l'ambition de construire des parcours de formation de nos futurs experts. Nous avons évoqué ce vivier d'experts trop peu abondant. Le dialogue avec les universités et les écoles est essentiel pour alimenter ce vivier. Nous l'avions inscrit dans l'initiative IFRES et nous pourrions le reprendre dans des politiques ultérieures.
Enfin, nous devons nous doter des instruments analytiques dont nous avons besoin pour être à la hauteur des enjeux. « Instruments » est à prendre au sens large comprenant les moyens de calcul scientifique.
Ce n'est pas la matière grise qui manque mais plutôt la coordination et la mise en cohérence. Il s'agit de passer de la volonté exprimée de s'organiser à des actes. Pour l'avoir expérimenté dans le domaine des infrastructures de recherche, j'ai constaté concrètement que les communautés de recherche, dans les laboratoires, ont leur propre dynamique. Leur dire « nous allons vous organiser une nouvelle vie et vous allez être mobilisés pour une grande cause nationale » peut se faire, mais ce n'est pas « gagné ». Il ne faut pas seulement mobiliser les ministères, les directions d'instituts mais il faut que cela percole.
Cette percolation a lieu sur certains sujets, sur le changement climatique par exemple, où les communautés de recherche se mobilisent, y compris dans leur vie de tous les jours, pour diminuer leur impact sur le climat. Ils prennent moins l'avion, utilisent moins de plastiques, chauffent moins les bâtiments. Même si cela paraît anecdotique, cela concerne des milliers de personnes et peut avoir un impact.
Dans le domaine de l'environnement-santé, je ne pense pas que nous en soyons à ce niveau de préoccupation dans nos communautés de recherche. Nous pouvons essayer d'y tendre et c'est aussi notre mission en tant que responsables d'organismes.

Nous connaissons tous la résistante naturelle aux changements de l'être humain. Je vous remercie pour ces échanges extrêmement intéressants et les pistes d'amélioration que vous nous avez suggérées. Votre participation permettra aux politiques d'essayer de décider de façon plus éclairée.
L'audition s'achève à quinze heures cinquante-cinq.