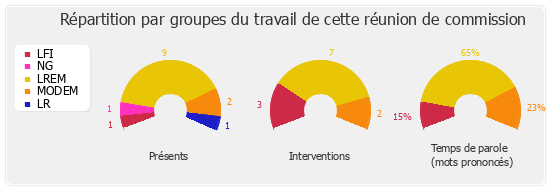Commission d'enquête chargée d'examiner les décisions de l'État en matière de politique industrielle, au regard des fusions d'entreprises intervenues récemment, notamment dans les cas d'alstom, d'alcatel et de stx, ainsi que les moyens susceptibles de protéger nos fleurons industriels nationaux dans un contexte commercial mondialisé
Réunion du jeudi 18 janvier 2018 à 9h35
Résumé de la réunion
La réunion
La séance est ouverte à neuf heures quarante.

Mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui MM Élie Cohen et Pierre Veltz, deux personnalités appréciées et remarquées pour la pertinence de leur regard sur les questions économiques et industrielles. Au cours de cette audition, qui sera un peu plus informelle que les précédentes, nous aurons un échange de vues sur les sujets que traite notre commission d'enquête.
M. Élie Cohen est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Auteur de plusieurs ouvrages, il a notamment écrit Le Décrochage industriel, paru en 2014. Avec Philippe Aghion et Gilbert Cette, il a aussi écrit en 2015 un livre sur les réformes nécessaires en France – vaste programme ! – qui est intitulé Changer de modèle.
M. Pierre Veltz a aussi une expérience riche et nourrie. Urbaniste de profession, titulaire d'un doctorat en sociologie, il a été président de l'établissement public Paris-Saclay, de 2010 à 2015. Il est aussi l'auteur d'ouvrages parmi lesquels on peut citer Le Nouveau monde industriel, paru en 2008, et La Société hyper-industrielle, le nouveau capitalisme productif, publié en 2017.
Avec le rapporteur, nous avons essayé d'organiser les thèmes que traite notre commission autour de deux volets.
L'un consiste, en quelque sorte, à faire de l'archéologie et à pratiquer l'autopsie de certaines décisions prises par l'État, notamment au moment de la cession d'Alstom Power, en 2014. Concentrée de diverses choses, cette opération vient de très loin : l'abandon d'un conglomérat à partir de l'éclatement d'Alstom-Alcatel et de la vente des chantiers navals en 1995. Elle intervient dans un contexte de mondialisation et d'une guerre économique qui utilise tous les moyens. Nous avons vu que l'extraterritorialité du droit américain n'était pas sans effets et qu'elle avait pu fragiliser certaines entreprises, notamment au moment de la cession d'Alstom Power. Nous serons très heureux d'avoir vos analyses sur ces sujets. Vous avez eu l'occasion, monsieur Cohen, de vous exprimer publiquement sur la cession d'Alstom Power à General Electric (GE).
Le deuxième volet, extrêmement vaste, est beaucoup plus prospectif. La première question, celle que pose régulièrement notre rapporteur aux personnes que nous auditionnons, est la suivante : qu'est-ce qu'un secteur stratégique justifiant une intervention de l'État pour protéger nos intérêts dans une économie mondialisée ?
La deuxième question est celle des outils utilisés pour assurer cette défense de nos intérêts. Notre législation est assez aboutie. Le décret Montebourg, dont on parle souvent, s'appuie sur un texte aussi ancien que la liberté de circulation des capitaux dans notre droit, qui date de 1966 et n'a jamais été remis en cause par l'Europe. Pourtant, tout cela n'est pas une évidence puisque, par exemple, le jour où M. Patrick Kron a décidé d'aller négocier la vente d'une entreprise aussi importante et stratégique qu'Alstom, il ne lui est pas venu à l'esprit que l'État pourrait avoir un droit de regard sur cette vente et pourrait s'y opposer. C'est dire le peu de cas qui est fait de notre droit en la matière dans notre pays ! Nos outils sont-ils performants ? Les Américains ont des systèmes beaucoup plus performants, sans parler des Chinois.
Tout cela conduit à d'autres interrogations sur l'organisation de nos entreprises – activité unique ou conglomérat – et sur la recherche. Les entreprises dont nous parlons sont généralement issues d'une collaboration fructueuse avec la recherche publique. On a changé de modèle. Est-on totalement adapté aux nouveaux défis en matière de recherche, si l'on compare la France aux pays avec lesquels elle est en compétition ?
Se pose aussi la question de la gouvernance de certaines entreprises comme Areva. L'effondrement d'Areva laisse perplexe. Y avait-il un conseil d'administration dans cette entreprise ? Le mode de désignation des présidents de ces entreprises – qui relève essentiellement du fait du Prince, même si les commissions parlementaires sont désormais censées avoir un mot à dire – peut laisser songeur. Est-ce vraiment adapté aux défis que doivent relever les entreprises dans la compétition mondiale.
Nous aimerions aussi avoir vos lumières sur une autre question, à la fois très importante, très ancienne et très rebattue dans notre pays : l'insuffisance du capital. Des personnes auditionnées ont utilisé l'expression « capitalisme sans capital » à l'égard de l'économie française. Comment diriger l'épargne vers les entreprises ? Peut-on imaginer que nous arriverons un jour à aller au-delà des tentatives faites au travers du Fonds stratégique d'investissement (FSI) puis de la Banque publique d'investissement (Bpifrance) ? Parviendra-t-on à mobiliser une part plus significative de l'épargne en faveur de l'économie donc d'entreprises dont la rentabilité ne sera assurée qu'à plus long terme ?
Voilà quelques-uns des très nombreux sujets de réflexion sur lesquels nous aimerions vous entendre. Vous serez certainement capables de relever ce défi consistant à nous fournir des idées intéressantes en très peu de temps. Je vous donne la parole pour un exposé liminaire d'une quinzaine de minutes chacun, puis nous passerons aux échanges avec les membres de la commission d'enquête.
Vous avez évoqué les problèmes d'archéologie industrielle et Pierre Veltz considère que c'est mon domaine. Je vais donc commencer par là. Vous ne pouviez pas mieux choisir comme point de départ que le sort de la Compagnie générale d'électricité (CGE), tant il est vrai qu'avec la cession de la partie ferroviaire d'Alstom, on a bouclé le dernier acte, le dernier chapitre de l'histoire de cette société.
Vous avez présenté d'emblée la Compagnie générale d'électricité comme un conglomérat technologique et vous avez voulu initier la réflexion sur le devenir de ce type de groupes.
La cession finale d'Alstom ferroviaire à Siemens ouvre la voie : nous pouvons comparer deux conglomérats technologiques dont l'un persiste encore et l'autre a totalement disparu. Cependant, je crois que ce n'est pas tout à fait la bonne façon de présenter l'histoire de la CGE car, avant d'être un conglomérat technologique, elle est la figure emblématique du capitalisme à la française et je dirais de la politique industrielle à la française.
Traditionnellement, on oppose deux conceptions de la politique industrielle, l'une étant appelée horizontale et l'autre verticale. Dans le cadre d'une politique industrielle horizontale, l'État n'a pas un rôle particulier à jouer dans la spécialisation industrielle d'un pays. La spécialisation se constate ex post en fonction des avantages comparatifs, des stratégies et développements des entreprises. Ainsi, on constate ex post qu'un pays est plutôt spécialisé dans tel secteur plutôt que dans tel autre. Il y a des indices de spécialisation relative par rapport aux voisins, plus ou moins marqués dans tel ou tel secteur.
La politique industrielle horizontale revient alors à créer toutes les conditions favorables au développement de cette activité par le biais de mesures fiscales, réglementaires ou sociales, de la commande publique, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche. En gros, elle consiste à créer l'environnement le plus favorable. Le rôle de l'État est de maximiser la localisation sur le territoire national des activités qui sont génératrices d'emplois, de recherche, de développement, de revenus, etc.
Selon cette conception horizontale de la politique industrielle, l'État est agnostique par rapport à la propriété du capital. Si des investisseurs étrangers viennent acheter nos « fleurons » mais qu'ils développent l'activité sur le territoire national, c'est très bien, on applaudit. Dans cette pure logique de maximisation de la valeur créée sur le territoire, le rôle de l'État est de favoriser au maximum cette activité et ces développements.
Cette conception horizontale est encore qualifiée de britannique. On lui oppose la conception verticale, dite française, selon laquelle l'État ne peut pas être indifférent à la nature des activités et à la spécialisation industrielle, parce que certaines spécialisations sont plus désirables que d'autres. Porteuses de plus fortes contributions, ces spécialisations désirables permettent de créer plus de richesses utiles au pays pour ses autres politiques stratégiques, notamment de défense.
Pour favoriser telle spécialisation plutôt que telle autre, l'État doit agir par des politiques sectorielles et volontaristes de spécialisation. La France a poussé très loin cette logique, mais d'autres pays comme le Japon l'ont également fait. En France, on a même inventé un modèle auquel j'avais consacré un bouquin, il y a très longtemps, et que j'avais appelé le « colbertisme high-tech. ». C'est le modèle des grands projets, des grands programmes etc. À partir de la vision d'un développement et d'une spécialisation nécessaires dans une activité industrielle déterminée, L'État met en commun les moyens de la recherche publique, de la commande publique, du développement d'infrastructures et du financement public pour faire en sorte qu'un ensemble naisse et se développe. C'est ainsi qu'ont été élaborés les grands programmes aéronautiques, spatiaux, dans les télécoms et dans le ferroviaire.
La Compagnie générale d'électricité est la parfaite illustration de ce modèle puisqu'elle a chevauché plusieurs grands programmes : les télécoms avec Alcatel, le ferroviaire, celui de la génération électrique. Elle a même essayé de faire un bout de chemin dans le nucléaire avant d'abandonner pour se concentrer dans l'îlot conventionnel des centrales électriques quand la France a choisi le réacteur à eau pressurisée et a écarté le réacteur à eau bouillante.
La CGE est le prototype de ce modèle. Elle a bénéficié de la recherche publique, notamment des travaux du Centre national d'études des télécommunications (CENT) dans le domaine des télécoms. Elle a bénéficié de la protection de l'État qui, par le biais de la commande publique, a favorisé les technologies développées. Elle a bénéficié des grands programmes d'équipements comme le plan Delta LP dans les télécoms. En plus de tout cela, le financement même de son activité était assuré par le biais d'avances accordées par une grande administration de l'époque, la direction générale des télécommunications (DGT). La stratégie d'internationalisation d'Alcatel a été partiellement financée par France Télécom à travers toute une série de techniques.
Qu'est-il arrivé ? Dans un premier temps, ce modèle a été un formidable succès puisqu'il a permis un rattrapage dans les domaines de la téléphonie et du ferroviaire, et la réalisation des grands plans d'équipement du territoire. Dans un deuxième temps, le modèle s'est épuisé pour plusieurs raisons. Premièrement : les objectifs fixés ont été atteints. Deuxièmement : avec l'adoption des réglementations de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l'Union européenne, certaines pratiques jusqu'alors banales comme les subventions directes ou croisées et les transferts gratuits sont devenues impossibles. Troisièmement : l'entreprise ayant réussi, elle a elle-même aspiré à un développement international, à réussir sa mondialisation, d'où les incursions du groupe de la Compagnie générale d'électricité en Chine dans la génération électrique et aux États-Unis dans les équipements télécoms. Le groupe est devenu international.
Une fois devenu mondialisé et présent dans des activités aussi diverses que la presse, les télécoms, la génération électrique, la construction navale et les machines-outils, il est difficile de mener à bien tous ces développements en même temps. C'est d'autant plus difficile que la vertu du conglomérat technologique est évidente lorsque les transferts technologiques viennent pour l'essentiel de la recherche publique. Quand un groupe doit financer lui-même des efforts spécifiques de recherche dans chacun des domaines où il entend être présent, la tâche se révèle rapidement impossible. Au bout d'un moment, la Compagnie générale d'électricité a dû se spécialiser. Cette stratégie s'est d'autant plus imposée que de nouveaux acteurs étaient apparus, notamment des entreprises chinoises. En quinze ans, deux petits acteurs chinois, inconnus dans le domaine de la construction ferroviaire, sont devenus, en fusionnant, le premier groupe mondial du secteur. C'est compréhensible : en France, il faut se battre en duel pour construire cinquante kilomètres de ligne à grande vitesse (LGV) alors qu'en Chine on construit des lignes de 1 500 kilomètres. Les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. Pour résumer, dans un contexte de mondialisation et de nouvelles réglementations, l'impératif de spécialisation devient plus important.
Autre élément important : ces grands groupes français, comme vous l'avez indiqué dans votre intervention liminaire, étaient faiblement capitalisés. Cette faiblesse tient au modèle français de financement des entreprises, qui repose beaucoup plus sur la dette que sur le capital. Le taux d'autofinancement actuel des entreprises allemandes est de 120 % alors que celui des entreprises françaises est de 80 %. Les entreprises allemandes sont depuis longtemps productrices nettes d'épargne alors que les entreprises françaises continuent à dépendre largement de financements extérieurs. Or pour les activités très capitalistiques et à cycles très longs dont nous parlons, il est nécessaire d'avoir des ressources en capitaux qu'une entreprise du type de la Compagnie générale d'électricité – qui n'a jamais été une vraie entreprise de marché et a toujours beaucoup dépendu des financements de l'État – n'est pas capable d'assurer.
Les entreprises ont d'autant plus ressenti le besoin de se spécialiser et de se concentrer qu'elles ont été confrontées au même moment à la révolution de l'internet et à la montée d'acteurs nouveaux dans les télécoms comme le chinois Huawei.
Elles ont eu besoin d'investir beaucoup, de prendre le tournant de la 4G et de la fibre. À ce moment-là, il a été décidé de casser la Compagnie générale d'électricité en deux pôles, l'un organisé autour des télécoms et l'autre autour de la génération électrique et du secteur ferroviaire.
Cette partition n'a pas suffi. Les acquisitions d'entreprises de l'internet américaines, effectuées dans le cadre du développement dans les télécoms, se sont révélées catastrophiques. La Compagnie générale d'électricité a payé très cher pour rien : sitôt les opérations réalisées, les créateurs et les principaux dirigeants de ces entreprises américaines sont partis. Ces mauvais choix ont entraîné des pertes importantes et l'affaiblissement du pôle « télécoms ». Quant au pôle « électrique et ferroviaire », il a aussi souffert de grandes difficultés : l'activité dans les turbines, rachetée au groupe ABB, a occasionné de lourdes pertes car la technologie était défectueuse.
Le modèle colbertiste s'est ainsi délité progressivement sous l'effet combiné des pressions de la mondialisation, de l'intégration européenne et de certains choix industriels qui se sont révélés malheureux. Il y a eu une lente descente aux enfers. Le groupe ne pouvait que subir durement tout choc exogène violent comme un retournement économique. C'est ainsi qu'est arrivé le premier plan de sauvetage d'Alstom, négocié par Nicolas Sarkozy et Mario Monti, le commissaire européen à la concurrence. Selon la procédure classique, pour aider l'entreprise à s'en sortir et dans la mesure où l'État devait intervenir, il a fallu faire des cessions. Les Chantiers de l'Atlantique ont été vendus. Cela n'a pas suffi. Les éclatements successifs ont abouti à la disparition pure et simple du groupe.
Quand on fait de l'archéologie, il faut être lucide et ne pas se payer de mots. Dire qu'on est en train de faire des « Airbus » du ferroviaire, de l'électrique ou de la construction navale, revient à se payer de mots. On est en train de mettre le point final à une aventure industrielle qui a été particulièrement coûteuse. Mettons néanmoins un bémol : après tout, si tout cela permet le maintien sur le territoire national des compétences, de l'activité et de la recherche dans les domaines des télécoms et du ferroviaire, où est le problème ? On revient à une conception de type britannique de la politique industrielle. C'est sur le territoire national que vont continuer à avoir lieu les développements scientifiques et technologiques majeurs tels que la 5G ou les trains du futur. Si nous conservons la technologie et la maîtrise scientifique, si les activités et des centres de commandement locaux continuent à prospérer sur notre sol, après tout, on sera sorti d'un modèle colbertiste pour entrer dans un modèle plus classique ou le rôle de l'État est de négocier au mieux les avantages comparatifs du territoire national pour maintenir sur place les compétences et les activités nécessaires.
Est-ce le cas dans l'affaire Alcatel ? Je crains que non pour deux ou trois raisons assez évidentes. L'actuel Nokia est le produit du regroupement de Nokia, d'Alcatel, de Nortel, de Lucent et de Siemens Télécoms. Il y a eu tellement de branches agglomérées et fusionnées que l'entreprise doit nécessairement faire des choix en matière de lignes de produits et de filières technologiques. Les arbitrages en cours ne sont pas nécessairement en faveur des filières françaises, comme cela risque d'être le cas pour les développements de la 5G. Il y a malgré tout un coût à perdre le contrôle de certaines activités, lorsque des entreprises nées de rameaux différents finissent par se concentrer et se déployer sur un axe qui n'est pas nécessairement favorable à celui qui a été longtemps privilégié au niveau national.
Quelle a été la stratégie de la France dans ces cas-là ? Nous en arrivons à la fin du processus. Le Gouvernement actuel a cherché à négocier au mieux la présence de ces activités sur le territoire national, en essayant d'obtenir le maximum de garanties. Dans le cas des Chantiers de l'Atlantique, le groupe Fincantieri a donné des garanties sur le maintien de l'activité et des compétences sur le sol national, et sur la protection de la propriété intellectuelle. Des conditions ont ainsi été mises au transfert éventuel des compétences aux partenaires de Fincantieri, notamment à China State Shipbuilding Corporation (CSSC) qui cherche à monter en gamme. On essaie de prendre des garanties et de développer l'activité sur le sol national, mais on renonce à l'idée que l'État joue un rôle spécifique dans le développement et la présence d'activités et de compétences maîtrisées sur le territoire national, sous contrôle de capitaux nationaux.
Élie Cohen est un excellent médecin légiste ! Il a parfaitement décortiqué le cadavre. Nous sommes clairement en train de vivre la fin d'un cycle. Ne soyons pas totalement négatifs et reconnaissons que ce fameux colbertisme a bien fonctionné dans certains domaines comme l'aéronautique et les filières énergétiques où nous ne nous en sortons pas si mal.
Les changements actuels nous arrivent de multiples horizons et possèdent de multiples facettes. La montée du digital, de la numérisation, se ressent dans tous les secteurs. Quant à la mondialisation, nous ne savons pas très bien quel tournant elle est en train de prendre. Pour certains, nous serions dans une phase de démondialisation. Le commerce international a augmenté moins vite que le PIB mondial pendant quelques années, ce qui les a fait conclure à une démondialisation. Depuis deux ans, ce n'est plus le cas. Nous constatons la montée de la Chine, une bonne reprise de l'industrie américaine et une évolution positive de l'industrie européenne.
Dans ce cadre nouveau, comment peut-on redéfinir la politique industrielle et le rôle de l'État ? Faut-il laisser jouer les forces du marché le plus librement possible, tout en aménageant leurs conditions générales, conformément à la politique horizontale ? Faut-il redéfinir des politiques verticales, sachant qu'elles ne peuvent plus être identiques à celles pratiquées par le passé ?
Dans vos propos liminaires, monsieur le président, vous avez mis l'accent sur la notion d'industries et d'entreprises stratégiques pour le pays. Que faut-il garder ? Quel type de contrôle faut-il conserver sur les fusions-acquisitions, les réorganisations, les restructurations internationales ? Pour répondre à ces questions, il faut se placer dans une perspective plus large et essayer d'avoir une vision de notre économie future sur le territoire, en partant du fait que les grandes entreprises sont désormais présentes dans le monde selon un modèle de développement extrêmement extraverti. Dans ce contexte, quel est le rôle de l'État ?
Cette réflexion conduit à se poser une série de questions. Quel est le champ de ce qu'on appelle la politique industrielle ? Dans le livre que vous avez cité, je mets beaucoup l'accent sur l'intégration – pour ne pas dire la fusion – progressive entre les secteurs des services, en tout cas des services entre entreprises (business to business – B to B) dans lesquels la France occupe des positions relativement fortes grâce à des sociétés comme Atos ou Dassault Systèmes. Que devient la relation entre les services et le monde manufacturier traditionnel ? Il suffit de regarder autour de soi pour constater que, notamment sous l'effet du numérique, la frontière est devenue extrêmement floue entre ces deux mondes.
Or toutes nos institutions et nos organisations, qu'elles soient patronales ou syndicales, et la construction même de nos statistiques continuent à séparer ces deux mondes de manière assez rigide. Les politiques de compétitivité, je pense au rapport Gallois, ont été extrêmement centrées sur le monde manufacturier et son relatif décrochage qui est indéniable. Pour ma part, je pense qu'il faut adopter une vision plus large. Il ne s'agit pas seulement d'une question de nomenclature ou de définition de périmètre. Il y a là un enjeu de fond, ne serait-ce que parce que les infrastructures générales, je pense aux questions de normes, continuent à séparer ces deux mondes de manière très rigide.
Ce constat peut conduire à des conclusions assez différentes. Certains économistes – Lionel Fontagné et son équipe, par exemple – estiment qu'à ce stade d'intégration entre les services et l'industrie, on peut imaginer une France « industrielle » mais factory free, c'est-à-dire sans usines. C'est une nouvelle version du fameux concept de fabless utilisé par Serge Tchuruk au début des années 2000. L'ancien PDG d'Alcatel avait provoqué un véritable séisme, d'ailleurs à sa grande surprise. Ces économistes tiennent un raisonnement qui rejoint un peu les propos d'Élie Cohen : tant qu'on garde chez nous certaines activités et la R&D, on peut avoir une industrie au sens large du terme, ce que j'appelle une hyper industrie, qui soit performante tout en n'ayant plus d'activité manufacturière sur le territoire.
Pour ma part, je suis très opposé à cette idée. À mon avis, elle témoigne d'une grande méconnaissance de la complexité des fonctions manufacturières, au sens étroit du terme. Ceux qui ont visité des usines modernes savent que ce sont des objets extrêmement sophistiqués qui ont besoin d'un environnement technologique très avancé. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'avenir de l'industrie manufacturière mondiale n'est pas essentiellement dans les pays émergents, en tout cas pas dans la grande masse de ces derniers. Certains pays comme la Chine et d'autres tirent actuellement leur épingle du jeu, mais l'avenir appartient plutôt à des pays plateforme qui seront en nombre assez limité car les compétences exigées seront extrêmement pointues.
Le mouvement de robotisation et la balkanisation des dérégulations montrent que nous sommes très loin de la mondialisation lisse et homogène que nous avions imaginée à un moment. On voit des formes de retour de la production dans des pays développés, même si le mouvement reste encore relativement marginal. American Apparel a ainsi créé, à grand renfort de publicité, une grosse usine de textile-habillement sur le sol américain mais qui utilise très peu de main-d'oeuvre. Le secteur du textile-habillement est assez typique : la production a été complètement déléguée à des pays à faibles coûts salariaux parce que c'était une industrie très intensive en main-d'oeuvre ; après le textile, l'habillement devient extrêmement robotisé, ce qui va provoquer une très importante redistribution des cartes.
À mon avis, il est extrêmement dangereux de penser que l'on peut séparer durablement les centres de conception, la distribution, la logistique et le marketing de la fabrication. Pour bien concevoir les produits, il faut une interaction permanente avec les usines. Il est donc très important de garder des usines sur le sol national. Ce n'est pas du tout contradictoire avec l'idée qu'il faut aussi réfléchir à améliorer la qualité et l'efficacité de nos grands services. En fait la compétitivité est globale.
Quand on compare l'industrie manufacturière de la France à celle de l'Allemagne, comme cela a été fait dans le rapport Gallois et d'autres, on ne peut pas se limiter au monde manufacturier. En moyenne, les exportations manufacturières françaises intègrent entre 30 % et 40 % de services. Le coût et la qualité de ces services sont donc absolument essentiels. En moyenne, ces exportations intègrent aussi quelque 30 % de composants achetés. Dans ce domaine, l'Allemagne a été beaucoup plus efficace que nous parce qu'elle a mobilisé toute son « arrière-cour » – je n'y mets aucune connotation péjorative – des pays d'Europe de l'Est, ce que nous n'avons évidemment pas été capables de faire. Nous devons absolument avoir une vision globale. Ce qui nous manque, c'est d'avoir une vision stratégique du territoire, de la manière dont il sera équipé en services numériques et en industries manufacturières.
Sans revenir sur les concepts de politique industrielle développés par Élie Cohen, je dirais que nous éprouvons actuellement une grande difficulté à définir ce qu'est un secteur industriel. L'idée de politique industrielle verticale est très liée aux filières et à secteurs industriels, mais il y a actuellement beaucoup de discussions autour de ce vocabulaire.
L'une des caractéristiques du nouveau monde dans lequel nous entrons, c'est une extraordinaire hybridation technologique qui est transversale à beaucoup de secteurs. Le numérique pousse à cela de manière extrêmement puissante, ce qui fait que les frontières jusqu'alors traditionnelles entre les secteurs sont très largement bousculées. Après avoir développé des logiciels de calcul de structures pour les avions, Dassault Systèmes travaille à présent dans des domaines variés comme l'urbanisme ou la santé. Les systèmes techniques actuels sont très ouverts et peuvent difficilement se réduire à la notion de filière.
En France, je ne vois guère qu'un domaine où la notion de filière reste encore très forte : l'aéronautique et le spatial, des secteurs qui sont liés à la défense. Ce n'est pas un hasard si c'est dans ce domaine que les institutions de filière fonctionnent le mieux. Même le secteur de l'automobile est complètement percuté par des technologies exogènes : le numérique, comme le montrent les tentatives d'entrée des GAFA ; le passage du moteur thermique au moteur électrique, qui représente un vrai changement de système technique. La question des batteries est absolument stratégique pour l'avenir de la France. Or le monde des batteries n'a vraiment rien à voir avec le monde de la mécanique traditionnelle, voire de la mécatronique.
Pour ma part, je raisonnerais plutôt à partir des nouveaux systèmes techniques qui sont en train d'émerger et qui sont centrés autour de grands sujets sociétaux, comme la santé et la mobilité. Le devenir de l'automobile s'analyse en termes de mobilité, on peut le constater à la manière dont les industriels conçoivent désormais leur métier. Ils comprennent qu'ils vont devoir proposer des services et ne plus se contenter de vendre des objets, et ils sont d'ailleurs assez mal armés pour ce faire. Ils vendent déjà des services financiers mais ils n'en sont pas à considérer la voiture comme un service de mobilité. Le changement de posture est culturel et profond.
Les nouveaux systèmes sociotechniques, qui s'organisent autour de la mobilité, demandent de nouvelles infrastructures physiques et normatives. C'est là que la puissance publique a un rôle à jouer : il faut équiper le territoire en stations de recharge électrique, adapter la régulation aux voitures autonomes, etc. Ce changement de système ne peut pas être totalement pris en charge par les entreprises, ne serait-ce que parce qu'il implique des adaptations normatives qui ne sont pas de leur ressort. Or les normes sont absolument stratégiques, ce que nous avons toujours eu du mal à comprendre en France. Il faut aussi repenser le système de propriété intellectuelle. Tout cela ne peut pas se faire sans l'État.
La santé est l'exemple type de l'imbrication entre l'industrie et les services. À mon avis, la technologique appliquée à ce secteur représente un enjeu central des prochaines décennies. Alors que le génie mécanique et l'ingénierie informatique n'avaient aucun rapport avec le domaine du vivant, nous assistons désormais à une fusion des deux mondes. Dans le domaine de la recherche, les grandes universités américaines créent des instituts mixtes où les roboticiens travaillent avec les médecins, les ingénieurs et les biologistes.
Du côté du marché et de la demande, on constate que l'on ne peut plus séparer le médicament des appareils médicaux, alors que les entreprises pharmaceutiques ne sont absolument pas équipées pour gérer ces dispositifs. Prenons le traitement du diabète. Sur le papier, il paraît très simple d'assurer une surveillance permanente grâce à un système qui associe une pompe à insuline sous-cutanée et un capteur de glycémie sans aiguille. Le dispositif fonctionne en boucle fermée avec un contrôle automatique du débit de base de la pompe. En fait, cela ne se développe pas vraiment pour des raisons purement économiques mais aussi parce que ces grandes entreprises pharmaceutiques n'ont pas cette culture du dispositif médical.
Le changement de système passe par la même trilogie : industrie-services-numérique. Si l'État n'intervient pas pour fixer des règles et créer de nouvelles infrastructures, nous n'allons pas nous en sortir.
L'une des manières d'avancer consisterait à lancer des expérimentations en vraie grandeur. Avec le programme d'investissements d'avenir (PIA), on a multiplié les petites expérimentations. Il est temps de sortir de l'ère des démonstrateurs. Il faut ajouter au zéro aux montants en question pour mettre en place des expérimentations lourdes sur des territoires entiers à une échelle industrielle.
Prenons l'exemple de la mobilité. Il est clair que le déploiement de la voiture électrique est une évolution inéluctable. Or, en France, son développement se fait dans un certain désordre. Nous ne mettons pas toutes les chances de notre côté pour être en position de leadership international alors que nous disposons de tous les atouts nécessaires. Il serait bon de lancer une expérimentation à grande échelle, en choisissant une ou deux villes où mettre le paquet. Tout le monde en tirerait des enseignements : les industriels, les collectivités, les services.
Là réside le nouveau modèle de la recherche. Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a constitué une aventure formidable mais ses recherches se limitaient au laboratoire. Aujourd'hui, en matière de mobilité ou de santé, le laboratoire, c'est la société tout entière.
Grâce au grand emprunt et au PIA, nous avons beaucoup avancé. J'ai présidé récemment le jury de l'appel à manifestation d'intérêts de l'action « Territoires d'innovation de grande ambition » dont le cahier des charges était extrêmement ouvert et, avec les membres du jury, nous avons été très heureusement surpris de la qualité des projets qui nous ont été soumis. Les financements devraient toutefois passer à l'échelle supérieure.
Pour terminer, je distinguerai quelques sujets clefs pour une nouvelle politique industrielle et territoriale.
Il y a d'abord toutes les questions relevant de la fiscalité du capital et des charges qui restent très largement non résolues. Les taux de marge des entreprises sont trop faibles. Il faut absolument les reconstituer.
Il y a ensuite les politiques d'innovation pour lesquelles l'État consacre beaucoup d'argent : 10 milliards d'euros, soit 25 % de plus que le budget du ministère de la justice. Elles sont loin d'être optimales car les dispositifs sont très dispersés : soixante-deux au niveau national et quatre-vingt-neuf au niveau régional, selon un rapport de France Stratégie. Les patrons de PME ne peuvent pas passer leur vie à rechercher le dispositif le plus adapté. C'est une excellente chose que les régions reprennent la main en ce domaine mais il faut éviter les superpositions. Mieux vaudrait régionaliser certains dispositifs nationaux que de les faire coexister avec les dispositifs propres aux régions et aux métropoles.
Enfin, il y a la formation. Celle des ingénieurs n'est pas en cause : nous savons qu'elle est reconnue au plan international. Le grand sujet de préoccupation est la formation des techniciens et des opérateurs qualifiés. Un même lamento se fait partout entendre : les directeurs d'usine ne parviennent pas à recruter, y compris dans les régions où le taux de chômage est élevé. Les usines modernes sont extrêmement sophistiquées et nécessitent un personnel qualifié. Quand j'ai interrogé des proviseurs du bassin minier du Pas-de-Calais où j'ai travaillé ces dernières années, j'ai été effaré de constater que deux fois sur trois, ils répondaient qu'ils regrettaient de ne pas envoyer assez d'élèves dans l'enseignement général. C'est d'une certaine manière un drame français. Le défi stratégique est de valoriser la formation professionnelle, d'opérer une montée en gamme, de travailler avec le monde des entreprises. Il faut former cette jeunesse qui ne demande qu'à travailler et lui montrer qu'occuper un job passionnant dans le monde industriel, c'est mieux que d'être chômeur après avoir fait des études de psychologie à la fac !

Monsieur Cohen, doit-on vous laisser à votre rôle de médecin légiste ou voulez-vous apporter des compléments ?
Je suis assez largement d'accord avec Pierre Veltz mais pour éviter les redites, je vais examiner la question sous un autre angle en m'attachant aux actions lancées par le nouveau Gouvernement et le Président de la République en matière de politique industrielle.
Nous pouvons en distinguer trois types différents.
La première action tend à préserver l'emploi industriel et une capacité manufacturière dans des secteurs qui ont connu des difficultés et qui ont fait l'objet de restructurations majeures comme cela a été le cas des Chantiers de l'Atlantique. L'idée directrice est de se préparer au plein déploiement des technologies nouvelles de la French Fab.
Nous connaissons une grande révolution manufacturière. L'usine du futur est en train de se dessiner sous nos yeux : largement numérique, elle combine les techniques de l'intelligence artificielle, du big data, de la virtualisation et de la robotisation. Les nouveaux acteurs industriels ne sont pas du tout ceux auxquels on s'attend. Si je devais dire quelle entreprise est au coeur de la nouvelle industrie, je citerai également Dassault Systèmes. J'ai visité une usine dont la modélisation avait été conçue par leurs services et qui utilisait les outils d'intelligence industrielle de la société BrainCube qui permettent de connecter les machines entre elles, de corriger en temps réel les éventuelles pannes et d'organiser des dérivations de production.
La deuxième action est le financement des innovations de rupture. Le fonds de 10 milliards d'euros qui leur est dédié sera alimenté par des cessions d'entreprises publiques ou semi-publiques. Cela correspond à la volonté de faire de la France une start-up Nation : tout miser sur l'innovation disruptive pour renouveler profondément le modèle économique et le modèle industriel en favorisant le financement d'une partie du cycle de vie de l'entreprise. Nous savons en effet que l'un des grands problèmes en France n'est pas la création d'entreprises – il y a autant d'entreprises nouvelles chez nous que chez nos voisins, si ce n'est plus – mais la capacité à les faire croître jusqu'à une taille intermédiaire.
Nous comprenons bien l'idée sous-jacente : gérer le déclin progressif de l'ancienne industrie et favoriser l'éclosion de la nouvelle industrie. Le problème est que ces évolutions ne suivent pas du tout le même rythme. Du côté de l'industrie, il y a un processus massif ; de l'autre, des effets macroéconomiques qui se réduisent à des chiffres infinitésimaux. D'où la difficulté extrême dans laquelle nous sommes. Dans les domaines décisifs que sont la robotique, l'intelligence artificielle, le big data, la cybersécurité, la virtualisation, on ne trouve aucune entreprise française aux cinq premiers rangs mondiaux. On peut même se demander si cette start-up Nation ne s'appuie pas avant tout sur un phénomène d'inflation verbale car les chiffres ne sont pas au rendez-vous.
La troisième action passe par le fameux Grand plan d'investissement. Il conduit à rapatrier dans les ministères les fonds nécessaires et à sortir de la logique d'agence indépendante qui était celle du Commissariat général à l'investissement (CGI). Je ne vous cache pas que je n'approuve pas cette évolution, même si je suis un peu juge et partie puisque j'ai participé à la création du CGI et à l'élaboration des programmes d'investissements d'avenir. Je comprends la logique à l'oeuvre : les ministères ne peuvent pas seulement être porteurs de mauvaises nouvelles avec les restrictions budgétaires ; il faut leur laisser aussi la maîtrise de quelques programmes de développement mobilisateurs.
Toutefois, je ne vois pas beaucoup l'avantage qu'il y aurait à retourner à un cadre administratif traditionnel, d'autant que l'expérience du PIA a été plutôt réussie, notamment pour ce qui est de sa gouvernance et des modalités de sélection, de suivi et d'évaluation des projets.
De plus, on peut craindre que cette évolution administrative ne rende plus difficile de mener des stratégies plus intégrées alors que c'est le type même de démarche qu'il faudrait appliquer à la nouvelle industrie qui est en train d'émerger. Une industrie qui déjoue les définitions sectorielles traditionnelles car elle élabore avant tout des solutions : solutions de mobilité, de santé, d'efficacité énergétique, de bien-vivre ensemble dans le cadre de nouvelles conceptions de l'urbanité et de l'urbanisme.
Il faut réfléchir aux instruments disponibles sans remettre en cause ce qui marche et prendre pleinement conscience de ce qu'est cette nouvelle industrie.

J'aimerais revenir sur la mobilisation du capital.
Pour l'innovation et la croissance des start-up, il y a le plan de 10 milliards d'euros qui prolonge ce qui avait été fait avec Bpifrance.
Un problème de financement du long terme se pose dans les secteurs lourds où la mondialisation et une concurrence accrue ont conduit à une concentration des entreprises. La rentabilité à court terme n'est pas très élevée. Aucune solution satisfaisante n'a été trouvée alors que ce constat est établi depuis longtemps. Comment, selon vous, améliorer la mobilisation de fonds pour alimenter cette économie ? Nous avons pu voir à quelles difficultés se sont heurtés les tours de tables organisés pour sauver Alstom en 2004 et PSA en 2015. On a su inventer un modèle pour le logement. Quel pourrait-il être pour l'industrie ?
Il y a un fait sur lequel on ne met jamais l'accent : tout est organisé dans notre fiscalité et dans notre système de financement pour favoriser l'endettement au lieu des fonds propres et du capital. Si une entreprise dispose d'un système plus avantageux pour se financer par la dette, elle n'a pas intérêt à investir du capital. À cela s'ajoutent la fiscalité du capital, même si elle a connu quelques progrès récemment, avec le prélèvement forfaitaire unique notamment, et la faible rentabilité des activités industrielles. Enfin, quatrième élément : toutes les percées réglementaires et prudentielles effectuées ces dernières années visent à « dérisquer » le bilan des banques et des assurances, avec les accords de Bâle et les directives « Solvabilité ». Tout cela fait que l'investissement en capital est fortement pénalisé.
Si ni les acteurs institutionnels, ni les particuliers ne sont incités à investir et que l'État se retire, d'où voulez-vous que viennent les financements ? Vous me répondrez sans doute qu'il y a les financements par les marchés et vous aurez raison. Les entreprises françaises du CAC40 sont très largement détenues par des investisseurs étrangers.
Doit-on penser cette mutation profonde seulement à l'échelon national ou faut-il prendre en compte l'échelle européenne ? C'est un sujet complexe. Pensons à la mobilisation de l'épargne : il est frappant de constater que les excédents considérables qui existent en Allemagne ne sont pas consacrés à l'investissement en Europe. Ce serait une excellente nouvelle si ces sommes étaient investies non seulement dans les pays en difficulté mais aussi en France.

Je vous remercie, messieurs, pour vos interventions passionnantes qui éclairent grandement les membres de notre commission.
Vous avez fait le constat que nous arrivions au terme du colbertisme, caractérisé par une vision verticale où l'État oriente les investissements, la fiscalité et les efforts économiques vers les secteurs qu'il juge stratégiques. Vous avez rappelé tous les désavantages que cela comporte en économie ouverte et les travers quotidiens que cela représente pour les entreprises. Une telle vision induit toujours le risque de passer à côté de secteurs nouveaux, plus porteurs en termes d'emplois et de savoir-faire pour l'avenir. Pensons à la mobilité et ses innovations que sont la route intelligente, les véhicules autonomes, le partage de véhicules. Or, sur l'échiquier politique, il y a toujours une tentation colbertiste. S'exprime encore le regret que l'État ne soit pas assez stratège, n'intervienne pas assez pour défendre nos champions nationaux, champions anciens qui ne sont pas les champions de demain. Le colbertisme est-il vraiment mort ?
Ma deuxième question porte sur les investissements étrangers et les intérêts nationaux. Nous ne pouvons pas nier qu'il y a des secteurs qui relèvent de nos intérêts vitaux, qu'il s'agisse de la défense, de la sécurité nationale, du nucléaire. Sommes-nous bien outillés pour les protéger des investisseurs étrangers malveillants ? À quel niveau fixer le seuil maximum pour les investissements étrangers ?
Ma troisième question concerne les entreprises étrangères. Un représentant syndical nous a dit que ce qui comptait pour lui, ce n'était pas la nationalité de l'investisseur mais la stratégie qu'il entendait mener. Beaucoup de questions que nous nous posons au sein de cette commission renvoient non pas à la nationalité des investisseurs mais à la capacité à détecter les difficultés des entreprises avant qu'elles n'en arrivent au stade dramatique des plans sociaux. Dispose-t-on des bons outils pour identifier ces difficultés et aider les entreprises à opérer un retournement stratégique ? N'a-t-on pas intérêt à sortir de la vision négative de l'investisseur étranger pour se focaliser sur la stratégie économique des entreprises, comme nous y appelait ce syndicaliste ?
J'aime bien votre expression de « tentation colbertiste ». J'ai essayé d'expliquer pour quelles raisons structurelles le colbertisme à la française avait buté sur des difficultés politico-institutionnelles majeures et sur les trajectoires d'entreprises devenues suffisamment grandes pour ne plus accepter cette intervention. Les acteurs français en ont été tellement conscients qu'il y a eu au début des années 2000 une tentative de colbertisme à l'européenne. Souvenons-nous de l'insistance de Jean-Louis Beffa sur la nécessité de développer un Google européen ou des grands projets visés par l'Agence de l'innovation industrielle (AII) qui se sont heurtés aux règles relatives aux aides d'État.
Le plus bel exemple de colbertisme à l'oeuvre aujourd'hui se situe en Chine et c'est un succès. Il a permis l'émergence de Tencent, Alibaba, Baidu face aux GAFA américains. Pour passer d'un statut de sous-traitant au statut de leader mondial du secteur des télécoms, Huawei a bénéficié de la combinaison des commandes publiques, de la protection nationale, d'un certain usage de la propriété intellectuelle, de financements sur fonds publics, de la mise à disposition de terrains gratuits. Cela m'a rappelé les développements d'Alcatel du temps de ma jeunesse.
Une solution colbertiste au niveau européen serait-elle possible ? La tentation se fait jour à nouveau avec le numérique : s'il n'y a aucune grande entreprise européenne pour faire face aux Baidu, Alibaba, Tencent d'un côté et aux GAFA de l'autre, peut-être y a-t-il quelque chose à faire ? Le président d'ATOS cherche un soutien politique pour développer un cloud européen. Le moins que l'on puisse dire est que pour le moment, il n'y a aucune espèce de débouchés. Certains de nos partenaires européens, je pense notamment aux Hollandais, nous regarde de travers lorsque nous évoquons ce genre d'idées. Il n'y a pas de base en Europe pour développer des stratégies de ce type.
Parmi les facteurs qui ont contribué à la dissolution du système colbertiste, certains sont de nature technologique. L'hybridation des filières est devenue une réalité du monde industriel. Ce n'est pas un hasard si la France a bien réussi dans des domaines qui relevaient de la logique du projet où des milliers d'ingénieurs se consacraient à tel ou tel produit – souvenons-nous du plan Calcul.
Je ne crois absolument pas qu'il puisse y avoir une continuité entre la politique industrielle et la politique de soutien aux start-up. Les mécanismes en jeu sont beaucoup plus complexes. Il faut plutôt miser sur de nouveaux modes de collaboration entre le tissu industriel et les start-up. Celles-ci ne peuvent être la source du renouveau industriel dont nous avons besoin même si leur développement est souhaitable et que nous pouvons espérer que la France compte plusieurs licornes. Il est indéniable qu'elles suscitent une formidable mobilisation culturelle de la jeunesse. Les élèves des grandes écoles ne rêvent plus de longues carrières dans les grandes entreprises.
La Chine est capable de tenir tête aux États-Unis dans le monde numérique grâce à son système politique mais aussi grâce à son énorme marché intérieur. L'obstacle majeur à la montée en puissance des entreprises du numérique européennes est la fragmentation du marché européen des consommateurs et des capitaux, le patron de BlablaCar le soulignait récemment. Il leur faut être capables de monter en puissance très rapidement or c'est impossible dans une telle configuration. Si les start-up sont soutenues par l'État en France, c'est qu'elles ne bénéficient pas d'un équivalent du capital-risque de la Silicon Valley. Les Américains s'intéressent du reste de plus en plus aux nouvelles sociétés qui émergent dans notre pays.
J'aimerais revenir sur ce que vient de dire Pierre Veltz pour souligner deux ou trois dissonances.
L'émergence des Baidu, Tencent, Alibaba et Xiaomi est bel et bien liée à une stratégie colbertiste chinoise. Dans le domaine des télécoms, les pouvoirs publics chinois ont piloté la technologie de la 4G en mettant au point une norme chinoise qui a servi d'outil de pression pour favoriser les transferts technologiques des grands opérateurs américains et européens. Il y a encore des domaines où cette vieille méthode pourrait fonctionner mais il faudrait pour cela une volonté politique européenne or elle n'existe pas. Pensons à ce que pourrait être un plan « batteries » pour le développement des véhicules autonomes. Les industriels de l'automobile ont tous dit qu'ils iraient s'approvisionner sur le marché et ne veulent pas investir dans ce secteur alors que toutes les grandes usines de fabrication de batteries se situent toutes en Chine.
En matière d'investissements étrangers, la France a mis depuis très longtemps en place des dispositifs de contrôle des investissements non européens. La direction du Trésor a un pouvoir de veto. La question est de savoir si nous ne pourrions pas créer un équivalent du CFIUS – Committee on Foreign Investment in the United States – à l'échelle de l'Europe. Emmanuel Macron plaide pour une telle solution. Il est évident que si nos voisins n'ont pas de règles aussi strictes que les nôtres en matière d'investissements étrangers, cela engendre pour nous une situation extrêmement défavorable.

C'est un sujet de débat important pour notre commission. Toute la logique du CFIUS est de veiller aux intérêts des États-Unis en matière de sécurité nationale et de défense. Un dispositif analogue existe dans notre pays depuis la loi de 1966 mais il n'est pas appliqué. Je dois dire que je ne vois pas bien comment il pourrait y avoir un CFIUS à l'européenne ? Comme seraient alors définis les intérêts nationaux de chaque pays ?
L'idée est de communautariser et de fédéraliser cette politique pour ce qui concerne les enjeux européens. Des seuils de montants d'investissements seraient définis et, comme en matière concurrentielle, ce serait la Commission européenne qui serait saisie et non pas les gouvernements nationaux.
Les États-Unis ont une interprétation extensive de la sécurité et de la défense nationales. Elle intègre par exemple les ports comme on l'a vu lorsque des investisseurs des Émirats ont voulu racheter plusieurs grands ports américains.
La percée politique n'a pas encore été faite en Europe mais il y a des petits progrès. Les Allemands commencent à s'inquiéter du rachat par des investisseurs chinois de certaines de leurs pépites dans le domaine de la robotique. Comme tout ce qui concerne les affaires européennes, cela prend beaucoup de temps. Il faut que la prise de conscience soit largement partagée, que la question soit inscrite à l'agenda politique et que des propositions concrètes soient faites.
La France, qui a déjà des dispositifs protecteurs, veut aller encore plus loin. Le Gouvernement actuel réfléchit à étendre la protection aux start-up, dont l'actif essentiel est le capital humain et la recherche. Il s'agit de préserver non pas des capitaux mais des maillons d'une longue chaîne que l'on voudrait conserver sur le territoire national. Aller dans cette voie est intéressant mais passer à l'échelon européen nous serait plus utile.
Enfin, s'agissant des entreprises en difficulté, le problème n'est pas tellement la détection car il existe encore des systèmes d'alerte. Depuis 1989, date à laquelle j'ai écrit L'État brancardier : politiques du déclin industriel, ce n'est pas tant la capacité à identifier les difficultés que nous avons perdue que la capacité de l'État à tordre les bras des banques et des créanciers pour les obliger à rester dans des entreprises alors qu'ils voulaient s'en retirer, à fabriquer des faux-nez capitalistiques en obligeant certaines personnes à remettre des capitaux au pot. La direction du Trésor avait une puissance à laquelle nul n'osait résister. Ce système d'intervention a totalement disparu.
Nous pourrions essayer de mettre en place un dispositif qui permette d'être à l'écoute des besoins de croissance des quelque 4 000 ETI que compte notre pays. Nous avons su par le passé créer des administrations de mission au service des stratégies d'expansion des entreprises.
Nous sommes face à des situations asymétriques en matière d'investissements étrangers. Il y a la question des autorisations mais aussi des contraintes associées. La Chine impose aux investisseurs de produire localement et de procéder à des transferts de technologie. Je n'ai jamais compris pourquoi les Européens n'imposaient pas aux Chinois des contraintes analogues.
Certes, mais ils peuvent augmenter rapidement et de toute façon, je considère qu'il s'agit d'une question de principe. Le système législatif pourrait l'autoriser.

Sur le papier, il existe un CFIUS à la française mais toute la question est de savoir s'il y a une volonté pour le faire fonctionner. Parmi les outils, il y a le pouvoir de blocage mais lorsque M. Kron vend sans se soucier de la possibilité de se voir opposer un blocage, cela en dit très long sur la culture française. En outre, il y a un pouvoir de conditionnement qui peut être utilisé en cas de crise.
Nous en venons aux questions.

Messieurs, merci pour vos brillants exposés qui apportent de l'ordre dans nos esprits. Je préciserai en préambule que j'ai travaillé pendant vingt-trois ans chez Hewlett-Packard afin que vous compreniez de quel point de vue je me place.
J'aimerais revenir, monsieur Cohen, sur la distinction que vous établissez entre modèle horizontal britannique et modèle vertical français. Le modèle français a réussi partout où il y avait intégration : avec Airbus, avec les programmes spatiaux, avec le secteur ferroviaire à une certaine époque. Mais il a échoué là où la logique reposait sur une technologie particulière, avec Bull, par exemple. Nous n'avons pas assez tiré les enseignements de ces échecs car nous continuons dans cette direction.
M. le rapporteur n'a pas posé ses questions habituelles sur le périmètre des domaines stratégiques. Leur définition dépend évidemment des objectifs que nous voulons atteindre or ceux-ci n'apparaissent pas clairs. S'agit-il de l'indépendance énergétique, de la défense, de l'emploi, du leadership technologique ?
Le rôle de l'État est de créer des écosystèmes qui permettent d'avancer en accueillant dans un système intégré des composants qui se créent de façon brownienne.
J'apprécie que vous parliez davantage de mobilité que d'automobiles. En effet, la question qui se pose est bien de savoir si le rôle de l'État n'est pas d'investir massivement sur la 5G puisque la 5G, c'est la mobilité, les véhicules autonomes, etc.
J'observe que lorsque l'on parle des stations-service du futur, on évoque souvent l'électricité – alors que l'on peut aussi, par exemple, utiliser l'hydrogène. Mais peut-être est-ce une erreur de s'intéresser à la pile électrique, dans la mesure où le marché le fera automatiquement, si c'est nécessaire.
Et si l'on passe le cadre de la mobilité nationale en faisant des investissements d'État sur l'infrastructure, y arrivera-t-on mieux qu'en tentant de trouver une parade aux GAFA ? Je note que lorsque l'on s'intéresse aux GAFA, il est déjà trop tard. Les GAFA n'ont pas été créés par une politique de la Nation américaine, mais par l'écosystème de la Silicon Valley. Ils ne se sont pas faits tous seuls. Nous devons donc créer l'écosystème qui nous permettra de mettre la France à la première place.

Merci, messieurs, pour la richesse de vos interventions. Je voudrais d'abord revenir sur la question des GAFA et des « BATX » chinoises.
Les dernières années du capitalisme ont prouvé qu'avec des gens très intelligents et beaucoup de capital, on pouvait aller très loin, et que ce qui avait prévalu par le passé, à savoir que l'histoire et l'expérience des entreprises leur permettaient d'avoir une assise suffisante pour les empêcher de se détruire, ne se vérifiait plus. Une entreprise peut être totalement phagocytée par l'innovation avec des gens très intelligents et beaucoup de capital derrière eux.
Cela me conduit à vous faire part d'une crainte. Les gens des GAFA et des BATX accumulent au fil des années de plus en plus de capital, qu'ils utilisent pour acheter des entreprises et grossir encore plus. On finit par se retrouver avec ce que j'appellerai des « Étaprises », des entreprises dont les pouvoirs s'apparentent parfois à ceux d'un État : elles s'occupent pour leurs salariés de logements, de mobilité en gérant les transports entre leur lieu de vie et leur lieu de travail. Leur emprise s'étend dans tous les domaines, et ils achètent de plus en plus d'entreprises un peu partout dans le monde pour être sûrs que la prochaine innovation naîtra dans leur giron, et qu'ils n'auront donc pas à y être confrontés directement. Dans un tel contexte, comment nos entreprises avec la taille des entreprises françaises ou européennes, qui sont souvent sous-capitalisées, pourront résister au pouvoir de ces entreprises géantes qui finiront par leur prendre du capital ? Pouvez-vous nous donner votre sentiment ?
Je voudrais ensuite aborder la question des batteries, qui m'intéresse tout particulièrement. Nous avons entendu hier, en commissions communes, M. Carlos Ghosn, PDG de Renault, qui, au-delà de l'annonce qu'il a faite en exclusivité aux parlementaires selon laquelle son groupe était devenu le premier constructeur mondial, a annoncé qu'il était prêt à travailler avec l'État ou avec les partenaires européens, au développement d'une unité de production de batteries en Europe. Il serait prêt à s'engager à récupérer la production de batteries.
Cela étant dit, on peut se demander comment il est possible de développer une vraie filière de la batterie en Europe alors qu'aujourd'hui tout se fait en Asie, particulièrement en Chine. Pourtant, initialement, la recherche sur les batteries s'était faite en France, avant que Sony ne récupère les connaissances et les brevets pour faire fabriquer les premières batteries au Japon. Au début, on était bons, mais par manque de capital, et par incapacité à fédérer des entreprises pour créer une industrie, on a perdu notre avance.
On se rend bien compte que les batteries sont au centre du développement de la voiture de demain – dont elles représentent une grande partie de la valeur. Si l'on ne maîtrise pas les technologies des batteries qui sont faites en Europe, nos constructeurs risquent de se retrouver sur le bas-côté. En Chine, des constructeurs peuvent se développer en très peu d'années, prendre de l'avance technologique sur nous. Par voie de conséquence, les consommateurs seront plus intéressés par les produits chinois que par les produits européens.
Selon vous, sur quels éléments serait-il intéressant de travailler, pour développer une vraie filière de la batterie en Europe ?

Je voudrais revenir sur la politique européenne et sur ce que l'on pourrait améliorer.
Selon moi, le droit à la concurrence, qui est la spécificité de l'Union européenne, est anti-colbertiste. Et sur des sujets qui nous intéressent comme le développement de la 5G, les règles européennes, en favorisant le développement d'opérateurs de téléphonie, ont fragilisé nos propres opérateurs. Cela a eu des conséquences sur nos industries. En effet, placés devant la concurrence, ils ont peut-être été davantage vers les marchés chinois qu'ils ne l'auraient fait s'ils avaient eu des marges suffisantes. Ne pensez-vous pas qu'à ce niveau-là, il faudrait engager une réforme de fond ?
Et puisque l'on est en train de parler d'industries, j'aimerais que l'on s'intéresse aux industries agro-alimentaires, que les récents scandales ont mises sur le devant de la scène. Certaines filières occupent des positions dominantes. Mais ce sont des industries qui dégagent peu de marges. Comment voyez-vous l'avenir de ce type d'industries ?

Je me suis passionnée pour la question qu'a posée le rapporteur, à savoir : « Qu'est-ce qu'un intérêt stratégique ? » J'aimerais donc y revenir.
Que pensez-vous de l'hypothèse d'une scission des activités d'EDF ? Cela permettrait d'identifier, par exemple, son activité nucléaire qui, de manière assez simple et assez naturelle, peut être considérée comme étant d'intérêt stratégique, afin de la protéger des aléas boursiers. Et ainsi, on ne relierait plus les intérêts stratégiques à une entité, mais aux activités qui la composent.
Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes vos questions, et me contenterai de réagir à certains de vos propos.
Monsieur, je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que nous avons toujours été meilleurs comme ensembliers que comme producteurs de composants. Il est très important d'être ensembliers. Le problème, c'est que nous l'avons été dans des domaines assez proches du régalien, c'est-à-dire la défense, l'aéronautique et l'énergie. Et c'est là, finalement, que nous avons remporté les plus grands succès.
Aujourd'hui – je ne sais pas si c'est utopique ou pas – nous sommes face à de grands enjeux systémiques.
Je reviens sur l'idée qu'entre l'horizontal et le vertical, il y aurait cette dimension de nouveaux systèmes techniques en émergence : la mobilité ; la santé ; l'énergie, avec un nouvel équilibre entre le « centralisé » et le « décentralisé » qui est en train de se chercher ; et d'une manière générale, le fonctionnement de nos villes. J'observe d'ailleurs que certaines entreprises sont assez bien placées dans les utilities, et qu'on ne les prend pas en compte quand on parle de la désindustrialisation ce qui est tout de même absurde.
Pour moi, une des questions est de savoir si l'on serait capable de faire émerger aussi – encore une fois avec des modes de recherche et d'expérimentation assez différents de ceux que l'on a connus traditionnellement – des ensembliers capables de fournir des solutions sur des sujets systémiques comme ceux-là. J'espère être clair.
Par exemple, la question des batteries est un élément du système. Et je pense qu'il serait intéressant de se dire que si l'on veut être un pays véritablement leader dans le développement d'une nouvelle offre de mobilité globale – car c'est cela qu'attendent aujourd'hui un certain nombre de grandes villes à travers le monde…
Elles sont incluses. Mais je ne fais pas de distinction. Pour moi, une telle opposition n'a pas de sens. Aujourd'hui, les métropoles peuvent travailler avec leurs arrière-pays.
Il pourrait y avoir de nouvelles formes de colbertisme. En effet l'État est nécessaire pour fixer les règles, mettre en place les infrastructures de base, pour donner un coup de pouce afin d'avoir un ensemble de composants, de services, etc., que l'on pourra expérimenter, mettre ensemble, et essayer de faire émerger des ensembliers sur des sujets qui ne se limitent pas forcément à la défense ou à l'aérospatiale – même si ce sont les seuls secteurs où cela a vraiment réussi.
Je ne sais pas si c'est une idée tout à fait réaliste, mais je n'en vois pas tellement d'autres. La filière mobilité ne peut pas se résumer à l'industrie des batteries et de l'automobile traditionnelle. On voit bien qu'il y a une place à prendre, et que cette place est potentiellement discutée – évidemment, les GAFA lorgnent dessus. Ils veulent se positionner. L'objectif de la société Uber n'est pas de remplacer les taxis, mais de devenir un opérateur global de mobilité en en intégrant tous les aspects.
On pourrait dire la même chose de l'alimentation. Le domaine de l'agro-alimentaire dont vous avez parlé est en train de bouger considérablement. Toutes nos filières ont compris qu'elles devaient faire une petite révolution, que les pesticides et tout le reste, c'était terminé, qu'il fallait réinventer une nouvelle forme d'agriculture – sans oublier l'industrie qui va avec. Mais pour cela, on a besoin d'une vision systémique des choses.
Je vais commencer par la dernière question. J'avoue que je ne vois pas quel peut-être le lien entre le problème d'EDF et la question de l'intérêt stratégique et surtout, je ne vois pas quelle peut-être la nécessité de séparer les activités d'EDF. Mais je vais répondre à cette question comme je la comprends.
Je suis violemment hostile à l'éclatement d'EDF. C'est pour moi le type même de la fausse bonne idée. Je dirais même que c'est une solution en quête de problèmes.
Quels sont les arguments de ceux qui veulent l'éclatement d'EDF ? Il y en a trois.
Le premier argument est d'ordre purement financier. Il consiste à dire qu'une entreprise n'est pas correctement valorisée lorsqu'elle a des activités très diverses. C'est ce que l'on appelle la décote de holding, dont on se fiche complètement. De toute façon, EDF n'est pas un sujet boursier.
Ceux qui ont investi dans EDF ne l'ont certainement pas fait pour faire une affaire boursière. Ils sont rentrés quand l'État a commencé à privatiser à un niveau deux ou trois fois supérieur au niveau actuel, et par rapport au plus haut, le cours actuel est dix fois inférieur à ce qu'il était. Cela n'a donc jamais été un enjeu majeur. Ensuite, je peux vous garantir que la pression boursière exercée sur EDF est faible ou nulle. Si EDF était vraiment sensible à la pression boursière, ses dirigeants feraient tout le contraire de ce qu'ils ont fait pendant la période récente : premièrement, ils n'auraient pas repris Areva ; deuxièmement, ils n'auraient pas fait Hinkley Point. En bref, EDF n'est pas parasitée par des considérations boursières.
Le deuxième argument – c'est la question fondamentale – a été avancé par le ministre de l'environnement actuel, M. Nicolas Hulot. Selon lui, le fait que EDF ait une stratégie intégrée, mais essentiellement basée sur le nucléaire, l'empêche de consacrer l'énergie et les financements nécessaires au développement du renouvelable. Un tel argument ne tient pas une minute.
Comme vous le savez, EDF a une activité dans les énergies renouvelables, qu'elle a formidablement développée partout, sauf en France. Où est le problème ? On peut se demander pourquoi ils sont devenus très bons aux États-Unis, pourquoi ils sont très bons au Brésil, et pourquoi ils ne sont pas bons en France. Cela a peut-être quelque chose à voir avec les réglementations qui existent en France sur l'éolien, qui font que dix années de procédure sont nécessaires pour créer une ferme éolienne, etc. Je ne crois donc pas du tout à cet argument.
Maintenant, est-ce que le fait, pour EDF, d'être dans le nucléaire constitue un problème ? EDF est l'opérateur nucléaire historique. Lorsque le Gouvernement et le régulateur ont estimé que la rente nucléaire devait être partagée pour permettre un accès à la concurrence et assurer le développement de celle-ci, on a inventé l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique (ARENH), qui permet à des opérateurs de concurrencer EDF en ayant, dans de bonnes conditions, de l'énergie nucléaire. D'où ce paradoxe : la déréglementation du marché de gros de l'électricité et l'effet massif de l'injection du renouvelable allemand dans les réseaux européens fait baisser le prix de gros de l'électricité en dessous du niveau de l'ARENH. Voilà pourquoi les concurrents d'EDF ne prennent plus les quotas d'électricité dont ils ont besoin. Là encore, je ne vois pas ce que l'éclatement d'EDF réglerait en matière de market design de l'électricité en France et en Europe.
Enfin, contrairement au troisième argument, je trouve très intéressant qu'EDF soit présent dans les différents maillons de la chaîne énergétique, car cela lui permet de chevaucher plusieurs cycles d'activité et de rentabilité, ce qui ne serait pas possible s'il était concentré sur le renouvelable. D'ailleurs, l'éclatement auquel ont procédé les Allemands avec RWE, Innoggy, etc., a eu des effets très négatifs. Il faudrait peut-être regarder un peu ce que font les voisins, surtout lorsqu'ils mènent des politiques catastrophiques – et ce qu'a fait l'Allemagne en matière d'électricité est simplement catastrophique. Je ne veux surtout pas que l'on imite un tel modèle.
Je suis tout à fait d'accord…
Une question a été posée sur les effets du droit de la concurrence en matière de politique européenne. Le droit de la concurrence est évidemment la politique constitutive de l'Union européenne, et il est exact que les logiques industrielles sont moins présentes, même si tous les outils théoriques sont là pour prendre en compte un intérêt industriel quand on prend une décision de type concurrentiel. La contradiction n'est pas aussi nette qu'on pourrait le penser.
Est-ce que la Commission européenne pourrait prendre une initiative sur la 5G ? Je remarquerai à ce propos que le paysage s'est formidablement éclairci. Quand on débattait de la 2G, il y avait encore une dizaine d'acteurs industriels européens dans le secteur. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y en a plus que deux : Ericsson et Nokia. Les initiatives en matière de recherche peuvent parfaitement être financées dans le cadre des politiques de recherche européenne. En revanche, l'articulation entre ces politiques de recherche, les politiques d'innovation et du déploiement de la 5G posera des problèmes plus traditionnels de concurrence, d'aides d'État, etc.
Donc, si je suis sensible au fait que la politique européenne a essentiellement porté sur la concurrence et qu'elle a objectivement défavorisé la logique de production européenne sur le sol européen, j'observe tout de même un fait qui me trouble : aux États-Unis, alors qu'il y a eu, à un moment, le démantèlement d'ATT et d'ITT et que l'on a créé les Baby Bells pour développer la concurrence et combattre le lazy monopoly d'ATT, le mouvement de concentration a repris. Le paysage est aujourd'hui très concentré et les prix beaucoup plus élevés qu'en Europe, où l'on observe toujours une hyper-fragmentation des acteurs et une hyper concurrence par les prix. Globalement, les prix des prestations internet et des prestations de téléphonie mobile sont au moins deux fois plus élevés aux États-Unis qu'en Europe.
Le mouvement de concentration n'est pas reparti en Europe. Il faut peut-être s'interroger là-dessus et revoir les politiques nationales. Après tout, personne ne nous obligeait à accepter un quatrième acteur dans les mobiles : c'est bien nous qui l'avons décidé.
On peut dire que l'on est aujourd'hui dans un monde qui pousse à la création d'oligopoles. C'est particulièrement flagrant dans le domaine du numérique, où les coûts fixes sont très importants et où les effets de réseau ont permis la montée en puissance d'entreprises géantes, les fameux GAFA. Cela a bien été décrit par la théorie économique dès les années trente : c'est la concurrence monopolistique, qui n'a pas grand-chose à avoir avec la concurrence au sens où on l'entend à Bruxelles.
On se tire une balle dans le pied si l'on n'accepte pas cette réalité qui veut que nous soyons dans un monde de coûts fixes, d'investissements lourds, d'infrastructures lourdes – ce à quoi s'ajoute le fait qu'avec le numérique il est possible changer d'échelle de manière extrêmement rapide grâce à des effets de réseau extrêmement puissants.
Cette concurrence monopolistique a un certain nombre de défauts. On le voit avec les GAFA, qui sont devenues effectivement des puissances considérables, non pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle planétaire. Il faut donc la réguler, et on ne peut pas la réguler sur le mode de la concurrence pure et parfaite qui continue à inspirer la politique européenne de la concurrence.

Je suis tout à fait d'accord avec le constat que vous faites. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires moyen par client – average revenue per user (ARPU) – est extrêmement bas. La concurrence a en effet amené les opérateurs à pratiquer des « prix planchers ». Le modèle de profitabilité n'est plus le même par rapport à celui d'autres pays européens ou aux États-Unis. Cela nuit à la capacité d'investissement des entreprises, qui voient fondre leurs revenus. Mais passer de quatre à trois, voire à deux opérateurs suffirait-il pour que les prix augmentent ? Imaginons que l'un des trois, ou des deux, continue à casser les prix !

Depuis quelques années, on n'entend parler que du modèle allemand et des PME allemandes qui chassent en meute pour aller chercher des affaires à l'international. Selon vous, que faudrait-il pour que les PME françaises soient capables de faire la même chose ?
Malgré tout, on a assisté, ces dernières années, au succès de la filière numérique en France, avec la French Tech. De nombreuses techniques se sont développées, tant dans le domaine du software que dans celui du hardware. Que faudrait-il pour s'assurer d'une bonne hybridation économique entre la filière numérique et la filière industrielle, pour faire une vraie industrie du futur à la française ?

Nos entreprises stratégiques, qui sont soumises aux règles de concurrence européennes, ne sont-elles pas fragilisées lorsqu'elles doivent affronter des opérateurs qui ne subissent pas de telles règles, comme les Américains ou les Chinois ?
Hier encore, les dirigeants d'EDF nous ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas lancer de nouveaux projets hydroélectriques en raison de l'opposition de la Commission européenne. Cela fragilise par là même les commandes d'Alstom, d'abord racheté par General Electric (GE) et aujourd'hui on ne sait par qui...
Deuxièmement, l'État est capable de lancer de grands projets comme Airbus ou Ariane, qui fonctionnent très bien – sans compter les grandes entreprises de défense, qui fonctionnent également. N'aurait-il pas pu prendre ses responsabilités, et nationaliser purement et simplement les entreprises dont nous parlons, afin d'éviter cette perte de souveraineté et d'agir comme un acteur du monde industriel pour reconstituer de grands pôles industriels français ? Aujourd'hui, ni Airbus ni Ariane n'existeraient si, dans les années 1960, l'État n'avait pas fait preuve de volontarisme. Il faut dire qu'à l'époque les règles de la concurrence européenne n'existaient pas non plus.
On parle effectivement beaucoup du modèle allemand qui, comme vous le savez, n'est pas tant fondé sur les PME que sur les grosses ETI. D'ailleurs, on a tendance à oublier qu'il existe en France un tissu d'ETI, même s'il est trois fois moindre en volume et beaucoup moins dense géographiquement. Ce sont de très belles entreprises, assez disséminées sur le territoire, et que les Français connaissent fort peu.
Ce double aspect, de volume et de densité, est très important. Dans le Land de Bade-Wurtemberg, les gens se connaissent tous. Ils sont dans des villes voisines, ils travaillent avec les Länder et avec toutes sortes d'institutions de médiation. Bref, il existe tout un tissu économique dont l'équivalent n'existe malheureusement pas en France. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas oublier les ETI françaises, qui ont souvent un potentiel local très important.
La géographie a son importance. En Allemagne, on peut parler d'une vraie densité, avec des entreprises d'échelle mondiale qui sont parfois implantées dans de toutes petites villes. Cela existe également en France, mais à un degré nettement moindre, car l'histoire et la géographie en ont décidé autrement.
Vous avez évoqué la question des start-up et la politique à adopter à leur égard. Comme je le disais tout à l'heure, la vague des start-up est culturelle plus qu'économique. Les jeunes générations attendent autre chose de l'entreprise que par le passé. La demande d'autonomie est devenue majeure, et passe avant celle de sécurité. De nombreuses politiques sont encore axées sur la sécurité du travail, mais les jeunes entrepreneurs nous disent que l'important, pour eux, c'est l'autonomie : ils veulent pouvoir « mener leur barque ». Ils sont également en recherche de sens. Ils ne veulent pas faire des choses idiotes, mais des choses auxquelles ils croient. Il ne faut pas négliger ces éléments, qui sont très immatériels, mais absolument essentiels dans la trajectoire des pays.
J'ai par ailleurs été frappé de constater qu'une grande partie de ces startups s'étaient implantées massivement en région parisienne, et même dans le centre de Paris. Cela s'explique par les très fortes politiques de soutien que vous connaissez – Station F, etc. Mais de ce fait, les start-up sont un peu coupées du tissu industriel « lambda ». En particulier, elles ont des connexions éventuelles avec les grands groupes, mais sont éloignées du monde des ETI et des PME. On observe d'ailleurs plutôt la même chose dans les grandes villes de province.
Il s'agit souvent d'étudiants qui montent leur start-up. Il n'y a pas beaucoup de hardware. On y est très coupé du monde de la technologie dure, on est beaucoup dans le « dot. com ». Pour caricaturer, je dirai que ce sont des cerveaux brillants qui nous inventent la nouvelle version de la livraison de pizza à domicile. C'est tout de même un problème, d'autant que, sur ce type de créneau, ils ne tiendront pas longtemps face à Amazon.
Ne pourrait-on pas, sur une base locale – ce serait plus facile à faire en région qu'en Île-de-France – essayer de reconnecter ces deux mondes, les startups issues du monde universitaire dans les métropoles, et les entreprises industrielles dans les territoires, en général dans des petites villes ou dans des territoires ruraux ? Il y a là une source fantastique de problèmes passionnants à régler, beaucoup plus intéressants que la livraison de pizzas – d'autant que ceux qui se consacrent aux pizzas risquent de se heurter rapidement à Amazon.

J'ai organisé des rencontres entre un très bel incubateur, Euratechnologie, à Lille, et les entreprises industrielles de tout le bassin Nord. Et ça marche ! Encore faut-il susciter de telles rencontres. Parfois, ce sont les pouvoirs publics ou les pouvoirs consulaires qui en organisent sur le terrain.
Je pense qu'il y a là une connexion intéressante à faire.
Je commencerai par la question sur la nationalisation d'Alstom. Était-ce une solution ?
Le premier problème était la contraction du marché intérieur. Le dernier grand contrat d'Alstom, qui portait sur les motrices pour le tunnel sous la Manche, a donné lieu à une bataille à mort avec Siemens. Et lorsqu'une pluralité d'acteurs – en l'occurrence Siemens, Alstom et Bombardier – se battent sur un marché en peau de chagrin, les perspectives de développement sont limitées.
L'autre problème qui se posait était la concurrence, sur les marchés extérieurs, entre ces trois Lilliput européens et le géant chinois.
Enfin, si vous regardez la baisse des coûts que permet un grand marché intérieur par rapport à un marché très étriqué, si vous regardez le bottom line, c'est-à-dire ce qu'était la rentabilité d'Alstom ferroviaire ou d'Alstom tout court, ou même des Chantiers de l'Atlantique, qui était proche de zéro, vous parvenez à la conclusion que nationaliser une entreprise qui n'a plus de marché, qui n'a pas de marge, et qui est en concurrence féroce avec des gens quinze fois, cent fois plus importants, est une idée pour le moins originale…

M. Kron a tout de même convaincu l'assemblée générale des actionnaires de vendre la branche « Énergie » d'Alstom en leur faisant la démonstration que l'essentiel de la rentabilité et de la profitabilité du groupe était dans la branche « Transport » – pour un tiers de l'activité, plus de la moitié des profits. Cela a peut-être introduit un peu de confusion dans les esprits…

Je complèterai ce que vient de dire le président en rappelant que le carnet de commandes était encore plein pour quatre ans, et qu'aujourd'hui on sait que la transition écologique est telle qu'il faut supprimer les camions et donc développer le fret ferroviaire. Or le fret ferroviaire, ce sont des locomotives et des trains. Et cela, c'est aussi la volonté de l'État de relancer le marché.
On a aussi évoqué, dans une question, les effets de la concurrence sur la fragilisation d'EDF. Pendant vingt ou trente ans, au niveau européen, on a poursuivi une stratégie qui visait, en matière énergétique, à concilier trois logiques : la logique climatique, environnementale ; la logique de sécurité d'approvisionnement ; la logique de compétitivité.
Globalement, les politiques définies au niveau européen ont essayé de concilier ces trois logiques, et cela a donné lieu à toute une série de déclinaisons.
Le problème est que la politique de sécurité énergétique a une dimension géopolitique, qui échappe assez largement au pouvoir de la Commission et qui renvoie aux prérogatives des États. Voilà pourquoi, en matière de sécurité énergétique, on n'a pas fait grand-chose.
En matière climatique, des objectifs ont été fixés par la Commission européenne – les « trois fois 20 % », etc. Mais l'Allemagne a annoncé récemment qu'elle n'allait pas suivre les obligations qu'elle s'était elle-même fixées, et cela n'a pas eu d'effet.
En revanche, la politique de compétitivité est d'application directe. Elle est gérée directement par Bruxelles. Cela explique qu'elle ait eu une efficacité relative plus importante qu'ailleurs. D'où la remise en cause des modèles énergétiques des différents pays, et notamment de leurs modèles organisationnels – désintégration comptable, puis désintégration juridique des grands champions européens. Cela a conduit au paysage électrique que nous connaissons. On peut dire que cet objectif de concurrence a eu des effets structurants sur la politique de l'énergie et sur l'organisation des entreprises énergétiques au niveau européen.
Une question du rapporteur portait sur les effets de la libéralisation dans les télécommunications. Son auteur a tout à fait raison : on peut très bien imaginer que, même avec trois, voire deux opérateurs, si l'un d'entre eux est particulièrement agressif, il n'y aura pas de remontée des prix. En revanche, j'observe ce qui s'est passé aux États-Unis sur une longue période.
Aux États-Unis, on avait décidé d'éclater le Bell System en sept compagnies régionales, et permis à de nouveaux arrivants d'intervenir dans la téléphonie à longue distance. Dans un premier temps, la concurrence a entraîné de véritables baisses des prix, et une diffusion plus rapide – notamment de la technologie des mobiles – en raison de l'arrivée de nouveaux entrants. Enfin et surtout, la concurrence entre le réseau du câble et le réseau téléphonique a permis, en matière de téléphonie fixe, des progrès et des baisses, et on a assisté à la multiplication des fournisseurs d'accès à internet.
Je remarque qu'on a appliqué ce raisonnement, non pas à l'Europe, mais à chaque pays d'Europe. Alors qu'il y avait, après le démantèlement d'ATT, sept opérateurs européens, on a commencé à en fabriquer trois ou quatre par pays, ce qui, à raison de vingt-huit pays, a abouti à un paysage littéralement atomisé. On est entré dans une dynamique de concurrence particulièrement dure, qui a tiré les prix vers le bas. Mais ne nous payons pas de mots : s'il y a à nouveau un mouvement de concentration en Europe, il se traduira par une certaine hausse des prix.

Je reviens sur la nécessité de rapprocher les start-up et les entreprises entre elles, pour qu'elles puissent mieux se connaître et gagner en performance. Les pôles de compétitivité traduisaient une certaine volonté de « clusterisation », mais il me semble que le dispositif est un peu remis en question aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ?
Des évaluations ont été faites, mais l'exercice est extrêmement délicat. Certains éléments, comme l'impact sur l'emploi, ne peuvent être mesurés qu'à moyen terme, et de manière surtout qualitative. Il est difficile de savoir ce qui relève vraiment d'un pôle de compétitivité et ce qui relève d'autres logiques qui auraient pu se manifester même s'il n'y avait pas eu ce pôle de compétitivité.
Ensuite, les situations diffèrent beaucoup d'un pôle à l'autre. On le voit bien, certains pôles marchent très bien, d'autres marchent moins bien, d'autres encore ne marchent pas du tout. Mais nous sommes aujourd'hui dans un monde un peu darwinien. Lorsque quelque chose ne marche pas, il est très important de savoir le détecter, et aussi, parfois, de savoir l'arrêter. Or ce n'est pas notre fort. Nous avons plutôt tendance, en France, à laisser les situations se prolonger, à faire de l'acharnement thérapeutique plutôt qu'à trancher de façon radicale.
Cela étant, sur le plan qualitatif, je tire un bilan positif de ces pôles de compétitivité. Je parlerai d'un sujet que je connais particulièrement bien, Saclay, et je citerai le cas du pôle de compétitivité Systematic. Il s'agit d'un pôle un peu colbertiste, qui n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu le CEA, Alcatel et Thales pour monter l'affaire. Je pense que cela a été extrêmement positif, car cela a permis de remettre en connexion des PME qui pouvaient apporter des solutions technologiques – des techno providers comme on dit dans notre jargon – à des ensembliers qui avaient tendance à s'enfermer dans leur coquille.
Je pense aussi que le contact avec le monde universitaire en général – et je ne parle pas seulement des grandes écoles, mais aussi des universités – s'est beaucoup amélioré. Il faut aller dans ce sens-là. Mais peut-être faudrait-il, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, aller parfois un cran plus loin, et mettre maintenant en place de vraies grandes expérimentations.
Cela m'amène à vous reparler de la voiture électrique. Les Américains ont fait un appel national à projets. Et ils ont choisi une seule ville, qui, si ma mémoire est bonne, est Columbus dans l'Ohio, où ils ont décidé de « mettre le paquet ». Ce sera un terrain d'apprentissage, où l'on apprendra à faire de la mobilité électrique, mais en système. Et tout le monde apprendra.
Je pense qu'il faudrait aujourd'hui capitaliser sur les pôles de compétitivité qui marchent bien, et peut-être essayer d'aller un cran plus loin. On ne l'a pas beaucoup évoquée, mais cette question des écosystèmes locaux annonce une mutation irréversible. Or la dimension territoriale était très absente de la pensée du colbertisme à l'ancienne qu'a décortiquée notre ami Élie Cohen.
Je donnerai quelques chiffres, pour compléter ma réponse de tout à l'heure. Siemens dégage une marge d'exploitation de 8,8 % du chiffre d'affaires, contre 5,8 % pour Alstom. Le carnet de commandes d'Alstom était plus important que celui de Siemens, mais, du fait d'une moindre rentabilité d'Alstom et du fait que la spécialisation de Siemens dans la signalisation lui autorisait des marges systématiquement plus élevées, le rapport de valorisation était malgré tout favorable à Siemens.
Aujourd'hui, dans le ferroviaire, la signalisation, comme l'informatique qui va avec, revêt une importance stratégique – davantage même que les trains.

Oui, mais Alstom a tout de même pu augmenter son bénéfice de 6 % au dernier trimestre. Et je rappelle que Siemens a bénéficié du contrat sur le marché du tunnel sous la Manche, alors que ses trains ne respectaient pas les conditions de sécurité, contrairement à ceux d'Alstom. Vous voyez donc que tout n'est pas aussi clair et simple qu'on peut le penser.
Même sur le marché français, il est arrivé que Vossloh, qui est une « moyenne grosse » entreprise allemande, batte Alstom.

Merci, messieurs. Votre intervention était très attendue. Ce fut un moment de respiration et un moment d'inspiration pour notre commission d'enquête. Nous n'avons pas été déçus.
La séance est levée à onze heures quarante-cinq.
Membres présents ou excusés
Réunion du jeudi 18 janvier 2018 à 9 h 35
Présents. - M. Damien Adam, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Michèle Crouzet, Mme Dominique David, M. Bruno Duvergé, Mme Sarah El Haïry, M. Éric Girardin, M. Guillaume Kasbarian, M. Loïc Kervran, M. Bastien Lachaud, M. Olivier Marleix, M. Hervé Pellois, Mme Natalia Pouzyreff
Excusé. - M. Daniel Fasquelle