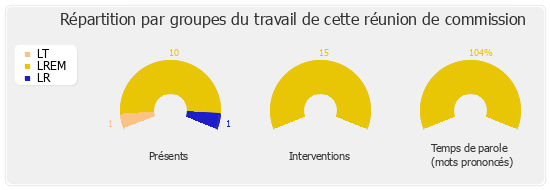Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
Réunion du jeudi 28 novembre 2019 à 10h45
Résumé de la réunion
La réunion
Jeudi 28 novembre 2019
- Présidence de M. Gérard Longuet, sénateur, président de l'Office –
La réunion est ouverte à 10 h 45.
Audition publique, ouverte à la presse, sur les enjeux du conseil scientifique aux institutions politiques
– Mes chers collègues, chers invités, cette session de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques est consacrée à un sujet dont la mise à l'ordre du jour a été souhaitée et très largement organisée par notre premier vice-président Cédric Villani. Il s'agit de la question du conseil scientifique aux institutions politiques, c'est-à-dire aux gouvernements, pour faire simple. C'est un sujet absolument majeur, organisé de façon très différente d'un État à l'autre, la France se singularisant par le fait de n'avoir aucune organisation formelle de conseil scientifique auprès du gouvernement.
L'Office parlementaire ne revendique pas ce rôle : créé voici un peu plus de 35 ans, il est, comme son nom l'indique, à la disposition du Parlement. J'ajouterai, pour être parfaitement exact sur le plan historique pour nos visiteurs étrangers qui ne sont pas nécessairement familiarisés avec notre histoire, que l'OPECST est né assez largement de l'idée que de grandes décisions, qui revêtaient une dimension non seulement scientifique, mais également économique et de société (je pense en particulier au poids de la production d'électricité nucléaire dans notre pays), n'avaient fait l'objet en réalité d'à peu près aucun débat, qu'il soit public ou parlementaire. Pour que ce débat soit possible et que députés et sénateurs se l'approprient à partir d'un socle commun de connaissances et de références, l'idée a été de créer par la loi cet Office parlementaire qui permet, à la demande des commissions de nos deux chambres que sont l'Assemblée nationale et le Sénat, d'examiner et d'étudier des sujets scientifiques, afin de disposer d'un panorama le plus complet, le plus objectif et le plus actuel possible de la situation dans tel ou tel secteur. Cette formule est assez satisfaisante. Nos deux assemblées sollicitent régulièrement l'Office parlementaire, qui travaille avec beaucoup de sérieux. Je voudrais à ce propos remercier les collègues qui, dans une discrétion peu compatible avec la carrière politique, approfondissent, à la demande du Parlement, des sujets soit par la production de notes scientifiques présentant l'immense mérite de coller à l'actualité, soit par le biais d'études plus longues, qui font autorité dans leur domaine.
L'exécutif, quant à lui, ne s'est pas doté pour l'instant, pour des raisons complexes, de structure de conseil scientifique, contrairement à d'autres pays, notamment anglo-saxons, ou aux institutions européennes.
Les invités qui nous font le plaisir d'être parmi nous ce matin sont tout à fait exceptionnels. Je voudrais ainsi saluer Sir Peter Gluckman, de Nouvelle-Zélande, et Mme Emily Hamblin, pour le Royaume-Uni. Nous accueillons également un interlocuteur qui nous est familier, en la personne de M. Rémi Quirion, conseiller scientifique en chef du Québec. Je souhaiterais enfin avoir un mot pour les institutions européennes, auxquelles je suis très attaché, en saluant la présence de M. Rolf Heuer, physicien au CERN et président du collège resserré des conseillers scientifiques de la Commission européenne, et du responsable de ce mécanisme de conseil scientifique européen, M. Johannes Klumpers. Je tiens à vous signaler, avant de laisser la parole à Cédric Villani, que nous avons en outre demandé à M. Patrick Flandrin, vice-président de l'Académie des sciences, qui a beaucoup travaillé avec l'Office et réfléchi sur cette question du conseil scientifique aux exécutifs, et plus généralement aux institutions, d'être présent parmi nous. Nous devrions également bénéficier d'une communication de M. Émilien Schulz, sociologue.
Je précise que cette audition est retransmise en direct et en différé sur internet, et demanderai par conséquent aux intervenants de bien vouloir respecter le temps de parole de 8 minutes qui leur est imparti.

– C'est un immense plaisir et un très grand honneur pour moi que d'introduire cette séance. J'ai eu le privilège de côtoyer, dans des vies antérieures variées, la plupart des personnalités qui vont s'exprimer au cours de cette audition et ai pu apprécier leurs extraordinaires compétences et leur joie de les partager. Elles composent pour nous aujourd'hui un panel d'exception. Les actes de cette matinée seront pour nous, à n'en pas douter, un document de référence, extrêmement précieux pour la suite.
En France, le conseil scientifique aux autorités publiques est traditionnellement considéré, dans l'administration de l'État, comme un sujet secondaire. En effet, l'administration, se percevant comme omnisciente, estime ne pas avoir besoin de conseil. Il existe certes des conseils scientifiques auprès de grands groupes comme EDF ou Orange, dont j'ai été membre par le passé, et des conseils scientifiques embryonnaires comme le conseil stratégique de la recherche ou ses différents avatars, qui n'ont jamais vraiment fonctionné. On compte évidemment, traditionnellement, l'Académie des sciences, dont le lien avec l'État s'est cependant considérablement relâché au cours des dernières décennies.
C'est en partant notamment de ce constat de défaut de fonctionnement du conseil scientifique de la recherche que le rapport du premier groupe de travail constitué par le gouvernement pour réfléchir à l'élaboration de l'avant-projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche, dont j'ai été co-rapporteur, a souligné l'importance de disposer d'une réelle instance de conseil scientifique au politique, avec un rattachement effectif au Premier ministre, ceci signifiant en pratique que le Premier ministre rencontre ce conseil, le convoque, le préside effectivement, sur le modèle constaté dans d'autres pays, comme le Japon par exemple.
La composition de ce conseil devrait refléter son haut niveau décisionnel et rester relativement resserrée, avec une douzaine de membres seulement (dirigeants d'organismes de recherche, universités et entreprises majeures en recherche, personnalités scientifiques reconnues) chargés de définir des priorités scientifiques. La question de sa composition est très importante. J'ai ainsi eu l'occasion de participer aux deux premiers conseils scientifiques de la Commission européenne, avec mon collègue Rolf Heuer ici présent et Johannes Klumpers, qui en était le brillant directeur, et ai pu voir, entre les deux premières moutures, à quel point, selon sa composition et sa taille, le conseil pouvait fonctionner extrêmement bien ou excessivement mal. La mise en place effective d'un conseil scientifique au pouvoir politique en France, en l'occurrence au gouvernement, serait un acte fort en matière de politique institutionnelle.
Lorsque j'ai été élu président de l'Office parlementaire en juillet 2017, avant que Gérard Longuet, à la faveur d'un nouveau vote, ne me ravisse cette position, mon premier travail a consisté à réfléchir à l'organisation de ce conseil scientifique, qui aujourd'hui n'existe pas vraiment, sauf finalement au Parlement, avec l'OPECST, chargé par la loi d'évaluer les choix scientifiques et technologiques, ce qui inclut l'analyse de la préparation des décisions. Pour prendre des exemples concrets, notre très récent travail sur la politique spatiale s'est inscrit dans le calendrier de la préparation de la conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne, chargée de prendre des décisions importantes pour les années à venir. Une première idée pour renforcer le rôle des sciences dans le travail du Parlement a consisté à suggérer de compléter les études d'impact, dont le gouvernement doit obligatoirement accompagner ses projets de loi, d'un volet concernant les impacts scientifiques et technologiques. Cette idée paraît de bon sens, dans un monde où les enjeux scientifiques sont omniprésents. Elle est pourtant restée au stade de la proposition. J'espère qu'elle pourra avancer avant la fin de la législature.
Quoi qu'il en soit, après deux ans et demi de travail de l'Office parlementaire, il m'a semblé que le moment était venu de poser sur la table le sujet du conseil scientifique aux autorités politiques, en nous appuyant sur des comparaisons internationales, afin de voir ce qu'il est possible de faire et s'inspirer des meilleures pratiques en la matière.
Nous allons ainsi, ce matin, faire le tour du globe. Certains de nos invités viennent de très loin. J'ai souhaité que nous entendions en premier lieu quelqu'un qui constitue une référence mondiale en la matière. Il s'agit de Sir Peter Gluckman, professeur de pédiatrie et biologie périnatale, qui a été nommé en juin 2009 premier conseiller scientifique en chef auprès du Premier ministre de Nouvelle-Zélande. Son mandat a été renouvelé à deux reprises et a pris fin en juin 2018. Au cours de cette période, Peter Gluckman a créé des fonctions de conseil scientifique au sein des principaux ministères néo-zélandais. Il a également été nommé envoyé spécial pour la science auprès du ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur de son pays en 2010, afin de l'aider à jouer son rôle dans la diplomatie scientifique. En 2012, il a créé et présidé le premier réseau régional formalisé de conseillers scientifiques en chef de la coopération économique Asie Pacifique. En 2013, il était invité par le Conseil international pour la science à envisager la création d'un réseau international de conseillers scientifiques. C'est ainsi qu'il a présidé la conférence inaugurale du Conseil scientifique aux gouvernements convoquée en août 2014 à Auckland en Nouvelle-Zélande. Il s'agissait de la première réunion mondiale de conseillers scientifiques, académiques et universitaires de haut niveau. En juin 2018, Peter Gluckman a quitté son poste de conseiller scientifique en chef du Premier ministre néo-zélandais, pour être élu président du Conseil scientifique international, lors de sa réunion inaugurale à Paris. J'ajoute pour conclure que Peter est toujours prêt à donner des conseils et que j'ai profité à de multiples reprises de ses conseils avisés. Peter, vous avez la parole.
Je tiens tout d'abord à vous avouer que je parle très mal français. J'ai étudié cette langue pendant deux ans au lycée, il y a 55 ans, et n'oserai m'exprimer en français devant cette auguste assemblée. Je vous promets toutefois que d'ici la fin de l'année prochaine je serai en mesure de faire un discours dans cette belle langue. Ma femme et moi étudions en effet le français et nous nous y exerçons autant que possible.
Comme l'a indiqué Cédric, j'ai été pendant neuf ans premier conseiller scientifique en chef auprès du Premier ministre de Nouvelle-Zélande, et ce auprès de deux Premiers ministres successifs. Je précise que j'ai joué ce rôle sans prise de position politique.
Il faut savoir que les pays ont des systèmes de conseil scientifique différents en fonction de leur culture parlementaire, de leur constitution, de leur histoire. Ces systèmes peuvent ainsi être fondés sur l'individu ou sur le collectif. En Nouvelle Zélande, nous sommes partis de rien et avons à présent un conseiller scientifique en chef directement placé auprès du Premier ministre et des conseillers scientifiques dans chaque ministère. Ce dispositif est d'une importance primordiale. Toute proposition budgétaire, du moins dans le secteur de l'environnement et des affaires sociales, est examinée dans le cadre du système de conseil scientifique ainsi que par le Trésor, afin de s'assurer qu'elle est en correspondance avec les données scientifiques. Dans le cas contraire, il faut en expliquer les raisons. Force est de constater que les scientifiques ne créent pas les politiques. Ces dernières sont le fruit de la combinaison de plusieurs facteurs. La science devrait être le point de départ, pour conseiller le gouvernement et lui présenter les preuves. Si l'on y réfléchit, chaque défi que doit relever un gouvernement a une dimension scientifique ; mais bien souvent, on ne le reconnaît pas. Le monde post-vérité d'aujourd'hui suscite de nombreux questionnements : qu'est-ce qu'un fait ? Qu'est-ce qu'une donnée ? Les données scientifiques sont-elles robustes, fiables ? Qui décide de cette robustesse ? Que faire des données massives ? Nous sommes à une époque où les changements sont nombreux, qu'ils soient d'ordre social, démographique, technologique, scientifique, économique. Tous créent de nouvelles perspectives en même temps que des risques dont certains menacent notre existence-même. Nous sommes ainsi parvenus à un point où il est impératif de disposer de connaissances scientifiques robustes et de les présenter de manière sereine et objective, afin que les décideurs politiques puissent les exploiter pour définir la meilleure manière de procéder.
Les preuves scientifiques peuvent aider à l'élaboration des politiques de plusieurs manières. Il importe tout d'abord de comprendre ce que nous savons et ce que nous ignorons. Il faut être conscient du fait que la science ne peut produire toutes les réponses. Je crois que dans ce monde de post-vérité, l'un des aspects les plus importants du conseil scientifique est d'être une source d'informations et de connaissances respectée et fiable. Ceci implique une intégration transdisciplinaire et que ces données soient transmises par un système d'intermédiation (« broker »). Il ne s'agit pas d'effectuer un travail de plaidoyer, mais de diffuser l'information par le biais d'intermédiaires. Le passage doit se faire vers les responsables politiques, puis vers la communauté des politiques, les autorités réglementaires et le public. En situation d'urgence, mon rôle de conseiller scientifique s'exerçait souvent au sein d'une cellule de crise, que ce soit face à des menaces terroristes ou à des catastrophes naturelles, environnementales. Je pense par exemple au séisme de 2017, qui s'est produit à 100 km au sud de notre capitale. De nombreux bâtiments avaient été endommagés et nous redoutions que ce séisme en annonce un second, beaucoup plus important. Une réunion de l'équipe ministérielle avait alors été convoquée, à laquelle j'avais assisté. L'une des décisions à prendre portait sur la question d'évacuer ou de ne pas évacuer Wellington, la capitale du pays. On ne peut guère imaginer discussion plus tendue entre politiques et experts en géologie. Il s'agissait d'une question de risque relatif et de risque absolu, en lien avec la notion d'anticipation. L'explication de ce concept de risque absolu et de risque relatif au Premier ministre a nécessité beaucoup de temps.
Je crois que le rôle principal du conseiller scientifique est de s'assurer que les décideurs politiques comprennent les systèmes complexes, puissent envisager les différentes options possibles, en vue d'obtenir les résultats escomptés. Il lui faut également expliciter les implications de chacune de ces options. Il est nécessaire de disposer pour cela des compétences de personnes (universitaires, chercheurs) qui produisent le savoir et les connaissances, de professionnels capables de synthétiser et d'intégrer ces connaissances (au sein d'académies, de groupes de réflexion des universités, des organes consultatifs), puis de spécialistes susceptibles de traduire ces données pour les rendre accessibles à la communauté des responsables politiques. C'est là qu'interviennent les conseillers scientifiques auprès du législateur et de l'exécutif.
Aujourd'hui, il y a trop de science. On compte ainsi actuellement trois millions de publications scientifiques par an. Comment les intégrer pour créer des connaissances et du savoir ? La nature même de la science a évolué. On peut désormais étudier des questions très complexes, auxquelles on ne trouvera jamais toutes les réponses. Il peut alors exister des différences de points de vue. On parle ainsi de la nature « post normale » de beaucoup de sciences, avec les dangers que représentent Wikipédia et Google. Trop de décideurs politiques pensent tout trouver grâce à ces deux outils, qui donnent souvent des informations erronées. Il existe aussi des perceptions du risque différentes et il est important de trouver des personnes comme Cédric Villani, Rolf Heuer ou Johannes Klumpers qui comprennent à la fois la communauté scientifique et le monde des décideurs politiques. Il est nécessaire, dans ce contexte, de bénéficier de traducteurs pour ainsi dire. La façon de procéder dépend enfin largement de la dimension culturelle.

– La notion de « broker » (courtier) est apparue à plusieurs reprises dans votre exposé. Pourriez-vous nous en dire plus ?
– Je crois qu'il faut faire la différence entre le plaidoyer et les « brokers ». On parle de plaidoyer lorsqu'une personne se présente avec un point de vue bien précis, qu'elle souhaite imposer à son interlocuteur, en l'occurrence dans notre cas au gouvernement.
La démarche de courtage procède d'une logique différente : il s'agit d'exposer ce que l'on sait, les limites de ses connaissances, ce que l'on ignore, les options qui en découlent et les incidences que chacune pourra avoir, à charge ensuite pour le décideur politique de prendre en compte l'ensemble des considérations en présence et de faire un choix parmi les différentes options envisageables.
De fait, je refuse de donner des indications précises sur ce que les décideurs devraient faire. Je préfère leur exposer les possibilités, du point de vue scientifique, sachant que les décideurs politiques doivent également tenir compte d'autres éléments pour prendre leurs décisions. Il s'agit selon moi du seul moyen pour être un conseiller scientifique de confiance : il faut mettre de côté ses propres préjugés.

– Nous continuons cette audition en accueillant le professeur Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec depuis juillet 2011. Professeur titulaire en psychiatrie à l'université McGill, il a occupé le poste de directeur scientifique au centre de recherche de l'institut Douglas. En avril 2009, il a pris le poste de vice-doyen des sciences de la vie et initiatives stratégiques à la faculté de médecine et celui de conseiller principal de l'université en recherches en sciences de la santé à l'université McGill, en plus de la fonction de directeur exécutif de la stratégie internationale de recherche concertée sur la maladie d'Alzheimer. Il a démissionné de ses postes depuis, à l'occasion de sa nomination comme scientifique en chef en 2011. Il préside les conseils d'administration des trois fonds de recherche du Québec (santé ; nature et technologie ; société et culture).
M. Quirion, l'Office parlementaire a eu le plaisir de vous auditionner longuement en décembre 2017 et nous sommes très heureux de vous entendre de nouveau ce matin pour nous présenter l'expérience du Québec en matière de conseil scientifique aux autorités politiques. Vous avez accepté de détourner une partie de votre séjour à Paris pour l'anniversaire des 80 ans du CNRS afin de venir devant nous, ce dont nous vous remercions.
– C'est un plaisir d'être de retour parmi vous. Depuis l'audition de décembre 2017, j'ai eu l'opportunité de mieux connaître le système de recherche français. J'ai en effet été sollicité par le président du CNRS pour évaluer l'ensemble du CNRS. Ceci a donné lieu à la remise d'un rapport il y a deux ans. Plus récemment, j'ai présidé le comité d'évaluation de l'ANR, dont le rapport devrait être rendu public demain.
Je me propose aujourd'hui de vous faire partager les leçons apprises en tant que scientifique en chef du Québec au cours des huit dernières années. Je tiens tout d'abord à signaler que le gouvernement actuel du Québec, contrairement au précédent, est très pragmatique et attend des résultats concrets. Mon rôle est celui de conseiller auprès du ministre responsable de la science, de l'innovation et de la recherche. Le Québec étant relativement petit, il est toutefois très facile d'interagir avec plusieurs ministères et ministres. Depuis ma prise de poste en 2012, quatre gouvernements, de trois partis, se sont succédé : ceci a donc nécessité une grande capacité d'adaptation aux différents contextes politiques et, de la part des parlementaires, un grand intérêt à interagir avec mon bureau pour obtenir des avis sur la recherche et l'innovation au Québec.
Il est très important, comme l'a souligné Peter Gluckman, d'établir un réel climat de confiance avec les élus et les hauts fonctionnaires. Au début, ministres et hauts fonctionnaires me demandaient souvent des rapports de quelques pages, se concluant par des préconisations. De plus en plus, les procédures s'allègent et il n'est pas rare que je reçoive des appels téléphoniques pour m'indiquer les problématiques sur lesquelles les autorités s'interrogent et me demander quelles suggestions je pourrais formuler d'ici le lendemain. Le monde politique est toujours dans l'urgence ; il n'est donc pas question d'écrire une thèse de doctorat mais de donner des suggestions très concrètes. En tant que président des trois conseils subventionneurs de recherches au Québec, dont chacun dispose d'un conseil d'administration de quinze experts nommés par le gouvernement, j'ai la chance de pouvoir solliciter l'expertise de 45 spécialistes, dans de nombreux domaines. Par exemple, le cas s'est posé de deux villes voisines, dont l'une acceptait la présence de pitbulls et l'autre non. Le ministre de la sécurité publique m'a sollicité pour me demander de formuler très rapidement des propositions à ce sujet, car un projet de loi était en préparation. Nous avons par ailleurs été confrontés, au cours des deux dernières années, à de très graves inondations, qui nous ont conduits à réfléchir à des préconisations en termes de sécurité et de santé publiques. Bien évidemment, le gouvernement du Québec a un certain contrôle dans ce domaine, mais il est également nécessaire d'interagir avec les provinces voisines, dont l'Ontario, mais aussi avec le gouvernement fédéral, les États-Unis (par rapport au Saint-Laurent, d'où viennent souvent les problèmes) et les maires des villes, afin de prendre des décisions concrètes, en termes par exemple d'évacuation des populations et de santé publique, tant au niveau pulmonaire qu'en matière de santé mentale des citoyens touchés.
Je rappelle que notre rôle est de conseiller les décideurs, de leur fournir les éléments leur permettant de faire des choix, et non de décider à leur place ou d'imposer quoi que ce soit.
Comme vous l'avez précisé, je suis en charge des trois fonds de recherche, ce qui constitue un levier d'action, plus évident sans doute dans le modèle québécois que dans d'autres systèmes à travers le monde.
La promotion du dialogue entre la science et la société constitue également une mission importante confiée à mon bureau. Ceci s'effectue tout d'abord en organisant des activités avec les parlementaires, à partir des demandes qu'ils nous transmettent. Ils nous ont par exemple sollicités parce qu'ils souhaitaient avoir des informations sur CRISPR-Cas9 ou sur l'intelligence artificielle. Lorsqu'elle s'adresse au public, notre action consiste plutôt à intervenir par rapport aux fausses nouvelles, aux « fake news » diffusées dans les journaux ou les réseaux sociaux. Nous avons ainsi créé un outil, le « détecteur de rumeurs », qui vise à développer l'esprit critique des gens, en présentant chaque semaine des découvertes récentes et en les remettant dans leur contexte.
Nous avons aussi un rôle en matière de diplomatie scientifique pour le Québec. Le Québec est toujours un peu différent du reste du Canada et a quelque 38 représentations à l'extérieur du pays, un peu partout dans le monde. Nous avons ainsi vocation à être présents à l'international, lors de missions avec des ministres ou le Premier ministre, pour parler de la science au Québec et de la manière dont elle peut aider la diplomatie. Nous avons par exemple développé avec la Palestine un partenariat pour inviter des collègues palestiniens à venir faire des séjours au Québec, dans plusieurs disciplines. En deux ans, une soixantaine de jeunes chercheurs palestiniens sont ainsi venus passer plusieurs mois au sein d'universités québécoises. Ceci représente notre petite contribution à l'augmentation des capacités de recherche en Palestine et peut peut-être constituer un outil pour la diplomatie.
Parmi les mots clés que j'ai retenus des quelques dernières années, le plus important est assurément la confiance. Il faut un certain temps pour la bâtir et peu de temps pour la détruire ; nous avons néanmoins réussi à la conserver. Il faut également être capable de s'adapter aux changements, de parti au pouvoir, de gouvernement, de ministres, et faire preuve de neutralité. Il importe aussi d'être en capacité de répondre rapidement aux sollicitations.

– Merci beaucoup, cher Rémi. Tu nous indiques qu'il t'est parfois demandé de fournir des propositions pour le lendemain matin. Si un scientifique en chef peut jouer ce rôle, un conseil scientifique ne le peut pas, car il faut du temps pour le réunir. Le modèle du scientifique en chef est populaire en particulier dans les pays anglo-saxons. En France, il n'existe pas de scientifique en chef rattaché au gouvernement ou au président. Un commentaire par rapport à cet état de fait ?
– Il est vrai que le modèle du scientifique en chef est plutôt anglo-saxon. Le gouvernement du Québec a décidé de créer ce poste suite à des rencontres avec des collègues israéliens. Le ministre de l'époque était en effet rentré au Québec en indiquant qu'il souhaitait qu'un tel dispositif soit mis en place chez nous. Au départ, le but était de disposer d'une personne susceptible d'être contactée pour avoir des réponses rapidement, plutôt que d'avoir à solliciter différentes personnes en fonction du sujet. L'idée était que cette personne soit responsable de la collecte des informations nécessaires auprès de ses collègues et puisse les synthétiser afin de formuler des recommandations.

– Nous abordons maintenant le sujet du conseil scientifique via l'angle des institutions européennes. Nous allons entendre en premier lieu Johannes Klumpers, chef de l'unité SAM (Scientific Advice Mechanism) à la Commission européenne. Cette unité soutient le groupe des conseillers scientifiques en chef de la Commission européenne, ainsi que le groupe européen d'éthique des sciences et nouvelles technologies. Le premier groupe fournit des conseils scientifiques à la Commission pour le développement des politiques, pour lesquelles un tel conseil est crucial, tandis que le second conseille la Commission sur des questions éthiques liées à la science et au développement de nouvelles technologies. L'unité dirigée par Johannes Klumpers élabore elle-même des politiques sur l'intégrité et l'éthique de la recherche, tout en étant responsable du système d'évaluation éthique des projets soumis dans le cadre du programme de recherche Horizon 2020.
En ce qui concerne son parcours personnel, Johannes Klumpers a, après plusieurs années de recherche industrielle en Suède, rejoint en 1998 la direction générale de la recherche et de l'innovation de la Commission européenne. Il occupe son poste actuel depuis sa création le 1er octobre 2015. Il nous présentera l'organisation générale du conseil scientifique au sein des institutions européennes.
À titre personnel, j'ai eu l'honneur et la chance d'être moi-même membre de ce conseil, sous la direction de Johannes, et ai démissionné de ce poste à mon entrée dans cette auguste institution qu'est l'Assemblée nationale.
– Je vais présenter brièvement le conseil scientifique dans les institutions européennes, pour vous permettre de mieux situer ensuite le rôle joué par le groupe des conseillers scientifiques en chef, représenté ici aujourd'hui par son président Rolf-Dieter Heuer. Le Parlement européen dispose d'un excellent système de conseil scientifique, avec l'équivalent d'un OPECST et un service de recherche. Le Conseil européen n'est en revanche pas doté d'un tel dispositif ; en cas de besoin de conseil scientifique, soit les États membres se réfèrent à leurs propres systèmes nationaux, soit il est fait appel à des systèmes autres, comme ceux de la Commission européenne.
Il a été dit précédemment que l'administration française, estimant tout savoir, ne percevait pas l'intérêt d'être conseillée. À la Commission européenne, la situation est exactement inverse : la Commission, considérant qu'elle ne savait rien, s'est dotée de nombreux mécanismes de conseil scientifique. Il existe entre autres une série d'agences, que vous connaissez bien car elles interagissent avec les États membres : on pense à l'EFSA pour la sécurité alimentaire, à une agence sur les addictions, une autre relative à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Ce système d'agences apporte du conseil scientifique à la Commission européenne, qui ensuite joue un rôle dans la gestion du risque.
La Commission européenne elle-même dispose d'un service interne de conseil scientifique, le Centre commun de recherche, qui fait de la recherche, mais donne aussi des conseils aux différents départements de la Commission.
Le groupe des conseillers scientifiques en chef, qui est relativement récent puisqu'il existe depuis fin 2015 seulement, présente deux particularités. La première est qu'il conseille non pas l'administration, mais les commissaires européens, c'est-à-dire la tête politique de la Commission européenne. La seconde tient au fait que les sept personnes qui le composent ne sont pas employées par la Commission européenne ; elles sont indépendantes et ne consacrent qu'une partie de leur temps à la Commission. La somme du temps dédié par ces sept personnes à la Commission correspond à environ 1,5 équivalent temps plein par an.

– La parole est maintenant au professeur Rolf Heuer, physicien expérimental des particules très réputé, ancien président de la société allemande de physique et actuellement vice-président de cette même institution. Depuis mai 2017, il préside le conseil de SESAME, le fameux synchrotron qui, au Moyen-Orient, rassemble des scientifiques de diverses nationalités, dont on sait à quel point les pays entretiennent entre eux des relations diplomatiques difficiles. Le Pr. Heuer a été directeur général du CERN de 2009 à 2015. C'est au début de son mandat, en 2009, que le CERN a lancé le Grand collisionneur de hadrons, qui a permis aux chercheurs de prouver l'existence du fameux boson de Higgs. Rolf Heuer a activement engagé le CERN à promouvoir l'importance de la science et de la formation pour le développement durable de la société. Je souligne qu'une délégation de l'Office parlementaire a rendu visite au CERN au printemps dernier. Rolf Heuer avait antérieurement été directeur de recherche en physique des particules et des astroparticules en Allemagne, où il a orienté les groupes de physique des particules vers le Large Hadron Collider, en rejoignant les expériences de grande envergure comme ATLAS ou CMS.
Il a en outre été l'un des premiers membres du groupe de conseillers scientifiques principaux de la Commission européenne, groupe dont il a été élu président en avril 2017. C'est sur son expérience de cette fonction que nous souhaitons entendre son témoignage ce matin.
– Merci beaucoup, Cédric, pour cette introduction. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous.
Je vais vous présenter brièvement qui nous sommes, ce que nous faisons et comment nous le faisons.
Le groupe des conseillers scientifiques principaux de la Commission européenne a été créé voici quatre ans, pour présenter des conseils scientifiques indépendants au collège des commissaires européens et leur permettre de prendre des décisions éclairées, en espérant ainsi participer à la qualité de la législation de l'Union européenne. Ce modèle, adopté par un certain nombre de pays, remplaçait une situation dans laquelle n'existait qu'un seul conseiller scientifique pour la Commission. Nous sommes aujourd'hui sept personnes au sein de ce groupe, qui avons des parcours et des expériences différents les unes des autre, dans des disciplines diverses dont la physique des particules, la biologie ou encore la sociologie. Il est important de savoir que le mot « science » est à envisager dans ce contexte au sens allemand du terme « wissenschaft », c'est-à-dire n'englobant pas uniquement les sciences dures et l'ingénierie, mais aussi les sciences humaines et sociales. Nous bénéficions d'un soutien très fort de l'unité présidée par Johannes Klumpers, sans lequel nous ne pourrions pas mener à bien notre tâche, dans la mesure où nous ne l'exerçons qu'à temps partiel. Nous collaborons en outre très étroitement avec un nouvel organe, qui est le conseil scientifique des académies européennes, qui nous donne accès aux connaissances accumulées par plus d'une centaine d'académies européennes regroupées en cinq réseaux.
Le mécanisme de conseil scientifique de la Commission européenne compte trois niveaux. À la base, se trouve l'unité SAM, sans laquelle rien ne fonctionnerait. On trouve ensuite le niveau des académies scientifiques, puis celui des conseillers scientifiques, c'est-à-dire notre groupe.
Nous avons la responsabilité de fournir à la Commission des conseils scientifiques indépendants, sur des questions spécifiques. Il ne s'agit pas de faire double emploi avec d'autres organes existants, mais de collaborer avec eux et de fournir des recommandations pour une meilleure interaction entre le processus d'élaboration des politiques et le conseil scientifique indépendant. Notre activité de conseil porte essentiellement sur des sujets sélectionnés du haut vers le bas (top-down) : ce sont les commissaires qui nous confient des tâches. Mais certaines idées viennent aussi du terrain, c'est-à-dire du bas vers le haut (bottom-up).
Notre rôle dans le contexte du conseil scientifique européen est de collaborer avec d'autres organes consultatifs, sans duplication de nos efforts. Le mot clé de notre action est l'indépendance, qui renforce notre crédibilité aux yeux de la société.
Comment fonctionnons-nous ? Nous déterminons les sujets à aborder en lien avec les différents services de la Commission européenne. Nous n'acceptons en effet jamais de question sans comprendre les raisons pour lesquelles on nous la pose. Cette collaboration ne limite en rien notre indépendance, mais constitue au contraire le seul moyen pour nous de comprendre les questions qui nous sont soumises et d'y répondre. Nous créons ensuite un groupe d'experts, puis examinons la littérature disponible sur le sujet. Les académies rédigent un rapport fondé sur les preuves, sur la base duquel nous élaborons nos avis. Nous évaluons, nous faisons des synthèses et formulons des recommandations. Notez que ces recommandations ne sont élaborées que par le groupe de conseillers scientifiques en chef et non par les académies. Cette structure à trois niveaux est donc très importante et extrêmement utile.
Cette mission de conseil scientifique à l'appui des politiques européennes s'inscrit dans un monde complexe. Comme l'a souligné Peter Gluckman, la confiance et la communication sont des éléments majeurs. Avant de formuler une recommandation, nous devons ainsi nous assurer de la qualité du conseil scientifique que nous allons fournir, avec la participation de toutes les sciences. Il faut non seulement analyser et évaluer, mais aussi communiquer sur les incertitudes, en évitant toute confusion, pour créer une vraie confiance en ce que nous présentons. C'est là l'un des grands défis qui s'offrent à nous.
Quel est l'impact de notre activité ? Pour toutes les questions que nous avons traitées jusqu'ici, nous avons constaté que les recommandations que nous avons formulées ont été utilisées dans le cadre des règlements, législations et notes de la Commission. Nous travaillons ainsi pour et avec la Commission.
En conclusion, je souhaiterais insister sur le fait qu'un conseil scientifique ne doit pas, selon moi, compter plus de 7 ou 8 membres. Toutes les disciplines ne peuvent pas y être représentées. Il faut donc prévoir une structure à différents niveaux, afin de pouvoir garantir des réponses pertinentes. Nous sommes là pour présenter les connaissances et les recommandations, mais aussi pour identifier d'éventuelles lacunes. Nous ne préconisons pas à la Commission de mener des recherches dans tel ou tel domaine, mais identifions simplement des lacunes dans les connaissances scientifiques. Nous présentons des options et des faits, mais évitons d'exprimer des valeurs.

– Je retiens notamment de votre exposé l'idée du conseil scientifique resserré. Nous avons évoqué le scientifique en chef, c'est-à-dire un dispositif composé d'une seule personne, placée auprès du gouvernement. Vous venez de nous présenter l'intérêt d'un conseil scientifique très resserré, autour de 7 à 8 personnes. Je le confirme, pour avoir fait partie de la première version du conseil scientifique, qui était beaucoup plus large, mais aussi beaucoup moins efficace.
Je retiens également la notion d'incertitude, qu'il est difficile de faire passer auprès d'un gouvernement. On sait qu'il en existe plusieurs interprétations possibles : elle peut être intrinsèque ou due à notre façon d'évaluer au regard de notre manque de connaissances. Pourrais-tu citer des exemples dans lesquels la question de l'incertitude était particulièrement importante ?
– Je pense à un cas très pertinent, intervenu lors de la discussion sur la question des pesticides, des produits phytosanitaires. Il existe dans ce domaine des incertitudes statistiques et intrinsèques à la méthodologie. Il a été difficile d'effectuer la distinction entre ces différentes incertitudes et de communiquer à ce propos.

– Nous accueillons maintenant Mme Emily Hamblin, directrice régionale pour le réseau de la science et de l'innovation du ministère des affaires étrangères et du Commonwealth d'Europe de l'Ouest. Elle dirige les services de conseil scientifique auprès de l'ambassadeur britannique en France et représente le gouvernement britannique pour la science et l'innovation en Europe occidentale. Mme Hamblin connaît très bien le système de conseil scientifique du gouvernement britannique et pourra également nous transmettre d'éventuels messages de l'équipe du conseiller scientifique en chef du gouvernement. Elle va nous présenter le modèle britannique d'avis scientifiques au gouvernement.
– Je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. C'est un vrai plaisir que d'avoir l'occasion de vous présenter le système britannique de conseil scientifique auprès du gouvernement.
Sir Patrick Vallance, conseiller scientifique en chef auprès du gouvernement, aurait beaucoup aimé être là mais ne peut malheureusement pas être présent et vous prie de l'en excuser.
Je vais aborder le rôle du conseiller scientifique en chef du gouvernement britannique et vous présenter le réseau des conseillers scientifiques du gouvernement, les ressources, les outils à leur disposition et vous donner quelques exemples de l'impact que ce système a pu avoir.
Le Royaume-Uni a un conseiller scientifique en chef du gouvernement depuis 1964. À l'heure actuelle, il s'agit de Sir Patrick Vallance. Avant cela, dès les années 1920, plusieurs administrations, dont le ministère de l'agriculture par exemple, ont bénéficié de conseillers scientifiques. Aujourd'hui, le conseiller scientifique en chef du gouvernement dirige un réseau de 26 conseillers scientifiques en chef, en lien avec chaque ministère, administration et d'autres organes.
Le rôle d'un GCSA (Government Chief Scientific Adviser) est quadruple. Il doit tout d'abord fournir des conseils scientifiques et présenter les défis en jeu directement au Premier ministre et à son gouvernement, y compris dans les situations d'urgence. Il est important de souligner que le GCSA a un lien direct avec le Premier ministre. Il s'agit également de s'assurer que les procédures sont en place à l'échelle de l'ensemble du gouvernement, pour étayer les processus de prise de décisions politiques en matière de sciences et d'ingénierie : il doit présenter de façon indépendante la manière dont la situation est examinée et contrôler les budgets des administrations. Il a également un rôle de supervision. Le troisième rôle du GCSA consiste à conseiller en matière de politique scientifique, technologique, d'ingénierie et de mathématiques. Il dirige également la profession scientifique et d'ingénierie dans la fonction publique et doit s'assurer que les scientifiques et les ingénieurs ont accès aux formations et aux possibilités d'apprentissage et les différentes administrations aux compétences nécessaires. Les conseillers scientifiques en chef du gouvernement sont des hauts fonctionnaires, désignés par voie de concours. Ils peuvent être issus de la fonction publique, des universités, de l'industrie ou du secteur tertiaire.
Les ressources à leur disposition pour remplir leurs rôles sont multiples. Sir Patrick Vallance bénéficie du soutien de l'office des sciences du gouvernement. Ainsi, quelque 80 scientifiques l'aident et mènent avec lui une réflexion sur le long terme. Il s'agit d'examiner les opportunités et défis scientifiques qui se présentent. Le GCSA copréside également le conseil du Premier ministre pour la science et la technologie : il s'agit d'un conseil consultatif indépendant de 20 membres, dont des universitaires, des représentants des entreprises, qui donnent des conseils sur des questions transversales relevant de la responsabilité de différentes administrations. Il se réunit une fois par semaine avec le réseau des conseillers pour savoir ce qui se passe à l'échelle des administrations. Les conseillers scientifiques ont le même rôle que Sir Vallance, mais à l'échelle des administrations. Ils se réunissent, président différents conseils scientifiques (il en existe environ 70).
Quel est l'impact de ce système ? Comment les travaux de ces conseillers éclairent-ils les politiques ? Comment fonctionnent-ils en matière de supervision de la recherche ? Quels conseils scientifiques apportent-ils ? Pour ce qui est de l'éclairage des politiques, des rapports sont élaborés et publiés, portant sur des thèmes variés, comme l'avenir des transports, la recherche, l'industrie, les océans, la technologie quantique, etc. Ces travaux ont pu aider à façonner les stratégies du gouvernement. Le conseil du GCSA a par exemple directement contribué à la conception du « Faraday Challenge », programme de 246 millions de livres visant à soutenir la recherche et l'innovation dans le secteur des batteries d'automobiles. Le GCSA a également présidé le groupe consultatif qui a examiné la question de la pollution environnementale suite à l'incendie de la tour Grenfell. Dans le domaine de la santé, les travaux du conseil des sciences et des technologies ont par ailleurs conduit au lancement d'un investissement à hauteur de 2,5 milliards de livres, intitulé « British patient capital programme ».
Pour ce qui est du conseil scientifique en situation d'urgence, le gouvernement peut demander, en cas de besoin, la constitution, en quelques heures, d'un groupe consultatif, qui se réunit quotidiennement jusqu'à la fin de la situation d'urgence, afin d'examiner les différents aspects en présence et de s'accorder sur les conseils scientifiques susceptibles d'étayer les recommandations politiques, en vue de prises de décisions par le gouvernement. Le GCSA et les CSA (Chief scientific advisers) décident ensemble des personnes les plus compétentes dans tous les domaines. Dernièrement, des groupes de ce type ont notamment été constitués lors d'inondations, d'épidémies ou d'incidents industriels. En 2011, en réaction à l'accident nucléaire de Fukushima, un tel groupe a été mis en place et a joué un rôle important en examinant les données disponibles sur l'état du réacteur avant l'accident, les données météorologiques, l'impact probable, afin d'informer le gouvernement sur la question de savoir s'il fallait évacuer les ressortissants britanniques ou non.
Les aspects de risque et d'incertitude, tout comme les délais de prise de décision, sont des défis que nous pourrons aborder ultérieurement, dans les discussions.

– Quelle est la durée du mandat de conseiller scientifique en chef ? À quelle fréquence est-il renouvelé ?
– Je pense que le mandat est d'une durée de cinq ans. Le précédent GCSA, Sir Beddington, est à présent directeur de l'Agence sur la recherche. Généralement, ces personnes restent impliquées dans le domaine du conseil scientifique au-delà de leur mandat en tant que GCSA.

– Nous avons souhaité, pour la France, entendre les représentants de l'Académie des sciences, qui disposent de toutes les compétences pour jouer un rôle d'expertise scientifique auprès des autorités et institutions.
L'Office parlementaire bénéficie de longue date de cette expertise, mais de manière plus systématique depuis 2018, avec l'organisation de séances de travail thématiques conjointes réunissant, outre des représentants de l'Académie des sciences, de l'Académie nationale de médecine et des experts invités, le fleuron de la recherche française sur des sujets sélectionnés d'un commun accord : recherche participative, cybersécurité, CRISPR-Cas9 et l'industrie du génome ou encore programmation pluriannuelle de l'énergie.
Les académies nous font également bénéficier de leurs compétences via les experts qu'elles nous désignent selon les sujets et par l'intermédiaire des avis qu'elles nous transmettent très régulièrement, par exemple, pour l'Académie des technologies, sur des thèmes technologiques que nous traitons.
Pierre Corvol, président de l'Académie des sciences, qui est régulièrement en interaction avec nous, aurait souhaité être présent, mais n'a pu se rendre disponible.
Nous écouterons ce matin Patrick Flandrin, vice-président de l'Académie des sciences, qui pourra évoquer les réflexions actuelles de celle-ci sur le conseil scientifique. M. Flandrin est physicien, directeur de recherche CNRS au laboratoire de physique de l'École normale supérieure de Lyon, membre de l'Académie des sciences depuis 2010 et vice-président pour 2019-2020. Il a antérieurement, de 2016 à 2018, été délégué de section des sciences mécaniques et informatiques, et a une expérience approfondie du fonctionnement de l'Académie. J'ajoute qu'il a été mon collègue à l'École normale supérieure de Lyon, dans une autre vie.
– L'Académie des sciences est très heureuse d'avoir été invitée à intervenir dans cette circonstance.
Je vais évoquer brièvement son expérience ainsi que les souhaits qu'elle peut formuler en termes d'interaction avec les activités d'expertise et de conseil.
L'Académie des sciences a été créée en 1666 par Colbert. De nombreuses évolutions ont eu lieu depuis lors, avec non seulement un renouvellement du paysage scientifique, mais aussi une modification des rapports que l'Académie a toujours entretenus avec son protecteur, initialement le roi, désormais le Président de la République. À l'origine, l'Académie avait clairement pour objet d'être sollicitée en tant que conseil scientifique. Comme cela a été précédemment évoqué, ce lien s'est ensuite distendu et a varié au cours des siècles. Il faut reconnaître que l'Académie n'est aujourd'hui que rarement sollicitée de cette façon. Néanmoins, si l'on regarde la présentation actuelle de l'Académie, on peut y lire que « les réflexions que l'Académie conduit ont pour rôle de fournir à tous un cadre d'expertise, de conseil et d'alerte vis-à-vis des enjeux politiques, éthiques et sociétaux que pose la science. En vertu de cette mission, elle oeuvre au partage de la science pour éclairer les choix des citoyens et formule des recommandations sur lesquelles peuvent s'appuyer les autorités gouvernementales. Elle soutient en outre la recherche, s'engage pour la qualité de l'enseignement des sciences et participe à la vie scientifique internationale ». On se situe là au coeur de la problématique, avec une académie supposée occuper une place tout à fait affirmée à l'interface entre le monde scientifique, la société dans son ensemble et la puissance publique.
L'Académie bénéficie pour ce faire de deux atouts majeurs. Composée d'un ensemble de membres de toutes disciplines des sciences exactes et naturelles, elle dispose tout d'abord d'une expertise pluridisciplinaire avérée. Le petit bémol que l'on pourrait apporter est que les sciences humaines et sociales n'y sont pas représentées. Cette absence pourrait aujourd'hui se discuter, dans la mesure où il est désormais souvent difficile d'aborder les questions de science sans prendre en compte les aspects sociétaux ou éthiques. Il se trouve toutefois que nous avons, au sein de l'Institut de France, des académies voisines, comme celle des sciences morales et politiques, avec lesquelles nous pouvons échanger et mener des travaux communs.
Le deuxième atout de l'Académie est son indépendance. Placée sous la seule protection du Président de la République, elle n'a pas d'attache ou de tutelle ministérielle de quelque sorte que ce soit. Ceci lui offre une capacité d'intervention assez unique, soit par saisine, soit, le plus souvent, par autosaisine, sur toute question où la science trouve sa part.
L'Académie dispose de plusieurs instruments internes, sur la base essentiellement, de façon assez classique, de comités, de groupes de travail, qui engagent des travaux au long cours. Certains sont pérennes, tandis que d'autres sont mis en place de façon ad hoc, transitoire, beaucoup plus réactive sur des questions d'actualité.
Au cours des dernières années, l'Académie a fourni une trentaine de rapports, sur des sujets très divers. Elle a ainsi publié entre autres des Remarques et propositions sur les structures de la recherche publique en France en 2012, ainsi que des études remarquées sur L'enfant et les écrans, Les nouveaux enjeux de l'édition scientifique ou encore, plus récemment, Les mécanismes d'adaptation de la biodiversité aux changements climatiques, pour ne citer que quelques exemples.
Indépendamment de ces rapports, l'Académie a émis et rendu publics une cinquantaine d'avis et de recommandations, sur des sujets d'actualité dont elle a pu s'autosaisir, comme le financement de la recherche ou les bonnes pratiques en matière d'évaluation des chercheurs et des programmes de recherche. Ces deux textes ont été élaborés de manière conjointe avec d'autres académies, le premier avec l'Académie nationale de médecine, le second avec nos amis allemands de la Leopoldina et britanniques de la Royal society. Récemment, l'Académie des sciences a produit des recommandations sur la révision de la loi de bioéthique, et plus récemment encore une contribution à la préparation de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, qui nous intéresse tous en ce moment.
Dans le prolongement de ses actions passées, l'Académie travaille actuellement dans plusieurs directions. Ainsi, le comité des sciences de l'environnement s'intéresse au sujet d'actualité des matières plastiques et de l'environnement. Le comité de prospective en énergie travaille sur la transition énergétique. Nous disposons en outre, bien évidemment, d'un groupe d'initiative intelligence artificielle, qui s'intéresse à ce sujet sous ses multiples aspects. Enfin, le comité science, éthique et société aborde notamment les questions d'intégrité scientifique, dans lesquelles notre président, Pierre Corvol, est particulièrement impliqué.
Les réflexions menées par l'Académie s'articulent aussi avec des actions internationales. L'exemple emblématique de cette démarche est sa participation, chaque année, au GScience, qui regroupe essentiellement les académies des pays du G7, parfois élargi, et élabore des recommandations sur des thèmes choisis collectivement. En 2019, la France était l'hôte du G7 politique et à ce titre, notre Académie des sciences a organisé en mars une réflexion commune sur trois thèmes d'intérêt très général, qu'elle a proposés à ses partenaires : science et confiance, intelligence artificielle et société, et enfin science citoyenne à l'heure d'internet. Ceci donne lieu à des amendements, des discussions, puis à l'adoption de textes finaux, portés ensuite en une déclaration commune. Ce texte de quelques pages, assorti d'un résumé, comporte notamment des recommandations à l'usage des gouvernements. Un effort est en outre accompli pour essayer d'assurer un suivi de toutes ces réflexions : ainsi, la réflexion sur l'intelligence artificielle (IA) aura une continuation lors du prochain G7 à Washington, sous forme d'un travail sur l'IA dans le domaine de la santé. Ce thème, initié à Ottawa en 2018, a déjà fait l'objet d'un forum franco-canadien en septembre dernier, pour approfondir certains de ses aspects. Évidemment, cette réflexion donne également lieu à des interactions avec des initiatives plus locales : un groupe de travail conjoint a ainsi été constitué avec l'Académie nationale de médecine, tandis qu'un groupe d'initiative spécifique a, comme mentionné précédemment, été mis en place au sein de notre académie.
Pour revenir à un plan national, je rappellerai qu'a été initié en 2018 un cycle de rencontres sous forme de petits-déjeuners d'échanges, en partenariat avec l'Académie nationale de médecine et l'Office parlementaire. Quatre sessions ont déjà eu lieu, portant sur l'énergie, l'édition du génome, la cybersécurité et récemment la recherche participative. Une cinquième rencontre, en préparation, se tiendra en février 2020 sur le thème de la robotique. Ces rendez-vous sont autant d'occasions d'échanges, de partage de questionnements et d'expertises. Sans doute pourrait-on aller plus loin, pour faire en sorte que la réflexion se poursuive au-delà de ces rencontres ponctuelles et se conclue éventuellement par la formulation d'avis et de recommandations.
D'une manière générale, l'Académie des sciences a de multiples façons de jouer le rôle d'expertise et de conseil qui lui incombe de par ses statuts. On peut noter à cet égard qu'elle s'est dotée voici quelques années d'une charte de l'expertise, actuellement en cours d'actualisation, visant à préciser et garantir de façon claire et transparente les principes déontologiques à respecter dans le rendu de ses avis.
Comme ceci a été précisé en introduction, l'Académie a la capacité de mener à bien ses missions grâce à la richesse pluridisciplinaire de ses membres et à son indépendance. J'ajoute qu'elle en a évidemment le souhait, sans cesse réaffirmé sans ambiguïté.

– Merci beaucoup, cher Patrick. Ma question s'adresse à l'ensemble des intervenants : quels exemples emblématiques pourriez-vous citer montrant l'intérêt de bénéficier d'un mécanisme de conseil scientifique qui fonctionne bien et à l'inverse l'inconvénient de disposer d'un système qui fonctionne mal ? Il est bien évident que nous sommes conscients du fait que le premier vaut mieux que le second. Mais pourriez-vous citer un cas particulier dans lequel l'existence d'un mécanisme satisfaisant a permis d'avoir une bonne communication gouvernementale ou de prendre une décision appropriée ? Dans le cas de l'OPECST, nous sommes automatiquement impliqués dans l'élaboration de certaines lois. Ainsi, la future loi relative à la bioéthique ne serait pas la même si l'OPECST n'avait pas préalablement examiné les questions en débat. Pourriez-vous nous donner des exemples relatifs aux conseils que vous connaissez ?
– En particulier, quelle a été la décision après le séisme qui avait frappé les alentours de Wellington et qui pouvait menacer la capitale ? Quel a été l'historique ?
– Il fallait prendre une décision rapidement. Il était alors très important que le conseiller scientifique en chef soit membre du conseil de sécurité nationale, pour deux raisons : d'une part, parce qu'il avait sur la situation une réflexion singulière et posait des questions différentes des autres membres, d'autre part, parce qu'il pouvait contacter très rapidement les experts, qu'il connaissait. Nous avions, pour conseiller le Premier ministre sur la décision à prendre concernant le tremblement de terre, le soutien d'experts géologues, mais aussi d'équipes japonaises, européennes, etc., qui ont apporté des informations sur la question des risques absolus et relatifs. Étant médecin, donc scientifique moi-même, je voulais m'assurer que le Premier ministre, qui est un financier, et le responsable géologue pourraient véritablement communiquer, se comprendre. J'ai joué le rôle d'intermédiaire, permettant une bonne compréhension par le Premier ministre du fait que le risque relatif pouvait être élevé, mais que le risque absolu était assez faible. L'alternative était la suivante : ne rien faire, évacuer la ville ou faire un plan d'action sans que la population ne panique. Cette dernière option l'a finalement emporté. Différentes mesures ont ainsi été prises, par exemple le fait que les supermarchés prévoient de stocker davantage de denrées non périssables, que les services de téléphonie mobile soient maintenus, que l'armée puisse apporter son aide sans passer par les processus habituels. Il fallait également mettre en place les moyens de maintenir la continuité du gouvernement. Beaucoup de choses ont ainsi été faites sans que le public ne le sache. Nous avons en outre utilisé énormément de messageries, comme habituellement dans le cas d'un tsunami ou d'un séisme.
La décision a été prise à cette réunion et le Premier ministre a été très clair : il a indiqué qu'il s'agissait d'une décision scientifique en premier lieu et qu'il se plierait à ce que les conseillers scientifiques lui recommanderaient dans ce contexte. Il a également demandé que ces préconisations soient consignées par écrit, ce qui a été fait. Je pense que cette situation met en lumière le fait que la dimension temporelle est extrêmement importante. Beaucoup de travaux peuvent être menés, au niveau universitaire notamment ; mais ceci demande du temps. On peut faire appel aux experts. Mais dans les situations d'urgence, il faut un processus spécifique, établissant le lien entre le gouvernement et la communauté scientifique.
Rémi Quirion a indiqué par ailleurs qu'il fallait souvent apporter des conseils par le biais d'une discussion. Il est en effet très important d'avoir des échanges informels avec des ministres, de hauts responsables, un président, un Premier ministre, très en amont, pour établir un cadre. Prenons l'exemple de la santé mentale : le gouvernement allait dans une direction et je lui avais conseillé de ne pas se précipiter et d'envisager d'autres possibilités. Cette discussion, qui a eu lieu dans un couloir, a conduit à une complète réorientation de la politique. Les experts sont ensuite entrés en jeu, pour lancer le cycle politique.
– Peut-être ne répondrai-je pas directement à la question, mais je souhaiterais rebondir sur la dimension du cadrage, dont le groupe de conseillers scientifiques auprès de la Commission européenne considère qu'il s'agit d'un élément très important. Prenons l'exemple des pesticides. Il existe un cadre réglementaire et les agences chargées d'évaluer le risque lié à une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un pesticide travaillent conformément à la mission qui leur été confiée et évaluent ce pesticide particulier. Il est toutefois probable qu'un certain nombre de citoyens apprécieraient un cadrage parfois plus large et seraient par exemple intéressés de savoir ce qui arriverait si l'on n'utilisait plus du tout de pesticides, quel serait l'impact sur les prix, sur les agriculteurs et si cet objectif serait atteignable. Je pense que le rôle des agences réglementaires est très important et nécessaire ; mais il faut s'assurer aussi que les questions plus larges soient traitées et ne soient pas oubliées.

– Il est certain que la bonne formulation de la question est majeure. Ceci m'évoque un rapport de l'OPECST sur l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux par les agences : une confusion entre cette question générale et la question spécifique du glyphosate nous avait menés à une sorte de tempête médiatique après les imprudences de communication d'un de nos collègues sénateurs.
– Je souhaiterais prendre la parole en témoin interrogatif quant à la possibilité du conseil scientifique froid, objectif, donc parfaitement scientifique. J'y suis très favorable et j'en rêve, car j'essaie d'être rationnel. Je constate toutefois que la société fonctionne de façon différente. J'observe par exemple le succès du principe de précaution tel qu'il est porté par les hommes politiques et par le système médiatique. Ceci constitue l'une des premières difficultés que vous, scientifiques, avez à surmonter. L'exemple de Wellington est très éclairant. Si l'information est mal traduite et mal diffusée (ce que la société numérique permet de faire en masse, y compris lorsqu'il s'agit de fausses nouvelles), la tentation de l'homme politique, dans le doute du désordre intellectuel que ces informations apportent, est, vis-à-vis d'un risque qu'il ne sait pas évaluer et que son conseiller scientifique encadrera certainement, mais dans une fourchette assez vaste, de faire valoir le principe de précaution pour choisir la solution la plus apaisante, cette dernière n'étant pas nécessairement la plus pertinente.
Je vois une deuxième difficulté en matière de conseil scientifique. Vous avez évoqué les notions de confiance et d'indépendance. Plus les gens sont compétents, plus ils sont engagés professionnellement, comme universitaires, chercheurs, enseignants, mais aussi, c'est leur droit le plus strict, comme professionnels d'un métier, salariés d'une entreprise ou dirigeants d'un établissement. Or le présupposé d'indépendance voudrait que nous ayons affaire à de purs esprits, à la fois extraordinairement compétents, adossés à une culture inépuisable, et acceptant de vivre dans un monastère, loin des tentations et de l'image du péché, du diable corrupteur, ce dernier pouvant être en l'occurrence une fonction de chercheur ou de conseiller scientifique dans une entreprise, ou encore la tentation d'exister médiatiquement. Je trouve, en résumé, que vous occupez une fonction extraordinairement difficile. C'est la raison pour laquelle je remercie vraiment Cédric Villani d'ouvrir ce débat. Il n'y a jamais eu autant de scientifiques en activité, dans toute l'histoire du monde, qu'aujourd'hui, ni autant de mécanismes de scepticisme dans la société. J'adore l'histoire : pourquoi les rois de France ont-ils créé les académies ? Pour se libérer de la superstition religieuse. L'université alma mater était tenue par des religieux, qui parfois se querellaient entre eux, si bien que ce n'était pas un monde totalement fermé ; elle était néanmoins dépendante. Les académies ont été conçues pour disposer d'une information indépendante. Or cette information se heurte aujourd'hui non pas tant à des obscurantismes religieux, bien que ceci puisse arriver dans certains pays, mais à une société hyperémotive, inquiète et très sur la défensive à l'égard de tout. Ressentez-vous ceci dans l'exercice de votre fonction ?

– Nous allons entendre la réponse de Rémi Quirion, puis donner la parole aux parlementaires qui souhaitent s'exprimer et poser des questions. Émilien Schultz nous fera enfin partager le regard extérieur qu'il a posé sur notre Office.
– J'ai mentionné brièvement dans mon exposé l'exemple des inondations auxquelles nous avons dû faire face. Ceci relève, d'une part, d'une question d'urgence lorsque le phénomène survient, d'autre part, de décisions de plus long terme par la suite. Aucun scientifique en chef n'a la science infuse. Si l'on m'interroge sur la maladie d'Alzheimer, qui correspond à mon domaine d'expertise, les choses sont évidemment plus faciles ; mais peut-être ma vision du sujet est-elle aussi de ce fait plus biaisée. Il faut donc être vigilant. Lorsqu'il s'agit de prodiguer des conseils en situation d'inondations, je ne suis plus dans mon domaine de prédilection : il me faut donc travailler avec des experts. En situation d'urgence, les éléments doivent être rapidement réunis : j'ai la chance de disposer autour de moi, au sein des différents conseils d'administration des fonds que je préside, d'un groupe de 45 experts de toutes disciplines que je peux contacter facilement pour leur demander de me fournir rapidement quelques suggestions. Dans le cas des inondations, maires et ministres subissaient beaucoup de pressions pour indemniser rapidement les citoyens inondés, qui souhaitaient tous rebâtir exactement au même endroit – même s'ils avaient été inondés plusieurs fois au cours des années précédentes – car les rives du Saint-Laurent à Montréal sont un lieu magnifique. Or la suggestion que nous avions faite était précisément de ne pas reconstruire au même endroit. Les politiques ont fait le choix de différer leur décision à ce sujet, préférant régler d'abord les difficultés liées à la situation d'urgence. Les décisions ont donc été prises en deux temps, avec tout d'abord des décisions d'urgence, et dans un second temps le vote de nouvelles lois interdisant de rebâtir sur ce territoire ou prévoyant, pour les citoyens décidant de passer outre, qu'ils ne recevraient aucune indemnisation de la municipalité ou du gouvernement en cas de nouvelles inondations. Il est ainsi possible de différer certaines décisions et, en n'étant plus sur la ligne de feu, de bénéficier de l'appui d'experts pour étayer certains points.
Un autre exemple est celui de la vitamine C et de son impact dans le traitement du cancer. Cette question s'est posée au moment de l'élection d'un nouveau gouvernement. Les nouveaux ministres et députés venaient d'arriver en poste. Un député reçut alors des personnes de son comté, dont une dame qui lui indiqua qu'elle avait un cancer et qu'elle savait que la vitamine C fonctionnait très bien pour traiter cette maladie. Le député, qui n'était pas médecin, décida alors de lancer une pétition à ce sujet, qu'il se proposait de déposer à l'Assemblée nationale pour que le ministère de la santé du Québec rembourse les traitements à la vitamine C dans le cadre du traitement des cancers. Cette pétition a recueilli 120 000 signatures en l'espace de quelques semaines. La télévision, les journalistes, les artistes se sont emparés du sujet. Je recevais continuellement des appels pour m'inciter à signer, au motif que tel chanteur d'opéra connu l'avait signé avant moi. Des discussions ont alors eu lieu avec le député en question et les ministres, pour les inviter à la plus grande prudence. Le gouvernement a finalement décidé de ne pas aller de l'avant. C'est là l'un des dangers des nouveaux élus, qui sont soumis à de nombreuses pressions et souhaitent satisfaire leur électorat et les personnes qui les sollicitent à tout propos. Ceci fait partie de notre rôle de scientifique en chef que de les aider.
– Merci à toutes et à tous de nous avoir éclairés sur ce sujet, que je trouve très intéressant, ayant moi-même été professeure de physique-chimie dans une vie antérieure. Une catastrophe industrielle s'est produite dans notre pays à Rouen, avec l'incendie de l'usine Lubrizol. Pourriez-vous nous indiquer ce qui, selon vous, aurait été immédiatement mis en place dans vos différents pays suite à une catastrophe comme celle-ci ? J'ai l'impression que nous n'avons pas été à la hauteur de la circonstance. J'ai par exemple entendu aux informations que le lendemain de l'incendie, des professeurs et des élèves s'étaient présentés à leur école dans le périmètre impacté. Des pompiers ont également constaté, après être intervenus, des conséquences sur leur santé, certainement dues à la présence de substances nocives dont ils n'étaient pas suffisamment protégés.

– M. le président, M. le vice-président, mesdames et messieurs, je vous remercie pour cet échange très intéressant, pour moi qui suis députée mais ne suis pas membre de l'OPECST. La transition technologique que nous vivons actuellement est, vous l'avez rappelé, inédite. Les progrès récents, notamment en matière d'intelligence artificielle, ont des impacts sur nos vies quotidiennes et sur les politiques publiques dans de nombreux domaines. Je salue par conséquent la structuration d'instances permettant d'apporter du conseil aux politiques en matière d'analyse de ce qu'est aujourd'hui notre monde scientifique. Actuellement, les politiques publiques peinent à prendre véritablement en compte les résultats des exercices prospectifs menés par les chercheurs, du fait peut-être d'un manque de coordination entre les différents acteurs et d'un manque d'indépendance de financement. Je citerai notamment l'exemple du centre Facebook Artificial Intelligence Research, basé à Paris, qui réunit 80 chercheurs et 20 doctorants, mais est évidemment à la main de Facebook.
Face au défi environnemental, la communauté internationale a fait émerger le GIEC, en 1988, qui dépend du programme des Nations-Unies pour l'environnement. Financé par les 195 États membres de l'ONU, qui y contribuent de manière indépendante et volontaire, le GIEC n'est pas un organisme de recherche à proprement parler, mais un lieu d'expertise visant à synthétiser les travaux menés dans les laboratoires du monde entier, en fonction d'un problème précis pour lequel les membres onusiens l'ont mandaté. En bref, il travaille à dégager clairement des éléments qui relèvent du consensus de la communauté scientifique.
Face au défi que représente l'intelligence artificielle, pourquoi ne pas faire naître dans ce domaine l'équivalent d'un GIEC, « IPCC » en anglais, financé par la communauté internationale, indépendant des GAFAM et qui évaluerait de façon objective les informations d'ordre scientifique qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les enjeux liés au développement des technologies de l'intelligence artificielle ? Il est à mon sens nécessaire de créer une structure pérenne, qui permettrait à l'ensemble des acteurs internationaux de l'intelligence artificielle de compiler leurs recherches, dans une logique interdisciplinaire et de production de recommandations pour des sujets précisément définis. Ces préconisations seraient tenues à la disposition des États pour guider leurs politiques publiques. Cet organisme intergouvernemental, à la main des Nations-Unies, n'aurait pas vocation à faire de la recherche, mais pourrait contribuer à une harmonisation et un multilatéralisme autour des aspects scientifiques.
Étant députée de la troisième circonscription de l'Ain, je salue ici la présence des collègues du CERN, qui se situe sur ce territoire, ainsi que de la Nouvelle-Zélande, dont j'avais rencontré des représentants dans le cadre de l'élaboration d'accords commerciaux.
Je souhaiterais avoir votre avis sur cette proposition de création d'un équivalent du GIEC dans le domaine de l'intelligence artificielle.

– Comme vous l'avez rappelé, la France possède la particularité de disposer d'une organisation toujours très complexe. Ceci est le cas notamment en matière de défense et de sécurité, avec le conseil de défense et de sécurité nationale, qui fixe les objectifs, la cellule interministérielle de crise, souvent sollicitée pour proposer les décisions stratégiques, et des commissions d'orientation, qui apportent davantage de complexité encore. Clemenceau avait coutume de dire que « pour prendre une décision, il faut être un nombre impair, et trois c'est déjà trop ». Sans être aussi radical, se doter d'un organisme de coordination et de synthèse politique, militaire et scientifique serait bienvenu, notamment pour gérer certaines situations de crise d'urgence, lesquelles seront sans doute de plus en plus importantes, avec les changements climatiques que nous connaissons.
Ma question est assez simple : comment les différents conseils scientifiques aux autorités politiques étrangères ont-ils fait évoluer leurs modes de communication face à l'information télévisée en continu et au phénomène des réseaux sociaux dans les cas de crises intérieures ? La communication apparaît en effet comme l'un des axes problématiques majeurs.
– Je vais répondre aux questions en commençant par la dernière. Le Conseil international des sciences, basé à Paris, travaille avec les différentes institutions scientifiques pour assurer un processus de vérification des informations scientifiques. Ceci est nécessaire, mais pas aisé, car les fausses informations voyagent très bien sur internet.
Dans l'institution co-présidée par Rémi Quirion, nous passons également du temps à essayer de voir comment partager des informations de confiance. Comment comprendre, à l'échelle internationale, ce qui se passe dans le cyberespace ? Les choses vont si vite dans ce domaine. Il faut envisager la manière dont la société peut et doit y faire face. L'OCDE se saisit également de cette question actuellement. Il faut un organisme plus efficace, mais il est difficile de savoir comment procéder, entre le rôle des États-Unis et de la Chine, les entreprises privées, la ploutocratie aux États-Unis, etc. Pour vous donner un exemple, nous avons été confrontés à la tragédie de la mosquée de Christchurch. Les autorités ont essayé de créer un débat pour établir la vérité. Mais ceci s'est avéré difficile, car les gens ne voulaient pas que la désinformation cesse. Pour autant, il ne faut pas baisser les bras.
Je pense que le changement climatique constitue aujourd'hui la plus grande menace pour l'humanité. Les trois blocs, en particulier chinois et américain, rendent la situation difficile.
Pour ce qui est de l'accident industriel, il apparaît que les systèmes d'urgence mis en place au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande sont efficaces. Nous avons, en Nouvelle-Zélande, été confrontés à un cas similaire à celui que vous avez cité : en quelques secondes, nous savions exactement quelle section de l'agence compétente disposait de l'expertise pour nous aider à gérer la question de la toxicité chimique. Bien évidemment, chaque cas est différent. Mais il faut être préparé à faire face à tous les types d'urgence, en sachant à l'avance à quels experts il pourra être fait appel et quelles substances toxiques sont utilisées dans quelles usines. Il n'y a pas d'autre moyen. Je sais que le Scientific Advisory Group of Experts (SAGE) au Royaume-Uni intervient sur ces questions, tout comme nous. Il faut être préparé et savoir qui contacter. Ce n'est pas la communauté scientifique habituelle spécialisée qui intervient, mais des gens bien identifiés a priori.
– Le problème en cas d'incendie est de savoir comment obtenir l'information : il faut avoir une personne sur place, qui décide de donner l'alerte. Je crois que c'est la difficulté majeure à résoudre.
– En Nouvelle-Zélande, les pompiers sont appelés et alertent un centre d'urgence en cas d'accident industriel majeur.
– Au Québec, et plus globalement au Canada, nous sommes relativement en retard. Nous sommes actuellement en discussion avec l'Angleterre, en lien avec le bureau de Sir Patrick Vallance et avec la scientifique en chef du Canada, Mona Nemer. Des collaborations ont ainsi eu lieu récemment entre l'Angleterre et le Canada. Nous devons apprendre de la Nouvelle Zélande et de l'Angleterre dans ce domaine, même s'il reste encore des questions à résoudre.
Pour ce qui est de l'intelligence artificielle et d'un modèle de type GIEC, nous avons essayé, au Québec, de travailler avec la société civile. Ceci a conduit à l'élaboration de la « déclaration de Montréal », qui a été construite avec les citoyens et des experts dans le domaine de l'intelligence artificielle, des algorithmes, mais aussi des sciences humaines et sociales et de l'éthique. Il s'agissait donc d'une démarche très concertée. Depuis, nous avons créé un observatoire sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle, qui implique l'ensemble du réseau académique et a signé un accord de collaboration avec l'OCDE. Des discussions sont également en cours avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Il s'agit donc d'un pas dans la bonne direction. Le G7 a par ailleurs mené de nombreux travaux au Canada, en France et nous l'espérons maintenant aux États-Unis. Ceci reste toutefois une structure relativement lourde, qui présente en outre la particularité de n'impliquer que quelques zones du monde. Comment s'assurer de ne laisser personne en arrière ? Il s'agit là d'un beau défi pour les années à venir. Un modèle de type GIEC pourrait probablement présenter un intérêt, mais je pense personnellement qu'il faudrait lui confier davantage de pouvoir. En effet, le GIEC produit des rapports excellents, mais dont l'impact n'est pas évident. Je pense donc qu'il faudrait, dans le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle, aller un peu plus loin.
Notre but est d'expliquer davantage la science au public et de faire participer nos concitoyens à la science, afin qu'ils comprennent mieux la méthode scientifique. L'important n'est pas de se focaliser sur l'actualité qui fait la une des journaux ou se diffuse sur les réseaux sociaux, mais de permettre aux gens d'appréhender la démarche scientifique, afin de développer leur esprit critique et leur capacité à débusquer eux-mêmes les éventuelles fausses nouvelles. Il reste toutefois encore beaucoup de travail à accomplir dans ce domaine.
– La fonction de conseiller scientifique évolue vers des structures qui vont être amenées à proposer ou prendre des décisions qui impacteront les citoyens. Ceci suppose une notion d'acceptabilité, qui renvoie à des questions d'éducation, de formation et de compréhension, pour des prises de décisions informées, des choix éclairés. La recherche participative peut être l'une des façons d'organiser des aller-retour entre la science et la société, en prenant en compte des questions susceptibles d'être abordées par des faits et non par des opinions. Ceci peut commencer dès l'école primaire. À l'Académie des sciences, des personnes comme Georges Charpak ont par exemple été à l'origine d'initiatives comme « La main à la pâte », qui permettent aux enfants d'être sensibilisés à la démarche scientifique, non dans l'idée d'en faire nécessairement des scientifiques, mais plutôt des citoyens éclairés, des décideurs avertis. Il est important que chacun sache quelque chose du fait scientifique, quand bien même il ne le pratique pas. Ceci permet d'envisager de questionner ce qu'est le doute scientifique, qui se distingue du doute au sens commun, ce qui peut causer des confusions et des ambiguïtés.
– Comment réagir en cas d'urgence, d'accident industriel par exemple ? Je reprends à mon compte les propos de Sir Gluckman : il est essentiel d'être bien préparé. Nous menons ainsi des actions pour nous préparer à ce type d'accident. Avoir les scientifiques autour de la table, disposer d'une structure de conseil scientifique, est important, car les scientifiques posent des questions différentes de celles des politiques et peuvent se rendre compte de la nécessité de faire appel à divers types d'expertises, auxquels ils peuvent avoir rapidement accès. Il est également fondamental que les conseillers scientifiques aient l'habitude de faire le lien entre les experts et les décideurs politiques, afin de permettre une bonne compréhension mutuelle. Dans une situation où chacun est sous pression, les conseils venant des scientifiques, incluant des notions de risque et d'incertitude, doivent en effet être traduits en des termes compréhensibles, afin d'être utilisables par les politiques. Nous avons, dans le système britannique, travaillé précisément sur cet aspect.
La réflexion concernant les technologies émergentes et l'intelligence artificielle est une priorité au Royaume-Uni. L'utilisation éthique de l'IA, les implications pour la société, sont des questions importantes, à tel point que ceci a conduit à la création d'un centre des données et de l'éthique. Des ressources considérables y sont consacrées et nous essayons de voir comment relever ce défi à l'échelle internationale. Les propositions formulées par le Canada et la France sur le partenariat mondial sur l'intelligence artificielle nous intéressent. Comme vous l'avez souligné, tout le monde n'y participe pas ; il s'agit néanmoins d'un point de départ pour la réflexion collective.
Concernant la communication, je pense que cette question est centrale, avec le développement des réseaux sociaux et de l'information en continu. Les sciences sont à la pointe des défis auxquels nous devons faire face. Que ce soit en matière d'IA ou de changement climatique, il faut identifier ces défis, ainsi que les solutions envisageables, en temps réel. L'évolution rapide du contexte complique la donne et les relations entre scientifiques et décideurs politiques. Tout est fondé sur la confiance : il faut expliquer pourquoi les avis changent, pourquoi notre façon d'appréhender les preuves évolue. Créer cette confiance est un défi. Il faut pour ce faire disposer sur place de structures permettant un dialogue permanent entre les scientifiques et les politiques. Ceci améliore la compréhension que les politiques ont des méthodes scientifiques et vice versa.
– Il est très important de se doter d'un registre national des risques. Nous avons pour notre part repris le modèle en vigueur au Royaume-Uni. Cela a pris quatre années, entre les membres du gouvernement et la communauté scientifique, pour explorer tous les risques, à court, moyen et long termes, auxquels le gouvernement doit se préparer. Il ne s'agissait pas seulement de recenser les risques dans un registre, mais de définir un référent en cas de problème. Il s'agit d'un exercice de grande ampleur, qui a révélé un certain nombre de risques principaux, environnementaux ou dans d'autres domaines, auxquels la Nouvelle Zélande n'était pas du tout préparée. Ceci a conduit à de nombreuses modifications. Ce partenariat entre le mécanisme de conseil scientifique et les responsables du gouvernement, y compris des personnes responsables de la sûreté, visait à essayer de savoir à quoi il fallait se préparer. Il s'agit d'une bonne démonstration. Les scientifiques réfléchissent d'une façon, les politiques d'une autre. Associer les deux visions peut aboutir à quelque chose de positif. Je crois que l'Union européenne a adopté une résolution encourageant tous les États à adopter un tel système, mais je ne suis pas sûr que cela ait été mis en oeuvre.
– Je souhaiterais intervenir sur la proposition visant à créer pour l'intelligence artificielle un organisme équivalent au GIEC pour le climat. J'aime beaucoup cette idée d'un organisme transversal et multinational. On pourrait mettre ceci en place non seulement pour l'IA, mais aussi pour différents autres sujets. L'important est d'avoir un modèle financier. Il faut aussi disposer d'une structuration claire, avec un responsable, un directeur, et que l'instance soit totalement indépendante des politiques. La crédibilité de la structure est à ce prix. En effet, il ne s'agit pas vraiment ici de pouvoir, mais plutôt de crédibilité, qu'il faut établir pour mener à bien la mission. Malheureusement, ceci demande un certain temps, du courage politique et des financements.

– Si vous n'avez pas d'autres questions ou réponses à formuler, je vais maintenant donner la parole à M. Émilien Schultz, qui n'est pas inconnu au sein de l'Office parlementaire puisque nous avons déjà eu l'occasion de le rencontrer lorsqu'il a coordonné avec Michel Dubois, un numéro de la revue d'histoire de la recherche contemporaine du CNRS consacré à l'OPECST, paru très récemment, ce dont nous sommes reconnaissants. Certains membres de l'Office vous ont entendu en petit comité en octobre 2017, ce qui ne vous empêche aucunement d'intervenir aujourd'hui dans un cadre plus ouvert. M. Schultz, après une agrégation de physique, a présenté une thèse de sociologie des politiques scientifiques sur le financement de la recherche en France, en particulier sur la création de l'ANR. Dans ce contexte, il a rencontré l'ancien président de l'Office, Jean-Yves Le Déaut, ce qui l'a conduit à s'intéresser à notre Office, finalement encore peu connu des sociologues. Vous avez, M. Schultz, suivi quasi intégralement l'enquête de l'OPECST portant sur les nouvelles biotechnologies, dont les deux co-rapporteurs étaient Jean-Yves Le Déaut et Catherine Procaccia. Je crois savoir que vous menez actuellement des recherches sur les innovations thérapeutiques en cancérologie à l'institut Gustave Roussy et que vous continuez par ailleurs à vous intéresser à l'Office, en particulier pour les enjeux d'innovation en santé. M. Schultz, au vu de vos travaux et de cette séance, quel regard de sociologue portez-vous sur cette institution et plus généralement, si vous le souhaitez, sur le conseil scientifique auprès du politique ?
– Merci M. le vice-président et merci à toutes et à tous pour vos contributions, qui dépassent très largement le cadre de mon propos, mais vont contribuer à l'enrichir.
Je vais vous faire part de mon regard de sociologue, et en particulier de sociologue des sciences, sur l'OPECST et surtout sur ce que l'Office a été historiquement, avant la quinzième législature. Ma rencontre avec l'OPECST est finalement représentative de sa position intermédiaire entre les comités scientifiques et l'institution parlementaire, puisque c'est par le biais d'une réflexion sur le financement de la recherche que j'ai eu l'occasion de m'intéresser à son fonctionnement. J'ai été intrigué par le rôle d'intermédiaire de cette organisation et constaté que la sociologie ne s'était jusqu'alors intéressé ni à l'OPECST en particulier, ni plus généralement au conseil scientifique, avec lequel il n'est pas sans lien. Tout au plus cet Office était-il décrit dans son fonctionnement par trois caractéristiques : il était présenté comme une entité qui réalise de l'évaluation technologique, est intégrée au Parlement et dont le rôle est d'informer les parlementaires sur des sujets technologiques au sens large.
Comme l'a souligné Cédric Villani, j'ai coordonné récemment le numéro d'une revue d'histoire rassemblant les travaux de chercheurs et chercheuses qui ont travaillé ou travaillent actuellement sur l'OPECST en particulier. J'ai moi-même contribué à une observation participante sur l'un des rapports, afin de renseigner un aspect moins visible, concernant le travail très concret, au quotidien, de production d'un rapport, avec toutes les interactions que ceci suppose.
Nous nous sommes rendu compte que cette activité mettait à l'épreuve les catégories habituellement utilisées pour décrire ce genre d'organisation, tant sous un angle parlementaire qu'avec un vocable de l'évaluation technologique ou renvoyant au conseil scientifique, puisque l'OPECST est, historiquement, difficilement réductible à cette dimension.
Je vais tâcher de discuter les trois propositions simples suivantes, permettant de mettre en perspective ce qu'est l'OPECST, ce qu'il a été et la façon dont il évolue : l'Office de l'évaluation technologique, l'Office caractérisé par sa culture parlementaire et enfin l'Office au travers de sa mission d'information du Parlement.
Une tribune récente parue dans la revue Nature s'alertait de la disparition des entités d'évaluation technologique et de conseil scientifique. Dans ce cadre, l'OPECST était présenté, aux côtés de son alter ego britannique le POST (Parliamentary Office of Science and Technology), comme l'un des modèles représentatifs et historiques, bien que ces deux systèmes aient des fonctionnements très différents. Il était rattaché à la notion de technology assessment, vraiment fondatrice dans l'histoire de l'OPECST. La création de l'Office en 1983 s'est faite explicitement en référence à l'OTA (Office of Technology Assessment) des États-Unis, fondé en 1972, qui a initié ce mouvement d'évaluation technologique, lequel a ensuite essaimé dans de nombreux pays. Pourtant, il serait faux de chercher dans la transposition de ce modèle OTA au cas français l'explication du fonctionnement de l'OPECST ou simplement de l'existence de procédures génériques.
Ce terme de technology assessment, utilisé pour la première fois en 1964 et présenté dans l'un des premiers ouvrages français sur le sujet comme « un processus qui prétend évaluer par avance pour mieux les orienter les progrès de la technologie », est déjà très contextualisé. Les auteurs précisent en effet que cette évaluation technologique dépend d'une réalité complexe et spécifique, politique, sociale et culturelle. Le politologue Pierre Delvenne, qui s'intéresse à ces structures d'évaluation technologique, montre dans ses travaux la particularité du cas français, qui s'est progressivement stabilisé au fil de ses plus de trente ans d'existence. Il existe trois grands modèles : le modèle de la commission parlementaire, celui de l'office parlementaire et celui de l'institut indépendant. Or l'OPECST se caractérise par sa très forte intégration au sein du Parlement, de par sa méthode de travail qui implique directement des parlementaires dans la collecte de l'information et la rédaction des rapports, ceci sans beaucoup s'appuyer, tout du moins dans son modèle historique, sur une expertise scientifique intérieure. Notez toutefois que la situation a évolué de ce point de vue depuis 2017. Ce sont donc des parlementaires, a priori profanes, qui mènent une enquête et problématisent progressivement un sujet technologique, dans une perspective législative, à vocation non partisane. L'indépendance éditoriale et le consensus parlementaire sont alors posés comme des valeurs fondatrices. Les rapporteurs sont évidemment amenés à formuler des propositions proprement politiques, votées in fine par les membres de l'Office. L'export de ces propositions dans le cadre du débat parlementaire s'effectue sur la base soit du rapport, soit de l'engagement des parlementaires eux-mêmes dans leur travail quotidien de sénateurs ou députés.
Dans ce contexte, la notion d'évaluation technologique est insuffisante pour décrire l'activité de l'OPECST. Elle est d'autant plus insuffisante qu'il a d'autres rôles que celui de réaliser des rapports. Il intervient en effet directement dans l'évaluation de la loi et occupe aussi une fonction d'interface entre l'institution scientifique, les comités scientifiques et le Parlement. Ceci crée une proximité très forte avec les organismes de recherche, au point que l'Office peut jouer le rôle, à travers ses parlementaires, d'ambassadeur du Parlement dans les différents comités scientifiques ou à l'inverse de porte-parole de ces comités auprès du Parlement.
La deuxième affirmation que je souhaiterais discuter est celle de la culture parlementaire de l'OPECST. L'activité de l'Office est traversée de part en part par son organisation parlementaire, dans la mesure où ce sont des parlementaires qui font son activité quotidienne. L'importance du rapport d'information proprement parlementaire est d'ailleurs illustrative de cette situation. Pour autant, ne correspondant ni à une commission permanente, ni à une mission d'information, l'organisation et les missions de l'OPECST lui impriment une culture spécifique. Sa position bicamérale entre l'Assemblée nationale et le Sénat, son choix de restreindre la place du jeu partisan, la délimitation de ses objets d'intervention à des aspects techniques et son éloignement de la temporalité législative le conduisent dans les faits à un double écart de l'activité politique quotidienne. Le premier est une forme de spécialisation scientifique, tant par les sujets couverts que par le profil de ses membres les plus engagés, le second une neutralisation de la décision partisane, pour proposer un éclairage scientifique des questions abordées en amont du processus législatif.
Ceci trouve une traduction dans la sociologie de l'OPECST. Sur l'ensemble de la période, soit 35 ans d'existence, 79 députés et 80 sénateurs se sont succédé à l'Office, y restant en moyenne chacun six ans. Nous avons représenté sous forme de graphique la répartition de ces parlementaires dans le temps. On compte sur la période près de 80 % d'hommes. Le profil des parlementaires semble par ailleurs surtout se distinguer par une forte proportion d'ingénieurs, d'anciens universitaires ou de médecins. Ainsi, 36 % des sénateurs et 48 % des députés siégeant à l'Office ont exercé une profession en lien avec la technique ou la science, et seul un tiers n'ont au final exercé aucun métier en lien avec la production ou la transmission des savoirs. Tous les parlementaires n'ont pas la même activité au sein de l'Office. Cette disparité devient visible lorsque l'on met en relation les deux caractéristiques que sont l'ancienneté au Parlement et à l'Office, d'une part, et le nombre de rapports produits, d'autre part. Si les parlementaires siégeant à l'Office ont tendance à y passer un temps important de leur mandat, des profils très différents apparaissent et seuls 17 % des députés et 25 % des sénateurs ont passé plus de six ans à l'OPECST en produisant au moins un rapport. Ainsi, l'activité de l'Office repose sur un petit groupe de membres, dont la formation initiale dans les domaines de l'ingénierie, de la médecine ou de la recherche contribue à accréditer historiquement l'impression d'un pôle scientifique du Parlement. Tous les parlementaires, loin s'en faut, n'ont pas ce profil ; mais la tendance est et a été suffisamment importante pour installer une réputation d'expertise et mener au souci de neutraliser le débat partisan, pour favoriser, dans les faits, historiquement, une culture particulière.
Ceci me conduit à aborder la troisième affirmation : celle d'un rôle bien défini pour l'Office. La dualité entre son rôle d'évaluation et sa mission d'interface est redoublée par un changement historique de ses modes d'engagement. Sa mission initiale d'information du Parlement a bien évolué. Pour reprendre les mots d'un ancien président, « ce rôle d'éclairage a été largement dépassé et en ce sens l'Office a joué un rôle plus important que celui qui était voulu par le législateur initial, au cours de son existence ». Cette transformation de l'activité de l'Office est particulièrement visible dans la tendance longue dans l'évolution de certaines thématiques, avec en particulier une montée des sujets liés à la recherche scientifique à proprement parler, à l'organisation des politiques scientifiques, et dans l'augmentation considérable du nombre des auditions publiques, permettant de davantage médiatiser la réflexion et d'être en lien avec l'actualité scientifique et technologique du pays. Cette transformation progressive correspond à un rapprochement du temps de l'action.
Dans ce contexte, force est de constater que la quinzième législature a vu une transformation des pratiques au sein de l'OPECST et l'émergence d'une nouvelle philosophie de son action. Ceci s'est traduit notamment par l'introduction des notes scientifiques, qui correspondent à une forme d'autosaisine affirmée, et par une présence plus forte dans l'espace médiatique et les réseaux sociaux.
Je conclurai par quelques mots visant à faire le lien avec la question du conseil scientifique. L'OPECST constitue un point d'observation privilégié des transformations du rapport entre science et politique. Il a vécu la tension existant entre une dimension générique du travail législatif parlementaire et la spécialisation sur des périmètres revendiqués comme scientifiques ou technologiques. Ceci interroge à la fois la question des savoirs spécialisés, nécessaires pour outiller le débat public, et les conditions de leur usage, et le rapport à l'expertise ainsi que les procédures d'enquête et de synthèse mises en place, révélatrices de l'articulation qui peut exister entre les représentants politiques, les scientifiques et les acteurs de la société civile, lesquels ne sont pas forcément présents dans le modèle historique de l'OPECST. L'Office s'est longtemps identifié comme un acteur de l'évaluation technologique parlementaire, avec toute l'ambiguïté que cette notion peut recouvrir. Actuellement, le modèle du conseil scientifique, détenteur quasiment en propre d'une forme d'expertise, semble se poser comme une alternative, renforçant ce faisant le prolongement de l'institution et des comités scientifiques. Cette transformation témoigne du fait que l'OPECST est un acteur institutionnel important, non seulement pour comprendre la place de la science au Parlement, mais plus généralement le lien entre la production de connaissances scientifiques et son utilisation politique, sachant qu'un baromètre d'opinion publié récemment montre que les Français ont confiance dans les chercheurs, alors qu'ils éprouvent de la défiance vis-à-vis du monde politique. Ceci pose donc toute la question de la mise en relation entre ces deux pôles.

– Mes chers collègues, chers invités, il est temps de conclure cette matinée très riche en exemples, en recommandations et en explications.
Je retiens notamment de ces échanges l'idée que la notion de conseil scientifique ne recouvre pas nécessairement une dimension de conseil au sens où on l'entend communément. Ceci peut prendre la forme d'une présentation d'options, d'une explication, d'une traduction, d'une explicitation de certains concepts. Il peut aussi s'agir simplement de s'assurer que tel expert et tel membre du gouvernement se comprennent l'un l'autre et que leur dialogue n'achoppe pas sur des questions de terminologie ou de concept.
Nous avons aussi pu entendre que la façon dont l'organisation est conçue est un élément clé et que la prime est donnée, dans les expériences qui fonctionnent bien, aux structures comportant un petit noyau de personnes prenant la responsabilité du conseil, capables de réagir rapidement, dans un monde où il est nécessaire de disposer d'informations sur toutes sortes de sujets. Le travail préparatoire est très important, en particulier la mobilisation d'un réseau d'experts utiles en fonction des situations. En ce sens, les institutions de conseil apparaissent aussi comme des structures relais, qui permettent au monde politique de se frayer un chemin à travers l'océan des connaissances et des experts, jusqu'à contacter la personne idoine.
J'aimerais aussi insister sur la question du contact entre scientifiques et politiques. Qui en prend la responsabilité ? Dans certains exemples qui ont été cités, ce sont des scientifiques qui sont aux manettes du conseil, écrivent les rapports, apportent des avis. Dans d'autres comme l'OPECST, ce sont, même si le travail est préparé par des scientifiques, des parlementaires qui en prennent au final la responsabilité, avec une légitimité politique plus importante et certainement aussi l'avantage intrinsèque que le politique qui présente lui-même un sujet le maîtrise mieux que lorsqu'il se contente de consulter des rapports rédigés par des scientifiques. Évidemment, par rapport à la communauté scientifique et au suivi, le modèle dans lequel les scientifiques sont en responsabilité présente d'autres avantages. M. Klumpers a évoqué l'analogue européen de notre institution, dans lequel les rapports sont rédigés par des scientifiques et non par des politiques, même si à la fin ce sont les politiques qui prennent les décisions. Nous sommes dans tous les cas face à l'articulation d'une expertise scientifique et d'une décision politique : la question est de savoir sous quelle forme s'effectue le contact, à quel niveau précisément la décision est prise. Cette problématique n'est pas simple à résoudre, dans la mesure où ces deux communautés ne fonctionnent pas selon les mêmes codes ni avec les mêmes impératifs. L'exemple, fourni par Rémi Quirion, du jeune parlementaire fougueux qui s'est lancé dans une croisade en faveur de la vitamine C pour soigner des maladies graves, est très parlant : même s'il ne devrait en principe pas y avoir de contrôle de l'action politique par le monde scientifique, il existe néanmoins des cas criants dans lesquels on a besoin de remettre un peu de bon sens scientifique dans une discussion qui, sinon, pourrait dériver. Le plus inquiétant dans cet exemple n'est finalement pas tant le comportement du collègue député que celui de la société entière, qui s'enflamme et accorde autant d'importance au jugement d'un chanteur d'opéra qu'à celui du spécialiste en pharmacie. Ceci montre que nous avons encore un long chemin à parcourir pour trouver le bon équilibre entre l'indépendance et le mariage des voies rationnelle et irrationnelle, toutes deux légitimes dans le débat public, jusqu'à un certain point.
Mes chers collègues, je pense que les discussions riches que nous avons eues donneront lieu à la rédaction d'excellents actes, pour cette journée qui aura été l'occasion pour l'Office de mettre en avant sa volonté d'ouverture, aussi bien vers l'extérieur que vers nos collègues parlementaires à travers les commissions et rapports parlementaires, ainsi que le plaisir non dissimulé que nous éprouvons à accueillir les collègues étrangers et à leur présenter nos belles institutions respectives, avec leurs défauts et leurs avantages.
La réunion est close à 13 heures.
Membres présents ou excusés
Députés
Présents. - M. Didier Baichère, Mme Émilie Cariou, M. Claude de Ganay, M. Pierre Henriet, M. Cédric Villani, Mme Olga Givernet, M. Matthieu Orphelin, Mme Valérie Petit, Mme Claire Pitollat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe
Excusés. - M. Philippe Bolo, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Antoine Herth, M. Jean-Paul Lecoq
Sénateurs
Présents. - Mme Florence Lassarade, M. Gérard Longuet, Mme Angèle Préville
Excusés. - Mme Laure Darcos, M. Rachel Mazuir, Mme Catherine Procaccia