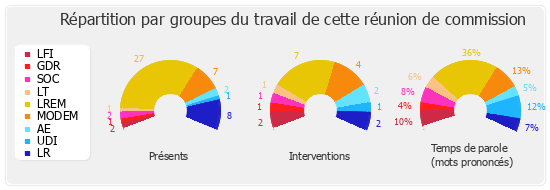Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la république
Réunion du lundi 21 décembre 2020 à 11h00
La réunion
COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D'EXAMINER LE PROJET DE LOI CONFORTANT LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE
Lundi 21 décembre 2020
La séance est ouverte à onze heures.
La commission spéciale procède à l'audition de M. Bernard Stirn, membre de l'Institut, ancien président de la section du contentieux du Conseil d'État.

Mes chers collègues, nous auditionnerons, dans le cadre de nos travaux, des personnalités diverses et variées. Je rappelle qu'auditionner ne signifie pas acquiescer, pour nous, membres de la commission, qui sommes d'ailleurs d'opinions diverses. De même, les personnes que nous entendrons ne seront pas là non plus pour adhérer à notre projet mais pour éclairer nos débats, soit du fait de leurs connaissances en la matière et des travaux qu'ils ont conduits dans un cadre professionnel, soit en tant que représentantes d'organisations concernées par son application. Sur ce sujet, sensible et passionné, recueillir des points de vue de nature différente enrichira notre réflexion et nous permettra de mener à bien notre travail législatif.
Nous recevons donc pour notre première audition M. Bernard Stirn, membre de l'Institut et de l'Académie des sciences morales et politiques, ancien président de la section du contentieux du Conseil d'État.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, c'est un grand honneur pour moi d'être auditionné par votre commission, d'autant que je suis le premier à ouvrir le cycle des auditions. J'espère pouvoir vous apporter des éléments d'information utiles. Atteint par la limite d'âge, j'ai quitté le Conseil d'État au mois d'août dernier et je n'ai donc pas participé à l'examen de ce projet de loi. Mais je pourrai vous faire part de mon expérience de président de la section du contentieux relative aux débats sur la laïcité que le Conseil d'État a été amené à trancher.
Je rappellerai d'abord quelques acquis de l'histoire, indispensables à la bonne compréhension du droit tel qu'il est aujourd'hui manié par les différentes juridictions et élaboré par le législateur. J'évoquerai ensuite les évolutions de la société qui ont conduit le Conseil d'État, comme l'ensemble des juges français et européens, à renouveler en partie leur approche, en dialogue avec le législateur puisque, au-delà de la jurisprudence, la loi a évolué, avant même le projet de loi que vous examinez.
Pour cette première audition, je rappellerai que notre droit repose sur un socle qui s'est progressivement constitué en trois temps principaux : l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, le Concordat de 1801 et la loi de 1905, qui restent les trois piliers de l'encadrement juridique de la laïcité.
Reprenons l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». En le relisant, on pourrait se dire : arrêtons-nous là, on ne saurait mieux ni plus fortement dire. Tout notre propos repose sur le socle de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme. Les membres de l'Assemblée constituante avaient déjà bien perçu la dialectique entre la liberté religieuse et l'ordre public établi par la loi.
Le Concordat de 1801 entre Bonaparte et le pape Pie VII commence à organiser les rapports entre l'Église catholique et l'État. Ce concordat conclu avec l'Église catholique sera rapidement étendu, par décision unilatérale du Gouvernement, aux deux autres religions alors présentes en France, le culte protestant et le culte israélite. Rappelons qu'il reste en vigueur dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Le Conseil constitutionnel l'a confirmé et un principe fondamental a même été reconnu par les lois de la République. Il y a donc plusieurs manières de décliner la laïcité dans la France d'aujourd'hui, en métropole et dans certaines collectivités d'outre-mer dont le régime est proche de celui du Concordat. Le Conseil constitutionnel a notamment confirmé le maintien en vigueur, en Guyane, de l'ordonnance de Charles X.
La troisième étape est la loi de 1905, dont je rappelle les deux premiers articles. Article 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes ». Article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Tout est dit.
J'ajouterai deux citations de vos prédécesseurs pour éclairer ces textes. Dans un discours prononcé en décembre 1789, quelques mois après l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme, le député Stanislas de Clermont-Tonnerre déclarait à l'Assemblée constituante : « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et accorder tout aux Juifs comme individus ». L'universalisme de la Déclaration des droits de l'homme est ici magnifiquement exprimé. Par ailleurs, dans son discours de présentation de la loi devant la Chambre en mars 1905, Aristide Briand a déclaré que, grâce à l'article 1er de la loi de séparation « placé en vedette de la réforme, le juge saura dans quel esprit tous les autres ont été conçus et adoptés » et que « toutes les fois que l'intérêt de l'ordre public ne pourra être légitimement invoqué, dans le silence des textes ou dans le doute sur leur exacte application, c'est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur ».
Cette phrase a eu rapidement un écho en matière de jurisprudence puisque, dans un arrêt Abbé Olivier, rendu en février 1909, le Conseil d'État a fait la première grande application de la loi de 1905. L'abbé Olivier avait contesté un arrêté du maire de Sens, qui avait cru pouvoir s'appuyer sur la loi de 1905 pour lui interdire d'accompagner, en costume ecclésiastique, un convoi funéraire du domicile du défunt à l'église. Le Conseil d'État a annulé cette décision du maire de Sens. Dans son arrêt, il fait remarquablement écho aux propos d'Aristide Briand, puisqu'il dit : « l'intention manifeste du législateur a été de respecter autant que possible les habitudes et les traditions locales et de n'y porter atteinte que dans la mesure strictement nécessaire au maintien de l'ordre ». Là encore, le socle juridique est parfaitement exprimé.
J'en viens aux évolutions actuelles. L'application de la loi de 1905 donna lieu à des tensions, comme le montre une jurisprudence assez riche, dont celle de l'arrêt Abbé Olivier et plusieurs autres, mais après la Première Guerre mondiale et le rétablissement par Édouard Herriot des relations entre la France et le Vatican, la situation fut totalement apaisée jusqu'à la fin des années 1980. De 1920 à 1989, pendant près de soixante-dix ans, on ne note pas de résurgences juridiques ou de débats contentieux sur l'application de la loi de 1905. Puis, ceux-ci sont réapparus.
Dans son étude de 2018, « Être un citoyen aujourd'hui », le Conseil d'État écrivait : « Après plusieurs décennies d'apaisement, les questions religieuses ont fait leur retour dans le débat public en raison des évolutions sociologiques et de l'apparition de nouveaux fondamentalismes. Les espaces publics, l'école, les services publics, mais aussi parfois les entreprises, sont parcourus de nouvelles tensions qui sont autant de remises en cause, involontaires ou délibérées, des règles de la laïcité ». Ces tensions se sont manifestées dans trois grands secteurs : le service public, les collectivités publiques et l'espace public.
Le service public est le lieu de départ des nouvelles tensions juridiques, marquées par l'avis du Conseil d'État du 27 novembre 1989 sur le foulard islamique. À l'époque, on se trouve dans une grande incertitude juridique. Aucun texte, aucune loi n'a abordé la question des signes religieux à l'école. Saisi pour avis par le Gouvernement, le Conseil d'État souligne qu'en l'absence de texte, la liberté religieuse des usagers du service public doit avoir ses limites et qu'ils ne doivent pas accomplir des « actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande ». Ils ne doivent pas non plus avoir un comportement de caractère « ostentatoire ou revendicatif ». C'est la première pierre de cette nouvelle construction. Des signes religieux, dès lors qu'ils ne sont pas ostentatoires et n'ont pas un caractère de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, peuvent donc être admis.
Quelques années plus tard, en 1992, David Kessler, et c'est une manière de rendre hommage à mon collègue décédé il y a quelques mois, commentant les conclusions d'un arrêt rendu par le Conseil d'État dans le cadre nouveau de l'avis de 1989, précise : « L'enseignement est laïque, non parce qu'il interdit l'expression des différentes fois, mais au contraire, parce qu'il les tolère toutes ».
Cela a été la première occasion d'un dialogue avec le législateur, puisqu'après l'avis de 1989, est intervenue la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux à l'école, qui interdit les signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. En restant sur la ligne de l'avis de 1989, on déplace légèrement le curseur, en passant de l'ostentatoire à l'ostensible. On observe une nuance, mais pas de changement de cap. La loi de 2004 a été jugée conforme à la Convention européenne des droits de l'homme par la Cour européenne des droits de l'homme. Elle s'applique dans un contexte très apaisé, sous forme d'un dialogue avec l'élève, et ne donne lieu qu'à très peu de mesures d'exclusion. La question du foulard à l'école a été réglée dans le cadre qui, en l'absence de loi, commence à être fixé en 1989, et est conforté par le législateur, en 2004.
La situation des agents du service public est différente. Ils ne doivent manifester aucune appartenance religieuse. Le Conseil d'État rappelle dans une décision de 2000 que : « Le principe de laïcité fait obstacle à ce que les agents publics disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses ». Cette règle est partagée par la Cour européenne des droits de l'homme.
Le cadre du service public est donc bien déterminé et n'est plus guère source de difficulté, ce qui, dans le projet de loi, permet d'examiner sans difficulté les dispositions prolongeant les règles relatives aux délégataires et concessionnaires de service public.
Le deuxième grand secteur est celui des collectivités publiques, qui a donné lieu à de nombreux débats.
Dans sa plus haute formation, soit l'assemblée du contentieux, le Conseil d'État a rendu, le 19 juillet 2011, quatre décisions de principe concernant les liens entre les collectivités territoriales et les cultes, sur fond de renaissance des tensions. Pour éclairer le tableau, le Conseil d'État a choisi de juger le même jour deux affaires intéressant la religion catholique et deux affaires intéressant le culte musulman. Des collectivités territoriales avaient restauré un orgue dans une église de campagne, à Trélazé, aménagé un ascenseur donnant accès à la basilique de Fourvière, à Lyon, ouvert les abattoirs municipaux pour l'abattage rituel, au Mans, et mis un terrain à la disposition de la communauté musulmane pour construire une mosquée, à Montreuil. Dans ces quatre affaires, le Conseil d'État a jugé légale l'intervention des collectivités locales, sans méconnaissance de la loi de 1905, dès lors qu'elles avaient agi dans l'intérêt public local. L'intérêt public local justifiait en effet la restauration de l'orgue aussi bien que l'ouverture de l'abattoir municipal, sans manifestation de favoritisme à l'égard d'un culte.
Après ces arrêts de principe, sont apparus quantité d'événements révélateurs de la sensibilité de la question. On n'avait plus vu cela depuis les années précédant la Première guerre mondiale. Je rappellerai les principaux épisodes que certains d'entre vous ont peut-être vécus dans leur circonscription.
S'agissant de la présence de crèches de Noël dans les bâtiments publics et dans l'espace public, sujet difficile parce que non traité non plus par les textes, le Conseil d'État s'est prononcé, le 9 novembre 2016, sur les affaires Commune de Melun et Département de la Vendée, dans lesquelles deux cours administratives d'appel avaient statué en sens contraire. Le Conseil d'État a retenu la double signification de la crèche, l'une, religieuse, de l'iconographie chrétienne, et une autre, détachée en partie de la religion. Il en a déduit, ce qui était une création prétorienne, une distinction entre les bâtiments publics et l'espace public. En principe, on ne peut pas installer de crèche dans les bâtiments publics, sièges de services publics, mais il peut y avoir des exceptions, notamment lorsque les traditions locales l'ont instauré. Dans l'espace public, des crèches peuvent être aménagées par les collectivités publiques, à condition qu'il n'y ait pas de caractère revendicatif ou de volonté de favoriser la religion catholique.
Après les crèches, la statue du pape Jean Paul II et sa croix, à Ploërmel, ont défrayé la chronique. Cette commune bretonne avait installé dans l'espace public la statue du pape, ce qui n'aurait pas posé de problème si elle n'avait été surmontée d'une grande croix, ce qui entrait dans le champ des dispositions de la loi de 1905.
En 2020, il y eut l'affaire plus anecdotique du blason de la commune de Moëslains, en Haute-Marne, qui comportait deux crosses épiscopales, en référence à deux évêques qui avaient joué un rôle important dans son histoire. Là encore, le Conseil d'État s'est fondé sur la tradition historique pour juger que, dans ce contexte, le blason communal n'était pas contraire aux règles de laïcité.
Tout récemment, statuant, le 11 décembre, sur une requête de la commune de Chalon-sur-Saône, le Conseil d'État a jugé que le principe de laïcité n'entraîne pour les communes ni obligation ni interdiction de proposer aux élèves des menus de substitution leur permettant de s'alimenter dans le respect de leurs convictions religieuses.
On le voit bien, les débats subsistent pour les collectivités publiques. Mais la question de l'espace public est sans doute la plus délicate, celle où les solutions sont encore le plus en construction. Du service public aux collectivités publiques puis à l'espace public, les difficultés vont croissant. Pour le service public, le cadre est assez bien défini, pour les collectivités publiques, la jurisprudence est relativement nourrie et le cadre relativement apaisé, mais pour l'espace public, il reste des interrogations.
Il y eut d'abord la question de la dissimulation du visage, pour laquelle le législateur a pris la main par la loi du 11 octobre 2010, dont l'article 1er dispose : « Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. ». Cette loi très discutée a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et, ce qui était un peu plus incertain, à la Convention européenne des droits de l'homme par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a d'ailleurs pris une position identique pour une loi belge similaire.
Il y eut, à l'été 2016, l'épisode du burkini, et les décisions rendues en référé par le Conseil d'État le 26 août 2016. C'était d'ailleurs la première fois que le Conseil d'État faisait usage de la possibilité que, fort opportunément, la loi lui avait donnée, en avril 2016, de siéger en référé non pas en juge unique mais en formation de trois juges. L'affaire du burkini qui avait enflammé le pays a trouvé sa conclusion dans les décisions du Conseil d'État, s'inscrivant dans la droite ligne de l'arrêt Abbé Olivier de 1909. Depuis 2016, nous n'avons assisté à aucun rebondissement en la matière.
Se pose aujourd'hui la question des signes religieux sur les lieux de travail. Nous commençons à observer des débuts d'encadrement par des arrêts prudents, notamment dans l'espace européen, de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans la loi du 8 août 2016, le législateur a également indiqué que le règlement intérieur de l'entreprise peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées et proportionnées. C'est bien sur le caractère justifié et proportionné qu'insiste la jurisprudence européenne. Ce sont des sujets délicats et moins juridiquement bordés que les précédentes rubriques.
J'ai ainsi rappelé ce dont j'ai été le témoin, ces dernières années, au Conseil d'État, en étant attentif à l'attitude des cours européennes et à l'application des lois les plus récentes. Ce contexte me semble important pour alimenter votre réflexion sur le projet de loi dont vous abordez l'examen.

À vous entendre, monsieur Stirn, la question centrale posée à notre commission et à la société est l'application du principe de laïcité dans un contexte marqué par l'émergence non seulement de nouveaux cultes mais plus encore, et c'est la cible principale du projet de loi, d'idéologies que le Président de la République a qualifiées de séparatistes, au premier rang desquelles l'islamisme. Comment lutter contre ces dérives tout en garantissant le pluralisme et une diversité religieuse croissante, c'est-à-dire sans remettre en cause les principes républicains, que ce projet de loi, comme l'indique son titre même, vise à renforcer ?
Après la présentation du projet de loi en conseil des ministres, le 9 décembre dernier, certains ont estimé que les dispositions du projet visant les associations cultuelles modifieraient profondément les relations entre l'État et les religions. Je pense notamment à l'obligation pour chaque association de déclarer préalablement son caractère cultuel et aux dispositions prévoyant un droit d'opposition de l'autorité administrative si leur objet, qui se doit d'être exclusivement cultuel, ne l'était pas. Que pensez-vous de cette interprétation ?
Tout doit-il faire l'objet d'un traitement exhaustif par la loi et par le règlement ? En d'autres termes, tout doit-il être régi par des normes ? Je pense ici aux points les plus débattus dans la classe politique, mais aussi dans notre société, tels que les repas différenciés, au sujet desquels vous avez rappelé un récent arrêt du Conseil d'État, ou l'accompagnement des sorties scolaires.
Enfin, que répondez-vous en termes de droit constitutionnel, de libertés publiques à celles et ceux qui souhaiteraient voir inscrit dans le corps du projet de loi le mot « islamisme » qui, je le rappelle, figure dans son exposé des motifs ?

En tant que rapporteure du chapitre V relatif à l'éducation et au sport, je poserai deux questions sur la liberté d'enseignement.
La liberté d'enseignement, en vigueur depuis 1882, offre aux parents le choix entre soit inscrire leurs enfants dans une école publique, choix souvent contraint par le périmètre scolaire, soit les inscrire dans une école privée, sous contrat ou hors contrat, choix soumis à l'acceptation de l'enfant par la direction de l'école, soit l'instruction à domicile, relevant d'une déclaration et soumise au contrôle de la mairie ou de l'Éducation nationale. Le chapitre V du projet de loi prévoit une modification de ces modalités. Selon vous, la liberté d'enseignement serait-elle menacée par le passage du mode déclaratif à un mode d'autorisation ? Qu'en est-il dans les autres pays européens, notamment au regard des exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ?
L'article 21, traitant de l'instruction en famille, prévoit quatre motifs d'autorisation, dont « l'existence d'une situation particulière propre à l'enfant, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant ». Quels contentieux pourraient résulter de cette rédaction et comment les éviter ?

En tant que rapporteure de la partie relative à la haine en ligne, je souhaite savoir si vous considérez l'espace numérique comme un espace public comme un autre. Doit-on légiférer spécifiquement ou doit-on s'assurer pleinement que les dispositions applicables dans l'espace physique et publique le sont également dans l'espace numérique ?
L'article 18 crée, à la suite de l'abominable assassinat de Samuel Paty, un délit de mise en danger par la diffusion d'informations relatives à la vie privée. Le Conseil d'État estime, dans son avis, nécessaire la création de ce nouveau délit pour combler des « trous dans la raquette » de notre droit. En revanche, est évoqué un frottement potentiel avec l'article 23 de la loi de 1881, applicable en cas de provocation à la haine qui a été suivie d'effet, et l'article 24 de la loi de 1881, applicable lorsque cette provocation n'a pas été suivie d'effet. Ces dispositions du droit pénal ne risquent-elles pas de créer un risque de contentieux du fait d'un doublon avec les mesures d'une loi spéciale ?
L'article 20 crée des procédures rapides de comparution immédiate. Le Conseil précise qu'elles ne seront possibles qu'en cas de flagrance. En matière numérique, n'est-on pas toujours en présence de flagrance dès lors que le contenu est toujours en ligne ?
Enfin, il est regrettable que le dispositif proposé ne soit pas applicable aux personnes détenant des blogs, comme cela ressort de l'avis du Conseil d'État. Cela peut créer de l'incompréhension et de l'émoi, comme c'est le cas au regard de la situation d'impunité multiple d'Alain Soral, qui n'a rien d'un journaliste mais se retranche derrière les règles de protection du droit de la presse. Comment éviter que de tels pourvoyeurs de haine échappent aux protections du droit de la presse et puissent passer en comparution immédiate ?

Dans sa version initiale, l'exposé des motifs du projet de loi ne faisait aucune référence au contexte. Le groupe Les Républicains craint qu'à ne pas vouloir nommer ce que l'on veut combattre, le texte risque d'être très général et très large dans ses effets, d'autant qu'il touche à des libertés fondamentales, consacrées par la Constitution – la liberté de culte, la liberté d'association et la liberté d'enseignement. Ainsi, pour l'instruction en famille, on passerait d'un régime de déclaration assorti de contrôles, d'ailleurs souvent insuffisants, à un régime d'interdiction assorti de dérogations, ce qui change considérablement le principe constitutionnel de liberté d'enseignement. Comment appréciez-vous le risque de contentieux et de censure de certaines mesures, à droit constitutionnel et conventionnel constant ?
Votre carrière est marquée par la constante recherche d'équilibre entre le respect des libertés individuelles et les objectifs d'intérêt général. De ce point de vue, quelle est votre appréciation sur ce texte ?

Merci, monsieur le président Stirn, pour votre exposé très clair et que j'apprécie d'autant plus que je serai rapporteure sur le chapitre Ier portant sur la neutralité du service public.
Nous, Français, avons le défaut de donner à notre histoire particulière une dimension universelle. Ainsi notre loi de 1905 sur la laïcité est-elle plus contingente qu'il n'y paraît. Elle a formalisé un compromis passé non pas avec les Églises mais avec l'Église catholique, après plus d'un siècle d'affrontement marqué par le triomphe de la jeune République, les premiers signes de déchristianisation de la société française, qui sera massive au XXe siècle, et l'acceptation tacite de ce rapport de force inégal par l'Église. Mais l'islam n'est pas le christianisme, notamment dans la relation entre la religion et l'État. Selon un sondage réalisé par l'IFOP en septembre 2016 pour l'institut Montaigne, 29 % des membres de la communauté musulmane en France considéraient que la loi islamique est plus importante que la loi de la République. Selon un sondage plus récent de l'IFOP pour la fondation Jean-Jaurès et Charlie Hebdo, en septembre 2020, les convictions religieuses passent avant les valeurs de la République, pour 17 % de l'ensemble des Français, musulmans inclus, 40 % de l'ensemble des musulmans de France et 74 % des musulmans âgés de 18 à 24 ans. Quelles réflexions vous inspirent ces statistiques ? Pensez-vous que l'islam entre dans les catégories de la loi de 1905 ?

Merci pour votre exposé et d'avoir montré à quel point la laïcité est d'abord un principe de liberté qui doit permettre à chacun d'exercer, ou non, sa foi religieuse. Dans le discours des Mureaux, à l'origine notamment du projet de loi, le Président de la République a souligné combien certains quartiers étaient en rupture avec les valeurs de la République et l'esprit républicain. Dans certains d'entre eux, les services publics ont été progressivement remplacés par un tissu associatif sur lequel on a eu un regard assez peu vigilant et qui a mélangé la satisfaction de besoins réels que les services publics traditionnels n'assuraient plus et une propagande religieuse ou communautariste. Au regard de la nécessaire neutralité du service public, quelle exigence doit-on avoir à l'égard d'un tissu associatif qui, certes, assume des services communs mais dans un esprit bien différent de celui de la République ?

Comme vous l'avez précisé, tout est dit dans les textes fondateurs, admirables et longuement pensés. Pourtant, si nous partageons tous le même objectif de lutte contre l'extrémisme, la funeste idéologie islamiste radicale, nous assistons à une avalanche de textes sécuritaires, d'ailleurs critiqués à l'étranger, comme celui sur la sécurité globale. Fort heureusement, car il interroge nos libertés et principes républicains, le présent projet de loi a été profondément modifié, et même bonifié, après l'avis rendu par le Conseil d'État. Notre groupe redoute précisément la remise en cause de nos libertés sans que la question de l'extrémisme radical soit traitée.
Il est fait état d'un contrat d'engagement républicain pour toutes les associations, qu'elles relèvent de la loi de 1901 ou de 1905. Un contrat signifie un accord entre deux parties, en l'occurrence, les associations et l'État. Mais en renforçant son autorité de contrôle, l'État va contrevenir aux principes fondamentaux de la laïcité. Cela peut être assimilé à une forme de mise sous surveillance qui tourne le dos à l'approche jurisprudentielle et prudente qui fut la vôtre en tant que président de la section du contentieux du Conseil d'État.
De fait, toute association doit respecter les principes républicains, mais cela peut-il se faire dans une approche préalable, par le biais d'un contrat dont je ne comprends pas les termes ? S'agira-t-il d'un serment pour les associations – vous comprendrez mes hésitations ? Ne convient-il pas plutôt de réinterroger la capacité de la République à faire respecter ses principes fondateurs ?

Si la République ne reconnaît aucun culte, elle protège notre liberté de croire ou de ne pas croire, notre liberté de conscience. L'article 44 du projet de loi crée une mesure de fermeture administrative des lieux de culte. Les dispositions sont-elles bien formulées ? Cette mesure est reprise des dispositions introduites à titre temporaire par la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT), issue elle-même de la loi d'avril 1955 sur l'état d'urgence.
Deuxième point, en tant que grand connaisseur de l'État, comment voyez-vous l'organisation du culte musulman ?
Enfin, quel est votre point de vue sur ce texte, qui est soumis à des critiques contradictoires ? Est-il trop bavard ou oublie-t-il des dispositions importantes ?

Depuis Philippe Auguste, l'État français s'est toujours donné le droit d'organiser ses relations avec les religions, voire d'organiser les religions, comme dans le cas du Consistoire. Une des difficultés de la religion musulmane, visée par le texte, même s'il ne peut le dire pour des raisons juridiques et politiques, est l'absence d'interlocuteur stable. On a essayé de le faire, sans grand succès, au travers du Conseil français du culte musulman (CFCM). Une autre difficulté vient des financements et des influences provenant de l'étranger.
Je m'interroge tout d'abord sur le souhait du Gouvernement s'agissant de l'instruction par les familles : après l'avoir interdite, le texte la soumet à autorisation. Or dans notre droit, la liberté est le principe. Elle n'exclut pas le contrôle, mais seul l'abus de liberté conduit à l'interdiction. En l'occurrence, le texte prévoit l'inverse : en présumant l'abus, on soumet à autorisation – je ne vois d'ailleurs pas très bien sur quels critères celle-ci peut être donnée. Il me semblerait plus logique et plus conforme à nos traditions républicaines d'ériger la liberté en principe et d'assurer un contrôle effectif, ce qui nécessite des moyens.
Existe-t-il une difficulté entre la liberté constitutionnelle d'administration des collectivités locales et l'intervention de l'État dans ce qu'il considérerait comme un contrôle insuffisant des religions ou une immixtion inadmissible de la part d'une collectivité dans telle ou telle religion ? Deux libertés fondamentales ne risquent-elles pas de s'entrechoquer ? Au niveau constitutionnel, cela ne pourrait-il pas faire l'objet de questions prioritaires de constitutionnalité ?
Dans les entreprises, l'autorisation existe, sauf si le règlement intérieur prévoit l'interdiction du port de signes religieux. Ne serait-il pas plus simple, comme dans l'espace public, de prévoir une interdiction, sauf s'il existe une bonne raison d'autoriser le port de signes religieux ?
Le texte prévoit l'interdiction de la polygamie, mais comment la caractériser ? Cela nécessiterait d'apporter la preuve d'une vie multifamiliale, ce qui me semble difficile.
Quant à la haine en ligne, elle est encouragée par l'anonymat. Si l'on a tendance à se modérer dans l'espace public, l'espace virtuel est un défouloir de la haine et de la bêtise. Est-il légalement et constitutionnellement possible d'interdire l'anonymat ? On pourrait s'exprimer sous un pseudonyme mais pouvoir être identifié, car on s'autorise dans l'anonymat ce qu'on ne se permettrait pas en étant identifié.

Il est prévu un contrat d'engagement républicain avec les associations. Quel en serait le contenu ? Le texte est abscons sur ce point.
Des inspecteurs des impôts devraient s'assurer que les dons faisant l'objet d'un avantage fiscal soient cohérents avec l'objet de l'association. Cela relève-t-il de la compétence d'inspecteurs des impôts ?
À l'article 18, le nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui par la diffusion d'informations concernant des agents publics chargés de la police, prévoit l'intention particulière de l'auteur des faits de porter atteinte à l'intégrité de ces agents. Comment apporter la preuve de l'intention particulière de l'auteur des faits ?
Le passage d'une obligation d'instruction à une obligation de scolarisation n'est-il pas une rupture historique des traditions de notre République ? Que signifie juridiquement « l'existence d'une situation particulière propre à l'enfant » ? En revanche, les trois autres conditions requises en la matière sont à peu près claires.
Concernant l'article 30, estimez-vous possible de distinguer entre les associations cultuelles et les associations culturelles, notamment les associations mixtes qui devront avoir des comptes séparés ? En tant que juriste, cela vous paraît-il opérationnel ?
L'article 35 prévoit la possibilité pour l'autorité administrative de s'opposer à des dons venant de l'étranger. Peut-on accorder un tel pouvoir à une autorité administrative ?

Ce projet de loi prétend courir plusieurs lièvres à la fois. Il ne le dit pas mais il suffisait d'écouter plusieurs de mes collègues pour comprendre qu'il s'en prend en fait à l'islamisme radical, au risque de provoquer des discriminations et, pour reprendre l'expression du président Stirn, des tensions accrues dans notre pays, notamment à l'encontre de nos concitoyens de confession musulmane. Le président Lagarde a d'ailleurs dit que le projet de loi visait la religion musulmane et une de nos collègues se demandait, sondage à l'appui, si l'islam était compatible avec la République. On est sur un chemin de crête que le texte parcourt du mauvais côté.
Le Conseil d'État a estimé que l'étude d'impact devait être complétée par le nombre de dissolutions prononcées et sur les contentieux. Pourquoi donner plus de pouvoir à l'autorité administrative plutôt que les moyens à la justice de faire son travail ? Rendre responsables des groupes entiers de l'agissement d'individus, n'est-ce pas une atteinte à la liberté associative, alors que la convention de Genève de 1949 souligne le caractère constitutionnel de l'individualisation des peines et des délits ? En rendant responsables des associations de commentaires sur leur compte Facebook et non pas un de leurs membres, on prend un risque liberticide.

Le fait que les textes fondateurs de notre République disent déjà pratiquement tout doit nous inciter à la modestie. Cela éclaire l'aspect trop communicationnel du projet de loi.
J'aurais aimé vous entendre sur les mérites du statut de la fonction publique, qui fait l'objet du chapitre Ier. Ce statut garantit la neutralité, et il est solide. Le rapport d'Éric Diard a conforté cet aspect en pointant plutôt les failles des délégations de service public. Le confirmez-vous de par votre expérience ? Cela pourrait ouvrir un débat intéressant, non sur la réduction du périmètre du statut de la fonction public mais sur son élargissement ?
Par définition, un contrat engage les parties. Considérez-vous que l'État vérifie suffisamment ceux des écoles sous contrat du point de vue de l'intérêt général ?
Mesdames et messieurs les députés, je grouperai vos nombreuses interrogations sous trois grandes rubriques : la place et le rôle de la loi, les particularités de la religion musulmane – comment traiter une religion présentant des caractéristiques propres ? – et enfin, le respect des normes supérieures par la loi, c'est-à-dire les questions de conventionalité et de constitutionnalité. Bien sûr, ce sont les leçons de mon expérience, plus que mon sentiment de citoyen, qui pourront vous éclairer.
Plus optimiste que certains d'entre vous, je crois, quant à moi, qu'il y a une place pour la loi, et qu'elle peut être un facteur d'apaisement et non d'accroissement des tensions. Mais une loi ne peut pas tout régler, c'est la première leçon de l'expérience de tout juge. Quelle que soit sa qualité, il existe toujours des cas particuliers que le législateur n'a pas pu prévoir et il n'a pas vocation à le faire. Il faut laisser place à une certaine souplesse et à la jurisprudence. Portalis le disait déjà dans le Discours préliminaire sur le projet de code civil, la loi ne doit pas viser l'exhaustivité – ce ne serait pas sain. Il est bon de laisser la place au débat devant les différentes juridictions. Mais il y a tout de même une place pour la loi, parce qu'il est important que le législateur exprime, au nom du pays, certaines valeurs. Dans les années récentes, les interventions de la loi ont d'ailleurs été bénéfiques. Ainsi, la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école a apaisé considérablement le débat. Après mûre réflexion et la prise en compte de ce qu'avait dit le Conseil d'État en 1989, la loi a redéfini un cadre et contribué à l'apaisement. De même, s'agissant de la dissimulation du visage dans l'espace public, le débat est devenu moins vif qu'en 2010.
Je suis donc convaincu qu'il y a une place pour la loi. Bien sûr, elle doit être préparée, mûrement réfléchie – vos travaux permettent de l'assurer. Il me semble que le droit est un facteur d'apaisement des tensions de société. Au nom de la souveraineté nationale, le législateur doit orienter les boussoles. Je ne vois pas de difficulté, au contraire, à ce que la loi joue pleinement son rôle, sans aller jusqu'à un niveau de détail qui ne relève pas du législateur et qui serait vain au regard du grand nombre de cas particuliers.
S'agissant des pratiques extrêmes de la religion musulmane qui peuvent rendre difficile son insertion dans les principes républicains, il ne faut pas non plus exagérer les difficultés. En effet, ce n'est pas la religion musulmane qui pose problème, mais l'extrémisme islamique. La plupart des musulmans vivant en France souhaitent vivre dans le cadre de la République et font tout pour cela. Seul est visé l'islamisme radical en rupture avec les principes républicains, et non la religion musulmane en tant que telle.
Cela étant, même dans ses aspects pacifiques et les plus intégrateurs, la religion musulmane a plus de difficulté à dialoguer avec l'autorité publique que les autres cultes. Son problème de représentation n'est cependant pas insoluble. Les leçons de l'histoire sont, à cet égard, encourageantes. Le Concordat en 1801 avec le pape ou la loi de 1905 visait la religion catholique et une intransigeance de sa pratique. Mais Bonaparte a su étendre les principes de ce concordat aux cultes protestant et israélite. Je ne suis pas certain qu'en 1801, il était facile d'avoir un interlocuteur unique, représentatif du culte israélite Le Gouvernement du Consulat leur a mis le marché en main en leur expliquant que les croyants auraient un régime inspiré du concordat, avec les avantages qui en découlent, s'ils avaient une représentation avec laquelle le Gouvernement pourrait dialoguer. En relisant les débats parlementaires, on s'aperçoit que la force d'Aristide Briand et de Jean Jaurès a été de savoir s'adresser à la majorité des catholiques qui souhaitaient pratiquer leur religion dans le cadre nouveau de la République. C'est ce que la loi de 1905 a su faire.
Je ne crois pas qu'il faille nommer l'islam dans la loi, au risque d'introduire une rupture. En effet, aucune des lois précédentes n'a nommé de religion. Les particularités de la religion catholique étaient fortement présentes à l'esprit mais elle n'a pas été nommée – pas plus qu'une autre. L'islam peut figurer dans l'exposé des motifs qui explicite les raisons pour lesquelles le Gouvernement souhaite une intervention du Parlement, mais pas dans le corps de la loi. Cela me paraît d'une sage prudence dans la mesure où, à ma connaissance, jamais le législateur ne l'a fait pour aucune religion.
La constitutionnalité et la conventionalité sont des questions difficiles. Dans son avis, le Conseil d'État montre qu'il a eu des interrogations d'ordre constitutionnel ou conventionnel. Mais le Gouvernement a suivi ses recommandations pour y répondre et le présent projet de loi tient compte des observations formulées, ce qui est plutôt rassurant.
La liberté d'association, notamment cultuelle, et la liberté de l'enseignement sont au cœur des préoccupations constitutionnelles. C'est d'ailleurs sur ces deux points que le Gouvernement, après avis du Conseil d'État, a le plus modifié le projet de loi initial. Il revient à l'Assemblée nationale de trouver le juste équilibre. Cela ne vous surprendra pas, j'ai le sentiment que les ajustements mettant en œuvre les recommandations du Conseil d'État apaisent les inquiétudes constitutionnelles, mais il y a place pour le débat.
Il est heureux que le Parlement reprenne la main sur le régime juridique des associations cultuelles. Il est circonstanciel et lié au refus initial de l'Église catholique du cadre de la loi de 1905 et au compromis trouvé en 1907. Le système fonctionne bien, depuis 1905, pour le culte israélite et les cultes protestants, depuis 1907 pour le culte catholique, mais il est inopérant pour le culte musulman. S'il y a un besoin de loi, c'est bien sur ce sujet ! Le système des associations mixtes, qui font du cultuel et autre chose, imaginé au tout début du XXe siècle dans le contexte de tensions entre l'Église catholique et la jeune République, a ouvert la voie à des abus de certaines associations « musulmanes » et doit être corrigé. C'est ce qu'essaie de faire le projet de loi, de manière aussi fine et équilibrée que possible, sans mettre en cause la liberté cultuelle mais en évitant la brèche ouverte par le régime purement historique des associations mixtes dans laquelle des pratiques critiquables s'étaient engouffrées. Après avoir été remaniés par le Gouvernement après avis du Conseil d'État, ces articles importants et délicats présentent un certain équilibre mais ils doivent être affinés.
Sur l'enseignement, autre sujet délicat, le Conseil d'État a émis un très long avis. Je reprendrai le point 60 : « Le Conseil d'État constate que, sur cette question de l'instruction des enfants au sein de la famille, le droit et la pratique des États européens diffèrent, l'instruction à domicile étant, par exemple, autorisée au Royaume-Uni, en Irlande, en Autriche, en Belgique, en Italie, mais interdite ou très strictement encadrée en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grèce, en Suède et en Espagne ». Suit une analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui fait une large place à la marge nationale d'appréciation. Je retiens qu'un large espace d'appréciation est ouvert au législateur. À défaut de consensus européen, il n'y a pas de contrainte européenne forte, mais le principe constitutionnel de liberté de l'enseignement doit être combiné avec le principe constitutionnel de respect de la laïcité. Le Gouvernement a sensiblement modifié le projet de loi après les débats devant le Conseil d'État. Des observations ont été faites également sur l'intérêt supérieur de l'enfant, boussole conventionnelle qui procède de la convention internationale des droits de l'enfant des Nations unies et principe constitutionnel. En effet, le Conseil constitutionnel a jugé que l'intérêt supérieur de l'enfant, reconnu par la convention de New York, était aussi un principe de valeur constitutionnelle. Le texte, fortement amendé après examen par le Conseil d'État, est-il totalement équilibré ? Je ne m'avancerai pas personnellement. En tout cas, il a été fortement rééquilibré. Je ne doute pas que le sujet soit très important pour votre commission, l'Assemblée nationale et le Parlement tout entier.
La troisième rubrique concerne internet, la haine en ligne, les moyens d'y remédier, l'anonymat, la protection des agents publics. Sur tous ces points, les débats sont gigantesques. J'étais, non plus à la section du contentieux, mais à la section de l'intérieur lorsque nous avons eu des débats intéressants avec Mme Avia au sujet de sa proposition de loi, avant qu'ils se poursuivent devant le Parlement, puis donnent lieu à l'intervention du Conseil constitutionnel. En la matière, il y a un besoin de loi. Il faut que le législateur intervienne. Il y a un espace pour la loi, dont le Conseil constitutionnel a précisé les contours, peut-être avec une certaine sévérité, mais sans l'avoir réduit à néant. Le président Fabius s'est d'ailleurs exprimé à plusieurs reprises sur ce point après la décision du Conseil constitutionnel. Il est heureux que le Parlement reprenne la main. Ce n'est pas facile, nous l'avons constaté lorsque le Conseil d'État discutait avec Mme Avia, puis avec la décision du Conseil constitutionnel. Nous le constatons plus encore dans le cadre européen car, pour être effectif, le droit doit être européen. La Commission européenne – et c'est très positif – prépare des textes qui pourront, enfin, imposer des contraintes effectives aux grands opérateurs de réseau internet. L'échelle européenne est la bonne, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas place pour le législateur national, notamment pour la protection des agents publics et de tous ceux qui sont investis d'une forme d'autorité publique.

L'article 9 prévoit la signature par les associations d'un contrat républicain. Lorsque j'étais maire de Sarcelles, une association proche d'une communauté, qui n'était pas musulmane mais dont la religion interdisait de mélanger les hommes et les femmes, avait demandé une vacation à la piscine en dehors des heures d'ouverture au public. Ai-je eu le droit de la lui accorder ? À l'avenir, comment s'assurer du respect du fameux contrat ?

Je reviendrai sur le constat alarmant de Laurence Vichnievsky. À la lumière de votre expérience, estimez-vous fondée la crainte de voir le communautarisme évoluer vers le séparatisme ? À cet égard, les orientations du texte sont-elles pertinentes ou comporte-t-il des oublis ?

Ne faut-il pas distinguer dans la loi ce qui relève de la confortation de la laïcité et de la nécessité pour toute religion de s'y conformer, même si elle ne dira rien de l'organisation des religions – en l'occurrence de l'islam –, de la volonté d'importer en France, de la pire des manières, le terrorisme, les atteintes aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui forment notre socle républicain ? La loi, dans un article plus général, ne peut-elle séparer l'islamisme de l'islam, le racialisme de la lutte contre les discriminations ?

Il peut exister une tension entre la neutralité du service public et la neutralité dans l'espace public. Je pense aux accompagnants scolaires et aux intervenants non représentants religieux dans des bâtiments publics à dimension symbolique forte comme l'Assemblée nationale. Faut-il clarifier les choses ou dispose-t-on des instruments nécessaires dans notre législation ?

Nous avons compris l'importante du dialogue entre le Conseil d'État et le législateur pour mettre en œuvre la notion de laïcité, mais qu'en est-il de l'intervention du Conseil constitutionnel ? Quels sont ses apports en la matière ? Pour l'instruction en famille, le passage d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation n'est-il pas une rupture attentatoire aux libertés ?

Il y a plusieurs visions de la laïcité dans notre pays. Faut-il remettre en cause l'entretien des églises par les collectivités ou l'étendre aux monuments des autres cultes ? Nombre d'enfants sont scolarisés dans des écoles confessionnelles. Doit-on continuer à les aider ou, au contraire, ne doit-on plus les financer ? Pensez-vous que des éléments sur l'organisation de la laïcité en vigueur dans les trois départements métropolitains sous concordat pourraient être étendus au pays tout entier ?

Dans le prolongement de la question posée par Perrine Goulet, quel regard portez-vous sur le maintien de la loi de 1905 et de l'exception que cela constitue ? Ne s'agit-il pas d'une séparation avec la règle commune ? Comment l'accepter en restant égalitaire ?
Il me semble que vous n'avez pas répondu à une question de mon collègue Éric Coquerel. Le Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF) a été récemment dissous. Sans vous prononcer sur le contenu des actions de cette association, quel regard juridique portez-vous sur cette décision, ainsi que sur l'article 8 du projet de loi ouvrant la possibilité de dissolution d'une association au motif du comportement individuel d'un de ses membres ? Cela ne risque-t-il pas d'ouvrir de larges possibilités de dissolution allant à l'encontre du respect des droits de l'ensemble des membres ?

À la différence de la loi de 1905 et d'autres interventions législatives, ce texte tire certaines interdictions, notamment sur la protection du corps de la femme, auxquelles je suis favorable, à partir du principe de dignité humaine. Ce fondement est-il de nature à contribuer à l'apaisement collectif pour les prochaines années voire les décennies à venir ? Pensez-vous qu'il soit applicable de la même façon à la partie du texte relative à la protection du corps de la femme, celle relative au respect de l'intégrité physique et morale, à celle relative au numérique et comme motif de dissolution d'une association ?

Vous n'avez pas répondu à une question relative à la polygamie. À l'article 14, il est préconisé la remise en cause de l'attribution de titres de séjour en cas de polygamie. Comment établir cet état ?

Je me fais le relais d'un message d'Éric Coquerel qui rappelle sa question sur la dissolution d'une association au motif du comportement individuel d'un de ses membres, et sur sa compatibilité avec la convention de Genève.
La loi de 1901 ne prévoyait qu'une dissolution judiciaire. Une dissolution administrative a été instaurée en 1936 dans le contexte des ligues d'extrême droite. Le nombre de cas de dissolutions administratives s'est progressivement accru. En regardant la loi, on a l'impression de relire l'histoire de France de 1936 à 2020, puisque, au fil du temps, les cas de dissolution par décret pris en Conseil des ministres se sont ajoutés. Le projet de loi prévoit la remise en ordre et la modernisation de la sédimentation opérée de 1936 à aujourd'hui – le vocabulaire est parfois désuet. Le texte recodifie le code de la sécurité intérieure, ce qui est très positif.
La dissolution administrative présente des avantages. Elle est plus rapide que la dissolution judiciaire, qui peut être prononcée pour les mêmes motifs mais qui peut faire l'objet d'une demande d'appel et d'un pourvoi en cassation. La dissolution administrative relève, quant à elle, d'un décret motivé en Conseil des ministres, soumis au contrôle du Conseil d'État. Cette procédure donne d'ailleurs lieu à une importante jurisprudence, car celui-ci est très exigeant sur la pertinence des motifs de dissolution. Un décret de dissolution ne doit donc pas susciter d'inquiétudes de principe sur une menace des libertés.
La nouveauté, c'est que le comportement des dirigeants pourrait servir de fondement à une dissolution. Mais je ne crois pas qu'une telle mesure se heurte au principe de l'obligation d'individualisation des peines, qui est d'exigence non seulement conventionnelle, celle de la convention de Genève, mais aussi constitutionnelle de la Déclaration des droits de l'homme. Le Conseil constitutionnel y veille. Comme l'a souligné le Conseil d'État dans son avis, il faudra être très attentif à la rédaction de la loi. On se situe, non pas dans le domaine pénal mais dans le cadre d'une mesure administrative, donc hors du champ de l'individualisation des peines au sens du droit pénal. Mais même pour une mesure de police administrative, il faut pouvoir saisir, au travers du comportement des dirigeants, l'association elle-même. Le texte vise à se donner des moyens de ne pas être exagérément naïf. Il faut faire en sorte qu'on ne puisse pas dire : ce n'est pas moi, association, c'est mon président. Cela ne me semble pas illégitime.
Mon expérience des questions de polygamie au Conseil d'État porte sur le refus du Gouvernement d'envisager l'acquisition de la nationalité française pour un étranger polygame. La polygamie est un motif légitime de refus fréquent, régulièrement soumis à la section de l'intérieur. La situation de l'étranger polygame est facilement identifiable. C'est un étranger dont le pays autorise la polygamie. Dans l'instruction des dossiers de nationalité, le ministère de l'intérieur a l'habitude de vérifier la polygamie. Cela pourrait parfaitement se faire pour d'autres types de décisions administratives, pour les titres de séjour. Il ne s'agit pas, pour autant, d'entrer dans le secret des foyers. En outre, le regroupement familial polygamique, c'est-à-dire l'entrée de plusieurs épouses au titre du regroupement familial, est d'ores et déjà impossible. Je ne crois donc pas que le terrain soit délicat.
S'agissant du contrat d'engagement républicain, le mot contrat peut en effet surprendre et n'est pas strictement conforme au sens du code civil. Mais nous utilisons déjà le terme au-delà du sens juridique. Dans l'administration elle-même, beaucoup de contrats sont passés. Un service de l'État qui a un projet d'innovation peut contracter avec la direction du budget pour qu'elle s'engage à accompagner chaque année financièrement l'évolution envisagée. C'est un mode de réforme administrative. Il m'arrive de dire aux étudiants qu'ils peuvent passer des contrats avec eux-mêmes. Ils peuvent par exemple décider de s'accorder une pause-café après avoir terminé leurs exercices. Bref, le mot contrat est déjà employé de manière non étroitement juridique, comme une dynamique positive.
Concernant les conditions d'accès aux piscines, c'est exactement ce qui est visé. La loi peut donner des armes aux collectivités territoriales. La commune pourra exiger d'une association sportive souhaitant avoir accès à la piscine municipale qu'elle ne fasse pas de discrimination contraire aux principes républicains entre les hommes et les femmes. Elle pourra faire savoir que, pour accéder aux équipements publics, il faut s'engager par « contrat » à respecter les principes républicains, et donc à ne pas faire de discrimination entre les garçons et les filles. Il y aura une base juridique. Si le mot « contrat » ne traduit pas la réalité contractuelle au sens du code civil, on peut le prendre dans un sens plus large – ou le changer. En tout cas, le sens juridique est tout à fait établi.
La liberté de l'enseignement et le droit à l'éducation sont deux principes de valeur constitutionnelle. C'est sûrement un des points sur lesquels le projet de loi fera l'objet de discussions. Le Conseil d'État a considéré que la première mouture allait exagérément loin, au risque de rencontrer des obstacles constitutionnels. Le texte qui vous est présenté atteint-il le bon équilibre pour resserrer la pratique, qui doit être exceptionnelle, de l'enseignement dans la famille ? Il revient au Parlement de le mesurer.
En matière d'équilibre entre école privée et école publique, nous avons connu des étapes successives. La loi Debré de 1959 et les contrats d'association étaient une grande nouveauté. La IIIe République a vécu selon le vieil adage : « À école publique, fonds publics, à école privée, fonds privés », jusqu'à la IVème République et la loi Baranger, et surtout le système actuel des lois Debré. Chercher à changer l'équation de la loi Debré, c'est prendre le risque de grands problèmes constitutionnels. Souvenez-vous de l'échec, devant le Conseil constitutionnel, de la révision de la loi Falloux ! En 1985, Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'éducation nationale, est revenu au système de la loi Debré pour mettre fin à la grande querelle de l'enseignement déclenchée par le projet de loi Savary visant à la création d'un grand service public unifié et laïc de l'éducation nationale, qui avait donné lieu à des manifestations en 1984. L'équilibre est très délicat et il ne faut y toucher qu'en tremblant. Il est frappant de voir qu'en 1985, le Gouvernement de Laurent Fabius et Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'éducation nationale, après les débats de 1982 à 1984, en soient revenus au système de la loi Debré, qu'ils ont simplement adaptée à la décentralisation et aux compétences nouvelles des communes, des départements et des régions en matière d'éducation. Cela doit inciter à une certaine prudence.
Le Conseil constitutionnel a bien sûr reconnu la laïcité comme principe constitutionnel. Il en a donné une formule très intéressante dans sa décision du 19 novembre 2004 que je cite de mémoire : « en vertu du principe constitutionnel de laïcité, nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers ». C'est ce qui définit aujourd'hui le principe constitutionnel de laïcité.
Le même Conseil constitutionnel a érigé, en 1994, la dignité de la personne humaine en principe de valeur constitutionnelle. C'est une boussole qui pourra vous être utile dans vos travaux. Une partie du projet de loi repose précisément sur le principe de dignité. On a peut-être moins évoqué ces aspects, comme les certificats de virginité. En tout cas, la dignité de la personne humaine est très présente. Cette importante notion peut être un instrument de lutte contre les discriminations.
J'évoquerai un dernier souvenir. Quand le Conseil d'État a jugé légale, en 2014, l'interdiction des spectacles de Dieudonné, l'ordonnance de référé mentionnait bien que les propos antisémites qui s'y trouvaient portaient atteinte à la dignité de la personne humaine. Ce principe constitutionnel, qui peut avoir beaucoup de ramifications, est de premier ordre pour poser des barrières face à toutes les formes de discrimination.

Merci beaucoup, monsieur Stirn, pour vos nombreuses réponses. Je le répète, vous étiez là, non pas pour répondre à des questions politiques proprement dites, mais pour éclairer nos travaux.
La séance est levée à treize heures dix.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
Réunion du lundi 21 décembre 2020 à 11 heures
Présents. – Mme Caroline Abadie, M. Saïd Ahamada, Mme Stéphanie Atger, Mme Laetitia Avia, Mme Géraldine Bannier, M. Belkhir Belhaddad, M. Florent Boudié, M. Pierre-Yves Bournazel, M. Xavier Breton, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Émilie Chalas, M. Francis Chouat, Mme Fabienne Colboc, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. François Cormier-Bouligeon, M. Charles de Courson, M. Éric Diard, Mme Coralie Dubost, M. Christophe Euzet, Mme Isabelle Florennes, Mme Laurence Gayte, Mme Annie Genevard, Mme Perrine Goulet, Mme Florence Granjus, Mme Marie Guévenoux, M. Yves Hemedinger, M. Pierre Henriet, M. Sacha Houlié, Mme Sonia Krimi, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Anne-Christine Lang, M. Guillaume Larrivé, M. Gaël Le Bohec, Mme Constance Le Grip, M. Jean-Paul Mattei, M. Ludovic Mendes, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Frédéric Petit, M. Stéphane Peu, M. Éric Poulliat, M. François Pupponi, M. Julien Ravier, M. Robin Reda, M. François de Rugy, M. Pacôme Rupin, Mme Cécile Untermaier, M. Boris Vallaud, Mme Laurence Vichnievsky, M. Guillaume Vuilletet