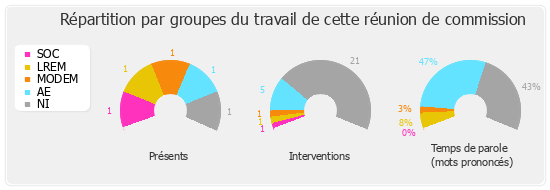Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
Réunion du jeudi 8 avril 2021 à 9h00
Résumé de la réunion
La réunion
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
Jeudi 8 avril 2021
La réunion est ouverte à 9 h 10.
Examen de la note scientifique « Les enjeux sanitaires et environnementaux de la viande rouge » (Antoine Herth, député, rapporteur)

. Deux sujets importants et fort différents sont à l'ordre du jour de notre réunion de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST). Le premier est l'examen de la note préparée par notre collègue Antoine Herth sur « Les enjeux sanitaires et environnementaux de la viande rouge ». Le second est une audition publique sur le thème du Covid long, qui se situe dans la continuité des travaux de l'Office sur la pandémie.
Le premier sujet, celui de la viande rouge, peut paraître anodin. Il n'en est rien. En effet, il soulève à la fois un enjeu de société important et un enjeu économique considérable. Si l'Office peut dissiper les malentendus, je crois qu'il sera utile à l'humanité souffrante.

Le 20 octobre 2020, le bureau de l'Office a décidé que serait réalisée une note scientifique consacrée aux enjeux sanitaires et environnementaux de la viande rouge. C'est donc une double thématique. Dans le sillage de la COP 21, la question de l'alimentation et de son impact sur l'environnement est devenue un sujet de débat. Pour preuve, dimanche dernier, une tribune de 20 députés, dans le journal L'Opinion, plaidait en faveur d'une moindre consommation de viande, voire d'une suppression complète. Cette note vise donc à analyser l'état des connaissances scientifiques sur cette double question, ainsi que les pistes faisant l'objet de recherches.
Pour la clarté du propos, je vais aborder successivement la dimension sanitaire et la dimension environnementale. Il est compliqué de voir d'emblée les deux en résonance. Pour les besoins de la note, le terme viande rouge, retenu dans son intitulé, a été pris comme signifiant viande hors volaille. C'est l'acception généralement retenue par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
La viande rouge est un enjeu de santé, mais aussi un enjeu culturel, puisque la consommation de viande fait référence à des habitudes alimentaires ainsi qu'à des notions d'éthique, voire des questions religieuses. Je ne les ai pas abordées dans cette note. Cela pourrait être un sujet à part entière.
Dans la gastronomie française, les plats sont en général nommés selon leur composante en protéines animales. La viande y tient une place très importante. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la consommation de viande varie comme le niveau de revenus. Santé Publique France indique qu'il est recommandé de ne pas consommer plus de 500 grammes de viande rouge par semaine. Cependant, 41 % des hommes et 24 % des femmes dépassent cette limite posée par le Programme national nutrition santé.
Quelles sont les caractéristiques de la viande rouge ? Sa composition chimique se caractérise d'abord par sa richesse en fer héminique, qui est contenu dans l'hémoglobine et la myoglobine. La teneur en fer héminique varie selon le type de viande. Elle est de 69 % pour le bœuf, 39 % pour le porc et le veau. Les modes de cuisson peuvent influer sur la teneur en fer. Par exemple, faire bouillir la viande provoque une dégradation très importante du fer héminique. Celui-ci présente l'intérêt d'être facilement assimilable par l'organisme : selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), il représente 30 % du fer ingéré, mais 80 % du fer assimilé par l'organisme. Ces pourcentages sont inverses pour le fer d'origine végétale. Le risque généralement pointé d'une non-consommation de viande est l'anémie ferriprive. C'est un risque relativement faible : il ne concerne que 3 % à 4 % de la population, surtout des femmes en âge de procréer, et il apparaît essentiellement dans les outre-mer.
Quels sont les risques sanitaires liés à la consommation de viande ? Le fer héminique est le principal responsable de la cancérogenèse colique. Il provoque une réaction enzymatique et catalyse l'oxydation des lipides pour former des alcénals, qui provoquent des cassures de l'ADN par effet cytotoxique et génotoxique. Ainsi, en 2015, 2 031 cancers étaient liés à la consommation de viande rouge, et 4 380 cancers étaient liés à la consommation de charcuterie, qui a donc des impacts beaucoup plus importants. Nous en avons débattu très récemment à l'occasion de l'examen d'une proposition de loi de notre collègue député Richard Ramos. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) classe la viande rouge comme cancérogène. Au-delà de 100 grammes de consommation de viande rouge par jour, le risque de cancer augmente de 17 %.
Je vous présente un tableau qui montre les recommandations du Programme national nutrition santé (PNNS). Font partie des catégories d'aliments à réduire la charcuterie, les produits sucrés gras, les produits salés, l'alcool et les viandes – porc, bœuf, veau, mouton, agneau, abats, en fonction des recommandations. Pour mémoire, il est recommandé de ne pas consommer plus de 50 grammes de charcuterie par jour pour ne pas avoir d'effets négatifs sur la santé.
Le deuxième tableau concerne l'impact sur le cancer. Pour les remettre en perspective, les cancers liés à l'alimentation représentaient au total 18 781 cas en 2015, dont 2 031 liés à un excès de consommation de viande rouge et 4 380 liés à un excès de consommation de viande transformée. Le cancer du côlon et du rectum représentait 1 699 cas pour 332 cas de cancer du pancréas en 2015. Il faut rappeler que celui-ci engage le pronostic vital de façon bien plus défavorable que le cancer colorectal. Ces nombres sont un point d'inquiétude pour les spécialistes de la nutrition santé.
Quelques risques cardiovasculaires sont également associés à une trop grande consommation de viande, comme le risque d'AVC : augmenter de 100 grammes la consommation de viande rouge majore ce risque de 13 % ; la majoration atteint 42 % pour 100 grammes de charcuterie.
Les messages de modération diffusés par le Programme national nutrition santé sont diversement reçus par la population, une partie n'y étant absolument pas sensible. D'où l'intérêt des recherches entreprises pour essayer de limiter l'impact sanitaire de la viande au stade de sa préparation ou de son ingestion.
L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) de Toulouse mène des recherches sur les effets de l'absorption concomitante d'antioxydants, comme les polyphénols, qui permettent de bloquer l'oxydation du fer héminique sans en limiter l'absorption. L'absorption de calcium ou de chlorophylle permet également de bloquer cette oxydation, mais elle empêche l'absorption du fer. Il n'y a donc pas de bénéfice pour l'organisme. Les modes de préparation peuvent également influer. Ainsi, les marinades diminuent le risque, de même que l'adjonction de curcuma, mais celui-ci modifie profondément la couleur de l'aliment, ce qui n'est pas forcément accepté par le consommateur.
Des recherches sont également en cours dans des élevages et portent sur l'ajout d'antioxydants dans la ration des bovins. Les graines de lin, en particulier, permettent d'améliorer la composition de la viande et ont un effet bénéfique sur les émissions entériques des bovins.
Cependant, le faible niveau de preuve de ces études ne permet pas, pour l'instant, d'élaborer des messages sanitaires suffisamment fondés. Nous en sommes toujours au stade de la recherche, même si celle-ci est engagée sur des pistes intéressantes.
Le deuxième volet de la note porte sur les enjeux environnementaux de la viande rouge. Le débat sur le changement climatique a eu une forte influence sur l'élevage en France. Il oscille entre la prohibition et l'adaptation, comme le débat sur la consommation de viande. Les recherches sont nombreuses pour limiter les impacts de l'élevage. L'élevage ruminant, en particulier bovin, est en première ligne. Son bilan carbone est cependant très variable selon les conditions dans lesquelles il est réalisé, selon les modes d'élevage. En moyenne, l'élevage bovin émet 25 kilos d'équivalent carbone sous diverses formes pour produire 100 grammes de protéines. Cette quantité est comprise entre 9 et 105 kilos selon le type d'élevage, ce qui montre qu'il existe un réel potentiel d'optimisation de l'impact environnemental du point de vue du bilan carbone. La Food and Agriculture Organization (FAO) attribue à l'élevage 14,4 % des émissions de gaz à effet de serre. Dans ces émissions, on trouve du méthane provenant des fermentations entériques et des déjections ; du protoxyde d'azote provenant des engrais et également des déjections ; enfin du CO2, essentiellement produit par les machines agricoles et le transport.
Entre 1990 et 2017 on a observé une baisse du cheptel de vaches laitières, qui résulte essentiellement de la réorganisation des politiques encadrant la production laitière européenne. Pour le Boston Consulting Group (BCG), qui a publié un rapport à l'occasion du projet de loi Climat et Résilience, il conviendrait de diminuer de 25 % la taille de l'élevage français pour répondre aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, les vaches permettent aussi de produire du lait et de la viande à partir de ressources fourragères non utilisables par l'homme. Le questionnement porte donc aussi sur l'utilisation optimale des terres et l'aménagement du territoire.
Le tableau suivant présente des flux en masse, depuis la production végétale primaire jusqu'au produit fini. Les chiffres viennent de la FAO et permettent en particulier d'observer la part d'importation d'aliments pour animaux, essentiellement le tourteau de soja – qui est aussi une forme de déforestation importée. Le tableau permet également de constater que la France exporte une partie de ses produits végétaux primaires, essentiellement des céréales. Elle exporte et importe des produits transformés. 50 millions de tonnes sont utilisées pour la population métropolitaine, dont 15 millions de tonnes pour les produits animaux et 35 millions de tonnes pour les produits végétaux. Cela représente la totalité de la consommation.
En matière d'émissions de gaz à effet de serre, on observe : l'impact de l'ammoniac, pour plus de 30 millions de tonnes en équivalent tonnes CO2 ; la fermentation entérique, premier poste, avec près de 45 millions de tonnes ; les effluents d'élevage qui produisent du méthane, pour plus de 10 millions de tonnes ; enfin, la consommation d'énergie qui est une contribution relativement faible comparée aux autres sources. Notons également – cela fait partie du débat qui a eu lieu récemment dans l'hémicycle – les émissions liées à l'utilisation des engrais, dont un peu plus de la moitié en équivalent CO2 pour leur fabrication et une partie résultant des émissions de protoxyde d'azote au moment de l'épandage dans les champs.
Comment mesurer les impacts de l'élevage sur l'environnement ? Les agronomes proposent de porter un regard large sur le sujet, en prenant par exemple en compte l'entretien des prairies qui en fait des puits de carbone, au même titre que les forêts. Ils proposent une approche au travers de cinq paramètres : les gaz à effet de serre et le stockage du carbone ; la qualité des eaux et de l'air ; l'emploi des ressources naturelles ; l'usage des terres ; l'impact sur la biodiversité.
Je vais illustrer cette approche par quelques exemples. Pour le cycle du carbone, les vaches au pâturage provoquent certes des émissions de gaz carbonique et de méthane, mais les rejets permettent d'alimenter le cycle du carbone, et notamment d'augmenter son stockage dans les sols. C'est un enjeu important.
Un autre impact de l'élevage est l'empreinte eau. Il existe une segmentation des usages de l'eau : l'eau dite « bleue » sert à l'abreuvement des animaux et représente 3,6 % du total ; l'eau dite « verte » – eau de pluie – qui tombe sur les prairies et fait pousser les fourrages, représente près de 94 % de la quantité d'eau utilisée par les animaux ; l'eau dite « grise » est une eau virtuelle provenant de l'effet de dépollution des prairies sur les eaux.
Des risques sont liés à une trop forte densité d'animaux, comme l'eutrophisation des rivières et les nitrates qui se retrouvent dans les nappes phréatiques – on peut avoir les deux selon le mode de conduite de l'élevage.
Une autre illustration de l'impact sur la biodiversité est un sujet qui a fait débat il y a quelques années, à savoir la valorisation des déjections par les insectes coprophages, qui sont à la base d'un véritable écosystème, notamment dans les prairies d'alpage. À l'époque, les produits vermifuges étaient remis en cause car ils tuaient indirectement les insectes coprophages lorsqu'ils se fixaient sur leurs ressources alimentaires, c'est-à-dire les bouses de vache. Ces produits cassaient toute la chaîne, tout l'écosystème qui se construisait derrière.
Quels sont les leviers d'action pour réduire les gaz à effet de serre ? Plusieurs mesures sont proposées : réduire la déforestation importée en accroissant l'utilisation de légumineuses et en cherchant une plus grande autonomie fourragère des exploitations d'élevage françaises, ce qui est actuellement l'un des axes forts de la politique du ministère de l'Agriculture ; développer des techniques de culture sans labour et améliorer la gestion des prairies afin d'en maximiser la fonction de stockage de carbone ; réduire l'utilisation des engrais de synthèse au profit d'une meilleure valorisation des engrais organiques ; développer l'agroforesterie et la plantation de haies qui permettent de fixer davantage de carbone ; développer l'agriculture biologique, globalement favorable à un meilleur cycle du carbone et à un moindre impact sur l'environnement.
Un tableau de l'INRAE retrace quelques-unes des pistes dans lesquelles des travaux sont engagés. Par exemple, l'accroissement du pâturage dans les prairies permanentes est très favorable au stockage du carbone. D'autres pistes sont à l'étude. De façon plus indirecte, la réduction des émissions dans les élevages peut être favorisée par le stockage des effluents dans des contenants couverts fermés, par l'installation de torchères pour brûler le méthane issu des fermentations et par l'installation de méthaniseurs qui valorisent les déjections animales.
Des pistes et des projets industriels émergent pour valoriser les déchets gras de l'industrie alimentaire en les transformant en biocarburant, dans le but d'améliorer globalement le cycle du carbone sur l'ensemble de la filière. Existent également des pistes pour améliorer la fermentation entérique dans le rumen par l'apport de lipides insaturés. Il s'agit en particulier de l'apport de graines de lin en substitution des tourteaux de soja. Certaines pistes sont plus directes et travaillent sur la génétique des bovins pour améliorer leurs caractéristiques de rumination, réduire l'âge du premier vêlage – ce qui permet d'améliorer le bilan carbone sur l'ensemble du cycle de vie d'un animal –, favoriser les vêlages de printemps, qui sont également plus favorables, ou réduire la durée d'engraissement des animaux mâles en produisant des animaux plus légers.
Avant de finir, je voulais, à titre plus anecdotique, vous faire part d'expérimentations intéressantes de renaturation, de retour à la nature sauvage. Un programme européen est en cours aux Pays-Bas, en Roumanie et au Portugal où, pour recréer un écosystème sans intervention humaine, on utilise de gros bovins, en tout cas de gros ruminants, pour structurer la masse végétale forêt/herbage et permettre ensuite à une chaîne de biodiversité de s'installer. Dans ce cas d'école, évidemment, c'est l'homme qui s'efface.
Une photo pour conclure : quelles sont les tendances de fond de la consommation de viande en France ? Le maximum de consommation a été atteint dans les années 1980-1990. On observe depuis une érosion, de l'ordre de 12 % ou 13 % ces dix dernières années, avec une forte baisse pour la viande bovine ; la viande porcine affiche une baisse moins marquée ; la viande de mouton connaît un fort recul ; en revanche, la viande de volaille augmente de façon importante.
La réduction de la consommation de viande est une donnée structurelle qui est déjà engagée, et nous consommons plus de viande blanche que de viande rouge. Cette évolution va dans le sens – et c'est heureux – des recommandations du Programme national nutrition santé. En revanche, du côté de la production, il existe beaucoup de marges pour améliorer l'empreinte carbone de l'élevage français. Il convient de ne pas négliger l'ensemble des composantes de ce bilan, en particulier pour l'élevage à l'herbe.

Je salue l'ampleur de ce travail et surtout la variété des ingrédients, des critères, des sources que vous avez eu à consulter. Il s'agit d'une tentative très ambitieuse de traiter un sujet scientifique au sens des sciences dures, mais aussi culturel, faisant intervenir les sciences humaines et sociales, ainsi que des éléments très variés de différentes sciences. Mon impression est que tous les ingrédients y sont et je n'ai personnellement que quelques recommandations de forme.

Je félicite Antoine Herth pour cette note scientifique. Nous connaissons tous les débats entre les pro et les anti dans les circonscriptions rurales où se pratique l'élevage. Désormais, nous disposons d'un document qui regroupe un ensemble d'informations factuelles, tant du point de vue sanitaire qu'environnemental, permettant d'avoir un débat apaisé. Bravo et merci.
Ma première question est technique. Elle concerne le tableau qui nous a été présenté sur le bilan carbone, dont la source était Clim'Agri. Étaient indiquées les parts respectives du CH4, du CO2 et du N2O. Les chiffres concernaient-ils l'élevage seulement ou toute la « ferme France » ? Les engrais représentaient une part importante. Or ceux-ci sont moins utilisés en élevage qu'en grandes cultures. J'ai donc un doute sur le périmètre.
Le rapporteur nous a dit que les bovidés pouvaient aussi être la solution et que des essais, des perspectives et des réflexions étaient menés aux Pays-Bas et au Portugal. Avez-vous regardé l'effet de l'élevage bovin sur l'hydrologie à l'échelle des bassins-versants ? On sait très bien qu'un bassin-versant bocager où se pratique l'élevage montre une circulation et un écoulement des eaux totalement différents de ceux du même bassin-versant avec le même profil topographique mais couvert de grandes cultures – l'érosion des sols n'y est pas non plus la même. Essayons cette prospective : si l'on ne consomme plus de viande, que deviennent ces bassins-versants et quelles conséquences cela peut-il avoir en termes de crues ou de qualité des eaux ?
Le rapporteur a bien mis l'accent sur les méfaits d'un excès de consommation carnée, en particulier de viande rouge. Inversement, une question reste en suspens : si nous ne mangeons plus de viande rouge, quel est l'impact sur la santé de l'absence de fer héminique dans le bol alimentaire ?

Quand on lie consommation de viande et présence des vaches, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des vaches laitières. Je ne pense pas que cela crée des différences au niveau du paysage. En tout cas, le natif de la Corrèze que je suis, qui a littéralement grandi en voyant les vaches par la fenêtre, ne peut que se réjouir quand il entend parler des bovidés comme étant la solution.
Je voudrais remercier Antoine Herth. Son travail absolument formidable me conduit à penser qu'il aurait fallu en réalité rédiger deux notes distinctes : l'une sur l'enjeu sanitaire et humain et l'autre sur l'enjeu environnemental. La richesse de cette note et la diversité des problèmes rendent le pari des quatre pages extraordinairement difficile à tenir.
La consommation de viande rouge ou blanche – les protéines animales – est un phénomène ancien de nos sociétés, avec des traditions culturelles très différentes, y compris en Europe, et a fortiori entre l'Europe et le reste du monde. Cela mériterait que l'on entre plus dans le détail des conséquences sanitaires négatives et positives. S'il y a des conséquences négatives, il y a aussi des conséquences positives, il faudrait le souligner, notamment sur la croissance et la taille des organismes – bien qu'après tout, des êtres plus petits pourraient être plus nombreux sur Terre, chacun disposant de plus de surface. Une délicieuse comédie de science-fiction propose de surmonter les inconvénients de la surpopulation en organisant un plan de réduction de la taille des êtres humains pour que leur empreinte soit plus modeste, tout en gardant le droit de vivre – mais vivre à condition d'être plus petit. Tout est possible.
Les pistes ouvertes sont toutes intéressantes et mériteraient d'être systématiquement confrontées à la diversité des expériences mondiales. Comme la langue d'Ésope, les animaux sont la meilleure et la pire des choses. Va-t-on entretenir des bisons qu'on ne mangerait pas pour que les paysages soient à l'image de ce que pouvait être le monde avant que l'homme ne le colonise ? Cela mériterait d'être approfondi et de lister toutes les ouvertures possibles. Pour le reste, c'est un travail absolument parfait qui ouvre grand notre appétit de connaissances.

Notre conseillère scientifique en sciences humaines et sociales nous signale que la comédie citée à l'instant est le film Downsizing d'Alexander Payne.

Je ne pouvais pas manquer la présentation de cette note, que je trouve en tous points remarquable. Je tiens à féliciter notre collègue Antoine Herth.
Mes réactions et réflexions rejoignent ce qui a été très bien dit par Philippe Bolo et Gérard Longuet. La note est particulièrement équilibrée. C'est peut-être un mot passe-partout et c'est ce que nous devons faire à l'Office, mais c'est toujours bon de le souligner. Tous les aspects sont abordés avec rigueur et l'ensemble est remarquablement intéressant. C'est parce que l'OPECST produit ce type de note que je ressens une certaine fierté à en être membre. Je suis toujours aussi étonné par la qualité de ce que l'Office réalise.
J'aimerais bien que soit explicité un point sur la gestion du carbone. Il a été dit que le meilleur équilibre se trouve dans l'agriculture biologique. J'ai été rapporteur de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la sortie du glyphosate et j'ai beaucoup travaillé sur les techniques de culture, notamment l'agriculture de conservation des sols. Je ne suis le représentant de personne ; je m'aperçois simplement que pour avoir moi-même bêché des parcelles totalement contiguës en agriculture biologique, en agriculture de conservation des sols et en agriculture conventionnelle, il y a matière à discuter. Je ne suis pas certain que tout soit mieux dans l'agriculture biologique. Cela se joue entre l'agriculture de conservation des sols et l'agriculture biologique. Il ne s'agit pas d'opposer l'une à l'autre. D'ailleurs, nous pouvons faire l'une et l'autre en même temps. Assurément, l'agriculture de conservation des sols est remarquable et contribue à fixer le carbone. Tout cela doit être intégré, notamment dans le débat sur l'importance de l'élevage pour un couvert végétal permanent permettant de fixer le CO2. C'est un sujet sur lequel je voudrais quelques précisions.
L'intérêt de la méthanisation pour fixer le carbone a été évoqué. En effet, il y a un lien avec l'élevage. Nous l'avions dit dans le rapport sur l'agriculture face au défi de la production d'énergie que l'Office a adopté en juillet dernier. Nous pouvons imaginer un formidable développement de la méthanisation, à condition de maîtriser les intrants, la qualité des digestats, etc. Il faut donc mettre beaucoup plus de rigueur et adopter une démarche quasi scientifique dans la manière de gérer la méthanisation du début à la fin.
Dans les lycées agricoles, des réflexions sont-elles conduites sur ces sujets liés à l'élevage ? On y étudie la technique agricole, la technique de production, la technique d'élevage. Mais, au fond, pourquoi faisons-nous tout cela ? Sur l'alimentation, sur telle ou telle viande, donne-t-on des éléments de réflexion, présente-t-on les avantages et les inconvénients comme cette note le fait ici ?
Dans les autres pays, notamment en Amérique du Sud, en Argentine, symbole de l'élevage bovin extensif et de la viande rouge, voit-on des réflexions, voire des orientations qui pourraient se recouper avec ce qui se passe en Europe ? Ou bien est-ce très différent sur un plan culturel ?
Le troisième point rejoint aussi ce que disaient Philippe Bolo et Gérard Longuet. D'ailleurs, c'est peut-être une interrogation que l'Office devrait avoir. Ce travail ne peut-il être considéré comme un élément de la stratégie eau-air-sol ? Pour moi, ces trois éléments sont vraiment liés. Hier soir, les débats de l'Assemblée nationale sur le projet de loi Climat portaient sur des questions relatives à l'eau. Ce week-end, ils porteront sur l'air, entre autres. Eau, air, sol, tout est lié. N'y a-t-il pas une stratégie globale à construire ? J'ai participé à des échanges sur le sujet avec des agriculteurs de mon département, le Rhône. Des démarches eau-air-sol devront sûrement être développées. La réflexion sur l'élevage n'est-elle pas une brique de la réflexion globale eau-air-sol qu'il faut développer pour réduire l'impact environnemental de notre agriculture – tout en conservant la qualité de ce que peut nous apporter l'agriculture, par exemple à l'aménagement du territoire et à l'entretien des paysages ?
Une toute dernière remarque : le volet « Se nourrir » du projet de loi Climat sera bientôt abordé en séance avec notamment les controverses relatives aux repas végétariens. J'aurais aimé que la note que nous examinons aujourd'hui soit à la disposition de toutes celles et tous ceux qui participeront aux débats. C'est une note remarquable produite par le Parlement, plus intéressante que certaines lectures journalistiques parfois trop partisanes, dans un sens ou dans l'autre. Là, nous avons une note scientifique de l'Office parlementaire. Cela viendrait donc à bon escient dans le débat. Je serai le premier à inciter nos collègues à en prendre connaissance.
Je suis à peu près en accord avec ce qui a été dit par mes collègues. Je tiens à féliciter Antoine Herth pour ce travail d'une remarquable précision, même si, pris dans un contexte uniquement nutritionnel et avec des considérations sur l'impact carbone, il peut paraître légèrement à charge. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas non plus l'esprit de l'Office.
Il faut globaliser la réflexion. Comme le disait Gérard Longuet, il aurait peut-être fallu plusieurs publications. En matière d'impact carbone, on peut montrer du doigt l'élevage en général, qui a une forte empreinte. Je veux cependant aussi le voir dans la perspective de la ressource en protéines. J'ai réalisé pour le ministère de l'Agriculture, en 2019, un rapport sur la pêche en mer, qui s'intéressait à la ressource protéine marine. C'est une ressource aujourd'hui limitée : pillée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, dans nos départements et territoires d'outre-mer, mais surtout limitée.
La viande est une importante ressource de protéines, que ce soit la viande rouge ou la viande blanche – là, il s'agit de viande rouge. Je vais prendre le sujet dans la perspective de l'aménagement du territoire. J'ai passé quinze ans de ma vie dans une ferme, avec 250 têtes de blondes d'Aquitaine. J'étais conseiller général du canton, qui était le plus gros canton d'élevage de la Haute-Garonne. Lors des élections sénatoriales de l'été dernier, j'ai fait une petite enquête au cours de ma tournée du département. Il s'avère que dans la moitié sud du département de la Haute-Garonne, qui comprend des zones de montagne, des zones de piémont, ainsi que des zones de plaines et de coteaux, nous avons perdu au cours des vingt-cinq dernières années 50 % des surfaces d'estive et de pâturage. La principale raison est le renoncement de certains éleveurs, qui ne vivent plus de leurs revenus. Il faut vraiment de la passion pour être éleveur aujourd'hui. C'est un beau métier, mais c'est un métier prenant. Il n'y a pas de dimanches ni d'étés. Quand ce ne sont pas les étables à nettoyer, ce sont les clôtures à réparer, etc.
On constate un renoncement de jeunes, qui se sentent totalement stigmatisés par certaines organisations – comme les agriculteurs en général et les pêcheurs aussi maintenant. C'est grave. En montagne, il y a ce que l'on appelle le pastoralisme, cette interdépendance entre l'homme, le milieu et l'animal. Avec 50 % de la surface d'estive en moins, que se passe-t-il à la place ? De la ronce, du noisetier. Cela fait du taillis. Avec le réchauffement climatique, c'est la porte ouverte aux incendies, donc ces zones vont devenir impropres à la promenade, avec des conséquences touristiques très fortes. Donc si nous abandonnons l'élevage dans ces zones, nous nous dirigeons vers une catastrophe écologique, économique et humaine. Cela concerne plusieurs zones en France. La Haute-Garonne n'a pas l'apanage de ce type de problème. Il faut y réfléchir.
Une réponse a été apportée avec les premiers dossiers de méthanisation, qui ont été travaillés au début avec Sébastien Lecornu. Or ces dossiers n'en finissent pas et se heurtent à des complexités. Les ONG attaquent systématiquement tous les dossiers présentés. Les contrats de rachat de l'électricité ont été revus à la baisse. Ces projets qui étaient censés améliorer les revenus des éleveurs s'avèrent de plus en plus coûteux et difficiles à mener. C'est dommage car la méthanisation est un bon complément de l'élevage. Cela permet de produire de l'énergie, au lieu de dépendre de fournisseurs extérieurs et de faire des fosses à déjections. Cela paraissait tout à fait positif, à condition que ce soit maîtrisé, comme l'a dit Jean-Luc Fugit.
Nous ne pouvons pas laisser tomber l'élevage comme cela. On parle d'insectes et de protéines végétales, mais je pense que les gens ne sont pas prêts. J'ai eu une discussion avec des avocats de l'ONG Sea Shepherd, qui veut interdire la pêche purement et simplement. Allez raconter à des Polynésiens, à des Néo-Calédoniens pour qui c'est la seule ressource – ils vivent tous en bord de mer et ont un bateau pour pêcher dans le lagon – qu'il faut arrêter la pêche. C'est ridicule. Nous n'en sommes pas à ce point. Je pense qu'il faut regarder l'élevage avec peut-être plus de circonspection. Il faut essayer de trouver des solutions d'amélioration, peut-être diminuer les consommations. Le downsizing, je n'y crois pas. Si nous devons faire de petites vaches, il faudra en faire deux fois plus, parce qu'il y a tout de même un problème de rentabilité des élevages. Je crois qu'il existe des solutions plus rationnelles. La méthanisation en est une, de même que la maîtrise de certaines techniques, ainsi qu'une meilleure gestion de l'eau.

Merci beaucoup, cher collègue. Voilà un sujet qui passionne et qui enflamme. C'est bien que l'Office s'y implique.
Je remercie moi aussi Antoine Herth pour son rapport. Je rejoins les propos de Gérard Longuet : c'est un vrai défi de pouvoir traiter à la fois les parties sanitaire, humaine et environnementale dans la même note. Je m'inscris dans la suite des propos de mes collègues. J'étais encore dans une exploitation la semaine dernière. C'est un vrai sujet que celui du maintien des paysages. Je n'apprends à personne qu'au travers de la filière viande, on ne touche pas seulement à la production de fourrage mais aussi au maintien des paysages ruraux, ce processus qui façonne et évite le refermement par des taillis. Nous évoquons ce sujet au travers de la viande, certes, mais il a de vraies conséquences environnementales et paysagères.
J'aurais bien aimé que la note différencie la consommation de viande rouge, qui est le sujet aujourd'hui, et la consommation de viande rouge de qualité. L'expression « de qualité » est essentielle. Aujourd'hui, il y a un processus de labellisation bien défini – nous connaissons tous les labels rouges.
Tout ce qu'a dit le rapporteur sur l'importance des conditions d'élevage, de l'alimentation, de la production d'une viande de qualité est évidemment essentiel. Mais l'industrie post-abattoir – ce n'est pas péjoratif – peut venir ternir cette qualité, quand bien même le producteur et l'exploitant ont fait tout le travail en amont. Comme dans beaucoup de domaines, « il en faut pour son argent » : après l'abattoir, on peut ajouter des graisses dans des proportions variées, ou divers additifs qui permettent de faire baisser le coût de la viande à volume équivalent. Les impacts sanitaires ne sont pas du tout les mêmes selon qu'il s'agit d'une viande rouge de qualité ou d'une viande rouge transformée. Sans complexifier le processus global de la production à la consommation, il est essentiel de labelliser les viandes de qualité qui, certes, ont un coût.
Cela rejoint un autre débat, que nous avons d'ailleurs déjà eu au sein de l'Office : selon le budget consacré à l'alimentation, celle-ci est de plus ou moins bonne qualité. J'en terminerai là. Merci encore pour tout le travail effectué.
Je félicite Antoine Herth pour cette note qui nous sera précieuse, notamment pour l'examen de la loi Climat et Résilience. Je partage les remarques de tous les collègues, notamment de Ludovic Haye, qui vient de s'exprimer sur la qualité de la viande et la qualité de l'alimentation. À mon avis, ce peut être un sujet à part entière. J'ai été très intéressée par le thème du retour à la nature sauvage.
De nombreux diagrammes nous ont été présentés. Ils sont très éclairants. Peut-être un ou deux pourraient-ils être ajoutés à la note.
La note s'intéresse-t-elle aux âges auxquels on consomme de la viande rouge et à l'effet de cette consommation ? Je ne suis pas du tout scientifique et certainement pas nutritionniste, mais la taille de nos compatriotes a évolué depuis un siècle. Deux raisons différentes ont été bien identifiées : je dirais sous forme de boutade que la première est le vélo, lorsque les hommes ont pu aller chercher des femmes un peu plus loin que leur village ; ce mélange a permis de faire grandir. Mais il y a aussi la consommation de protéines animales : dans les pays qui n'ont pas de culture de la protéine animale, les individus sont plus petits. La viande a-t-elle des conséquences inégales aux différents âges de la vie ? Par exemple, le fer héminique est-il plus utile en période de croissance qu'à d'autres âges ?

Je suis ravi de voir les nombreux commentaires et questions constructives des collègues. C'est un sujet qui passionne, nous avons vraiment bien fait de l'aborder. Je vais y ajouter quelques remarques et recommandations et je sais qu'Antoine Herth s'efforcera d'incorporer les remarques qui ont déjà été formulées.
Je m'associe à ce qui a été dit. Tout y est dans cette note, à quelques questions de périmètre près. C'est donc une note qui incorpore beaucoup de critères, beaucoup de sujets. Il faut arriver à l'organiser de la façon la plus claire et la plus accessible. Il s'agit d'un sujet d'abord culturel et, d'ailleurs, la note commence par cette dimension. En France, le sujet est encore plus sensible qu'ailleurs, notamment en raison de notre tradition culinaire. Pour information, la France compte trois fois moins de végétariens que la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou l'Italie.
De nombreux avis scientifiques ont été rendus sur la consommation de viande. Par exemple, l'Académie nationale des sciences américaine a depuis longtemps déjà rendu un avis dans lequel elle estime que l'alimentation végétarienne est parfaitement propre à assurer une bonne santé, y compris une bonne croissance, à condition que les apports protéiques soient bien réalisés sous certaines formes. Du côté de la France, nous en sommes encore au stade où l'ANSES a lancé un appel à la constitution de groupes de travail. En France, un pays où l'un des plus anciens livres de cuisine connu s'appelle Le Viandier, le débat est bien plus difficile que dans d'autres pays.
L'enjeu est aussi de bien définir les concepts. À cet égard, commencer la note en disant que la viande rouge est un concept culturel est bien. Attention cependant à ne pas évacuer la définition chimique.
Pour ce qui concerne la couleur de la viande, l'industrie agroalimentaire a suscité au moins deux polémiques que l'on peut dire « classiques ». La première se rapporte à la couleur rouge ou rosée de la charcuterie : dans leur récent rapport d'information sur les sels nitrités dans l'industrie agroalimentaire, les députés Richard Ramos, Barbara Bessot-Ballot et Michèle Crouzet estiment que l'une des fonctions majeures des additifs nitrités est de donner une couleur rouge « appétissante » à la charcuterie, bien plus que garantir l'innocuité contre le botulisme et autres risques.
La seconde concerne la couleur de la viande de veau. Ce que je vais dire n'est pas polémique dans le sens où c'est officiellement visible sur le site Internet du ministère de l'Agriculture, bien que, personnellement, cela me choque. Bien souvent, le veau d'élevage est anémié à dessein. Les carences en fer sont organisées précisément pour que la viande ait une couleur aussi pâle que possible. Le veau, avec une alimentation normale, a une couleur rosée. Le veau anémié a une couleur blanche. La seule justification – c'est indiqué sur le site du ministère de l'Agriculture – est la satisfaction du consommateur.
En termes de bien-être animal, cela pose des questions majeures. Certains auteurs ont considéré que cet élevage est l'un des plus terribles qui soit sur le plan éthique. Ce n'est pas forcément le sujet de la note, mais ce débat sur la couleur rouge ou pas, le sujet de l'élevage du veau, est bien là. C'est ce à quoi m'a fait penser l'évocation du curcuma, excellent condiment mais dont l'acceptabilité est faible dans la mesure où il affecte la couleur rouge de la viande. Ici comme ailleurs, quand nous disons « acceptable », il faut être clair : parlons-nous du critère de santé, du critère de l'appétence du consommateur ou d'autres critères ? Pour l'OPECST surtout, il faut déterminer ce que nous entendons par « acceptable ».
Même si la note inclut la viande de porc dans le périmètre de la viande rouge, elle se concentre sur le bovin plus que sur les autres mammifères. Ceci est parfaitement légitime car, tant en matière d'impact environnemental que de gaz à effet de serre, d'aménagement des pâturages, de déforestation importée, etc. l'élevage bovin a les impacts les plus importants. C'est moins évident pour ce qui concerne la pollution. Le débat sur ce dernier sujet est très animé en Bretagne, mais nous n'allons pas nous y lancer maintenant. C'est moins évident également si l'on inclut dans la notion d'environnement le critère du bien-être animal. Celui-ci n'est pas tellement problématique pour l'élevage bovin, il l'est beaucoup plus pour l'élevage porcin. Donc lorsque nous parlons d'environnement, quel périmètre donnons-nous à ce mot ? Cela se limite-t-il au paysage et au bilan carbone ? Si cela exclut le bien-être animal, disons-le clairement, parce que c'est un tout autre débat, pour lequel il est impossible de ne pas évoquer le cas du porc, qui est l'un des plus sensibles.
La question des labels a été évoquée, à très juste titre, par l'un de nos collègues. Il faut là aussi être clair sur le fait que la note exclut cette question de son périmètre.
Chacun sait que la méthode d'évaluation d'un impact environnemental est sujette à débat. Il faut donc être très rigoureux. Je prends pour exemple l'étude du Boston Consulting Group (BCG) mentionnée par la référence bibliographique n° 26. Vous n'ignorez pas que le BCG a fait l'objet de certaines controverses. Or son travail s'appuie forcément sur des études scientifiques. Autant citer directement les études sur lesquelles il se fonde. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a aussi pris position pour la réduction de la viande rouge dans l'alimentation, se basant sur d'autres chiffres. Référons-nous autant que possible aux sources et aux articles originels.
J'attire l'attention sur l'intérêt de donner aux éléments chiffrés leur précision la plus pertinente. Lorsqu'il est avancé qu'en France, en 2015, 4 380 cancers étaient attribuables à la consommation de viande transformée et 2 031à la consommation de viande rouge, il ne s'agit pas d'un diagnostic – relatif à la pathologie – mais d'une estimation – relative à sa cause. La précision d'une telle estimation n'est donc pas l'unité. Il vaut mieux dire « environ 2 000 » plutôt que « 2 031 ». Si la précision affichée excède ce qui est pertinent, le débat est faussé. C'est le matheux qui parle.
Dans le même registre, les conclusions que l'on peut tirer d'une analyse de cycle de vie sont très variables selon les paramètres utilisés – cela a donné lieu à quelques débats dans l'hémicycle ces jours-ci. Si l'on s'intéresse à l'efficacité seulement, l'analyse de cycle de vie pousse à des croissances rapides. Pour les animaux, ceci signifie des durées de vie courtes, avec des répercussions évidentes en termes de condition animale. Ce n'est pas le débat ici, mais il est clair qu'un poulet abattu après quarante et un jours en élevage intensif a un bien meilleur bilan au regard du cycle de vie que le poulet Label rouge qui a une durée de vie et d'élevage bien plus longue. Il faut donc faire attention à la méthode utilisée, l'afficher et dire quels critères ont été retenus.
Gérard Longuet disait : « Pourquoi pas deux notes ? » Pourquoi pas, en effet ? Mais à tout le moins, clarifions encore davantage le périmètre, les définitions, les critères, les enjeux de la note présente. Ceci lui permettra d'ailleurs d'améliorer sa visibilité et de la rendre plus accessible.
Un dernier point, à propos de la corrélation entre consommation de viande et niveau de vie, avec la référence faite à une étude de l'OCDE. C'est certainement une chose à nuancer. Les études montrent qu'en France, les personnes ayant de bas revenus ont une consommation de viande supérieure aux autres. Des études similaires existent aux États-Unis, dont l'une, spectaculaire, faite à partir d'analyses de la composition protéique des cheveux, qui montre une consommation de protéines animales plus élevée pour les bas revenus que pour les hauts revenus. Selon que les classements sont effectués entre pays ou, au sein d'un même pays, par catégories socioprofessionnelles (CSP), ils sont différents. Ce sont les grandes complexités qui résultent de ce qui est avant tout une pratique culturelle, avec de nombreuses composantes.
Je trouve moi aussi que la note est passionnante, sur un sujet dont elle montre très bien la complexité. Je félicite le rapporteur pour ce travail.
Il est beaucoup question des échanges commerciaux internationaux, du CETA (Comprehensive and Economic Trade Agreement), du Mercosur, etc. La question de la viande y est très prégnante, notamment l'arrivée massive de viande bovine sur le territoire européen, notamment français, y compris des morceaux nobles comme l'aloyau, qui viendrait concurrencer les productions nationale et européenne.
Quelle est la production acceptable à l'échelle d'un pays ? Devons-nous maintenir des échanges agroalimentaires dans les échanges internationaux ? Nous pourrions en effet justifier d'une production suffisante au niveau européen ou au niveau national, par exemple l'autosuffisance, et ne pas faciliter ou permettre l'arrivée massive sur notre continent de ces tonnes de viande qui ajoutent une note extrêmement « salée » au bilan carbone, au-delà de ce qui a été mis en évidence sur la façon de produire et sur les conséquences de la production et de l'élevage en matière environnementale.

C'est une excellente question, sur un sujet extrêmement polémique.
Je repense à ce qu'évoquait Gérard Longuet il y a quelques instants sur la consommation de viande. Parfois, il y a des surprises, un grand décalage entre les images que nous pouvons en avoir et la réalité. Pour la petite histoire, nos collègues archéologues ont découvert il y a quelques années que les gladiateurs de l'Antiquité étaient essentiellement végétariens, avec quelques mini-apports animaux ; on est loin de l'image de consommateurs de viande que nous pourrions poser sur des symboles de l'action guerrière.

Je vais essayer d'éclairer les collègues sur un certain nombre de questions posées. Je n'ai malheureusement pas les éléments pour répondre à toutes.
En réponse à la question de Philippe Bolo concernant l'étude Clim'Agri, le tableau montre que la « ferme France » produit 109 millions de tonnes équivalent CO2, et l'élevage 48 % de ces émissions. Je n'ai pas d'informations sur l'impact de l'élevage sur l'hydrologie d'un bassin-versant. J'avais vu une étude sur l'effet de l'élevage sur la biodiversité, mais elle avait été réalisée sur commande de l'ancienne région PACA et c'était plutôt une démonstration pro domo. Je ne l'ai pas reprise parce que c'était assez polémique.
S'agissant de l'impact sanitaire de la consommation de viande, « c'est la dose qui fait le poison ». Pour l'impact environnemental, c'est la même chose : plus vous chargez en animaux, plus il y a d'impacts négatifs sur l'environnement dans tous les domaines, y compris sur la biodiversité. Pour maintenir un équilibre, il faut donc des chargements faibles sur les pâturages. Cela répond également à la question posée sur le pastoralisme, qui est extrêmement bénéfique à condition d'avoir des chargements permettant à l'ensemble de la nature d'être respecté.
Cédric Villani a déjà répondu en partie à la question « qu'en est-il si nous ne consommons pas de viande ? » Il y a également des éléments de réponse dans le tableau du Programme national nutrition santé : il en ressort qu'il faut rechercher des sources de protéines dans les légumes secs, en particulier les légumineuses – lentilles, etc. – et dans les fruits à coque, ce qui est peut-être moins connu. 100 grammes de noix, par exemple, apportent autant de protéines que 100 grammes de viande et, par ailleurs, apportent énormément d'oméga 3 bénéfiques. L'alimentation végétale est possible, mais elle suppose du discernement. Si je délaisse mon steak pour ne manger que de la purée, cela ne convient pas.

C'est un ensemble qu'il faut revoir, ce qui suppose tout de même d'avoir une démarche intellectuelle rigoureuse en parallèle.
Notre collègue Jean-Luc Fugit a évoqué le bio. Une note de l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) analyse l'impact du bio. Quand je regarde le tableau produit par l'INRAE, il y a là aussi matière à controverse. Il y a bio et bio. Je pense que le système d'agriculture biologique le plus équilibré est celui de polyculture-élevage. Or le bio ne peut être que de la culture. Les impacts sont différents. Avec le système polyculture-élevage, l'apport très intéressant des déjections animales permet de stimuler le cycle de l'azote donc de maximiser la fixation du carbone dans les sols, ce qui favorise l'apparition d'un équilibre. Selon leurs modalités, les effets de l'agriculture biologique sont plus ou moins bénéfiques. En revanche, il est évident que la pression que provoquent les engrais chimiques disparaît totalement dans l'agriculture biologique, puisqu'ils sont proscrits.
Sur la gestion de la méthanisation, il faut là aussi être très professionnel, par exemple pour ne pas avoir de fuites de méthane, qui sont extrêmement négatives en termes de bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Je ne sais pas si les programmes des lycées agricoles incluent un travail sur l'alimentation. C'est un point qu'il faudrait regarder de plus près. Je sais, en revanche, que dans certaines fermes expérimentales accolées aux lycées agricoles, des installations de méthanisation permettent de démontrer la valorisation des déjections.
La brique eau-air-sol est ce qui est en train de se construire à travers les écoschémas de la politique agricole commune. J'ai lu ce matin dans La France agricole un article où il est dit que le ministère de l'Agriculture veut interdire l'épandage de lisier à travers des buses à palettes, qui permettent d'épandre très largement le lisier en le projetant dans l'air, en faveur de systèmes permettant son enfouissement. Mais en enfouissant dans les prairies, détruit-on ou non le couvert végétal ? Il y a peut-être des limites techniques, mais une orientation politique est donnée dans le sens d'une moindre émanation de gaz à effet de serre lors de l'épandage des lisiers et du traitement des odeurs.
J'avais vu une étude sur l'impact de l'élevage sur les estives, sujet qu'a évoqué notre collègue Pierre Médevielle. Je n'ai pas pu suffisamment creuser cet aspect des choses et je n'ai donc pas trouvé d'éléments scientifiques solides. De tels éléments, de telles études doivent exister à l'INRAE et dans d'autres centres de recherche, comme l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) qui a peut-être des éléments, notamment en matière de valorisation des photos aériennes.

L'IRSTEA est d'ailleurs intégré désormais dans l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), après la fusion de l'INRA et de l'IRSTEA.

Notre collègue Ludovic Haye s'est intéressé à la qualité de la viande. J'ai effleuré ce sujet lorsque j'ai parlé de la modification des rations des bovins, par exemple avec l'introduction de graines de lin. C'est la démarche appelée Bleu-Blanc-Cœur, qui permet une amélioration intrinsèque de la qualité de la viande, y compris une diminution des émanations entériques. Il faudrait approfondir et chercher si des études scientifiques existent sur la relation entre santé et environnement et les démarches de production. Il doit probablement y en avoir. En revanche, le risque est le même : ce sont des démarches menées par des entreprises, des filières, et il n'est pas toujours évident d'avoir un regard objectif.
Je suis tout à fait d'accord avec Angèle Préville sur l'intérêt d'ajouter des diagrammes à la note. Il faudra seulement y trouver un peu de place.
Gérard Longuet a évoqué la distribution par âge de la consommation de viande. J'ai échangé avec Philippe Bolo avant le début de la réunion et il me disait que les enfants consomment effectivement moins de viande. L'évolution des habitudes alimentaires, les moments où l'on consomme tel ou tel produit, la forme du produit consommé, etc. est un sujet qui mériterait un éclairage à part entière. En France, le steak haché est un enjeu très important, parce que cela permet de valoriser les quartiers moins nobles de la bête et de rééquilibrer la balance économique de l'ensemble du bovin. C'est néanmoins un sujet difficile.
Sonia de La Provôté a évoqué le commerce de la viande. J'avais abordé ce sujet dans l'un de mes rapports sur le budget du commerce extérieur. Le secteur de la viande est souvent utilisé comme monnaie d'échange dans les négociations commerciales, parce que la valeur de la viande, notamment bovine, est très élevée rapportée à son poids. Les effets sur le climat de ce commerce alimentaire ne sont pas pris en compte, et c'est regrettable – la France souhaite que cela le soit davantage à l'avenir. Cela fait partie des discussions aujourd'hui engagées à la Commission européenne pour changer les règles du jeu des négociations commerciales internationales. Ce n'est pas gagné. Cela prendra du temps, mais l'orientation est prise.
Je remercie Cédric Villani pour toutes ses remarques et suggestions visant à réorganiser le propos, qui mérite d'être plus clair sur certains points. La dimension culturelle est étudiée, par exemple, par l'université de Tours – qui, d'ailleurs, s'appelle Rabelais. Elle a développé une charte sur l'alimentation, dans le sillage du classement de la gastronomie française au patrimoine de l'Unesco. Elle a notamment fait un travail historique qui répondra aux questions de Gérard Longuet, et un travail prospectif sur l'évolution des modes alimentaires et la façon de consommer.
Nous avons parlé du végétarisme et des définitions chimiques. Quand j'évoque l'acceptabilité du curcuma, je cite en fait Fabrice Pierre, de l'INRAE de Toulouse, qui a été auditionné. Une viande de couleur jaune ne suscite pas forcément d'appétence, sauf le poulet au curry qui a une couleur jaune très prononcée et que nous consommons fréquemment. Pour les autres types de viande, le consommateur ne semble pas être prêt aujourd'hui. Je ne faisais que citer, et le mot « acceptabilité » n'était pas un commentaire de ma part.

Je suis tout à fait d'accord pour que nous le gardions. Mais il faut préciser ce que nous entendons par « acceptabilité ».

En travaillant préférentiellement sur le bovin, je me suis retenu de travailler davantage sur le porc. J'en avais pourtant très envie. D'ailleurs, j'ai auditionné la coopérative Cooperl, qui est, à mon sens, un laboratoire à grande échelle de toutes les évolutions possibles en matière d'élevage et de traitement des effluents directement à la ferme. Soit ils sont enlevés le plus rapidement possible pour éviter la fermentation sur place, en particulier les émanations d'ammoniac, soit ils sont traités dans des stations de méthanisation pour valoriser l'énergie sous-jacente. Un projet de séchage des effluents de méthanisation – par la chaleur produite en amont de la méthanisation – est en cours de développement, l'idée étant de faire des engrais organiques qui pourraient ensuite être commercialisés, par exemple pour les zones de grande culture. Je cite dans la note un projet de construction d'une usine pour valoriser les déchets gras des industries alimentaires rattachées à cette coopérative et les transformer en un biocarburant qui sera utilisé par les camions de livraison de l'entreprise.
Il existe donc une réflexion sur l'ensemble du cycle du carbone à l'échelle d'une coopérative, dans le cadre de la filière porcine. Ceci n'est malheureusement pas possible pour l'élevage bovin en raison de sa dispersion géographique et des difficultés d'organisation de la filière – par exemple, les coopératives y sont peu présentes. Un abattoir comme l'entreprise Bigard réalise 45 % de l'abattage de bovins en France et n'est pas forcément inclus dans la démarche d'analyse du cycle complet de la production. Par ailleurs, le bovin subit une grave crise de positionnement commercial. Mais c'est un autre débat qui rejaillit sur les discussions de la politique agricole commune.
Par un raccourci, j'ai cité le Boston Consulting Group, mais nous allons remonter aux sources.
Pour ce qui concerne la référence OCDE sur le lien entre consommation et niveau de vie, je dispose d'un tableau détaillant la consommation de viande par décile de revenu, où apparaît le fait qu'aujourd'hui les catégories de populations les moins sensibles au message de modération sur la consommation de viande sont justement celles qui sont dans les basses échelles de revenus. La tendance de fond des années 1980-1990 – plus je suis riche, plus je mange de viande – reste encore très présente dans les esprits. Pourtant, les hauts revenus sont entrés dans une autre démarche, considérant que pour la santé et pour l'environnement, un peu moins de viande et plus d'autres aliments serait peut-être plus bénéfique.

Je remercie notre rapporteur Antoine Herth d'avoir apporté des réponses et des réactions à tous les commentaires qui ont été formulés. Je vous propose de donner un accord de principe à la publication de la note, sachant que le rapporteur va en retravailler la forme et tenir compte de tous nos échanges pour établir une version finale qui vous sera communiquée très bientôt.
Je voudrais faire part d'une réflexion de pédiatre, suite à ce qu'a dit Gérard Longuet sur la croissance. Chez l'enfant, il faut tout de même envisager très souvent des anémies liées à une carence en viande ou acide folique, par exemple chez les enfants qui ne boivent que du lait de chèvre. Il faut donc faire une place spécifique à l'enfant lorsqu'on veut apprécier l'intérêt nutritionnel de la viande rouge. Très souvent, les pédiatres sont confrontés à des anémies. Leur conseil est de manger du bœuf bien cuit, de bien prendre le fer héminique avec le jus de bœuf et, par ailleurs, de manger du boudin.
C'était la petite nuance que souhaitait apporter une sénatrice élue dans une terre qui produit une viande de qualité, en particulier le bœuf de Bazas, remarquable par sa qualité gustative. Bien que cher, il dégage une faible rentabilité en raison des contraintes associées à l'élevage extensif. Il ne faut pas abandonner nos atouts gastronomiques et nos produits de qualité, même si c'est relativement confidentiel. Il vaut mieux manger de la viande de très bonne qualité, comme la race bazadaise, mais en moindre quantité, ce qui est le cas puisqu'elle est à vrai dire très chère.

À titre personnel, je partage tout à fait cette idée du « manger moins, manger mieux ». Sur les recommandations pédiatriques, je suis tout à fait d'accord pour considérer la place spéciale des enfants. Quoi que nous publiions, il faut cependant s'appuyer sur des études, des articles scientifiques, qui ne seront pas forcément faciles à récupérer. En tout cas, il est certain que la France est très en retard sur ce sujet par rapport à d'autres pays.
Les références sont sur le site Internet de l'Association française de pédiatrie ambulatoire.

Merci beaucoup pour cette précision. En votre nom à tous, j'adresse une nouvelle fois nos félicitations à notre collègue Antoine Herth.
L'Office autorise, à l'unanimité, la publication de la note scientifique « Les enjeux sanitaires et environnementaux de la viande rouge ».
Audition publique sur « Les symptômes prolongés après un Covid, ou “Covid long” » (Jean-François Eliaou, Florence Lassarade, Sonia de La Provôté, Gérard Leseul, rapporteurs)

Mes chers collègues, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) organise aujourd'hui une audition publique et interactive, selon nos usages, qui va concerner le Covid. Elle sera consacrée à ce sujet particulièrement sensible, encore entouré d'une part de mystère, qu'est le « Covid long », situation où certains des symptômes associés au Covid peuvent durer plus d'un mois, voire plus de six mois, après que l'individu a été guéri de l'infection virale.
Cette audition sera animée par les quatre rapporteurs de la mission Covid : Gérard Leseul, Sonia de La Provôté, Florence Lassarade et Jean-François Eliaou, qui ont pour mission de recueillir toutes les informations nécessaires auprès de nos invités. J'ajouterai mon grain de sel de temps en temps et Gérard Longuet fera de même s'il le souhaite. Je me chargerai aussi de proposer une brève synthèse des échanges à la fin de l'audition.
Ont été conviés à cette audition publique :
Merci beaucoup de donner la parole aux patients, surtout pour un sujet aussi important que le Covid long.
Je suis ingénieur en nutrition. Je finissais ma thèse sur le comportement alimentaire et l'obésité quand j'ai eu le Covid en mars dernier. Je n'ai malheureusement pas guéri, comme de nombreux patients. C'est pour cela que j'ai participé à la création de l'association Après J-20, association Covid long France. Elle porte le nom « Après J-20 » parce qu'on nous avait dit qu'au bout de vingt jours nous serions guéris, que ce serait fini. Or ce n'était pas le cas pour de nombreux patients.
Nous avons créé l'association en octobre 2020. Un peu plus de 700 adhérents nous suivent maintenant. L'association a pour but de fédérer et d'informer sur le Covid long. Je précise que c'est une demande des patients comme des médecins. Notre association collabore avec les patients, les médecins, les chercheurs et les institutions pour apporter un soutien aux patients et de la connaissance sur le Covid long.
Nous nous sommes formés en octobre et notre message principal était que le Covid-19 concerne tout le monde. Malheureusement, nous portons toujours le même message aujourd'hui. En effet, on parle souvent du Covid-19 pour dire qu'il y a des hospitalisations, des décès ou des cas asymptomatiques, mais c'est beaucoup plus nuancé que cela : il y a aussi tous les patients qui n'ont pas guéri, donc les patients Covid long. À présent, le Covid long est un peu mieux compris, même si la communication est encore insuffisante. Il a été reconnu par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et par la HAS avec qui nous avons collaboré pour écrire des réponses rapides sur le Covid long à destination des médecins généralistes.
Qu'est-ce que le Covid long ? Pour résumer en quelques mots, cela correspond à des symptômes prolongés, fluctuants et multisystémiques. Multisystémique signifie que cela touche plusieurs organes, plusieurs fonctions, et que les problèmes sont donc de nature respiratoire, cardiaque, neurologique, vasculaire, dermatologique, ORL, digestive, etc. Cet ensemble de symptômes caractérise le Covid long. Par « fluctuant » – c'est aussi ce qui est difficile pour les patients –, on entend le fait que les symptômes peuvent apparaître au début de la phase aiguë, disparaître puis revenir. Le Covid long, ce sont donc ces symptômes prolongés, fluctuants et multisystémiques qui se sont développés pendant la phase aiguë et qui apparaissent ou persistent après quatre semaines.
L'autre point important à mentionner est qu'un test positif – PCR ou sérologique – ne doit absolument pas être un prérequis pour poser un diagnostic de Covid long. Cela a été bien expliqué par la HAS dans sa recommandation, mais ce n'est pas encore bien compris par la population générale. Pourtant, nous savons maintenant qu'un test n'a de valeur médicale probante que s'il est positif. Quand il est négatif, cela ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de Covid, et c'est pour cela que nous avons besoin d'une compréhension globale du Covid long, de manière prolongée, fluctuante et multisystémique pour diagnostiquer un patient. Cette précision est importante car cela a un impact sur les soins : beaucoup de patients n'ont pas accès aux soins du fait d'un test négatif. Je laisserai les médecins et les chercheurs l'expliquer bien mieux que moi, mais nous savons par exemple qu'en matière de sérologie, tout le monde ne développe pas d'anticorps et que ceux-ci peuvent disparaître avec le temps.
La question de la prévalence a quelque temps été posée : le Covid long est-il une maladie rare ? Ce n'est pas du tout une maladie rare ou franco-française, c'est un problème de santé mondial. L'OMS a déjà fait plusieurs réunions à ce sujet, auxquelles nous avons été conviés ; elle a parlé de millions de patients Covid long. Il est toujours compliqué de donner des chiffres de prévalence parce que les études actuelles se fondent sur des populations différentes. Mais l'on peut dire que 10 à 30 % des patients qui ont eu un test Covid positif ont une forme longue de la maladie.
Par ailleurs, nous ne parlons pas du Covid mais des Covid longs. Plusieurs phénotypes pourront être expliqués par la physiopathologie, malheureusement encore peu comprise, et des hypothèses existent, que Dominique Salmon présentera.
Pour finir sur la définition du Covid long, il est important de rappeler les symptômes, qui ont été bien étudiés en France et à l'étranger ; en France, par exemple, l'étude ComPaRe a identifié au moins 53 symptômes rapportés par les patients : fatigue terrassante – qui n'est pas juste une fatigue apparue parce que nous avons un peu travaillé, mais une fatigue empêchant de réaliser les actes du quotidien –, brouillard mental, soit l'impossibilité de penser clairement, maux de tête, pertes de mémoire, troubles thoraciques, tachycardies, diarrhées, douleurs articulaires, etc. Ce sont des symptômes multisystémiques et invalidants pour les patients.
S'agissant du ressenti des patients, donc la voix des malades, notre association recueille chaque jour des dizaines de témoignages sur nos différents réseaux sociaux et sur nos messageries électroniques. Nous avons classé ces témoignages sous trois thèmes caractéristiques de ce que les patients nous rapportent.
Le premier thème est l'impact de la gestion du Covid long sur le ressenti des malades. L'absence de reconnaissance et de soins, la mécompréhension du Covid long ont vraiment eu un impact sur les malades. Ceux-ci rapportent que la maladie est stigmatisée en problème psychique, qu'ils ne se sentent pas écoutés ni crus par les médecins, qu'ils ont un sentiment d'abandon, de perte de confiance, d'isolement. On leur dit que c'est dans leur tête parce que leur sérologie est négative. Ils font des dépressions. Je cite là ce que les patients nous rapportent. Il y a donc un vrai problème de compréhension de la maladie, qui sera remédiable par la recherche et par la découverte des causes de la maladie. Les patients rapportent ce manque de reconnaissance, cette errance médicale, cette sensation d'être des malades imposteurs, cette culpabilité d'être malades, même si le guide de la HAS a apporté un progrès ; malheureusement, il n'est pas connu de tous. Il faut donc accomplir un important travail de communication sur le Covid long, notamment sur ses fondements biologiques. Ce n'est pas du tout une maladie psychosomatique.
Le deuxième thème caractéristique est l'impact sur la santé physique et mentale. Le point commun à tous les témoignages est que le Covid long est un ensemble de symptômes prolongés invalidants. Évidemment, il existe des nuances, un prisme, une intensité variable selon les malades, mais beaucoup rapportent un réel handicap dans la vie de tous les jours, une réduction de leur autonomie, de leur force dans les activités quotidiennes. Par exemple, je cite : « si je veux prendre une douche mais que je sais qu'il peut y avoir un malaise post-douche, alors je ne prendrai pas de douche ». L'évocation d'un malaise post-effort revient souvent. Ce sont des malaises qui apparaissent directement après une activité cognitive ou physique et qui empêchent les patients de vivre normalement leur vie quotidienne.
Il existe aussi un impact sur la santé mentale. Des patients rapportent des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la dépression, du stress, comme conséquence de la maladie, des symptômes invalidants et de l'errance médicale, du manque de compréhension vis-à-vis de leur entourage.
Enfin, la dernière catégorie de témoignages rapportés par les patients concerne les conséquences du Covid long sur la vie au travail, dans les études, auprès de leur famille, de leurs proches. Ils rapportent une précarisation. Beaucoup de patients ont perdu leur emploi. L'aspect financier, l'impact économique, est important du fait de l'incapacité à avoir une vie normale, physique ou cognitive. Cela impacte aussi la vie de famille, par exemple pour des parents qui sont fortement touchés et qui ont donc des problèmes pour s'occuper de leurs enfants, pour cuisiner, pour s'occuper des tâches quotidiennes. Ces personnes demandent par exemple des congés qui ne sont pas acceptés.
Enfin, demeure l'incertitude quant aux séquelles. Le fait que les symptômes du Covid apparaissent, reviennent, disparaissent, s'étendent sur le long terme – sur plus d'un an pour la plupart des Covid –, le fait qu'il n'y ait pas de visibilité sur l'évolution des symptômes, tout ceci crée une incertitude difficile à vivre pour la majorité des patients.
À présent que nous avons vu ce qu'est le Covid long en tant que maladie, avec ses symptômes fluctuants, multisystémiques et prolongés, et les plaintes des patients avec ces trois caractéristiques majeures, je vais vous parler rapidement des propositions qui nous paraissent importantes à partager en tant qu'association de patients. Ces propositions sont au nombre de quatre, et sont les objectifs de l'association : la reconnaissance du Covid long, la mise en place de soins pluridisciplinaires dans tous les territoires, une communication vers le grand public et le médecin, et le développement de la recherche sur la cause du Covid long.
Il nous paraît important que la reconnaissance soit concrétisée. Pour concrétiser ce qui a été commencé par le guide de la HAS, il faudrait par exemple instituer une « affection de longue durée (ALD) Covid long », qui a sa justification, parce que le Covid long est maintenant bien caractérisé. C'est une maladie longue durée qui nécessite un traitement coûteux et prolongé de plus de six mois. Obtenir une ALD permettrait de faciliter la prise en charge des soins et d'éviter la précarisation des personnes atteintes de Covid long. Je ne l'ai pas beaucoup mentionné, mais il y a aussi la reconnaissance du Covid long pédiatrique, qui malheureusement est peu connu actuellement, mais dont beaucoup de personnes, notamment des parents, nous rapportent l'existence.
Au niveau des soins, il est nécessaire d'avoir un parcours pluridisciplinaire mieux organisé. Nous espérons donc un parcours de soins pluridisciplinaires pour que le malade puisse aller voir son médecin généraliste. Nous souhaitons un médecin coordinateur avec des médecins spécialisés Covid long pour faciliter la prise en charge et le soin du Covid long.
Pour ce qui concerne la communication, c'est simple : il doit y avoir une communication globale vers le grand public, comme pour les vaccins et l'hospitalisation. Il faut aussi parler du Covid long, qui fait partie de l'image, de la compréhension globale du Covid. Cela permettrait d'en faciliter la compréhension chez les médecins et le grand public.
Pour la recherche, le plus important sujet de notre liste, il faut absolument des financements français spécialisés sur le Covid long, notamment sur la physiopathologie, pour expliquer d'où viennent les symptômes, pourquoi certains sont malades et pas d'autres, etc. C'est vraiment important, car tant que nous ne saurons pas cela, nous ne pourrons pas spécialiser les traitements.
L'Angleterre a décidé de consacrer 20 millions d'euros spécialement au Covid long, et les États-Unis 1,2 milliard d'euros. Il est essentiel que des financements soient aussi dégagés en France sur la physiopathologie du Covid.

Merci beaucoup, madame Oustric, pour cette intervention qui pose bien le débat dans toutes ses dimensions. Pour la clarté des débats, pour celles et ceux qui nous regardent, pouvez-vous juste rappeler ce qu'est qu'une ALD ?
Une ALD est une « affection de longue durée ». Les médecins seront mieux placés que moi pour en parler. Dans le cas où une maladie est reconnue comme ALD, les soins des patients sont pris en charge intégralement par l'assurance-maladie.
Merci beaucoup d'avoir organisé cette audition. Je suis médecin interniste à l'hôpital Bicêtre et je représente ici un groupe d'étude pluridisciplinaire, le groupe COMEBAC, acronyme de « consultation multi-expertises de Bicêtre – hôpital dans lequel je travaille – après Covid ».
Cette organisation pluridisciplinaire est née au détour de la première vague, où nous avons accueilli à Bicêtre beaucoup de patients atteints de Covid, comme beaucoup d'hôpitaux à ce moment-là. La question naturelle qui s'est posée était : que deviennent les patients que nous avons vus ?
Dans ce propos liminaire, je vais uniquement insister sur ce qui survient après l'hospitalisation. Cela va être important dans la discussion. Je ne parlerai pas de tout ce qui concerne les patients non hospitalisés, mais il y a des convergences de lutte. Mme Oustric l'a bien rappelé.
Nous avons accueilli à Bicêtre, à ce moment-là, 1 151 patients entre début mars et fin mai 2020. La question s'est posée de reconvoquer ces patients. Nous étions dans une situation hospitalière extrêmement tendue, mais il fallait que nous trouvions les moyens de le faire. En premier lieu, nous nous sommes dit que nous allions appeler les patients qui avaient été hospitalisés. Nous les avons listés afin de voir ceux que nous pouvions joindre par téléphone. Sur les 851 patients, nous en avons retrouvé 834 éligibles à la téléconsultation. Sur ces 834, nous avons réussi à en joindre 478. Le traçage est un point important.
478 patients ont donc été vus en téléconsultation, que nous avons appelée COMEBAC. L'objectif de cette téléconsultation était de recenser les symptômes éventuels qui persistaient. Nous ne connaissions pas vraiment le Covid long à ce moment-là, mais nous avions évidemment l'idée que des symptômes persistaient. Dans cette téléconsultation, nous avons posé aux patients des questions très standardisées sur leur condition générale, leur condition respiratoire, leur condition psychologique, la mémoire, etc., tout ce qui est symptômes persistants.
Nous avons remarqué que chez 51 % des 478 patients contactés par téléphone, soit 244, il existait au moins un symptôme persistant ou nouvellement apparu, ce qui est considérable. Au premier rang de ces symptômes : la fatigue, chez un tiers des patients. Nous retrouvions aussi des difficultés de mémoire – Mme Oustric en a parlé – chez 10 à 20 % des patients, qu'il s'agisse de la concentration, de l'attention ou d'une lenteur de la mémoire, l'essoufflement chez 16 % des patients et des fourmillements pour 12 %.
Je précise qu'il s'agit de patients qui ont été hospitalisés en soins critiques ou hors soins critiques, sachant que, dans d'autres temps, nombre des patients hospitalisés hors soins critiques auraient été admis en soins critiques, ce qui relève de soins très importants alors que nous manquons de places.
Après la téléconsultation, tous les patients qui présentaient des symptômes devaient être vus physiquement dans une structure d'hôpital de jour. Grâce à l'infrastructure de l'hôpital Bicêtre et aux efforts consentis par cet hôpital, nous avons revu 177 des patients joints par téléphone, certains ayant refusé de venir, d'autres étant suivis ailleurs sur différentes consultations déjà en place, et d'autres ne nécessitant pas forcément d'être revus.
Sur les 177 patients revus, 97 étaient passés en soins critiques, 80 hors soins critiques. Nous avons évalué leur condition générale. Parmi les symptômes principaux recensés, nous retrouvons une fatigue significative et un impact de la fatigue mentale chez un nombre considérable de patients, une altération de la qualité de vie, notamment due à une limitation des activités physiques, un manque de vitalité et un ressenti dans l'état général.
Nous avons évalué la condition respiratoire par deux aspects. Au niveau des symptômes, il est à noter qu'un nouvel essoufflement est apparu au moment de l'hospitalisation, qui n'était pas présent auparavant, persistant chez 78 patients, soit 16 %. Nous avons voulu voir si cela pouvait être lié à des anomalies persistantes visibles sur un scanner du poumon, le Covid impactant les poumons : 56 % des patients présentaient un nouvel essoufflement avec des anomalies persistantes au scanner, ce qui signifie que 44 % n'avaient pas forcément ces anomalies. Nous constatons une respiration dysfonctionnelle, appelée syndrome d'hyperventilation, chez 18 à 20 % des patients, ce qui est considérable. Ce sont des patients pour lesquels il faut prendre en compte l'essoufflement alors même que l'imagerie est normale. Pour certains médecins, c'est un élément nouveau. Je reprends le thème de la communication, dont cela fait partie.

Dans la moitié des cas environ, vous voyez quelque chose à l'imagerie et, dans une autre moitié des cas, vous ne le voyez pas. C'est bien cela ?
C'est exactement cela.
Ensuite, nous avons évalué les conditions psychologiques de manière standardisée L'impact sur les symptômes psychiatriques est important. Les tests faits à ce moment-là ne permettent pas toujours de poser des diagnostics. C'est une notion importante lorsque nous faisons des questionnaires psychiatriques. Des symptômes anxieux étaient présents chez 31 % des patients revus en hôpital de jour ; des symptômes de dépression étaient vus chez 20 % des patients ; une insomnie persistante chez 53 % des patients ; des symptômes de stress post-traumatique étaient retrouvés chez 14 % des patients environ.
Nous avons également évalué la condition cognitive, c'est-à-dire la mémoire, la concentration. Une plainte cognitive a été notée chez la moitié des patients revus physiquement. C'est une plainte subjective. Un trouble cognitif, au travers de différentes échelles de dépistage, existe chez 38 % des patients.
Ces résultats ont été publiés récemment dans le Journal of the American Medical Association (JAMA). Nous avons évalué ces éléments. Les patients vus depuis novembre vont également être réévalués – je parle à nouveau de patients hospitalisés.
Nous n'avons pas vu énormément de différences entre des patients qui étaient hospitalisés en soins critiques et d'autres patients. Dans notre méthodologie subsiste un biais : nous avons systématiquement revu les patients en soins critiques mais nous n'avions pas la possibilité de faire plus.
Je reprendrai certains des propos de Mme Oustric, qui sont importants. Nous avons voulu nous placer dans une démarche pluridisciplinaire au travers de cette consultation multi-expertise, qui est nouvelle dans nos thématiques. Nous travaillons souvent ensemble, mais en l'espèce c'était la première fois – et cela continue – que nous réunissions autour d'une même table à Bicêtre, des psychiatres, des neurologues, des pneumologues, des internistes, des infectiologues, des réanimateurs, qui ont moins cette culture de la consultation post-réanimation en France. Pourtant, nous nous rendons bien compte que c'est important. Évidemment, ces soins pluridisciplinaires nécessitent des moyens, une organisation, et mobilisent des psychologues, des infirmières, des kinésithérapeutes, des médecins, des locaux, etc. Nous répondons à divers appels d'offres mais il faut probablement quelque chose de plus pérenne.
Enfin, le Covid long soulève des questions importantes en termes de recherche sur la physiopathologie et les traitements, médicamenteux ou non, tels que l'accompagnement, le suivi psychologique ou le suivi kinésithérapeute de ces patients.
Merci beaucoup de m'avoir proposé d'intervenir lors de cette audition sur le Covid long. Je suis neurologue à l'hôpital Delafontaine, où nous avons organisé un registre d'évaluation des manifestations neurologiques de la maladie lors de sa phase aiguë en 2020. Nous avons observé, grâce à cette étude prospective, que le Covid avait un impact sur le système nerveux, notamment à cause d'accidents vasculaires cérébraux, d'encéphalites ou d'encéphalopathies fréquentes et sévères, de syndromes de Guillain-Barré, avec des paralysies des quatre membres, ce que nous avions vu de façon assez fréquente avec le Zika, par exemple. Nous avons encore observé d'autres manifestations, assez nombreuses, éventuellement liées à la réanimation comme les neuromyopathies de réanimation, etc.
Avec autant d'atteintes possibles au système nerveux, entre 8 et 13 % des malades hospitalisés vont être touchés en phase aiguë, après laquelle s'ensuivront une convalescence et des séquelles, éventuellement définitives. Ce n'est pas de cela dont nous allons parler aujourd'hui.
En effet, en dehors de ces séquelles, diverses manifestations suivent la phase aiguë, éventuellement après une phase de récupération post-aiguë. Ces manifestations sont apparues suffisamment multisystémiques et relativement stéréotypées pour déclencher mondialement la désignation d'une nouvelle pathologie, « Covid long » ou « manifestation post-Covid », dont les principales caractéristiques sont qu'elle touche plusieurs domaines, comme le domaine cardiothoracique, le système nerveux, les troubles digestifs, les troubles dysautonomiques, les symptômes cutanés, la fièvre.
Des symptômes neurologiques ont été enregistrés, parmi les patients du professeur Salmon à l'Hôtel-Dieu, dans 70 % des cas. Dans ce contexte, nous avons organisé à l'hôpital de Saint-Denis une consultation dédiée pour les patients qui présentaient des manifestations neurologiques. Quelles sont-elles ? La fatigue physique, que nous pourrions poser comme non neurologique, mais qui est bien une pathologie neurologique, constatée par les patients.
Cette fatigue peut donc être physique, musculaire, avec une intolérance à l'effort prolongé et l'obligation de se ménager. Elle peut être aussi « mentale ». Je n'aime pas trop le terme de « fatigue mentale » ni de « brouillard mental ». Néanmoins, c'est une approche d'un symptôme que nous ne connaissons pas bien en neurologie, qui se traduit par des difficultés de concentration, des troubles de l'attention, l'impossibilité pour les patients d'avoir une attention plus ou moins divisée entre deux tâches différentes, d'être aussi « alertes » qu'ils l'étaient avant la maladie. Souvent ces troubles de l'attention, de la concentration, touchent des patients particulièrement actifs avant la maladie, qui subissent donc un coup d'arrêt à cause de la survenue du Covid. Le Covid dont il est question ici est, pour l'ensemble des patients que j'ai pu voir, une maladie non hospitalière. Il s'agissait donc de maladies ambulatoires qui pour la plupart n'avaient pas été graves au point d'entraîner une oxygénothérapie, voire une prise en charge en soins critiques. Les troubles qui caractérisent cette fatigue mentale, cette perte de concentration ou d'attention, se traduisent aussi en troubles de mémoire, par exemple des difficultés à trouver les mots sur le moment – ils existent encore, on les a sur le bout de la langue mais ils ne viennent pas – ou des difficultés à mémoriser les choses sans y faire attention, les tâches routinières – où ai-je mis mes clés ? qu'ai-je fait hier ?
Par ailleurs, en dehors de la fatigue mentale ou physique, une dysautonomie peut être constatée, assortie d'anomalies tensionnelles. On pourrait appeler cela cardiovasculaire, mais c'est le système nerveux autonome qui, manifestement, est en état de dérégulation. Cette dérégulation peut toucher la tension artérielle comme la température corporelle, voire la vasodilatation cutanée qui peut survenir à des moments inappropriés.
Nous constatons aussi des troubles du sommeil – c'est en lien avec l'état du système nerveux. Ces troubles du sommeil, en général, se traduisent par des insomnies, soit d'endormissement, soit par réveil en milieu de nuit, et troublent énormément la vie du patient.
Par ailleurs, nous observons des symptômes à tonalité neurologique : d'une part, des douleurs à type de brûlure, souvent erratiques, d'autre part, des fourmillements qui peuvent être très prégnants. Enfin des céphalées, qui sont de type tensif, en rapport avec la tension musculaire inappropriée ou la tension nerveuse, et sont parfois très aiguës et pénibles. Voici l'ensemble des symptômes neurologiques que nous pouvons observer.
Ces symptômes neurologiques sont particulièrement invalidants et occasionnent souvent une incapacité de travail. C'est chronique, on n'en voit pas la fin. Néanmoins, chez les patients que j'ai pu évaluer et observer dans le cadre de ces consultations post-Covid, depuis juin dernier, nous notons plutôt une amélioration avec le temps, très progressive, très lente et en rapport avec une prise en charge qui, comme cela a été dit, était polyprofessionnelle.
Quelles sont les causes des manifestations neurologiques post-Covid ? Si nous le savions, nous pourrions directement déterminer un traitement. Les données de la littérature sont très limitées, notamment les données neuropathologiques ou d'imagerie, qui manquent cruellement. Nous connaissons les anomalies. Mais, dans les phases aiguës du Covid, lorsque nous sommes confrontés à un AVC, une encéphalopathie ou une encéphalite, nous observons des anomalies à l'IRM, ou bien des anomalies de la coagulation des vaisseaux, au niveau cérébral, si malheureusement nous avons accès à une autopsie.
Les manifestations post-Covid, par contre, sont souvent fluctuantes. C'est intéressant sur un plan scientifique. Il y a des jours « bien » et des jours « mauvais ». Les jours difficiles, sur le plan neurologique, c'est-à-dire marqués par un dysfonctionnement intellectuel, sont relativement imprévisibles. Mais ce qui est intéressant est qu'à partir du moment où il y a des jours « bien », cela veut dire qu'il n'y a pas a priori de lésions définitives, pas de lésions dont il va falloir récupérer, notamment par la rééducation, puisqu'il y a des fluctuations et des améliorations spontanées. Ceci est extrêmement important. Par contre, il faudrait trouver le mécanisme expliquant la réapparition de ces symptômes, puisqu'ils surviennent à plusieurs reprises dans les mois qui suivent le Covid.
Chez les patients qui ont des manifestations neurologiques, les explorations elles-mêmes, comme l'IRM, l'électroencéphalogramme ou l'examen neurologique – l'avis du neurologue est très important dans ce contexte – sont négatifs. Aucun élément ne nous permet de dire que c'est tel endroit du cerveau qui est pathologique. Le bilan neuropsychologique lui-même, qui consiste à explorer la mémoire, la concentration, les capacités de langage, etc. objective clairement des troubles de l'attention, de la concentration, mais il ne montre pas d'anomalies des fonctions dites instrumentales ou de la mémoire qui soient autres que des problèmes d'activation de ces fonctions. L'ensemble des capacités cérébrales, auparavant aisément et directement accessible, devient plus difficile à mettre en œuvre ; par exemple, la mémoire est moins facilement activée, moins facilement accessible à l'activité immédiate. C'est le problème qui apparaît et nous n'en connaissons pas la cause.
Il existe clairement un dysfonctionnement cérébral associé aux symptômes post-Covid de type neurologique. Ce dysfonctionnement est peut-être aspécifique, touchant notamment des personnes très actives avant la maladie, en rupture forcée d'activité – le Covid est un coup d'arrêt très violent – dans un contexte professionnel et sociétal vraiment très perturbé, avec des symptômes anxieux et dépressifs. Ces symptômes sont proches de ceux que nous constatons dans les syndromes de fatigue chronique, dans les syndromes dits post-viraux, dans les syndromes somatiques anxieux, ensembles pour lesquels la physiopathologie n'est toujours pas clairement élucidée. La spécificité du Sars-Cov2 et de mécanismes aujourd'hui encore hypothétiques – Dominique Salmon va en parler – est que les perturbations du système nerveux sont probablement de nature neurohumorale et, nous pouvons penser qu'elles sont tout à fait réversibles.
Des recherches supplémentaires sont évidemment indispensables car très peu de choses ont pu être faites jusqu'à présent.

Merci beaucoup, docteur De Broucker. Beaucoup de questions viendront certainement à la suite de cette intervention.
Je suis professeur en maladies infectieuses et tropicales à l'AP-HP, Université de Paris, et je coordonne une consultation sur le Covid long. J'ai présidé aussi le groupe d'experts qui a rédigé les recommandations récentes de la HAS. L'Hôtel-Dieu de Paris a été un centre d'accueil en ambulatoire au début de l'épidémie de Covid-19. À la fin de la première vague, des patients sont revenus avec des symptômes qui persistaient. Nous avons donc ouvert une consultation spécialisée qui nous a permis de prendre le temps nécessaire pour recueillir tous les symptômes déclarés par ces patients, les classifier et établir les diagnostics correspondants. Nous avons travaillé avec différents spécialistes de façon multidisciplinaire et avons pris contact avec des unités de recherche à la fois fondamentale, en sciences sociales, en psychiatrie, sur différents aspects. La majorité des patients ont accepté d'intégrer un protocole de recherche observationnelle, et pour 200 d'entre eux le recul approche désormais un an.
Les symptômes ont déjà été bien décrits par les orateurs précédents. Je rappellerai juste qu'ils sont très variés et que ceux qui prédominent sont cette fatigue souvent majeure, des signes neurologiques et des signes cardiothoraciques. Mais il existe aussi d'autres signes : digestifs, cutanés, vasculaire. Presque tous les organes sont atteints.
Concernant les facteurs de risque, ces symptômes touchent en majorité des femmes, pour 75 à 80 %, des sujets d'âge moyen, environ 45 ans, assez souvent allergiques. Très peu de nos patients, 10 %, ont été hospitalisés, ce qui peut être dû au fait que nous étions un centre d'accueil ambulatoire lors de la première vague.
L'une des caractéristiques des symptômes déjà mentionnés est qu'ils évoluent de façon fluctuante, avec une alternance de périodes calmes et de périodes d'exacerbation. Ces résultats ont été publiés récemment dans Journal of Infection.
Les enfants ne figurent que très peu parmi ces patients, ce qui est confirmé par les collègues pédiatres que j'ai interrogés. Mais les enfants plus âgés, notamment les adolescents, représentent malgré tout un nombre faible, mais croissant, des appels que nous recevons, avec des conséquences sur leur comportement scolaire qu'il faudra certainement analyser.
Avec le recul actuel d'un an, qui reste insuffisant, nous constatons une amélioration globale, mais certains symptômes, tels que les signes neurologiques, peuvent persister. Or nous constatons maintenant des conséquences non médicales très importantes : professionnelles ou financières, avec l'impossibilité pour certains de reprendre leur travail, le coût des soins, quelquefois la nécessité de changer d'emploi, voire la perte d'emploi, et avec l'entourage.
Nous trouvons des similitudes entre les symptômes de Covid long et certains syndromes post-viraux, comme après la mononucléose infectieuse, en particulier l'existence d'une fatigue chronique majorée par l'effort. Mais, globalement, les tableaux de Covid long sont beaucoup plus complexes et plus sévères.
Par ailleurs, dans les syndromes post-viraux, les examens réalisés sont en général normaux. Dans les Covid, il existe parfois des signes objectifs d'atteinte aux organes. Les tests neurocognitifs objectivent des atteintes cognitives, des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention. Des tests spécialisés trouvent également une réduction du métabolisme cérébral dans certaines zones profondes du cerveau. Des troubles du système nerveux autonome sont parfois objectivés : les atteintes du cœur comme des péricardites, des myocardites, des troubles de l'odorat. Il est donc vraiment important d'établir au plus vite la nature des mécanismes à l'origine de ces symptômes, car c'est une condition indispensable à la mise au point d'un traitement adapté.
Quelles sont les hypothèses actuelles ? La première hypothèse est celle d'une persistance virale faible dans des réservoirs difficiles à déceler. Les travaux préliminaires avec l'Institut Pasteur et d'autres équipes, à la fois chez l'homme et chez l'animal comme le cobaye, vont dans ce sens. Mais ils sont très préliminaires et doivent être confirmés sur un plus grand nombre de patients et avec de bons témoins.
La deuxième hypothèse est celle d'une réponse immunitaire non adaptée ou insuffisante. En effet, il est constaté que la moitié des patients environ ne développe pas d'anticorps contre le virus ou a développé des anticorps à des taux tellement faibles qu'ils ont disparu quand nous les testons.
La troisième hypothèse est celle d'une inflammation persistante dans certains organes, notamment peut-être les petits capillaires sanguins, qui expliquerait que les troubles soient fluctuants. Ils ne touchent pas directement l'organe, mais peut-être sa vascularisation. Mais c'est encore vraiment une hypothèse.
Il peut exister des facteurs génétiques, hormonaux, voire auto-immuns associés.
Enfin, la dernière hypothèse est celle de troubles psychosomatiques. C'est une hypothèse qui doit être explorée, car il est vrai que, devant ces symptômes qui persistent, nous retrouvons souvent une anxiété, voire plus rarement une dépression, et celles-ci peuvent participer à l'entretien des symptômes. Ces troubles sont malgré tout inconstants et semblent davantage pour moi être la conséquence plutôt que la cause de leur survenue.
Où en sommes-nous maintenant concernant la prise en charge des patients ? À l'heure actuelle, il n'existe malheureusement pas de traitements antiviraux efficaces. La prise en charge repose sur quatre piliers.
Le premier est celui des traitements symptomatiques pour soulager les patients et, à ce titre, les anti-inflammatoires sont parfois efficaces et non contre-indiqués.
Le deuxième pilier est la rééducation. Elle est très importante et peut prendre la forme d'une rééducation respiratoire pour les syndromes d'hyperventilation, olfactive, psychocognitive très prolongée, ou de sport.
Le troisième pilier est la participation du patient : il s'agit de l'informer de façon aussi précise et complète que possible pour lui apprendre à reconnaître lui-même les facteurs qui déclenchent les crises et les éviter. C'est un apprentissage à l'autogestion de sa maladie.
Enfin, le quatrième pilier est la prise en charge des troubles anxieux et dépressifs, voire psychosomatiques quand ils sont présents.
Selon les données publiées au Royaume-Uni, et bientôt en France, il existe plusieurs centaines de milliers de patients atteints. Tous ne peuvent être dirigés vers des centres de prise en charge spécialisée. En France, il est donc indispensable que la médecine de ville, au même titre que les médecins hospitaliers, puisse prendre en charge les Covid longs. C'est ce qui a guidé l'esprit des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Cependant, certaines situations resteront complexes ou difficiles à gérer, et il est nécessaire que des réseaux et des circuits de soins soient organisés et que quelques centres de prise en charge spécialisée soient définis, qui pourraient reposer sur des services de rééducation et des médecins ayant une expertise dans cette prise en charge.
Pour conclure, les symptômes sont aujourd'hui de mieux en mieux décrits, mais leurs conséquences sur le long terme et leurs causes restent en grande partie inconnues. Les priorités, selon moi, sont de renforcer la recherche sur l'origine de ces symptômes, car c'est la condition indispensable à la mise au point d'un traitement efficace, et d'organiser des parcours de soins adaptés aux patients Covid long sur l'ensemble du territoire.

Merci beaucoup, professeur. Cette intervention nous éclaire extraordinairement. Je suis très frappé de ce que, malgré la meilleure description du syndrome, nous n'avons pas encore de recul sur ses conséquences à long terme et surtout sur ses causes. Nous en sommes encore à explorer des hypothèses : une réponse immunitaire insuffisante, ou une inflammation persistante, ou des troubles psychosomatiques, ou une persistance du virus ou des facteurs génétiques, ou une combinaison de l'ensemble. Nous y reviendrons.
Le dernier intervenant de cette audition est M. Olivier Robineau, infectiologue au centre de Tourcoing.
Merci de m'avoir invité à cette table ronde. Mes collègues et les associations ont déjà développé largement les problématiques de l'audition. Toutes ces problématiques que nous avons plutôt abordées par le versant du soin se retrouvent également dans la recherche. Si nous résumons, il y a une grande hétérogénéité des symptômes et une grande hétérogénéité de patients.
Sur le plan épidémiologique, il est difficile d'avoir des chiffres fiables. De manière assez caricaturale, la littérature portant sur les patients ambulatoires, donc ceux qui n'ont pas eu besoin d'être hospitalisés initialement mais qui présentent des symptômes persistants, dénombre, selon les articles, entre 2,6 % et plus de 40 % de patients qui présentent encore des symptômes de trois à six mois après la fin de l'infection virale. Nous voyons donc une grande hétérogénéité, et cela dépend évidemment des populations étudiées et de la qualité du suivi des patients.
Sur ce dernier point, nous sommes dans une période pandémique marquée par un nombre très important de patients. C'est une maladie qui se superpose aux autres. Il est donc assez difficile d'organiser des suivis de qualité, surtout en médecine ambulatoire où il est beaucoup plus difficile de faire de la recherche qu'en médecine hospitalière.
Le premier enjeu consiste donc à définir l'impact de la pathologie étudiée sur la configuration du dispositif de recherche. En effet, nous ne créons pas les études de la même manière selon que nous avons affaire à une pathologie plutôt fréquente ou plutôt rare. Il faut également apprécier l'impact sur la prise en charge des patients, notamment sur ce que nous devons élaborer, de manière très pragmatique, pour mettre en place une prise en charge clinique multidisciplinaire – c'est absolument indispensable.
La deuxième hétérogénéité dont il faut tenir compte est la sévérité de la maladie. Nous avons raisonné pendant très longtemps sur la base d'une dichotomie entre les patients de ville et les patients hospitalisés, les deux catégories étant réputées différentes au regard de la maladie. Initialement, il est vrai que les patients de ville et les patients hospitalisés sont dans des configurations cliniques très différentes, mais il est probable qu'à terme, un certain nombre de symptômes et de conséquences à long terme seront reconnus comme étant communs.
Enfin, sur une maladie émergente et, surtout, ses conséquences, la recherche se déploie sur différents niveaux. Le premier est épidémiologique et cherche à savoir ce qui est associé à la pathologie et ce qui ne l'est pas. Cela nécessite d'étudier les patients et des individus en population générale, c'est-à-dire de comparer des personnes qui ont eu le Covid à d'autres ne l'ont pas eu ou qui ont eu une autre infection. En France, les équipes de recherche se sont efforcées d'utiliser les cohortes en population générale déjà existantes pour faire des études sur le Covid en ambulatoire ; ces cohortes intègrent des personnes qui ont été sélectionnées de manière à être représentatives de la population et qui sont suivies depuis des années. Certaines vont avoir le Covid. Nous allons donc pouvoir comparer, au sein de ces cohortes, chez des gens qui ont l'habitude de répondre à des questionnaires, un certain nombre de choses. C'est la première étape.
La deuxième étape consiste à s'intéresser spécifiquement aux gens qui ont eu le Covid pour essayer de comparer ceux qui ont fait une forme courte et ceux qui se plaignent de symptômes qui persistent au-delà d'une certaine durée. Cela peut éventuellement être fait en cohorte de population générale, mais également à partir d'un suivi de patients. Ce suivi est beaucoup plus « facile », parce qu'une infrastructure technique le permet chez les patients hospitalisés, surtout dans les hôpitaux universitaires, avec des équipes de recherche, des personnels formés à la collecte de données, etc. Il est plus difficile à réaliser en ville.
Une fois que les patients ont été définis, il faut les comparer sur des critères autres que l'épidémiologie pure, notamment sur les facteurs de risque clinique. Nous savons que, par exemple, pour les formes graves, l'obésité est un facteur de risque majeur. Une fois que l'on a passé ces étapes d'analyse sur les données cliniques, sur les antériorités, l'âge, les données sociodémographiques, etc., il faut aller plus loin dans l'exploration des différentes hypothèses, telles que celles qu'a évoquées Dominique Salmon : les troubles fonctionnels, l'inflammation persistante, le virus persistant, etc., tout en sachant qu'elles ne sont pas forcément exclusives. Cela nécessite de suivre des patients montrant un groupe de symptômes particuliers pour créer une homogénéité. Il faut rappeler que le grand problème en recherche est l'hétérogénéité des patients. Faire des recherches de qualité suppose de trouver des patients similaires pour les comparer à des patients un peu différents, afin de voir quelles sont les différences. C'est difficile. Les recherches fondamentales à réaliser sont d'ordre physiopathologique, autour des cellules et de l'inflammation dans le sang. Elles sont également cognitives, neurologiques et psychiatriques, grâce à des questionnaires formalisés, réalisés auprès du patient. Tout cela demande du temps, et évidemment beaucoup d'argent.
Nous avons parlé de la recherche sur la causalité épidémiologique, puis fondamentale. La recherche se veut aussi thérapeutique, parce qu'évidemment les patients sont en demande de solutions, ainsi que les médecins. Nous sommes à vrai dire extrêmement désarmés face à la pandémie. Les corticoïdes sont efficaces pour les patients hospitalisés mais, globalement, à l'heure actuelle, l'arsenal thérapeutique contre cette pathologie est pauvre.
Pour les personnes qui présentent des symptômes persistants, il s'agit de savoir si un médicament va agir et, surtout, de manière très pragmatique, s'il existe une prise en charge efficace. Il faut faire de la recherche sur ce que nous connaissons déjà et sur ce que nous pouvons déjà utiliser – je pense notamment à la prise en charge multidisciplinaire – et évaluer quels sont les parcours de soins efficaces pour améliorer la condition des patients et quels sont ceux qui ne le sont pas.
Pour aller plus loin sur l'axe thérapeutique, au sens médicamenteux, il faut d'abord voir une cause physiopathologique pour comprendre le mécanisme sur lequel on peut éventuellement jouer. Mais avant tout, de manière pragmatique, l'évaluation qui fait du bien à tous les patients est la prise en charge pluridisciplinaire.
Voilà l'état de la recherche : différentes strates s'imbriquent sur la recherche fondamentale et épidémiologique. Une recherche très pragmatique est aussi urgente pour améliorer au plus vite le sort des patients, pour trouver des solutions avec les moyens que nous connaissons déjà.
En France, depuis le début du Covid, beaucoup de projets ont été financés, dont plus de 80 grâce aux appels d'offres publics. Parmi eux, deux ou trois de manière directe, une dizaine au moins de manière indirecte, ont un volet relatif aux conséquences du Covid-19 à long terme. Voilà où nous en sommes. Pour ce qui est de la recherche thérapeutique, deux essais randomisés sont en cours d'élaboration ou vont débuter sur l'évaluation des prises en charge multidisciplinaires chez ces patients. Nous en espérons au moins deux autres à moyen terme.

Merci beaucoup, docteur Robineau. Je présenterai tout à l'heure les questions, et surtout les témoignages des internautes qui nous suivent. Mais tout de suite, je passe la parole aux rapporteurs.

Merci beaucoup pour vos témoignages sur l'état actuel des recherches menées.
Les recherches que vous avez évoquées sont-elles franco-françaises ? Avez-vous au contraire un dialogue européen sur ce sujet, notamment avec des confrères britanniques, puisqu'il y a eu une épidémie très dure au Royaume-Uni ?
Ce sont des auditions très éclairantes sur un sujet qui est désormais une réalité et qui a mis du temps à être considéré comme tel. Il était important pour nous de faire le point sur Covid long, même si nous n'en sommes qu'au début de la connaissance.
Concernant le filtre des cohortes et le filtre hospitalier, vous avez bien expliqué que la gravité des symptômes dans la phase infectieuse n'est pas en relation directe avec l'apparition du Covid long. Certaines personnes ont été testées positives et sont suivies en ambulatoire, mais n'appartiennent pas pour autant à une cohorte. J'aimerais savoir ce qui empêche de mettre en place une telle cohorte, dans la mesure où les tests positifs sont tous enregistrés via le dispositif SI‑DEP, auquel l'AP-HP a d'ailleurs participé. Qu'est-ce qui empêche de constituer une cohorte, ou de procéder à un échantillonnage représentatif en médecine générale et de mettre en place un questionnaire similaire à celui qui est utilisé auprès des patients hospitalisés ? Est-ce un problème financier ? Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur cette question financière, dans la mesure où le Royaume-Uni et les États-Unis ont commencé à investir massivement, probablement pour faire face aux conséquences financières du Covid long, qu'elles résultent de dépenses de santé directement ou d'une désorganisation sociale et économique du fonctionnement du monde du travail. La France semble avoir engagé un certain nombre d'études, mais il demeure un « blanc » important alors que d'autres pays ont pris de l'avance.
La qualification du Covid long comme ALD est une question administrative, mais cela pourrait compter beaucoup dans la reconnaissance sociale de la pathologie. Je rappelle que la reconnaissance en maladie professionnelle est conditionnée au recours à l'oxygénothérapie. Or, manifestement, cette nécessité ou non de l'oxygénothérapie en phase aiguë n'a aucun lien avec la complexité et la gravité du Covid long. Considérez-vous que le Covid long peut être reconnu comme une maladie professionnelle ? Par ailleurs, considérez-vous que le critère d'oxygénothérapie reste une condition légitime de la reconnaissance comme maladie professionnelle ?
L'âge a été évoqué comme facteur de risque. Vous avez mis en évidence, certes sur une cohorte particulière, le fait que les femmes étaient beaucoup plus touchées que les hommes. Cette cohorte est-elle représentative ? Ce phénomène est-il observable aussi pour les autres syndromes post-viraux ? Dans l'évaluation des symptômes neurologiques et psychologiques – tout cela est lié – pouvons-nous isoler la part liée à un syndrome post-traumatique ? Certains n'ont pas vécu le traumatisme physique et réel de la maladie aiguë, mais la situation de crise épidémique est vécue comme un traumatisme par un grand nombre. En d'autres termes, ne sommes-nous pas, finalement, sur une origine multiple, dont la dimension mentale et psychologique serait prégnante ? Avons-nous des études qui s'intéressent à cette dimension ?
Un certain nombre de maladies sont qualifiées de psychosomatiques, souvent celles que nous parvenons plus ou moins bien à caractériser. Ces maladies n'ont-elles pas, en fait, une origine bien réelle dont les mécanismes chimiques, biologiques, physiques et autres seront probablement objectivés plus tard ? La pandémie actuelle ne permet-elle pas de montrer que de nombreuses maladies sont mises dans le grand fourre-tout du « psychosomatique » alors que nous ne les avons pas encore identifiées dans leur réalité pathologique ?
J'ai suivi avec un très grand intérêt toutes les interventions de cette audition.
Y a-t-il eu des accidents vasculaires cérébraux associés à des cas de Covid long ? On parle beaucoup des thromboses susceptibles d'être causées par les vaccins. Pouvons-nous rapprocher les problèmes neurologiques, même aigus, causés par le Covid qui peut se prolonger en Covid long, des accidents vasculaires qui ont été associés au vaccin ?
Pédiatre de profession, je suis très intéressée par le côté pédiatrique de l'épidémie. J'éprouve un grand regret à l'idée de tous les tests que nous n'avons pas faits aux enfants, alors que nous pouvions les faire en grande quantité. De nombreux cas de Covid seront passés inaperçus. Il faudrait pouvoir évoquer le diagnostic en cas d'enfant fatigué ou dont les résultats scolaires baissent.
Je souhaiterais avoir votre éclairage sur ces deux sujets.

Voilà de nombreuses questions. Avant de redonner la parole aux participants à la table ronde, je vais d'abord vous lire quelques éléments des contributions qui ont été déposées par les internautes. Pour la majorité, il s'agit de témoignages qui recoupent très bien trois des quatre axes présentés par Mme Oustric pour l'association de patients Après J-20 : la disponibilité des soins dans une approche pluridisciplinaire, la communication grand public, la reconnaissance.
« Peut-il être envisageable que soient créées, dans les hôpitaux de chaque chef-lieu de département ou région ou CHU, des consultations pluridisciplinaires vers lesquelles seraient orientés les Covid longs ? »
« Bonjour, je suis atteinte d'un Covid long depuis le 9 novembre 2020. Mon médecin traitant a fait une demande de congé longue maladie, qui a été refusé. Pourquoi rien n'est prévu en termes de prise en charge de congé longue maladie pour les Covid longs, invalidants au quotidien ? »
« À quand la reconnaissance comme maladie professionnelle dans l'Éducation nationale et pour les soignants, pour les personnes n'ayant pas fait de réa ? »
« Les soignants, en première ligne depuis le début de l'épidémie, se voient refuser le statut de maladie professionnelle pour le Covid-19, n'ayant pas été hospitalisés ou mis sous oxygénothérapie. Qu'en est-il du statut de maladie professionnelle pour les soignants ? Covid long, à quand la reconnaissance ? »
« Je suis aide-soignante, malade du Covid depuis avril 2021, contracté sur mon lieu de travail – hôpital –, avec PCR et sérologie positives. Je suis toujours en arrêt maladie, incapable de retravailler. N'ayant pas été hospitalisée, je n'ai pas de reconnaissance en maladie professionnelle. À quand cette reconnaissance ? »
« Quand tous les soignants pourront-ils être reconnus en maladie professionnelle et pas seulement les cas hospitalisés ? »
« Militaire, contaminé depuis le 14 mars 2020 en mission à l'étranger, je n'ai pas bénéficié d'un suivi médical optimum. J'ai toujours des symptômes. Quand l'État reconnaîtra-t-il cette maladie comme professionnelle pour celles et ceux qui l'ont contractée alors qu'ils étaient au service de l'État ? »
« Atteint d'un Covid long depuis octobre, malgré les tests négatifs mais tous les principaux symptômes – asthénie, frissons, maux de tête, problèmes respiratoires –, à quand la reconnaissance comme une longue maladie ? »
« Pourquoi si peu de communications officielles dans les médias ? Une meilleure connaissance du Covid long permettrait d'éviter des prises en charge calamiteuses et peut-être un meilleur respect des règles sanitaires. »
« Depuis onze mois, au lendemain d'un effort minime, j'ai fièvre, vertige, maux de tête, voix quasi inaudible tant je suis faible. Impossible de rester debout plus de quelques instants. Peut-on parler de malaise post-effort ? La réadaptation à l'effort est-elle recommandée malgré ces rechutes ? »
« Pourquoi aucune communication d'ampleur ? »
Un autre parle d'un syndrome de fatigue chronique.
« Est-ce qu'un jour nous serons reconnus sur nos symptômes ? »
« Comment faire en sorte que les maladies Covid long dans les territoires dits isolés puissent bénéficier de soins et être prises en charge de façon efficace et sur le long terme ? »
Une question plus technique nous parle de recherche et de la position de la Haute Autorité de Santé : « Des travaux aux États-Unis expliquent qu'un certain nombre de Covid longs souffrent en fait de syndrome de fatigue chronique, qui est une maladie grave et un dysfonctionnement immunitaire. Pourquoi le rapport de la Haute Autorité de Santé n'en parle pas ? »
À ces commentaires et questions des internautes, j'ajoute une question de mon cru. L'exposé de Mme Salmon-Céron a bien montré que nous avons encore bien des interrogations sur les symptômes à long terme, et des interrogations sur les causes possibles, différentes hypothèses étant formulées. La question est : des tentatives de traitement, des expériences, des essais, sont-ils en cours de réalisation ?
À partir de quel moment peut-on poser un diagnostic de Covid long ? Y a-t-il un moment fixant précisément le début d'un Covid long ?

Je vous propose de répondre aussi directement et brièvement que possible à l'ensemble des questions qui ont été posées, parce qu'il y a beaucoup de questions et que les intervenants pourront ainsi avoir plusieurs points de vue.
S'agissant des recherches qui seraient éventuellement franco-françaises ou conduites au niveau européen, les données actuelles sont essentiellement internationales. Il y a eu quelques publications pour les patients d'origine française, surtout ceux qui ont été hospitalisés.
Pour ce qui concerne la coordination internationale, il n'y a pas encore d'essais internationaux ou d'enquêtes épidémiologiques internationales de type cohorte. En revanche, des données d'assurance-maladie sont mises en commun. Des logiciels utilisés dans plusieurs pays anglo-saxons ont permis de rassembler un certain nombre de données. Nous notons une volonté, notamment au niveau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il y a quinze jours, une réunion a eu lieu à l'OMS sur le Covid long qui a insisté sur la nécessité de coordonner le recueil des données sur cette maladie, et donc de favoriser la recherche sur ce point.
Une question a été posée sur le lien avec la cohorte en population générale. Nous pouvons mettre dans des cohortes les patients qui ont été positifs ou négatifs à un test. Il faut surtout se demander quelle est la question à laquelle nous voulons répondre, dans la mesure où, maintenant, ce qui va être intéressant n'est pas de suivre tous les patients. Nous observons que les plaintes sont assez fréquentes, et nous n'allons pas pouvoir inclure tous les patients dans des cohortes. Par contre, choisir un certain nombre de personnes ayant des symptômes particuliers, les suivre et les comparer à d'autres qui n'ont pas ces symptômes ou qui ont des pathologies similaires est ce qui, a priori, est probablement le plus efficace. Il faut savoir que mettre en place des cohortes est très onéreux et nécessite énormément de temps pour avoir des données intéressantes. Si nous voulons constituer une cohorte avec des patients infectés maintenant, il faut la mettre en place ; des données vont arriver dans trois à quatre mois ; pour avoir suffisamment de patients, il va falloir attendre six mois, un an, etc. C'est important pour étudier les conséquences à long terme, pour le suivi à long terme. Par contre, pour obtenir des réponses aux questions physiopathologiques, une stratégie efficace consiste à sélectionner des patients ayant des symptômes homogènes pour pouvoir se focaliser sur différents groupes et les étudier de manière précise.
Je complète ce propos en précisant que nous avons été sollicités par les National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis pour mettre en commun nos données. Mais la recherche française est pauvre en termes de financement. Tant que nous n'aurons pas de protocoles financés de façon conséquente, nous ne paraîtrons pas assez ambitieux.
Par exemple, les études génétiques doivent être faites au niveau international, car il faut des milliers de patients. Il faut pouvoir constituer des banques de données pour les partager avec nos collègues anglais et américains. Cela fait six mois que nous sommes en train de déposer, avec Olivier Robineau, des projets de recherche. Nous redéposons encore et encore. Ce n'est pas du tout la façon de faire des Anglais qui, eux, mettent de l'argent sur la table. Et cela va beaucoup plus vite…
Nous les déposons en réponse à différents appels d'offres : l'ANRS - Maladies infectieuses émergentes, l'Agence nationale de la recherche (ANR), etc. Nous pouvons toujours améliorer les projets et la méthodologie. Il faut toujours de bons témoins. Mais en France, nous prenons du retard par rapport à nos collègues anglais ou américains. Nous pourrions déjà avoir des biothèques constituées prêtes à envoyer à des chercheurs, avec une collaboration européenne ou internationale. Nous sommes sollicités pour cela.

Je comprends qu'il y a une difficulté sur les moyens et un problème de réactivité. L'idéal serait une mise en place rapide, à laquelle la procédure ANR habituelle est peut-être mal adaptée.
Je suis d'accord. La réactivité est importante. L'année dernière, nous avons eu des appels à projets de type « Covid flash » qui permettaient d'avoir des réponses rapides. Malheureusement, c'est beaucoup moins le cas depuis. Or nous en avons toujours besoin parce que les questions que nous nous posons évoluent au gré de l'état des connaissances. Nous avons besoin d'aller plus vite, de plus de financements et de réponses plus rapides ; nous avons besoin de financements directs de recherche, mais également de financements hospitaliers. J'en donnais un exemple tout à l'heure, mais l'ensemble est lié.
La recherche ne fonctionnera pas sans argent dédié, rapidement alloué aux protocoles et à l'embauche du personnel autre que le personnel de recherche : les infirmières, les soignants, les psychologues, tous ceux qui, en dehors des études cliniques proprement dites, vont voir les malades. C'est fondamental.
Il faut également souligner l'importance de la recherche sur le post-Covid. Elle est majeure à plusieurs égards. Nous parlons depuis le début des syndromes post-infectieux. Si la recherche est stimulée sur le post-Covid, elle pourra peut-être apporter aussi des réponses à des questions posées dans d'autres domaines de syndromes post-infectieux ou post-maladie, qui sont des questions majeures peu étudiées.
Nombreux sont les intervenants de cette audition qui ont touché de près ou de loin au VIH. Or la recherche sur le VIH a été profitable à d'autres pathologies et d'autres domaines de recherche. Donc, il faudrait aussi pouvoir s'appuyer sur ce qui se fait sur le Covid, la phase aiguë et les symptômes prolongés, pour d'autres pathologies.
Je rebondis sur le côté européen. En tant que patients, nous travaillons avec différents pays européens : l'Espagne, l'Italie, la Finlande, de la Suède, les pays anglo-saxons et les États-Unis. C'est important parce que cela nous permet de voir que les symptômes rapportés par les patients ne sont pas culturels ou liés à une société particulière, ce sont vraiment les mêmes dans les différents pays. C'est important aussi pour l'analyse des causes et la physiopathologie. Certains scanners faits en Angleterre ont permis, par exemple, de montrer des micro-embolies qui ont ensuite été montrées aussi en France sur des patients français, avec le même test.
La collaboration est essentielle au niveau des patients et au niveau des chercheurs et des médecins internationaux et européens, pour mieux comprendre ce qui se passe et pour s'entraider. Nous l'avons commencée en tant que patients et nous espérons pouvoir avancer pour ce qui est de la recherche. En effet, les Anglais ont beaucoup d'avance et nous ne pouvons pas attendre qu'ils aient trouvé des réponses de leur côté, parce qu'il y aura aussi des éléments de nature génétique. Il faut que nous ayons des réponses en France aussi.
Je ne peux m'exprimer que dans le domaine de la neurologie. Il est clair que de très nombreux patients se plaignent de dysfonctionnements cognitifs. À l'heure actuelle, pour faire une évaluation cognitive, il est indispensable de passer par un neurologue ou par un neuropsychologue. Or il faudrait augmenter l'offre de soins. En effet, les neurologues, qui exercent en médecine de ville, sont saturés et les actes des neuropsychologues ne sont pas remboursés s'ils ne sont pas hospitaliers – j'en profite pour le signaler, c'est un problème très pointu de nomenclature. Un bilan neuropsychologique représente deux ou trois heures de travail avec le patient. C'est extrêmement précieux pour le patient, pour les conclusions que nous en tirons, mais aussi pour la prise en charge ultérieure qui sera faite non pas par les neuropsychologues, mais probablement, en termes de remédiation cognitive, par des orthophonistes.
Mme de La Provôté a évoqué à deux reprises le caractère péjoratif d'un discours mettant en avant la psychologie. Je rappelle – pas à vous, madame de La Provôté, puisque, manifestement, vous l'avez bien compris – que la psychologie est de la neurologie. C'est le même système nerveux qui se charge de l'exploitation des données neurovisuelles, du langage, de l'humeur, de la motivation, etc. Nul ne prétend l'inverse d'ailleurs. Et dans tous les syndromes dont la physiopathologie est compliquée, y compris la fatigue chronique, nous ne parlons pas de simulations mais de symptômes dans lesquels le patient est le premier à se sentir mal en raison de sa maladie. Par contre, parmi ce type de maladies, le Covid long est la moins bien comprise. Il est certainement dû à un dysfonctionnement au niveau du système nerveux, plutôt de nature neurohumorale, mais nous ne savons pas encore le déclencher, ni dans le cadre du Covid, ni peut-être aussi dans d'autres pathologies – je rejoins Olivier Robineau sur la nécessité d'approfondir la recherche à ce sujet.
La « quantité », le nombre de patients concernés est important. C'est donc le moyen d'avoir une population relativement cohérente, qui est d'ailleurs avide de prise en charge, y compris de contribuer à la recherche. C'est le moment de faire un pas en avant, qui peut être un pas scientifique très important.
Il y a beaucoup de questions sur l'ALD et la reconnaissance en maladie professionnelle. Le Covid long ne fait pas partie des 30 maladies reconnues comme ALD. Toutefois, les médecins peuvent demander un classement en longue maladie, puisque le Covid long répond au critère d'une maladie grave avec des conséquences handicapantes. Je pense que ce n'est pas suffisamment connu des médecins et reconnu par les caisses d'assurance maladie. Pourtant, cette possibilité existe et il est important de l'utiliser dans un premier temps, avant que le Covid ne soit peut-être un jour susceptible de donner lieu à une prise en charge en ALD ou reconnu comme maladie professionnelle.
Je pense que ce dernier point relève plutôt de la loi. Pour l'instant, la reconnaissance comme maladie professionnelle est conditionnée au recours à l'oxygénothérapie. C'est beaucoup trop restrictif. Certains patients ont maintenant un an de recul. Ils ne peuvent plus reprendre leur travail, ils ont une maladie professionnelle avérée – avec anticorps ou pas – qui n'est pas reconnue par leur médecin du travail. Les conséquences sont absolument majeures. Ils doivent reprendre à tout prix leur travail, fût-ce à temps partiel, ou se mettre en disponibilité, ou prendre une retraite anticipée. Il est urgent de pouvoir reconnaître ces patients en maladie professionnelle et que les médecins experts reconnaissent qu'une grande partie de ces patients n'ont pas d'anticorps – cela a été intégré dans les recommandations de la HAS : il est possible d'avoir avoir un Covid long avec ou sans anticorps. Malgré tout, je vois beaucoup de collègues médecins experts déboutant les patients au bout d'un an en leur disant que ce n'est pas reconnu. Il faut donc faire un effort important pour changer de vision.
Nous avons tout de même des approches thérapeutiques, mais sur une base symptomatique : nous pouvons donner des traitements liés aux symptômes. Par exemple, nous voyons une gastrite, nous traitons la gastrite ; nous voyons une inflammation majeure, nous donnons des anti-inflammatoires comme l'aspirine. Nous traitons aussi par rééducation, c'est extrêmement important. En fait, notre cerveau est extraordinairement plastique et même si des zones dysfonctionnent, la rééducation est très efficace : rééducation de l'olfaction, pour ceux qui ont des troubles de l'odorat ; rééducation neuropsychologique, beaucoup plus longue, mais elle marche bien aussi ; rééducation par le sport ; rééducation d'un syndrome d'hyperventilation. S'agissant de cette dernière, les patients n'arrivent plus à respirer, n'utilisent plus leurs muscles diaphragmatiques et leurs muscles respiratoires principaux mais des muscles accessoires. En 20 séances, ils réapprennent à respirer. La rééducation est le deuxième pilier de traitement.
Le troisième consiste à apprendre au patient à reconnaître sa maladie et à éviter les situations qui le mettent en danger. Il faut qu'il sache, par exemple, que s'il fait du sport de façon trop intensive, cela va être contreproductif. Il faut qu'il sache reconnaître les situations lui permettant d'éviter les exacerbations.
La prise en charge psychologique est également importante. Beaucoup de patients sont anxieux, possiblement en raison de leur situation, et ils ont besoin d'une telle prise en charge psychologique, parfois accompagnée de médicaments, antidépresseurs, anxiolytiques, qui d'ailleurs peuvent agir au niveau du cerveau et du système nerveux autonome par d'autres mécanismes que les mécanismes classiques.
Ces méthodes ne sont pas complètement satisfaisantes. Nous voudrions tous avoir un traitement antiviral comme l'Aciclovir, et que les gens soient contrôlés. Mais dans l'attente de traitements efficaces, les quatre approches que je viens de mentionner sont synergiques.
Pour répondre à Mme Lassarade, tout est à faire en pédiatrie. Les enfants ne se plaignent pas. Ce sont les parents qui remarquent qu'ils ont changé, qu'ils ne sont pas bien, qu'ils ne suivent plus à l'école ; de leur côté, les professeurs s'aperçoivent que les enfants ont décroché. Je suis médecin adulte, je vois que des jeunes âgés de 15 ou 16 ans sont devant le tableau et n'arrivent plus à comprendre une leçon de philosophie ou à faire leur devoir d'espagnol. Ils sont tout de suite taxés d'enfants déprimés et adressés aux psychiatres. Je pense que, comme nous l'avons fait pour les médecins des adultes, les pédiatres doivent mettre en place des cohortes de patients pour essayer de lever l'ambiguïté entre des troubles psychologiques liés au stress post-traumatique – c'est possible, il en est énormément question – et les cas plutôt liés à des Covid longs.
Beaucoup de parents nous écrivent pour dire que leurs enfants ont des symptômes qui ne sont pas forcément ceux auxquels nous pensons pour le Covid long. Ce sont des symptômes dermatologiques. Je ne suis pas forcément la mieux placée pour en parler. Comme ce n'est pas reconnu, ce n'est pas compris et ce n'est pas soigné. Je pense qu'il faut que nous nous posions la question de la reconnaissance du fait pathologique : à partir de quel moment considérons-nous qu'une maladie est reconnue comme telle ? Là, cela concerne tout de même le monde entier. Le Covid long a été reconnu par l'OMS, par la HAS. Nous avons eu un guide. Nous avons été interviewés avec un système pluridisciplinaire. Il est vrai que nous ne savons pas tout, par exemple la physiopathologie du Covid long, mais nous savons que cela existe et nous connaissons les symptômes. Cela a été bien décrit et il existe des publications dans tous les pays.
Il faut cesser de s'arcbouter sur des critères de reconnaissance administrative. Le Covid long existe. Soignons donc les patients en fonction de leurs symptômes, utilisons ce que nous connaissons déjà pour faire avancer les choses, et utilisons la recherche pour faire avancer le futur. J'ai l'impression que nous restons bloqués sur cette question de la reconnaissance alors qu'en fait, nous y sommes, il faut juste en parler. Tant que la communication gouvernementale n'en parle pas clairement, de même que les médecins traitants et les médecins-conseils, ce ne sera pas reconnu. Cette reconnaissance doit être acquise maintenant.
Mme Oustric a tout à fait raison. Le fait que des symptômes persistent après une infection par le Covid est un fait établi. La question est : quelles sont les causes ? Mon hypothèse est qu'il y en a probablement plusieurs. Il s'agit alors de savoir comment les prendre en charge et comment développer la recherche sur cette symptomatologie et cette maladie qui persiste.
Je reviens sur deux sujets liés, qui sont la définition du Covid long et les facteurs de risque. La définition que nous avons utilisée, au sein de la HAS, est très pragmatique. Définir une pathologie qui se développe dans une certaine temporalité est compliqué. La HAS a fait le choix de dire que, comme il n'existe pas vraiment de mécanismes connus pouvant expliquer toutes ces plaintes de patients, il faut se demander à partir de quand ces personnes ont besoin d'une prise en charge. La définition de la HAS est pragmatique : elle n'est pas la définition d'une maladie à proprement parler, mais d'un état de santé qui nécessite un soin. Et c'est ce qui est important.
La définition pose qu'il s'agit de personnes pouvant avoir une PCR positive ou non, que des symptômes peuvent s'y associer dans un contexte épidémique, et que ces symptômes existent depuis un mois. Pourquoi disons-nous cela ? Tout simplement parce qu'à ce moment-là une rééducation peut commencer : une réadaptation à l'effort, et surtout une réadaptation respiratoire. On peut commencer à utiliser des traitements antalgiques, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, sans qu'il y ait de risque pour le patient. Pour autant, un débat subsiste : si la charge virale est importante, donner des anti-inflammatoires n'est peut-être pas une bonne chose dans un premier temps. Cette définition est essentiellement pragmatique pour la prise en charge des patients.
Il y a un lien avec les facteurs de risque de cette maladie à symptômes persistants. Comment caractériser des personnes à risque de faire une symptomatologie longue ? Des facteurs épidémiologiques ressortent, notamment le ratio hommes/femmes, l'âge également. Ce qui marque dans la population vue en ambulatoire est que la maladie touche des gens plus jeunes. Mais quelques publications internationales montrent que les symptômes sont quand même un peu plus sévères chez les personnes plus âgées. Par contre, cela touche toutes les tranches d'âge adultes, en tout cas pour les données que nous avons.
Un facteur de risque très intéressant et important a été démontré. Un article publié dans Nature Medicine, revue médicale de premier plan, a démontré l'association avec la symptomatologie initiale. Plus elle est intense en termes de nombre de symptômes, plus il y a des risques que ces symptômes persistent au-delà d'un temps que nous pourrions qualifier de raisonnable, plus de trois mois. Nous en sommes là, et c'est peu…
Cela reflète le fait que nous avons du mal à mettre en évidence des facteurs de risques classiques, sociodémographiques, antécédents médicaux, etc., à la persistance. Il est absolument nécessaire d'aller plus loin dans l'exploration de l'inflammation immunitaire et des troubles fonctionnels.
Je souhaite apporter un éclairage sur une question relative au suivi ambulatoire des patients et à l'organisation de la recherche. Il est important d'accroître nos connaissances. Cependant, le Covid long est réel et nombre d'entre nous, médecins, et soignants d'une manière générale, ont besoin de l'entendre de manière probablement plus forte. Si l'on rapproche cela de la problématique des syndromes de fatigue chronique, le fait de dire que les symptômes existent et qu'il faut prendre en charge les patients peut résoudre une partie du problème et remédier peut-être à l'impuissance ressentie par certains de nos collègues en ville.
En effet, en dehors de Mme Oustric, tous les participants à cette audition sont des médecins hospitaliers. La différence est énorme entre la prise en charge en ville et la prise en charge hospitalière. Nécessairement, nous travaillons en équipe, d'autant que certains d'entre nous sont en CHU dans des équipes faisant de la recherche. La vision que peut avoir la médecine de ville est évidemment très différente. Pour apporter cet éclairage, il faut favoriser l'émergence de réseaux de soins autour du Covid long.
Mais cela va bien au-delà. Il n'est pas toujours simple pour les médecins de ville de faire intervenir les collègues spécialistes, psychiatres, pneumologues, neurologues, psychologues, kinés, infirmiers de ville, etc. Cela demande du temps. Les symptômes multiples appellent des soins pluridisciplinaires. Mais le soin pluridisciplinaire, c'est ce que fait tout seul le médecin généraliste. Il est la racine qui doit tout faire converger, et ce n'est pas facile. Ce sont donc des consultations qui prennent du temps. On ne peut pas se fixer une même durée de 15 minutes pour un renouvellement d'ordonnance et pour voir une personne qui a des symptômes de Covid long. Il faut le dire. La consultation n'est pas la même et la tarification de cette consultation, probablement, ne peut pas être la même.
Je m'étonne donc qu'il n'y ait pas de médecin généraliste autour de la table. Nous sommes probablement sur une première table ronde, et évidemment, au-delà des associations de patients et du travail de Mme Salmon-Céron et de M. Robineau à la HAS, les médecins généralistes ont été impliqués. Je pense qu'il faut les impliquer plus. Nous pouvons voir certains éléments par le prisme hospitalier, mais nous ne les voyons que partiellement si nous n'impliquons pas les autres intervenants.
La recherche en soins primaires doit être développée. Elle demande de l'argent, mais aussi de l'organisation et de la formation. Nos collègues médecins généralistes en ville sont en partie formés et le font déjà. Souvent, ce sont des médecins généralistes universitaires par ailleurs, qui accueillent des étudiants et qui participent à la recherche. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Faire de la recherche en soins primaires est très consommateur de temps et nos collègues croulent déjà sous les demandes de consultation. Ils n'ont pas forcément ce temps-là. Il faut le leur donner. Si je dois résumer : premièrement, la recherche en soins primaires demande du temps ; deuxièmement, elle demande de la formation ; troisièmement, elle demande de faciliter la communication et la constitution de réseaux pour nos collègues.
Je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de Nicolas Noël. Il est vrai que la prise en charge de ces patients nécessite une consultation longue, surtout en première visite. Nous ne pouvons pas la faire en un quart d'heure : il faut plutôt une heure ou une heure et demie. Ce n'est pas facile pour les médecins généralistes, nous le comprenons bien. D'un autre côté, quand il y a en France plusieurs centaines de milliers de patients atteints d'une même pathologie, tout le monde ne peut pas aller à l'hôpital, déjà très occupé par la prise en charge des patients hospitalisés. C'est pour cela que la HAS a souhaité donner des outils aux médecins pour que le premier recours au moins puisse être efficace. D'ailleurs, nous nous rendons compte que depuis la publication de ces recommandations, le profil des patients qui arrivent à l'hôpital a changé. Ils ont déjà eu la rééducation respiratoire, les bilans usuels.
Il faut trouver un équilibre et peut-être permettre aux médecins généralistes d'être renforcés par des cotations de consultations spécialisées plus élevées que les consultations. Il faut les aider à s'organiser pour qu'ils aient des réseaux, qu'ils trouvent sur place, même dans des régions où l'offre de soins est réduite, un neurologue, un rééducateur, un psychologue, etc. pour pouvoir mettre sur pied un réseau. L'un des internautes a proposé une consultation pluridisciplinaire au niveau départemental au moins. C'est une très bonne idée. Cependant, si tous les généralistes disent : « Je ne m'occupe pas de ce patient, il va à la consultation pluridisciplinaire », c'est contreproductif. Il faut les deux leviers : d'une part, renforcer les généralistes pour leur permettre d'être efficaces. Ce sont eux les interlocuteurs naturels, ils connaissent la famille, ils renouvellent ou non les arrêts de travail, ils voient aussi tout l'environnement du patient. D'autre part, développer les consultations pluridisciplinaires, clé du succès, au niveau départemental. Il n'est pas normal que des patients viennent de Corse, de Perpignan, de Bretagne, d'un peu partout, à Paris, alors que la complexité des situations ne le justifie pas. C'est juste une question de temps et d'organisation des disciplines médicales.
Les complications neurologiques ont-elles un lien avec les AVC ? Cette question est plutôt pour Thomas De Broucker. Je peux cependant vous dire qu'une revue de neurosciences a fait récemment paraître un article mettant en avant l'hypothèse de microthromboses, de micro-inflammations. De temps en temps, le virus – est-ce parce qu'il persiste ou est-ce à cause des conséquences inflammatoires de l'infection ? – entraînerait des microthromboses, et donc des défauts de vascularisation et de fonctionnement cérébral.
On n'observe pas d'accidents vasculaires constitués autour du Covid long. D'ailleurs, nous ne notons pas de paralysie, mais des signes neurologiques fluctuants, dont il faut chercher la cause.
Je n'ai rien à ajouter. Ce qui est sûr est que le virus a une certaine appétence pour les parois vasculaires. C'est bien connu pour la phase aiguë. Dans le cadre du Covid long, c'est une hypothèse à creuser. Naturellement, s'il y a une persistance virale, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'atteinte vasculaire associée. Mais ce n'est pas un facteur de risque d'AVC post-Covid à l'heure actuelle.
Le Covid long est une occasion majeure de favoriser la recherche sur des patients suivis en ville. Évidemment, l'attention est plutôt attirée par le caractère absolument dramatique des patients hospitalisés, dont un certain nombre va décéder. Cependant la grande majorité des patients ne vont pas à l'hôpital. Il est donc très important de travailler avec la médecine générale et avec les patients qui sont en ville. C'est également le cas pour les autres symptômes post-viraux.
Juste avant l'épidémie de Covid, nous avions voulu monter un projet sur les conséquences de l'infection à cytomégalovirus en médecine du travail. Nous avions reçu un excellent accueil de la médecine du travail pour évaluer l'impact de cette infection, assez fréquente, qui peut entraîner des fatigues longues. On voit donc une réelle volonté de médecins généralistes ou de médecins de soins premiers de s'intéresser et de travailler sur des questions qui les touchent directement, car ils sont le premier filtre avant d'arriver en consultation hospitalière. Ils font énormément de travail en amont, dont nous n'avons pas connaissance.
La recherche peut porter sur les formes cliniques, qui peuvent être différentes, mais aussi sur l'organisation du soin, sur ce que cela entraîne en termes de consommation médicale chez ces patients. Un grand nombre de questionnements ne sont pas hospitalo-centrés.

Je vous remercie beaucoup pour ces échanges de grande qualité.
Ma première remarque est qu'il était important que nous organisions cette table ronde dans ce format interdisciplinaire où les patients sont représentés et où les différentes spécialités de médecine nous parlent aussi bien de diagnostic et de traitement que de recherche. Comme vous l'avez fait remarquer, cela aurait pu être encore plus large. Nous aurions dû ajouter la médecine de ville. Peut-être aurions-nous pu avoir un représentant de l'Ordre des médecins. En tout état de cause, la composante « soins en médecine de ville » a été souvent évoquée dans les interventions.
S'agissant des conclusions à tirer, notre premier public, ce sont les parlementaires, dont l'Office est le bras armé sur les questions scientifiques. Pour ce qui est des décideurs, il faudra que nous nous tournions vers les médecins.
Le politique a été invoqué à plusieurs reprises, par exemple sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle. C'est un sujet qui déborde le cadre des prérogatives de l'Office, mais nous pouvons faire des recommandations et attirer l'attention de nos collègues sur ce qui a été dit ici. Au-delà, le Parlement dispose des moyens que la Constitution lui donne pour interpeller le gouvernement sur ces sujets, avec des questions écrites, des questions orales ou de nombreux autres moyens. Nous avons eu le sentiment, en vous écoutant, qu'il y avait urgence à agir et que l'Office devait y prendre sa part.
D'emblée, nous avons bien vu l'importance de la mobilisation des patients. Les quatre axes que vous avez indiqués dans votre intervention, madame Oustric, ont structuré tout le débat. La pertinence et l'importance de votre participation ont été amplement démontrées par ce seul fait.
Après ce que nous avons entendu, la réalité du Covid long ne peut plus être mise en doute. Certes, il subsiste de fortes interrogations sur les mécanismes d'action. Nous avons bien entendu ce que disait la professeure Salmon-Céron sur les différentes hypothèses : est-ce une inflammation ? une persistance du virus ? une réponse immunitaire insuffisante ? un trouble psychosomatique ? une combinaison de tout cela ? Il n'empêche, le message est fort : la réalité des symptômes est là, quand bien même ce sont des symptômes multiples, des symptômes variables. Nous ne sommes pas sur quelque chose qui relève de l'invention ou de l'imagination des patients.
L'exposé du docteur De Broucker a insisté sur les questions neurologiques sous-jacentes : des dysfonctionnements cérébraux, des problèmes liés à certaines facultés cognitives, des troubles de la mémorisation, etc., qu'il faut distinguer de ce qui relèverait de symptômes dépressifs, de découragement ou autres manifestations. Non qu'il ne faille aussi prendre en compte les questions dépressives, mais nous sommes bien là sur quelque chose de différent, de précis au sens neurologique et cognitif, et vous l'avez très bien décrit.
Vous avez également insisté sur le fait que, même en l'absence de certitude sur les causes et sur les traitements, il est très important d'avoir des réponses pragmatiques rapides, dont certaines peuvent passer par des moyens peu utilisés comme le classement en longue maladie, même si le Covid long n'est pas dans la liste officielle des ALD.
Il est important aussi, pour le corps médical, de s'organiser : meilleure information des praticiens ; mise en place, sans que les deux s'excluent, de consultations interdisciplinaires avec des centres ad hoc qui peuvent avoir un caractère régionalisé, territorialisé en tout cas.
Ce qui est important est de rester pragmatique. Nous savons bien que la médecine est une subtile combinaison de science et de pragmatisme, d'expérimentation. La boussole qui doit nous guider ici est le bien-être et le réconfort des citoyens qui sont en souffrance.
Ma dernière remarque ira vers la recherche. Vous avez insisté sur l'importance des moyens, de la réactivité et de la vitesse. Hier, l'Élysée annonçait la mise en œuvre de moyens importants dans la lutte contre le Covid, sur la recherche en particulier. Le communiqué publié hier dit très précisément que 460 millions d'euros seront mobilisés cette année pour soutenir les laboratoires et entreprises engagés dans la lutte contre le Covid-19. Évidemment, ce soutien aux laboratoires inclura un volet sur les questions vaccinales et sur d'autres questions déjà bien identifiées. Il faut aussi qu'il y ait un soutien aux opérations de recherche. Comme vous l'avez dit, si des opérations « Covid flash » étaient mises en place l'an dernier, aujourd'hui les outils sont redevenus plus délicats à manier, et il est important de réaffirmer l'importance de ces programmes urgents par rapport, notamment, au Covid long qui nous occupe ce matin.
Voilà les remarques principales qui me viennent à l'issue de ces échanges. Nos débats feront l'objet d'un compte rendu, d'une synthèse et de recommandations, dans le cadre du travail confié par l'Office aux quatre rapporteurs sur l'épidémie de Covid.
Il me reste à vous remercier une nouvelle fois pour cet échange qui a été mené dans un climat extrêmement constructif, en étant à l'écoute des besoins des patients, de la science et de la recherche.
La réunion est close à 12 h 30.