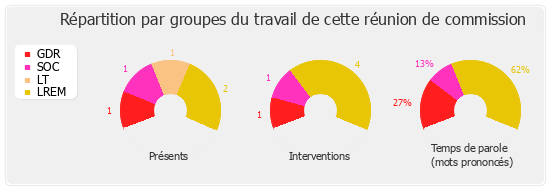Commission d'enquête sur les migrations, les déplacements de populations et les conditions de vie et d'accès au droit des migrants, réfugiés et apatrides en regard des engagements nationaux, européens et internationaux de la france
Réunion du mercredi 8 septembre 2021 à 14h30
Résumé de la réunion
La réunion
La réunion débute à quatorze heures trente.

Nous poursuivons nos travaux avec une après-midi consacrée à la question des mineurs non accompagnés, qui préoccupe nombre des membres de cette commission d'enquête. Nous commençons avec l'audition des associations de terrain de la région parisienne – un des endroits, même si ce n'est pas le seul, où le problème se pose avec force – qui travaillent au plus près de cette population très vulnérable : Médecins sans frontières (MSF), les Midis du MIE et Droit à l'école.
L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mmes Mélanie Kerloc'h, Euphrasie Kalolwa, Agathe Nadimi et M. Sylvain Perrier prêtent serment.)
Merci de nous avoir invités à parler de la situation des mineurs non accompagnés (MNA) que MSF prend en charge en Île-de-France et à Marseille.
Médecins sans frontières n'a normalement pas vocation à agir en France, mais plutôt à l'étranger pour y aider des personnes en difficulté sur le plan médical. En 2016, nous avons constaté l'existence, au sein de la population exilée à la rue à Paris, d'un groupe de mineurs en nombre assez important et particulièrement vulnérables. Sur les 1 930 personnes que nous avons décidé d'héberger en urgence, en décembre 2016, 72 % se déclaraient mineures. Nous nous sommes donc engagés dans la prise en charge des mineurs non accompagnés, en ouvrant d'abord un centre d'accueil de jour à Pantin, en Seine-Saint-Denis, puis progressivement plusieurs maisons pour héberger les cas médicaux les plus complexes, somatiques ou mentaux.
Nous avons pu constater les carences de la prise en charge de ces mineurs et la façon dont ils sont mis en danger sur notre territoire. Les divers aspects de nos activités, qu'il s'agisse de santé, mentale ou somatique, ou d'accompagnement social ou juridique, nous mettent en contact avec tous les obstacles, administratifs, juridiques ou sociaux, que les mineurs non accompagnés rencontrent au quotidien dans leur parcours en France.
Ceux qui se présentent au centre d'accueil de jour de Pantin ont été évalués majeurs par un département, pas forcément d'Île-de-France d'ailleurs, et souhaitent faire appel de cette décision devant le juge des enfants pour faire reconnaître leur minorité et accéder à une protection. La plupart de ces jeunes ont été évalués d'une façon arbitraire, il n'est qu'à lire le compte rendu d'évaluation pour s'en rendre compte. Il s'agit d'une évaluation sociale, puisqu'il n'existe pas de moyen scientifique de déterminer un âge objectif. Elle prend la forme d'un entretien avec une ou deux personnes désignées par le département, par exemple des travailleurs sociaux ou des juristes, dont il ne me semble pas que leur formation leur permette de déterminer l'âge d'une personne. Les entretiens ont parfois lieu sans interprète, sachant qu'une grande partie des jeunes que nous accueillons à Pantin ne parlent pas le français, en tout cas pas assez bien pour un tel enjeu.
Nous constatons que ces entretiens ne permettent pas d'évaluer correctement l'âge des jeunes, puisque 50 % de ceux qui arrivent chez nous finissent par être reconnus mineurs par le juge des enfants au terme de leur procédure.
Pendant plusieurs mois, ces jeunes qui entament un recours sont plongés dans une précarité extrême, sans aucune prise en charge. Ils ne sont pas hébergés, ils n'ont pas de ressources financières, ils ne sont pas toujours scolarisés, à moins d'avoir croisé des associations engagées. Ils sont très seuls. L'accès aux soins est difficile. Comme ils n'ont pas de représentant légal, se faire opérer ou bénéficier de certains actes médicaux est très compliqué, voire impossible. Ils n'ont souvent aucune couverture maladie, puisqu'il faut être accompagné pour mener toutes les démarches nécessaires.
Ces jeunes qui ont déposé un recours devant le juge des enfants devraient bénéficier d'une présomption de minorité qui n'existe pas aujourd'hui. S'ils étaient présumés mineurs jusqu'à la décision du juge des enfants – une décision judiciaire, alors que celle des départements est administrative –, ils pourraient être pris en charge et mis à l'abri entre-temps. C'est selon nous l'enjeu essentiel pour les mineurs non accompagnés.
Je suis psychologue clinicienne et responsable des activités en santé mentale du programme que mène MSF en Île-de-France pour les mineurs non accompagnés en recours.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces jeunes ne sont ni mineurs, ni majeurs. Ils sont dans un interstice : sans représentant légal, ils ne peuvent pas bénéficier des dispositifs dédiés aux mineurs, puisqu'ils ne sont pas reconnus par l'aide sociale à l'enfance (ASE) mais ils ne peuvent pas non plus accéder aux dispositifs prévus pour les majeurs puisque leurs papiers d'identité, qui sont la plupart du temps des extraits d'acte de naissance, sont ceux de mineurs.
Cette situation de « ni-ni » engendre d'immenses difficultés, notamment dans l'accès aux soins. Ces jeunes sont rendus invisibles dans la masse des grands précaires de rue. C'est pour cette raison que nous avons ouvert ce programme, avec l'objectif de proposer une approche globale : étant donné leur situation, il n'était pas possible de ne s'occuper que des questions de soin. Il faut aussi prendre en considération leur situation administrative et juridique, par exemple le type de procédure dans laquelle ils sont engagés, afin de les aider à régulariser leur dossier, et mener des actions sociales puisque ces jeunes sont à la rue, dans le dénuement, sans aucune aide financière, souvent sans formation scolaire, isolés, sans famille ni réseau.
S'agissant de la santé mentale, lorsque nous avons fait un premier tour de ces jeunes avant d'ouvrir le centre, nous nous sommes rendu compte que les acteurs de soin qui étaient censés les recevoir, qui d'ailleurs sont saturés, ne les connaissaient pas. Ils connaissent les mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, mais pas les mineurs en recours. Nous avons donc ouvert une consultation psychologique. Les chiffres dont je dispose concernent les trois premières années du centre, soit 2018, 2019 et 2020.
Environ 2 000 jeunes ont intégré le centre au cours de cette période, dont un tiers ont été orientés vers des psychologues pour un entretien individuel : tous sont bien sûr affectés psychologiquement par leur parcours, mais tous n'ont pas besoin de soins en santé mentale. Sur ces 650 jeunes, 340 sont devenus nos patients. Malgré leur situation d'immense précarité, ils se sont engagés dans un suivi et dans des soins.
Sur cette cohorte de 340 jeunes, un tiers souffrent de psychotrauma. Ils ont développé des troubles soit dans leur pays d'origine, soit sur la route, en faisant face à des exactions graves en Libye, à une traversée de la Méditerranée… Ainsi, 25 % de nos patients ont connu un naufrage en Méditerranée, ce qu'aucune administration ici en France ne prend en compte d'une quelconque façon pour apprécier leur situation. Par ailleurs, 10 à 12 % de ces jeunes souffrent de dépression, généralement liée à des pertes graves dans leur pays. Bref ils arrivent malades sur le territoire et ne peuvent accéder aux soins sans accompagnement –alors que s'ils sont aidés, on voit qu'ils veulent et qu'ils réussissent à se soigner. Et nous avons constaté que leur situation de précarité est telle qu'elle aggrave encore les choses : la symptomatologie flambe, ce qui rend l'ensemble du processus thérapeutique plus long.
Ce qu'il faut noter, c'est que 50 % des jeunes de notre cohorte développent des troubles psychiques ici, en France. Ils arrivent certes affectés par ce qu'ils ont traversé, mais pas malades ; puis ils développent des troubles réactionnels à la précarité et à l'exclusion. Pour nous, soignants, il est essentiel de vous en faire part : nous constatons cliniquement le développement de troubles en lien avec cette précarité. Et il se trouve qu'en pratique, ces jeunes adhèrent aux prises en charge.
Voilà les constats principaux que je peux dresser. Je serai heureuse, si vous me le demandez, de vous donner davantage d'éléments sur ces jeunes, leur parcours, qui ils sont et ce qu'ils vivent.
Je vais moi aussi décrire des situations de terrain, et préciser les différents stades du parcours du mineur isolé étranger.
J'ai créé l'association les Midis du MIE en 2016 autour d'une mission essentielle, celle de nourrir les mineurs isolés étrangers, ou mineurs non accompagnés, qui sont laissés à la rue pendant la période incertaine où leur minorité n'est pas reconnue et qui ne sont pris en charge par aucun pouvoir public.
Chaque année, des centaines de jeunes étrangers arrivent seuls sur le territoire national, principalement à Paris et en Île-de-France, après un parcours migratoire de plusieurs mois, parfois plusieurs années. Fuyant la misère ou la guerre, ils ont quitté pays et famille avec l'espoir d'un avenir meilleur. Leur première demande est d'être scolarisés, d'apprendre un métier, de s'intégrer au mieux, avec une grande volonté qui les mène à des parcours scolaires exemplaires. Ils ont connu des situations traumatisantes, de grandes violences sur leur trajet – la traversée de la mer, le désert, la Libye – et ils découvrent à leur arrivée à Paris l'inhumanité des procédures administratives, alors que leur âge, leur fragilité et leur vulnérabilité devrait leur assurer la protection de l'aide sociale à l'enfance, conformément à sa mission et au droit international.
Dans les faits, la grande majorité des mineurs isolés demandant cette protection la voit rejetée. En Île-de-France, on estime à 80 % le taux de refus après évaluation. Âgés de 13 à 17 ans, ils ne peuvent bénéficier des aides réservées aux adultes et se trouvent exposés à tous les dangers de la rue. Le 115 précise qu'ils ne peuvent pas partager des hébergements avec des majeurs. Or, même s'ils ont été notifiés majeurs, ils sont mineurs et le disent, sans mentir : ils sont ainsi refoulés du dispositif de droit commun, pourtant le seul vers lequel on les ait orientés en leur remettant leur lettre de notification.
C'est sur le trottoir de la rue du Moulin-Joly, à la sortie des locaux du DEMIE (dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers), géré par la Croix-Rouge, prestataire de la ville de Paris, que j'ai découvert, au cours de maraudes matinales, le sort tragique de ces adolescents à qui vient d'être notifié un refus de prise en charge. J'ai décidé de leur apporter des aides de première nécessité, de les faire héberger quand cela était possible, de les écouter, et de les soutenir dans leur procédure de recours, d'ailleurs quasi impossible à entreprendre seul quand on ne connaît pas les rouages, les codes culturels et administratifs ni même la langue du pays dans lequel on vient d'arriver.
J'ai voulu leur offrir un espace à eux, une sorte de cour de récréation en retrait des campements, loin des gares et autres lieux où ils se rendent invisibles. Depuis 2016, le jardin de la Rue-Pali-Kao, dans la continuité du parc de Belleville, au métro Couronnes, à quelques pas du DEMIE, est devenu le cœur de l'activité des Midis du MIE. L'adresse est connue de tous les adolescents arrivant à Paris, au même titre que celle du DEMIE. C'est là que nous distribuons des repas préparés par des bénévoles ou fournis par des restaurants ou des associations partenaires, là que nous recueillons les demandes individuelles de tout ordre.
Au fil des années, avec l'aggravation de la situation générale, notre accompagnement est devenu total. Nos bénévoles sont présents depuis la sortie du DEMIE, pour orienter les jeunes les plus fragiles, jusqu'à la remise aux services de l'aide sociale à l'enfance, en fin de procédure. Entre les deux, nous les accompagnons au tribunal, chez leur avocat, à la permanence de soins médicaux, au vestiaire collectif. Nous proposons aussi des activités ludiques ou artistiques pour apporter de la joie dans leur vie d'adolescent. Nous travaillons étroitement avec les différents acteurs, des associations, des ONG comme MSF, pour orienter les jeunes et couvrir l'ensemble de leurs besoins.
Depuis le premier confinement de mars 2020, les activités des Midis n'ont hélas connu aucun répit. Elles se sont même amplifiées. Plus de soixante déjeuners sont servis cinq jours par semaine dans le jardin de la Rue-Pali-Kao, et le contexte sanitaire nous a contraints à assurer de surcroît un hébergement permanent pour les plus fragiles. Entre octobre 2020 et juin 2021, une quarantaine de jeunes ont ainsi été accueillis dans des lieux collectifs prêtés par des établissements culturels ou associatifs ou dans des chambres d'hôtel payées par l'association. Nous ne proposons pas qu'un toit, mais également des repas et le nécessaire du quotidien : tout cumulé, cela représente des budgets supérieurs à 30 000 euros, un nombre de nuitées considérable, des recherches de lieux, des déménagements à répétition…
Dans le cas des opérations d'évacuation et de mise à l'abri, dont la dernière a eu lieu ce week-end au parc André-Citroën, n'ayant pas d'autre choix, nous occupons des lieux à côté du collectif Réquisitions. Il est évident que le relais doit être assuré par les pouvoirs publics. L'ensemble des mineurs en recours ont été mis à l'abri depuis par la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL) d'Île-de-France.
Toutes nos actions reposent sur le bénévolat. L'association n'a aucun salarié, juste un jeune en service civique depuis février 2021. Les Midis du MIE fonctionnement avec très peu de moyens financiers, grâce à des dons citoyens. La Fondation de France, la fondation Abbé-Pierre et le fonds Riace France ont apporté une aide ponctuelle, à titre exceptionnel, au vu de la situation d'urgence sanitaire. Cela nous a permis de financer des denrées alimentaires, les fournitures nécessaires pour préparer et distribuer plus de trois cents déjeuners par semaine ainsi que des petits déjeuners pour les maraudes du matin près du DEMIE, de petits téléphones mobiles, remis aux adolescents afin qu'ils soient joignables à tout moment et puissent rester en contact avec leur famille, des cartes de recharge téléphonique à 5 euros, des produits d'hygiène, des vêtements, des duvets en cas d'urgence, des fournitures éducatives pour les cours suivis auprès d'associations partenaires ou en établissement scolaire, des chambres d'hôtel, entre 44 et 70 euros la nuit, les frais liés aux hébergements collectifs assurés dans des lieux solidaires ou culturels – matériel, lessive, entretien, chauffage, participation aux frais… – les repas naturellement offerts aux adolescents hébergés et enfin quelques sorties.
L'association n'a malheureusement jamais été aussi active que ces derniers mois, du fait de la situation d'abandon dans laquelle sont laissés ces adolescents malgré les inlassables signalements faits aux pouvoirs publics – État, élus, ville de Paris, départements, pourtant légalement responsables. Ces deux dernières années, nous avons beaucoup développé notre accompagnement juridique, car nous ressentons une obligation de résultat envers ces adolescents qui demandent notre aide. De la décision de placement dépend en effet tout leur avenir – car ils ne repartiront pas dans leur pays d'origine, c'est-à-dire pour notre association majoritairement en Afrique : Sierra Leone, Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Tchad. Nous nous occupons aussi d'Afghans.
Je me permets de vous donner quelques exemples des failles et autres anomalies du système tel qu'il fonctionne actuellement, en commençant par l'évaluation par le DEMIE.
Imaginez l'état d'esprit d'un jeune arrivant d'Italie ou d'Espagne après un long voyage et qui se présente à la Croix-Rouge ou à France terre d'asile, organisations connues pour leur bienveillance, bien loin de comprendre l'enjeu de l'évaluation et du refus qui lui sera opposé. Parfois sans interprète, il doit répondre à des questions sur sa scolarité – classes sautées, redoublements… alors qu'il n'a le plus souvent fréquenté que l'école coranique – ou sur son trajet – qui a pu durer des mois sans repère temporel ni géographique. Toute hésitation ou incohérence est source de suspicion sur sa sincérité. La décision de refus relève d'un seul agent, dont l'identité, d'ailleurs, n'est pas communiquée. Pour la ville de Paris, la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé, qui ne verra jamais le jeune, se basera sur cette évaluation pour notifier le refus.
Des erreurs sont commises. Il m'est arrivé d'accompagner un jeune, après des mois d'attente, devant un juge pour enfant qui avait dans les mains un rapport concluant à la minorité alors qu'une lettre de refus avait été remise. Différentes rencontres ou ateliers autour de l'évaluation ont eu lieu avec le cabinet de Mme Versini, adjointe à la maire de Paris en charge des droits de l'enfant et de la protection de l'enfance, mais les préconisations et champs d'amélioration qui ont été actés ne trouvent hélas pas de traduction sur le terrain.
S'agissant de l'expertise des documents, la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité (DEFDI), chargée de l'expertise des documents étrangers, émet des avis défavorables non justifiés, ou fondés sur des irrégularités de forme. Nous avons fait une expertise sur des jugements guinéens dont nos avocats spécialisés ont pu se servir dans des dossiers dont l'issue fut favorable devant les juges.
Certains départements demandent la production des documents au moment de l'évaluation. Or il est plutôt rare à ce stade que les jeunes aient un document d'identité, encore moins légalisé dans leur pays d'origine et en France, double exigence valable pour la Guinée par exemple, ou alors traduit, comme c'est demandé pour la taskera afghane, entre autres. Comment un mineur isolé sans moyens peut-il, sans l'aide d'associations, payer pour l'acheminement de ces papiers, les faire légaliser, demander des pièces d'identité auprès de l'ambassade et les faire traduire par des traducteurs assermentés ?
S'agissant du fonctionnement de la procédure judiciaire, chaque juge est souverain dans son appréciation de la minorité du jeune et peut fonder sa décision sur les éléments qu'il souhaite. La valeur donnée à l'avis de la DEFDI sur les documents et à la décision de refus du DEMIE nous semble excessive dès lors que les textes et la jurisprudence accordent le bénéfice du doute au jeune en cas d'éléments défavorables. Il est à noter que certains juges se déclarent incompétents sans avoir convoqué le jeune, se basant sur le simple rapport de l'évaluation. D'autres demandent le dépôt des documents d'identité pour expertise et recevront le jeune des mois plus tard. D'autres encore ordonnent des tests osseux sans voir le jeune, dès réception de la demande de protection.
Depuis sa création, notre association a obtenu des centaines de décisions de placement pour des jeunes reconnus comme mineurs. Entre novembre 2020 et juillet 2021, trente et un d'entre eux ont vu leur recours aboutir, dont dix-huit devant le tribunal pour enfants de Paris, six à Bobigny, cinq à Créteil. Cela représente 98 % des jeunes suivis et confirme la réussite des dossiers bénéficiant d'un accompagnement rapproché. Actuellement, une dizaine de jeunes sont en attente d'audience ou de décision et neuf, rencontrés et pris en charge au jardin entre juillet et août, sont en début de procédure.
Certains jeunes, dont le recours a été déposé entre avril et juin, n'ont toujours pas de date d'audience. Le temps passe pour eux, sans possibilité de scolarisation en dehors du biais associatif pour quelques-uns. Leurs 18 ans approchent, et la défaillance de certains juges est réelle. Trois jeunes sont en appel pour des raisons arbitraires. Il est important de noter que les tests osseux, qui ne doivent être selon la loi qu'un dernier recours, sont souvent demandés avant même l'expertise ou le retour d'expertise des documents et qu'ils sont interprétés au bon vouloir du juge. Plusieurs études montrent d'ailleurs leur inefficacité.
J'en viens à la clé de répartition nationale et à la réévaluation. Certains jeunes évalués mineurs sont transférés vers d'autres départements : la clé de répartition est enclenchée en fonction des places disponibles sur le territoire national. Or certains départements procèdent à une réévaluation systématique et n'hésitent pas à déclarer le jeune majeur et à le remettre à la rue, y compris lorsqu'il avait obtenu une ordonnance de placement de la part d'un juge. Cela se produit à Angers, au Mans, dans les Yvelines… La liste hélas est longue. Le jeune est souvent dissuadé d'entreprendre un appel et revient alors chercher de l'aide en région parisienne, où il se retrouve à nouveau à la rue. Il n'a d'autre solution que de saisir un juge, souvent celui qui l'avait reconnu mineur…
Il semble indispensable que l'ensemble des départements accueillent évitent de remettre en cause l'évaluation faite par un autre département, voire par un juge.
Passons aux conditions de mise à l'abri. Une fois pris en charge par la DRIHL, les jeunes sont hébergés dans des établissements hôteliers, dans des conditions d'accueil variables. Ils ont droit parfois à trois repas, parfois à deux, parfois à un seulement. Certains ont des titres de transport, d'autres pas. Et l'encadrement par des assistants sociaux est très inégal selon l'opérateur social ou l'association mandatée : Coallia et Alteralia par exemple, qui pourtant doivent recevoir le même budget journalier, ne fournissent pas les mêmes prestations.
Selon la qualité de cet accueil, qui risque de durer des mois, certains jeunes que nous suivons se découragent. Ils craignent de perdre leur place ailleurs, mais partir ruinerait de toute évidence notre suivi juridique. Ils sont mélangés avec des adultes, mais même si l'État les a évalués comme tels, ils sont engagés dans des procédures administratives pour mineurs.
S'agissant de la prise en charge par l'ASE, une fois la décision favorable du tribunal pour enfants rendue, le SEMNA (secteur éducatif des mineurs non accompagnés) parisien se montre plutôt diligent, qu'il s'agisse d'hébergement, de scolarisation ou de conclusion d'un contrat jeune majeur. C'est un exemple à suivre pour tous les autres départements, notamment pour la Seine-Saint-Denis voisine où il n'y a aucune prise en charge. Beaucoup de départements remettent les jeunes à la rue le jour de leurs 18 ans, sans rien.
Notre association, comme de nombreuses autres, défend la présomption de minorité. Le projet de loi de protection de l'enfance de M. Taquet impose la prise des empreintes dans tous les départements. En Île-de-France, Paris, le 93 et le 94 s'y refusaient jusqu'à présent. Comment le jeune sera-t-il reçu par le dispositif d'évaluation ? Sera-t-il directement envoyé prendre un rendez-vous en préfecture ? Sera-t-il mis à l'abri tout au long de la période d'investigation ? Les prestataires mandatés pour faire les évaluations auront-ils leur libre arbitre face à la préfecture ? Quelles seront les conséquences ?
Partout en France, de plus en plus de jeunes pourtant présumés mineurs sont envoyés en centre de rétention administrative, parfois à la sortie du service des évaluations, parfois au sein même des locaux de l'ASE. Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) peut être délivrée à la sortie de l'évaluation.
Nous défendons donc la présomption de minorité, au vu des fréquentes erreurs commises par les services d'évaluation et du nombre de mineurs finalement placés à l'aide sociale à l'enfance par un juge. Nous demandons un réel suivi et un accompagnement par les institutions jusqu'à épuisement des voies de recours. Nous demandons l'harmonisation des pratiques entre les juges pour enfants et entre les départements, la disparition des réévaluations, l'arrêt des remises à la rue à la majorité, un accompagnement personnalisé, plus de foyers et de moyens financiers, un encadrement adapté, une meilleure répartition du budget pour les mineurs non accompagnés et les jeunes majeurs isolés – bref, que la France honore la Convention internationale des droits de l'enfant et applique les textes en la matière.
Nous demandons la création partout en France, comme cela se fait déjà dans quelques rares départements, de dispositifs d'hébergement adaptés pour tout le temps du recours, avec une prise en charge médicale, sociale, administrative et éducative. Il est de notre devoir d'accueillir ces adolescents qui sont l'avenir de notre pays. Ils prétendent à la réussite, leurs résultats sont exemplaires une fois dans les rouages de la scolarisation et de l'apprentissage.
Tout cela est essentiel pour nos valeurs humaines et pour celles de la République. C'est essentiel pour éviter les dérives et la mainmise des trafiquants en tout genre, qui mène à une vie de délinquant nuisible à la réputation et au parcours des autres, et au travail des associations et des politiques. Il est de notre devoir d'accueillir ces jeunes sans restriction ni distinction et de les aider à construire leur avenir, qui est aussi l'avenir de notre pays.
Merci de nous écouter. Je suis consultant en gouvernance d'entreprise, entrepreneur et un des fondateurs de l'association Droit à l'école.
J'habite à côté de ce jardin dont on a parlé et j'ai commencé, il y a quatre ou cinq ans, à héberger des jeunes. J'en ai cinq à dix à la maison en permanence. Ne sachant pas bien quoi en faire dans la journée, j'ai monté d'abord des cours, avec d'anciens professeurs, puis une vraie école. L'école des sans école accueille aujourd'hui une soixantaine de jeunes, qui ont cours tous les jours. Ce sont les jeunes dont on vient de parler, qui sont à la rue la plupart du temps, sous des tentes, ou quand ils ont un peu plus de chance dans des centres sociaux parisiens ou chez des hébergeurs solidaires.
L'objectif est de les remettre à niveau, de leur donner un cadre et des horaires. Ils viennent sur la base du volontariat et sont là absolument tous les jours. Nous avons une liste d'attente de 150 jeunes qui nous relancent sans cesse : ils veulent aller à l'école, ils le réclament du matin au soir. Quand l'association n'existait pas, les jeunes qui habitaient chez moi allaient toute la journée en bibliothèque. Bien sûr, ils faisaient ce qu'ils pouvaient – les jeunes Afghans par exemple ont plus de mal à se mettre au français que d'autres – mais ils faisaient leurs huit heures par jour – dans un endroit chauffé. Bref, malgré leurs conditions de vie très précaires, ils ont la volonté de s'intégrer et d'aller à l'école. Alors pourquoi ne pas y répondre ?
Ce sont des garçons et des filles – nous en avons une quinzaine à l'école – dont le parcours migratoire a été marqué par des situations de maltraitance extrême, d'abus, de travail forcé et pour les jeunes filles a minima de violences sexuelles. La traversée par voie maritime a été traumatisante. Aucun n'a échappé à la vision de la mort, même ceux qui sont passés par l'Iran ou la Turquie, ou qui viennent du Bangladesh ou de l'Afghanistan. La violence a fait partie de leur parcours, qui a été au minimum de six mois, parfois d'un an ou un an et demi quand ils devaient gagner leur vie à chacune des étapes.
Le pire, c'est qu'ils continuent ici à être maltraités. C'est vraiment dingue, d'autant que – je n'en étais pas conscient il y a cinq ou six ans – la plupart d'entre eux, au moins les francophones, ont l'impression d'avoir souffert tout cela dans le but de nous rejoindre, nous. La France représente quelque chose pour eux, ils parlent le français, ils ont subi tout cela et quand ils arrivent enfin, c'est dans le pire de ce qui existe ici.
Comme cela a déjà été dit, la plupart d'entre eux seront finalement reconnus mineurs. C'est le cas de 80 % des 180 ou 200 jeunes qui passent par an dans notre école, à Ground Control, dans le 12e arrondissement de Paris. Le problème est qu'ils sont reconnus mineurs juste avant leur majorité ! Qu'ils ont perdu deux ans, et ce entre 14 et 18 ans, un âge où on doit se construire et où on a envie d'apprendre ! C'est un gâchis incroyable, et cela alors qu' il y a des places pour eux à l'école.
D'où cela vient-il ? Les problèmes sont de deux types : les freins à la scolarité, et les freins administratifs au titre de séjour.
Pour ce qui est des freins à la scolarité, on n'en comprend pas bien les raisons. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans en France, et c'est un droit jusqu'à 18 ans : alors pourquoi pas pour eux, sachant que l'école est le marchepied indispensable pour l'intégration dans la République et dans nos valeurs, et qu'ils réclament d'y aller ?
La première difficulté que nous rencontrons, celle que nous renvoient les académies toute la journée, est qu'ils n'ont pas de tuteur légal. Et alors ? Pourquoi leur en demande-t-on un, si ce n'est pour les bloquer ? Selon le ministère de l'intérieur, 6 000 jeunes sont arrivés entre le 1er janvier et le 31 août 2020 : après un rapide calcul, cela en représente un mineur toutes les quinze classes… À Paris, où nous sommes en lien avec toutes les classes d'accueil, nous savons qu'il y a des places libres. Les profs réclament des jeunes comme les nôtres, qui sont motivés, qui sont tous les jours à l'heure et qui sont absolument toujours les premiers de leur classe. Pourquoi freinons-nous des quatre fers ?
Il s'avère que certaines académies un peu conciliantes passent outre à l'absence de tuteur légal pour scolariser un jeune, s'il est suivi par une association. Mais voilà qu'on nous demande des preuves d'hébergement ! Comment faire alors qu'ils sont dans des foyers, trimbalés d'un hébergeur à un autre, parfois sous des tentes ? D'autant qu'on ne nous demande pas n'importe quelle preuve : le contrat d'achat de l'appartement, les taxes foncières ou d'habitation… Pourtant, un décret du 29 juin 2020 vise à la simplification des documents demandés pour une inscription à l'école. C'était une avancée, mais qui malheureusement s'arrête à 16 ans alors que les jeunes que nous suivons ont majoritairement 17 ans.
Et puis certaines académies ne jouent absolument pas le jeu. Dans les Hauts-de-Seine, il n'y a pas une seule classe d'accueil : que faire d'un jeune Afghan qui ne parle pas le français et qui a un bon niveau de troisième en maths ? Sans classe d'accueil pour lui apprendre le français, impossible de l'envoyer passer un CAP en lycée professionnel. Il en est de même dans les Yvelines, alors que Paris compte presque une centaine de classes d'accueil.
Les académies doivent jouer le jeu, sans quoi rien n'est possible. En Seine-Saint-Denis, on dit à certains jeunes après leurs tests d'évaluation qu'ils peuvent aller à l'école. Puis on se rend compte qu'ils ont 17 ans, on se dit que la majorité est proche… et on ne leur trouve pas de place ! Bref on les laisse dans la rue alors qu'ils veulent aller à l'école, sachant que c'est le seul moyen de les intégrer et de les rendre comme tous les autres.
Quand les classes d'accueil existent, l'idéal serait qu'elles se trouvent dans des lycées généraux plutôt que des lycées professionnels, où les arrivants se retrouveront avec des jeunes plutôt en difficulté. Heureusement, les choses bougent de plus en plus dans le privé, où nous créons des classes d'accueil auprès des jeunes des beaux quartiers. Après une petite appréhension des parents d'élèves lors de la réunion de rentrée, tout se passe très bien ! Car ce sont des jeunes comme les autres – avec la volonté, la motivation et l'envie de réussir en plus : presque mieux !
Tout compte fait, les problèmes d'accès à la scolarité, à Paris en tout cas, finissent avec l'expérience par se résoudre relativement bien. Mais le second problème, celui de l'accès aux titres de séjour en préfecture, est kafkaïen. C'est même de la vraie maltraitance.
Le jeune doit déjà arriver à reconstituer son identité, à obtenir un passeport de son pays. Souvent, ce qui a motivé son départ est la perte de son deuxième parent, et l'impossibilité d'aller à l'école. Il n'a aucun contact au pays, et il est presque impossible pour lui de faire venir des documents comme des actes de naissance.
Obtenir un rendez-vous dans un consulat, c'est un an d'attente. Pareil pour une préfecture. Sauf qu'il en faut beaucoup, des rendez-vous : une carte de l'AME (aide médicale de l'État) c'est quatre mois, une domiciliation cinq mois… Difficile de faire ses études tranquille ! Pour obtenir un rendez-vous dans une préfecture, il faut faire des copies d'écran prouvant qu'il n'y a pas de créneau disponible. Pendant un an, le jeune va faire une douzaine de copies d'écran tous les jours, pendant les récréations, avant de saisir un juge qui va obliger la préfecture à le recevoir. Pour le rendez-vous, il doit avoir sa promesse de contrat d'alternance et son inscription en centre de formation d'apprentis (CFA). Sauf que le patron qui lui a signé une promesse d'embauche ne va pas l'attendre pendant un an et demi ! Au moment du rendez-vous donc, il y a toutes les chances que le jeune ait perdu son patron, son alternance et son CFA : il sort alors de la préfecture pour tout recommencer à zéro… Les associations le voient revenir, de nouveau à la rue, alors même qu'il avait été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Un truc de fou.
J'ai rencontré le ministre de l'éducation nationale, M. Blanquer, avec un jeune qui n'arrivait pas à obtenir un rendez-vous en préfecture. Il a trouvé cela absolument anormal – il y en a des centaines à Bobigny. Il a écrit lui-même un mot au préfet, et la situation ne s'est pas débloquée. C'est fou.
Troisième folie de notre système : les OQTF, qui pleuvent aujourd'hui sur des jeunes qui sont en France depuis quatre ou cinq ans. Ils ont été à l'aide sociale à l'enfance, ils ont fait des études, ils ont un diplôme, souvent une copine en France, ils ont un travail, une promesse d'embauche, une proposition de poursuite de la scolarité en BTS ; ils reçoivent l'OQTF et ils perdent tout. Vont-ils repartir au pays au bout de cinq ans, après avoir tout donné ? À Paris en tout cas, les OQTF tombent tous les jours pour des jeunes scolarisés et diplômés.
Autre problème administratif : l'impossibilité de poursuivre une formation en alternance. Jusqu'au début de cette année, quand on avait un visa d'étudiant, on pouvait demander une autorisation de travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Aujourd'hui, il faut passer par la préfecture. Alors qu'un titre de séjour étudiant devrait être compatible avec une alternance, puisqu'il permet de travailler la moitié de son temps, il faut aujourd'hui un titre de salarié. De crainte de recevoir une OQTF, le jeune, qui n'a pas de titre de séjour salarié, arrête son alternance. Cela met les patrons solidaires vraiment en rogne.
Il y a de quoi l'être, quand il y a 260 000 jobs non pourvus dans le BTP, et 9 000 dans la boulangerie. On a investi dans ces jeunes – environ 12 000 euros par an pour ceux que nous avons réussi à mettre à l'école – on les a motivés, ils ont été de brillants élèves, et on leur dit de retourner à la rue, traîner devant les stations de métro pour essayer de vendre des tickets ? Parce qu'il faut bien survivre !
Nous avons deux propositions. La première est de pousser les académies à remplir leur mission pour intégrer ces jeunes, comme certaines le font très bien, de simplifier les choses et de faire en sorte que tous les jeunes puissent accéder à l'alternance sans passer par les préfectures, qui bloquent manifestement les choses.
La seconde proposition, essentielle, serait que tout jeune qui a commencé des études en France avant ses 19 ans voie sa situation sanctuarisée jusqu'à sa première promesse d'embauche, qui lui permet de faire une demande de titre de séjour salarié, comme tout le monde. Je vois cela comme un « tunnel anti-interférences », un moment où les jeunes sont complètement protégés.
Pendant ce temps, ils devraient avoir accès à un toit, à un centre d'hébergement d'urgence. Les adultes y ont droit, les mineurs y ont droit, pourquoi pas tous les jeunes qui sont scolarisés dans un lycée de la République ? Ce ne serait pas bien compliqué à réaliser. Ils devraient aussi avoir l'aide médicale de l'État : ils y ont droit, ce n'est pas la peine de les faire attendre pendant des mois et des mois. Et ils auraient ces trois ou quatre années tranquilles pour finir leurs études ; ensuite ils pourraient aller se battre à la préfecture, accompagnés par les bénévoles.
Il faudrait aussi dans chacune des préfectures un guichet unique pour ces jeunes scolarisés. Cela a existé : RESF (Réseau éducation sans frontières), formidable association qui aide les jeunes scolarisés à obtenir des papiers, avait ses entrées dans les préfectures pour s'occuper de leurs cas. Un jeune qui commence son alternance en septembre doit obtenir des rendez-vous pour son autorisation de travail sans avoir à attendre douze à dix-huit mois et à saisir le juge ! Mais non, tout cela a disparu récemment. On ne prend pas en considération la spécificité de ces jeunes, qui sont des lycéens, des étudiants en BTS et qui ont besoin qu'on leur simplifie un peu la vie dans toute cette galère que je vous ai racontée.
Je tiens à remercier pour finir ces milliers de professeurs de l'éducation nationale qui soutiennent tous les jours dans leurs classes nos élèves, avec passion et dévouement. C'est vraiment la seule institution qui leur redonne de l'espoir. Pour ceux qui ont la chance de l'intégrer, l'éducation nationale fait vraiment des merveilles.
Si j'ai un message à passer aujourd'hui, c'est que ces jeunes ne peuvent pas continuer durablement à souffrir et à être nos boucs émissaires.

Comme je le dis souvent, l'histoire ne se rappellera que les gens qui ont tendu la main. Merci pour tout ce que vous faites.
Nous avons déjà noté, à la suite des précédentes auditions, bon nombre des recommandations que vous avez faites. Nous reprendrons également l'idée d'un « tunnel anti-interférences ».
Tous les centres communaux d'action sociale (CCAS) ont une obligation de domiciliation. J'ai néanmoins constaté dans le 93, avec Sébastien Nadot, que cette obligation n'est pas respectée dans toutes les villes – je ne dirai pas où –, ce qui crée le fameux « appel d'air » : on s'échange les bonnes adresses, celles où on respecte la loi. Nous mettrons l'accent sur la nécessité de l'application de la loi. Qu'en est-il dans vos communes ? Nous intégrerons aussi la question du tuteur légal et celle de la présomption de minorité.
Je ne jette pas l'opprobre sur la Croix-Rouge et France terre d'asile. Le débat est très difficile, et il y a tellement de problèmes qui se posent… Ce que nous souhaitons, ce n'est pas qu'il y ait des vainqueurs et des vaincus mais simplement que l'on se mette autour de la table pour trouver des solutions aussi satisfaisantes que possible.
Les « mijeurs » – majeurs ou mineurs, on ne sait pas –, sont confrontés à un vide juridique. Quid de la proposition qu'avait faite Brigitte Bourguignon, lorsqu'elle était encore députée, pour l'accompagnement des jeunes majeurs jusqu'à 21 ans ?
Personne ne nous avait parlé jusqu'à présent d'un guichet unique ou d'une voie d'accès spécifique pour les mineurs, mais nous en prenons également note.
Les histoires types ont-elles changé depuis quelques années ? Sont-elles toujours liées à la perte d'un parent ?
J'aimerais vous entendre davantage au sujet des femmes. Même si elles ne sont peut-être pas nombreuses, y a-t-il des spécificités les concernant ?
Enfin, pouvez-vous nous dire combien de personnes vous accompagnez ?

Nous avons pu mesurer lors de nos déplacements l'écart entre le droit et la réalité de ce que vivent au quotidien les mineurs non accompagnés ou, parfois, accompagnés – nous avons notamment rencontré des jeunes Soudanais de 15 ou 16 ans à Calais et nous sommes allés dans des squats du 93.
La remarque de Sylvain Perrier sur les personnels de l'éducation nationale, qui constituent le dernier rempart, est importante. La solidarité qui se manifeste à travers le monde enseignant et les associations est magnifique, mais pas suffisante. Il y a un grave problème de responsabilité de tous les autres acteurs en ce qui concerne les mineurs non accompagnés. Nous avons bien vu toutes les difficultés, tout ce que l'État n'assure pas comme il le devrait en matière d'accès au droit.
S'agissant des enfants que vous accueillez et accompagnez, constatez-vous des parcours nouveaux ou différents depuis deux ou trois ans ?

Ce que vous avez dit était très complet – bien plus encore que ce que mon expérience en tant que députée et militante a pu m'apprendre.
Je suis très inquiète pour les mineurs non accompagnés. En effet, à une phase d'invisibilisation succède une période d'instrumentalisation dans le débat public, médiatique et politique, ce qui met ces jeunes en grave danger. Nous avons vraiment un devoir vis-à-vis d'eux, et cela vaut aussi pour les préconisations que vous ferez, madame la rapporteure et monsieur le président. Avant d'aligner des propositions, il faut renverser la logique suivie en matière d'accueil et grâce à une présomption de minorité, voire d'innocence, les mineurs non accompagnés étant comparés, dans le débat public, à des fraudeurs ou à des criminels.
Il est presque douloureux de vous entendre dire à quel point ces jeunes sont courageux et formidables. C'est vrai, et on ne devrait pas avoir à le souligner. Néanmoins, l'instrumentalisation actuelle finit par pousser à le faire, pour leur donner leur vrai visage.
Les tests osseux sont malheureusement demandés, parfois par les jeunes eux-mêmes, faute d'autre solution, et que c'est ce qui permet souvent au juge de trancher. On en déduit ensuite que tous les papiers sont faux : tout dépend de ces tests. Je continue à dire qu'il faut les interdire et regarder comment on accompagne les juges.
Même si cela ne concerne évidemment pas la majorité et que cette question fait partie de l'instrumentalisation dont j'ai parlé, certains jeunes ont de très fortes addictions et sont impliqués dans des trafics. Les pouvoirs publics, ceux qui veulent bien faire – disons-le ainsi – sont parfois en difficulté s'agissant du traitement de ces mineurs et de leur accord. Qu'en pensez-vous ?
Il y avait dans ma préfecture, avant que je devienne députée, des rendez-vous mensuels ou trimestriels pour traiter des cas particuliers, comme ceux des femmes violentées et des jeunes accompagnés par l'ASE. À ma connaissance, tout cela a complètement disparu. Ce n'était pas un guichet pour les mineurs non accompagnés, mais un traitement spécifique visant à permettre aux associations, à qui on délègue tout, puisque l'État ne fait pas son boulot, de bien faire le leur jusqu'au bout.

Il faudrait aussi parler des milliers de places d'hébergement qui ont été créées, en très peu de temps. On ne peut pas prétendre que rien n'est fait, mais je vous soutiens sur beaucoup de points.
Les enfants sont notre futur. Je suis toujours plus touchée quand je vois un jeune mineur dehors. C'est notre criminalité qu'on est en train de créer. Il y a eu des échanges un peu houleux à la commission des affaires étrangères entre ceux qui ont une vision très sécuritaire de ces questions – je crois que ce n'est pas le cas de la majorité des membres de cette commission d'enquête – et ceux qui disent qu'il faut ouvrir les frontières. Nous devons essayer de trouver des solutions pour que ces jeunes qui commencent leur vie puissent entrer dans un « tunnel » sans trop d'interférences.

Je suis députée d'Asnières et de Colombes, dans le 92, comme Elsa Faucillon.
Vous avez dit que des deuxièmes évaluations ont lieu dans les départements. La loi relative à la protection des enfants l'interdira.
J'ai été enseignante en UPE2A (unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants) et je vous remercie pour vos propos concernant les professeurs. J'ajoute que les éducateurs s'investissent aussi à fond. Je suis en contact avec l'EREA (établissement régional d'enseignement adapté) Martin Luther King d'Asnières. Néanmoins, comme l'a dit Sébastien Nadot, ce n'est pas suffisant.
Un rendez-vous systématique est prévu avant 18 ans pour les jeunes confiés à l'ASE, depuis une circulaire de septembre 2020, afin d'essayer d'éviter les ruptures dans les parcours. Avez-vous constaté une amélioration ? Une ordonnance du 16 décembre 2020 prévoit, par ailleurs, qu'un jeune doit obtenir un titre de séjour s'il justifie de six mois de formation professionnelle. Je suis en relation avec les associations, comme RESF, et j'ai l'impression qu'il y a une différence de statut dans la loi selon que l'on est arrivé avant ou après 16 ans sur le sol français. En tant que législateur, j'aurais tendance à plaider pour qu'on y mette un terme. Quand on est arrivé avant 16 ans, on a un titre de séjour vie privée et familiale. C'est beaucoup plus facile que lorsqu'on est arrivé après 16 ans, car on doit alors justifier de six mois de formation professionnelle. Il y a un immense gâchis, je le confirme, aux yeux des enseignants et des éducateurs qui se mobilisent pour ces jeunes. Supprimer cette distinction ne permettrait-il pas de simplifier la situation ?
Une proposition phare serait de rétablir un accès facile aux autorisations de travail. Là aussi, il y a un gâchis énorme. C'est récent : si on réagit vite, je me dis qu'on pourra revenir en arrière. J'aimerais aussi avoir votre avis sur ce point.

Les situations qui ont été décrites concernent plutôt les milieux urbains. Je suis députée d'un milieu rural, dans l'Orne, mais je constate les mêmes difficultés de parcours et les mêmes problèmes pour les jeunes, lorsqu'ils sont des mineurs non accompagnés et accèdent à la majorité. Face à ces constats édifiants, la première chose que nous demandons, c'est de commencer par respecter le droit existant. On peut ensuite s'interroger sur l'utilité de revoir les politiques d'accueil, pour faire un pas supplémentaire.
S'agissant des relations entre les associations de bénévoles et les organismes professionnels d'accueil, qui ont été évoquées, pouvez-vous préciser quelles difficultés on rencontre ? Quel travail positif, par exemple en matière de respect des droits des enfants, pourrait-on envisager entre ces acteurs ?
S'agissant de la santé mentale, vous avez dit que 50 % des jeunes développaient des troubles psychiques après leur installation dans notre territoire. Pouvez-vous nous apporter des précisions ? J'avais le sentiment que les jeunes développaient ces troubles à cause d'un accueil qui n'était pas satisfaisant. Or l'accueil ne pourrait-il pas constituer un premier soin ?
Nous sommes tous d'accord : il y a un écart très important entre le droit et la réalité et, en outre, le droit n'est pas adapté. On doit effectivement revoir la démarche dans son ensemble. Ce qui prime pour l'instant, en ce qui concerne les MNA, c'est le contrôle des « flux migratoires » et non la protection de l'enfance, que la France est pourtant tenue d'assurer en raison de ses engagements internationaux.
Depuis que nous avons ouvert notre centre à Pantin, en décembre 2017, 2 500 jeunes en ont bénéficié. La proportion de jeunes filles est de 3 %. Nous avons beaucoup de mal à « capter » des jeunes femmes, alors qu'elles sont là : on les voit dans les parcours migratoires et aux frontières mais elles disparaissent en France, ce qui est très problématique. Il faut réellement s'atteler à la vulnérabilité particulière qui est liée au genre – je pense en particulier à la traite des êtres humains. Le constat est grave : il existe un réel besoin de protection.
S'agissant de la domiciliation, il y a vraiment un refus de prise en charge, qui se traduit par des aberrations. À Pantin, nos jeunes bénéficient d'un suivi médicosocial, mais ils n'ont pas accès à une domiciliation administrative au CCAS : ils restent sans réponse. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à cette commune en particulier : je sais que les CCAS sont sous-dotés, qu'ils n'ont pas de moyens pour mener à bien l'activité de domiciliation. Cela peut expliquer les refus, mais ces derniers sont très problématiques, car la domiciliation est une porte d'entrée pour les droits. Sans domiciliation, on ne peut avoir de couverture médicale, on ne peut pas bénéficier de l'AME, et il est difficile d'être scolarisé.
Les tests osseux sont utilisés, à tort, pour leur caractère scientifique. Nous sommes favorables à leur interdiction. Cet outil a été construit dans les années 1930 à partir d'études corporelles conduites sur des jeunes nord-américains, ce qui n'est pas cohérent avec le public actuel. Par ailleurs, il est reconnu que ces tests ont une marge d'erreur importante, de deux ans, notamment à l'adolescence, mais ce n'est pas systématiquement pris en compte par le juge. Le jeune ne bénéficie pas toujours de la marge d'erreur, alors que cela devrait être le cas. Quand on a 16 ans, on peut ainsi être déclaré majeur.
Le parcours est constitué de ce qui s'est passé dans le pays d'origine, sur la route et ici. Or souvent, on ne considère que ce qui s'est déroulé avant l'arrivée sur notre territoire.
Nous travaillons avec le Comité pour la santé des exilés (COMEDE) et avec les acteurs de soins. Chez les patients que nous recevons – la cohorte est de 340 personnes –, le deuil est une dimension très présente : 50 % ont perdu un proche chez eux ou sur la route. Leur vie personnelle a été déstabilisée et leur famille a été désorganisée. Ils viennent d'environnements très instables politiquement – au Mali, en Côte d'Ivoire ou en Guinée Conakry –où il n'existe pas d'autre protection que celle de la famille. Si celle-ci se décompose, vous n'avez plus de protection, ni d'issue. Les patients nous parlent des ruptures qu'ils ont vécues au cours de leur enfance ou de leur jeune adolescence et qui ont précipité leur départ, en l'absence d'autres possibilités. Les jeunes prennent la route, où ils connaissent des violences, d'une manière absolument dramatique quand ils passent par la Libye et par le désert, mais aussi dans les forêts du Maroc et lors de leur traversée de la Méditerranée. Or ce n'est pas entendu et reconnu ici. Nous suivons également de jeunes demandeurs d'asile originaires d'Afghanistan, qui ont vécu des exactions graves dans leur pays, sur la route et en Europe – ils ont eu de longs parcours.
Il faut aussi intégrer ce qui se passe chez nous. Ce dont se plaignent nos patients, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe. S'ils maîtrisent la langue française et s'ils ont déjà vécu dans une capitale, c'est une chance pour eux, car ils ont alors des repères. Mais certains sont analphabètes et ne maîtrisent ni le français ni la manière dont on se repère ici. Ils nous décrivent comme le « pays des rendez-vous » : les semaines et les mois ne sont pas rythmés de la même façon, la temporalité n'est pas la même. Ces jeunes ont tout simplement envie qu'on leur explique les choses. Si on ne le fait pas, le décalage est important. Cela ne crée pas des troubles psychiques pour tout le monde, mais cela peut constituer un terreau.
Les 50 % de jeunes dont je parle, dans notre patientèle, ont tenu le coup psychiquement, ils sont affectés par ce qu'ils ont vécu mais ils ne sont pas malades. Lorsqu'ils se trouvent à la rue – ils peuvent bénéficier d'une solidarité grâce à des hébergeurs, mais d'une manière très discontinue, qui ne peut pas remplacer un équilibre à long terme –, lorsqu'ils sont confrontés à un système qu'ils ne comprennent pas, à une machine administrative, c'est David contre Goliath. Ils ont un sentiment d'impuissance terrible et toute une série de représentations et de fantasmes. La peur d'être déporté, après avoir perdu un ami en Méditerranée et être passé par tout cela, est insupportable.
Par ailleurs, ce sont des jeunes qui vivent sans un euro, sans consommer, ce qui est fou dans une société telle que la nôtre. Ils nous disent qu'ils ne supportent pas le regard des autres. L'un d'eux avait le sentiment d'être un déchet, il disait qu'on le regardait comme s'il était une poubelle.
Au-delà de la dimension narcissique, vous avez évoqué la question de l'instrumentalisation et celle de la délinquance. La société française ne propose rien durant cette phase de ni-ni – je ne parlerais pas de « mijeurs », mais de ni mineurs ni majeurs. En revanche, des gens qui peuvent avoir une prise sur eux ont clairement des choses à leur proposer, dans l'illégalité.
Certains jeunes pourront traverser ces difficultés mais d'autres développent des troubles. Cela commence par une anxiété massive, puis par des troubles du sommeil, de la concentration et de la mémoire – les jeunes se perdent, ils se repèrent encore moins. Ensuite, des affects dépressifs – une tristesse envahissante, des idées suicidaires – s'installent d'une manière massive. Nous recevons pas mal de jeunes qui font des passages à l'acte, ce qui mobilise alors beaucoup de monde. Les conditions dans lesquelles ils évoluent, leur isolement, les nouvelles ruptures qu'ils subissent, leur impossibilité de s'inscrire et les refus constants dont ils font l'objet s'accompagnent de troubles psychiques. Par ailleurs, ce qui se passe ici majore les troubles préexistants.
Nous aimerions que les soignants puissent recevoir ces jeunes, ce qui suppose de faire un travail d'« aller vers ». Si on ne leur explique pas qu'ils peuvent se soigner et qu'on ne leur dit pas où s'adresser, rien ne se passe. Il faut aussi qu'ils puissent s'exprimer dans leur propre langue, pour que les soignants les comprennent et qu'ils comprennent ces derniers. Le recours à l'interprétariat est donc nécessaire. Il est également important que les lieux de soins soient du type maison des adolescents, qu'ils soient pour les 12-25 ans. Il faut sortir de l'obsession des 18 ans. Pour nous, c'est une problématique de jeunesse qui se pose : ce sont des gens qui ont terminé leur enfance sans avoir encore entamé l'âge adulte. Ils traversent une phase transitoire, qu'ils vivent en exil et seuls, sans les étayages parentaux qu'ils pouvaient avoir dans leur pays d'origine, et ils doivent se construire dans une société qu'ils ne connaissent pas. Il faut s'appuyer sur leur désir de se construire, de se former, de se soigner. Cela permet de guérir plus vite, ce qui coûte par ailleurs moins cher au système.
La question des addictions est très problématique. Certains jeunes sont polytoxicomanes – c'est un groupe particulier. En ce qui les concerne, l'« aller vers » est encore plus important, afin de réaliser un travail très spécifique autour de l'addiction avec des équipes dédiées. C'est une question très complexe qu'on ne peut pas laisser de côté.
Nous recevons des filles, certes en petit nombre, mais elles accèdent davantage aux consultations psychologiques. La question du genre fait qu'elles sont beaucoup plus vulnérables – elles ont subi des violences nettement plus importantes. Cela nécessite une attention et des programmes particuliers.
Un jeune qui arrive en France se trouve rarement dans l'Orne. Vous parliez donc de mineurs pris en charge et placés. Il y a aussi la question de ceux qui arrivent, qui sont évalués et refusés : ce sont ceux dont nous nous occupons. Une fois qu'ils sont pris en charge par l'ASE, on recommence avec d'autres qui viennent d'arriver, qui ont été refusés et sont à la rue. Cela ne veut pas dire que nous laissons tomber, une fois qu'ils sont pris en charge par l'ASE, les jeunes que nous avons accompagnés pendant des mois, le temps de leur recours, mais on part du principe que le relais est passé et que c'est moins à nous d'agir.
La population des mineurs étrangers a-t-elle évolué ? J'étais devant les grilles du DEMIE en 2015 et j'y suis encore. J'ai donc une vision d'ensemble. Il y a maintenant moins d'arrivées, il faut le souligner. J'en ai parlé récemment avec la mairie de Paris, et les chiffres sont très éloquents. On a l'impression que les arrivées sont de plus en plus nombreuses – les médias et les institutions veulent nous le faire croire – mais ce n'est pas le cas. Entre 2015 et 2017, il y avait une file d'attente devant les grilles du DEMIE à Paris : vraiment beaucoup de jeunes arrivaient. C'est moins vrai aujourd'hui. Durant les hivers de ces années-là, 250 jeunes venaient chercher de l'aide et de quoi manger au jardin ; ils sont aujourd'hui entre 60 et 80. Cette réalité devrait permettre une meilleure prise en charge.
Par ailleurs, les arrivées de Guinéens ont connu un boom. Quand j'ai commencé à m'engager, en 2015 et 2016, il y avait 3 000 personnes avenue de Flandre. On y trouvait beaucoup de jeunes Afghans, de 13 ou 14 ans, et je me demandais comment ils étaient arrivés là, tout seuls ou non, avec des oncles et des passeurs qui les lâchaient sous le métro aérien. Ce qui m'a sensibilisée, c'était ces petits Afghans qui ne comprenaient rien au film, qui étaient refusés par la Croix-Rouge et qui se retrouvaient à nouveau dans des campements. C'est ce qui m'a donné envie d'agir : on ne laisse pas des enfants dans la rue. Je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point.
Des axes d'amélioration existent à tous les stades : avant la prise en charge, pendant celle-ci, lors de la scolarisation et concernant le suivi des titres de séjour.
Nous demandons que les mineurs isolés étrangers ne dépendent pas des associations. Elles font le job de l'État : elles mettent à l'abri, elles nourrissent, elles procurent du plaisir à travers des cours, des sorties. Il s'agit d'adolescents dont l'enfance a été brisée. On ne quitte pas pour rien ses parents, sa famille, son village, son pays. Face à l'instrumentalisation actuelle, il faut rappeler qu'on ne part pas sans raison. Nous entendons les histoires, puisque nous devons faire des récits de vie pour les avocats. Nous connaissons les jeunes, nous les hébergeons, nous nous occupons d'eux, nous sommes une famille de substitution.
Ailleurs, leur situation est absolument méconnue. Des travailleurs sociaux me téléphonent et je comprends parfois leur désarroi : ils récupèrent un jeune après son placement, sans savoir ce qui s'est passé avant. Il faut construire des ponts entre les associations, le personnel de l'ASE et d'autres dispositifs, notamment celui de l'évaluation. L'évaluateur voit le jeune dans un bureau, avec un timing serré. Je ne jette pas la pierre aux associations mandatées, mais quand je vois, de l'autre côté de la grille, que des gens remettent des jeunes de 15 ans à la rue sans duvet en plein hiver, je ne peux que trouver cela inhumain. Nous en avons parlé avec les services de la ville de Paris.
J'insiste sur le fait que les arrivées sont moins nombreuses. On veut nous faire croire qu'il y a des flux migratoires qu'on ne peut pas absorber, mais ce n'est vraiment pas le cas. Les chiffres le montrent.
Vous avez demandé combien de jeunes nous aidons. Il est très compliqué de donner un chiffre car des jeunes d'autres associations viennent manger chez nous, ou bien nous leur donnons des vêtements, mais nous ne leur apportons pas un suivi juridique. En revanche, à partir du moment où nous faisons héberger un jeune, nous l'accompagnons du début à la fin. Cela concerne des centaines de personnes.
Nous avons eu des hébergements collectifs d'octobre à fin juin, puis nous avons eu recours à des hôtels et ensuite à des occupations en l'absence de bénévoles et de solutions d'hébergement. Il faut trouver des lieux et du personnel d'encadrement, qui n'est d'ailleurs pas du personnel puisque ce sont des bénévoles. Je suis, pour ma part, professeure dans l'enseignement supérieur. Il faut pouvoir passer des nuits à côté des jeunes et aller faire les courses. Nous avons eu quarante jeunes en continu, étant entendu qu'un jeune placé est remplacé par un autre. Nous sommes très peu de bénévoles sur le terrain : nous faisons les distributions à cinq ou six, sachant que d'autres personnes agissent à d'autres niveaux. Pour l'hébergement collectif, une dizaine de personnes se relaient.
Lors de l'occupation du square Jules-Ferry l'année dernière, pendant trente-cinq jours et trente-cinq nuits, avec MSF et d'autres associations, notre demande solennelle était que l'État et la mairie de Paris mettent en place un dispositif d'hébergement : les associations devaient arrêter de s'en occuper. Trente places d'hébergement d'urgence ont été ouvertes dans le 15e arrondissement, alors qu'une association peut arriver, avec peu de moyens et même aucun salarié, à héberger au moins quarante jeunes en continu ! Il faut développer les hébergements. Il serait bien de créer un « tunnel », mais encore faudrait-il qu'il y ait un pont, c'est-à-dire un dispositif en cas de refus à la suite de l'évaluation. On ne doit pas renvoyer les jeunes vers les dispositifs pour les majeurs.
S'agissant des filles, il faut souligner que nos associations interviennent en aval des dispositifs d'évaluation qui les acceptent, heureusement, beaucoup plus vite. Elles sont confiées à l'ASE plus rapidement, comme les tout petits. Un Érythréen de 13 ans amené au DEMIE est pris en charge tout de suite. Il y a des choses qui fonctionnent, et il faut le dire, comme l'ASE à Paris pour ceux qui sont pris. Comme nous nous occupons de ceux qui ne sont pas pris, nos chiffres ne sont pas très représentatifs.
Nous avons soixante élèves en permanence. MSF est le premier pourvoyeur de jeunes dans notre école : nous travaillons de concert avec les autres associations. Nous avons scolarisé 180 jeunes l'année dernière, soit directement soit avec l'ASE qui les avait pris en charge.
En ce qui concerne le critère de six mois de formation professionnalisante pour la délivrance d'un titre de séjour étudiant, que nous avions réclamé, le problème est que certains jeunes sont toujours inscrits dans une classe d'accueil. La condition n'est donc pas remplie. S'ils font une demande en préfecture, ils feront l'objet d'une OQTF. Les jeunes obtiennent souvent un récépissé, après des mois et des mois, ils commencent un bac pro ou un CAP, mais ils ont quand même une OQTF à la fin. C'est le cas pour la plupart d'entre eux, même ceux qui ont eu un statut étudiant pendant un ou deux ans. Celui-ci ne garantit donc rien, et encore faut-il avoir été pris en charge par l'ASE : la plupart de ceux qui ne l'ont pas été risquent de ne rien avoir.
Nous avons eu hier une OQTF visant un jeune qui avait un bac pro en pâtisserie : il avait été absent deux fois au cours du trimestre. Ces jeunes sont beaucoup moins absents que les autres, mais pour deux absences lors d'un trimestre – liées à une opération chirurgicale – on vous refuse un titre de séjour et on vous oblige à quitter le territoire. Ces jeunes n'ont pas le droit d'être absents, quand bien même ils auraient de bonnes raisons de l'être.
Je suis mille fois d'accord avec l'idée qu'il faut sortir de l'obsession de la minorité. Si l'on parvenait à prendre un peu de recul pour s'occuper de tous les jeunes scolarisés, quel que soit leur âge, étant entendu qu'on ne peut pas vraiment entrer dans l'éducation nationale après 18 ans, ce serait un soulagement, car il y aurait une petite marge. Que le jeune scolarisé ait 18 ou 19 ans, cela ne change pas grand-chose : il a été à l'école en France, on a commencé à faire de lui un futur super-citoyen.
Je travaille avec des migrants depuis une vingtaine d'années, même si l'association que je représente n'a que cinq ou six ans. Je peux vous dire que les empêcher d'avoir un titre de séjour stable revient à les empêcher de rentrer chez eux. J'ai côtoyé un grand nombre de personnes venant de diverses communautés qui ont dû attendre dix ou douze ans pour avoir un titre de séjour stable, de plus d'un an. Le jour où ils l'ont obtenu, ils sont retournés dans leur pays pour développer des liens, ils ont fait des allers-retours. Si on n'a pas un titre de séjour de cinq ans, rentrer chez soi, c'est perdre tous ses amis, parce qu'on ne pourra plus jamais revenir, on ne pourra plus jamais redemander un visa dans une ambassade : cela représente des années de galère, et il faut avoir 50 000 euros sur un compte en banque. Les gens ne repartiront jamais tant qu'ils n'auront pas ce document très précieux.

Mille mercis à vous.
La présidente Marielle de Sarnez – nous sommes nombreux à appartenir à la commission des affaires étrangères – insistait beaucoup sur la question des visas, qui permettent aux jeunes, notamment africains, de faire des allers-retours. Les visas existent, mais leur nombre a diminué ces dernières années.
La réunion s'achève à seize heures dix.