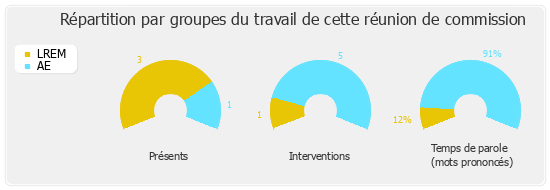Mission d'information sur la résilience nationale
Réunion du mercredi 12 janvier 2022 à 15h30
Résumé de la réunion
La réunion
MISSION D'INFORMATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS SUR LA RÉSILIENCE NATIONALE
Mercredi 12 janvier 2022
La séance est ouverte à quinze heures trente
(Présidence de M. Alexandre Freschi, président de la mission d'information)

Pour la dernière phase des travaux de notre mission d'information sur la résilience nationale, il nous a semblé important d'engager une réflexion sur l'exercice du pouvoir en temps de crise – en particulier de crise grave – sur les différents cadres juridiques prévus dans ces circonstances, qu'ils soient constitutionnels, législatifs ou réglementaires, ainsi que sur une mise en perspective historique de l'évolution de ces cadres.
Monsieur le professeur, vous êtes l'auteur, entre autres ouvrages, de L'État d'exception et de À l'épreuve du terrorisme, les pouvoirs de l'État. Vos éclairages seront donc précieux pour notre mission d'information, car, si la résilience nationale peut nécessiter le recours à des mesures d'exception extrêmement fortes, son horizon est bien la préservation et le rétablissement de l'État de droit et l'exercice plein et entier de la démocratie.
La question que vous posez est très vaste. J'essaierai d'indiquer ce qui caractérise les notions de crise et de crise grave dans notre histoire, ainsi que la nature des crises qui ont donné lieu à la mise en place de législations d'exception. J'essaierai également d'analyser ce qui caractérise les menaces actuelles, qui me semblent être d'une nature très différente, et la manière d'y répondre, qui me semble, elle aussi, différente.
Depuis la Révolution française, la crise politique peut être de deux natures : la crise internationale – le conflit armé – ou la sédition, la rébellion intérieure d'une partie du territoire, d'une ville ou d'un groupe politique. On retrouve ici les deux cas de mise en œuvre de la grande loi du 9 août 1849 sur l'état de siège. Dans le premier cas, l'invasion étrangère et le franchissement des frontières par les armées ennemies conduisent à placer sous état de siège les zones occupées. Dans le second cas, la sédition et la rébellion violente conduisent à appliquer un siège inversé : les armées françaises assiègent la ville et procèdent à son nettoyage systématique avec des mesures de perquisition administrative, d'assignation à résidence, de fermeture des lieux de réunions, de couvre-feu. Cette technique est bien connue des militaires et des pouvoirs civils de maintien de l'ordre ; elle relève du contrôle de zone et vise à rendre une zone à la légalité normale le plus rapidement possible.
Au XIXe siècle, ces deux types de crise étaient très limités d'un point de vue spatial et temporel. La notion de guerre entre justes ennemis, entre armées constituées, existait sur un temps limité, dans un champ de bataille, et les batailles ne duraient que quelques jours. La légalité normale se rétablissait très rapidement. De la même manière, lorsqu'une ville ou un quartier de ville était placé en état de siège, le nettoyage de la zone se faisait de façon vive et violente et le rétablissement de la légalité normale était très rapide.
L'évolution a conduit à une altération de cette limitation spatiale et temporelle. La Première Guerre mondiale a duré plus de quatre ans ; alors qu'il n'y avait qu'un seul front, l'ensemble du territoire était placé en état de siège, en parfaite contradiction avec les dispositions de la loi. En ce qui concerne les phénomènes d'insurrection et de sédition, l'on a vu apparaître des mouvements politiques qui ne fonctionnaient plus selon la logique du foyer insurrectionnel. La crise de terreur, dite anarchiste, qui a concerné toute l'Europe entre 1892 et 1894 en est un bon exemple. Ce n'étaient pas des loups solitaires, mais des personnes autoradicalisées qui fonctionnaient en réseau et qui étaient disséminées dans la population. En conclusion, la limitation dans le temps a cessé pour la guerre et la notion de limitation dans l'espace a cessé pour la sédition politique.
L'autre caractéristique qui me semble intéressante est la suivante : les buts recherchés par ceux qui menacent politiquement sont devenus plus lointains et incertains. Les guerres des XVIIIe et XIXe siècles étaient des guerres qui cherchaient à conquérir quelques territoires tandis que l'on peut penser que la logique appliquée au XXe siècle était celle de l'anéantissement complet d'un pays. La logique qui est celle du mouvement terroriste, du mouvement anarchiste, consiste à détruire le phénomène de l'organisation étatique, ce qui est une perspective d'assez long terme. Lorsque les buts de guerre sont lointains, on ne sait pas très bien quand on entre dans la crise ni quand on en sort.
J'en viens aux caractéristiques des menaces actuelles. Il s'agit premièrement de la multiplication des menaces. Il existe aujourd'hui des menaces de long terme, telles que la menace terroriste, mais aussi des menaces de court ou de moyen terme, comme la menace épidémique. Des menaces latentes existent aussi ; elles peuvent être de nature énergétique, climatique, migratoire, ou concerner la cybersécurité. Ces attaques ne sont pas associées à des buts de guerre ni à quelque chose dont on voit clairement la fin. Ces menaces ne sont pas spatialisées. Cette déspatialisation et cette détemporalisation font que l'on a du mal à identifier l'entrée dans la crise, et encore plus de mal à identifier la sortie de la crise. Vous vous souvenez certainement du débat qui a eu lieu au moment de l'adoption de la loi du 30 octobre 2017 visant à sortir de l'état d'urgence pour adopter des dispositions particulières pour la lutte contre le terrorisme. Certains députés expliquaient que cela revenait à se désarmer, tandis que d'autres considéraient que l'on entrait dans un état d'exception permanent. On voit bien que la notion de sortie de crise est très difficile à saisir. S'il n'y a pas de véritable entrée dans la crise ni de véritable sortie, il est de plus en plus malaisé d'identifier ce qu'est le moment de l'état d'urgence.
En réalité, il faut réinventer la notion de résilience. La question n'est pas de savoir si l'on doit être très angoissé par la menace à venir et si l'on doit être rassuré par le fait d'être en état d'urgence ou en législation d'exception ou non. Nous avons affaire à une préparation à des politiques publiques de long terme pour lesquelles, vraisemblablement et de manière relativement durable, des périmètres de nos libertés devront être plus ou moins restreints et pour lesquelles, si l'on réduit peu les libertés et si les risques demeurent élevés, le bon moyen de résister, pour la société, sera d'être résiliente.
Je crois que la problématique est la suivante. Soit l'on a un niveau de résilience très bas, et les préoccupations de sécurité conduisent à devoir accepter de renoncer à un très grand nombre de libertés, mais renoncer à des libertés est aussi de nature à créer une anxiété. Soit il faut accepter que, dans un certain nombre de circonstances, nos vies soient insécurisées. Nous avons vécu une période merveilleuse après la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement après 1989 ; nous considérions que la menace était lointaine et que notre sol serait éternellement préservé parce que nous étions protégés par la dissuasion nucléaire ainsi que par des opérations menées à des milliers de kilomètres de la France. Nous nous sommes aperçus que ce n'était pas le cas. Ces réalités doivent être dites et je suis de ceux qui pensent que, dans un État de droit, le niveau de protection des droits n'est pas invariable.
Jusque dans les années 1990, nous avons vécu avec la théorie du cliquet : plus l'on avançait, plus le niveau de protection des libertés était élevé, plus le Conseil constitutionnel s'engageait à ne jamais revenir dessus. Nous nous sommes aperçus, avec les nouvelles menaces, qu'il existe un recul des libertés ou une acceptation des motifs légitimes de réduction du périmètre des libertés au nom de la protection. Nous sommes donc dans un cliquet inversé, mais je ne pense pas, pour autant, que nous soyons sortis de l'État de droit.
Faut-il aller beaucoup plus loin pour réduire les libertés ? Je ne le crois pas non plus, et c'est la raison pour laquelle je crois que le travail sur l'acceptation et l'acceptabilité de situations très difficiles en France doit être promu. Nous l'avons vu lorsqu'il se produit des attentats d'intensité faible ou moyenne : la vie reprend après un moment de consternation. Peut-être que la séquence de sidération serait plus courte si nous connaissions de nouveau un attentat massif, parce que nous serions plus résilients. Par rapport à la menace sanitaire, je pense que le temps a permis à la résilience de progresser. De nombreux Français trouvent en effet que la vie est désagréable en ce moment, mais prennent sur eux. Il faut que nous soyons prêts à cette résilience dans d'autres domaines.

L'article 16 de la Constitution n'a été appliqué qu'une seule fois, après la tentative de coup d'état de généraux en Algérie. Vous semble-t-il que le recours aux pouvoirs exceptionnels prévu dans cet article pourrait être envisagé ? Serait-il suffisant pour parvenir à la résolution d'une crise grave qui affecterait notre territoire ?
Les crises se résolvent par l'action politique, par l'action des administrations, et donc par les hommes et les femmes plutôt que par des normes. Le cadre normatif dans lequel on agit n'est pas ce qui est décisif. Lorsque l'on déclare l'état d'urgence, on ne fait que mettre en place un cadre dans lequel agir. Le recours à l'article 16, en soi, ne fait rien d'autre qu'ouvrir la possibilité, pour le Président de la République, de légiférer sans les chambres pendant une durée que seul lui détermine.
Je crois donc qu'il faut sortir de cette idée que le recours à la législation d'exception est une action en soi. C'est un point important puisque c'est une des raisons pour lesquelles nous avons eu du mal à sortir de l'état d'urgence. Il y avait en effet cette idée selon laquelle l'on cessait d'agir si on le faisait. Ce n'est pas le cas : nous disposons de moyens suffisants pour agir en dehors du cadre de l'état d'urgence.
J'insisterai sur le caractère « performatif » du mot « urgence » et de l'article 16. Ce n'est pas parce que l'on déclare un état de guerre, un état de siège, un état d'urgence, ou que l'on recourt à l'article 16, que l'on a agi.
L'article 16 est prévu pour des crises qui concernent l'intégrité du territoire national, l'indépendance de la nation, les engagements internationaux, le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels. Il vise donc une guerre étrangère, un coup d'état ou encore une insurrection armée intérieure. En cas d'invasion étrangère, admettons que nous serions dans un consensus pour la repousser. Dans l'hypothèse où une partie de la population soutiendrait le Président de la République et où une autre partie le combattrait, l'article 16 pourrait s'avérer une arme sans puissance. On dirait alors que le Président abuse du pouvoir. Cela poserait la question de l'obéissance des pouvoirs publics au Président. Il existe un précédent sur ce point, qui s'est produit lors de l'adoption des ordonnances du 25 juillet 1830. En cas de menace sur la sûreté de l'État, le roi Charles X pouvait agir par le biais de l'article 14 de la Charte. Il a agi… et s'est exilé en Angleterre quelques jours après. L'abus de ses pouvoirs exceptionnels s'est donc retourné contre lui. Je crois qu'il ne faut pas avoir une vision trop confiante de ce que serait un recours à l'article 16. Encore une fois, ce n'est pas un moyen d'action. En outre, il peut provoquer des réactions importantes.
L'état d'urgence a été décrété en novembre 2015, puis a eu lieu l'attentat du 14 juillet 2016. La question qui se posait était de savoir jusqu'où les Français accepteraient cette hypothèse. Le Gouvernement a travaillé sur l'hypothèse de l'article 16, un article 16 qui aurait été utilisé pour éviter des phénomènes de justice privée, de réaction des populations contre les musulmans en particulier.

Notre pressentiment – et nous espérons qu'il est faux – est que la crise sanitaire pourrait être un premier exemple des crises auxquelles nous pourrions être confrontés, qu'elles soient de nature alimentaire, cyber ou énergétique. Nous pensons que notre société perd potentiellement en résilience, étant de plus en plus dépendante aux technologies et aux flux. Nous devons alors nous préparer à cela tout en préservant notre État de droit.
La question que nous nous posons aujourd'hui concerne le fonctionnement de l'État ainsi que sa capacité à décider tout en le faisant dans une certaine sécurité juridique et à mobiliser des moyens dans des conditions exceptionnelles. Plus que la sécurité juridique en tant que telle, il s'agit aussi de prendre des décisions qui semblent légitimes aux yeux des Français. C'est ce qui nous a conduits, pendant la crise sanitaire, à prendre des mesures pour que le Parlement continue de fonctionner et que nous n'ayons pas à actionner des moyens tels que l'article 16, afin que les décisions résultent d'un débat, bien qu'elles ne soient pas prises dans des conditions confortables.
J'en viens à une question sur la manière dont s'organise le droit d'exception. L'ensemble législatif et normatif relatif aux situations de crise se trouve-t-il uniquement dans des lois particulières ou avons-nous parfois des lois ordinaires qui définissent des situations de crise ? Comment le droit des situations de crise s'organise-t-il ?
La question est redoutable. Il y a quelque chose de l'ordre de la superposition qui est lié à des raisons historiques. Il existe des régimes législatifs et en partie constitutionnalisés. Je songe là à la loi sur l'état de siège de 1849, qui est constitutionnalisée dans l'article 36 de la Constitution. Vous avez un régime de type constitutionnel, qui est l'article 16. L'état d'urgence, quant à lui, est un régime seulement législatif qui peut être modifié par une simple loi, comme cela a déjà été fait. Il a été question, dès 2016, de constitutionnaliser la loi sur l'état d'urgence dans l'article 36. C'est aussi une suggestion qui a été faite dans le rapport du Conseil d'État présenté le 29 septembre dernier. À cette législation de crise s'ajoute la loi du 23 mars 2020, qui concerne l'état d'urgence sanitaire. L'ensemble forme les lois qui relèvent de l'état d'exception.
Lorsque l'on raisonne de manière plus large, on constate que, depuis 1986, trente-cinq lois concernant la lutte contre le terrorisme ont été adoptées. La plupart d'entre elles sont des lois pénales qui vont concerner et aménager l'article 421-1 du code pénal, lequel définit le régime de l'infraction terroriste. Ce ne sont pas des législations de crise, mais des législations ordinaires qui portent sur un sujet qui a trait à la notion de crise.
Prenons l'exemple de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, adoptée et ratifiée avant les attentats des terrasses et du Bataclan. C'est une loi ordinaire dont l'objet est la lutte contre le terrorisme. Si l'on examine une loi sur la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou une loi de vigilance sanitaire, comment en analyser la nature ? Nous dirons que c'est une loi ordinaire et non une loi d'exception, car elle ne comporte pas les mots « état de siège », « urgence », « exception », mais nous espérons tous que c'est une loi qui ne sera pas utilisée et qu'elle tombera dans les oubliettes lorsque la crise sanitaire sera derrière nous.
Il y a des lois qui sont adoptées depuis fort longtemps et qui sont très bien installées dans l'ordre juridique et il y a des lois qui sont adoptées en temps de crise pour la crise. Je crois qu'il faut s'habituer à voir coexister des textes d'anticipation et des textes de réaction. Il me semble important – et c'est l'une des recommandations faites par le Conseil d'État, dans son rapport – que le législateur réalise un travail d'anticipation en temps de calme pour les types de crises auxquels nous pourrions être confrontés – une canicule particulièrement longue, une attaque cyber, etc. – et que les services de l'État travaillent au sujet de l'organisation de la nation pendant ces périodes. Si l'on anticipe par des mécanismes à la fois législatifs et opérationnels, je crois que nous aurons fait franchir un petit pas à la résilience.

Certaines des lois qui fixent des conditions d'action particulières dans des crises exceptionnelles sont particulièrement anciennes. Ces lois sont-elles bien applicables, quel que soit le motif, y compris pour de nouveaux risques auxquels nous pourrions être confrontés ?
Vous évoquez des lois d'anticipation et des lois d'adaptation. Selon vous, une certaine diversification des régimes se poursuivra-t-elle ? Pourrions-nous établir un état d'urgence cyber, un état d'urgence énergétique, etc. ? Il est souhaitable de prévoir les cadres juridiques applicables en situation de crise, mais sommes-nous capables, à froid, d'imaginer les efforts que la nation serait prête à consentir pour faire face à une telle situation ? Il y a deux ans, aurions-nous imaginé qu'un confinement soit possible ? Ne sommes-nous pas condamnés à conserver une forme de réactivité pour bien adapter la réponse au niveau de menace et au niveau d'effort que la nation est prête à faire ?
En réponse à votre première question, je dirais que les régimes de crise ne peuvent être déclenchés pour des crises non politiques. Déclarer l'état de siège ou l'état d'urgence permet de réaliser un contrôle de zone, ce qui serait inutile dans le cas d'une crise cyber. L'interdiction des réunions et l'organisation de couvre-feu ne seraient pas non plus utiles en cas de longue sécheresse.
Il faudrait donc prévoir une réponse adaptée pour chaque type de crise. On peut essayer d'anticiper, mais cela ne pourra pas être fait de façon parfaite. Pour autant, ce n'est pas une raison pour ne pas essayer de le faire. Si le législateur s'empare d'un sujet comme une cyberattaque ou une crise migratoire non maîtrisée, il lui appartient d'expliquer aux Français que gouverner, c'est prévoir, et de faire valoir de bons arguments en faveur de l'anticipation des crises plutôt que des postures de réaction. La résilience, c'est accepter l'idée qu'il peut y avoir des niveaux de crise extrêmement élevés et que, plutôt que de nous angoisser à l'idée de leur survenue, il est préférable d'être prêt. Vous avez raison de dire qu'il pourrait y avoir des réactions très vives de la part de personnes estimant que le Gouvernement prépare des mécanismes quasi dictatoriaux, mais ces crises existent et les anticiper est un travail sain. C'est dans ce sens que vont les recommandations du Conseil d'État. Je pense que nous pourrons avoir un très bon retour d'expérience de la crise sanitaire ainsi que des crises terroristes aiguës. Il sera donc possible de travailler sur d'autres types de crises.

Une crise cyber ou énergétique pourrait conduire les parlementaires à ne plus pouvoir se réunir. Si certains régimes de crise n'ont été prévus que pour faire face à certains cas particuliers, l'article 16, est-il, lui, l'ultime filet de sécurité qui permet de continuer à agir, même quand le Parlement ne peut plus se réunir ?
En principe, ce n'est pas le cas, mais, dans les faits, cela pourrait vraisemblablement se produire. Il existe quatre hypothèses matérielles décrites de manière relativement large. Elles ont trait à l'intégrité du territoire, aux engagements internationaux, mais aussi à l'indépendance du pays. Il faut aussi – et c'est un critère cumulatif – constater l'impossibilité du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels – par exemple l'impossibilité matérielle, pour le Parlement, de se réunir. C'est ce qui explique qu'en 1961, le gouverneur d'Alger ait pu avoir recours à l'article 16.
En principe, donc, l'article 16 vise des hypothèses politiques majeures, mais, en réalité, l'idée que l'indépendance de la nation est mise en cause peut être interprétée de manière relativement large. Quoi qu'il en soit, bien qu'une consultation préalable du Conseil constitutionnel soit prévue, cela reste un pouvoir discrétionnaire du Président de la République. Il n'existe donc pas de contrôle de fond sur la décision du Président. Face à cela, il ne reste que l'opinion publique et l'article 68, c'est-à-dire l'éventuelle destitution du Président de la République en cas de manquement grave à sa fonction.
Ouvrir la possibilité de légiférer et de prendre des mesures du domaine de l'article 34 sans l'assentiment des représentants de la nation serait-il la bonne solution pour résoudre une crise ? Rien n'est moins sûr. Il existe certainement une vertu dans toutes les législations d'exception : c'est l'électrochoc qui se produit lorsque l'on constate que l'on n'est plus dans une situation normale. Vous vous souvenez certainement des discours émouvants prononcés par le Président Hollande après les attentats de Nice et des terrasses, du discours grave du Président Macron du 16 mars 2020, et du discours du 23 avril 1961, à l'occasion duquel le Président de Gaulle a remis son uniforme de général de brigade pour annoncer qu'il mettait en œuvre l'article 16. Il existe donc une dimension psychologique dans l'électrochoc, qui est très utile. La nation est-elle prête et les pouvoirs publics sont-ils capables de gérer cela ? C'est une question d'anticipation.

Ma question porte sur les données personnelles qui pourraient être recueillies pour répondre à une crise ou encore après une crise, par exemple concernant des personnes susceptibles de participer à une action de terrorisme. Comment pouvons-nous conserver ces données et pendant combien de temps ? Des discussions auront prochainement lieu pour augmenter le temps de conservation en raison de la jeunesse des personnes concernées ou encore pour éviter que des actes délictueux ne se produisent sur le territoire...
Les fichiers reposent sur une philosophie selon laquelle quelqu'un qui a commis un acte délictueux est susceptible de le reproduire. Dans la recherche de la vérité face à un délit ou à un crime, le fait de disposer d'un fichier accélérera ou facilitera vraisemblablement le travail que réaliseront les enquêteurs. Du point de vue du respect des droits et des libertés, cette philosophie est embarrassante puisque l'on considère de plus en plus les personnes non seulement pour ce qu'elles font, mais aussi pour ce qu'elles sont.
Le casier judiciaire présente différentes catégories. Dans ce casier, la nature des inscriptions et la durée de leur conservation varient en fonction des infractions commises. Il existe par ailleurs des fichiers dans lesquels on ne tient pas compte de ce que les gens ont fait et dans lesquels on ne s'intéresse qu'à ce qu'ils sont ou à ce qu'ils représentent. Ce sont les fichiers utilisés par les services de renseignement pour la lutte antiterroriste ou le contre-espionnage. Pour les auteurs de crimes qui relèvent de l'article 421-1 du code pénal, la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) peut continuer à suivre les personnes avec des dispositifs particuliers et autorisés par le ministre dans le cadre fixé par la loi du 24 juillet 2015, après qu'elles ont payé leurs dettes auprès de la société. Certaines personnes sont toujours aussi radicalisées tandis que d'autres sont authentiquement déradicalisées. Il y a aussi ceux qui pratiquent la « taqiya », c'est-à-dire la dissimulation, et qui se font passer pour des personnes ayant renoncé à toute accointance avec l'islam radical.
En ce qui concerne l'aspect terroriste, il est certainement souhaitable que des informations soient conservées pour une durée significative. Je ne pourrais toutefois pas me prononcer à la place de la DGSI sur cette durée.
La question que l'on se pose actuellement concerne les données qui peuvent être enregistrées dans le cadre de la situation sanitaire, par exemple. Il est impératif – et je pense que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) travaille sur ce point – que la conservation des éléments soit alors limitée au strict nécessaire.

La résilience est un objectif de l'Union européenne. Quelle est sa traduction dans le droit communautaire ? Le cadre constitutionnel et législatif français se prête-t-il à une transposition de directives et règlements adoptés dans un objectif de résilience ?
Pour nous, juristes, la notion de résilience, que ce soit en droit français ou en droit de l'Union, n'a pas beaucoup de sens étant donné que la résilience est une aptitude de nature citoyenne, civique, psychologique, à accepter l'aléa, le risque, et à y faire face avec un état de non-stress suffisant. En général, lorsque l'on adopte des dispositions, on le fait dans l'idée qu'elles sont de nature à protéger les citoyens. Il serait donc contradictoire d'adopter des mesures qui prépareraient les citoyens à devoir accepter l'aléa. Il me semble que faire le lien entre la notion de résilience et les dispositions législatives présente un aspect paradoxal.
J'ai bien noté que la résilience était un objectif pour l'Union européenne, mais annoncer que l'on va adopter des lois sur la résilience n'aurait pas beaucoup de sens. La résilience appartient à la société. Au fond, c'est l'aptitude à dire la vérité sur des hypothèses qui peuvent être identifiées et renseignées, ainsi que la manière de s'y préparer et, en cas de crise importante, d'ajuster le niveau de protection des libertés pour faire progresser cette aptitude sociale et citoyenne qui relève de la psychologie collective.

Je voudrais aussi aborder la question du pouvoir en temps de crise. Quelles sont les conditions qui peuvent aboutir à une vacance du pouvoir ? Comment la nation ferait-elle pour continuer à avoir un chef capable de décider et de l'incarner ? En cas de vacance du pouvoir du Président de la République, comment la permanence du pouvoir s'exerce-t-elle ? Quelles sont les modalités de transmission du pouvoir au président du Sénat ? Qui déciderait de cela ?
Inversement, quels sont les contre-pouvoirs lorsqu'un chef abuse de son autorité ? Estimez-vous que certains engagements internationaux et européens de la France peuvent constituer des contre-pouvoirs face à certaines crises, ou tout cela est-il totalement indépendant ?
Dans le droit constitutionnel général, il existe deux types de vacance du Président de la République : la vacance temporaire et la vacance définitive. Dans ces deux cas, la Constitution prévoit que le président du Sénat assume l'intérim, et ce de plein droit.

La situation n'est pas nécessairement binaire. Il peut se présenter des cas dans lesquels le Président ne peut être contacté ou dans lesquels il est pris en otage. Il peut alors se produire un flottement.
Le constat de la vacance du pouvoir est fait par le Gouvernement. La question s'est posée au cours du deuxième mandat du Président Mitterrand, lorsque son état de santé ne lui permettait plus de travailler que quelques heures par jour pendant certaines périodes. Personne n'aurait imaginé expliquer au pays que la Présidence était en situation de vacance. S'il n'y a pas de volonté de la part du malade de dire qu'il est incapable, il n'existe aucun autre moyen. Dans une situation où le Président est très affaibli et où il n'est pas en mesure de se prononcer, une situation d'intérim serait très difficile. Nous pourrions aussi imaginer une situation de coma. Il existerait certainement une forte pression de la part du pays pour que le Premier ministre identifie cette vacance. Le professeur Guy Carcassonne avait suggéré un mécanisme reposant sur une commission de médecins indépendants qui pourraient examiner l'état de santé du Président de la République dans ces circonstances. J'ignore si ce serait efficace.
La vacance du pouvoir est à envisager, mais je ne suis pas de ceux qui pensent que ce serait de nature à provoquer une très grande fragilisation des institutions parce que le Gouvernement continuerait à fonctionner et parce que nous avons un État qui fonctionne seul. Dans les périodes de campagne électorale, l'activité de l'État se poursuit alors qu'une grande partie du temps des personnalités politiques présentes au sommet de l'État est occupée par la conquête du pouvoir ou par le maintien au pouvoir.
S'agissant de l'excès de pouvoir, la Constitution a été révisée en 2007. La seule hypothèse dans laquelle le Président peut être destitué était celle de la haute trahison, mais personne ne savait ce que c'était. La Constitution a donc été modifiée et, maintenant, il est question de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». Il n'existe pas de superposition entre une infraction pénale et un manquement grave du Président de la République. Imaginons qu'un Président soit photographié dans une situation très gênante ; il n'y aurait rien d'illégal à cela, mais l'on pourrait imaginer une situation proche du manquement s'il est la risée de la communauté internationale. L'accusation de ce manquement grave serait faite par une des deux chambres et serait jugée par les deux assemblées réunies en un équivalent du Congrès. Il faudrait obtenir une décision à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée pour destituer le Président de la République.
Il semble toutefois difficile de réunir ces conditions. Il est peu vraisemblable qu'une procédure d'accusation aille à son terme, car il est probable que le Président serait acculé à la démission. Cette procédure a abouti une seule fois dans notre histoire. Louis-Napoléon Bonaparte a en effet été destitué le 2 décembre 1851, mais, puisqu'il organisait un coup d'état au même moment, il s'est maintenu au pouvoir.
La question des réquisitions et de la mobilisation générale a été réglée par la loi sur l'organisation de la France en temps de guerre, adoptée en 1938, qui prévoit des mécanismes de mobilisation militaire et de mobilisation générale. La loi de 1996 qui met fin au service militaire obligatoire n'a fait en réalité que le suspendre. Mais le dispositif n'est pas prévu pour des hypothèses non militaires et non politiques. Pour des hypothèses de type climatique ou cyber, on en revient à une préoccupation qui me semblerait salutaire, qui consisterait à travailler en anticipation sur le plan législatif, mais aussi sur le plan organisationnel. Un dispositif de ce genre comprendrait certainement une partie qui relèverait de l'article 34 de la Constitution, avec un impact sur les libertés publiques, et une partie réglementaire ainsi que des scénarios sur lesquels chaque ministère travaillerait.
Au sujet des moyens de l'État, je crois que la mission d'information peut s'inspirer du troisième chapitre du rapport du Conseil d'État, rédigé par des personnes qui connaissent l'État profond et l'administration active. Il comporte des recommandations sur les mécanismes d'anticipation et sur l'organisation des moyens de l'État en situation de crise, ainsi que des recommandations opérationnelles au cas par cas. Je vous renvoie donc à ce travail, auquel je ne saurais ajouter quoi que ce soit de pertinent.
La réunion se termine à seize heures quarante-cinq.
Membres présents ou excusés
Mission d'information sur la résilience nationale
Présents. – Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Alexandre Freschi, M. Thomas Gassilloud, Mme Sereine Mauborgne