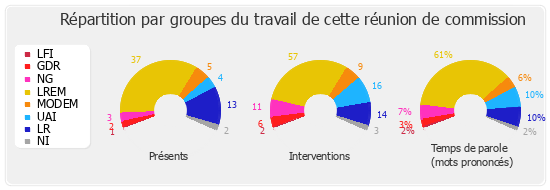Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du mercredi 20 juin 2018 à 8h30
La réunion
Présidence
La commission examine pour avis le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (n° 901) (Mme Bénédicte Peyrol, rapporteure pour avis).

Notre commission examine ce matin pour avis le projet de loi par lequel le Gouvernement nous demande l'autorisation de ratifier la convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices – la commission des affaires étrangères se prononcera au fond cet après-midi. Derrière ce projet de loi très court se cache un instrument très complexe, dont je vais essayer de vous détailler le contenu – il me paraît important que vous le connaissiez tous.
Le projet BEPS (base erosion and profit shifting), lancé en 2013 à la suite d'un mandat donné par le G20 à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), vise à lutter contre les différentes formes d'évasion fiscale des entreprises qui conduisent à dissocier le lieu de réalisation des bénéfices de celui de leur imposition, et qui entraînent une perte de recettes d'impôt sur les bénéfices des sociétés à l'échelle mondiale, estimée par l'OCDE entre 100 et 240 milliards de dollars par an. À travers quinze actions qui embrassent l'ensemble des questions fiscales internationales modernes, le projet BEPS entend apporter une réponse aux pratiques fiscales dommageables et renforcer la justice fiscale mondiale. Rappelons qu'il ne concerne pas seulement les pays développés membres de l'OCDE mais associe également les pays en développement. Ainsi, l'Inde, le Brésil ou encore la Chine étaient assis à la table des négociations et font aujourd'hui partie de ce que l'on appelle le « cadre inclusif », lequel suit la mise en oeuvre des actions BEPS.
La quinzième et dernière action du projet BEPS consistait précisément en l'élaboration de cette convention multilatérale, outil juridique extrêmement innovant. Rappelons que les conventions fiscales bilatérales, dont l'objectif est d'éviter la double imposition des revenus, régissent les relations fiscales entre les États. Elles peuvent néanmoins présenter des lacunes et parfois être exploitées par des contribuables pour échapper à l'impôt. Même si un consensus s'est formé dans le cadre de ces négociations BEPS pour modifier ces conventions dans le sens d'une meilleure lutte contre l'évasion fiscale, la mise en oeuvre effective des mesures prendrait un temps considérable si chaque État devait renégocier ces conventions fiscales une par une. C'est pour cette raison qu'a été imaginé cet instrument juridique que je qualifiais d'innovant, car il accélère le processus de renégociation des conventions – pour la France, qui dispose de l'un des plus importants réseaux conventionnels au monde, l'intégration des mesures du projet BEPS aux conventions aurait pu prendre trente ans.
La solution à ce problème, c'est donc cette convention multilatérale qui fait l'objet du présent projet de loi. Signée à Paris le 7 juin 2017 après avoir été élaborée par un groupe de travail spécialisé réunissant une centaine de pays et organisations internationales, elle est un véritable accélérateur juridique, puisqu'elle va modifier plus de 1 200 conventions bilatérales de façon quasi instantanée. Le processus prend non plus des décennies, mais des semaines, ou quelques mois, et le réseau conventionnel mondial est enrichi de nouveaux outils opportuns.
La force de la convention multilatérale tient à son mécanisme et à son contenu. Elle réside également dans le nombre de ses participants : actuellement, pas moins de soixante-dix-huit États et territoires l'ont signée, parmi lesquels tous les États membres de l'Union européenne à l'exception de l'Estonie – mais nous espérons qu'elle rejoindra bientôt les signataires. La Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil ont également rejoint l'instrument, comme plusieurs pays régulièrement qualifiés de paradis fiscaux tels l'île Maurice, le Panama, Singapour ou encore Jersey. Les États-Unis, qui ont pourtant participé aux négociations, sont un absent de marque, mais relativisons, car cette absence ne remet pas en cause l'efficacité pleine et entière de la convention multilatérale : d'une part, les conventions conclues par les États-Unis intègrent déjà souvent les outils de la convention multilatérale. D'autre part, les pratiques dommageables qui peuvent être celles des entreprises américaines tirent surtout parti du réseau conventionnel des pays membres de l'Union européenne, et pourront donc être quelque peu corrigées.
Ces éléments précisés, détaillons un peu le contenu de l'instrument.
La convention multilatérale « couvre » les conventions bilatérales que les pays notifient à l'OCDE, c'est-à-dire celles qu'ils souhaitent voir modifiées. La France a ainsi notifié quatre-vingt-huit des cent vingt conventions conclues avec des pays étrangers.
Pour qu'une convention bilatérale soit effectivement modifiée, il faut que les deux États parties aient non seulement signé la convention multilatérale, mais aussi qu'ils aient notifié chacun la convention bilatérale. À titre d'exemple, la convention franco-américaine ne sera pas modifiée puisque les États-Unis n'ont pas signé la convention multilatérale, pas plus que celle conclue entre la France et la Norvège dans la mesure où, si la France l'a notifiée, la Norvège ne l'a pas fait.
Compte tenu de ces conditions, qui ne font que traduire le principe de consentement des États, sur les quatre-vingt-huit conventions notifiées par la France, soixante-et-une, en l'état, seront effectivement couvertes par la convention multilatérale. Ce nombre devrait toutefois évoluer puisque d'autres pays la signeront bientôt et que la France va notifier de nouvelles conventions bilatérales – tel devrait être le cas de celle conclue avec le Panama, qui n'avait pas signé la convention multilatérale lorsque la France a notifié sa liste. Une fois qu'une convention bilatérale est couverte, elle va connaître différentes modifications apportées par la convention multilatérale. Il faut bien comprendre que celle-ci ne se substitue pas aux conventions bilatérales ; c'est un instrument « à côté » de chacun des conventions, et qui les modifie.
La convention multilatérale met en oeuvre quatre des quinze actions du projet BEPS.
L'action 2 vise à lutter contre les dispositifs hybrides, ces instruments qui permettent d'être imposé nulle part, voire de réduire son assiette dans un pays sans être imposé dans un autre. Ainsi, ce qui est considéré comme un dividende dans un pays peut être considéré comme la contrepartie d'un prêt dans un autre : le dividende se trouve alors exonéré de tout impôt tandis que les intérêts rémunérant le prêt sont déduits, aboutissant à une déduction sans imposition. Un schéma que vous trouverez dans mon rapport illustre ce type de montage.
La convention met également en oeuvre l'action 6 contre l'octroi d'avantages injustifiés, luttant contre les abus, notamment le treaty shopping, pratique qui consiste à jouer sur différentes conventions fiscales pour bénéficier indûment d'avantages.
L'action 7 vise l'évitement artificiel de l'établissement stable. J'ajoute que l'une des mesures concernant cette action, l'article 12 de la convention, permettra à l'avenir de lutter contre les montages du type de celui mis en oeuvre par Google, sur lequel le tribunal administratif de Paris s'est prononcé au mois de juillet 2017.
L'action 14 est destinée à améliorer le règlement des différends par la procédure amiable et l'arbitrage.
L'absence de mesures sur l'économie numérique a pu être regrettée. Cependant, plusieurs dispositions, tel l'article 12 que je viens de citer, permettent de résoudre certains problèmes. En outre, un rapport intermédiaire de l'OCDE montre l'absence de consensus sur la question. Pour certains États, il faut traiter à part l'économie du numérique ; pour d'autres, il faut appréhender la question d'un point de vue plus global. Les négociations se poursuivent, largement entraînées par l'Union européenne, qui a repris la main avec la taxe de 3 % sur le chiffre d'affaires, les propositions de directive concernant une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés (ACIS) et de directive concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) et les notions de « présence digitale significative » et d'« établissement stable virtuel ». Comme l'économie numérique ne fait pas l'objet d'un consensus, l'inscription de la question dans la convention multilatérale aurait pu tempérer l'entrain de certains pays et les dissuader de la signer.
La question des prix de transfert et de la création de valeur est également absente de la convention car elle ne fait pas non plus l'objet d'un consensus. Si la convention multilatérale répond à certains problèmes, elle ne règle donc pas tout. La mission d'information que préside notre collègue Jean-François Parigi et dont j'ai l'honneur d'être rapporteure abordera ces questions et essaiera d'apporter des solutions.
La convention multilatérale comporte une vingtaine d'articles de fond. Les États peuvent faire le choix de les retenir ou au contraire de les exclure de leurs conventions bilatérales, en émettant une réserve.
Trois de ces articles sont néanmoins des standards minimums obligatoires, c'est-à-dire qu'on les retrouvera dans toutes les conventions fiscales bilatérales conclues par les États qui ont souscrit à cet instrument : les articles 6 et 7 contre les abus – des clauses anti-abus générales très efficaces, qui permettent de refuser l'octroi d'avantages injustifiés – et l'article 16 sur l'amélioration des procédures amiables.
L'existence de ces choix conduit à des modifications à géométrie variable d'une convention bilatérale à l'autre. Chaque État choisira ce qu'il veut voir appliquer. Pour qu'un article de la convention multilatérale s'applique à une convention couverte, il faut que les deux pays qu'elle lie aient fait le même choix, c'est-à-dire qu'aucune réserve n'ait été formulée par l'un d'eux – l'OCDE ayant organisé un speed meeting entre les différents États, pour qu'ils se mettent d'accord, les choix faits sont normalement assez cohérents.
D'autres subtilités peuvent avoir un impact sur l'application d'une mesure de la convention multilatérale mais je ne développe pas ce point. Tout figurera dans le rapport, et je pourrai y revenir si certains le souhaitent.
La France a retenu une application relativement large de la convention multilatérale en n'émettant de réserves que sur cinq articles parmi les vingt-et-un susceptibles d'en recevoir. Le détail du contenu de la convention et des choix français figurera dans le rapport, mais ces choix traduisent l'ambition et la cohérence de notre pays.
Notre ambition se manifeste ainsi à travers les choix faits pour les articles 6 et 7, certes normes minimales mais qui peuvent dans certaines hypothèses faire l'objet de limitations. La France a retenu une approche opportunément large, permettant au plus grand nombre possible de conventions d'être enrichies de stipulations affirmant l'objectif de lutte contre l'évasion fiscale et la double non-imposition, renforçant par là même l'application de la clause anti-abus de l'article 7 qui joue face aux montages à l'objet principalement fiscal.
Cette ambition est également illustrée par le choix d'appliquer l'article 9, qui porte sur l'imposition des sociétés à prépondérance immobilière et qui permet de faire échec aux schémas consistant à réduire artificiellement la part immobilière de la société avant d'en vendre des parts ou à échapper aux règles applicables en intercalant dans l'opération une société de personnes.
Cette ambition, enfin, peut être trouvée dans les choix étendus de la France en matière d'établissement stable : l'ensemble du bloc correspondant à cette notion a été retenu, notamment l'article 12 sur les accords de commissionnaires déjà mentionné – les fiscalistes invétérés que vous êtes, chers collègues, connaissent tous l'arrêt Zimmer du Conseil d'État qui empêchait de faire obstacle à ces montages. Tous les pays n'ont pas fait preuve de la même volonté, mais cet article va tout de même modifier, pour la France, trente des soixante-et-une conventions notifiées couvertes, dont celles conclues avec les Pays-Bas. La convention nous liant au Luxembourg, qui vient d'être conclue, va également intégrer ce dispositif. : le Luxembourg a en effet refusé de retenir l'article 12 mais a consenti à l'intégrer à la convention franco-luxembourgeoise dans le cadre de négociations bilatérales. Avec cet instrument, nous pourrons donc, dans le cadre des futures renégociations, nous appuyer sur des éléments qui ont fait consensus au niveau international et les inclure dans les prochaines conventions.
La France est en pointe dans le domaine de la lutte contre l'évasion fiscale. Notre droit national prévoit une palette d'outils robustes et nous jouons un rôle moteur dans de nombreuses initiatives, comme les récentes propositions européennes de taxation du numérique. Faire preuve de timidité aurait été contraire à la position européenne et internationale de la France, aurait brouillé le message qu'elle veut porter et nui à sa crédibilité. Si tout le monde se regarde en chiens de faïence et ne fait aucun choix, chacun attendant de savoir ce que feront les autres, on ne peut pas avancer. Cette ambition, susceptible de faire évoluer les États, pourra également inciter à la levée de réserves, notamment celle émise par l'Irlande sur l'article 12 relatif aux mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable, comme le dispositif mis en place par Google.
Par ailleurs, la France n'a pas fait preuve de naïveté. Les articles retenus l'ont été parce qu'ils apportent un progrès ou qu'ils correspondent aux pratiques françaises. Les dispositifs n'apportant pas de progrès, susceptibles de porter atteinte à la sécurité juridique ou risquant d'être néfastes aux intérêts français, eux, n'ont pas été retenus. Cela explique, par exemple, la réserve sur l'article 3 relative aux entités transparentes, qui aurait posé des difficultés vis-à-vis des sociétés de personnes françaises – Gilles Carrez connaît très bien le sujet. Je rappelle que notre pays a exclu l'application de cinq articles.
Je reviens sur les inquiétudes que certains choix français ont pu soulever, notamment au Sénat et dans la presse. Pourraient-ils se révéler contraires aux intérêts de la France et de ses entreprises ? Selon moi, ces inquiétudes relèvent plus de l'intuition, dans la mesure où ceux qui les ont formulées ne les ont étayées d'aucun élément chiffré. Elles s'estompent même à l'issue d'une analyse approfondie du dispositif de la convention, des stipulations existantes dans les conventions bilatérales et des commentaires produits par l'OCDE qui accompagnent chaque article.
Elles n'en auront pas moins permis de mettre sur la table la question de l'évaluation des choix français en matière de fiscalité internationale. Le Gouvernement devrait à cet égard produire d'ici à la séance publique des éléments d'analyse à l'appui de ses choix, notamment en ce qui concerne l'article 14, portant sur les fractionnements de contrats, qui a beaucoup fait parler de lui. Je pense que c'est indispensable, et rappelle que s'il est loisible de lever à tout moment une réserve formulée, le choix d'appliquer un article est irréversible. Notre pays a jusqu'au dépôt de son instrument de ratification auprès de l'OCDE pour arrêter ses derniers arbitrages – c'est pour cela que nos débats sont importants –, et je considère que si un article était de nature à créer un risque pour la France, notre pays devrait pouvoir émettre une réserve par prudence, quitte à la lever ensuite : il ne sert à rien de se tirer une balle dans le pied.
Autre point de vigilance : la sécurité juridique. Vous comprendrez que cet instrument est très compliqué et il s'agira de l'interpréter. Le Gouvernement s'est engagé à prendre plusieurs initiatives pour garantir la lisibilité et l'intelligibilité des conventions bilatérales modifiées. C'est indispensable, mais je pense, personnellement, que nous pourrions peut-être aller plus loin. J'invite ainsi à une réflexion sur l'opportunité de rendre opposables les versions consolidées des conventions modifiées.
La question de la sécurité juridique doit aussi se traduire par une formation optimale des agents de notre administration, pour garantir à la convention une mise en oeuvre dans les meilleures conditions possibles.
J'aborde enfin l'information du Parlement. Je déplore un peu le caractère insuffisant de l'étude d'impact, d'une vingtaine de pages pour un instrument extrêmement complexe, soit la même longueur que l'étude d'impact d'une convention bilatérale. Le contenu de la convention multilatérale et l'explication des choix de la France sont relativement succincts, et plusieurs éléments pourtant essentiels font défaut, notamment le nombre de conventions conclues par notre pays qui seront effectivement modifiées par l'instrument – ce nombre, je le rappelle, est en l'état de soixante-et-un. De la même manière, rien n'est dit sur les modifications effectives de chacune des conventions couvertes. Je me suis permis de faire le travail et le rapport contiendra en annexe le détail des modifications apportées à chacune des soixante-et-une conventions – cela représente un travail de titan.
Plus généralement, il me semble nécessaire que le Gouvernement nous indique régulièrement les évolutions apportées à la convention multilatérale, qu'il s'agisse de la levée éventuelle de réserves ou de la couverture de nouvelles conventions bilatérales. Une information une fois par an est utile mais insuffisante ; des communications régulières devant les commissions des finances et des affaires étrangères sont indispensables pour que nous puissions bien suivre la mise en oeuvre de la convention, que nous sachions quelle est l'étendue des modifications qu'elle entraînera et comment celles-ci seront appliquées. Peut-être avons-nous fait un pas gigantesque en adoptant cette convention et en négociant ces dispositifs anti-abus, mais c'est la mise en oeuvre qui importera plus.
Nonobstant les réserves que je viens d'exprimer, cette convention multilatérale est une très bonne chose. C'est pourquoi je demande à notre commission de se prononcer en faveur de l'adoption de ce projet de loi. Elle ne règle cependant pas tout, il reste beaucoup à faire, mais je pense que nous sommes tous mobilisés.

Merci beaucoup, chère Bénédicte Peyrol, pour cet énorme travail. Bien évidemment, votre rapport nous instruira plus précisément sur une convention multilatérale qui modifiera les centaines de conventions bilatérales antérieurement conclues pour régler les questions d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de répartition des résultats.
Lorsque le dossier BEPS a été ouvert, on pensait que réviser toutes ces conventions prendrait cinquante ans. La réussite de l'OCDE – M. Pascal Saint-Amans peut en être félicité –, c'est d'avoir créé un outil qui modifie toutes les conventions en même temps, tout en laissant certaines marges de manoeuvre.
Ce travail s'inscrit dans un vaste chantier de lutte contre l'optimisation fiscale. C'est un texte court mais un grand pas pour la fiscalité, à tel point que l'administration américaine a anticipé un certain nombre de dispositions dans sa réforme fiscale. Elle prétend ne pas vouloir réellement s'associer au mouvement, mais, en réalité, elle le fait.
Le projet européen d'assiette consolidée pour l'impôt sur les sociétés sera aussi très important, notamment pour le numérique. Il nous manque encore une brique essentielle pour localiser un résultat et l'établissement stable. C'est sur ce sujet que nous rencontrons des difficultés depuis des années – il est compliqué de trouver un accord compte tenu des intérêts en présence, très contradictoires.
Et puis Mme Vestager, commissaire européenne à la concurrence, est en train de traiter – avec beaucoup de détermination, certes, et c'est très bien – certains sujets sous l'angle des aides d'État, voyez la question des dispositifs hybrides. Nous traitons ainsi avec des outils du droit de la concurrence des questions de fiscalité. Je pense malgré tout qu'il vaut mieux traiter les problèmes fiscaux dans des textes fiscaux, des conventions fiscales, des directives fiscales. Ce sont là les outils pertinents.

À mon tour, je remercie notre rapporteure pour avis pour son travail, très complet en même temps que synthétique, ce qui n'est pas facile, vu le caractère proprement universel des conventions auxquelles nous touchons au travers de ce dispositif.
Je suis très heureux que l'on trouve enfin, avec cet article 12 de la convention multilatérale, une solution au problème de l'établissement stable. J'avais moi-même été amené à écrire au Gouvernement à propos de Google, d'Airbnb et de la problématique des accords de commissionnaire. Il est heureux que l'on puisse aboutir à quelque chose qui me semble juridiquement plus stable que l'instabilité de l'établissement stable auparavant...
Je vois aussi beaucoup d'avantages à ce qui est arrêté en vue de faciliter le règlement des différends entre administrations fiscales. Jusqu'à présent, cela posait un problème. De même, la clause anti-abus de l'article 7 marque vraiment une avancée importante dans la lutte contre le chalandage fiscal. Cette convention est donc d'un grand intérêt.
Je vous rejoins cependant sur un certain nombre de points que vous avez soulevés. Il faut notamment être prudent face à certains dispositifs qui peuvent présenter des risques, mais, vous l'avez bien dit, les choix français sont cohérents et ambitieux. Il s'agit simplement d'être vigilant. L'information régulière et complète du Parlement sur les évolutions futures du champ d'application de la convention me paraît à cet égard extrêmement importante. Il est d'autant plus important que nous puissions être informés que vous-même nous avez appelés à la vigilance sur un certain nombre de points.
Ma seule question porte sur cette notion intéressante du droit français qu'est l'abus de droit, dont l'application aux conventions fiscales a été pleinement consacrée par le Conseil d'État au mois d'octobre dernier. La clause anti-abus générale de la convention risque-t-elle d'empêcher la notion d'abus de droit de s'appliquer en cas d'abus conventionnel ? Ou bien les deux outils peuvent-ils coexister ?

Effectivement, monsieur le rapporteur général, l'abus de droit que nous connaissons en droit français, défini à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) s'applique bien aux abus conventionnels, cela a bien été rappelé par une jurisprudence de 2017, mais la clause de la convention viendra-t-elle « écraser » notre dispositif anti-abus ? Il faut déjà préciser que la notion d'abus de droit français vient en répression, tandis que l'abus de droit de la convention est une règle d'assiette.
Je vous donne mon avis, mais il faudra que l'administration fiscale précise l'application et l'articulation de ces deux outils. Pour ma part, je pense qu'ils peuvent coexister. Je rappelle que l'article L. 64 du LPF vise les actes dont le but est exclusivement fiscal. Comme vous le savez, il entraîne une requalification des schémas et expose à des pénalités très élevées. La clause générale anti-abus pourrait s'appliquer, pour sa part, de manière plus générale, comme une règle d'assiette. C'est mon avis personnel, mais l'administration fiscale devra prendre position.
Nous avons d'autres clauses anti-abus, notamment celle de la directive dite « mère-fille ». Sa formulation est proche de celle de la clause de la convention, mais les professionnels, les entreprises, l'administration s'interrogent sur l'application en cascade, ou pas, de ces différents dispositifs.

Je me joins à ce concert de louanges plus que mérité. Merci, madame la rapporteure pour avis, pour ce travail, à la fois synthétique, complet et d'une grande précision.
Comme le disait Mme la présidente à l'instant, l'intérêt de ce dispositif est qu'il permet de transformer l'ensemble des conventions bilatérales en une fois ou quasiment. L'effort est grand, mais c'est un grand pas dans la lutte contre l'optimisation agressive fiscale qui nous coûte si cher.
Ma question portera sur la sécurité juridique. Chaque norme fiscale expose à un risque d'insécurité juridique. Avec un dispositif aussi long et aussi complet, il y a forcément une série de points de frottement qui risquent de poser problème, le principal étant forcément cette clause anti-abus, à l'article 7.
Certes, l'un des outils peut être plus répressif tandis que l'autre porte plutôt sur l'assiette. Cependant, n'y a-t-il pas quand même un problème de concordance ? L'article L. 64 du LPF, qui vise les montages à but exclusivement fiscal, présente un avantage, celui de la clarté pour les professionnels, pour les entreprises, pour les juristes, mais aussi un inconvénient, celui de restreindre le champ de la lutte contre la fraude fiscale. L'article 7, visant pour sa part les montages dont le but est principalement fiscal, est plus large, c'est un avantage, mais il risque d'entraîner de l'insécurité juridique.
Ne pensez-vous pas qu'il y a là un levier pour modifier un certain nombre de d'articles de notre droit fiscal national afin de nous doter d'une plus forte capacité de répression de l'optimisation agressive ? Une telle réforme fiscale nationale écarterait le risque d'insécurité juridique auquel cette discordance entre le dispositif de la convention et nos dispositifs nationaux.

Je salue à mon tour la qualité du travail de notre rapporteure pour avis. Elle a rendu la matière fiscale presque poétique !
Je m'arrêterai sur le caractère multilatéral de la convention. Il faut évidemment lutter contre l'évitement de l'impôt, mais il faut en même temps préserver les intérêts français. Une certaine flexibilité reste possible pour les États mais l'articulation entre les conventions reste complexe.
Comment clarifier les articles 12 à 15, relatifs à l'établissement stable ? Et comment être attentif aux évolutions futures et conserver l'agilité nécessaire ?

Je m'associe aux éloges de notre rapporteure pour avis. C'est effectivement un travail de titan, madame la rapporteure, je vous félicite donc.
Nous examinons aujourd'hui pour avis le projet de loi adopté par le Sénat autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en oeuvre de mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et les transferts de bénéfices. Disons les choses plus simplement pour celles et ceux qui écouteraient nos débats : il s'agit bien, tout simplement, de renforcer la lutte contre l'évasion fiscale. À la demande du G20 au sommet de Saint-Pétersbourg, au mois de septembre 2013, l'OCDE a élaboré un projet visant à lutter contre les deux aspects essentiels des phénomènes d'évitement de l'impôt. L'OCDE estime que le montant des pertes de ces recettes imputables à l'érosion de la base d'imposition et aux transferts de bénéfices est compris entre 100 et 240 milliards de dollars par an, soit entre 4 et 10 % des recettes de l'impôt sur le bénéfice des sociétés à l'échelle mondiale.
Ce projet a donc débouché sur le « paquet BEPS » finalisé au mois d'octobre 2015 et approuvé par le G20 au sommet d'Antalya au mois de novembre suivant. Ce paquet repose sur trois piliers : l'amélioration de la cohérence des règles fiscales, le renforcement des exigences de substance des activités et la garantie d'une meilleure transparence.
L'objet de cette convention n'est pas contestable et, évidemment, nous voterons en faveur de sa ratification. Je rappelle une nouvelle fois la volonté politique dont fait preuve la France.
Quelques questions cependant, madame la rapporteure pour avis. Pourquoi le numérique est-il absent de cette convention ? Compte tenu de la réalité du monde dans lequel nous vivons, cette absence est quelque peu incongrue. Et quid de l'efficacité réelle de cette convention en l'absence de la signature des États-Unis ? Elle a le mérite d'exister mais qu'en sera-t-il donc de sa force ?
Selon quel rythme le Parlement devrait-il être informé ? Et pensez-vous avoir suffisamment de moyens humains à disposition pour mener à bien ce travail titanesque mais indispensable ?

Je tiens à féliciter notre rapporteure pour avis, Bénédicte Peyrol pour ce travail : non, ce n'est pas un travail de titan, c'est un travail de bénédictine...
Cette convention me trouble à plusieurs égards.
En ce qui concerne son articulation avec le droit national fiscal français, l'étude d'impact indique-t-elle l'ensemble des articles de notre droit qui seront modifiés ? En principe, cette convention doit être supérieure au droit national à partir du moment où elle est ratifiée, mais comment cela s'articule-t-il, sachant que tous les pays au monde ne l'ont pas signée ? Cela veut-il dire que certaines dispositions de droit fiscal continuent à s'appliquer tandis que d'autres sont modifiées ?
Par ailleurs, le principe de réciprocité du droit international est inscrit dans la Constitution. Comment s'articule-t-il avec ces réserves à géométrie variable selon les États ?
Si la France n'a pas émis de réserves sur tel ou tel dispositif mais qu'un autre État l'a fait, cela signifie-t-il que le dispositif n'est pas applicable en droit français ?
Troisièmement, contrairement à ce que certains prétendent, on peut ratifier avec réserves et j'ai ainsi été étonné qu'elles ne figurent pas dans le projet de ratification. Où sont-elles ?
Enfin, on essaie de progresser en matière d'établissement stable : qu'en est-il de l'application de ce dispositif à nos chers GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) ?

L'outil présenté ici constitue une avancée mais non la panacée, et le chemin est encore long pour vaincre cette pandémie que constitue l'évasion fiscale. Au-delà de cet outil multilatéral, il faut aller plus loin et faire en sorte que tout le monde soit autour de la table. C'est pourquoi nous proposons que la France soit à l'initiative d'une « COP fiscale », sur le modèle de la Conférence des Parties (COP) environnementale, pour que tous les États, y compris les pays en développement, discutent entre eux. Où en est-on ?
Rappelons que les pays en développement sont les grandes victimes de la fraude et de l'évasion fiscales. Selon le FMI, l'impact sur ces pays est 30 % plus élevé que sur les États membres de l'OCDE. Ces pays perdraient l'équivalent de 125 milliards de dollars de recettes fiscales chaque année, soit plus que le montant de l'aide internationale qui leur est destinée. Les pays en développement sont notamment victimes des effets des conventions fiscales bilatérales entre États, conventions optimisées par de grandes entreprises ou des particuliers qui, pratiquant le chalandage fiscal, parviennent à réduire leur contribution à l'impôt.
L'exemple le plus connu est celui de l'île Maurice, qui constitue une plateforme tout à fait intéressante pour celui qui souhaite investir en Inde tout en payant un minimum d'impôts. Par le jeu des conventions fiscales, un Français investissant en Inde en passant par Maurice ne paiera aucun impôt, alors que, s'il avait directement investi en Inde depuis la France, il aurait été soumis à l'impôt en vertu de la convention franco-indienne.
Les conséquences de ces conventions sont visibles également en France. La convention bilatérale entre la France et le Qatar, par exemple, fait de la France un paradis fiscal pour les Qataris, avec une fiscalité allégée sur les plus-values immobilières, les revenus du capital... Un véritable toilettage s'impose. Est-il envisagé ?

Ce projet BEPS s'inscrit dans le cadre d'une prise de conscience au niveau international de la nécessité de lutter contre la fraude, l'évasion ou l'optimisation fiscale. Il intervient après la mise en place de l'échange automatique d'informations financières à des fins fiscales, également sous l'égide de l'OCDE.
Qu'il y ait une telle prise de conscience, c'est vrai au niveau européen, avec les travaux sur les juridictions fiscales non coopératives et la liste des sept pays dont les pratiques fiscales pénalisent leurs voisins européens. Je rappelle que le Parlement a voté une résolution pour définir une assiette commune consolidée pour les impôts sur les sociétés.
C'est vrai, bien sûr, pour la France. Sous l'ancienne législature, il y avait déjà eu une loi relative à la fraude fiscale votée en 2013 et notre mandat s'est ouvert avec nos travaux sur le « verrou de Bercy » et va se prolonger avec le projet de loi sur la fraude.
La France a été moteur dans la négociation au sein de l'OCDE et dans l'élaboration du projet BEPS, et il me semble qu'il faut soutenir ce projet autorisant la ratification de cette convention pour au moins trois raisons.
Tout d'abord, vous l'avez rappelé, madame la rapporteure, la France a l'un des réseaux les plus étendus de conventions bilatérales et cette ratification va permettre de les modifier d'un seul coup, en les enrichissant. On gagne ici des années de négociation sans remettre en cause les intérêts fiscaux de la France, la sécurité juridique, nonobstant quelques interrogations, ni les enjeux économiques de nos entreprises.
Deuxièmement, la France a eu une approche large et ambitieuse dans l'adoption de ce projet BEPS. Cette ratification permet donc à notre pays de jouer un rôle d'exemplarité dans la lutte contre la fraude fiscale et permet ainsi d'affirmer son leadership dans ce domaine.
Troisième et dernier point, la France applique une forme de diplomatie fiscale intelligente, me semble-t-il, qui lui permet d'attirer des investissements directs étrangers sur notre territoire et de gagner pour nos entreprises des parts de marché à l'international avec des pays qui ont signé cette convention.
Pour ces trois raisons, il me semble important, tout en gardant en mémoire les points de vigilance que vous avez indiqués, de soutenir ce projet de loi de ratification, d'autant que le Gouvernement s'est engagé à tenir le Parlement informé des évolutions du cadre conventionnel.
Je voudrais vous poser une question. Les actions 8, 9 et 10 du projet BEPS recommandent, en définitive, de se livrer à une analyse de la création de valeur au sein d'un groupe d'entreprises mondialisées dans le cas d'une évaluation des prix de transaction intra-groupe. Cette évaluation apparaît comme un garde-fou contre les stratégies de transfert des bénéfices au sein d'un même groupe vers les entités les moins lourdement imposées. Selon vous, en quoi l'approche de la création de valeur est-elle plus pertinente que d'autres méthodes habituellement utilisées pour évaluer les prix de transfert ? Pouvez-vous nous expliquer les raisons pour lesquelles il y a pour le moment une sorte de blocage ou en tout cas une absence de consensus sur cette question ?

Monsieur Grau, vous m'interrogez sur le risque juridique que pourrait représenter le fait que la clause anti-abus vise un « but principalement fiscal ». Le Conseil constitutionnel a censuré il n'y a pas si longtemps pour incompétence négative des tentatives de certains parlementaires visant à assouplir l'abus de droit ; on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ce « but principalement fiscal » mais il faut rappeler que la censure était aussi liée à la majoration de 80 % qui accompagne l'abus de droit. Les conseillers d'État Philippe Martin et Pierre Collin, que nous avons auditionnés, m'ont rassuré sur l'interprétation du « but exclusivement fiscal » de l'article L. 64 du LPF : il ne s'agit pas d'une interprétation restrictive mais la formule apporte tout de même une sécurité juridique aux entreprises. Le remplacer par un « but principalement fiscal » serait à mon avis un peu risqué. Je pense que ce dispositif anti-abus général n'écrase pas notre article L. 64 et il serait bon de garder les deux, avec l'article visant les dispositifs anti-abus de manière générale dans une répression très forte tout en conservant la règle d'assiette qu'est le dispositif. Nous conduirons, dans le cadre de la mission d'information sur l'optimisation et l'évasion fiscales, un travail d'explication de ce que devrait être selon nous l'articulation de l'ensemble de ces clauses anti-abus ; nous avons vu l'administration fiscale à cette fin et le travail est en cours.
Madame El Haïry, s'agissant de l'établissement stable, je vous renvoie à mon rapport, qui explique très précisément les choix qui ont été faits, ainsi qu'aux commentaires de l'OCDE sur lesquels se fonde l'administration fiscale quand elle a à interpréter une convention fiscale.
Monsieur Bricout, comme je l'ai indiqué, il n'y a pas de consensus aujourd'hui au sein de l'OCDE entre les États qui pensent que le sujet du numérique doit être envisagé de manière globale et ceux qui pensent qu'il doit être traité à part. Par conséquent, nous n'avons pas souhaité intégrer ces dispositions, afin que cela ne bloque pas les négociations sur le reste. Je rappelle tout de même que l'OCDE poursuit les négociations. Le G7 a rappelé la nécessité de trouver des solutions rapidement, dans l'idéal au cours de 2019, sur le sujet de la fiscalité numérique. La France est moteur au niveau de l'Union européenne avec la taxation à 3 % sur le chiffre d'affaires des services du numérique. L'idéal serait une définition commune de l'établissement stable virtuel, dans un premier temps au sein de l'Union.
Nous appelons à une information qui soit plus qu'annuelle, à savoir que la commission des finances, par le biais du président et du rapporteur général, puisse disposer d'une information régulière sur les futures conventions notifiées. Nous invitons le Gouvernement à nous transmettre ces informations, y compris sur les choix français.
Monsieur de Courson, cette convention multilatérale modifie les conventions bilatérales actuelles et vous savez comme moi qu'en vertu de l'article 55 de notre Constitution, une convention bilatérale prime sur le droit national, le cadre juridique de l'articulation entre ces normes ayant été précisé par le Conseil d'État dans ses décisions Schneider Electric de 2002 et 2013. Cela signifie que les stipulations de la convention primeront.
Nous avons reçu un engagement de l'administration fiscale de publier des versions consolidées des conventions fiscales notifiées par la France. Malgré cette consolidation, les conventions consolidées ne seront pas opposables à l'administration fiscale. Il faut donc se demander comment les rendre opposables.
Les réserves de la France, au nombre de cinq, ne sont pas dans le projet de loi mais elles figurent sur le site de l'OCDE.

Il faudrait reprendre chaque convention bilatérale avec cet instrument car chacune est modifiée différemment. Cela recoupe votre question sur le cas où la France fait une réserve et l'autre État non. Dans ce cas, la stipulation de la convention multilatérale ne s'applique pas, en vertu du principe de réciprocité, dès lors que les deux États ne se sont pas entendus. En revanche, ce qui s'applique à tout le monde, et nous n'aurons là pas à nous poser de question, ce sont les dispositifs anti-abus, aux articles 6 et 7, et les règles de procédure amiable à l'article 16.
S'agissant de l'établissement stable, je reprends l'exemple de Google. La société mère est en Irlande, il y a des bureaux en France, et l'administration fiscale n'a pas réussi à qualifier d'établissement stable l'activité en France, alors même que les représentants de Google en France jouent un rôle essentiel dans la conclusion des contrats de la société mère. Avec la nouvelle définition proposée, on pourrait qualifier d'établissement stable le bureau en France. J'y mets un bémol : l'Irlande ayant émis une réserve sur l'article 12, il n'y a pas réciprocité. Mais l'Irlande pourra toujours lever la réserve, et ce point peut faire partie de notre travail diplomatique.
Monsieur Dufrègne, oui, le chemin est encore long, nous en sommes collectivement bien conscients. Le projet de loi sur la fraude, même s'il ne concerne pas l'optimisation et l'évasion fiscales, montre que nous avons envie d'avancer. Une mission a été lancée dès le début de la législature et non à la fin, ce qui prouve la volonté d'agir des députés.
Vous rappelez l'idée de COP fiscale et demandez que tout le monde soit autour de la table. Comme je l'ai rappelé, ce qui est innovant dans cet outil et dans la démarche de l'OCDE, c'est justement d'avoir mis les États émergents autour de la table depuis le début, et ils sont aujourd'hui dans le cadre inclusif.
S'agissant du Qatar, je vous invite à poser la question au Gouvernement pour l'aspect diplomatique du sujet, mais je souligne que la France a notifié la convention fiscale bilatérale avec le Qatar et donc, si le Qatar souhaite rejoindre les différentes dispositions pour lesquelles la France a opté, cela ne tient qu'à lui.
Monsieur Labaronne, merci d'avoir employé l'expression de « diplomatie fiscale intelligente ». En matière de fiscalité internationale, on oublie trop souvent que nous n'évoluons pas dans un monde bilatéral mais global. Il faut conduire une vraie réflexion sur la diplomatie fiscale de la France.
Vous m'interrogez sur les actions 8, 9 et 10 du plan BEPS qui ne sont pas intégrées à la convention fiscale et sur l'analyse de la création de valeur. En matière de prix de transfert, un des principaux éléments d'optimisation et d'évasion fiscales, il existe cinq méthodes d'analyse pour calculer un prix de pleine concurrence, mais, pour des entreprises comme les GAFA, il est compliqué de trouver des entreprises comparables, et le contrôle des prix de transfert est donc loin d'être simple. Les discussions à l'OCDE se sont orientées vers l'analyse de la création de valeur. Là où l'on pèche, c'est que nous ne sommes pas d'accord collectivement sur ce qu'est la création de valeur, pour les incorporels par exemple, et encore moins sur ce que devrait être le partage de la valeur entre les différents États. Je pense que la value chain analysis, à savoir prendre la société dans la globalité de sa chaîne de valeur et estimer transaction par transaction ce que serait un bon prix de transfert, est une avancée, mais il reste beaucoup à faire, et l'Union européenne devrait là aussi conduire de manière urgente un véritable travail pour dire ce qu'est pour elle une bonne création de valeur, puis ce que serait un bon partage de la valeur. Les avancées sont encore loin d'être suffisantes.

Je confirme que les pays émergents ont toujours été présents dans ce chantier BEPS, dont l'un des objectifs était que les bénéfices soient répartis plus justement au niveau mondial, y compris pour que les pays émergents ne soient pas seulement des proies commerciales ou des lieux où puiser des ressources énergétiques sans aucun retour de valeur. L'optimisation fiscale fait aujourd'hui deux victimes : les pays développés, qui ont des entreprises mais ne perçoivent pas de résultats, et les pays en développement. Les seuls gagnants sont les systèmes financiers et les paradis fiscaux, le plus souvent des micro-États.

Question subsidiaire : les articles 18 et 19 sur l'arbitrage m'ont troublé. Comment s'articule cet arbitrage avec le droit français ? La France a-t-elle émis des réserves sur cet arbitrage touchant à des matières régaliennes ?

Un suivi aura lieu, le Parlement sera tenu au courant du développement de cette convention multilatérale. Sait-on déjà, au sein de l'OCDE, ce que seront les points de surveillance particulière ? De quelle manière des conséquences seront-elles tirées pour améliorer ensuite les conventions ?

Je veillerai à ce que le Parlement reçoive les informations. L'OCDE publie un suivi régulier sur son site internet, avec des mises à jour régulières des signatures, des notifications et des réserves des différents États.
Nous avons regardé pour toutes les conventions de la France les articles qui s'appliquaient et ceux qui ne s'appliquaient pas. L'administration s'est engagée à produire des versions consolidées : un document unique pour chaque convention bilatérale.
Le cadre inclusif BEPS, qui rassemble une centaine d'États, suit au-delà de la convention multilatérale l'ensemble des actions discutées dans le cadre des travaux BEPS, comme le dispositif des « sociétés étrangères contrôlées » sur les paradis fiscaux.

Nous arrivons à la fin d'une négociation que j'ai eu la chance de suivre quasiment dès le début, en 2012, après une période noire des négociations à l'OCDE. Je pense que la commission des finances devra à l'avenir être bien plus associée aux négociations et être informée au fil de l'eau.
La commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article unique de la proposition de loi à l'unanimité.
Puis la commission examine pour avis le projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (n° 911) (M. Laurent Saint-Martin, rapporteur pour avis).

Deux autres commissions se sont saisies pour avis de ce projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, dont la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est saisie au fond : la commission des affaires sociales et la commission du développement durable. Notre commission s'est saisie des articles 6 et 7, qui intéressent directement son champ de compétence. Dans le même esprit, nous examinerons tous les amendements déposés dans notre commission qui, sans viser formellement ces deux articles, portent spécifiquement sur les lois de finances et les questions budgétaires. En revanche, il ne nous revient pas de discuter d'autres amendements à visée plus générale, lesquels, au demeurant, peuvent être déposés et défendus devant la commission des lois, saisie au fond, qui se réunira le mardi 26 juin.

Notre commission s'est saisie pour avis de deux des dix-huit articles du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, les articles 6 et 7.
Ces deux articles nous intéressent au premier chef car ils modifient les conditions de l'examen du projet de loi de finances, qui constitue le coeur de l'activité de notre commission.
Chacun de ces deux articles apporte deux modifications au texte constitutionnel.
L'article 47 de la Constitution encadre strictement, depuis 1958, les délais d'examen des projets de loi de finances et assortit ces délais d'une sanction dissuasive. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans les délais impartis par la Constitution, le Gouvernement peut mettre les dispositions du projet de loi de finances (PLF) en vigueur par ordonnance. La durée maximale d'examen du PLF est actuellement fixée à soixante-dix jours. L'Assemblée nationale dispose en outre d'une durée maximale de quarante jours pour se prononcer en première lecture. Si elle ne respecte pas ce délai, le Gouvernement peut saisir le Sénat, qui doit se prononcer dans un délai de quinze jours.
L'article 6 du projet de loi constitutionnelle ramène la durée maximale d'examen du projet de loi de finances de soixante-dix à cinquante jours, et la durée de la première lecture à l'Assemblée nationale de quarante à vingt-cinq jours.
Parallèlement, pour accompagner la montée en puissance du contrôle parlementaire sur les résultats des politiques publiques et renforcer les moyens d'action des commissions des finances dans leur mission de contrôle de l'exécution de la loi de finances, il mentionne explicitement que les ministres peuvent être entendus par les commissions compétentes sur l'exécution de leur budget.
L'article 7 vise quant à lui à améliorer l'articulation entre le PLF et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Sans modifier la durée maximale d'examen du PLFSS par le Parlement, déjà fixée à cinquante jours par l'article 47-1 de la Constitution, il porte la durée maximale d'examen du PLFSS en première lecture à l'Assemblée de vingt à vingt-cinq jours afin de l'aligner sur celle qui est proposée pour le PLF.
Il habilite en outre le législateur organique à fixer les conditions dans lesquelles les PLF et PLFSS peuvent être, en tout ou partie, examinés conjointement. Il s'agira de trouver les moyens de permettre au Parlement de bénéficier d'une vision plus globale des dispositions des lois financières, en particulier de celles qui concernent les prélèvements obligatoires, et d'organiser une discussion plus cohérente, en particulier lorsqu'une réforme comporte des dispositions à la fois en loi de finances et en loi de financement de la sécurité sociale, comme ce fut le cas à l'automne dernier avec la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en baisse pérenne de cotisations ; de telles « mesures miroir », qui relèvent pour partie du PLF et pour partie du PLFSS, se sont multipliées ces dernières années. Le projet de loi constitutionnelle conserve bien deux textes différents et ferme ainsi la voie à une fusion en l'absence d'une révision constitutionnelle supplémentaire. En revanche, il ouvre un large éventail de possibilités quant à l'organisation de la discussion. Au demeurant, il nous est déjà possible de réfléchir, à droit constant, dans le cadre de la Conférence des présidents, à une meilleure organisation des débats dès l'examen des textes financiers pour 2019.
Disons-le d'emblée, je souscris pleinement à l'objectif de rationalisation de la procédure budgétaire.
Même si la célèbre formule d'Edgar Faure pour qualifier la discussion budgétaire, « litanie, liturgie, léthargie » est un peu datée, chacun s'accorde à considérer que l'examen du projet de loi de finances est trop long et peut avoir quelque chose de fastidieux. C'est un sentiment que nous avons été nombreux à éprouver à l'automne dernier, tant parmi les nouveaux que parmi les anciens députés. Nous avons l'occasion aujourd'hui d'organiser différemment les débats budgétaires pour gagner en efficacité sans perdre en substance.
L'article 6 consacre le rééquilibrage de la procédure budgétaire que nous appelions de nos voeux dans les conclusions du groupe de travail transpartisan relatif aux conditions d'examen des textes budgétaires et dont nous avons esquissé les contours avec l'organisation ces dernières semaines du « printemps de l'évaluation » et des commissions d'évaluation des politiques publiques.
S'il est possible d'améliorer encore cette nouvelle période budgétaire, son instauration a été un succès. Je vous invite d'ailleurs à faire part de votre bilan au président Woerth, comme il vous l'a proposé la semaine dernière.
Il s'agit à l'article 6 de rééquilibrer le temps parlementaire entre « l'automne de l'autorisation » et le « printemps de l'évaluation », afin de consacrer plus de temps et d'énergie à vérifier l'efficacité des politiques publiques sur la vie de nos concitoyens et à interroger le Gouvernement sur l'usage des crédits que nous l'avons autorisé à dépenser. En revanche, il est possible, sans renoncer à ce qui fait l'essence du parlementarisme, le consentement à l'impôt, de passer un peu moins de temps à discuter des prévisions de crédits, lesquelles feront ensuite l'objet de nombreux ajustements en loi de finances rectificative, par la voie réglementaire ou en gestion.
Que nous passions moins de temps en séance sur le PLF n'aura de sens que si plusieurs conditions sont réunies. Il nous faudra d'abord mener un travail plus approfondi lors de l'examen du projet de loi de règlement. Nous y avons déjà travaillé cette année, avec la collaboration de la Cour des comptes et du Gouvernement, qui ont accepté de publier plus tôt que d'habitude les documents que nous attendions, et grâce à l'engagement du bureau de la commission, en particulier de son président et du rapporteur général, ainsi que des rapporteurs spéciaux et des rapporteurs pour avis. En institutionnalisant les auditions des ministres sur l'exécution de la loi de finances, le projet de loi constitutionnelle lève le verrou de la séparation des pouvoirs, qui nous aurait interdit de prévoir dans le Règlement de l'Assemblée ou la loi organique la présence des ministres en commission d'évaluation des politiques publiques. Cet aspect de l'article 6 est à mes yeux fondamental.
Cet article souligne le rôle des commissions permanentes et non de la seule commission des finances. J'y vois une preuve d'ouverture, dont notre commission peut se féliciter.
Pour que l'examen en séance puisse être plus rapide, il est impératif que nous le préparions efficacement au stade de la commission. Pour cela, nous avons besoin de plus de temps pour examiner le projet de loi et les documents budgétaires. Or, si la Constitution limite le temps d'examen des projets de loi de finances, elle ne garantit pas au Parlement un temps de travail minimum avant la discussion.
Je vous proposerai trois amendements pour y remédier. Le premier instaure, comme l'article 42 de la Constitution pour les autres projets de loi, un délai incompressible entre le dépôt des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale et leur examen en séance. Ce délai ne s'appliquerait pas aux lois de finances rectificatives, pour lesquelles il reste nécessaire de pouvoir réagir en urgence. Le délai de droit commun de six semaines aurait été peu réaliste ; je propose donc un délai de quatre semaines. Deux autres amendements font courir le délai de cinquante jours encadrant l'examen parlementaire des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale à compter du début de la discussion en séance et non plus du dépôt du texte.
En pratique, le point de départ du délai constitutionnel du projet de loi de finances était déjà très proche du début de la séance, puisque, d'un commun accord entre le Gouvernement et l'Assemblée, il ne courait pas à compter du dépôt officiel à la suite de l'adoption du texte en Conseil des ministres, mais à compter de la réception d'une lettre du Premier ministre recensant l'ensemble des annexes déposées, qui intervenait en général entre le 10 et le 14 octobre, soit quelques jours avant le début de la séance.
Pour que le raccourcissement des délais aille de pair avec un travail plus efficace, nous devons aussi renforcer nos moyens d'expertise et ne plus dépendre des analyses du Gouvernement. La présidence de l'Assemblée et son Bureau réfléchissent au meilleur format d'un organe d'expertise propre au Parlement. Je proposerai en complément un amendement prévoyant la consultation du Conseil d'État sur des amendements fiscaux d'origine parlementaire ou gouvernementale. Comme les consultations sur les propositions de loi, celle-ci impliquerait un filtre et un délai compatible avec les exigences du débat parlementaire et le travail du Conseil d'État.
Montesquieu l'a écrit, il ne faut toucher aux lois que d'une main tremblante. Cela est plus vrai encore lorsqu'il s'agit de modifier la Constitution. N'oublions pas que nos propositions ont vocation à figurer au sommet de notre ordre juridique, pour de nombreuses années. J'ai donc déposé un nombre réduit d'amendements, mais qui me paraissent utiles pour améliorer concrètement la qualité de notre travail. Je serai amené à donner un avis défavorable ou à solliciter le retrait des amendements qui bouleverseraient l'équilibre de nos règles constitutionnelles, tels ceux qui viseraient à abroger l'article 40 ou qui introduiraient dans la Constitution des règles qui pourraient trouver leur place dans la loi organique, voire dans les règlements des assemblées.
Enfin, j'insiste sur le caractère organique de nombre de dispositions dont nous serons amenés à discuter dès l'année prochaine. L'examen d'une nouvelle loi organiques relative aux lois de finances (LOLF) nous donnera plus matière à débattre de la procédure. Je souhaite vous faire part de ma position favorable sur deux points : le monopole fiscal des lois de finances – j'en parlerai cet après-midi lors de l'examen de ma proposition de résolution en séance publique – et l'exclusion des dispositions fiscales du projet de loi de finances rectificative de fin d'année, dont l'essence est altérée par l'ajout, souvent tardif, de dispositions nouvelles par le Gouvernement.

Mais là n'est pas l'objet de ce projet de loi constitutionnelle. Les articles 6 et 7 seront l'occasion de débats fournis, comme ne manquera pas de le montrer l'examen des amendements.

La réduction des délais d'examen du PLF en séance ne doit pas se traduire uniquement par l'octroi à l'administration de délais supplémentaires pour instruire le PLF. Le Parlement doit bénéficier, en contrepartie, d'un délai incompressible pour examiner le texte en commission, ainsi que le propose le rapporteur pour avis dans son amendement. Il est essentiel que cette disposition figure dans la Constitution et ne soit pas renvoyée à une loi organique.
Par ailleurs, beaucoup d'amendements se rapportent à une loi de financement des collectivités territoriales, un sujet sur lequel le président de la commission s'est exprimé en séance hier. Bien qu'une telle perspective paraisse séduisante, il ne faut pas oublier que notre tâche est déjà rendue difficile par l'existence de textes de nature différente, le PLFSS n'étant pour partie pas normatif, et qu'une telle procédure imposerait aux collectivités des délais de transmission de données, comme ceux que connaissent les organismes de sécurité sociale. Faisons donc très attention. J'adore les jardins à la française, leur complexité et leur richesse les rendent merveilleux, mais on ne parvient jamais à les entretenir convenablement !

Nous devons en effet aborder ces débats d'une main tremblante. Bien des dispositions que nous souhaiterions voir advenir ne sont pas d'ordre constitutionnel, mais pourraient être prévues par la Conférence des présidents, lorsqu'elle fixe l'ordre du jour, par le Règlement de l'Assemblée nationale, par une loi organique ou par la LOLF. Nous devons nous prémunir d'une certaine hybris qui nous laisserait croire que nous voterons des lois éternelles sur l'organisation des débats.
Le fonctionnement institutionnel a souvent péché en perdant de la flexibilité qui lui permettait de s'adapter aux besoins d'une période. Plaçons dans la Constitution ce qui a lieu d'y être, qui est crucial pour la stabilité des institutions, et gardons nos bonnes idées pour les appliquer hors de ce cadre. Le printemps de l'évaluation a montré deux choses : nous avons besoin d'une agence – c'est l'une des propositions de Jean-Noël Barrot et Jean-François Eliaou, président et rapporteur du groupe de travail « moyens de contrôle et d'évaluation » du Bureau de l'Assemblée nationale, qui viennent de remettre leur rapport – ; nous pouvons aussi prendre des dispositions de notre propre chef, sans avoir à invoquer la Constitution.

Sur l'article 6, vous n'avez pas la main tremblante, mais lourde ! Faut-il inscrire, dans un projet de loi constitutionnelle, des dispositions concernant l'organisation de l'examen des lois de finances à l'Assemblée nationale ? Je suis peut-être d'une grande naïveté, mais je fais confiance à la Conférence des présidents pour organiser les temps de discussion ! Nous allons intégrer à la Constitution des dispositions sur le temps de parole sous couvert de « rationalisation », mais à force d'user de ce terme à tout bout de champ, on ne rationalise rien !
Le printemps de l'évaluation est une innovation qui a été testée cette année et je me suis félicitée que le Gouvernement ait accepté cette procédure. Mais ne confondons pas le contrôle de l'exécution de l'exercice précédent, et le débat sur le projet de loi de finances de l'année suivante ! Ces dispositions n'ont pas de commune mesure.
Monsieur le rapporteur, vous avez dit que les nouveaux députés s'étonnaient de la longueur des discussions sur le projet de loi de finances. Il est pourtant essentiel de prendre le temps d'examiner sérieusement chaque article du projet de loi de finances, dans la mesure où celui-ci détermine l'avenir fiscal et financier des politiques publiques menées par le Gouvernement. L'Assemblée nationale ne doit pas être une simple chambre d'enregistrement. Elle est le lieu du débat démocratique, et il est désolant que vous vouliez en restreindre le pouvoir.

Il ne s'agit pas d'une simple révision constitutionnelle, puisque s'ajoutent trois autres véhicules, la loi organique, la loi ordinaire et le Règlement de l'Assemblée. Je regrette que nous n'ayons pas été saisis d'un texte global, qui aurait pu prendre la forme d'une résolution. Cela nous aurait permis d'appréhender l'ensemble des problèmes et de répartir nos enfants entre les différentes familles. Cette absence de vision globale est très préjudiciable à une prise en compte réfléchie des enjeux auxquels nous sommes confrontés, à la clarté pédagogique et à la clarification de nos responsabilités.
Une remarque personnelle : la dissociation entre le vote et l'évaluation ne me convainc pas. Même si le printemps de l'évaluation a assez bien fonctionné, je pense que cette méthode s'érodera. Les parlementaires ne se sentent concernés que lorsqu'ils ont des décisions à prendre. Or, ils font face à une machine débranchée. Je crains que l'évaluation n'en vienne à correspondre à la définition du regretté président Edgar Faure !
Nous pourrions imaginer consacrer nos délibérations, entre janvier et juillet, à l'examen approfondi des missions et voter des pré-amendements qui refléteraient nos analyses. Ceux-ci pourraient ne pas être repris par la suite, mais une délibération de fond aurait eu lieu. Il faut donner une finalité à ces séances d'évaluation.

Nous en avons parlé hier en Conférence des présidents : il est certain que nous avons besoin d'une vision panoramique des textes qui modifieront l'organisation des institutions et la discussion de la loi. La commission des lois pourrait fournir une synthèse des mesures – encore faudrait-il que le Gouvernement les ait annoncées – prises dans le cadre de la loi organique, de lois ordinaires et du règlement de l'Assemblée.
Il va de soi que l'évaluation et les autorisations sont étroitement liées, et il est possible, lors du vote des crédits, de revenir sur la phase d'évaluation. Nous nous donnons le temps d'évaluer, en accordant une place centrale au travail des rapporteurs spéciaux. Ce temps ne sera pas inutile si l'engagement de tous, la coordination et la cohérence ne font pas défaut. La loi de règlement et la loi budgétaire sont deux sujets qui ne peuvent être séparés de manière artificielle.

J'appartiens à une famille qui croit au parlementarisme. La constitution de la Ve République a été conçue pour affaiblir le Parlement, tenu par des personnes considérées comme peu responsables, notamment en matière financière. Cette réforme constitutionnelle contient des éléments qui affaibliront encore un peu plus le système parlementaire, tel l'encadrement du droit d'amendement, ou de ce qu'il en reste.
Je trouve curieux que l'on entende réduire, à l'article 6, l'examen de la loi de finances à l'Assemblée de quinze jours.
Lors de l'audition par notre rapporteur des représentants de la direction du budget, à laquelle n'ont assisté hélas que deux députés, nous nous sommes interrogés sur la façon de caser dans le temps imparti l'examen de trente-deux missions. La direction du budget nous a remis un projet de calendrier, qu'il serait souhaitable de transmettre à l'ensemble des membres de la commission. Il en ressort que la première partie, qui concerne les recettes, ne peut être contractée. À la semaine d'examen par le rapporteur général, qui s'attelle au texte jour et nuit avec les administrateurs, il faut ajouter une semaine d'examen en commission et une semaine d'examen en séance publique. Que reste-t-il alors pour examiner les trente-deux missions ? J'ai demandé s'il était possible de les examiner sans les regrouper, ce qui éviterait d'enchaîner, outre les nuits auxquelles nous sommes habitués, les samedis et les dimanches pour tenir les délais constitutionnels.
Je suis pragmatique. Je veux bien entendre qu'il faille réduire les délais, mais personne ne semble savoir comment faire tenir l'examen de la seconde partie dans le temps qu'il reste. Nos lendemains vont déchanter !
Gilles Carrez peut compter avec moi les réformes constitutionnelles que nous avons vu passer, en vingt-cinq ans d'exercice d'un mandat parlementaire, une dizaine au moins. Toutes, ou presque, ont été utilisées pour pousser un certain nombre de thèmes, notamment en matière financière. Nous examinerons cela en détail.

Cette réforme constitutionnelle est la vingt-cinquième depuis 1958, mais ce sera la première à affaiblir les droits du Parlement, avec des dispositions dangereuses aussi bien pour nos assemblées que pour la démocratie locale. Nous aurons l'occasion d'en parler en séance.
Il est normal que cette réforme se décline dans trois textes, un projet de loi constitutionnelle, un projet de loi organique et un projet de loi ordinaire, mais je déplore leur examen saucissonné. Celui-ci nous posera problème et relève, peut-être, d'une stratégie.
Sous réserve de l'adoption des amendements annoncés par le rapporteur aux articles 6 et 7, nous devrions disposer de quatre semaines avant le début des discussions pour étudier sérieusement ce qui reste quand même un pavé, qu'il s'agisse de la loi de finances ou de la loi de financement de la sécurité sociale.

Ce projet de loi constitutionnelle, qui vise à minorer le rôle du Parlement, est en quelque sorte la concrétisation de ce qui se pratique depuis des mois, avec le passage au forceps de textes, sans que les parlementaires, a fortiori appartenant à des groupes restreints de l'opposition, n'aient le temps de débattre et de s'exprimer. Les parlementaires sont considérés comme les managers de certaines multinationales considèrent les salariés, et la phrase de Benjamin Griveaux – « C'est une très bonne nouvelle que les députés travaillent » – est non seulement injurieuse, mais éclairante sur la manière dont ce gouvernement regarde tous les députés, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. J'espère que chacun l'aura compris.
Pour un texte dont les seules annexes faisaient cette année 22 000 pages, l'idée de passer de soixante-dix jours à cinquante jours de débats parlementaires est contraire à l'article XIV de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. »
Réduire ce temps semble complètement lunaire, sauf si l'on considère que nous sommes là pour amuser la galerie et pour avaler ce que le Gouvernement souhaite que nous avalions, sans même s'efforcer de nous convaincre.
Enfin, l'idée de mêler PLF et PLFSS renvoie à la question, bien présente dans les arrière-pensées du Gouvernement, de la fiscalisation des cotisations sociales. Avec comme conséquence la fin du régime paritaire, c'est un avant-goût de ce que l'on nous prépare. Nous défendrons des amendements, mais j'alerte mes collègues de la majorité sur les responsabilités que nous prenons sur ces questions : lorsque l'on fait des lois, il faut penser au jour où l'on se trouvera dans l'opposition.

Une vague populiste monte en Europe et en France. En surfant sur cette vague, on fait le choix d'affaiblir une fois de plus le Parlement. Ce que l'on entend, c'est qu'il faut s'attaquer au Parlement, et aux députés, qui sont en trop grand nombre. Mais il faut se souvenir que, dans notre pays, le populisme a grandi à chaque fois que le Parlement a été affaibli : en 1934 avec les ligues factieuses, en 1956 avec le poujadisme. Ce projet de loi constitutionnelle prévoit de raccourcir le délai d'examen des lois de finances et de réduire le nombre de parlementaires : affaiblir le Parlement est dangereux pour notre démocratie.
L'un des amendements que nous avons déposés a été déclaré irrecevable et je souhaiterais, monsieur le président, en connaître les raisons. Il répond à l'appel d'une cinquantaine de juristes, d'économistes, de chercheurs pour subordonner dans la Constitution la défense de la liberté d'entreprendre et de la propriété privée à la défense de l'intérêt général, en introduisant l'idée de bien commun. Ainsi, lorsque j'étais le rapporteur d'une proposition de loi de lutte contre les paradis fiscaux, je me suis vu opposer le principe de la liberté d'entreprendre lorsque j'ai proposé d'interdire aux banques d'y travailler. Cette idée d'un intérêt général supérieur à la liberté d'entreprendre existe depuis longtemps et je regrette que notre amendement ait été déclaré irrecevable.

Il n'entrait pas dans le champ de la saisine de la commission des finances, mais vous êtes en droit de le déposer en commission des lois et en séance publique ; il y sera examiné.

Nous faisons face à une importante difficulté méthodologique. Comme l'a dit Jean-Louis Bourlanges, nous n'avons pas de vision globale et nous ne disposons pas davantage d'une évaluation des conséquences des textes que nous allons voter. On ne sait pas où on veut aller : voilà qui rend le débat surréaliste et pas du tout pragmatique. Il eût fallu procéder autrement, commencer par regarder ce qu'offre le Règlement, lever les blocages par d'éventuelles modifications du Règlement, puis de la Constitution. Ce n'est pas ce que l'on fait. Comme personne ne sait où l'on va et que le Parlement est déjà très affaibli, même les choses qui pourraient être intéressantes suscitent des doutes. Le timing politique qui nous est imposé ne permet pas le débat approfondi et serein qui aurait été nécessaire. Le Gouvernement serait bien inspiré de prendre du temps car, à l'évidence, les choses ne sont pas mûres.

Avec ces deux articles, on voit très bien où vous souhaitez aller : réduire le pouvoir et le rôle du Parlement. Je vous suggère de faire encore plus simple, monsieur le rapporteur, les parlementaires peuvent se taire et vous, tout valider depuis l'Élysée. Mais il faut nous le dire. Ces deux articles sont inacceptables !

Depuis la Ve République, l'équilibre des pouvoirs est relativement fragile et il convient d'y toucher avec de grandes précautions. Il est évident que ce texte, tel qu'il nous est proposé, accentuera le déséquilibre au profit de l'exécutif.
Monsieur le rapporteur pour avis, je suis étonné que vous proposiez de solliciter l'expertise du Conseil d'État : non pas que je remette en cause le Conseil d'État, mais parce que le président du Conseil d'État, c'est le Premier ministre. Demander à une instance qui joue le rôle de conseil du Gouvernement de s'immiscer dans l'activité législative est pour le moins choquant : cela revient à placer le pouvoir législatif sous le joug de l'exécutif. La Cour des comptes, dont nous sollicitons aussi l'avis, jouit d'une réelle indépendance. Ce n'est pas le cas du Conseil d'État, pour ce qui est de sa mission d'expertise.

Je propose de répondre sur les articles 6 et 7, sans aborder les autres sujets. Les articles 6 et 7 ne tendent pas à inscrire dans la Constitution les délais d'examen des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, comme l'a laissé entendre Marie-Christine Dalloz, puisque cela figure déjà aux articles 47 et 47-1 de la Constitution. L'article 6 tend, il est vrai, à modifier les délais, mais il n'introduit pas la notion dans le texte, encore moins celle de temps de parole, qui relève du Règlement. Il faut être très clair et éviter toute incompréhension : nous modifions les délais prévus à l'article 47 de la Constitution en les faisant passer de soixante-dix à cinquante jours, et de quarante à vingt-cinq jours pour la première lecture.
Réduire ces délais conduit-il à affaiblir le pouvoir des parlementaires, comme l'ont laissé entendre Marie-Christine Dalloz et François Cornut-Gentille ? Ce que nous disons depuis des mois, et ce à quoi le groupe de travail présidé par Éric Woerth sur la procédure budgétaire a conclu, c'est qu'il faut rééquilibrer les temps d'examen, en consacrant moins de temps à l'autorisation et davantage à l'évaluation.
Je suis d'accord avec Jean-Louis Bourlanges, il faut voir cette réforme comme un ensemble et ne pas regarder le petit bout de la lorgnette en se contentant de l'article 6. Celui-ci n'est qu'une brique, dans un ensemble bien plus important. Nous avons commencé à consacrer plus de temps à l'évaluation. Il n'est pas tout à fait vrai, monsieur Bourlanges, que les parlementaires ne prennent aucune décision, puisqu'ils votent des résolutions. Je rejoins ce qu'a dit le président Woerth : certes, peu de décisions sont prises au printemps, mais l'enjeu est que les parlementaires retrouvent leur rôle de contrôleurs. Il s'agit d'un rééquilibrage : le pouvoir parlementaire n'est pas réduit, il est mieux réparti. Je vous demande de ne pas voir cet article 6 comme un article isolé, visant à réduire les temps d'examen.
Monsieur de Courson, je vous rejoins sur ce qui concerne les délais. Je ne me suis pas senti autorisé à diffuser le calendrier de la direction du budget, mais je vous ai, en revanche, préparé des simulations sur lesquelles nous reviendrons au moment de l'examen de mon amendement visant à instaurer un délai incompressible de quatre semaines.
Monsieur Hetzel, j'avoue enfin ne pas bien comprendre votre remarque sur le Conseil d'État. Le président de l'Assemblée nationale peut déjà solliciter le Conseil d'État sur les propositions de loi, et cela fonctionne. Nous souhaitons appliquer ce modèle à quelques amendements au sujet desquels nous aurions besoin d'une expertise ex ante.
La commission en vient à l'examen pour avis des articles du projet de loi.
Après l'article 2
La commission examine l'amendement CF52 M. Charles de Courson.

Cela fait des dizaines d'années que de nombreuses initiatives parlementaires ont essayé d'encadrer la rétroactivité économique et juridique des lois fiscales, mais elles ont toutes échoué, si bien qu'en l'état actuel de notre droit, nous ne pouvons pas attacher par exemple à un produit d'épargne, un régime fiscal pluriannuel, puisque chaque année il pourra être modifié.
L'amendement que je propose vient donc compléter l'article 34 de la Constitution, aux termes duquel c'est la loi qui fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, pour préciser que ces dispositions ne peuvent être rétroactives à moins d'un motif d'intérêt général suffisant. Cela offrirait aux épargnants davantage de sécurité juridique.

Monsieur de Courson, je suis d'accord avec vous sur la visibilité et la stabilité qu'apporterait la mesure que vous proposez. Cependant, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, autorise la rétroactivité, sauf pour les lois pénales. Vous souhaitez constitutionnaliser la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour les dispositions fiscales. Il me semble néanmoins qu'il y aurait un problème à se limiter à ce seul champ, et je vous invite à retirer votre amendement pour l'étendre à l'ensemble du champ législatif et le redéposer devant la commission des lois.

Le principal problème c'est la « petite rétroactivité » au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés. Depuis quelques années, les gouvernements successifs ont pris l'engagement de ne pas la mettre en oeuvre, ce qui me semble une réponse suffisante.
Je suis donc très réservé sur cet amendement, qui nous lie les mains pour l'avenir. Lorsqu'on met en place un régime d'épargne – je pense notamment à l'assurance vie –, on le paramètre en fonction du contexte, et il me semble dangereux de ne pas pouvoir revenir dessus – je ne parle évidemment pas de ce qui a déjà été acquis. Il faut garder une certaine flexibilité en matière de recettes fiscales.

Je suis très sensible à l'argument de fond de Charles de Courson, mais l'amendement est bizarrement rédigé parce que parler de « motif d'intérêt général suffisant » est inapproprié : on n'imagine pas en effet qu'il pourrait s'agir d'un « motif d'intérêt général insuffisant »... « Exceptionnel » ou « impérieux » seraient préférables, à la rigueur, mais cette rédaction témoigne surtout de l'embarras dans lequel nous sommes. Il serait donc préférable que Charles de Courson retire son amendement pour lui substituer une proposition qui vise précisément le caractère contractuel d'un certain nombre d'engagements, comme ceux qui sont pris dans le cadre d'un contrat d'épargne, que le Gouvernement et le législateur peuvent aujourd'hui modifier unilatéralement.

J'ai la même position que celle de M. Carrez. Le Conseil constitutionnel limite déjà la rétroactivité des textes, notamment des textes fiscaux, puisque seule est autorisée la « petite rétroactivité », c'est-à-dire qu'on ne peut modifier ce qui est déjà acquis. L'amendement de M. de Courson est trop contraignant, et je ne vois pas pourquoi une mesure adoptée à un moment donné devrait lier tous les gouvernements suivants jusqu'à la nuit des temps.

Il est normal que vous soyez protégé lorsque vous avez choisi un produit d'épargne et que l'on ne puisse s'en prendre à ce que vous avez acquis. Il s'agit d'un contrat, comme l'a justement souligné M. Bourlanges, et, en le signant, vous avez souscrit à un certain nombre de règles.

Nous devrions méditer ce qui s'est passé en Allemagne avec les produits d'assurance vie, qui garantissaient une rémunération fixe, quelles que soient les conditions économiques. Or, les Allemands ont été obligés, il y a deux ans, de réformer le dispositif, sans quoi ils allaient droit dans le mur. Il est très dangereux pour l'État de se lier ainsi les mains.

Jean-Louis Bourlanges s'étonne, à juste raison, de l'expression « motif d'intérêt général suffisant » : ce n'est pas moi qui l'ai inventée, mais le Conseil constitutionnel, dans une décision qui limitait précisément la rétroactivité dite « économique ». Cette formulation permet au moins une certaine souplesse dans l'interprétation du principe. Cela étant, je retiens l'idée du rapporteur, et vais le généraliser. Je m'étonne, quoi qu'il en soit, des propos de Gilles Carrez, car un tel dispositif n'a pas pour objet d'empêcher le législateur de modifier la loi mais de faire en sorte que ces modifications ne puissent concerner le régime fiscal attaché à un produit d'épargne.
La commission rejette l'amendement.
Elle est saisie des amendements identiques CF13 de Mme Valérie Rabault, CF33 de M. Charles De Courson et CF58 de M. François Jolivet.

Cet amendement porte sur l'article 34 de la Constitution. Il vise à créer une loi de financement des collectivités territoriales.
Contrairement aux finances de l'État et de la sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des collectivités territoriales ne disposent pas d'un cadre propre. Cet amendement reprend donc la proposition n° 4 de la mission « flash » sur l'autonomie financière des collectivités territoriales. Il a pour objet d'instituer une loi annuelle de financement des collectivités territoriales. Sans avoir de caractère prescriptif, pour respecter l'article 72 de la Constitution, cette loi de financement permettrait de retracer l'ensemble des relations financières des collectivités territoriales avec l'État.
Le projet de loi de financement des collectivités territoriales (PLFCT) serait discuté indépendamment du PLF, mais évidemment en cohérence avec lui. Il découlerait d'une loi organique, qui définirait avec précision son cadre et sa portée, dans le respect des principes constitutionnels de libre administration et d'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales.
Pour mémoire, la création d'une loi de financement des collectivités territoriales a été proposée dans le rapport Lambert-Malvy en 2014, ainsi que dans deux rapports de la Cour des comptes, en 2013 et 2016.

L'amendement CF33 a été signé par des membres – de toutes sensibilités politiques – de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.
Instaurer une loi de financement des collectivités territoriales permettrait que l'on ait un document sur lequel appuyer le débat au sujet des collectivités territoriales, qui représentent entre 20 et 25 % du secteur public. Actuellement en effet les dispositions relatives aux finances des collectivités locales sont disséminées ici et là, sous formes de recettes, de prélèvements sur recettes (PSR), de dotations, qui sont considérées comme des dépenses, et j'en passe. Il est difficile dans ces conditions d'avoir une perspective sur l'équilibre, alors que cet équilibre participe de l'équilibre global du secteur public.
On nous oppose la complexité d'une telle construction législative, nous renvoyant à l'annexe du PLF qui récapitule en dépenses et en recettes tous les transferts de l'État vers les collectivités locales, pour un montant de 100 milliards... un détail !
Par ailleurs, une telle présentation ne nous dit rien ni sur l'équilibre, ni sur la stratégie pour y parvenir. Je pense d'ailleurs que l'on pourrait fort bien, pour remédier à cela, envisager une discussion commune de la première partie du PLF, du PLFSS et de ce PLFCT. Ce n'est pas une idée neuve : M. Darmanin, lui-même, a déclaré qu'à titre personnel il y était favorable, comme la plupart des associations d'élus.

J'ai également pris l'initiative, avec certains de mes collègues, de déposer un amendement qui reprend les travaux de la délégation aux collectivités territoriales. Notre intention est surtout d'ouvrir le débat dans un contexte de relations tendues entre l'État et les collectivités territoriales, qui voient leurs recettes diminuer depuis une dizaine d'années, sans que la stratégie de l'État à leur endroit soit parfaitement transparente.

Pour en avoir parlé avec M. Darmanin, je pense qu'il était plutôt favorable à une fusion de l'ensemble des lois de financement et à l'ajout d'un titre dédié aux collectivités territoriales.
L'arbitrage n'a pas été celui-là, puisque l'article 7 empêche la fusion du PLF et du PLFSS, ce que je regrette d'ailleurs, à titre personnel. À partir du moment où on ne les fusionne pas, il ne me paraît pas possible – ne serait-ce qu'en termes de temps – d'ajouter une troisième loi de financement, alors que nous nous efforçons de rationaliser le débat budgétaire.
En revanche, je rejoins les collègues qui ont défendu ces amendements sur un point, à savoir le manque de lisibilité dont souffre le débat sur le financement des collectivités territoriales, puisque que, comme l'a rappelé Charles de Courson, il y a en première partie les PSR et les dégrèvements, tandis que la seconde partie retrace les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales (RCT), rapportée par Christophe Jerretie et Jean-René Cazeneuve, et comprend des articles non rattachés.
Reste que je ne perçois pas bien l'objectif final de vos amendements : voulez-vous donner au législateur un outil supplémentaire, une sorte d'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) des collectivités territoriales ? Ou s'agit-il de rendre plus lisible le financement des collectivités territoriales ? Dans ce second cas, il me semble qu'il n'est pas nécessaire de créer une loi de financement des collectivités territoriales : c'est à nous d'organiser le débat sur ce financement de façon pertinente. Cela passe par une modification du Règlement, voire par une loi organique, mais en aucun cas par une modification constitutionnelle.
J'ajoute enfin qu'une loi de financement des collectivités territoriales ne serait pas réellement comparable aux autres lois financières du fait, d'une part, du pouvoir dont disposent les collectivités territoriales sur leurs recettes, d'autre part, de l'hétérogénéité de leurs besoins et de leurs ressources. Dans ces conditions, parvenir à un équilibre me semble assez compliqué.
La solution passe donc, selon moi, par une réorganisation du calendrier de l'examen des recettes et des dépenses, et par une amélioration du « jaune » budgétaire, qui permettrait de clarifier les données et de les rendre plus lisibles. Avis défavorable.

Après la fin de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) et la réforme avortée de la dotation globale de fonctionnement (DGF), il me semble que le contexte est aujourd'hui propice à une loi de financement des collectivités territoriales. Par ailleurs, la contractualisation nous inscrit déjà dans cette logique de finances encadrées, qui est celle d'une loi de financement.
L'une des difficultés que mettent souvent en avant les élus locaux et les parlementaires, c'est l'absence de vision consolidée des finances des collectivités locales. Or cet amendement et ceux que nous défendrons par la suite ont précisément pour objet de faciliter l'équilibre entre dépenses et recettes, puisqu'il s'agit de rétablir la cohérence entre les mesures votées et les politiques publiques territoriales.
En ce qui concerne enfin la question du temps, cette loi de financement permettrait de réduire la durée du débat budgétaire, puisque nous n'aurions plus besoin de revenir à plusieurs reprises sur les mesures concernant les collectivités.

Le rapporteur est très conservateur : il invoque les mêmes arguments que ceux que j'ai entendus pendant dix ans au sujet de l'éventuelle création d'une loi de financement de la sécurité sociale !
Nous sommes parfaitement capables d'établir une projection des recettes des collectivités territoriales, puisque non seulement c'est nous qui décidons de la réévaluation des bases mais que nous votons également les transferts de l'État, qui représentent la moitié des 220 milliards d'euros de recettes des collectivités territoriales – sans parler des régions ou des départements pour lesquels cette proportion est beaucoup plus importante. Par ailleurs, la suppression de la taxe d'habitation va encore augmenter la part des transferts.
On ne peut donc pas nous opposer la libre administration des collectivités territoriales. En outre, leur solde budgétaire est un des éléments du solde du secteur public, lequel doit être conforme aux règles de Maastricht.

Cette question ne concerne pas uniquement la forme de nos débats budgétaires, que nous pouvons en effet rééquilibrer ; c'est également une question de fond sur la place que nous entendons donner aux collectivités territoriales. Cela concerne 70 millions de Français, et cela mérite sans doute que nous en fassions plus de cas.
Par ailleurs, en saucissonnant les mesures de péréquation, les dotations et les prélèvements, nous brouillons totalement la visibilité que nous pouvons avoir et votons au bout du compte des dispositions dont nous ignorons l'impact global qu'elles auront.
Je peux comprendre que vous ne vouliez pas aller jusqu'à une loi de financement, monsieur le rapporteur, mais le Gouvernement doit nous donner des engagements plus forts que ce qu'il propose.

Nous nous heurtons également à la complexité des dispositifs. Il est bien de pouvoir aborder globalement la question de la péréquation, mais les élus ne comprennent rien à la manière dont elle est calculée.

Je soutiens la position du rapporteur car autant je considère que nous avons besoin de davantage de lisibilité et qu'il faut nous proposer des voies d'amélioration en la matière, autant j'appelle l'attention de ceux qui proposent cette loi de financement sur le caractère assez dangereux pour eux de la manoeuvre : ils risquent de se retrouver comme ces grenouilles qui demandaient un roi. Le rapporteur en effet a fait une allusion, perfide mais juste, à l'Ondam : si nous adoptons un instrument permettant d'encadrer globalement les finances des collectivités territoriales, il sera, tôt ou tard, utilisé comme un instrument de régulation des comptes des collectivités. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et je ne serais d'ailleurs pas fondamentalement hostile à cette idée, mais je pense que ce n'est pas ce qu'ont à l'esprit les auteurs de ces amendements. Donc, méfiez-vous de ce que vous proposez !

Nous sommes dans un État décentralisé où les collectivités territoriales ont pris une place essentielle et où les politiques publiques menées par ces collectivités territoriales sont très importantes, de plus en plus importantes. L'idée qui sous-tend cette loi de financement des collectivités locales, c'est de pouvoir examiner globalement toutes les mesures qui s'appliquent aux collectivités locales. Il ne s'agit absolument pas de mettre en place un Ondam, puisque nous avons déjà l'objectif d'évolution de la dépense locale (Odelel), qui est indicatif, et que nous avons contractualisé avec 322 collectivités. L'objectif est donc uniquement de pouvoir appréhender dans une vision globale les PSR, les crédits de la mission RCT, les remboursements et les dégrèvements, qui s'élèvent à plus de 100 milliards. Dans cette optique, monsieur le rapporteur, vos propositions n'ouvrent pas tout à fait les mêmes perspectives qu'une loi de financement, mais, s'il faut renoncer à celle-ci, je souscris à l'idée de repenser l'organisation du débat budgétaire.

Je suis tout à fait favorable à une approche consolidée des finances locales, notamment dans notre travail d'évaluation. En revanche Jean-Louis Bourlanges a raison lorsqu'il souligne les dangers d'une telle loi, d'autant que je vous invite à méditer sur la suppression du cumul des mandats, qui va profondément modifier le déroulement du débat budgétaire. Jusqu'à présent, on pouvait constater qu'à 2 ou 3 heures du matin, l'ensemble de l'hémicycle se réveillait dès lors qu'il s'agissait de défendre les intérêts des collectivités territoriales ; mais ces temps-là sont révolus, et donner un instrument législatif à des députés qui n'auront plus d'attaches locales, c'est le transformer en système coercitif. En effet, ne nous faisons pas d'illusions : de plus en plus nous allons être condamnés à adopter des mesures d'économies, et cet instrument se retournera contre leurs auteurs.

Nous devons soutenir les propositions de notre rapporteur, qui sont parfaitement cohérentes avec notre volonté d'améliorer la consolidation, l'agrégation et la compréhension des flux croisés qui traversent les finances locales.
J'insiste par ailleurs sur une bizarrerie : un projet de loi de financement des collectivités locales impliquerait de demander aux 36 000 communes de France de communiquer très tôt leurs taux de fiscalité locale. Or je ne suis pas sûre que ceux qui défendent cette idée voient par ailleurs d'un très bon oeil que les services de Bercy réclament dès le mois de juillet, avant même le vote du conseil municipal, les taux qui seront appliqués l'année suivante.
Il ne me semble donc pas que cette proposition aille dans le sens de l'autonomie des collectivités locales, que vous défendez par ailleurs.
La commission rejette les amendements.
En conséquence, les amendements CF15, CF34 et CF59 après l'article 3, ainsi que les amendements CF18, CF36, CF61, CF19, CF37, CF62, CF20, CF38 et CF63 après l'article 7 tombent.
La commission en vient à l'examen de l'amendement CF68 du président Éric Woerth.

L'amendement CF68 vise à réduire le champ du projet de loi de financement de la sécurité sociale plutôt que de créer un projet de loi de financement supplémentaire.
Au plan national, le contribuable dont il est question dans la première partie du PLF est le même que celui de la troisième partie du PLFSS – c'est notamment très clair avec la contribution sociale généralisée (CSG). Cela justifie donc que les recettes de l'un et de l'autre soient discutées concomitamment. C'est la raison pour laquelle nous proposons de fusionner leur examen.
Il ne s'agit pas d'organiser une discussion générale commune, et l'examen conjoint de tel ou tel article n'aurait pas non plus beaucoup de sens. Nous pensons donc que ce n'est pas tant une réorganisation de nos séances qui est nécessaire qu'une réorganisation des textes, ce qui passe par une révision constitutionnelle. C'est un vieux débat, mais dont l'acuité est particulièrement vive du fait de l'enchevêtrement croissant des flux de financements.

Au sein de notre groupe de travail, je me suis prononcé, vous le savez, en faveur de la fusion du PLF et du PLFSS. Dès lors que ce n'est ce qui est proposé dans ce projet de loi, la solution consistant à ne fusionner que les parties recettes me paraît présenter quelques difficultés. D'une part, cela remettrait en cause l'article d'équilibre qui est quand même la pierre angulaire du PLF ; d'autre part, cela viderait de sa substance le PLFSS. Si l'on considère, comme le projet de loi le suggère, que les deux textes existent toujours, il faut les respecter l'un et l'autre, tels qu'ils existent aujourd'hui. Avec votre amendement, vous videz le PLFSS de sa substance. Mon avis est donc défavorable.
Dès lors que la fusion des deux textes à laquelle j'étais favorable n'a pas été retenue, je suis en revanche favorable à l'organisation d'une discussion générale commune, voire à une réorganisation de la discussion des articles pour que nos débats gagnent en cohérence.

Vous aviez raison, monsieur le rapporteur, d'être favorable à une fusion du PLF et du PLFSS, et nous ne devons pas rater l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui. La question se pose depuis dix ans, et tous ceux qui se sont intéressés au sujet sont arrivés à la même conclusion : il faut fusionner les recettes. En ce qui concerne les dépenses, c'est un autre sujet, car elles ont leur spécificité, et la nécessité d'une loi de financement de la sécurité sociale reste intacte.
Les recettes sont aujourd'hui totalement imbriquées. On a d'abord créé la CSG, imposition qui s'est substituée aux cotisations d'assurance maladie. Au passage, la mise en place du prélèvement à la source va accentuer cette imbrication impôt sur le revenu-CSG. Par ailleurs, depuis la « loi Veil » de 1994, chaque perte de recettes pour la sécurité sociale doit être compensée, si bien que des morceaux entiers de TVA sont « branchés » sur les comptes de la sécurité sociale. Quand on ajoute tous les systèmes d'exonérations, d'abattements, d'exceptions ou de dérogations, la distinction entre les deux types de recettes rend notre système illisible et complètement imprévisible.
Surtout, on a atteint, fin 2017, un record en matière de prélèvements obligatoires. Quand on examine le programme de stabilité, ils ne vont baisser que très faiblement d'ici à 2022. Le fait d'éclater, de saucissonner la discussion sur les prélèvements obligatoires ne nous permettra pas de prendre la pleine mesure de leur poids qui est considérable, alors qu'une consolidation le permettrait. Nous avons une occasion à saisir et le terrain a d'ailleurs été préparé quand Éric Woerth était ministre, si bien qu'aujourd'hui le Gouvernement a un seul ministre des comptes publics responsables de l'ensemble des recettes. Le moment est donc venu et il serait dommage, je le répète, monsieur le rapporteur pour avis, de ne pas saisir l'occasion qui nous est ici offerte.

Je soutiens à 100 % cet amendement. En effet, l'hypocrisie est totale : 37 milliards d'euros correspondent, dans le budget de l'État, à des compensations à la sécurité sociale. Autrement dit, à chaque fois que le Gouvernement décide de créer des exonérations de cotisations, c'est le budget de l'État qui compense le manque à recevoir pour la sécurité sociale. Tout est de toute façon tellement intriqué qu'on n'y comprend plus rien. Il est donc nécessaire de disposer d'une synthèse : qu'il s'agisse de cotisations ou d'impôts, les Français s'en acquittent en puisant dans le même porte-monnaie. Or, Bercy prend un malin plaisir à ne pas réaliser la consolidation que nous réclamons ici. Et tant qu'on ne disposera pas d'une vision consolidée, le Parlement ne servira à rien puisque, sans cette synthèse par déciles de revenus, il est incapable d'estimer l'impact des mesures fiscales ou des modifications des taux de cotisation sur le pouvoir d'achat des Français.
J'ajoute que la fixation des taux de cotisation ne passe pas par le Parlement : le Gouvernement peut faire ce qu'il veut ou presque. Donc, j'y insiste, nous n'avons jamais de vision globale de l'impact d'une variation des taux sur le pouvoir d'achat des Français. Tout le monde se renvoie en effet la balle et, résultat...

Je ne sais pas si cela conduit à des erreurs mais je sais que les Français viennent nous voir pour se plaindre de mesures que nous n'avons jamais votées et dont nous ignorons tout. Il est très dangereux que le Parlement les découvre après coup.

Lorsque le projet de loi organique relatif aux lois de financement de la sécurité sociale a été discuté, nous nous étions posé la question de savoir s'il ne fallait pas établir un document unique. Nombre d'entre nous considéraient qu'à terme on fusionnerait les dispositions relatives aux recettes des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Eh bien, vu les modes de financement de la protection sociale, cette thèse est encore plus crédible qu'alors. Reste que le Gouvernement ne veut pas d'une telle fusion.
L'amendement Woerth est modéré puisqu'il propose que le projet de loi de finances arrête les recettes de la sécurité sociale et qu'ensuite, à partir de l'article d'équilibre, on examine les dépenses sociales. C'est tout, et c'est donc parfaitement « articulable », si je puis dire, et c'est un pas vers ce que nous souhaitons, à savoir la fusion de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale.

Je serais plus hésitant sur ce dernier point : si les recettes s'interpénètrent totalement, l'univers de la dépense sociale est assez différent.

Je salue la convergence de vues du président, de M. Carrez, des députés du groupe Les Républicains et des socialistes – et d'ailleurs je m'y associe. Je souhaite en revanche être éclairé sur un point précis à propos de l'article d'équilibre. Si l'on y voit clair en ce qui concerne les recettes, ce n'est pas le cas, le président vient de le rappeler, pour ce qui est des dépenses de l'État qui ne sont pas de même nature que celles de la sécurité sociale. Qu'allons-nous envoyer à Bruxelles ? Comment présenterez-vous l'article d'équilibre dès lors qu'on aura fusionné les recettes tout en maintenant une certaine hétérogénéité dans les dépenses ?

Les deux sont pris en compte dans le programme de stabilité et il y a deux articles d'équilibre. Cette question technique peut être facilement résolue.

Nous consolidons ainsi les recettes et elles sont par la suite réparties dans chacun des deux textes.

La LOLF prévoit un débat sur les prélèvements obligatoires, disposition pas vraiment appliquée.

Ce n'est plus le cas, comme de nombreuses autres dispositions d'ailleurs, tel le rapport d'application de la loi fiscale que je vais ressusciter. Or, le débat sur les prélèvements obligatoires serait une réponse pour éviter de sur-légiférer en la matière.

Je maintiens que l'adoption de l'amendement poserait un problème avec l'article d'équilibre, ne vous en déplaise. De surcroît, si l'on fusionnait uniquement la partie recettes, quid du rôle des caisses de sécurité sociale ? Elles sont aujourd'hui consultées dans le cadre du PLFSS mais, demain, comment ferait-on ? Alors que le but ultime serait la fusion du PLF et du PLFSS, l'amendement introduirait un déséquilibre dommageable. Je réitère mon avis défavorable.

Nous ne réformons pas tous les jours la Constitution, monsieur le rapporteur pour avis, et nous devons tenir compte de ce qui est utile et de ce qui ne l'est pas.
La commission rejette l'amendement.
Elle en vient aux amendements CF53 et CF54 de M. Charles de Courson.

C'est ici, vous le savez, mes chers collègues, un de mes dadas. J'appartiens à une famille politique qui pense que si nous voulons gérer correctement nos finances publiques, il faut instaurer la fameuse « règle d'or ». Qu'est-ce ? Elle consiste à interdire, pour le budget de l'État, le déficit de fonctionnement, sauf circonstance tout à fait exceptionnelle. Pour ce qui est de la sécurité sociale, qui n'a que des dépenses de fonctionnement, l'équilibre global s'impose.
Contrairement à ce beaucoup peuvent croire, dans la loi de finances, une annexe mêle budget de fonctionnement et investissements. Nombre d'élus locaux se demandent pourquoi l'État ne présente pas d'un côté un budget de fonctionnement et de l'autre un budget d'investissement.

J'avais fait voter un amendement au projet de loi organique relatif aux lois de finances prévoyant une annexe que personne n'utilise, d'ailleurs, qui montre par exemple, pour la loi de finances pour 2018, un déficit de fonctionnement de 56 milliards. Il est légitime de s'endetter pour financer des investissements mais pas pour financer les dépenses de fonctionnement.
Il s'agit donc, par le biais de l'amendement CF53, de « remonter » une disposition figurant dans la loi organique et, à l'alinéa 18 de l'article 34 de la Constitution, après les mots « de l'État », d'insérer les mots : « , présentent les recettes et les dépenses budgétaires en une section de fonctionnement et une section d'investissement. » ; il s'agit ensuite de compléter ledit alinéa par la phrase suivante : « À compter de l'exercice 2022, cette section de fonctionnement ne peut pas être présentée, votée et exécutée en déficit. En cas de situation d'urgence exceptionnelle qui échappe au contrôle de l'État et qui compromet durablement l'équilibre des finances publiques, un retour à l'équilibre de fonctionnement doit intervenir dans un délai raisonnable. » C'est l'article 115 de la loi fondamentale allemande... Donc la loi de finances initiale doit être présentée, votée et exécutée en équilibre de fonctionnement.
L'amendement CF54, quant à lui, prévoit qu'à compter de l'exercice 2022, le solde de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut être présenté, voté et exécuté qu'en équilibre.
C'est une question de discipline.

Je vous remercie, monsieur de Courson, de rappeler l'existence de cette annexe utile pour l'ensemble de nos collègues.
Pour ce qui est de la règle d'or, je rejoins totalement Gilles Carrez lorsqu'il parlait de souplesse. Je ne crois pas nécessaire d'inscrire dans la Constitution une disposition d'une telle rigidité sur l'équilibre du budget des administrations publiques, même si vous connaissez désormais mon attachement à cet équilibre dans les faits. Vouloir ainsi lier les mains de l'État me paraît dangereux. En cas de crise, en effet, il faut pouvoir faire preuve d'une certaine flexibilité.
En revanche, vous lancez un vrai débat, et je vous en remercie, sur la sincérité des budgets. Le Gouvernement a pris cette question très au sérieux et, dans la loi de programmation des finances publiques, vous avez pu constater l'effort de sincérisation budgétaire à l'oeuvre. Or, c'est ce qui compte vraiment : la réalité du sérieux budgétaire dépendra de la volonté politique et non de la constitutionnalisation de la règle d'or.

Nous avons eu cette discussion à l'occasion de la dernière réforme constitutionnelle de 2008 et nous nous sommes heurtés à plusieurs difficultés : qu'est-ce que la dépense d'investissement, la formation, les cycles... ? Difficultés auxquelles les Allemands ont été confrontés au moment d'inscrire la règle d'or dans leur loi fondamentale.
L'article 34 de la Constitution dispose que « les orientations pluriannuelles des finances publiques […] s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques ». Ce n'est peut-être pas suffisant mais un effort dans le bons sens a été fait.
Ensuite, c'est sans doute plutôt du côté du budget de la sécurité sociale qu'il faudrait essayer d'être plus rigoureux, alors que la proposition de M. de Courson concernant le budget de l'État me paraît très difficile à réaliser.

Je suis d'accord avec Gilles Carrez. Il vaut mieux fournir l'effort que de dépenser autant, sinon plus, d'énergie à fixer un cadre qu'on va ensuite passer son temps à essayer de déborder. En revanche, une telle disposition se justifie très bien pour le budget de la sécurité sociale, par principe un budget de fonctionnement.

C'est une très bonne idée de principe mais très difficile à appliquer pour les raisons rappelées par M. Carrez.
En effet, personne ne sait ce qu'est une dépense de fonctionnement. C'est certes une catégorie juridique mais, d'un point de vue économique, elle est très difficile à définir.
Ensuite, si nous sommes très attachés à la rigueur allemande, même si nous la pratiquons de façon très intermittente, il faut savoir que les Allemands nient la réalité du cycle économique : ils ont introduit la règle d'or qu'on soit en paix ou en guerre. Or, cette règle nous a profondément pénalisés au cours de ces dernières années. À cause de la pression allemande et parce que n'avons pas du tout accompagné le cycle, les taux de croissance en Europe ont été relativement faibles. Reste qu'à l'inverse, nous dépensons même quand tout va bien et nous creusons le déficit budgétaire. Il ne faut donc pas traiter la réalité du cycle par le mépris.
Enfin, quand on procède à une relance keynésienne, ce dont nos amis socialistes ont à mon avis tendance à abuser, relance parfois légitime, on touche aussi le budget de fonctionnement.
Dès lors, le voeu de M. de Courson est très bien inspiré mais il faudrait approfondir les notions considérées et nourrir notre réflexion des formules contenues dans le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire. J'invite en tout cas à la prudence.

Les amendements de M. de Courson vont dans le bon sens même si je comprends qu'il est difficile d'inscrire dans la Constitution une règle aussi définitive. Je rappelle néanmoins que, pendant très longtemps, les budgets étaient présentés comme ceux de bons pères de famille, à savoir en équilibre. Puis les guerres, et entre elles la crise de 1929, ont provoqué le dérapage que l'on sait, de même que l'influence keynésienne – encore qu'on oublie la notion d'équilibre keynésien car, à ma connaissance, Keynes n'a jamais écrit que le déséquilibre budgétaire devait être permanent.
Ce qui compte ici, c'est l'effet de levier, beaucoup plus perceptible en matière d'investissement que de fonctionnement. Les abus, les dérapages successifs ont conduit à transformer le déficit de l'État en fonds de commerce, ce qui n'est pas une bonne chose en soi et va à l'encontre de ce qui est recherché.
La commission rejette successivement les amendements CF53 et CF54.
Elle en vient aux amendements identiques CF67 du président Éric Woerth, CF3 de M. Marc Le Fur et CF47 de M. Fabien Roussel.

L'amendement CF67 vise à abroger l'article 40 de la Constitution. Fort de mon expérience, je considère que cet article déresponsabilise les parlementaires et sous-entend qu'ils pourraient proposer n'importe quoi. Ensuite, il n'y a pas lieu que les parlementaires n'aient pas la même liberté de proposition que le Gouvernement. L'article 40 avait peut-être une raison d'être il y a soixante ans ; c'est moins le cas aujourd'hui. Cette demande de suppression est du reste récurrente.

La modernisation des institutions passe par une revalorisation du rôle du Parlement. Aussi est-il surprenant de constater que le projet de loi ne prévoie pas de mettre fin à l'une des contraintes les plus fortes qui pèsent sur l'initiative parlementaire : celles résultant de l'article 40 de la Constitution. L'inefficacité de cette disposition n'est pas à démontrer ; elle est suffisamment mise en lumière par la situation actuelle des finances publiques. Ses effets pervers sont connus : déresponsabilisation des élus et incitation à la dépense fiscale.
En 2008, Didier Migaud, alors président de la commission des finances de l'Assemblée, et Jean Arthuis, président de la commission des finances du Sénat, cosignaient dans le journal Le Monde un article préconisant l'abrogation de l'article 40. Les deux parlementaires affirmaient qu'on ne pouvait, « sans hypocrisie, parler de revalorisation du rôle du Parlement, tout en conservant intact l'article 40 ». M. Migaud avait même déclaré, lors de la précédente révision constitutionnelle – en séance publique à l'Assemblée le 23 mai 2008 : « pour soutenir l'abrogation de l'article 40, nous estimons que le droit d'amendement doit être exercé dans toute sa plénitude par l'ensemble des parlementaires ».
Il est grand temps que le Parlement retrouve une pleine responsabilité en matière budgétaire. Or, seule l'abrogation de l'article 40 permettra d'y parvenir. Dans l'exposé des motifs d'un amendement similaire déposé en 2008, le Président de notre assemblée écrivait d'ailleurs que « l'expérience a montré qu'en matière d'équilibre des comptes, le Gouvernement n'[était] pas plus vertueux que les parlementaires ».

Je pourrais reprendre exactement vos propos, monsieur le président. Tous les parlementaires devraient d'ailleurs s'accorder pour supprimer cet article qui les empêche de faire ce que fait le Gouvernement. Nous ne pouvons pas augmenter les recettes parce qu'il y aurait trop d'impôts en France, donc on peut supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune ; mais nous ne pouvons pas augmenter la dépense publique par voie d'amendement. Ce n'est pas juste.

Je répète depuis plusieurs mois mon opposition à la suppression de l'article 40. Je suis parlementaire, comme vous, et je suis de ceux qui pensent que cet article est un garde-fou pour nos finances publiques. Il faut être cohérent : j'ai dit que je tenais à l'équilibre des comptes publics – donc je tiens à l'article 40.
Qu'il ait des effets néfastes, des effets pervers, qu'il entraîne une certaine inefficience, je veux bien l'entendre ; et on peut discuter du fait, quelque peu baroque, qu'on puisse gager une baisse de recettes mais pas une charge. Reste que ma position est claire et ferme, je suis farouchement défavorable à la suppression de l'article 40.

Je suis parvenu à la même conclusion que tous mes prédécesseurs, Pierre Méhaignerie, Didier Migaud, Jérôme Cahuzac... : quand vous avez appliqué pendant des années l'article 40, que vous avez refusé des milliers et des milliers d'amendements, vous vous demandez à quoi sert cet exercice. En effet, je rassure M. Roussel, du côté des recettes, les impôts, on peut les augmenter à l'infini – il n'y a absolument aucun frein en la matière ; de même qu'il n'y a pas de frein à des propositions de diminution d'impôts puisque grâce aux droits sur le tabac on peut gager presque tout et n'importe quoi. Il existe en revanche une dissymétrie avec les dépenses.
Depuis l'introduction d'un petit assouplissement, qui permet de proposer une dépense nouvelle à condition de la gager au sein de la même mission, le débat est beaucoup plus responsable. Aussi, monsieur le rapporteur, plutôt que de supprimer d'emblée l'article 40, il faut réfléchir à des propositions intermédiaires visant à élargir le dispositif instauré par la LOLF, que je trouve efficace et responsabilisant.

Je suis pour ma part très conservateur sur ce point. Je suis saisi de vertige en lisant dans l'exposé des motifs de l'amendement CF67 que l'article 40 est « un vestige d'une conception du parlementarisme rationalisé qui n'a plus lieu d'être ». Quand on voit nos déficits publics depuis tant d'années, le parlementarisme rationalisé a pourtant vraiment sa raison d'être. Alors je conçois bien que ce n'est pas cet article-là qui suffira à remédier à la folie des hommes – la folie des hommes dépasse tout et aucune barrière juridique ne l'arrêtera.
En matière de finances publiques j'ai deux maîtres : André Tardieu et Michel Debré. Aussi je suis effrayé de voir que c'est M. Woerth qui piétine la tombe de Michel Debré ! Michel Debré aurait-il pu en effet imaginer qu'un ancien ministre gaulliste du budget piétinerait ainsi son oeuvre ? Je ne m'associe pas à cette entreprise mortifère !

Mon plaidoyer risque d'être moins brûlant ; il sera plus pragmatique. Tant que le Parlement ne disposera pas des moyens de chiffrer, d'évaluer, de préciser ce que nous proposons, qu'il s'agisse de charges, de ressources, de gages, tout ce débat restera très poétique. Le combat pour créer une agence parlementaire d'évaluation à même de nous fournir des données, des modèles, des simulations, est essentiel. Tant que nous n'aurons pas ces outils, objectivement, l'article 40 est un garde-fou. Nous avons à faire la preuve que nous pouvons sérieusement, comme dans nombre d'autres démocraties, créer des offices internes d'évaluation et de chiffrage performants, montrer que nous savons les utiliser, et montrer que le garde-fou, en l'espèce, n'est pas un article de la Constitution mais l'expertise, la compétence et la raison.
Tant que nous n'aurons pas instauré ces agences qui demanderont un effort budgétaire de la part de l'Assemblée et que nos collègues Barrot et Eliaou sont en train de présenter au bureau de l'Assemblée, nous pouvons donner à l'infini dans le verbiage sur l'article 40 ; car nous devons prouver que nous sommes à même de faire les choses proprement avant de lever tout garde-fou.

D'ailleurs, parler de « garde-fou », je trouve cela épouvantable : nous ne sommes pas des fous ! Devons-nous nous garder de nous-mêmes ? Avons-nous peur de nos propres impulsions ? Il est temps d'avoir un débat responsable. Dès lors que la majorité souhaite modifier la Constitution – alors qu'il n'y a pas urgence à le faire –, qu'elle ne se contente pas de petites mesures. S'il s'agit simplement de réduire le débat budgétaire de soixante-dix à cinquante jours, est-ce la peine de réformer la Constitution ? Quitte à la toiletter, soyons « disruptifs » et admettons dès lors que le Parlement, au XXIe siècle, soit particulièrement responsable – c'est le sens de l'abrogation de l'article 40.

Fort bien, monsieur le président, mais toiletter n'est pas passer au kärcher et, en l'occurrence, supprimer l'article 40 de la Constitution. Je rejoins totalement Gilles Carrez : il y a probablement une possibilité d'amélioration au niveau organique. Nous sommes évidemment conscients de l'inefficacité relative induite par l'article 40 et je suis totalement d'accord avec Amélie de Montchalin : tant que nous ne disposons pas d'outils d'évaluation et d'expertise ex ante, la question n'est pas de savoir si nous sommes ou non des fous ; la question est qu'il n'est pas responsable de supprimer l'article 40 sans qu'on soit en mesure de chiffrer certaines propositions.
Il y a tout de même une différence entre le Gouvernement et le Parlement – et il n'est pas ici question de responsabilité ou d'irresponsabilité : le Gouvernement a une vue d'ensemble du budget de l'État que, par définition, le parlementaire qui dépose un amendement n'a pas forcément. Il est donc normal que l'article 40 ne s'applique pas au Gouvernement et je vous rappelle, monsieur le président, que vous avez été ministre des comptes publics...

Avec un peu d'humour, je dirai que l'article 40, c'est au Gouvernement qu'il faudrait l'opposer, qu'il faudrait l'élargir. Si c'était grâce à l'article 40 qu'on pourrait protéger les finances publiques, ça se saurait. C'est le Gouvernement qui est le garde-fou or, il n'a jamais joué le jeu depuis cinquante-neuf ans ! Ce n'est pas plus compliqué. C'est pourquoi je crois plutôt à l'élargissement des possibilités d'amendement sans dégradation du solde budgétaire. J'y reviendrai.

Je trouve également que le mot « garde-fou » est inadapté, déplacé quand il est question du travail des parlementaires. Vous voulez, avec cet article 40, lutter contre les déficits publics. Pour nous, c'est un verrou et nous luttons, nous, contre les déficits démocratiques. L'article 40 produit des effets pervers puisque, pour défendre un amendement qui crée une dépense, il faut le gager avec des propositions de recettes fiscales nouvelles ; et c'est ainsi que les recettes fiscales ont explosé ces dernières années.

Je comprends parfaitement, monsieur Roussel, mais je vais vous donner un exemple, celui de la « niche Copé », chiffrée à 200 millions dans l'amendement qui la créait et qui a coûté 22 milliards en deux ans ! Nous avons donc besoin d'outils d'évaluation pour « sécuriser » les amendements. La proposition de M. Carrez est intéressante alors que supprimer brutalement l'article 40 ne me paraît pas très raisonnable.

Je rappelle qu'il n'y a pas de faux combat. Nous avons tous signé, Éric Woerth, Laurent Saint-Martin, Valérie Petit, Valérie Rabault..., une tribune transpartisane, dans Le Monde, il y a quelques semaines, selon laquelle, pour avoir un budget responsable – et parce que nous ne croyons pas que le Gouvernement serait responsable alors que nous, députés, serions irresponsables –, nous avions besoin d'un engagement très fort afin de disposer de données, de modèles, de chiffrages, d'expertises et donc d'experts. Dans la perspective du prochain PLF, nous travaillons d'ailleurs activement pour poser les bases d'un soutien ex ante assuré par des modèles économiques, le but étant, autrement dit, que l'Assemblée dispose de cette expertise.
Je ne pense pas que nous gagnions à mener des débats partisans mais nous gagnerons tous, opposition comme majorité, à avoir plus de données.
La commission rejette les amendements.
Elle examine l'amendement CF45 de M. Jean-Paul Dufrègne.

Cet amendement de repli vise à permettre le dépôt d'amendements aggravant les dépenses pour peu qu'elles soient compensées par des recettes nouvelles.

Le présent amendement vise en effet à gager l'aggravation ou la création de charges publiques. Or, j'y insiste, il sera toujours aussi difficile de vérifier la réalité de la compensation à due concurrence, et ici encore plus si l'on prend en compte les charges. J'émets donc un avis d'autant plus défavorable que l'article 40, si l'amendement était voté, ne servirait plus à rien – donc autant, en effet, de votre point de vue, l'abroger...
De surcroît, l'adoption de la disposition que vous proposez entraînerait une inflation des amendements qui ne va pas précisément dans le sens souhaité.
La commission rejette l'amendement.
Elle est saisie d'un amendement CF49 de M. Charles de Courson.

Cet amendement, qui vise à appliquer l'article 40 au Gouvernement, avait surtout pour but de susciter la réflexion. Je le retire.
L'amendement est retiré.
La commission examine en discussion commune les amendements CF42 de M. Fabien Roussel ainsi que CF51, CF56 et CF57 de M. Charles de Courson.

L'amendement CF42 est un amendement de repli. Si le Parlement ne peut même pas proposer la création de nouvelles dépenses, il va finir par devenir un simple organe de contrôle budgétaire.

Tout à l'heure, l'idée qui est ressortie de nos discussions était qu'il fallait essayer d'aménager l'article 40 plutôt que de le supprimer. Notre amendement CF51 propose de compenser une charge d'une mission donnée par la diminution d'une charge appartenant à une autre mission. L'amendement CF56 a pour but de permettre aux parlementaires de répartir des crédits budgétaires entre différentes missions et de prévoir des dépenses supplémentaires si elles sont compensées par des économies sur d'autres dépenses. L'amendement CF57 ouvre la possibilité de compenser une hausse des crédits budgétaires dans une mission budgétaire par une réduction des crédits d'une autre mission ou par une augmentation d'une ressource publique réelle.

Monsieur le rapporteur, j'avais cru comprendre que vous étiez favorable à une atténuation des contraintes de l'article 40.

Non, j'ai dit que je partageais les propos de Gilles Carrez sur le fait qu'il devrait y avoir une réflexion, au niveau organique, sur l'article 40 mais je suis défavorable à toute modification constitutionnelle car cela reviendrait à l'abroger.

La rédaction actuelle de l'article 40 impose de fortes contraintes du fait qu'il utilise le pluriel pour les ressources et le singulier pour les charges. Il est possible de compenser une perte de recettes par une augmentation de recettes mais pas une augmentation de charge par la diminution d'une autre charge, sauf à l'intérieur d'une même mission. Ce n'est pas dans la loi organique que vous pourrez modifier cet équilibre, qui est d'ordre constitutionnel.

Monsieur de Courson, cette rédaction n'a rien d'illogique. Elle freine la propension à viser des dépenses dont il est extrêmement facile de proposer la suppression car elles sont impopulaires.

Monsieur de Courson, nous sommes aujourd'hui incapables d'évaluer correctement les compensations à due concurrence. Nous ne sommes pas outillés pour avoir une expertise ex ante qui nous permette de prendre des décisions équilibrées. Si vous ouvrez la possibilité de compenser une charge appartenant à une mission donnée par la diminution d'une charge appartenant à une autre mission, il n'y aura plus de vue d'ensemble possible.

Cher collègue, que vous m'expliquiez ces choses sur un ton docte, vous qui êtes tout jeune parlementaire, me met hors de moi. Ceux qui comme moi sont députés depuis vingt-cinq ans ont une petite expérience. Votre argument est parfaitement inexact : il est impossible d'aménager l'article 40 dans le cadre de la loi organique. Dites plutôt que vous ne voulez rien faire. Cela aura le mérite d'être clair au moins !
La commission rejette successivement ces amendements.
Elle est saisie de l'amendement CF4 de M. Marc Le Fur.

Cet amendement de repli a pour objet de renforcer les pouvoirs du Parlement en assouplissant les règles de recevabilité financière des amendements et propositions formulées par ses membres.
L'insertion de ce nouvel alinéa à l'article 40 de notre Constitution permettrait ainsi aux membres du Parlement de disposer d'une marge de manoeuvre plus importante tout en prévoyant des conditions d'application suffisamment restrictives pour éviter une dégradation de l'état des finances publiques. En tout état de cause, il appartiendra au juge constitutionnel, comme c'est d'ailleurs déjà le cas, de veiller au respect de cette disposition.

Avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment. J'ai exposé tout à l'heure ma vision de l'article 40 : toute modification de sa rédaction le viderait de son sens. Nous sommes d'accord pour dire, monsieur de Courson, qu'il s'agit d'un garde-fou nécessaire.

Cela me semble contradictoire : un article 40 aménagé ne serait plus un garde-fou. Gilles Carrez a souligné qu'il y avait eu des modulations dans l'application de cet article. Et, si nous pouvons le faire sur la question des charges, je suis tout à fait prêt à en discuter au moment où l'on révisera la LOLF. Je redis clairement que je ne souhaite aucune modification de l'article 40.

La nouvelle majorité ne veut discuter de rien et ma présence ici est ainsi inutile ! Mais ne vous étonnez pas si vous n'obtenez pas la majorité requise pour l'adoption de ce texte !
La commission rejette l'amendement.
Après l'article 3
La commission est saisie de l'amendement CF69 du président Éric Woerth.

La réforme de 2008 a constitué la première étape d'une démarche qu'il convient de mener à son terme. Cet amendement propose d'aligner l'examen des projets de loi de finances sur les modalités qui encadrent les autres textes. Il serait examiné en séance publique sur la base du texte de la commission et non plus du Gouvernement. La question posée par l'article d'équilibre pourra être facilement réglée.

Nous avons eu une longue discussion à ce sujet au sein de groupe de travail. Tout dépend de l'angle de vue que l'on adopte. On pourrait aussi considérer que débattre en séance publique du texte du Gouvernement met davantage en lumière le travail de la commission, qui est appelée à présenter ses amendements.
En outre, la loi de finances, qui couvre l'ensemble des politiques publiques, a la particularité de concerner l'ensemble des députés, au-delà des membres de la commission des finances. Cela implique de prendre pour base de la discussion en séance publique le texte du Gouvernement afin que chaque député puisse déposer des amendements et les voter.
Avis défavorable.

Je vois midi à la porte du Parlement. Vous prenez pour argument le caractère global du projet de loi de finances mais la commission des finances est compétente pour saisir l'ensemble des politiques publiques et d'autres commissions sont saisies pour avis. Je considère qu'il faut aller plus loin que la réforme de 2008.

En tant que membre de la commission Balladur, je peux vous dire que nous avons beaucoup réfléchi à cette modification. La commission des lois d'alors était très favorable à ce que le texte élaboré par la commission serve de base aux discussions en séance publique. Nous avions toutefois unanimement souligné que la loi de finances avait une nature spécifique car elle engageait l'action exécutive du Gouvernement au jour le jour, ce qui constitue une différence de nature avec une loi générale.

En toute honnêteté, cela me paraît relever d'une fausse bonne idée. Je ne vois pas comment un tableau d'équilibre pourrait être établi à l'issue des travaux en commission. Cet aspect à lui seul justifie qu'on ne remette pas en cause le principe actuel.

Cela se ferait comme en séance. Il suffirait que le Gouvernement participe aux travaux de la commission et tire les conséquences des votes intervenus sur l'article d'équilibre.

On ne peut pas savoir ce que l'on aurait fait. Il peut y avoir un équilibre entre tropisme gouvernemental et tropisme parlementaire.

Je prendrai l'exemple des débats sur le projet de loi de finances pour 2018. L'examen de la première partie en commission s'est achevé 12 octobre alors que la date limite de dépôt des amendements en séance était le 13 octobre à 17 heures. Si l'examen en séance publique devait se faire sur la base du texte adopté en commission, quand en disposerait-on ? En termes de calendrier, il me paraît matériellement impossible d'avoir suffisamment de temps pour déposer des amendements.
La commission rejette l'amendement.
Article additionnel après l'article 3
Elle est ensuite saisie des amendements identiques CF72 du rapporteur pour avis et CF75 du rapporteur général.

Le présent amendement vise à introduire un délai incompressible de quatre semaines entre le dépôt du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année et leur examen en séance publique. Cela incitera le Gouvernement à laisser davantage de temps de préparation aux parlementaires qui examineront ensuite ces textes dans un délai de cinquante jours. Nous allons vous distribuer des calendriers qui vous permettront de voir concrètement ce que cela donne.

Plus cette proposition recueillera de suffrages, mieux nous serons placés pour inscrire dans la Constitution ce délai incompressible.

La création d'une agence parlementaire d'évaluation et d'un office de chiffrage n'aura en effet de sens que si nous avons le temps de les mobiliser en vue d'un débat budgétaire responsable.
La commission adopte ces amendements.
Article additionnel près l'article 4
La commission en vient à l'amendement CF71 du rapporteur pour avis.

Le présent amendement vise à ouvrir un nouveau droit au Parlement grâce auquel le président de chaque assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen, un amendement issu du Parlement ou du Gouvernement. Cela pourrait se faire pour quelques amendements importants. Rappelons qu'il arrive aujourd'hui que le Conseil d'État n'examine qu'un cinquième des dispositions d'un projet de loi.
La commission adopte l'amendement.
Article 6 (article 47 de la Constitution) : Réduction des délais d'examen des projets de loi de finances – Audition des ministres sur l'exécution des lois de finances
La commission est saisie de l'amendement CF1 de M. Marc Le Fur.

Les articles 6 et 7 du présent projet réduisent à cinquante jours la durée d'examen des textes financiers, qu'il s'agisse du PLF ou du PLFSS. Ces dispositions constituent clairement un recul de la place du Parlement, dont la légitimité historique depuis la Révolution française réside dans le consentement à l'impôt et le vote du budget de l'État. Restreindre le champ du débat fiscal et budgétaire revient à conforter la place déjà prépondérante de l'exécutif et plus particulièrement du ministère des finances dans la détermination de la règle fiscale et la répartition des dépenses de l'État. Le présent amendement vise à supprimer l'article 6.

Je suis tout à fait favorable au rééquilibrage entre l'automne budgétaire et le printemps de l'évaluation permis par l'article 6. Avis défavorable.
La commission rejette l'amendement.
Sur l'avis défavorable du rapporteur pour avis, elle rejette ensuite l'amendement CF16 de Mme Valérie Rabault.
Elle en vient aux amendements identiques CF73 du rapporteur pour avis et CF76 du rapporteur général.

Cet amendement vise à préciser que le délai de cinquante jours court à compter du début de la discussion en séance et non du dépôt du texte.
La commission adopte ces amendements.
Elle est saisie de l'amendement CF27 de M. Daniel Labaronne.

Afin de permettre aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat de se prononcer sur le projet de loi de finances dans les délais réduits prévus à l'article 6 du projet de loi constitutionnelle, il convient que les commissions compétentes soient informées de tous les éléments qui concernent ce projet de loi.

Pourquoi limiter cette possibilité aux projets de loi de finances ? Il me semble qu'elle devrait être étendue à l'ensemble des textes. Je vous propose donc de retirer cet amendement pour déposer en commission des lois ou en séance un amendement plus large afin d'avoir une discussion avec le Gouvernement.
L'amendement est retiré.
La commission examine l'amendement CF28 de M. Daniel Labaronne.

Comme certains de mes collègues ont proposé de modifier l'article 24 de la Constitution pour créer une agence d'évaluation parlementaire, je retire cet amendement qui visait à faire profiter le Parlement de l'expertise de France Stratégie dans l'étude du projet de loi de finances.
L'amendement est retiré.
La commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article 6, modifié.
Article 7 (article 47-1 de la Constitution) : Délais d'examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale – Examen conjoint des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale
La commission est saisie de l'amendement CF2 de M. Marc Le Fur.

L'examen conjoint de tout ou partie du PLFSS et du PLF, qui viendra s'ajouter au raccourcissement du délai, atténuera fortement la clarté des débats et la portée du contrôle parlementaire.
Restreindre le champ du débat fiscal et budgétaire revient à conforter la place déjà prépondérante de l'exécutif et plus particulièrement du ministère des finances dans la détermination de la règle fiscale et la répartition des dépenses de l'État.
C'est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer l'article 7.

Avis défavorable pour les mêmes raisons que pour l'amendement de suppression de l'article 6.
La commission rejette l'amendement.
Elle examine les amendements identiques CF74 du rapporteur pour avis et CF77 du rapporteur général.

Par cohérence avec les amendements que j'ai précédemment défendus, je propose de fixer le point de départ du délai de cinquante jours à compter du début de la discussion en séance publique du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et non à compter du dépôt du texte.
La commission adopte ces amendements
Elle est saisie des amendements identiques CF17 de Mme Valérie Rabault et CF31 de M. Éric Coquerel.

Je considère que cet amendement est tombé puisqu'il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement CF13 qui n'a pas été adopté.
L'amendement CF17 est retiré.

Par cet amendement, nous proposons d'empêcher la possibilité d'un examen conjoint du projet de loi de financement de la sécurité sociale et du projet de loi de finances. Une telle procédure reviendrait à nier l'un des apports essentiels de la Libération, à savoir la distinction entre financement du budget de l'État par l'impôt et financement de la sécurité sociale par la socialisation des salaires. Elle ferait peser le risque d'une fiscalisation des cotisations sociales, que nous redoutons fortement. En outre, elle constituerait un moyen pour le Gouvernement de mener des politiques d'austérité sur le budget de la santé.

J'estime à l'inverse que les alinéas que vous proposez de supprimer, monsieur Coquerel, empêchent tout risque de fusion entre PLF et PLFSS. Avis défavorable.
La commission rejette l'amendement CF31.
Elle donne un avis favorable à l'adoption de l'article 7, modifié.
Après l'article 15
La commission est saisie des amendements identiques CF21 de Mme Valérie Rabault, CF39 de M. Charles de Courson et CF64 de M. François Jolivet.

Cet amendement vise à redéfinir ce que sont les ressources propres des collectivités locales. Il ne faut pas seulement prendre en compte la taxation.

L'objectif de l'amendement CF39 est de définir précisément les ressources propres des collectivités territoriales, ce qui n'a aucune incidence sur la future réforme. Il s'agit d'adapter la définition à la réalité des territoires.
Ce débat sur les ressources propres revient régulièrement depuis 2003 et 2004 et il aura lieu à chaque loi de finances si nous ne clarifions pas les choses. Notre proposition aboutirait à la rédaction suivante : « La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette, le taux ou les tarifs dans les limites qu'elle détermine ». La refonte fiscale portera à la fois sur l'assiette et sur le taux et nous intégrons les tarifs dont la place dans les ressources propres va croissant. C'est un enjeu qui a été évoqué récemment au sein de l'Association des maires d'Ile-de-France.
Ce changement n'a rien de complexe à mettre en oeuvre.

L'objectif que vous poursuivez est louable mais ces amendements posent deux difficultés, l'une de forme, l'autre de fond.
Tout d'abord, ils n'interviennent pas à un bon moment. Il ne me semble pas opportun de modifier la Constitution tant que nous ne disposons pas d'une bonne visibilité sur la fiscalité locale, en particulier celle du bloc communal, qui va faire l'objet d'une réforme.
Ensuite, ils risquent de créer des inégalités. Selon moi, il n'y a pas meilleur système de péréquation qu'un système national. Si votre système s'appliquait dans ma circonscription, les communes les plus pauvres appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) les plus pauvres seraient pénalisées car elles ne pourraient plus bénéficier des effets de la péréquation issue du budget de l'État.

Je ne partage pas cet avis.
Définir les ressources propres revient à préciser la nature de l'argent à disposition des collectivités locales alors que la réforme de la fiscalité locale porte sur la fonction de ces ressources propres dans l'équilibre des finances des collectivités locales. Il faut faire attention à ne pas confondre nature et fonction.
Vous évoquez un risque d'inégalités. J'estime que tant que la question de la répartition de la DGF ne sera pas résolue, nous ne pourrons pas avancer. Je ne vous jette pas la pierre puisque nous ne nous en sommes pas saisis sous le précédent quinquennat. On comprend que la commune de Levallois-Perret n'ait pas besoin d'augmenter les impôts quand on sait qu'elle reçoit de l'État 600 euros par habitant et par an, somme à mettre en regard des 150 euros que reçoit Montauban, dans ma circonscription.

Ce débat sur les ressources propres nous fait approcher le coeur des relations entre les collectivités locales et l'État. Je soutiens ces amendements de clarification. Je considère que ce n'est pas au Conseil constitutionnel d'apporter tous les ans des précisions à l'occasion de l'habituel recours portant sur l'atteinte au principe constitutionnel de l'autonomie des collectivités locales.

Tout le monde a lu les conclusions du rapport d'Alain Richard et de Dominique Bur qui prend en compte ces problématiques. La mission préconise une certaine stabilité du partage des impôts entre État et collectivités locales, sur cinq ans. Je ne suis pas du tout convaincu qu'il faille modifier les modalités de définition des ressources propres aujourd'hui.

Je suis favorable à l'élargissement du périmètre des compétences des collectivités locales et je voterai donc ces amendements.
Le projet de loi définit de manière restrictive les rapports entre l'État central et les collectivités. Il prévoit que les collectivités territoriales peuvent déroger pour un objet limité aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. Pourquoi une telle limitation ? Ou une dérogation est utile ou elle ne l'est pas.
Ces conditions très strictes se retrouvent à l'article 16, qui porte sur le futur statut de la Corse : limitations de compétences, habilitation préalable, autorisation ex post, toutes dispositions éloignées de la vision exprimée par le vote majoritaire de la collectivité de Corse.
La commission rejette ces amendements.
Elle en vient aux amendements identiques CF22 de Mme Valérie Rabault, CF40 de M. Charles de Courson et CF65 de M. François Jolivet.

Cet amendement reprend la proposition n° 2 de la mission « flash » sur l'autonomie financière des collectivités territoriales, rapportée par Christophe Jerretie et Charles de Courson et approuvée par la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation lors de sa réunion du 9 mai 2018.
Il a pour objet de compléter l'exigence d'autonomie financière des collectivités par un droit à une certaine autonomie fiscale, mais qui serait limité au bloc communal.

J'ai tenté de prouver par a+b à Bercy que l'autonomie du bloc communal était possible.
D'abord, cette proposition est cohérente avec la réforme de la taxe d'habitation
En outre, elle est intelligible et réaliste. Nos collectivités ont besoin de voir leur autonomie fiscale consolidée pour mieux fonctionner. Il sera utile de pouvoir s'appuyer sur le bloc communal pour renforcer la cohésion du territoire dans les années à venir, d'autant que l'Europe est en grande difficulté.
Beaucoup se plaisent à établir des comparaisons avec l'Allemagne. Or il existe de fortes différences entre nos deux pays : le pouvoir parlementaire est beaucoup plus fort outre-Rhin ; l'organisation territoriale est fédérale ; l'article 105 de la loi fondamentale donne aux Länder le pouvoir de légiférer en matière d'impôts. Nous ne pouvons donc pas appliquer le modèle allemand à la France.
Quant à la péréquation, elle doit être assurée par la DGF, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui car la réforme n'a pas abouti pour diverses raisons – je ne mets en cause personne car nous savons que c'est une tâche difficile.
Enfin, je rappellerai que le Président de la République lui-même a évoqué la possibilité de rendre l'autonomie fiscale aux maires.

Je ne dis pas que votre proposition n'est pas réaliste ; je souligne simplement qu'elle impliquerait un changement de modèle : nous passerions d'un modèle se situant à mi-chemin entre le modèle fédéral et le modèle unitaire pour aller vers un modèle fédéral. Je ne pense pas qu'il faille donner une autonomie fiscale au bloc communal. Cela ne manquerait pas de créer des inégalités territoriales.
Prenons le cas, dans ma circonscription du Val-de-Marne, des deux communes les plus pauvres, Villeneuve-Saint-Georges et Valenton. Elles ne disposent d'aucun levier fiscal : très peu d'habitants sont en mesure d'acquitter la taxe d'habitation, sans compter les impôts locaux de demain. Sans DGF, comment feraient-elles ?

Les EPCI auxquels elles appartiennent ne disposent pas davantage de ressources propres.
Si l'autonomie fiscale des collectivités territoriales est remise en cause, qu'en sera-t-il demain des régions qui bénéficient de la TVA, ressource dynamique dont elles sont extrêmement satisfaites ?

La majorité devrait rediscuter avec le Gouvernement à ce sujet. Un grand flou règne à propos de l'autonomie fiscale des collectivités locales.
Dans l'esprit des auteurs de ces amendements, il est évident que les communes qui disposent de faibles marges fiscales continueront à recevoir des dotations de compensation de la part de l'État car cela n'a rien d'incompatible avec l'autonomie du bloc communal.
Il ne s'agit pas non plus de basculer dans le fédéralisme : la commune conserve une compétence d'ordre général.
Ces amendements sont des amendements de repli par rapport aux amendements précédents : ils portent sur le bloc communal car c'est le niveau qui détient le plus de compétences.

Les rapports entre l'État central et les territoires nourrissent un éternel débat dans la politique française
Deux conceptions s'opposent. La première consiste à considérer la France comme un bloc monolithique. La seconde la voit comme étant constituée de terroirs enracinés, aux spécificités géographiques et culturelles.
Certains font mine de confondre deux concepts : l'égalité des citoyens face à leurs droits, principe de base de la démocratie, et la reconnaissance de la diversité des territoires.
Nous avons évoqué Montesquieu qui affirmait qu'il ne fallait toucher aux lois que d'une main tremblante. Citons-le encore : « Une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. » Voici un raisonnement à garder à l'esprit dans le présent débat.

Je considère aussi que c'est un débat important, et je ne suis pas hostile à une discussion avec le Gouvernement pour voir ce qu'il faudrait faire. Cela étant, les collectivités territoriales conservent le droit de lever l'impôt et de modifier les taux applicables, elles gardent leur capacité fiscale.
Ce dont on parle en l'occurrence, c'est de la possibilité d'inscrire dans la Constitution un plancher en dessous duquel on ne pourrait pas descendre. C'est cela, l'autonomie fiscale. Alors que nous allons modifier considérablement la fiscalité locale au cours des prochains mois, il me paraît tout à fait périlleux, incohérent et prématuré de prendre aujourd'hui un pari, même s'il y a là une question de fond.
Par ailleurs, en effet, plus le plancher est élevé, plus la marge laissée pour la péréquation est faible.

J'entends l'argument du rapporteur. Le problème est cette hypocrisie qui règne depuis bien longtemps, à propos de la part des ressources décidée par l'État et la part des ressources fiscales des collectivités. Je ne prétends pas mettre un terme à cette situation par le seul effet de l'amendement CF22, mais à chaque débat nous avons tendance à aggraver la situation ! Prenons l'exemple concret de la taxe d'habitation. La municipalité de Toulouse a augmenté ses taux de 30 %. Le remboursement dont elle bénéficiera en raison du dégrèvement sera donc très élevé. Au contraire, une ville qui n'a pas relevé ses taux pendant dix ans bénéficiera de faibles remboursements. Au fond, les maires qui ont fait attention à ne pas trop augmenter les taux recevront moins d'argent de l'État que ceux qui les ont beaucoup augmentés. Je n'accuse pas le Gouvernement ; je dis simplement que ce système perdure depuis très longtemps.

Par ailleurs, il serait dommage de ne pas saisir l'occasion d'une révision constitutionnelle pour clarifier les choses. La question est au coeur du problème de l'équilibre de nos pouvoirs.

Il faut définir un socle. Si nous ne le faisons pas dans la Constitution, nous allons continuer nos discussions. Voyez ce qu'il en est de l'autonomie fiscale et de la péréquation : avec un taux de taxe d'habitation de 5,45 %, ma commune, soyons clairs, ne bénéficiera d'aucun remboursement, alors que celles qui ont augmenté leur taux... En fait, la péréquation se fait à l'envers.
Si nous définissons clairement l'autonomie fiscale, nous pourrons travailler sur la péréquation. On m'annonce certes une loi de finances des collectivités territoriales, mais, pour avoir lu tous les rapports, notamment celui du Conseil économique, social et environnemental, j'appelle votre attention, chers collègues : que voulons-nous pour la suite ? Aujourd'hui, nous pouvons figer certaines choses, mais nous pouvons aussi permettre certaines ouvertures. Et si nous ne consacrons pas l'autonomie fiscale, ce sera un autre fonctionnement des collectivités.
La commission rejette les amendements.
Puis elle se saisit de l'amendement CF23 de Mme Valérie Rabault.

J'y suis défavorable, en raison des réserves que les rapporteurs de la mission « flash » énoncent eux-mêmes.

En fait, c'était plutôt une proposition d'appel. Nous avons expliqué que des modulations étaient possibles pour certaines dépenses et ressources, mais la question mérite débat.
L'amendement est retiré.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur pour avis, la commission rejette les amendements identiques CF41 de M. Charles de Courson et CF66 de M. François Jolivet.
Informations relatives à la commission
La commission a reçu en application de l'article 12 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) un projet de décret de virement de crédits 862 078 euros en autorisation d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) du programme 218 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines à destination du programme 302 Facilitation et sécurisation des échanges de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines.
Ce mouvement de crédits a vocation à contribuer au financement du coût facturé de services informatiques liés à la location de baies par la direction générale des douanes et des droits indirects sur les sites du centre informatique douanier d'Osny et de Toulouse dans le cadre de la mutualisation des prestations informatiques.
Membres présents ou excusés
Réunion du mercredi 20 juin 2018 à 8 heures 30
Présents. – M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Jean-Noël Barrot, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Jean-Louis Bricout, Mme Émilie Cariou, M. Gilles Carrez, M. Michel Castellani, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chassaing, M. Dino Cinieri, M. Éric Coquerel, M. François Cornut-Gentille, M. Charles de Courson, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, M. Jean-Paul Dufrègne, Mme Stella Dupont, Mme Sarah El Haïry, Mme Sophie Errante, M. Nicolas Forissier, M. Olivier Gaillard, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, M. Romain Grau, Mme Olivia Gregoire, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, M. Patrick Hetzel, M. Alexandre Holroyd, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, M. Daniel Labaronne, Mme Valérie Lacroute, M. Mohamed Laqhila, M. Michel Lauzzana, M. Vincent Ledoux, M. Gilles Le Gendre, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie-Ange Magne, Mme Lise Magnier, M. Patrick Mignola, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Jean-François Parigi, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Sylvia Pinel, Mme Christine Pires Beaune, Mme Valérie Rabault, M. Xavier Roseren, M. Fabien Roussel, M. Laurent Saint-Martin, M. Jacques Savatier, M. Olivier Serva, M. Benoit Simian, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Jean-Pierre Vigier, M. Philippe Vigier, M. Éric Woerth
Excusés. – M. Jean Lassalle, M. Marc Le Fur, M. Jean-Paul Mattei, M. Hervé Pellois, M. François Pupponi
Assistaient également à la réunion. – M. Guillaume Larrivé, M. Jean-Louis Masson
———–——