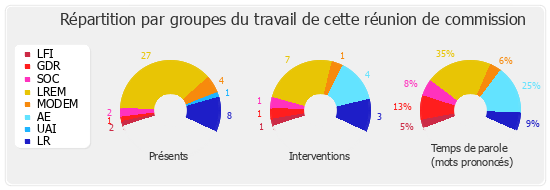Commission de la défense nationale et des forces armées
Réunion du mercredi 22 janvier 2020 à 9h30
La réunion
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Nous continuons notre cycle géostratégique et notre tour du monde, en nous intéressant aujourd'hui à la zone sur laquelle se concentrent traditionnellement les tensions internationales, et qui aujourd'hui encore est au cœur de l'actualité, c'est-à-dire le Proche-Orient. La chute de Baghouz en mars 2019 avait suscité beaucoup d'espoir en marquant la fin du califat territorial de Daech, mais cette défaite territoriale n'a pas été synonyme d'éradication des réseaux terroristes. La ministre Florence Parly l'a déclaré devant nous la semaine dernière : « si Daech est sans territoire, Daech n'est pas sans existence ». La situation est devenue encore plus complexe ces dernières semaines avec divers évènements qui sont venus contrarier la mobilisation contre le terrorisme. Ce fut d'abord l'attaque lancée par les Turcs contre la frontière turco-syrienne qui a déstabilisé le Nord-Est, contrôlé par les forces démocratiques syriennes, dont chacun reconnaît la part importante qu'ils ont prise dans la lutte contre Daech. Ce fut ensuite l'accroissement des tensions entre l'Iran et les États-Unis, qui a conduit à une escalade militaire sur le sol irakien, avec notamment des attaques dirigées contre l'ambassade des États-Unis à Bagdad, auxquelles a répondu l'élimination du général Qassem Soleimani par les États-Unis, qui elle-même a été suivie par des frappes iraniennes contre les bases américaines. Aujourd'hui, nous assistons à ce que le ministre Jean-Yves Le Drian a appelé une interruption de l'escalade, mais la destruction par erreur de l'avion d' Ukraine International Airlines illustre la volatilité extrême de la situation actuelle. Les inquiétudes sont encore renforcées par la résolution adoptée par le Parlement irakien, appelant au retrait des forces étrangères du territoire national, qui fait peser des incertitudes sur les moyens pouvant être conservés par la coalition dans la lutte contre le terrorisme. S'ajoutent à ces incertitudes le désengagement progressif de l'Iran de l'accord de Vienne, suite à la décision des États-Unis de se retirer de cet accord, et surtout, l'instauration de sanctions contre ceux continuant à commercer avec l'Iran.
Cette politique de sanction a plongé l'Iran dans une récession économique. Vous nous direz s'il est encore possible de sauver cet accord de Vienne et si la perspective d'une acquisition rapide par l'Iran de l'arme nucléaire doit être prise au sérieux. Face à la multiplication de ces menaces et de ces dangers, la France continue pour sa part de faire entendre sa voix, en adoptant une posture d'équilibre et en soutenant des initiatives pour apaiser les tensions. C'est notamment l'objet de la mission de surveillance maritime européenne dans le détroit d'Ormuz, à laquelle huit pays européens ont apporté leur soutien. J'étais d'ailleurs moi-même à la fin de l'année sur la première frégate française à y participer : la frégate Courbet. Pour nous aider à décrypter cette situation, nous avons le plaisir de recevoir trois experts, M. Pierre Razoux, directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire, qui nous dressera un tableau général de la conflictualité dans la région, avec un focus particulier sur l'Iran. Je précise également que M. Razoux est l'auteur d'un jeu de stratégie, « Fitna », qui a rencontré un grand succès à la Fabrique Défense, et qui permet de se familiariser avec les enjeux de la région. Notre deuxième invité est M. Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au CNRS, qui traitera plus particulièrement de l'Irak et du Liban. Notre troisième intervenant est M. Fabrice Balanche, maître de conférences à l'Université Lyon II, qui est revenu directement hier d'une mission au Moyen-Orient, et qui nous parlera plus spécifiquement de la Syrie.
La situation au Moyen-Orient est caractérisée par une rivalité de puissances. Je vais faire appel à vos connaissances en géophysique en évoquant l'image de deux plaques tectoniques. La première plaque tectonique, au nord, recouvrirait l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban et indirectement la Turquie, indubitablement contrôlée par la Russie et par l'Iran. Toute la question, pour les acteurs locaux, est de savoir si c'est l'Iran ou la Russie qui est le « senior partner » ou le « junior partner ». Je reviendrai sur la question irakienne plus tard. Il y a une deuxième plaque tectonique au sud qui est contrôlée par les États-Unis, s'appuyant sur Israël, la Jordanie et les monarchies de la péninsule arabique. Là, il n'y a pas de doute, ce sont les États-Unis qui contrôlent les autres. Les deux grandes puissances sont positionnées au nord et au sud du Moyen-Orient, avec une volonté de manifester leur puissance, leur influence, leur présence et bien entendu leur utilité, ce qui implique toute une série de contrats militaires et de postures de contrôle. Ensuite, la Chine est en embuscade, avec des valises pleines de yuans et de dollars, et attend le bon moment pour s'infiltrer dans la région afin d'investir massivement là où elle pourrait faire la différence dès qu'une case deviendrait libre.
Les trois grandes puissances stratégiques se retrouvent donc dans le jeu. La Russie et les États-Unis, paradoxalement, ont intérêt à s'entendre pour maintenir un certain niveau de tension dans la région, parce que ce niveau de tension minimum justifie leur présence, les contrats d'armement induits, et tout simplement leur influence géopolitique et stratégique au Conseil de sécurité des Nations unies et sur la scène internationale. Si les pays de la région se sentent menacés, ils ont en effet tendance à faire appel à un protecteur et les États-Unis et la Russie jouent ce rôle. Pour ces derniers, il est donc crucial de maintenir suffisamment de tensions pour justifier leur présence, mais pas trop, pour qu'il n'y ait pas d'escalade, pour qu'il n'y ait pas d'affrontement régional global, parce que Moscou et Washington savent très bien qu'ils en sortiraient tous les deux perdants. Bien entendu, le vainqueur, celui qui tirerait les marrons du feu de cette situation, serait Pékin.
À l'inverse, les Chinois ont intérêt à apaiser au maximum les tensions pour pouvoir plus rapidement s'installer, investir, prendre des positions, contrôler des parts importantes de marché, pour pouvoir poursuivre leurs fameuses « routes de la soie » terrestres et maritimes. Le paradoxe, c'est que dans cette grande équation, sur la question du Moyen-Orient, l'intérêt de l'Europe est plutôt proche de celui des Chinois. Nous souhaitons apaiser la situation pour des raisons différentes, mais nos partenaires naturels seraient plutôt, de mon point de vue, les Chinois.
Si l'Europe fait le jeu des Chinois au Moyen-Orient, elle donne évidemment un gros avantage tendanciel à la Chine dans le cadre de la compétition mondiale. Tous les dossiers sont liés. Par ailleurs, trois puissances régionales sont vraiment très influentes en ce moment dans la région : l'Iran, Israël et l'Arabie saoudite. Dans ce jeu triangulaire, aucun de ces trois acteurs n'a a priori intérêt à l'escalade et devrait rechercher la stabilité. Mais pour des raisons de politique intérieure, voire si leur régime était menacé, chacun pourrait être tenté d'attiser les tensions pour sauver son régime politique. C'est visible en Arabie saoudite et en Iran. Cela peut être le cas aussi en Israël, avec un Premier ministre aux abois, notamment sur le plan judiciaire, et qui attend avec une certaine anxiété les prochaines élections du 2 mars.
Dans ce contexte, la stratégie iranienne a plusieurs volets. Le premier consiste à s'aménager un corridor terrestre entre l'Iran et la Méditerranée pour pouvoir maintenir un glacis protecteur. L'Iran se comporte en effet toujours comme une citadelle assiégée. Je ne prends pas parti du tout mais je vous le présente en tant qu'expert historien : l'Iran se considère comme le petit village gaulois assiégé, entouré de camps romains qui n'attendent qu'une occasion pour réduire le territoire iranien. Les Iraniens se disent qu'il faut être dissuasif. Ce corridor terrestre vers la Méditerranée leur permettrait de mieux contrôler l'Irak, d'aider et de contrôler la Syrie, ou en tout cas, de jouer un rôle clé en Syrie, et de ravitailler la population chiite du Liban, notamment le Hezbollah, pour être en mesure de faire pression et de susciter une sorte de dissuasion asymétrique face à Israël.
Cela m'amène à la grande stratégie dissuasive de l'Iran. Telle que je la comprends, elle a deux volets. À l'occasion des échanges à propos de l'accord nucléaire, le Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA), et de leur influence régionale, les Iraniens tentent d'expliquer à la communauté internationale, ceux qui sont en mesure de peser – la Chine, les États-Unis, la Russie, les Européens –, que l'Iran a besoin d'être dissuasif. Il a deux manières de l'être : soit via la bombe atomique, soit via l'influence régionale, les missiles balistiques et une sorte de cordon défensif autour de l'Iran, comme depuis quelques siècles. Les dirigeants iraniens se ménagent pour le moment ces deux voies, gardant les deux fers au feu, et interrogent la communauté internationale : « vous avez voulu nous empêcher d'avoir la bombe atomique. A priori, on a dit oui, dans le cadre du JCPoA, mais maintenant, vous voulez nous empêcher d'avoir une influence régionale et donc d'avoir notre glacis défensif. Ça ne va plus. Il faut choisir. » Pour questionner la communauté internationale, l'Iran joue de ces deux fers et de ces deux stratégies : « regardez, on avance doucement mais sûrement sur la piste nucléaire, et en même temps, on se bat pour conserver notre influence régionale. Si vous voulez qu'on en lâche une, il faut nous garantir l'autre et vice versa. »
La grande stratégie iranienne vise aussi à diminuer l'empreinte militaire américaine au Moyen-Orient, certainement dans cette plaque tectonique nord que j'ai mentionnée tout à l'heure, et notamment en Irak, puisque cette empreinte est déjà réduite en Syrie. C'est pourquoi les Iraniens souhaitent obtenir des Irakiens le retrait des forces militaires américaines. Le pouvoir iranien n'est pas naïf, il se doute bien que M. Trump et la Maison-Blanche ne se retireront pas naturellement d'Irak, mais la résolution, votée il y a quelques jours, qui demande le retrait des troupes américaines, même si elle n'est pas suivie d'effets, est importante sur le plan politique et symbolique, parce qu'elle veut dire que si les Américains restent désormais en Irak, ils ne sont plus invités par les représentants du peuple irakien, et redeviennent une force d'occupation comme ils l'étaient auparavant. S'ils redeviennent une force d'occupation, ils redeviennent une « cible légitime » pour les actions « de la résistance ». Les Iraniens se positionnent ainsi pour prendre la tête de ce qu'ils appellent « le front de la résistance », non plus face à Israël, mais désormais face aux États-Unis. L'autre volet de la stratégie iranienne consiste à délégitimer auprès de ses voisins la présence américaine, et à faire comprendre à ses voisins du Sud et de la péninsule arabique, qu'ils ne peuvent plus vraiment compter sur la garantie américaine, au vu de ce qui s'est passé ces six derniers mois. Je constate que les Iraniens ont plutôt réussi : alors que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis refusaient depuis longtemps de parler aux Iraniens, les Émiriens et les Saoudiens sont allés à Téhéran à la fin de l'été dernier et ont repris un dialogue bilatéral avec l'Iran.
J'en viens maintenant à la crise récente avec les États-Unis et l'élimination de Qassem Soleimani. Je ne prends pas parti, mais en tant qu'analyste, je constate que paradoxalement, il a servi deux fois le régime iranien : une première fois lorsqu'il était vivant, pour projeter la puissance et l'influence iraniennes dans la région, et la deuxième fois lorsqu'il est mort, en permettant au pouvoir iranien de faire une démonstration médiatique d'unité nationale en Iran, lors de ses funérailles, pour dire aux Occidentaux, et surtout aux Américains, qu'ils n'ont pas peur, qu'ils ont deux millions de personnes dans les rues et plusieurs dizaines de personnes qui se sont fait piétiner sans que cela n'émeuve le reste de la société, et que s'ils sont prêts à cela, ils seront prêts à résister manu militari à toute intervention directe américaine sur leur territoire. Aussi et surtout, cela a permis de ressouder une partie de la population irakienne et le pouvoir irakien autour de l'agenda non plus pro-iranien, mais anti-américain, souverainiste et nationaliste, et on assiste à une évolution ultranationaliste dans tous les pays de la région, y compris en Irak et au Liban. Au Liban, de nombreuses manifestations ont eu lieu depuis la fin de l'automne. Le message adressé à tous, y compris à la classe politique libanaise était le suivant : « attention, si vous mettez dans ce moment critique le Liban dehors et renvoyez le Hezbollah dans ses foyers, Téhéran le prendra très mal ». Je pense que le message a été très bien reçu, puisqu'on a appris hier ou avant-hier l'officialisation d'un gouvernement qui semble être stable, sous tutelle de M. Diab, gouvernement qui a été avalisé par le Hezbollah et par l'ensemble de la classe politique iranienne. Pour conclure sur cette question de l'élimination de Qassem Soleimani, je trouve que la riposte iranienne sur deux bases irakiennes occupées par les Américains a été particulièrement mesurée ; les frappes étaient soigneusement calibrées pour ne pas faire de victimes ou très peu. Elles étaient juste en surface pour montrer que l'Iran était capable de répondre à la gifle ouverte qui lui avait été assénée par Trump, de manière proportionnée. Trump dit : « d'accord, un partout, balle au centre. On a compris, arrêtons là. » Connaissant bien les Iraniens, je pense que cela ne s'arrêtera pas là. C'est maintenant qu'ils vont réellement riposter, et ils ont jusqu'au 4 novembre – date de l'élection américaine – pour le faire. Ils vont sûrement le faire en plusieurs fois, de manière discrète, non assumée, pour essayer de cibler et de saborder la campagne électorale américaine. Cela pourra être aussi bien un ou plusieurs assassinats, des attentats ou des attaques sur des objectifs américains et partout à travers le monde.
Pour terminer, je pense que l'Irak, vu de Téhéran, a toujours été perçu comme une menace. Or, pour les Iraniens, l'Irak ne doit plus être une menace. Il faut « neutraliser » l'Irak d'une manière ou d'une autre, un peu comme la France gaullienne vis-à-vis de l'Allemagne. L'exécutif français, notamment sous De Gaulle, s'est dit que l'Allemagne ne devait plus jamais être une menace. C'est un peu la même chose pour l'Iran : l'Irak ne doit plus jamais être une menace.
Après cette présentation géopolitique de M. Razoux, je vais évoquer davantage le temps long. Nous commémorons en effet un anniversaire important. À mon avis, l'origine des crises actuelles remonte exactement à un siècle avant 2020 : 1920, avec la création d'institutions étatiques par les puissances mandataires françaises et britanniques – françaises pour le Liban et britanniques pour l'Irak. Avec du recul, nous voyons que ces institutions n'ont jamais réussi à acquérir suffisamment de légitimité, à former une citoyenneté commune et à ouvrir un espace public, ce qui a favorisé d'une part les ingérences étrangères, au Liban comme en Irak, et les guerres civiles, au Liban et en Irak. Les guerres civiles et les guerres extérieures étaient la prolongation au-delà des frontières irakiennes d'un conflit intérieur au pays. En effet, je vous rappelle quand même les conditions dans lesquelles ont été créés l'État libanais et l'État irakien. Ils ont été créés contre la volonté clairement exprimée à travers des référendums, notamment en Irak, de la majorité de la population musulmane au Liban, chiite en Irak. La majorité de la population au Liban était partisane d'un grand royaume arabe unifié, du projet Chérifien unissant le Liban, la Syrie, la Transjordanie et la Palestine. En Irak, les chiites s'étaient prononcés très clairement à travers un mouvement de djihad pendant la guerre de 1914-1918. Ensuite, la révolution de 1920 dont nous allons commémorer le centième anniversaire, exprimait clairement le refus d'un État-nation arabe, sous mandat britannique. Les chiites s'étaient prononcés pour un gouvernement arabe et islamique sans lien de dépendance avec une puissance étrangère. Il faut rappeler que l'idée de nation était une importation européenne de sorte qu'en Irak, le concept de nation était totalement inconnu. La meilleure preuve en est que la majorité de la population chiite est arabe et se sent profondément arabe, mais que ses dirigeants politiques et religieux, les grands ayatollahs des villes saintes, étaient iraniens de nationalité ou d'origine, autrement dit, il y avait un sentiment d'arabité, mais pas de nationalisme arabe. Ces États ont donc été fondés contre des majorités et ont institué des régimes, au Liban comme en Irak, confessionnels. C'est probablement le poison qui unit aujourd'hui le Liban et la Syrie, à savoir le confessionnalisme politique dans lequel il est très facile de rentrer, mais duquel il est pratiquement impossible de sortir pacifiquement.
Les mouvements de contestation qui unissent le Liban et l'Irak ont pleinement conscience du lien existant entre le confessionnalisme politique – inavoué en Irak et officiel au Liban, à travers le pacte national de 1943 – et la faillite de l'État qui, aussi bien à Beyrouth qu'à Bagdad, est incapable de remplir le minimum de ses devoirs régaliens. Au Liban comme en Irak triomphe aussi le système milicien. Les armées officielles passent au second plan face à des milices chiites en Irak. Mais nous pouvons aussi considérer que l'État islamique a été et continue d'être l'expression d'une certaine frange de la population arabe sunnite. Au Liban, on s'accorde à juste titre pour dire que le Hezbollah est un État dans l'État. Nous avons donc un État milicien et le confessionnalisme politique. À cela s'ajoute la dénonciation unanime, autant à Bagdad qu'à Beyrouth, de la corruption. En effet, dans ces systèmes, vous n'êtes pas promu à des responsabilités politiques en fonction de vos compétences ou de votre parti, de vos options politiques, mais en fonction de quotas. Au Liban, il y a dix-huit communautés reconnues et on vous demande d'être membre de la communauté chiite, sunnite, maronite, grecque orthodoxe ou catholique. Cette classe politique qui a institué le règne des grandes familles est aujourd'hui unanimement rejetée par les mouvements contestataires qui – et c'est là la tragédie que vivent les sociétés libanaise et irakienne – sont conscientes du piège du confessionnalisme politique, mais en même temps – notamment pour les chrétiens du Liban – ont très peur de voir la fin d'un système dont ils pensent qu'il les protégeait contre une majorité agressive, qu'elle soit sunnite, ou dans une moindre mesure chiite. À Bagdad aussi, les mouvements n'aboutissent pas, parce que ce confessionnalisme politique a un effet pervers, c'est qu'il contamine tout le monde. Tout le monde est corrompu. D'ailleurs, le mot « corruption » n'a pas grand sens puisqu'il est intrinsèquement lié à un système. Par exemple, je peux vous dire que lors d'un récent voyage en Irak, je voyais des puits de pétrole dans la région de Nâssirîyah. J'ai demandé qui les exploitait et on m'a répondu que c'étaient des puits de pétrole qui étaient côtés pour des intérêts privés. Quand on est au pouvoir, on distribue les puits de pétrole à tel chef de tribu, à tel clan, et après on ne peut pas s'étonner que l'un des pays les plus riches du Moyen-Orient soit aussi défaillant sur le plan de ses devoirs en matière d'infrastructures. Quand on est à Bagdad et qu'on reste dans la zone verte, on ne s'imagine pas que 500 mètres plus loin à Sadr City, l'eau n'est pas potable et qu'il faut la faire bouillir pour se laver les dents. Il n'y a que quelques heures d'électricité par jour, pas de ramassage d'ordures depuis presque 2003, pour certains quartiers, et pas d'égouts. La majorité de la population vit donc un enfer face à une classe dirigeante qui est incapable de lutter contre la corruption, tout simplement parce qu'elle ne le peut pas. Lutter contre la corruption signifie perdre son pouvoir, puisque ce dernier est basé sur des réseaux, un clientélisme. Corruption, système milicien, faillite de l'État dans ses missions régaliennes : ce sont les difficultés auxquelles se heurtent les mouvements que nous pouvons considérer comme issus de la société civile, mais qui se manifestent d'une façon communautaire. Même si cela peut choquer, je réitère l'idée selon laquelle l'État islamique a été une manifestation extrême et extrémiste d'une certaine société civile arabe sunnite, notamment à Mossoul, qui vivait une situation que vivaient tous les Irakiens, mais aggravée par l'exclusion de leur communauté du système politique. Comme vous le savez probablement, l'État irakien fondé en 1920 ne se réclamait pas du confessionnalisme, à la différence du Liban, mais c'est bien un État confessionnel sunnite qui a été fondé par les Britanniques, excluant les trois quarts de la population, les chiites et les Kurdes. En 2003, les Américains, non pas par choix délibéré, mais parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution, ont pris les exclus de l'ancien système – les chiites et les Kurdes – pour reconstruire un État, à nouveau confessionnel et communautaire, excluant ceux qui avaient toujours bénéficié du monopole du pouvoir à Bagdad, à savoir les Arabes sunnites. Autant au Liban qu'à Bagdad, on ne voit pas de débouchés politiques, tout simplement parce que tous les acteurs politiques ont été impliqués dans un cercle vicieux infernal où chacun a peur de l'autre et où les réflexes communautaires – nous l'avons vu ces derniers temps avec les événements liés à l'assassinat de Qassem Soleimani – ne demandent qu'à se réenclencher. On a peur de l'autre parce qu'il n'y a pas d'État de droit, et l'État n'est pas à même de vous protéger. Ce vide politique a été manifeste à Beyrouth dans le fait que les manifestations unissaient surtout des jeunes de toutes les communautés, mais que des sondages montraient que plus de 90 % des chrétiens, et notamment des maronites, étaient défavorables à la fin du confessionnalisme politique et proposaient une sortie par étapes, ne livrant pas les communautés chrétiennes aux lois de la majorité.
En Irak, je dirais que le vide est encore plus sidéral, puisque c'est un vide à la fois politique et religieux, qui concerne la communauté chiite, qui aurait pu voir dans l'autorité religieuse chiite, notamment celle du grand ayatollah Ali al-Sistani ou de Moqtada al-Sadr, un recours face à l'incurie de l'État. Or, lors de l'invasion américaine en 2003, les chiites étaient très ambigus. La majorité d'entre eux ne voyait pas avec déplaisir la chute du régime de Saddam Hussein, et avait compris après l'insurrection de février-mars 1991 qui avait été réprimée, que sans intervention étrangère, ils ne pourraient jamais se débarrasser d'un régime qu'ils considéraient à juste titre comme assassin. L'ayatollah Ali al-Sistani avait très justement résumé un sentiment général, en disant que dans une fatwa, il ne fallait ni s'opposer aux Américains, ni s'opposer aux forces armées irakiennes, ce qui voulait dire qu'il fallait rester passifs. Nous pouvons dire qu'au fil des années, il a apporté sa bénédiction à la construction d'un système politique qui fait faillite.
Face à lui, il y avait un autre acteur chiite, Moqtada al-Sadr, qui a tenté de s'ériger en tant que parrain des réformes, mais qui à son tour a été phagocyté par un système qui englobe tous les acteurs, au point qu'aujourd'hui, aucun acteur n'est susceptible d'incarner l'espoir politique des Irakiens et du mouvement de contestation. Ni à Beyrouth, ni à Bagdad, vous n'avez de portraits de dirigeants politiques ou de dirigeants religieux. Il y a un vide sidéral et un grand désespoir parce que la société civile, par définition, ne peut pas assumer le pouvoir. Il lui faut une transcription politique. Je terminerai sur cette note pas très optimiste. Il est très facile de rentrer dans un système confessionnel, mais il est très difficile d'en sortir, tant ce système est un piège.
Je vais partir de l'exemple concret de la crise syrienne pour ensuite voir comment cette crise s'intègre dans le nouvel axe iranien qu'a décrit M. Razoux, et plus généralement dans le nouvel arc de crise que nous avons dans la région au Moyen-Orient, et essayer de faire un peu de prospective à l'horizon 2050.
Tout d'abord, la crise syrienne a commencé en 2011 à la suite des printemps arabes. Cependant, une divergence majeure avec la Tunisie et l'Égypte – comme vous pouvez le voir sur cette carte – est que la Syrie est un pays fragmenté sur le plan communautaire. Les deux tiers de la population sont arabes sunnites, mais vous avez des minorités comme les alaouites (10 %), les druzes (3 %), les chrétiens (5 % à l'époque), et les Kurdes dans le Nord. Ce paramètre communautaire a eu une grande importance dans le déroulé de la crise et dans le maintien au pouvoir de Bachar el-Assad, puisque ce dernier s'appuie en priorité sur les alaouites, qui forment la majorité du corps des officiers de l'armée et des moukhabarates, les services de renseignement. Cela explique que l'appareil sécuritaire soit resté intact et que les minorités se soient largement regroupées derrière le régime, non pas par amour pour lui, mais par peur des mouvements radicaux sunnites qui ont rapidement gangréné l'opposition. Cette opposition étant soutenue par le Qatar, l'Arabie saoudite s'est divisée sur l'aide à lui apporter. Outre les querelles d'ego et les clans, les stratégies divergentes des bailleurs de fonds l'ont quasiment achevée. Finalement, les seuls mouvements d'opposition qui ont eu du succès furent l'État islamique et le Front al-Nosra (branche syrienne d'Al-Qaïda), du fait de leur idéologie radicale et d'une organisation très centralisée, contrairement aux autres groupes d'opposition.
Le régime de Bachar el-Assad était plus résilient que nous ne le pensions. En s'appuyant sur ces minorités, que nous voyons en violet sur la carte, il est parvenu à reprendre petit à petit le territoire. Aujourd'hui, lui échappe encore la province d'Idleb dans le Nord-Ouest, mais il est en train de la reprendre tout doucement, et le grand tiers nord-est, dominé par les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire par les milices kurdes des Yépégués, qui sont la branche syrienne du PKK (Le Parti des travailleurs du Kurdistan). Il faut le souligner : c'est un parti extrêmement centralisé, ce qui explique qu'ils tiennent toujours cette région, malgré les coups de boutoir de la Turquie à Afrin en mars 2018, et plus récemment l'offensive turque qui a pris Tell Abyad et Ras al-Aïn. Cependant, il ne faut pas accorder une trop grande force à cette administration autonome dans le Nord-Est syrien. Elle est fragile parce que les Kurdes ne représentent qu'un petit tiers de la population du Nord-Est syrien, et parce qu'entre Kurdes et Arabes, ce n'est pas le grand amour, contrairement à ce que laisse entendre la propagande de l'administration. Les Arabes ne supportent pas la domination des Kurdes et ils n'attendent que de pouvoir se révolter ou rejoindre soit Damas, soit les Turcs. Si les Turcs ont attaqué entre Tell Abyad et Ras al-Aïn, ce n'est pas un hasard : c'est parce que la population est en grande majorité arabe et qu'elle n'a surtout pas défendu l'administration locale, elle ne s'est pas battue avec les Yépégués. Bien au contraire, ils ont aidé les supplétifs arabes de l'armée turque qui étaient largement originaires de cette région et qui l'avaient quittée en 2015, lorsque les Kurdes l'ont occupée. Ils connaissaient le terrain, ils avaient des relations, et ce sont eux qui ont été en première ligne et qui ont repris cette zone. Cette apparence de solidité masque une grande fragilité. Ce statu quo n'est pas viable.
Le régime de Bachar el-Assad a aussi été sauvé par ses soutiens iraniens et russes. Il faut replacer conceptuellement la Syrie dans le corridor iranien dont a parlé M. Razoux, et dans la stratégie russe visant à se réimplanter en dehors de l'ancien espace soviétique puisque grâce à leur intervention, les Russes ont aujourd'hui des bases à Lattaquié et à Tartous. Je ne l'ai pas mis sur cette carte, mais Qamichli, au nord-est de la Syrie, est devenue une base logistique russe importante, avec plusieurs petites bases russes, comme à Amouda et à Tell Tamer, qui sont également dans cette région et qui sont proches des bases américaines de Rmeilan et d'Al-Suwar. Nous ne pensions pas que la Russie allait intervenir. J'ai souvenir de discussions en 2013 avec des diplomates français qui me disaient : « on va maintenir une guerre de basse intensité contre le régime de Bachar el-Assad et il finira par tomber ». C'était quand même oublier que la Syrie n'était pas unie, que nous n'étions plus hégémoniques dans le monde, comme c'était le cas après la chute de l'Union soviétique, et que des acteurs comme la Russie allaient évidemment vouloir combler le vide. La géopolitique a horreur du vide.
Pour les Iraniens, il est important de sauver la Syrie, parce que, tout comme l'Irak, c'est une pièce maîtresse dans la stratégie consistant à maintenir un accès iranien vers la Méditerranée, et qui peut devenir – c'est la volonté des dirigeants iraniens – un des tronçons des routes de la soie chinoise. Une délégation chinoise vient régulièrement inspecter le port de Tripoli au nord du Liban, un port en eau profonde très adapté aux porte-conteneurs, qui pourrait être un débouché chinois en Méditerranée et s'intégrer dans cet axe. Pour cela, il faudrait que cet axe soit sécurisé. Ce n'est pas encore le cas, mais les Iraniens y travaillent, notamment en cherchant à expulser les troupes américaines de Syrie et d'Irak. C'est une année qui leur est favorable ; l'année de l'élection américaine est en effet traditionnellement une année de faiblesse aux États-Unis, puisqu'on se préoccupe davantage de la politique intérieure. Trump n'a aucune envie de lancer une guerre contre les Iraniens aujourd'hui, même s'il ne faut pas perdre de vue qu'il n'est pas question pour les États-Unis de laisser les Iraniens avoir la bombe atomique et qu'ils s'en rapprochent à l'horizon de deux ou trois ans. Une fois l'élection américaine passée, la politique américaine sera sans doute plus agressive à l'égard des Iraniens, mais cette année, nous avons encore un peu de temps pour réfléchir à l'avenir.
Dans cet axe iranien, la Syrie est le maillon faible parce que la population est à deux tiers arabe sunnite – contrairement à l'Irak où la population est en majorité chiite (plus de 50 %) –, outre les Kurdes dans le Nord (environ sept millions d'habitants), qui représentent un peu moins de 20 % de la population. Le roi de Jordanie a appelé ce maillon faible de l'axe iranien, en 2004, « le croissant chiite », et il n'avait pas tellement tort. J'ai rédigé un article pour l'université de Stanford il y a deux ans sur « l'axe iranien ou le croissant chiite », parce que les Iraniens, pour s'implanter dans la région, ont besoin d'une population qui leur est favorable. Les chiites, par peur des sunnites, leur sont favorables, même si des divergences sont visibles en Irak. Mais les manifestations en Irak sont internes au camp chiite. Les sunnites ou les Kurdes ne se joignent pas aux manifestations. Si nous agitons la menace de l'islam radical sunnite, les chiites vont se rassembler naturellement. Les Iraniens cherchent donc à s'appuyer sur les chiites et à réduire la part des sunnites dans la région. Parmi les sept millions de réfugiés syriens, 80 % sont sunnites. Cela s'apparente à de l'épuration ethnique. Dans le nord de l'Irak, aucune volonté de reconstruction de Mossoul ne se manifeste, bien au contraire ! On met des bâtons dans les roues à ceux qui veulent la reconstruire pour éviter que cette grande ville sunnite du nord de l'Irak ne redevienne une zone économique attractive. On préfère que la bourgeoisie sunnite de Mossoul reste à Dubaï ou émigre aux États-Unis pour que Mossoul devienne une ville en perdition, perde sa population, et que les sunnites émigrent, ce qui permettra de réduire leur poids en Irak comme en Syrie.
Convertir les sunnites au chiisme est un grand fantasme. Les sunnites agitent cette menace, qui reste marginale. Toutefois, il ne faut pas négliger cet aspect. À Alep, par exemple, beaucoup de jeunes sunnites se convertissent au chiisme et entrent ensuite dans des milices chiites comme les Fatemiyoun, pour 200 ou 300 dollars par mois. Les gens sont dans une telle misère que vous pouvez les acheter très facilement. Ils ont l'impression de faire partie du camp des vainqueurs. Le mythe du Hezbollah qui a tenu en échec Israël en 2006 continue de fonctionner. Il s'est montré particulièrement efficace dans les combats contre les rebelles en Syrie, et cela attire du monde. Et enfin, si vous voulez avoir une promotion dans les milices chiites, il vaut mieux être chiite. La réduction de la population sunnite l'a poussée à l'exil, l'a fragmentée, l'a divisée. Aujourd'hui, en Irak, il n'y a pas d'opposition sunnite unie, les partis sunnites sont liés à des partis chiites pour essayer de récupérer leur part de la rente pétrolière. C'est la seule manière pour eux de continuer à avoir une clientèle.
Cette stratégie iranienne rejoint la stratégie russe dans la région, qui est de faire pression sur l'Arabie saoudite pour que les cours du pétrole restent à des niveaux acceptables. En 2015, lorsque les Russes sont intervenus en Syrie, les prix du pétrole étaient à 25 dollars le baril. C'était une catastrophe pour la Russie, qui est un pays exportateur de pétrole. Le pétrole représente 50 % des exportations russes, et le gaz, 25 %, avant l'armement. La guerre en Syrie permet d'ailleurs aux Russes de remplir leur carnet de commandes au-delà de toute espérance. Les Russes cherchent donc à domestiquer l'Arabie saoudite, régulateur mondial des cours du pétrole, même si avec le pétrole de schiste aux États-Unis, nous n'atteindrions pas 100-150 dollars le baril, comme cela a été le cas en 2007. Mais 60 dollars le baril, c'est plus acceptable pour Poutine. Cela permet ensuite d'encercler la Turquie, qui voulait être un carrefour énergétique et qui risquait ainsi de faire perdre à la Russie des parts de marché, notamment le marché européen.
En contrôlant la Syrie, l'Irak, en étant en lien avec l'Iran, la Russie empêche la Turquie de devenir un carrefour énergétique avec des pipelines et des gazoducs qui viendraient du Sud. En revanche, Poutine a dit à Erdogan que s'il voulait devenir un carrefour énergétique, il n'y avait pas de problème, mais que ce serait un carrefour russe, ce qui explique bien l'alliance entre la Turquie et la Russie. Il ne faut pas perdre de vue cette alliance entre la Russie et l'Iran, parce que la Russie a besoin des réseaux iraniens dans la région pour faire pression sur les Saoudiens et éviter qu'ils ne répondent davantage aux ordres de Washington en ce qui concerne les prix du pétrole, plutôt qu'en fonction de Moscou. L'alliance entre la Russie et l'Iran va au-delà de la Syrie, tout comme aujourd'hui l'alliance entre la Turquie et la Russie dépasse l'enjeu syrien. Nous le voyons en Libye et sur d'autres terrains. C'est vraiment ce groupe d'Astana qui a des ambitions qui dépassent la Syrie, même si cette dernière a contribué à les rapprocher.
J'étais récemment au nord-est de la Syrie, où la coopération russo-turque est manifeste. En août 2016, a eu lieu la rencontre de Saint-Pétersbourg entre Erdogan et Poutine, dont nous ne connaissons pas exactement le résultat, ces accords étant restés secrets. Les Turcs sont ensuite intervenus en Syrie, empêchant les Kurdes de faire leur jonction entre Afrin et Kobané, puisqu'ils ont pris la ville d'Al-Bab au nord-ouest de la Syrie. Quelques temps plus tard, Alep-Est est tombée entre les mains de la Russie. Depuis 2016, il y a un échange de bons procédés entre les Turcs et les Russes : « j'arrête de soutenir les rebelles à Alep-Est, et tu peux prendre Alep Est. En échange, tu me laisses intervenir contre les Kurdes à Al-Bab ». L'armée syrienne a repris une partie d'Idleb ou la Ghouta, le sud, la Turquie neutralisant les rebelles. En échange, les Turcs ont pris le canton kurde d'Afrin au nord-ouest d'Alep. Plus récemment, une nouvelle offensive russo-syrienne a eu lieu sur Idleb, tandis qu'une offensive turque avait lieu sur Tell Abyad et Ras al-Aïn. La Russie pourrait ainsi permettre à la Turquie de prendre Kobané, de prendre un autre canton kurde, parce que la Russie a besoin de la Turquie pour reprendre le nord de la Syrie. La Russie a aussi besoin de la Turquie comme cheval de Troie au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) et sur d'autres terrains, comme le terrain libyen. Cela ne dérange pas beaucoup la Russie de donner une partie du territoire syrien à la Turquie, comme jadis la France a donné Sandjak d'Alexandrette à la Turquie, pour éviter qu'elle se joigne à l'Allemagne nazie lors de la deuxième guerre mondiale. C'est toujours à peu près le même procédé. Ce qui bloque, c'est évidemment la présence américaine, puisqu'ils conservent encore deux bases dans l'Est, mais la pression contre les troupes américaines s'accentue. Dans la région, j'ai vu se déployer les patrouilles russes pour gêner le passage des troupes américaines. Ce nord-ouest de la Syrie est extrêmement fragile, parce qu'il ne tient que grâce aux postes-frontières de Fechrabour qui se trouvent tout au nord-est du bec de canard, et qui pourraient être coupées très facilement par les Russes, privant cette région de toute aide alimentaire, de toute aide extérieure, et de toute aide logistique militaire pour les bases américaines. L'objectif de la Russie est de couper les vivres à l'administration locale kurde, pour qu'elles ne puissent plus délivrer de service à la population, et ainsi que la population s'en détourne et qu'elle retourne progressivement du côté de Damas, les Arabes les premiers, les Kurdes ensuite. L'objectif de Damas et de la Russie n'est pas de reprendre cette région par la force, le régime de Damas étant quand même assez faible. Il est occupé à Idleb, il sait que cela serait difficile. Il lui faut être patient, mais cette année, l'objectif du régime est bien de reprendre toute cette région, en poussant les États-Unis à l'extérieur par des attaques terroristes contre les bases, contre les patrouilles, avec du harcèlement indirect via des proxys.
Vous nous avez demandé de faire des scénarios à l'horizon 2050. Dans cette région, les pays sont dominés par la rente pétrolière, que ce soient les producteurs ou des pays qui sont dépendants de la rente indirecte, c'est-à-dire des aides des pays pétroliers. L'Égypte reçoit chaque année 25 milliards de dollars de l'Arabie saoudite et les travailleurs immigrés égyptiens renvoient des milliards à leurs familles, ce qui leur permet de survivre. La principale source de devises de l'Égypte vient des travailleurs immigrés. C'est le cas aussi pour la Jordanie, le Liban, le Yémen, la Syrie, avec en plus le million de réfugiés syriens en Europe, qui renvoient de l'argent chaque année. Nous avons calculé que ce que les réfugiés syriens en Europe renvoyaient représentait environ deux milliards d'euros, sans lesquels la situation monétaire en Syrie serait beaucoup plus grave. Seuls deux pays échappent à ce modèle : la Turquie et Israël. Tout cela est très fragile, parce que cela dépend des cours du pétrole et de la capacité des pays pétroliers à exporter une partie de leur production pour nourrir leur population. Or, vu leur modèle de développement, le delta exporté se réduit : en Arabie saoudite, en raison d'un aménagement du territoire ubuesque, et au Qatar, du fait d'une dépense énergétique par habitant incroyable. Ces pays ont de plus en plus de difficultés à nourrir leur propre population. En Arabie saoudite, par exemple, il y a vingt millions de citoyens saoudiens et il y a dix millions de travailleurs immigrés. D'ici vingt ans, nous aurons trente millions de citoyens saoudiens, dont les besoins augmentent. Si les parents se contentaient d'une voiture et d'un petit appartement, les enfants, eux, veulent deux 4x4 Cayenne, des vacances à Las Vegas et à Pattaya, et un niveau de vie bien supérieur, en étant évidemment tous employés dans une fonction publique pléthorique. Ce ne sont même pas eux qui travaillent, ce sont évidemment les Égyptiens ou les Jordaniens qui travaillent pour eux. Ce modèle n'est pas soutenable. En cas de crise économique, les travailleurs immigrés seront les premiers touchés car ils seront renvoyés chez eux. La crise financière de 2008 qui a touché les pays du Golfe et qui a, à mon avis, conduit au « Printemps arabe », a renvoyé chez eux des millions de travailleurs immigrés. L'Égypte avait la tête hors de l'eau jusqu'en 2008, et a coulé ensuite, ce qui a provoqué les manifestations et la chute de Moubarak. La prochaine crise qui touchera les pays du Golfe sera catastrophique pour l'ensemble de la région, et notamment les pays de la rente indirecte qui vivent de ces retours d'argent.
Par ailleurs, il s'agit d'une zone de confrontation géopolitique, et cela ne va faire que s'accentuer. Nous sommes vraiment à l'épicentre d'un nouvel axe de crise. Outre la rente pétrolière, l'autre ressource des pays de cette région est la rente stratégique, la rente milicienne. Aujourd'hui, en Syrie ou au Liban, la population a le choix entre l'émigration ou rentrer dans une milice. Au Yémen, c'est encore pire. Ce pays de trente millions d'habitants est complètement à plat. Plus les pays sont pauvres, plus vous pouvez constituer des milices, en payant leurs membres avec 150 à 200 dollars par mois. Cela vous donne un potentiel de déstabilisation interne et extérieure. Le Hezbollah y travaille, au Yémen. En Syrie, des mouvements miliciens sunnites peuvent également être utilisés sur différents territoires. Daech est un très bon exemple. Aujourd'hui, les Turcs sont en train d'utiliser des miliciens syriens de l'ancienne armée syrienne libre ou de Daech en Libye. Ce n'est pas l'armée turque qui va intervenir en Libye. Ce sont des miliciens recrutés dans le nord de la Syrie. Dans le Golfe, au sud, la divergence entre l'Arabie saoudite et le Yémen dans le Golfe d'Aden me semble être un nouveau conflit potentiel à l'horizon 2050. Les Émirats arabes unis se rêvant Bismarck, alors que l'Arabie saoudite aurait le rôle de l'Autriche-Hongrie. La réponse aux divergences entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à propos du Yemen ne manquera pas de poser problème par rapport à l'Iran.
Par ailleurs, la région, aride, va rapidement subir les conséquences directes du réchauffement climatique. Des zones entières sont inappropriées à la vie humaine, du fait des températures. La climatisation va vite trouver ses limites en Arabie saoudite lorsqu'il va falloir réfrigérer en permanence trente millions d'habitants. Nous voyons déjà les ravages sur la population irakienne lorsque des coupures d'électricité surviennent l'été. Des émeutes éclatent immédiatement, parce que les gens n'en peuvent plus. L'été 2019 a été extrêmement chaud dans le nord de l'Irak. En Syrie, on a dit que c'était la première fois que les paysans voyaient leurs légumes sécher dans les champs. Même si c'était irrigué, ils n'arrivaient plus à cultiver. Il y a eu des incendies de champs de céréales, certes alimentés par Daesh, mais tout de même ! Cette pénurie d'eau va s'accentuer du fait des barrages en amont du Tigre et de l'Euphrate construits par les Turcs qui consomment énormément en amont. C'est quelque chose à prendre très au sérieux.
Pour conclure, il faudrait investir de façon massive dans l'environnement dès maintenant. Toutefois, comment le faire dans des pays instables, en guerre, rongés par la corruption ? De plus, le modèle de vie qui séduit n'est pas le modèle de vie occidental, de transports en commun et d'économie d'énergie, mais plutôt le modèle Dubaï ou Dora, très dispendieux en énergie.

Depuis des décennies, nous nous interrogeons sur le sujet suivant : est-ce que la répartition politique et confessionnelle des principaux postes de pouvoir dans les pays concernés – Liban, Irak, Syrie, pour l'essentiel – est pertinente ? Président chrétien au Liban, Premier ministre sunnite et Président du parlement chiite, pour l'Irak ; Président kurde, Premier ministre chiite et Président du Parlement sunnite ; et pour la Syrie, vous connaissez la situation. Ce schéma reste-t-il pertinent ? D'ailleurs, le modifier fait partie des hypothèses de travail aux Nations Unies, dans le cadre du comité dit constitutionnel pour la Syrie. Ce schéma est-il devenu impertinent, inopérant, avec des facteurs de blocage et de sectarisme communautaires et confessionnels ? Ce qui m'intéresse est d'avoir votre lecture sur une option ou l'autre puisque le sujet est sur la table pour les trois pays concernés. Cela peut valoir pour d'autres pays, mais c'est en particulier pour ces pays-là.

Nous voyons que certaines élites émigrent. Il y a aussi ceux qui sont poussés par le réchauffement climatique, par la guerre. Les élites sunnites émigrent d'Irak. Les chrétiens maronites émigrent peut-être du Liban. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur l'émigration de ces « élites » ? Ensuite, vous avez très peu parlé de la Jordanie, pourrait-on rapidement faire un point ?

Exception faite des quelques actions menées dans le cadre de l'opération Chammal, le rôle de la France dans la zone est-il uniquement dépendant des décisions américaines ? En d'autres termes, existe-t-il ou peut-il exister une relation bilatérale prégnante entre la France et les autorités locales ?

Vous avez beaucoup parlé de la stratégie de la Turquie, de la Russie, des États-Unis, de la Chine, de l'Iran. Quid de la stratégie de l'Union européenne, de la France dans cette région ? Nous avons l'impression d'être absents alors que nous sommes présents. Ensuite, nous avons l'impression que cette région et l'opinion publique sont guidées par l'appartenance confessionnelle. Vous qui connaissez bien cette région, n'est-ce pas plus compliqué que cela ? Par exemple, en Irak, il y a eu des manifestations et vous avez dit que les sunnites n'ont pas manifesté. Je ne sais pas si c'est vrai. Il y a quand même des tensions en Irak qui sont liées, pas forcément aux communautés, mais peut-être à la situation économique et sociale du pays. Troisième question : vous avez très peu parlé des Kurdes, qui pour moi sont les victimes de la situation actuelle. Ils sont repoussés, réprimés un peu partout, en Syrie en particulier, en Turquie aussi, et en Irak, ils ont quand même une province qui est importante. Ils ont failli être indépendants, mais ils n'ont pas été suivis par la communauté internationale. Quelle est votre analyse sur la situation des Kurdes, qui ont tendance également à quitter ces régions pour venir en Europe et pour aller en Angleterre ?

J'aimerais vous poser une question relative à l'énergie au Moyen-Orient. Vous nous avez parlé des différents facteurs de déstabilisation, dans une région qui est d'ailleurs déstabilisée depuis très longtemps ; pas seulement depuis les Omeyyades ou les Abbassides : cette région, d'un point de vue religieux, communautaire et ethnique, a souvent été déstabilisée. Si l'on s'implique dans cette région aujourd'hui, si nous y sommes présents – alors que nous ne sommes pas impliqués dans d'autres conflits, comme ceux du Darfour ou du Sud Soudan, qui ont fait des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés et déplacés – c'est bien parce qu'il y a derrière un enjeu particulier pour nous. Vous nous avez un peu parlé d'énergie, à travers l'eau, en nous disant que les fleuves peuvent être un sujet de conflit pour la Syrie et l'Irak. J'aimerais savoir quel est votre point de vue sur la dépendance de l'Europe aux énergies du Moyen-Orient. Est-ce pour nous un facteur d'implication particulier dans ces conflits avec nécessité de stabilisation ou est-ce qu'au contraire, nous pouvons, comme on le fait parfois, contourner ces zones pour trouver d'autres voies pour acheminer l'énergie – en l'occurrence le pétrole et le gaz – vers l'Europe ?

Je reviens sur les mouvements qui se développent aujourd'hui en Irak, au Liban et en Iran, avec une dimension que nous pourrions qualifier de révolutionnaire, parce qu'ils ont un paramètre social et démocratique. Est-ce que cela peut entrer en résonance avec les révolutions arabes de 2011 ? Des jeunes, des étudiants, descendent dans la rue, dans les grandes villes. Certes, il y a une répression sanglante : 4 500 morts en Irak, 1 500 morts en Iran pour les seules manifestations du mois de novembre, 520 blessés ce week-end au Liban. Or, c'est l'arc chiite pro-iranien, qui va de Téhéran à Beyrouth, qui est mis en cause et qui est dans la tourmente. Ne pourrions-nous pas nous interroger sur une possible sécularisation de ces sociétés, puisque ces révoltes populaires ne sont pas motivées par des raisons religieuses, bien au contraire ? N'y a-t-il pas une émergence de quelque chose de nouveau qui pourrait aboutir à des élections démocratiques, s'il y avait une mobilisation de la France, de l'Europe sous l'égide de l'ONU ?
Ensuite, la Turquie fêtera son 500e anniversaire en 2023. C'est l'anniversaire du traité de Lausanne qui l'a créée. Depuis sa réélection en 2018, le président turc Erdogan a fait de ce centenaire une année symbolique et n'a pas caché son intention de faire de la Turquie un acteur mondial d'ici 2023, avec pour objectif de reconstruire une crainte de la Turquie. Certains s'inquiètent. Je pense notamment aux Kurdes, qui s'inquiètent de sa volonté de créer les conditions d'émergence d'un nouveau califat. Certains le soupçonnent même de vouloir ressusciter l'Empire ottoman et de vouloir se déclarer calife. La ville de Mossoul en Irak, la ville d'Alep en Syrie, les îles grecques proches de la Turquie sont trois territoires qui n'ont pas été intégrés dans le traité de Lausanne mais qui demeurent dans l'inconscient collectif turc. Pensez-vous que l'Irak, la Syrie et la Grèce doivent se sentir menacées ?

Je voudrais revenir sur la place de la France dans la région, qui historiquement avait un positionnement qui lui permettait de travailler et discuter avec l'ensemble des États. Ne constatons-nous pas, depuis une décennie, un tropisme vers la plaque tectonique sud que vous avez définie, M. Razoux, qui gêne les relations avec la zone tectonique nord ? Quelle est aujourd'hui la capacité de la France à faire entendre sa voix ? De plus, le grand absent de la région est quand même l'Organisation des Nations unies, qui n'est pas le cadre de l'intervention américaine de 2003 en Irak, qui n'est pas le cadre non plus dans lequel s'est effectuée la discussion sur le nucléaire iranien. Quel rôle aujourd'hui l'ONU devrait-elle jouer pour pouvoir sortir de ce conflit ou cette zone est-elle le terrain de jeu de grandes puissances ?
Je vais tenter de répondre aux questions sur la nature des communautés confessionnelles au Moyen-Orient. Le fait qu'il y ait des systèmes confessionnels, n'implique pas que tout le monde soit croyant. Je vais vous raconter une anecdote. Les Américains, en 2003, cherchaient un personnel politique pour reconstruire l'État irakien. J'avais été sollicité à l'époque et on me demandait, du fait de ma connaissance de l'opposition au régime de Saddam Hussein, de donner des noms. Je disais : untel est socialiste arabe, untel est dans l'opposition. Je voyais bien que cela ne les intéressait absolument pas. Les Américains voulaient savoir s'il était sunnite, chiite ou kurde. J'ai dit que je ne savais pas, qu'il appartenait au parti communiste et que je pensais qu'il était chiite. Ils l'ont donc mis parmi les chiites. L'actuel premier ministre démissionnaire irakien, Adel Abdel-Mehdi, est un de mes anciens amis de l'époque où il était en exil à Saint-Étienne avec sa famille et où il était militant maoïste. Sa femme était partisane d'un certain style de vie lié à la bonne nutrition. J'étais très loin d'imaginer qu'un jour il ferait tirer sur une foule qui ne demandait rien d'autre que de manger à sa faim, et surtout, Adel Abdel-Mehdi n'est pas croyant. Tout le monde le sait, et c'est là un point important sur lequel je suis en train d'écrire, sur le chemin particulier de la sécularisation dans les pays musulmans. C'est très lié à la captation d'une certaine modernité par les puissances coloniales, le fait que la sécularisation s'est faite à travers, non pas des idéaux sécularisés, mais à travers la religion. Nous avons eu une idéologisation de l'islam sunnite comme chiite. D'ailleurs, nous voyons très bien la différence entre l'islam d'avant la réforme et l'islam d'aujourd'hui qui ne respecte plus aucune autorité religieuse. Même chez les chiites, il y a un vide au niveau de l'autorité religieuse, chose que nous avons beaucoup de mal à comprendre. Ce que l'on appelle la radicalisation, les mouvements islamistes, sont des mouvements qui se réclament de l'islam, mais qui sont l'expression d'une sécularisation. Ils se placent dans une temporalité politique, et non plus une temporalité religieuse intemporelle, comme c'était le cas avant la réforme. C'est très difficile à comprendre pour des Français, pour lesquels sécularisation et laïcisation vont de pair. Dans les pays musulmans, du fait des retournements systématiques – je rappelle que la colonisation des pays arabes a été faite très largement par la Troisième République et légitimée au nom de ces mêmes idéaux qu'on propose aujourd'hui aux musulmans de France pour les intégrer – ce qui nous semble naturel ne l'est pas pour beaucoup de musulmans pour qui la sécularisation et la laïcité sont antinomiques. C'est donc une nouvelle religion idéologisée anti-occidentale, qui n'implique pas la foi. Vous pouvez être chef de milice chiite ou dirigeant d'un groupe de combattants salafistes, sans être un véritable croyant. Vous vous situez dans une nouvelle temporalité, ce qui est d'autant plus problématique qu'une modernité s'oppose à une autre modernité et qu'il y a un décalage historique avec la modernité exportée par le biais de la colonisation. Je vous renvoie à la mission civilisatrice de Jules Ferry en Algérie et en Tunisie, qui montre bien que cela n'a pas été qu'une « realpolitik ». Il y avait véritablement une foi dans le progrès universel, qui devait s'imposer par la force et par la domination, bien que les choses se soient délitées par la suite. Par une ironie de l'histoire, Bush a légitimé en 2003 l'occupation de l'Irak pour en faire le phare de la démocratie au Moyen-Orient. Aujourd'hui, Donald Trump dit aux Irakiens qu'il est d'accord pour quitter l'Irak mais que cela va leur coûter 34 milliards de dollars de dédommagement. Les acteurs sont donc nus, d'une certaine façon, et nous ne sommes pas face à une réaction religieuse, mais face à une opposition politique qui s'explique très largement par l'échec d'institutions nées de la colonisation, auquel nous assistons dans les pays fragmentés, confessionnels, mais aussi dans des pays comme la Libye. Ces pays n'existent pas, ce sont des créations coloniales. Nous pouvons dire la même chose de l'Irak. Sous ce nom et dans ses frontières actuelles, l'Irak n'a jamais existé avant 1925.
Comme d'habitude, la Jordanie est dans l'œil du cyclone. Elle est plus affaiblie que jamais. Le roi et les élites se posent des questions existentielles, à la fois du fait de la « menace » djihadiste émanant du Nord et de l'Est, et du fait de l'absence de résolution du dossier palestinien à l'ouest. Tout le monde sait, à commencer par le pouvoir jordanien, qu'il y a des structures et des cellules d'Al-Qaïda et de Daech présentes en Jordanie. Cette dernière est potentiellement très fragile, et le roi se pose des questions existentielles sur la garantie américaine. Les Occidentaux et les États-Unis sont pour le moment très présents en Jordanie, mais qu'en sera-t-il demain ? Le Roi se tourne donc clairement vers la Russie et vers la Chine, en se disant qu'ils ne veulent pas être les dindons de la farce, si un grand plan de paix israélo-palestinien mettait en cause les intérêts de la Jordanie. La situation est inquiétante, d'autant que la population jordanienne est de plus en plus opposée aux traités de paix israéliens – n'y voyant plus aucun intérêt – et devient de plus en plus anti-américaine.
Ensuite, la grille de lecture sur les communautés est-elle toujours pertinente ? Quand vous êtes au Liban, on vous dit que si vous voulez essayer de tenter de comprendre la question libanaise et les rapports de force au Liban, il ne faut pas raisonner en termes de communautés, il faut raisonner en termes d'argent. On m'a toujours dit de suivre l'argent. C'est ce qui permet de comprendre ce qui se passe à propos de l'énergie au Moyen-Orient.
Le Moyen-Orient est-il toujours un enjeu pour nous ? De mon point de vue, plus du tout. Nous continuons à acheter du gaz et du pétrole aux pays du Moyen-Orient uniquement pour équilibrer la balance commerciale. Si vous voulez que ces pays-là vous achètent des jolis avions, des beaux métros, du luxe et tout ce qui va avec, il faut en échange acheter ce qu'ils produisent et globalement, comme ils ne produisent que du gaz et du pétrole, c'est ce que nous leur achetons. Si vous allez voir les macro-comptes de Bercy, vous verrez que ce qu'on exporte dans ces pays-là correspond à peu près à ce qu'on importe en termes d'énergie. L'avenir de l'énergie au Moyen-Orient est un véritable enjeu, parce qu'évidemment, les pays producteurs comprennent que le monde est en train de s'adapter à d'autres sources d'énergie que le pétrole. Le pétrole restera pour les armées, pour faire fonctionner tout ce qui est militaire, pour l'aviation militaire et civile, pour le pétrochimique et pour faire fonctionner les gros bateaux super tankers, etc. C'est à peu près tout. À l'avenir, l'enjeu énergétique sera certes un peu pétrolier, mais le véritable enjeu énergétique au Moyen-Orient sera le gaz naturel liquéfié (GNL) et ce sera le nucléaire. J'en suis convaincu.
Ensuite, que peut-on penser de la Turquie, de M. Erdogan ? M. Erdogan a compris que dans le contexte que j'ai décrit en première partie, vous gagnez des points quand vous êtes un perturbateur intelligent, et non pas le bon élève de la classe. Il joue donc les perturbateurs intelligents et il marque des points. Comme il est intelligent, il a compris quelles étaient les lignes rouges qui lui avaient été fixées par les États-Unis, par la Russie et par la Chine, et que comme les pays européens n'ont pas osé lui exprimer quelles étaient les leurs, il en use, en abuse et il pousse le pion le plus loin possible.
Concernant l'aspect confessionnel, je suis géographe de formation, et pour moi, le territoire se décompose en plusieurs strates : le social, l'économique, le confessionnel, etc. Le communautaire est une strate très importante : moins importante quand cela va bien économiquement et très importante quand cela va mal économiquement et que le pays est en guerre. Qu'est-ce qu'une communauté ? Une communauté est un réseau de solidarité qui vous permet d'obtenir du travail, une bourse pour votre enfant, et différents types de services. Cette communauté peut avoir un facteur d'unité religieuse, elle peut avoir aussi un facteur d'unité ethnique – c'est le cas des Kurdes, voire les sunnites – mais cela peut aussi se décliner à travers les tribus, les clans. Si vous prenez les Arabes sunnites dans l'Est de la Syrie, ils sont divisés en tribus. Le facteur d'unité communautaire est là. Une communauté est un réseau social. Quand un État est faible, n'apporte pas de services, les gens s'appuient sur leur communauté. Au Liban, l'État est faible et le communautarisme est institutionnalisé politiquement ; cela renforce donc le phénomène communautaire. Ceux qui peuvent s'extirper du communautarisme sont les gens les plus riches, ceux qui n'ont pas besoin de compter sur les autres pour vivre, qui ont un passeport canadien ou français dans la poche, qui leur permet de partir quand ils le veulent. Plus vous êtes pauvre et sans passeport étranger, plus vous êtes obligé de compter sur le système communautaire. Vous n'avez pas le choix. C'est vraiment une question de survie. Dans ces sociétés, les mariages sont endogames, on se marie dans la même religion. Il y a des difficultés quand on veut se marier entre sunnites et chiites, ou entre chrétiens et musulmans. Bien souvent, le père apporte la maison qui permet de se marier ou c'est quelqu'un du clan qui a fourni le travail permettant de vous marier. Par conséquent, les individus ne sont pas libres du choix de leur conjoint, c'est leur famille qui décide. Les aînés sont sans doute plus conservateurs que la jeunesse qui voudrait essayer de changer le monde. Mais ces facteurs d'inertie maintiennent les communautés, notamment les mariages endogames.
Pourquoi les gens quittent-ils la région ? À cause de l'insécurité, de l'absence de débouchés professionnels. Un sunnite aujourd'hui en Irak a peu de chance de rentrer dans l'administration, au ministère des Affaires étrangères. Dans le secteur privé, il n'y a pas d'opportunités. Donc les gens partent, ce n'est pas très compliqué.
Dans la région, l'Union européenne apporte une aide humanitaire mais n'a pas de vision politique affirmée. Elle veut avant tout éviter une vague de migration et le terrorisme. C'est un peu aussi ce que veut la France, mais elle s'est tellement fourvoyée sur la crise syrienne qu'elle a perdu une part considérable de sa crédibilité dans la région. Du fait de son arrimage aux États-Unis, pour la plupart des pays, il vaut mieux parler directement au Bon Dieu plutôt qu'à ses saints, autrement dit avec les États-Unis plutôt qu'avec la France. En octobre 2019, les troupes américaines se sont retirées de la frontière syro-turque, laissant ainsi les troupes turques attaquer. Or, à 100 kilomètres de la frontière se trouvait la cimenterie Lafarge que gardaient 200 soldats français. Si le Président de la République voulait protéger les Kurdes, il lui suffisait de dire aux soldats français de monter à la frontière et d'empêcher les Turcs de passer. Or, nous avons protesté au niveau de l'ONU mais nous n'avons pas envoyé nos troupes à la frontière syro-turque, parce que nous sommes complètement subordonnés aux États-Unis sur cette question. Tant que nous n'aurons pas une force militaire indépendante capable de peser et d'intervenir indépendamment des États-Unis, nous n'aurons quasiment aucun poids dans la région. Les Kurdes sont victimes en Syrie, mais il faut savoir qu'ils sont quand même pris en otage, dominés par le Parti des travailleurs du Kurdistan ( Partiya Karkerên Kurdistan, PKK ), qui a sa logique propre d'affrontement avec la Turquie et qui se sert des Kurdes du nord-est de la Syrie dans ce combat, ce qui explique la réaction violente de la Turquie. Si nous avions dans le nord-est de la Syrie des gens proches de Barzani, du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) qui dirigent aujourd'hui le Kurdistan d'Irak, la réaction de la Turquie violente aurait sans doute été moins violente, mais ce n'est pas le cas et cela va aller de mal en pis. En effet, la stratégie turque dans le nord de la Syrie, consiste à s'emparer de cette zone de 30 kilomètres où les Turcs veulent installer les futurs réfugiés de la province d'Idleb. L'armée russe et l'armée syrienne poussent du côté d'Idleb. Environ deux millions de civils sont dans cette province et ne pourront pas passer en Turquie, parce qu'il y a un mur ; les Turcs n'en veulent pas. L'objectif est de les implanter à la place des Kurdes à Afrin, à Tell Abyad, Kobané, voire plus, s'ils s'emparent de toute la zone. Cela veut dire que les Kurdes vont venir se réfugier en Irak et par leur réseau migratoire, essayer de gagner l'Europe. Erdogan nous dit que s'il ne réalise pas son plan, il laissera passer une nouvelle vague de réfugiés vers l'Europe. Dans les deux cas, l'Europe est sous la menace turque.
Effectivement, Erdogan a de grandes ambitions pour la Turquie, pas seulement au Moyen-Orient. Il y a une base turque à Mogadiscio, en Somalie, à Souakin au Soudan, et en Libye. Il fait comme Poutine qui sort de l'ancien espace soviétique pour reprendre possession des pays alliés : la Syrie et la Libye. Erdogan essaie lui aussi de renouer avec l'Empire ottoman ; cela fait partie de sa stratégie. Il profite du fait que l'Europe est un « ventre mou » qui le laisse faire et que les États-Unis se désintéressent de plus en plus de la région. Le problème de la France, que j'ai remarqué lors de la crise syrienne et d'autres, c'est que notre diplomatie était largement dominée jusqu'à une date récente par le courant néoconservateur, très lié aux États-Unis, très partisan du changement de régime. Ces diplomates ont joué aux apprentis sorciers en Libye, en Syrie et ailleurs, sans se préoccuper de l'alternative, en pensant naïvement que des mouvements démocratiques seraient capables d'émerger ou que les Frères musulmans – qui est un parti totalitaire fondé en même temps que les partis fascistes en Europe – pourraient être une alternative. À mon avis, c'est une erreur grossière, parce que les Frères musulmans, c'est : « one man, one vote, one time » [un homme, une voix, une fois], comme ont pu l'être le fascisme et le nazisme. Il ne faut pas avoir beaucoup d'illusions sur les Frères musulmans et sur la Turquie.

Une construction politique pourrait-elle favoriser une alternance politique dans ces pays ? Le Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) présidé par Mme Radjavi peut-il avoir un effet positif ? Nous devons discuter les uns avec les autres. En tant que députés, rencontrer les diasporas ou ces mouvements politiques peut-il faire avancer les choses ?

La France envoie son groupe aéronaval avec le porte-avions Charles-de-Gaulle, accompagné de bâtiments européens en Méditerranée orientale pour soutenir les opérations de la coalition contre l'État islamique. Ceci dit, la Russie et la Turquie ont fait de la Syrie un champ de bataille pour leur influence propre dans la région. Les Européens ne sont pas d'accord pour proposer eux-mêmes une solution politique commune. Le Conseil de sécurité de l'ONU est bloqué dans son fonctionnement par le sempiternel vote des grandes puissances. Russie et Chine ont d'ailleurs utilisé leur veto de manière assez abusive sur la Syrie. Dans cette région (Syrie, Iran, Irak, Turquie), que faut-il faire pour trouver une solution de paix ? Faut-il poursuivre une démarche militaire plus effective ? À ce moment-là, avec quels objectifs ? Faut-il engager une stratégie diplomatique ? Avec qui ? La paix n'est-elle qu'un rêve utopique ? Faut-il simplement attendre un monde sans pétrole pour que les tensions disparaissent ? Qu'en pensez-vous ?

Je me permettrai de rebondir sur une des questions qui n'a pas encore reçu de réponse, sur les organisations internationales. Vous avez évoqué les États puissances, mais les organisations internationales manquent cruellement d'efficacité dans cette région. N'est-ce pas leur rôle de rééquilibrer les choses ou prenons-nous acte de l'échec de l'ONU ? À la rigueur, ne faut-il pas refonder une nouvelle organisation internationale qui serait efficace dans cet espace ?
Deuxième question : les intérêts économiques exogènes que vous avez mentionnés, qui peuvent être énergétiques, hydrauliques, etc., priment-ils les motivations endogènes des conflits – religieuses, ethniques – ou est-ce un savant mélange des deux ? Pour vous, qu'est-ce qui va primer pour pouvoir aboutir à la paix ?

Je voudrais vous interroger sur les financements du terrorisme. Je fais un parallèle. Vous avez évoqué le soutien nécessaire apporté aux familles déplacées qui vivent dans des conditions extrêmement précaires dans ces pays. Beaucoup de virements sont faits chaque année, ce qui représente des sommes importantes. Vous avez parlé de plusieurs milliards de dollars de virements en provenance de l'étranger. Pensez-vous que dans ce flot, nos services de sécurité occidentaux sont en capacité de voir ces petits virements qui, à mon avis, vont constituer une manne toujours précieuse pour ces cellules terroristes dormantes ?

Vous avez évoqué la tectonique des plaques, formule employée par Wilson en 1965. Il prévoyait trois mouvements. Il y avait la convergence, la divergence et le coulissage. Nous avons compris que nous pourrions converger avec les Chinois, mais sont-ils aujourd'hui nos meilleurs amis et alliés dans cette région ? De qui divergeons-nous réellement et vers qui pouvons-nous coulisser ? Vous avez évoqué l'armement nucléaire iranien. Est-il avéré à deux ou trois ans ? Est-ce que nous ne sommes pas encore victimes d'une communication identique à celle qui, une dizaine d'années, démontrait la présence d'armes de destruction massive qui n'ont finalement jamais été retrouvées et à propos desquelles la France a su s'honorer de ne pas agir à l'époque ? Quel avenir ont la France et l'Europe là-bas ? Vous l'avez évoqué dans quelques réponses, mais où en est-on ? Est-on encore utile là-bas ? Quelles sont vos propositions, techniquement, pour notre continent européen ?

Nous avons beaucoup parlé des États et notamment d'un certain échec des institutions nées de la colonisation. Selon vous, existe-t-il des pouvoirs locaux, qu'ils soient institutionnels, religieux ou tribaux, qui pourraient être des facteurs de stabilité ? Par ailleurs, j'aimerais que vous puissiez nous faire part de votre analyse sur le lien éventuel entre le Moyen-Orient et le Sahel. Sur la face émergée de l'iceberg, nous avons le financement de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis de la force du G5 Sahel, et donc une contribution à la stabilité de la zone. Selon vous, existe-t-il aussi des liens plus inavouables qui pourraient entrer en contradiction avec nos efforts de stabilisation au Sahel ?
Sur l'Iran et l'évolution du régime, je comprends très bien pourquoi à un moment donné de l'histoire, Maryam Radjavi a pu être populaire en France. Mais les Moudjahiddines du Peuple sont quand même perçus dans la région et en Iran comme un mouvement réellement terroriste, qui est responsable de la mort de plusieurs centaines de responsables et de plusieurs milliers d'Iraniens. Je peux vous assurer que si vous allez en Iran, y compris dans les milieux bobos, intellos et réformistes, ils honnissent ce mouvement et cette personne. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de la soutenir du tout, en tout cas, pas si nous voulons essayer d'avoir un dialogue constructif avec Téhéran.
Concernant l'évolution du régime, le paradoxe réside dans le fait que la jeunesse iranienne et les classes moyennes jusqu'aux quadragénaires et quinquagénaires, en ont assez du rôle du clergé mais qu'ils n'en ont pas assez de la République islamique. D'abord, pour la plupart d'entre eux, ils n'ont connu que cela. Ils en ont assez du rôle intrusif du clergé dans leur vie quotidienne : la police religieuse, les interdits, etc. Par contre, sur le plan politique, ils font avec. Ces mêmes personnes, y compris les jeunes et les réformistes qui critiquent le rôle du clergé, sont derrière les Pasdarans, les « gardiens de la révolution », heureux de les avoir pour garantir la sécurité du pays : « regardez ce qui se passe avec les États-Unis et tous les gens qui nous veulent du mal. Si nous n'avions pas les gardiens de la Révolution, nous serions déjà à terre, et sous la domination des Chinois, des Russes ou des Américains ». Je vois donc plutôt une évolution se profiler qu'un changement de régime. Des élections très importantes vont avoir lieu au Parlement dans environ un mois, pour le premier tour des législatives, et l'année prochaine, en 2021, il y aura l'élection d'un nouveau président.
Concernant la solution de paix au Moyen-Orient, de mon point de vue, l'Organisation des Nations unies n'est pas caduque. Elle a encore son utilité sur place, mais comme pendant la Guerre froide, à partir du moment où vous avez une rivalité de puissances, elle doit s'en accommoder. Les organisations influentes aujourd'hui sont l'organisation islamique et une série d'organisations régionales qui essaient d'exister et de pousser leurs solutions. De mon point de vue, si la France et l'Union européenne pouvaient avoir un rôle positif à jouer, ce serait en soutenant l'idée d'une organisation de sécurité et de coopération dans le Golfe. Nous sommes un certain nombre à soutenir l'idée, en France et en Europe, vis-à-vis des deux rives du Golfe, Nord, Sud et Ouest. Il s'agit de réunir tous les pays riverains pour créer un cadre où ils peuvent discuter entre eux. Ainsi, les choses pourraient peut-être aller mieux. La France et la Chine ont un intérêt objectif à apaiser la situation et à favoriser le dialogue. Nous pouvons jouer un rôle extrêmement positif. Évidemment, les Américains et les Russes ne seront peut-être pas très favorables à cette option, parce que cela les marginalise un peu, mais je crois vraiment que c'est ce que nous pourrions faire.
Pour répondre à votre question sur les plaques tectoniques : est-ce que cela coulisse, diverge ou converge ? Je vous ai un peu répondu indirectement. L'intérêt pour tout le monde serait que cela coulisse. Certains voudraient que cela diverge mais la réalité sur place fait que cela converge. Les « régionaux de l'étape » qui ont leur propre agenda intérieur préféreraient que cela diverge fortement, ou alors que cela converge pour aller à l'affrontement. Les régionaux qui espèrent au contraire s'en sortir vivants se disent qu'il faudrait que cela s'apaise, et les grandes puissances, les Russes et les Américains, ont plutôt intérêt à ce que cela coulisse et à ce que cela reste comme cela.
Je vais abonder dans le sens de M. Razoux en ce qui concerne la position de la France vis-à-vis de l'opposition iranienne, et notamment des Moudjahiddines du peuple, et de Myriam Radjavi. Je suis personnellement choqué à chaque fois que je vois des Moudjahiddines du peuple distribuer leurs tracts et avoir pignon sur rue en France. Il faut bien réaliser que c'est une forme de déclaration de guerre au peuple iranien. Depuis les partisans du Chah jusqu'aux partisans de la République islamique, tout le monde en Iran considère les Moudjahiddines du peuple comme des traîtres qui ont aidé Saddam Hussein au moment de l'agression irakienne contre l'Iran en 1980. Contrairement aux États-Unis qui ont exprimé des regrets pour avoir soutenu le régime de Saddam Hussein financièrement, militairement et politiquement, la France n'a pas exprimé de regret. Cette guerre a coûté un million de morts et nous nous sommes investis dans un conflit qui a eu pour effet de réunifier l'Iran, un peu à l'image de la guerre de 14-18 pour la France. Toutes les régions d'Iran, au-delà des confessions, des langues et des régions, se sont unifiées. Les Moudjahiddines du peuple ne sont pas l'avenir de l'Iran. Ils sont rejetés unanimement par tous les Iraniens, quelles que soient leurs positions politiques, en faveur ou pas du régime.
En ce qui concerne la position de la France dans les conflits au Liban, en Syrie et en Irak, et l'éventuelle solution politique, je dois dire que je suis assez pessimiste, parce qu'il me semble que les institutions en place, notamment les États, sont les principales responsables du chaos actuel, et qu'il n'y a aujourd'hui aucune volonté de privilégier les principes aux intérêts à court terme. C'est le cas de toutes les puissances impliquées dans le conflit. Nous sommes dans une période très délétère où les intérêts à court terme priment les principes, partout, ce qui ne favorise pas la stabilisation du Moyen-Orient. Quelle puissance peut affirmer aujourd'hui qu'elle a intérêt à la stabilité ? Chacun essaie d'avancer ses pions. Le problème est que les sociétés qui se sont exprimées depuis 2011 à travers les printemps arabes n'ont pas la possibilité, seules, d'aboutir à des solutions politiques, parce que l'État ne répond pas. Il répond soit par la répression, soit par la dégénérescence confessionnelle. C'est donc une remise en cause du système étatique, pas forcément des frontières, mais une consultation des sociétés qui paraît nécessaire. « Dans quel État voulez-vous vivre et quel État voulez-vous reconnaître de façon légitime ? » La Société des nations avait procédé à cette consultation, mais nous n'en avons pas tenu compte en 1918-2019 pour ce qui concerne l'Irak. Il faut cette fois-ci tenir compte des vœux des sociétés et ne pas les trahir systématiquement, comme cela a été fait. Le problème n'est pas tant celui du régime politique que celui de l'institution, qui implique que chacun se replie sur sa communauté, puisque c'est l'ultime recours quand on est face à un État prédateur dont on a peur.
En ce qui concerne la position de la France, nous n'avons pas suffisamment conscience de l'importance des campagnes militaires et de l'effet de la destruction de deux villes qui sont des métropoles arabes sunnites, Mossoul et Alep, avec la coopération, politique et militairement limitée, de la France. Cela a créé un traumatisme qui va perdurer sur plusieurs générations au sein des communautés arabes sunnites, qui sont aujourd'hui en Irak abandonnées, interdites de retour à Mossoul et cantonnées dans des camps en lisière des déserts, à la merci des exactions des milices chiites et dont personne ne se préoccupe. Cela offre un boulevard à l'État islamique, dans la mesure où aucune solution politique ne peut être envisagée dans le contexte des institutions actuelles.
Je vais tout de suite répondre à la question de M. Lejeune sur le financement du terrorisme et les transferts d'argent. Au Moyen-Orient, on transfère l'argent non pas par des virements bancaires, mais par le système de la hawala. Vous déposez 10 000 euros chez un vendeur de kebabs à Vesoul en Haute-Saône. Il va prendre son téléphone et appeler son copain qui habite à Damas et il va lui dire que quelqu'un lui a donné 10 000 euros, que son père va venir les chercher en équivalent livre syrienne. Il lui dit qu'il peut lui faire confiance et lui donner, c'est comme cela que cela se passe. Cela échappe complètement au système de traçage bancaire et c'est comme cela, vous avez des milliards et des milliards qui sont transférés d'Europe, des États-Unis vers ces pays-là.
Concernant le financement du terrorisme par ce biais, j'ai une amie qui travaille à Médecins sans frontières (MSF), au camp de Al-Hol en Syrie, là où vous avez les familles de djihadistes qui sont enfermées. Beaucoup arrivent à s'échapper, à récupérer 5 000 ou 10 000 dollars pour payer un passeur, payer les gardiens du camp, et puis ensuite gagner la Turquie et l'Europe par des réseaux de passeurs. Elles ont récupéré ces 10 000 dollars par ce système de la hawala. Les familles envoient l'argent à un commerçant, une connaissance dans la région, et ensuite, il suffit de le transférer aux personnes. C'est très difficile à tracer. Les services de renseignement sont démunis par rapport à tous ces systèmes informels du Moyen-Orient, où les économies sont largement informelles. Même les sanctions officielles toucheront les grandes entreprises mais seront complètement inopérantes pour l'essentiel du secteur privé.
Comment pouvons-nous nous en sortir ? Je pense que si nous voulons que la région soit stable, il faut soutenir les États, les institutions, mais ne pas les soutenir aveuglément, parce qu'il y a souvent de la gabegie et de la corruption. Il faut introduire une espèce de rapport de force avec ces États. J'ai travaillé plusieurs années avec la coopération allemande, la Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ). Nous travaillions avec le ministère de l'Environnement en Syrie. Lorsque nous avons vu au bout d'un an qu'il n'y avait rien à attendre du ministère de l'Environnement, nous avons établi un plan de coopération avec des entreprises privées pour développer des stations d'épuration, développer la protection des terres agricoles, etc., à travers le secteur privé que nous nous sommes mis à soutenir. Ainsi, le ministère de l'Environnement, voyant que nous passions vers le secteur privé, est devenu plus réceptif à nos demandes, l'objectif étant d'encourager la Syrie à se doter d'une législation sur la protection de l'environnement. J'ai vu les Allemands beaucoup plus pragmatiques que l'Agence française de développement (AFD) sur la question. Il faut toujours garder quand même ce souci de la stabilité des institutions, parce que sans stabilité, nous n'avons pas de développement, et sans développement, nous n'aurons pas de progrès dans l'éducation et nous n'aurons pas la création de classes moyennes. Nous n'aurons pas ce support de la démocratie. Si vous avez des pays où vit une élite extrêmement riche et une majorité de la population très pauvre, c'est-à-dire dépendante de ses patrons qui tiennent l'État, nous aurons du mal à voir émerger de véritables mouvements démocratiques. C'est malheureusement le cas. La seule « success story » concerne la Tunisie, parce que nous avions justement cette stabilité et cette classe moyenne, qui peut être le socle d'un mouvement démocratique.
Pour revenir à la première question, je ne connais pas tellement la politique iranienne, mais il faut être méfiant à l'égard des diasporas, des mouvements politiques en exil à l'étranger. Bien souvent, cela fait vingt à trente ans qu'ils sont ici, ils ont perdu pied avec la réalité, ils sont complètement déconnectés du terrain. Ils induisent nos politiques en erreur. C'est ce qu'on a appelé la « chalabisation » de l'opposition, qui a fait commettre toutes ces erreurs aux Américains en 2003, en Irak. L'opposition syrienne a aussi joué ce jeu pervers à l'égard de nos politiques en France.

En Jordanie, la base française projetée H5, ouverte en septembre 2014, joue un rôle important depuis les attentats de 2015, de par sa proximité avec les théâtres d'opérations, puisqu'elle ne se situe qu'à 40 kilomètres de la moyenne vallée de l'Euphrate, ce qui fait de cette base une plateforme essentielle pour les forces de Chammal. En quatre ans d'activité, 6 000 sorties ont été effectuées, soit 28 000 heures de vol, 1 500 frappes, ce qui est remarquable, sachant que son installation est provisoire. J'ai pu m'y rendre avec Madame la ministre des Armées et constater cette activité. Comment analysez-vous les possibles implications d'un retrait des troupes américaines sur le dispositif français Chammal et la visibilité de la base projetée H5 ?

La France, comme beaucoup de pays d'Europe, était auparavant très influente dans le conflit israélo-palestinien et dans la protection des chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un contributeur à des programmes internationaux et a perdu beaucoup de son influence. Quels seraient pour vous les moyens pour remédier à cette perte d'influence ?

Ma question s'adresse à M. Luizard, notamment sur le parallèle que vous faites entre le Liban et l'Irak. Si l'on revient dix ans en arrière, il me semble que les dynamiques confessionnelles étaient très différentes. Dans votre essai « Le piège Daech », vous montrez bien comment l'émergence de l'État islamique est liée à la marginalisation de la communauté sunnite, au fait qu'elle souffrait démesurément de la corruption, de l'abus de pouvoir, etc. À l'inverse, au Liban, le système confessionnel, le système milicien a, dans une certaine mesure, redonné leur place aux chiites dans le pays, leur a redonné une fierté. Dans une certaine mesure, le système confessionnel politique n'est-il pas nivelant, et n'a-t-il pas paradoxalement tendance à effacer les différences ? Aujourd'hui, je crois que les Libanais souffrent autant, quelle que soit leur confession, du manque de service public, de la corruption et nous sommes dans une situation très différente de l'Irak juste avant l'émergence de l'État islamique.

Alors que le sultanat d'Oman s'est trouvé endeuillé en ce début d'année avec la perte de son chef d'État, le nouveau sultan Haitham bin Tariq souhaite s'inscrire dans la continuité du sultan Qabus en développant une diplomatie neutre et médiatrice dans la région. Le détroit d'Ormuz, zone stratégique frontalière de l'Iran par laquelle transite 25 % du pétrole mondial, et la guerre civile au Yémen, par sa proximité, sont deux enjeux primordiaux pour Oman et pour la stabilité de la région. Aussi, dans ce contexte de montée des tensions, quels sont les défis diplomatiques et géopolitiques auxquels devra se confronter le sultanat d'Oman. Concernant la France, Mme la ministre Florence Parly a tenu à être aux côtés des marins de la frégate Courbet positionnés dans le détroit d'Ormuz le 31 décembre dernier. Par ce geste, elle a réaffirmé la volonté de la France de déployer la mission européenne de surveillance maritime dans le Golfe arabo-persique annoncé fin novembre. Savez-vous comment Oman et les autres pays du Moyen-Orient perçoivent cette initiative européenne visant à sécuriser la navigation dans cette zone ?
Par ailleurs, plus de deux ans et demi après la mise en place de l'embargo contre le Qatar par ses pays voisins, comment la situation évolue-t-elle et pensez-vous que nous allons vers un apaisement et la levée du blocus le mois prochain ?

J'ai une question sur le rôle de l'OTAN dans la région, tout spécialement à la lumière des récentes déclarations du Président Trump. Je le cite : « je pense qu'il faut élargir l'OTAN et nous devons y inclure le Moyen-Orient. » Cela me rappelle une initiative de 2008, qui avait fait long feu à l'époque. Nous avions parlé en 2018 d'une alliance avec les pays de la région, que nous avions appelée officiellement Middle East Strategic Alliance (MESA), avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, Oman, Bahreïn, l'Égypte et la Jordanie. De ce point de vue, j'ai deux questions : quelle est la position américaine ? Est-ce avant tout une question de politique intérieure à visée électoraliste ? Quelles sont les réactions des différents pays de la région par rapport à ces déclarations ? Sont-elles prises au sérieux ? Par quels pays, par quelles communautés ?
Je réagis sur Oman parce que nous en avons peu parlé et que j'ai une carte appropriée pour vous expliquer la situation. Oman est un peu la Suisse de cette région, puisque c'est le pays neutre où nous avons eu les premières discussions entre les États-Unis et l'Iran sur le Joint Comprehensive Plan of Action ( JCPoA ) en 2013, et le sultan Qabus a toujours voulu maintenir cette neutralité. Il va au forum de Doha, alors qu'au Qatar, aucun pays arabe ne veut y aller parce qu'ils ont peur des Saoudiens. Il a toujours réussi à maintenir cet équilibre. C'est la grande force d'Oman et son successeur voudrait poursuivre. Il se méfie beaucoup des Émirats arabes unis, parce qu'ils veulent unifier le sud de la péninsule arabique, faire éclater le Yémen, faire éclater la Somalie pour dominer ces territoires et surtout les territoires portuaires. Les Émirats arabes unis se méfient quant à eux du potentiel portuaire d'Oman, le port de Salalah, qui pourrait concurrencer Jebel Ali. Ils ont cherché à influencer la succession à Oman, ils cherchent à y étendre leur emprise, et c'est le principal défi pour le nouveau sultan d'Oman. Les Saoudiens le soutiennent parce qu'ils ne veulent pas que les Émirats arabes unis prennent trop d'influence dans cette corne. Ils voudraient aussi avoir un accès à l'océan Indien, parce que les débouchés saoudiens sont sur des mers potentiellement fermées, la mer Rouge et le golfe arabo-persique. Cette géopolitique du Golfe d'Aden est importante.
Concernant la mission navale européenne, les pays de cette région préfèrent quand même avoir le soutien des États-Unis. La principale base, la base de Bahreïn, la base au Qatar, la base américaine, représente quand même un déploiement de forces beaucoup plus important que la force européenne. Mais pourquoi pas ? Si nous pouvons monter en puissance et nous installer dans cette région, au même titre que les États-Unis, cela serait bienvenu.
Le blocus sur le Qatar ne me semble pas près d'être levé. Le Qatar finance la Turquie, appuie l'armée turque qui se déploie en Somalie, au Soudan, et a maintenant des ambitions en Libye qui contrecarrent les ambitions des Émirats arabes unis en Libye. Nous assistons à une guerre interne au monde sunnite, entre la Turquie et l'Arabie saoudite. Le Qatar s'est rangé derrière la Turquie pour se protéger de l'Arabie saoudite. Dans le cadre d'une confrontation majeure avec l'Iran, verrait-on le monde sunnite se réunifier ? Pourquoi pas ? Pour l'instant, le monde sunnite est en train de se fragmenter avec la Turquie et l'Arabie saoudite d'un côté, et dans le futur, les Émirats arabes unis vont rentrer dans une confrontation avec l'Arabie saoudite.
Y a-t-il un bon confessionnalisme qui amènerait à un effacement des oppositions entre les communautés, en les protégeant, et un mauvais confessionnalisme qui serait le modèle irakien, le « bon » étant le modèle libanais ? Il y a des différences entre le confessionnalisme politique au Liban et en Irak. Au Liban, il est officiel depuis la Constitution de 1926, dont l'article 75 institutionnalise le confessionnalisme avant le pacte national de 1943. Il y a dix-huit communautés reconnues depuis 1936. Ce n'est pas le cas en Irak. Dans la constitution irakienne de 2005, vous ne trouvez jamais les mots « sunnites » et « chiites ». Les seules communautés qui sont indiquées sont les communautés ethniques arabes et kurdes, et éventuellement les minorités turkmènes, mais rien sur le plan religieux. Pourtant, il y a beaucoup de ressemblances entre les deux systèmes confessionnels. Il y a des communautés qui ne sont pas reconnues au Liban, des nouvelles communautés, comme les évangéliques, qui aimeraient être reconnues. Les alaouites, bizarrement, ne sont pas reconnus non plus, malgré leur influence et malgré le fait qu'ils aient acquis une forme de représentation non-officielle, notamment du fait de leur présence importante à Tripoli. Il ne faut pas croire que la reconnaissance implique un effacement des identités communautaires. C'est le contraire : cela les met en concurrence les uns avec les autres. La meilleure preuve en est l'absence de mariage civil au Liban. Si vous êtes druze et que vous voulez épouser une maronite, vous êtes obligé d'aller à Chypre et les enfants n'hériteront pas parce que les communautés gardent jalousement leur patrimoine. Ceux qui étaient au bas de la pyramide sociale et politique étaient les chiites qui se sont réveillés grâce à un mouvement initié dans les années 70 et à la révolution islamique en Iran. Toutefois, nous ne pouvons pas dire que cela a atténué les rivalités, puisqu'à la rivalité entre chrétiens et musulmans a succédé la rivalité entre chiites et sunnites. Le fait d'être reconnu ne va pas dans le sens d'un effacement des identités. En Irak, la chose est totalement tacite, elle l'est depuis toujours depuis la fondation de l'État irakien. Il faut aller chercher dans le Code de la nationalité irakienne en 1924, pour voir que les chiites étaient considérés comme des citoyens de seconde zone qui devaient demander la nationalité, alors que n'importe quel Arabe sunnite, même s'il n'était pas né en Irak et qu'il n'avait pas la nationalité irakienne, pouvait avoir la citoyenneté parce qu'il était sunnite. Les deux systèmes se ressemblent beaucoup, et les différences ne sont que superficielles.
Le retrait américain n'aura aucun impact sur H5, parce qu'il a lieu en Syrie, pas en Jordanie. Les Américains restent très présents en Jordanie. Ce n'est pas le retrait américain de Syrie qui va influencer la sécurité de la base et du déploiement français H5.
Comment inverser la perte d'influence française au Moyen-Orient ? Tout simplement, en redonnant de la cohérence et de la lisibilité à l'action de la France, et en disant clairement à tous nos partenaires sur les rives nord, sud et ouest, que ce qui doit guider l'intérêt de la France, ce sont d'abord et avant tout les intérêts nationaux et européens. Il faut se prononcer non plus de manière générique, mais plutôt au cas par cas, en identifiant chaque dossier, et en disant : « sur telle affaire, tel dossier, l'intérêt de la France et de l'Europe est de soutenir ceci ou cela, ou d'avoir telle ou telle vision ». En poussant cette idée d'Organisation pour la sécurité et la coopération du Golfe, où tout le monde peut discuter dans le Golfe, je pense que nous y gagnerions vraiment.
Concernant le détroit d'Ormuz, tout le monde dans la région a intérêt à le garder ouvert, à commencer par les Iraniens. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui pourraient être tentés de le fermer sont plutôt les Américains, pour couper les approvisionnements énergétiques de la Chine. Les Iraniens et les pays du Golfe, au contraire, ont tout intérêt à le laisser ouvert, et font passer le message que c'est gagnant-gagnant ou perdant-perdant. Soit le détroit est ouvert pour tout le monde, aussi bien la rive nord que la rive sud, soit, si certains acteurs décident de le fermer, l'Iran prendra les mesures qui s'imposent de son point de vue.
Par ailleurs, l'idée de Donald Trump d'étendre l'OTAN à cette région est à vocation purement interne. Trump dit à son audience politique intérieure qu'elle ne va pas continuer à payer pour la sécurité des autres. Si les autres veulent que les États-Unis restent, il va falloir payer. Nous avons vu récemment les réactions des pays de l'OTAN, dont le Secrétaire général a été très mesuré, disant qu'il ne voulait pas faire la guerre des autres. Si les Américains et les Iraniens ne s'entendent pas, ce n'est pas l'OTAN qui va faire la guerre là-bas pour servir les intérêts américains. C'est très clair. Sur place, je pense qu'il n'y a pas une appétence phénoménale pour l'OTAN. Dans d'autres fonctions, j'ai mis en œuvre ce qu'on appelle l'initiative de coopération d'Istanbul, c'est-à-dire le programme de l'OTAN vis-à-vis des pays du Golfe. Cela n'a jamais suscité une appétence significative. Par contre, les pays du Golfe voient l'OTAN comme un cercle d'échanges et comme un outil d'interopérabilité, mais je pense que cela ne va pas au-delà.
Pour terminer sur la question du nucléaire, l'Iran peut avoir la bombe très vite, mais encore une fois, ce n'est pas leur intérêt. Leur intérêt est de rester en dessous de ce seuil afin de rester dans le système actuel. Les Israéliens et les Américains disent que toutes les options sont sur la table, y compris l'action militaire. Les Iraniens répondent en disant qu'ils ont besoin d'être dissuasifs. Ils demandent qu'on leur laisse une marge défensive et un rôle régional, autrement, ils n'auront pas d'autre choix que de faire la bombe, mais dans ce cas-là, ils peuvent la faire très vite.

Avant de clôturer cette séquence, je tiens à remercier M. Razoux qui nous offre un livre qui, je pense, aura beaucoup d'intérêt pour poursuivre nos travaux et notre réflexion. Il est édité par la Fondation méditerranéenne des études stratégiques, et s'appelle « Quelle(s) stratégie(s) pour la France en Méditerranée ? ».
Merci à vous et nous restons bien évidemment extrêmement vigilants et attentifs à ce qui va se passer dans les prochaines semaines, notamment au Liban.
La séance est levée à onze heures quarante-cinq.
Membres présents ou excusés
Présents. - M. Jean-Philippe Ardouin, M. Didier Baichère, M. Stéphane Baudu, M. Thibault Bazin, M. Olivier Becht, M. Christophe Blanchet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Philippe Chalumeau, M. André Chassaigne, M. Alexis Corbière, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Marianne Dubois, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Olivier Faure, M. Jean-Jacques Ferrara, M. Jean-Marie Fiévet, M. Philippe Folliot, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Thomas Gassilloud, Mme Séverine Gipson, M. Stanislas Guerini, M. Jean-Michel Jacques, M. Loïc Kervran, Mme Anissa Khedher, M. Bastien Lachaud, M. Fabien Lainé, M. Jean-Charles Larsonneur, M. Christophe Lejeune, M. Jacques Marilossian, Mme Patricia Mirallès, Mme Florence Morlighem, M. Jean-François Parigi, Mme Josy Poueyto, Mme Natalia Pouzyreff, M. Joaquim Pueyo, M. Bernard Reynès, M. Gwendal Rouillard, Mme Laurence Trastour-Isnart, M. Stéphane Trompille, Mme Alexandra Valetta Ardisson, M. Pierre Venteau, M. Patrice Verchère, M. Charles de la Verpillière
Excusés. - M. Louis Aliot, M. Florian Bachelier, M. Xavier Batut, M. Sylvain Brial, M. Olivier Falorni, M. Richard Ferrand, M. Laurent Furst, M. Claude de Ganay, M. Fabien Gouttefarde, M. Benjamin Griveaux, M. Christian Jacob, Mme Manuéla Kéclard-Mondésir, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Gilles Le Gendre, M. Franck Marlin, Mme Monica Michel, M. Philippe Michel-Kleisbauer