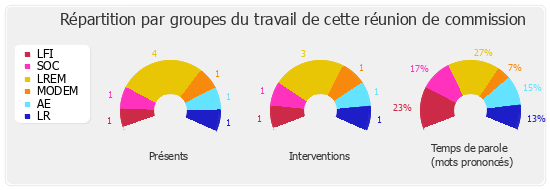Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du mardi 24 mars 2020 à 15h00
Résumé de la réunion
La réunion
La commission entend MM. Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Olivier Garnier, directeur général des statistiques, des études et de l'international de la Banque de France, et Jean Pisani Ferry, sur la situation économique et la conjoncture.

Nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui Jean‑Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE, et Olivier Garnier, directeur général des statistiques, des études et de l'international à la Banque de France, comme tous les trois ou quatre mois, depuis maintenant plus de deux ans, pour évoquer les équilibres économiques et la conjoncture. Les deux institutions, INSEE et Banque de France, ont récemment publié des notes qui permettent d'appréhender de façon plus précise la reprise d'activité au cours du premier trimestre 2021. La Banque de France table sur une croissance annuelle de l'ordre de 5,5 points en 2021, sous toute réserve relative aux incertitudes et aux aléas d'un tel exercice dans le contexte actuel.
Je remercie également, pour sa présence, Jean Pisani-Ferry, qui a publié, le 12 mars dernier, avec Olivier Blanchard, une note pour le Peterson Institute explorant les implications économiques d'une persistance de la crise sanitaire, des restrictions à la circulation internationale et des reconfinements périodiques, soit la situation que nous vivons aujourd'hui. Ils ont notamment mesuré l'effet sur l'économie des confinements mis en place dans sept pays européens, lors des deux phases du printemps et de l'automne 2020. Il apparaît, de façon encourageante, que le choix, lors de la deuxième vague, de mesures aux conséquences économiques moins lourdes que lors de la première, n'en a pas réduit l'efficacité sur la propagation de l'épidémie.
Les questions posées par la lenteur à atteindre l'immunité collective, que ce soit par la vaccination ou par la contamination, sont nombreuses. Quels sont les scénarios actuels de sortie de crise ? Quelles sont les conséquences à terme pour le PIB, la production de richesses et la façon dont nous les produirons ? Quelles sont les implications en termes de politique économique et de politique monétaire, cette dernière ayant déjà été très sollicitée ?
D'un point de vue plus prescriptif, les règles européennes du pacte de stabilité et de croissance, qui atteignaient leurs limites dans ce contexte de crise, ont été suspendues et le resteront sans doute encore un certain temps.
J'évoquerai d'abord la conjoncture immédiate. Olivier Garnier, qui réalise des prévisions à l'échelle du système européen de banque centrale, élargira le propos. Jean Pisani-Ferry a préparé un exposé des travaux que vous avez mentionnés, monsieur le président.
Nous avons effectivement publié une note de conjoncture le 11 mars dernier, indiquant que le recul du PIB, estimé par l'INSEE dans sa première prévision, le 26 mars 2020, à -35 %, s'était limité à -30 % lors du premier confinement. L'ordre de grandeur restait correct.
Un an après l'entrée en confinement, j'ai souhaité introduire cette note par un éditorial, qui rappelle la nécessité toujours prégnante de s'interroger sur l'évolution de la situation sanitaire et les conséquences des mesures de restriction d'activité et de mobilité. Nos prévisions de décembre ont été obsolètes dès l'apparition du variant anglais. Dans ce contexte, l'enjeu est d'effectuer la mesure la plus rapide possible des évolutions de l'activité, de la consommation et de l'emploi, dans un mode nowcasting, et de la prioriser par rapport à la prévision, qui attire l'attention médiatique mais reste extrêmement fragile dans l'attente de l'immunité collective et du retour à des comportements économiques habituels. Aujourd'hui, l'évaluation de la consommation s'appuie davantage sur l'analyse des mesures administratives limitant l'accès aux commerces que sur l'observation de l'arbitrage entre la consommation et l'épargne. Nous continuons à exploiter les sources de données à haute fréquence, l'enjeu étant de dépasser le niveau macroéconomique pour parvenir au niveau microéconomique et à la situation financière des entreprises.
L'INSEE s'intéresse par ailleurs à l'augmentation éventuelle des inégalités, au travers de la moyenne d'évolution du revenu des ménages, et à l'apparition de poches de nouvelle précarité, en s'appuyant sur des données originales.
Pour réaliser ses analyses conjoncturelles, l'INSEE raisonne en économie fermée et s'attache à déterminer quelle sera l'évolution de chaque secteur en fonction des mesures appliquées dans le pays, en se posant peu de questions sur les liens avec les autres États. L'objectif de réinvestir le sujet de l'économie internationale se rapproche cependant, en particulier avec le déploiement du plan de relance de Joe Biden, qui pourrait initier une remontée de l'inflation, avec ses conséquences sur les taux d'intérêt.
En 2020, une chute de 8,2 % du PIB a été enregistrée en France. Elle a été supérieure en Espagne, mais moindre en Allemagne et aux États-Unis. Elle s'avère très liée à la consommation, c'est-à-dire qu'elle a été provoquée par l'empêchement de consommer de façon normale. L'indicateur relatif à la consommation publique révèle l'hétérogénéité des mesures de l'activité réalisées par les différents instituts statistiques. Si, parmi les pays de l'hémisphère ouest, la France enregistre la plus forte contribution négative du commerce extérieur à son activité, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne se trouvent dans des situations similaires. Seul le Royaume-Uni échappe à ce constat.
La fréquentation des commerces établie à partir des indicateurs de Google mobility montre l'impact des confinements.
Le trafic des poids lourds et de l'ensemble des véhicules a connu une forte baisse au premier confinement. Lors du second épisode, cette chute s'est reproduite pour les déplacements des particuliers, tandis que le trafic des poids lourds se maintenait ; même sa traditionnelle décrue au moment des fêtes de fin d'année s'est effectivement manifestée. À fin février 2021, le fret routier se révèle plus important qu'avant la crise sanitaire, la circulation générale apparaissant proche de son niveau de début 2020. Ce constat atteste une certaine résilience, qui ne transparaît pas dans l'analyse du climat des affaires. Cette dernière montre la persistance d'un pessimisme dû à l'incertitude à laquelle doivent faire face les entreprises.
Selon les données annuelles entre 2007 et 2020, la crise financière de 2009 a fortement affecté le climat des affaires dans l'industrie et encore plus dans les services. La courbe le représentant, dans sa période récente, épouse de façon très nette les épisodes de confinement et déconfinement, pour ce qui concerne les services, alors que la remontée est plus tendancielle s'agissant de l'industrie, avec des secteurs affichant davantage de difficultés, comme les matériels de transport et en particulier l'aéronautique.
Dans les services, l'effet des mesures de restriction se manifeste de façon importante sur le secteur de l'hébergement et de la restauration, tandis que celui de l'information et de la communication conserve un bel essor. Une forte hétérogénéité sectorielle est constatée, même si elle s'atténue à certaines périodes.
Mes équipes, dans leurs commentaires, insistent beaucoup sur la combinaison de signes de lassitude et de résistance, ou de résilience, que traduisent les données, la détérioration des perspectives d'emploi constituant un motif important de découragement. L'irruption du variant anglais a par ailleurs suscité un fort retournement des perspectives dans les secteurs les plus sensibles.
En réponse à une question qui leur a été posée à deux reprises depuis octobre 2020, trois entreprises sur dix considèrent que les mesures sanitaires affectent leur productivité. Ce point est très intéressant pour l'avenir : si ces mesures deviennent des habitudes, plusieurs secteurs, dont celui de l'industrie manufacturière, des services et du bâtiment estiment qu'elles auront un effet négatif sur la croissance, même si ce dernier pourrait s'atténuer au fil des mois.
S'agissant des signes de résistance, les revenus sont préservés, la consommation s'adapte et l'investissement semble avoir résisté. L'évolution des créations d'entreprises atteste la capacité d'adaptation de l'économie, même si une chute vertigineuse s'est manifestée au premier confinement et, dans une moindre mesure, au deuxième. Actuellement, cet indicateur atteint des niveaux records. Les créations de microentreprises demeurent très nombreuses dans les secteurs les plus affectés par les mesures sanitaires. Pour la France en un mois, elles ont représenté des volumes de 3 500 pour l'hébergement et la restauration, et de plus de 11 500 pour la livraison à domicile (10 000 créations mensuelles depuis plusieurs mois dans ce dernier secteur).

La chute vertigineuse évoquée s'est-elle produite au premier confinement ? Le graphique présenté s'étend de janvier 2019 à février 2021.
Le creux de la vague a été enregistré en avril 2020. Nul ne souhaitait créer d'entreprises dans le contexte. Par ailleurs, les greffes et les différents réseaux administratifs étaient fermés. Dans les secteurs que j'ai mentionnés, le retournement de tendance excède le niveau du rattrapage. L'économie s'adapte donc à la demande.
S'agissant de la consommation, la métrique utilisée pour établir des comparaisons avec la période précédant la crise montre que le niveau de cette période avait été retrouvé dès l'été 2020, avant de subir une nouvelle baisse en novembre. Pour le premier trimestre 2021, qui aura été peu impacté par les nouvelles restrictions, la croissance était attendue à 1 %. Le PIB devait s'établir 4 % en dessous de son niveau avant la crise, à un montant à peu près similaire à celui de l'été 2020, du fait de la conjugaison de résultats satisfaisants dans le secteur industriel et de la poursuite des difficultés pour les secteurs de l'hébergement, de la restauration et de l'événementiel.
Nous prévoyions, avant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures, une augmentation de 1 % du PIB pour le deuxième trimestre, qui aurait suscité un acquis de croissance de 5,5 % à l'issue du premier semestre 2021. L'objectif de 6 % fixé par la loi de finances initiale pour 2021 restait accessible.
Après plusieurs mois d'inflation nulle, nous constatons qu'elle devrait atteindre, voire dépasser 1 %, en raison de la hausse des prix de l'énergie, dont ceux du pétrole. Le pouvoir d'achat des Français a légèrement augmenté en 2020 (+ 0,6 %), alors que le PIB baissait de 8,2 %. Les impacts de la crise sont supportés en premier lieu par les administrations publiques, puis par les entreprises, alors que les ménages ne la subissent pas. Cette configuration se maintiendrait au deuxième trimestre 2021.
Les indicateurs permettant de juger de l'effet favorable des soldes montrent un dynamisme bien moindre, surtout la première semaine, que les années précédentes. Ce constat atteste de la position entre lassitude et résistance qu'affichent les consommateurs.
Si la moyenne d'augmentation du pouvoir d'achat s'établit à 0,6 %, certains Français ont gagné davantage, tandis que l'écart entre ces derniers et ceux qui ont perçu un moindre revenu pourrait avoir augmenté. Pour analyser et vérifier cette conjecture, nous avons utilisé une étude de données réalisée sur des échantillons de clients du Crédit Mutuel, qui ne sont pas nécessairement représentatifs de la population française. Cette étude montre que la consommation a baissé en 2020, à toutes les échelles de revenus. La diminution a cependant été plus importante pour les plus hauts revenus, qui subissent plus les contraintes relatives au secteur de l'hébergement et la restauration, aux voyages, etc. Les revenus ayant eux-mêmes peu baissé, le patrimoine, soit les encours financiers, a augmenté pour ceux qui en disposent le moins comme ceux qui affichent le plus élevé. Le nombre de ménages en surendettement, selon les normes de la Banque de France, a baissé. Enfin, comme le confirme la BNP, la proportion de comptes de particuliers à découvert a diminué par rapport à la situation d'avant la crise, et ce quel que soit le revenu et quel que soit l'âge.
L'hypothèse que cette légère hausse du pouvoir d'achat des ménages cache des situations individuelles difficiles ne parvient pas à être clairement établie. Un travail est engagé avec la Banque Postale, qui accueillerait davantage de clients concernés, sachant que les cas les plus dramatiques sont ceux de personnes non bancarisées. Il reste difficile d'établir qu'une population importante aurait basculé dans la pauvreté.
Nous avons présenté, il y a une quinzaine de jours, dans le cadre des prévisions de l'Eurosystème, une actualisation de nos projections pour la France à l'horizon 2021-2023. Elles datent d'avant les dernières restrictions sanitaires annoncées par le Gouvernement. Elles étaient plus prudentes que celles présentées par l'INSEE dans sa note de conjoncture (5,5 % d'acquis de croissance à mi-année) ou par l'OCDE, car l'hypothèse, partagée avec les instances européennes, avait été de prévoir un maintien à l'identique des mesures sanitaires durant tout le premier semestre 2021. Nous prévoyions ainsi une croissance un peu supérieure à 0 % plutôt que de 1 % pour chacun des deux premiers trimestres 2021.
Les données constatées aujourd'hui, en matière de production industrielle, pour janvier et février s'avèrent légèrement au-dessus des attentes, ce qui nous conduit à maintenir notre prévision de 5,5 % de croissance, sachant que les dernières marches sont toujours les plus lentes à franchir. Même si nous sommes parvenus dès janvier et février 2021 à 95 % ou 96 % du niveau d'activité d'avant la crise, nous ne parviendrons au niveau 100 qu'au printemps 2022.
La Banque centrale européenne a publié, en lien avec les banques centrales nationales, ses prévisions d'augmentation du PIB pour la zone euro, soit 4 %, 4 % et 2 % pour les trois années à venir. La Banque de France table sur des évolutions de 5,5 %, 4 % et 2 %. Les taux de croissance sont toujours un peu trompeurs dans un tel contexte. La France a enregistré une plus forte chute du PIB (– 8,3 %) que la moyenne de la zone euro (– 7 %). Le rebond à partir d'un niveau plus bas explique l'atteinte de 5,5 % en 2021. Les courbes d'évolution des PIB des deux périmètres restent de fait similaires, sachant que les mêmes hypothèses ont été retenues concernant les mesures sanitaires entre la France et la zone euro, même si des écarts subsistent entre pays au sein de cette dernière.
S'agissant de l'emploi, les projections ont fait l'objet de révisions sensibles par rapport à la présentation de fin 2020, alors que le caractère atypique de l'ajustement de cette variable se confirmait. L'emploi salarié a de fait très peu baissé par rapport à la chute du PIB, durant l'année 2020, manifestant ainsi une réaction inhabituelle à la chute de la production. L'ajustement s'est effectué au niveau du nombre d'heures travaillées, qui a davantage diminué que la valeur ajoutée. Le niveau d'emploi restera donc stable en 2021. Le rétablissement, qui n'est à espérer qu'à partir de 2022 ou 2023, s'opérera par la remontée du volume des heures travaillées. L'incertitude perdure sur la mesure réelle du taux de chômage dans des périodes où il est difficile d'identifier la population à la recherche d'un emploi. L'évolution de ce taux s'avère donc atypique pour 2020.
Si les taux d'activité et les comportements relatifs à la recherche d'emploi redevenaient plus normaux, le taux de chômage plafonnerait à 9,5 % en 2021, à un niveau sensiblement inférieur à celui prévu dans les précédentes projections. Ce constat est entaché de fortes incertitudes, mais il faut néanmoins s'attendre à une hausse du taux de chômage.
Le scénario favorable, qui mise sur une levée des restrictions sanitaires dès le printemps, aboutirait à l'atteinte d'un PIB identique à celui datant de la pré-crise, avant même la fin d'année. Le scénario « sévère » parie sur un maintien des mesures jusqu'en 2022. Le scénario central, soit celui présenté, s'appuie sur une levée progressive de ces dernières au cours du deuxième semestre de 2021 et un retour à la normale début 2022, avec la généralisation de l'immunité, évoquée par le président Éric Woerth en début de séance.
S'agissant du volet financier, le surplus d'épargne financière, qui fait couler beaucoup d'encre, correspond à la part d'épargne après investissement immobilier, comparée à celle qui aurait été réalisée si les revenus et les dépenses des ménages avaient crû selon la tendance antérieure. À fin 2020, il est estimé à 110 milliards d'euros. Il devrait atteindre 160 milliards d'euros à fin 2021, l'accumulation ayant conservé un rythme inhabituel, mais de façon plus modérée. La stabilisation n'interviendrait qu'à partir de 2022, avant de commencer à diminuer. Cette donnée a été révisée, car les premières projections pariaient sur 200 milliards d'euros.
Ce surplus d'épargne des ménages ne doit pas être confondu avec l'épargne nationale, qui tient compte aussi des réserves des administrations publiques et des entreprises. Si les capacités de financement des ménages se sont accrues, car leurs revenus ont en moyenne été préservés, l'épargne des autres secteurs institutionnels a diminué. Les administrations publiques et, dans une moindre mesure, les entreprises ont dû s'endetter pour verser les salaires des ménages. La capacité de financement du reste du monde a augmenté, c'est-à-dire que l'ensemble des secteurs domestiques affichent un déficit par rapport à ce dernier. En 2020, la France a davantage dépensé qu'elle n'a perçu. Ses dépenses ont moins baissé que ses revenus.
Le surplus d'épargne ne concerne donc pas l'ensemble des secteurs de l'économie. La part engendrée par les ménages se révèle la contrepartie comptable du déficit des administrations publiques. Cette affirmation est illustrée par les données de la balance des transactions courantes, qui constitue la différence entre l'épargne nationale et l'ensemble de l'investissement public et privé. Alors que la baisse du prix de l'énergie aurait dû permettre une amélioration de notre solde extérieur, notre déficit, surtout hors énergie, a atteint un niveau record, jamais constaté durant les vingt dernières années. Il est donc faux d'affirmer que l'épargne est trop importante, puisque nous devons faire appel au reste du monde pour financer nos dépenses.
L'épargne des ménages prend principalement, pour l'instant, la forme de dépôts bancaires. Les flux les alimentant représentaient 80 milliards d'euros en 2019. Ils ont atteint 150 milliards d'euros en 2020, pour tous les types de dépôts, y compris le livret A. Cette épargne finance directement ou indirectement les prêts garantis par l'État et l'endettement public.
S'agissant de l'épargne non bancaire, les flux nets sont négatifs vers les fonds d'assurance vie en euros (‑ 2 milliards d'euros, contre 40 milliards d'euros en 2019), tandis qu'un mouvement inverse se manifeste sur les fonds d'assurance vie en unités de compte (17 milliards d'euros, contre 2 milliards d'euros en 2019). De la même façon, les OPCVM (placements en actions) ont vu les montants nets souscrits passer de - 3 milliards d'euros en 2019 à + 11 milliards d'euros en 2020, les autres placements ayant aussi connu une augmentation. L'épargne non bancaire a davantage été dirigée vers les placements en fonds propres que vers les placements de taux.
S'agissant des entreprises, une très forte augmentation de la dette se confirme, tant sous forme de crédits bancaires qu'auprès des marchés. Cette dette a crû de 12 % et de près de 220 milliards d'euros en 2020. La trésorerie des entreprises a augmenté dans le même temps de façon similaire (204 milliards d'euros). La croissance de la dette nette est donc limitée à environ 15 milliards d'euros, sachant que cet indicateur financier ne prend pas en compte les reports d'échéances fiscales ou sociales.
En lien avec l'INSEE, nous menons des travaux pour estimer à un niveau plus microéconomique la répartition des dettes et de la trésorerie. Les entreprises qui se sont le plus endettées ne sont peut-être pas celles qui ont accumulé le plus de trésorerie, même si cette dernière a pu être augmentée par le recours aux PGE. Ce dernier a constitué une précaution pour faire face à la crise. La dette a peu augmenté dans les activités immobilières et le service aux entreprises. En revanche, elle a crû de 40 % dans le domaine de l'hébergement et de la restauration, qui se trouve dans une situation très particulière.
Selon les réponses à notre enquête mensuelle de conjoncture auprès des entreprises, les dirigeants de l'industrie considèrent favorablement leur trésorerie, qui serait revenue au niveau atteint avant la crise. En revanche, dans les services marchands, l'opinion générale est que la situation est moins satisfaisante que la moyenne de longue période ou que la position avant la crise. Le secteur de l'hébergement et de la restauration est celui où cette perception est la plus négative.
En tant que banque centrale, nous suivons de près la situation sur les marchés obligataires internationaux. L'évolution des emprunts d'État à dix ans aux États-Unis révèle, depuis fin novembre, un phénomène qui s'accentue : la remontée des taux américains de 0,5 % à plus de 1,5 %, soit une hausse de plus de 100 points de base, liée à l'annonce du plan Biden. Cela pourrait s'accompagner de pressions inflationnistes suscitées par une forte relance de la demande, alors que l'offre resterait contrainte.
Dans la zone euro, hormis en Italie, une très légère remontée des taux est constatée, sans commune mesure avec celle constatée outre-Atlantique. Le risque d'inflation n'est pas du tout identique. Comme l'a rappelé, il y a quinze jours, le Conseil des gouverneurs, l'objectif de la politique monétaire est de maintenir des conditions de financement favorables, d'où le renforcement du programme d'achat d'actifs d'urgence, par rapport au début d'année. Les taux restent très bas, au niveau atteint avant la crise.
Je m'inscris dans la continuité des présentations déjà effectuées. J'apporterai quelques éléments complémentaires, permettant une mise en perspective.
Le travail qui a été réalisé par l'INSEE durant cette crise, si nous le comparons à celui effectué par d'autres instituts statistiques, à quelques exceptions près, est tout à fait remarquable. Pendant très longtemps, nous n'avons disposé d'aucune visibilité au niveau européen. L'INSEE a très vite opté pour un changement de méthode et de perspective, afin de se focaliser sur le nowcasting. La Banque de France a contribué à cet apport, à l'instar des autres banques centrales, qui ont généralement été réactives.
Je m'appuie sur les comptes trimestriels publiés depuis 1946 par l'INSEE. L'évolution du taux de croissance trimestrielle du PIB donne la mesure de ce que nous sommes en train de vivre, par rapport aux grands événements du passé. La crise financière a été d'un faible impact, de même que le choc pétrolier, quoique de façon un peu plus marquée. En revanche, la situation de mai 68 a eu des répercussions sur ce taux de croissance. Dans son évolution récente, la courbe montre l'extrême volatilité de la situation actuelle, qui n'a pas de précédent dans le passé dont nous avons la trace.
Un autre prisme est donné par la façon dont les États-Unis ont vécu la crise, sans déploiement d'un dispositif de chômage partiel. Les salariés se sont donc inscrits au chômage, ce qui est attesté par le pic des entrées dans ce régime au printemps 2020, à hauteur de 7 millions de personnes en un mois. Ce constat sans précédent donne la mesure de ce que nous avons évité en optant pour le chômage partiel.
Aux États-Unis, alors que les entreprises ont ajusté leurs effectifs, le constat est que l'évolution de l'emploi a impacté les trois strates de revenus (bas, moyens et hauts), mais de façon plus prononcée les bas salaires. La baisse a atteint -20 % pour ces derniers, -6 % pour les salaires moyens et +1 % pour les hauts salaires. Ces données brutes donnent une idée de la nature du choc que nous sommes en train de vivre. Un des points marquants est que l'impact a été plus important pour les emplois à bas salaires des bassins accueillant les ménages aux revenus les plus élevés, car les consommations de service de ces derniers ont été revues à la baisse, avec des répercussions immédiates sur l'emploi.
Je vous présente, au regard de la courbe d'évolution du PIB, présentée par Jean‑Luc Tavernier afin d'évaluer l'impact direct de la crise sanitaire et des restrictions, le graphique que j'ai construit avec Olivier Blanchard reprenant l'indice de restrictions sanitaires créé par l'université d'Oxford (qui tente de mesurer, pour l'ensemble des pays, le degré de restrictions introduits par les confinements, les fermetures administratives, etc.) ainsi que la mesure du PIB, réalisée par l'OCDE sur une base hebdomadaire.
Cette deuxième mesure du PIB s'avère moins fiable que celle de l'INSEE, mais offre des points de comparaison internationale. Le PIB a chuté lors de la mise en place des restrictions sanitaires et s'est redressé quand elles ont été assouplies. Leur redéploiement à un niveau très élevé, même si moindre qu'à l'origine, ne s'est pas traduit par une baisse aussi importante de l'activité économique.
Notre objectif étant d'obtenir de notre étude des enseignements pour la gestion de l'arbitrage entre santé et économie, il nous a paru intéressant de « court-circuiter » les mesures de restrictions et de nous attacher aux indicateurs relatifs à la contamination (le R effectif) et à l'activité économique. Le R effectif est le nombre de personnes qu'un malade de la Covid-19 contamine. Il était de 3 avant l'apparition du variant anglais, en l'absence de réelle mesure. Nous l'avons fait baisser en dessous de 1, niveau auquel il doit rester pour éviter une augmentation des cas et des hospitalisations. Le R effectif peut être observé à partir de séries publiées ou calculé à partir des hospitalisations, qui constituent un bon indicateur, même si retardé, des contaminations. Le R effectif estimé à 3 au début du premier confinement est descendu à 0,7 après les premières semaines. Sa baisse a été obtenue au prix d'une chute de l'activité économique de 30 %. En revanche, le relâchement des restrictions n'a pas conduit à son augmentation, alors que l'activité économique se relevait. La courbe présentant en ordonnée le R effectif et en abscisse le PIB a donc adopté la forme d'un L.
Lors du deuxième confinement, le R effectif a baissé de 1,4 à 0,7. Il a ensuite remonté de façon assez rapide.
Pour la France, alors que le premier confinement avait été très coûteux, le deuxième a permis de contraindre autant le R effectif à un coût économique bien moindre. Le relâchement des contraintes a été rapide, probablement trop rapide, mais le niveau de transmissibilité du virus semblait suffisamment faible pour l'autoriser. Nous aurions pu maintenir cet état, compte tenu de son coût économique, pour réduire sensiblement la contagion.
L'exercice conduit pour sept pays européens, le Royaume-Uni étant exclu pour cause de variant anglais, amène les remarques suivantes : la France a été, avec l'Italie, l'Espagne et le Portugal, parmi les pays pour lesquels le coût économique de la réduction du R effectif a été le plus élevé. En Autriche, en Allemagne et au Danemark, sa baisse a été sensiblement moins coûteuse. Ces pays ont subi des vagues moins fortes, qui leur ont permis de prendre des mesures plus limitées, sans risquer la thrombose complète de leur système hospitalier. Dès cette période, cependant, il est apparu que les contaminations pouvaient être réduites à un coût économique moindre.
L'observation des données pour le deuxième confinement montre l'absence totale de différence entre les pays. L'arbitrage entre santé et économie a été unifié, chaque gouvernement ayant appris de l'expérience, même si des différences persistent sur des points de détail. Le R effectif est descendu partout à 0,7 ou 0,8, pour une réduction du PIB de 5 % à 10 %.
J'aimerais maintenant évoquer le contexte actuel et les perspectives en fonction des différents scénarios sanitaires. La situation que nous connaissons est difficile à analyser, car nous faisons habituellement face à des chocs très macroéconomiques, qui se caractérisent par des impacts sur l'offre, du fait d'un ralentissement de la productivité ou d'une variation des prix de l'énergie, ou sur la demande, dans un contexte de récession internationale. Le constat actuel est moins tranché, puisque se conjuguent des effets sur l'offre et la demande, avec des secteurs à l'arrêt qui génèrent des contraintes d'offre pour les secteurs avals et des contraintes de demande pour les secteurs amont, tandis qu'ils suscitent des baisses d'emploi et de revenus.
Ces problèmes intersectoriels sont liés à l'hétérogénéité du choc. Cette dernière peut être mesurée par les données du système de statistiques publiques, en l'occurrence du ministère du travail. L'activité des entreprises est estimée via une enquête mensuelle auprès de ces dernières, selon qu'elle ait été arrêtée ou très fortement diminuée (de plus de 50 %), réduite de moins de 50 %, maintenue ou augmentée.
Les entreprises dont l'activité est considérée comme à l'arrêt ou quasi à l'arrêt ne représentent aujourd'hui plus que 2 % à 2,5 % de l'emploi, alors que 6 % sont considérées comme violemment affectées. Davantage d'entreprises connaissent une baisse de leur activité, qui n'excède cependant pas 50 %. La principale contrainte rapportée par ces dernières relève de la demande et du débouché, mais aussi des fermetures administratives, et ce bien avant les difficultés de main-d'œuvre et d'approvisionnement.
Une forte hétérogénéité est constatée entre les secteurs et à l'intérieur de ceux-ci. S'agissant des entreprises de l'hébergement et de la restauration, sans surprise, un bon tiers a vu son activité arrêtée et beaucoup l'ont vue fortement diminuer. Pour plus d'un quart, la réduction n'a pas atteint 50 %. Pour le reste, elle est demeurée inchangée, voire a augmenté.
Le premier scénario mise sur un retour à la normale un peu plus laborieux que ce qui était anticipé l'été dernier ou même fin 2020. Le diagnostic que nous pouvons faire est que notre potentiel de production a été faiblement entamé, même si certaines entreprises connaissent d'importantes difficultés et que des effets sectoriels perdureront. Cependant, en comparaison avec les conséquences de la crise financière, nous ne constatons pas les dommages profonds qui expliquaient la durée moyenne de sept ans nécessaire pour revenir au niveau d'activité antérieur. Un certain nombre d'indicateurs montrent la très forte résilience et l'adaptabilité des entreprises à la situation. Leur investissement a ainsi très vite retrouvé un niveau satisfaisant après le premier semestre 2020.
À mon avis, dans ce type de situation, il faut donner toute leur chance à ces capacités de rebond. Il serait difficile de se satisfaire d'un retour au niveau d'avant la crise au deuxième trimestre 2022. La levée des contraintes sanitaires et l'obtention à l'été d'une situation plus normale doivent conduire à une accélération de la reprise de l'activité. L'objectif est d'éviter que des dommages temporaires deviennent permanents. Il faut au maximum donner à l'économie la capacité de fonctionner à fort régime.
Je ne plaide pas en faveur du plan Biden, qui me semble extravagant. Le revenu des ménages américains, en données mensuelles et dollar courant, a augmenté, et de façon forte, durant la crise. Faute de dispositifs sociaux suffisamment ciblés, l'administration Trump a déversé de l'argent vers les ménages. L'administration Biden opérera de même. En contrepartie, le taux d'épargne a crû, près de deux fois plus qu'en Europe.
Je plaide en faveur d'un retour le plus rapide possible au niveau d'activité d'avant crise ou du rattrapage du terrain perdu. D'un point de vue macroéconomique, une telle volonté doit se manifester par un soutien monétaire et budgétaire suffisant, sans tomber dans les excès américains, et par le support des entreprises viables, même s'il est difficile de les identifier précisément, compte tenu de leur hétérogénéité. L'idée est de permettre à ces entreprises, qui émergent de la crise avec un très fort taux d'endettement, de se décharger d'une partie de leur dette.
Une stratégie qui viserait à minimiser le coût de la reprise pour les finances publiques ne serait donc pas adéquate, au regard de celle qui débarrasserait rapidement les entreprises d'une dette excessive. Nous disposons d'outils, via le PGE, la dette sociale (qui représente un point de PIB) et la dette fiscale. Un tri doit être effectué entre les entreprises qui ne sont pas viables et devront cesser leur activité et les entreprises dont le modèle économique n'est pas remis en cause, mais qui affichent une dette excessive.
Les prêts participatifs sont une modalité disponible. Ils ne doivent cependant pas susciter le report du problème. Certaines situations méritent d'être prises en charge.
Le second scénario, qui n'est pas à mon avis le plus probable, explore une situation sensiblement moins favorable, tant en termes sanitaires qu'économiques, avec le maintien d'un certain nombre de restrictions, dont celles affectant les voyages internationaux. De fait, pour transporter les marchandises, les contacts interpersonnels peuvent être très réduits. Le commerce international peut perdurer. Il a d'ailleurs très bien rebondi dans cette crise. En revanche, la gestion de chaînes de valeur internationales, le marketing et l'organisation de la production peuvent difficilement se passer de relations interindividuelles.
L'examen d'un certain nombre d'expériences de l'histoire, comme les périodes d'allègement ou de durcissement d'accord des visas, montre un impact sur le commerce des biens. Cela signifie que l'économie paiera le prix en matière d'efficacité, à terme, de la persistance des contraintes sur les voyages internationaux. Le travail devra par ailleurs être réalloué, dans une plus forte proportion, de certains secteurs vers d'autres. Il ne sera plus possible de compter sur un redémarrage de l'activité dès la levée des restrictions.
Nous pourrions accentuer l'effort de formation des salariés et la préparation de certaines réallocations. L'enquête auprès des entreprises, diligentée par le ministère du travail, montre que 66 % des salariés en chômage partiel en janvier 2021 n'étaient pas en cours de formation, sachant que ce pourcentage peut être revu à la hausse, puisque 17 % des personnes interrogées ne connaissaient pas la situation desdits salariés. Cette statistique n'est pas satisfaisante, qu'elle concerne la formation en vue d'améliorer ses compétences, tout en restant dans l'entreprise, ou un cursus permettant de changer d'établissement ou de branche. Ce volume devra augmenter si nous devons faire face à un scénario de crise sanitaire persistante, avec comme corollaire davantage de réallocations.
Ce scénario moins favorable, s'il n'est pas le plus probable, est possible. Nous devons donc commencer à réfléchir aux réponses qu'il faudrait apporter.

Je vous remercie pour ces exposés passionnants. Pour rebondir sur vos derniers propos relatifs à la formation, que je partage totalement, l'effort doit être consenti, y compris dans le cadre du premier scénario, compte tenu de l'hétérogénéité de la reprise en fonction des secteurs, certains ayant plus souffert que d'autres.
Comme vous l'avez indiqué, il s'agit de focaliser notre aide sur les entreprises viables, même si le tri est complexe. Mettre l'accent sur la formation est fondamental. Dans le secteur de l'hébergement et de la restauration, certains salariés, et souvent les plus investis, commencent à s'interroger sur leur avenir et se réorientent vers d'autres domaines. Ils ont à cet égard besoin de formations. La migration qui en résultera participera à l'affaiblissement des secteurs les plus touchés, qui mettront plus de temps à retrouver leur niveau de développement antérieur à la crise.
S'agissant de l'endettement, vous semblez dire, en particulier à la Banque de France, qu'il n'est pas aussi important que nous le croyions et qu'il ne constitue pas un point d'inquiétude vis-à-vis de la reprise. Cependant, les échéances sociales et de loyer ont été reportées, tandis que des prêts bancaires étaient accordés. Pourrions-nous revenir sur cette question ?
Depuis près d'un an, les salariés sont incités à intervenir en télétravail, malgré tous les problèmes constatés. Un rapport peut-il être établi entre ce mode d'intervention et la productivité ?
Vous n'avez pas abordé le pacte de stabilité et de croissance. Ses critères devront probablement être modifiés. Quels principes devront être retenus ?
Enfin, le caractère international de la reprise est fondamental. Cependant de fortes tensions politico-économiques se manifestent, en particulier depuis le changement de l'administration américaine, alors que la Chine adopte une position plus stricte, que l'Europe manifeste une certaine dispersion. La reprise ne pourrait-elle intervenir en ordre dispersé, les pays européens cédant à des tentations différentes sur le sujet ? Les difficultés se présentent déjà pour la mise en place d'un mécanisme carbone aux frontières. Les tensions peuvent-elles freiner la reprise européenne ?
Je remercie les trois intervenants pour leurs présentations extrêmement complètes et très complémentaires. S'agissant du redémarrage des activités par secteur, présenté par Jean Pisani-Ferry, j'aimerais évoquer les propos de certains syndicats patronaux, comme le MEDEF, qui a estimé en début d'année que 85 % de l'activité avait repris normalement, tandis que 15 % des entreprises connaissaient des difficultés ou un freinage et qu'une très petite part avait bénéficié des effets de la crise. Les informations transmises par monsieur Pisani-Ferry semblent montrer qu'une proportion plus forte d'activité est contrainte par la situation. Un tiers de l'économie serait encore très freiné par les restrictions administratives.
Les informations auxquelles vous faites allusion concernent les entreprises en baisse d'activité et non celles connaissant une situation normale. Mes constats ne sont donc pas incohérents avec ceux du MEDEF.
Pourriez-vous préciser très concrètement par quels types d'investissements publics l'accélération de la relance et de la reprise peut être soutenue, sans opter pour un plan similaire à celui mis en œuvre aux États-Unis ? Que faudrait-il engager comme actions supplémentaires par rapport à celles déjà initiées ?
S'agissant du taux de chômage, d'après la présentation de la Banque de France, je comprends qu'il manifeste une tendance pas trop négative, même si une remontée doit être attendue dans les prochains mois. Disposez-vous des estimations par secteurs ?
Cette question en amène une autre, relative à la formation, sur l'anticipation possible des mouvements inter-secteurs, du fait tant de salariés pouvant changer de secteurs que de types d'activités redémarrant plus vite que d'autres. Comment peut être déclinée la hausse du taux de chômage, puis sa stabilisation aux alentours de 9 %, secteur par secteur ? Un lien peut-il être établi entre cette donnée et les niveaux de trésorerie constatés, tant dans l'industrie que dans les services ? L'évolution de ces niveaux pourrait-elle préfigurer une variation du taux de chômage, sachant que la masse salariale constitue une variable d'ajustement en cas de difficultés de trésorerie ?
Sur le sujet de l'épargne financière, il est très intéressant de distinguer celle des ménages de celle des SNF et des administrations publiques, qui semblent « fonctionner en miroir ». Quelles conséquences peuvent être attendues sur certains actifs ? La création monétaire liée à la crise a-t-elle pour effet le gonflement de bulles d'actifs ? Les constats relatifs à la sur-épargne américaine laissent-ils présager, par effet de contagion, les mêmes phénomènes en Europe et en France, en particulier concernant la bulle immobilière ?
De manière générale, pourriez-vous décrire l'influence que pourrait avoir l'international, et en particulier le plan Biden et la reprise chinoise, sur notre propre économie ?
Pour compléter les propos du président Éric Woerth sur le pacte de stabilité et de croissance, vous êtes-vous positionnés sur les nouvelles règles de gouvernance des finances publiques à adopter en France, sachant que nous y travaillons au sein de la commission des finances ? L'objectif serait de permettre, à l'issue de la crise, un nouveau regard sur nos grands agrégats et nos soldes publics, et la prise de décisions plus cohérentes en la matière avec notre nouveau niveau d'endettement. Avez-vous une idée de la direction que doivent prendre les politiques relatives aux finances publiques à l'avenir, compte tenu d'un regard neuf sur le solde primaire et sur les dépenses d'investissement et de fonctionnement du budget de l'État ?

De vos présentations, je retiens le constat d'une résilience extraordinaire du système, au regard de la violence du choc économique, ainsi que l'efficacité des mesures économiques engagées pour protéger les citoyens et les entreprises.
Il faut s'en féliciter, malgré les inconnues qui subsistent sur le sujet. Monsieur Jean‑Luc Tavernier, les données que vous avez présentées semblent montrer une souffrance disproportionnée de l'investissement et du commerce extérieur en France par rapport à celle des autres États européens.
Monsieur Olivier Garnier, vous avez rappelé que l'accumulation de l'épargne privée, et réglementée en particulier, a une utilité. Le financement afférent est-il efficace, particulièrement au regard de l'impact de la crise sur la capacité d'investissement des administrations publiques ?

Monsieur Tavernier, l'analyse du climat des affaires, qui montre la dichotomie entre l'industrie et les services durant la crise sanitaire, atteste aussi que l'ampleur du choc ressenti dans le premier secteur a été identique en 2008 et en 2020. Comment expliquez-vous que le climat dans les services ait connu un tel impact suivi d'un tel redressement ? Où en est-on aujourd'hui ?
Nous avions évoqué dès la mi-2020 le risque d'explosion du e-commerce. Or les plateformes concernées n'ont pas relayé de progression d'activité. Comment l'expliquez-vous ?
Monsieur Garnier, j'ai des difficultés à comprendre comment l'épargne financière des ménages pourrait encore augmenter dans les mois qui viennent, à la hauteur que vous annoncez.
Enfin, concernant les crédits aux sociétés non financières françaises, comment expliquez-vous la différence entre une augmentation de plus de 20 % pour l'industrie manufacturière, la plus consommatrice, et une croissance de plus de 35 % dans la construction ?

Il est très intéressant d'être destinataire d'exposés de telle qualité. Monsieur Pisani-Ferry, le choc économique, en particulier lors du premier confinement, a été plus fort dans les pays du sud de l'Europe, dont les difficultés économiques et financières étaient déjà plus importantes. Comment imaginez-vous l'avenir, à partir de ce constat ? Le plan de relance européen est-il d'un niveau suffisant ? Quelle visibilité avez-vous quant à un éventuel nouveau plan, destiné en particulier à ces pays du sud de l'Europe ?

Je remercie les trois intervenants pour cette présentation. Je m'associe aux compliments de Monsieur Pisani-Ferry à destination de l'INSEE, qui a fait montre d'une grande capacité d'adaptation aux événements.
Monsieur Tavernier, dans vos propos liminaires, vous avez évoqué des poches de pauvreté nouvelle. Pouvez-vous nous dire où elles se manifestent et qui elles concernent ?
S'agissant de l'épargne, nous savons qu'elle représentait à la fin de 2020, 4 000 euros supplémentaires par Français, dont 218 euros pour les 25 % les plus pauvres et 10 000 euros pour les 25 % les plus riches. Cette épargne est très diversifiée en fonction de l'âge et de la profession. Si l'objectif est de la libérer, il passera par plusieurs propositions. Quelles sont‑elles ? Le bond inflationniste attendu aux États-Unis se répercutera-t-il sur la zone euro ?
Beaucoup d'économistes parlent d'une reprise en K, qui se traduirait par un accroissement des inégalités. Pensez-vous ce scénario plausible en France et en Europe ?
Enfin, l'augmentation importante de la création de microentreprises, que vous avez évoquée, n'est-elle pas exclusivement due au confinement, durant lequel la seule activité viable pouvant être créée était celle de chauffeur Uber ?

Je voudrais également remercier les intervenants pour leurs présentations très claires et extrêmement instructives.
Ma première question, qui s'adresse à Olivier Garnier, concerne l'épargne des ménages qui atteindrait le montant de 160 milliards d'euros fin 2021 et doit être considérée au regard de l'augmentation de la dette des entreprises, dont le taux pourrait s'établir à 12,3 %. Au niveau macroéconomique, la trésorerie serait en augmentation. En valeur absolue, la dette des entreprises s'élèverait à 15 milliards d'euros, soit un niveau relativement acceptable selon vous. Quel pourrait être l'impact à plus ou moins long terme de cet endettement sur l'innovation et la compétitivité ?
Ma seconde question porte sur les trois scénarios de croissance présentés dans le rapport Arthuis (1,5 % ; 1,35 % ; 1 %). Quel est selon vous, messieurs, le plus réaliste ? Quelles pistes pourraient être envisagées pour établir de nouvelles règles budgétaires européennes prenant mieux en compte le niveau de soutenabilité de la dette, puisqu'en dépit d'une épargne très importante des ménages, l'État est contraint d'emprunter sur les marchés ?

Je m'adresse à Jean-Luc Tavernier qui a supposé l'existence de nouvelles inégalités en matière de revenus et de chômage, tout en restant très prudent. Nous avons constaté l'apparition d'un million de personnes supplémentaires en dessous du seuil de pauvreté, en partie du fait de l'augmentation du chômage. Comment ne les repérez-vous pas dans vos données ?
Ma deuxième interrogation concerne à la fois à Olivier Garnier et Jean Pisani-Ferry. Les taux d'intérêt en Europe n'ont finalement pas augmenté, ce qui est sans doute dû au fait que les emprunts européens ont été rachetés par les banques centrales. L'augmentation des taux aux États-Unis, après l'injection de 7 000 milliards de dollars dans l'économie, soit trois fois plus qu'en Europe, reste étonnamment modérée. Monsieur Pisani-Ferry, vous expliquez qu'il va falloir être « proactif » pour relancer l'économie en 2022 et notamment faire en sorte que la dette des entreprises ne pèse pas trop sur ces dernières. Comment comprendre l'alerte du rapport de la commission Arthuis sur le danger de la dette, alors que les taux restent faibles et que l'essentiel semble être de relancer l'activité économique ? En 2008 et 2012, la récession a pu être évitée en France grâce à l'investissement public. Si ce levier n'est pas utilisé, il est à craindre que l'objectif que vous évoquez ne soit pas atteint. Ne devrait-on pas au contraire utiliser la dette pour relancer l'économie, que ce soit par la négation de cette dernière ou sa transformation en dette perpétuelle ? La cible pour 2022 et la faiblesse des taux d'intérêt rendent possible cette option.

Je reviens sur le paradoxe évoqué par monsieur Tavernier concernant la diminution du nombre de dossiers de surendettement et l'augmentation de la pauvreté. Pouvez-vous caractériser ce qui est à l'œuvre dans ce phénomène ? Quelle population se trouve aujourd'hui en décrochage ?
D'un point de vue plus macroéconomique, la situation économique et les plans de relance à venir ne risquent-ils pas de susciter une remontée rapide du taux d'intérêt ?

Messieurs, vos interventions très éclairantes m'amènent à m'interroger sur la réforme du chômage, d'actualité. Le scénario dit sévère prévoit un retour tardif au niveau de PIB d'avant la crise et une hausse du taux de chômage. L'étude d'impact de la réforme nous apprend qu'elle touchera une partie des demandeurs d'emploi, notamment les plus précaires : 800 000 personnes seraient concernées. Je m'interroge sur sa mise en œuvre dès janvier 2021 et sur son impact. Au regard d'une reprise en K, ne faut-il pas être particulièrement vigilant vis-à-vis des plus précaires et ajuster encore davantage la réforme de l'assurance chômage ?
Je répondrai aux questions qui m'ont été posées, mais je tenais d'abord à évoquer le sujet de la dette brute et de la dette nette, qui avait été examiné par l'INSEE avant la crise. Le constat était que les entreprises présentant la dette brute la plus importante étaient aussi celles qui affichaient le plus d'actifs à leur bilan. La raison pour laquelle les sociétés françaises cumulent davantage de dette brute et de trésorerie est peut-être liée au schéma capitalistique. Nous nous sommes attachés, à l'INSEE, à montrer l'intérêt de la dette nette, indicateur plus fiable et de niveau moins inquiétant que la dette brute. L'augmentation de cette dernière de 200 milliards d'euros est bien supérieure au besoin de financement des entreprises tel que perçu au niveau national. Elle est donc bien liée à l'augmentation de la trésorerie et donc à l'obtention de PGE, qui ne sont pas utilisés, ou au report de paiement de cotisations. Cette situation n'est pas surprenante. Elle est caractéristique de notre économie.
En ce qui concerne la productivité du télétravail, différents documents académiques ont été rédigés sur le sujet. Ils témoignent d'une extrême diversité de résultats, suivant les conditions d'exercice et de mise en place. À l'INSEE même, le déploiement du télétravail dans l'urgence en mars 2020 ne pouvait conduire à des gains de productivité. Aujourd'hui, notre équipement est plus adéquat, mais le travail en équipe demandant un peu de brainstorming n'est pas facilité par la configuration à distance et, par conséquent, par les restrictions de déplacement. La question ne peut donc faire l'objet d'une réponse générale, puisque la productivité du télétravail relève de l'art d'exécution, sachant que de nombreuses activités ne sont pas « télétravaillables ».
Une vision plus ou moins large des secteurs empêchés peut être prise en compte, puisque le point affecte les fournisseurs desdits secteurs. Le premier cercle a été estimé à 10 %, dans un point récent de conjoncture. Il est difficile aujourd'hui d'évaluer le taux de chômage par catégorie de personnes, d'autant que l'activité partielle domine et que la recherche d'emploi est différemment contrainte suivant les secteurs d'activité. Un problème de pertinence des critères au sens du BIT se manifeste, puisqu'une telle recherche dans le domaine de la restauration est totalement empêchée. La prospective sur les taux de chômage par secteur est donc difficilement réalisable. Les données pourraient ne pas être disponibles avant le retour à des conditions normales.
S'agissant de la position du Gouvernement en matière de finances publiques, en tant que directeur à Bercy et membre de la commission Arthuis, je suis doublement gêné pour répondre. Il y a davantage dans le rapport Arthuis que le résumé succinct qu'en a fait M. Coquerel. Si ce dernier y a vu une commission des « pères la rigueur », c'est qu'il l'avait décidé avant de lire le rapport, dont l'analyse est plus subtile. Si nous nous trouvions dans un environnement certain de taux d'intérêt durablement négatifs, nuls ou très bas, nous ne rencontrerions pas de problème de soutenabilité. Tout le problème provient de l'impossibilité où nous nous trouvons de parier sur la pérennité de tels taux. À un moment ou un autre, ces derniers remonteront. Nous devons nous y préparer, car les conséquences seraient très lourdes. Avec une dette à 120 % du PIB, une augmentation des taux d'intérêt de 1 % représente une trentaine de milliards d'euros, qui sont immédiatement retirés d'autres financements. La question de la soutenabilité ne se pose donc que si nous partons du principe d'une incertitude sur les niveaux futurs des taux d'intérêt. Elle a un fondement prudentiel. Sur ce point, la lecture approfondie du rapport Arthuis s'avère instructive.
Sur le sujet d'une souffrance disproportionnée de la France dans ses investissements et en matière de commerce extérieur, le premier volet devra être vérifié à l'aune des comptes définitifs. Au regard de la chute de l'activité et de l'incertitude, nous n'avons pas souffert de façon excessive. Les autres pays n'ont pas non plus semblé extrêmement contraints. Nous ne pourrons vérifier l'existence d'une hiérarchie entre les États qu'au moment de la production de comptes assis sur la comptabilité d'entreprise. S'agissant du commerce extérieur, qui comprend les échanges de biens et de services ainsi que le tourisme, la France dispose, en tant que destination touristique et du fait d'une industrie fortement focalisée sur l'aéronautique, d'une caractéristique doublement pénalisante. Cette particularité explique une grande partie de la contribution négative du commerce extérieur et de l'écart constaté par rapport à l'Allemagne.
La différence de climat des affaires entre les services et l'industrie s'explique par le fait qu'une partie des premiers subissent de plein fouet et de façon drastique les restrictions administratives, notamment l'hébergement et la restauration. Pour l'industrie manufacturière et la construction, une fois passée l'étape de sidération de la mi-mars 2020, l'activité a très vite repris, ce que traduisent de façon évidente les réponses des entreprises sur leur production passée, leurs projections, leurs perspectives sur l'emploi, leur carnet de commandes, etc. Quelle qu'importante qu'ait été la crise, et le sujet sera repris dans l'avenir, certains secteurs de l'industrie et de la construction continuent à souffrir de difficultés de recrutement. Le e‑commerce s'est accru, comme le montre l'évolution des transactions par carte bancaire sur les sites électroniques. Le GIE carte bleue a réalisé des publications sur le sujet.
La question des inégalités, notamment de revenus, demande que l'on s'y attarde. Nous ne disposons pas aujourd'hui de données fiables sur ces dernières pour 2020. Le volume d'un million de pauvres, évoqué par M. Coquerel et beaucoup d'autres avant lui, émane d'une source unique. Contrairement au traitement usuel que nous réalisons de la statistique et à notre habitude en matière de factchecking, cette information s'est répandue comme une vérité, sans qu'aucune vérification n'ait jamais été opérée. L'organisme dont un des responsables est à l'origine de cette donnée ne le revendique pas et m'a confirmé qu'elle n'était pas documentée. Je vous affirme clairement que nous n'avons pas d'estimation d'un volume exact de pauvres. Nous restons très attentifs au fait que les données agrégées puissent masquer des réalités très divergentes et ne pas permettre une bonne visibilité de la situation. Nous avons émis la conjecture que l'augmentation de 0,6 % du pouvoir d'achat des ménages recouvre, encore davantage cette année que les autres, des situations hétérogènes. Nous tentons de travailler en lien avec les banques, notamment deux réseaux qui, au travers des exploitations agrégées de données qu'ils nous ont fournies, indiquent qu'ils ne décèlent, à aucun niveau de revenu, de façon macroéconomique, l'apparition de problèmes de trésorerie depuis 2020. Le travail se poursuit avec la Banque Postale, dont le public pourrait être représentatif d'une nouvelle pauvreté. La discussion avec les associations caritatives montre qu'elles semblent plus inquiètes pour l'avenir que pour le présent. Nous ne savons donc pas si l'évolution du revenu a été plus hétérogène cette année. Par ailleurs, les « petits boulots », non déclarés, ont probablement été très impactés par la crise sanitaire, ce que nous ne pourrons jamais démontrer.
Nous réalisons une enquête annuelle sur les revenus. Nous effectuons une exploitation retardée des données fiscales et de celles des caisses de sécurité sociale, pour réaliser la photographie annuelle des inégalités de revenus et du taux de pauvreté, qui ne sera disponible qu'en fin d'année pour 2020. Pour pouvoir en parler de façon plus réactive, il faudrait un traçage, difficile à imaginer du point de vue administratif, ou la réalisation d'une enquête trimestrielle sur les revenus, que seuls les États-Unis parviennent à assumer. Aucun pays européen n'a engagé en la matière d'opération fiable, sur la base de très importants échantillons, comme ceux considérés pour l'enquête emploi pour laquelle 70 000 ménages et plus de 100 000 personnes sont interrogées chaque trimestre. Ce niveau hors de portée à ce jour nous incite à travailler différemment, d'où notre rapprochement des banques et la volonté de cibler des établissements avec des clientèles différentes, sachant que les personnes en difficulté ne sont pas nécessairement bancarisées. Nous sommes à peu près certains, même si nous ne pouvons le chiffrer, que les demandeurs d'asile ont connu des situations très difficiles, notamment car les administrations en charge de leurs dossiers n'ont pas fonctionné au moment du premier confinement. Les personnes vivant de « petits boulots », comme les jeunes, les étudiants et les primo-demandeurs d'emploi, qui n'ont pu finir leurs études, entre autres, sont très affectés par la crise, mais nous ne savons pas caractériser cet impact d'un point de vue statistique.
Il est toujours fait mention du taux de pauvreté, mais il est important de considérer l'intensité de cette dernière, c'est-à-dire l'écart moyen par rapport au seuil de pauvreté. Je serais surpris si nous dénombrions un million de pauvres supplémentaires, mais je ne peux rien affirmer sur le sujet à ce jour.
La création de microentreprises a bien sûr bénéficié du confinement. Il faut s'en féliciter.
Je répondrai aux questions sur l'épargne, la dette et les taux d'intérêt.
Le phénomène de surplus d'épargne financière n'est pas spécifique à la France, mais se manifeste dans toute l'Europe et aux États-Unis. Cette épargne est extrêmement liquide, puisque constituée essentiellement par des dépôts. Les agrégats monétaires M2 et M3 connaissent, un peu partout dans le monde, des croissances à deux chiffres. La question se pose de l'utilisation de cette épargne, qui pourrait profiter à la consommation, mais aussi au logement, comme le montre, pour le cas de la France, qui n'est pas isolé, le fait que la récession ne s'accompagne pas d'une baisse de l'immobilier. Par ailleurs, les dépenses des ménages, ces derniers mois, se sont beaucoup focalisées sur l'équipement du domicile et le mobilier. Une partie de l'épargne considérée pourrait donc être reversée dans le secteur du logement.
La hausse supplémentaire du surplus d'épargne, avec l'atteinte potentielle de 160 milliards d'euros à fin 2021, serait due au fait que la consommation ne reviendra pas au niveau précédent, alors que les restrictions se poursuivront, notamment en matière de tourisme, de voyages, voire d'autres types de dépenses. Dans un contexte où les revenus demeurent stables, ou presque, l'épargne continue d'augmenter.
S'agissant de l'efficacité de cette épargne et de la capacité de financement qu'elle permet au niveau national, il faut savoir que l'État français s'endette quoi qu'il en soit sur les marchés. L'épargne des ménages permet aux banques d'acheter des obligations, si elle fait l'objet de dépôts bancaires, ou donne la possibilité aux organismes d'assurance vie d'investir dans des emprunts d'État, le cas échéant.
Le président Éric Woerth, d'une façon un peu provocatrice, estime que la dette n'est pas aussi lourde que son niveau semble l'attester. La forte hausse de cette dernière, de plus de 200 milliards d'euros, s'ajoute au fait que la crise nous a surpris à un moment où le ratio d'endettement des entreprises était déjà supérieur en France à celui de ses partenaires de la zone euro. Nous sommes le seul pays de cette zone où la dette des entreprises a continué d'augmenter dans la période ayant suivi la grande crise financière. Leur trésorerie a crû à due concurrence, ce qui n'est pas surprenant, puisque les crédits font les dépôts. Une entreprise ayant souscrit un PGE peut ainsi le garder, en dépôt, à titre de précaution, si elle n'en a pas réellement besoin. Dans le cas contraire, elle paye son fournisseur, qui lui-même se retrouve avec un excédent de trésorerie. La question de la répartition de la trésorerie est donc importante. Le montant de 15 milliards d'euros évoqué représente la différence entre les augmentations de dette brute et de trésorerie.
Les données relatives aux volumes des crédits par secteurs sont exprimées en taux de variation. Entre décembre 2019 et décembre 2020, la hausse s'est établie à 30 % dans la construction et 20 % environ dans l'industrie. En revanche, les encours de dette dans l'industrie sont deux fois et demi plus importants que dans la construction. L'augmentation en valeur absolue des crédits au premier secteur a largement surpassé ceux consentis au second.
Pour appuyer les propos de Jean-Luc Tavernier sur les taux d'intérêt, personne ne peut dire si la propension actuelle se maintiendra. Un consensus se manifestait, encore récemment, chez les économistes pour convenir de la persistance d'un contexte de taux bas. Le débat évolue, notamment aux États-Unis, où des spécialistes analysent, au regard de cet indicateur, d'autres indices, comme le vieillissement de la population et la pénurie de main-d'œuvre en âge de travailler. Par ailleurs, si les restrictions aux échanges perdurent ou si les coûts de ces derniers s'accroissent, du fait par exemple de pénuries de containers ou de personnel pour les décharger dans les ports, tandis que les prix des matières premières affichent des tendances à la hausse, l'idée que l'inflation a disparu pourrait être remise en question. Le diagnostic de la Banque centrale européenne demeure que le niveau actuel de l'inflation est trop bas. Son évolution à cinq ou dix ans n'est pas prévisible.
Il me reste à traiter un certain nombre de questions de niveau macroéconomique.
S'agissant de l'épargne, le choc actuel a été absorbé par les finances publiques et les entreprises, les ménages ayant accumulé beaucoup d'argent sur leurs comptes. L'épargne nationale nette a très peu varié. Les différents pays « de niveau avancé » ayant subi le même choc, il y avait peu de raisons qu'ils modifient, à l'instant, les soldes extérieurs qui sont la différence entre l'épargne et l'investissement. L'impact a été assez symétrique, sachant que le choc a été absorbé par les finances publiques, les ménages ayant accumulé de l'épargne. Le coût de ce choix n'est pas particulièrement élevé. La formule largement relayée du « quoi qu'il en coûte » ne doit pas laisser penser que la France fait partie des pays où les mesures de soutien de l'activité ont été les plus coûteuses. Si les États-Unis se situent à un extrême, certains pays européens, comme le Royaume-Uni ou l'Espagne, ont mis en œuvre des mesures d'un coût bien supérieur à celui de la France.
La question est de savoir si les ménages auront la volonté de réduire leur épargne, ce qui dépend de leur possibilité de consommer et de leur inquiétude pour l'avenir. Le maintien des restrictions jouerait donc en faveur de son maintien. Le soutien public devrait dès lors être préservé à un niveau important. Dans un scénario de reprise de l'activité, voire d'une période de frénésie de consommation de type « années folles », le besoin serait moindre. Je plaide pour un objectif de résultats et non de moyens, qui demande une forte réactivité. Le nombre de lois de finances rectificatives que nous avons observé en 2020 atteste de cette possibilité de flexibilité. L'important est que la politique économique fixe un cap clair, qui doit être aujourd'hui d'effacer, autant que possible, les séquelles de la crise sanitaire, sachant que les impacts sont probablement moins significatifs qu'il y paraît. L'incertitude perdure néanmoins. Certaines entreprises vivent des situations difficiles. L'activité ne reprendra probablement pas dans certains secteurs. De manière générale, malgré la dette élevée des entreprises, la capacité de rebond existe. Les signaux conjoncturels perçus tant du côté de la consommation que de la production attestent la résilience du système, sur laquelle il faut miser et qu'il faut assurer.
Les interrogations perdurent sur la cohérence d'une telle politique avec l'exigence de soutenabilité de la dette et les critères européens du pacte de stabilité et de croissance. Je partage l'idée que nous ne pouvons demeurer pour l'éternité dans un système où la soutenabilité des finances publiques est assurée. Les risques existent, d'autant plus importants que les niveaux d'endettement augmentent, que la crise sanitaire dure et que des manifestations de contagion internationale se produisent.
Qu'un phénomène de contagion des taux longs en provenance des États-Unis ait pu s'interrompre est positif, d'autant qu'il n'avait pas de raison macroéconomique, puisqu'il était spécifiquement américain. Néanmoins le caractère dominant du marché obligataire américain était générateur du risque de voir se transmettre le sentiment d'un retour à une tendance inflationniste et à une remontée des taux longs. Le coup d'arrêt mis à cette tendance a permis de revenir à une évolution plane de ces taux, ce qui est positif.
Il faut donc être très attentif et en capacité de réagir vigoureusement à court terme. Le problème de fond est l'équilibre structurel de nos finances publiques, au delà de l'impact immédiat de la crise, puisque nous avons pris plusieurs décisions relatives aux dépenses de santé, à la baisse des impôts de production et aux investissements dans la transition écologique qui pèseront durablement. La difficulté à atteindre l'équilibre primaire en France est un vrai sujet de préoccupation pour la soutenabilité. Si je travaillais dans une agence de notation, j'identifierais ce point comme majeur pour notre pays, alors que je constaterais l'incapacité de l'Italie à maintenir la croissance. Il me semble donc qu'il faut davantage raisonner à moyen terme, sur ce sujet.
S'agissant du pacte de stabilité, la tentation européenne est de ne pas le réformer et de le remettre en place tel qu'il est, en tirant argument du fait qu'une limite de déficit de 3 % du PIB en période de charge d'intérêts faible n'est pas si rigoureuse. Pour la moyenne de la zone, ce taux était de 4 % à la mise en œuvre de l'euro. Il est passé à 1,5 %, ce qui offre une marge de manœuvre. Les critères structurels n'ont pas grande signification dans la situation que nous vivons. Celui relatif à la dette avait été abandonné avant la crise. Selon certains, le seuil de 3 % n'est pas extrêmement rigoureux et peut être conservé, dans l'attente d'une réforme ultérieure. Cette position me semble erronée, car le nouveau contexte que nous connaissons, avec des taux d'intérêt faibles, une dette publique élevée et le besoin plus récurrent de faire appel à la politique budgétaire, en complémentarité avec la politique monétaire, est très différent de celui dans lequel a été construit le pacte de stabilité. Par rapport à des responsables politiques et des opinions profondément désorientés, disposer d'un code de conduite s'appuyant sur la réalité, et non sur un monde qui a disparu, semble important. Le respect des règles communes repose d'abord sur le fait qu'elles apparaissent fondées. Le pacte de stabilité ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Si une dette insoutenable est dangereuse pour tout le monde, un déficit ne l'est pas, contrairement à l'hypothèse de base du pacte de stabilité. Aujourd'hui, l'objectif est de s'assurer du soutien budgétaire chez nos voisins.
Je pense donc qu'il faut avoir le courage de réformer le pacte de stabilité, sans attendre, en plaçant la soutenabilité parmi les critères les plus importants, de manière différenciée suivant les pays. Une norme de dette uniforme pour l'ensemble des pays ne résoudra pas le problème de soutenabilité. Il faut accepter que l'objectif en la matière se traduise par des cibles de dette adaptées, puisqu'elles ne peuvent être identiques pour des pays affichant des croissances ou connaissant des inflations structurellement différentes. Une fois l'exercice réalisé, il faudra fixer des normes de dépenses relatives à ces cibles de dette. Philippe Martin, Xavier Ragot et moi-même contribuerons au débat, via une note du Conseil d'analyse économique, qui sera publiée dans quelques semaines, parce que cette position nous semble importante et qu'un certain nombre de forces poussent à cette réforme. La BCE, en la personne de Christine Lagarde et d'Isabel Schnabel, s'est exprimée clairement sur le sujet.
Les différences de situation entre les entreprises ne donnent pas la possibilité de connaître avec précision celles qui auront besoin d'un réaménagement de leur dette. La première façon d'agir est d'intervenir ex ante, comme avec le fonds de solidarité qui permet aujourd'hui de socialiser une partie des coûts fixes, salariaux ou non, des entreprises. Elle est inspirée de la stratégie allemande, que nous n'avions pas choisie au printemps 2020. Elle est favorable aux entrepreneurs, mais plus coûteuse en matière de finances publiques. L'alternative est de procéder à des restructurations de dette en fonction des situations, une fois qu'elles ont pu être constatées. Il faut alors se poser la question de la participation des créanciers bancaires, puisqu'il n'est pas indispensable que l'ensemble du coût soit socialisé. Une part peut être assumée par le système financier, dans des conditions qui ne mettent pas sa stabilité en cause. La dette subordonnée peut être un bon instrument, pour peu qu'elle ne permette pas de trop repousser le remboursement, laissant ainsi les entreprises incertaines quant à leurs capacités d'investir.
Le dernier point concerne la réforme en cours de l'assurance chômage, qui, de mon point de vue, dans les conditions actuelles, ne se justifie pas. Dans un marché du travail qui s'améliore, il est important de donner rapidement le signal d'un nécessaire retour des personnes vers l'emploi, en fixant des durées d'indemnisation. Cependant, remettre en œuvre la réforme évoquée, conçue dans un environnement qui a évolué depuis, ne me semble pas une urgence absolue. Nous avons besoin de reprendre le sujet à partir du diagnostic des questions prioritaires se posant aujourd'hui à nous, mais non sur la base de celui effectué avant la crise, aussi fondé soit-il.

Je remercie Jean‑Luc Tavernier, Olivier Garnier et Jean Pisani-Ferry d'avoir éclairé les commissaires aux finances. Je m'associe aux propos qui ont été tenus pour relever la qualité du travail de l'INSEE depuis le début de la crise.