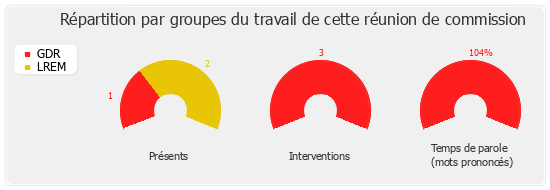Commission d'enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l'industrie risques chimiques, psychosociaux ou physiques et les moyens à déployer pour leur élimination
Réunion du jeudi 24 mai 2018 à 13h00
Résumé de la réunion
La réunion
L'audition débute à 13 heures 05.

Nous poursuivons les auditions de notre commission d'enquête sur les risques chimiques, physiques et psychosociaux dans l'industrie, avec une table ronde réunissant les organismes oeuvrant dans le domaine de la recherche en matière de maladies à caractère professionnel. En effet, les autorités chargées de la réglementation du travail et les partenaires sociaux chargés d'élaborer les tableaux de maladies professionnelles ne peuvent avancer sans les études que les uns et les autres peuvent mener.
Nous recevons donc aujourd'hui le professeur Alain Bergeret, directeur de l'unité mixte de recherche épidémiologique et de surveillance Transport Travail Environnement (UMRESTTE) de l'Institut universitaire de médecine du travail de Lyon, le professeur William Dab, titulaire de la chaire Hygiène et Sécurité du laboratoire de modélisation et surveillance des risques pour la sécurité sanitaire (MESuRS) du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), ainsi qu'une délégation du groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle en Seine Saint-Denis (GISCOP 93) composée de Mme Émilie Counil, enseignante-chercheuse en épidémiologie et biostatistiques à l'École des hautes études en santé publique (EHESP), M. Christophe Coutanceau, ingénieur, sociologue, directeur de GISCOP 93, M. Benjamin Lysaniuk, géographe, chargé de recherches au CNRS, Mme Anne Marchand, sociologue et historienne, post-doctorante au GISCOP 93, Mme Annie Thébaud-Mony, sociologue, directrice de recherche à l'Institut national de santé et de recherche médicale (INSERM), et enfin M. François Cochet, président de la Fédération des intervenants en risques psychosociaux (FIRPS).
Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les personnes entendues dépose sous serment. Je vous demande donc de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité de lever la main droite et de dire : « Je le jure. »
M. Alain Bergeret, M. William Dab, M. Christophe Coutanceau, Mme Emilie Counil, Mme Anne Marchand, M. Benjamin Lysaniuk, Mme Annie Thébaud-Mony, et M. François Cochet prêtent serment.
Je représente les enseignants hospitalo-universitaires de médecine et santé au travail. Nous sommes actuellement quarante-deux, plus ou moins répartis sur le territoire français, donc moins qu'en 2015, date à laquelle nous étions encore quarante-huit ; la diminution est franche et continue.
Notre rôle est de faire de l'enseignement, de la recherche et du soin, c'est-à-dire essentiellement, pour ce qui vous concerne, l'animation des trente-deux consultations de pathologies professionnelles réparties dans les différents centres hospitaliers universitaires (CHU) de France, qui reçoivent des patients susceptibles d'avoir des maladies d'origine professionnelle, le tout étant fédéré dans un réseau qui s'appelle le réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles, lui-même coordonné par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
Je suis également là au titre de mes fonctions de président de la sous-section de médecine du travail du Conseil national des universités (CNU), qui est chargée des concours de nomination d'hospitalo-universitaires et des promotions. Enfin, je copréside pour l'instant le comité scientifique des appels d'offres de recherche de l'ANSES et, à ce titre, je vous dirai deux mots de la recherche.
La santé au travail est l'une des disciplines de la santé publique, dont je vous expliquerai pourquoi elle est un peu à part. Votre commission ayant pour but sinon d'éliminer tout au moins de diminuer les maladies professionnelles, il me semblait judicieux de commencer par dire qu'on n'était pas totalement certain d'avoir tous la même définition des maladies professionnelles. On s'appuie en effet le plus souvent sur les maladies professionnelles indemnisables, celles qui figurent dans les tableaux des maladies reconnues comme telles. Or, elles ne constituent pas l'ensemble des maladies dues au travail, mais seulement les pathologies admises par la réglementation. Partant, les statistiques qui sont fournies, qui ne concernent d'ailleurs pas l'intégralité des personnes qui travaillent, mais seulement les salariés du régime général et du régime agricole, sont très partielles : on n'a que peu de données sur les fonctionnaires et rien sur les maladies des artisans ou des auto-entrepreneurs. Par ailleurs, il s'agit de statistiques assurantielles, sans dimension sanitaire. Dans la mesure enfin où elles se fondent sur ces tableaux de maladies professionnelles, dont l'élaboration procède in fine d'un consensus social, elles ne permettent pas véritablement de se faire une idée précise des maladies d'origine professionnelle.
La plupart des maladies professionnelles modernes étant de surcroît d'origine plurifactorielle, la démarche scientifique s'appuie, pour approcher une définition adéquate, sur la notion de « fraction attribuable », c'est-à-dire la part qui peut revenir au travail, dans telle ou telle maladie : le cancer du poumon, le cancer du rein ou les maladies péri-articulaires. Pour les cancers au moins, nous pouvons nous appuyer sur les travaux d'organismes comme le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui est l'agence spécialisée de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ou sur les diverses académies et unités de recherche qui se sont penchées sur ces questions.
L'objectif principal de la recherche dans notre domaine est d'améliorer la prévention médicale, et il faut pour cela identifier les risques professionnels, c'est-à-dire déterminer leur nature, à quel endroit et quand ils surgissent, afin de les prévenir et, évidemment, de les indemniser. L'indemnisation a des vertus préventives puisqu'elle participe de l'identification des risques, ce qui sert aussi bien au corps médical qu'aux travailleurs et aux employeurs. Par ailleurs, dans la mesure où elle représente un coût qu'endossent les acteurs, elle incite également aux actions de prévention.
Pour avoir une vue du panorama de la recherche, vous pourrez vous référer au document que je vous ai communiqué et dans lequel ont été recensés en juin 2015, à la demande de l'INSERM, les thématiques et les axes de recherche des structures hospitalo-universitaires en médecine du travail. Dans ce champ de la recherche, on retrouve soit des équipes universitaires, soit, le plus souvent, des équipes mixtes réunissant des UFR médicales et des instituts de recherche comme l'INSERM, le CNRS ou encore l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR), qui a succédé à l'INRETS et qui s'occupe des transports et l'aménagement des réseaux. Ces structures sont souvent associées à des agences sanitaires, comme l'ANSES, Santé publique France ou l'Institut national de sécurité et de recherche (INRS), l'institut de recherche de la sécurité sociale. J'ajoute que ce recensement de 2015 avait permis d'établir que les travaux de recherches menés dans ce cadre avait donné lieu, dans les cinq années précédentes, à trois cent vingt publications scientifiques.
La recherche hospitalo-universitaire sur la santé au travail s'intéresse aux pathologies et surtout aux pathologies cancéreuses. On travaille encore sur l'amiante et les liens éventuels qui pourraient exister entre l'exposition à l'amiante et certaines pathologies cancéreuses digestives ou certaines maladies respiratoires autres que le cancer du poumon, du larynx ou de la plèvre. Les maladies respiratoires sont au centre des recherches comme, évidemment, les maladies péri-articulaires et les troubles musculo-squelettiques. Enfin, plusieurs équipes travaillent plus spécifiquement sur les troubles psychologiques ou psychiatriques et la santé mentale. On le voit, le champ est large.
Ces travaux sont en général menés par de petites équipes, souvent en collaboration avec d'autres acteurs, notamment des épidémiologistes ou des toxicologues, issus d'établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST).
Si l'on ajoute à ces équipes hospitalo-universitaires trois à quatre équipes de l'INSERM qui travaillent sur les pathologies et les risques professionnels, peut-on considérer que l'on dispose d'un réseau et de moyens suffisants ? Probablement pas, en particulier pour ce qui concerne la formation des acteurs de terrain.
Depuis une douzaine, voire une quinzaine d'années, la recherche en santé au travail est essentiellement financée par l'ANSES, à qui les ministères de la recherche, du travail, de l'environnement mais aussi l'Institut national du cancer (INCa) ont confié le soin de lancer, chaque année, un appel d'offres pour des projets de recherche sur le travail et l'environnement, les deux domaines étant de plus en plus liés.
Cet appel d'offres, assorti d'axes prioritaires définis par les financeurs, auquel on peut également ajouter un appel d'offres sur les risques liés aux radiofréquences, représente tous les ans une enveloppe d'environ 2 millions d'euros, à laquelle sont éligibles les équipes de recherche françaises et les équipes internationales si toutefois elles incluent des chercheurs français. Il s'agit d'un appel d'offres assez sélectif, puisque, cette année, on comptait un peu plus de trois cents lettres d'intention et quatre-vingt-dix projets présélectionnés. La sélection finale ne se fera qu'en juillet, mais il est rare que la proportion de projets jugés finançables et susceptibles d'entrer dans l'enveloppe dépasse un tiers.
D'autres appels d'offres, lancés par des associations, notamment de lutte contre le cancer, ne s'intéressent pas uniquement aux risques professionnels mais aussi à la question du maintien dans l'emploi, ce qui participe de la prévention tertiaire.
Si les financements sont « courts », il faut néanmoins souligner le fait que le vivier de chercheurs n'est pas non plus illimité et je ne suis pas du tout certain qu'il se trouve pléthore d'autres équipes de recherche capables de lancer d'autres projets dans le domaine de la santé au travail.
J'en viens à présent à la prévention. En tant qu'enseignants de médecine, nous sommes en première ligne pour former les acteurs de la santé au travail.
C'est une matière totalement absente du premier cycle des études médicales et assez peu abordée dans le second cycle : elle représente huit à douze heures d'enseignement sur l'ensemble du cursus, ce qui n'est pas beaucoup. Ça l'est d'autant moins que, sur ce quota, un nombre d'heures non négligeable doit être consacré à l'approche réglementaire des maladies professionnelles et des accidents du travail – ce qui est l'un des aspects les plus rébarbatifs de la discipline mais indispensable à la future pratique des étudiants en médecine. Dans ces conditions, l'étude des risques professionnels eux-mêmes est réduite à la portion congrue.
On note cependant quelques améliorations. Ainsi, des étudiants de deuxième cycle sont désormais accueillis dans les services de pathologie professionnelle des CHU, mais leur nombre reste une goutte d'eau par rapport au nombre total des étudiants accueillis dans les CHU. Par ailleurs, c'est encore au stade embryonnaire mais des étudiants hospitaliers sont également accueillis désormais dans les services de santé au travail interentreprises.
En ce qui concerne le troisième cycle de médecine générale et les futurs médecins généralistes, qui sont souvent aux avant-postes pour déceler les maladies professionnelles, il existe, ou non, selon les universités, des modules de formation spécifiques. Cela étant, les futurs médecins savent que c'est un sujet qu'ils auront besoin de maîtriser et ils font en sorte de s'informer.
Quant aux internes qui effectuent leur spécialisation, il faut savoir que près de la moitié des places en médecine du travail offertes à l'issue du concours ne sont pas pourvues, le déficit étant encore plus important dans le nord que dans le sud. Il faut dire que la médecine du travail est une discipline mal connue et assez mal cotée. Dans la mesure où la médecine préventive est assez peu abordée lors des premiers cycles, les futurs internes ne se précipitent pas sur les spécialités en santé publique.
En revanche, ceux qui choisissent cette spécialité sont motivés et s'investissent de manière efficace sur le terrain.
Les besoins démographiques restent néanmoins supérieurs à l'offre, en renfort de laquelle on peut cependant compter sur l'apport de filières complémentaires – je pense notamment aux médecins décidant une réorientation professionnelle. Mais le manque de médecins du travail reste criant.
Le problème se retrouve au niveau de formateurs, dont le nombre est également en chute libre. Cela s'explique par le fait que, dans les différentes UFR de médecine comme dans les CHU, priorité est le plus souvent donnée aux disciplines de soins plutôt qu'aux disciplines comme les nôtres, dont l'accroche avec le CHU est assez faible et dont la rentabilité, au sens de la tarification à l'activité (T2A), est très inférieure à celle des disciplines classiques – et je ne parle pas ici de rentabilité globale, car nous apportons, malgré tout, des financements, du fait de nos missions d'intérêt général.
De plus, face à un cursus honorum difficile et aléatoire, la perspective d'une situation stable dans l'industrie ou dans un service interentreprises est beaucoup plus attrayante pour les jeunes, ce qui accroît le déficit de candidats à des postes hospitalo-universitaires.
J'en finirai par quelques mots sur la place de la médecine du travail dans la santé publique. Elle est un peu à part des autres domaines, dans la mesure où elle est pilotée par le ministère du travail et les partenaires sociaux, qui n'appréhendent pas la santé au travail au travers du prisme sanitaire mais par le biais de la réparation, voire de la démographie, du fait du manque de médecins du travail. Or je ne suis pas le seul à penser qu'il serait opportun de revoir ce pilotage, pour y intégrer les acteurs de la santé.
À cette question du pilotage est liée celle de la visibilité de notre discipline, sur laquelle je nourris quelques inquiétudes, a fortiori depuis qu'il a été annoncé que la direction Santé au travail de Santé publique France devait être démantelée.
Je m'occupe au CNAM de deux chaires. La première, la chaire Hygiène et Sécurité, forme principalement des ingénieurs de prévention, à la fois dans le champ du travail et dans celui l'environnement, parce que c'est ce qui correspond aux besoins des entreprises. C'est une filière qui vient d'être réhabilitée par la commission des titres d'ingénieur et qui a été ouverte à Paris à Amiens et à Nancy, puisque le CNAM est présent sur tout le territoire.
Par ailleurs, nous formons depuis douze ans des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) – plus de 1 500 à ce jour –, au travers d'une licence professionnelle qui est habilitée dans sept régions et qui fonctionne à la fois en cours du soir et sous le régime de l'alternance.
Je dirige par ailleurs la chaire Entreprise et santé, animée en partenariat avec la mutuelle Malakoff Médéric, au sein de laquelle nous formons « le reste du monde », c'est-à-dire, pour être plus précis, les non-spécialistes de la santé au travail dans les entreprises, à commencer par les dirigeants et les personnels d'encadrement.
Le laboratoire MESuRS est commun aux deux chaires et abrite toutes nos recherches, principalement dans le domaine de l'épidémiologie, de la modélisation statistique et de la modélisation mathématique des risques. À titre d'exemple, nous développons, dans une optique méthodologique, des modèles d'analyse de l'absence au travail, à partir des données de Malakoff Médéric, qui assure 500 000 personnes en Île-de-France.
Je travaille également depuis très longtemps en collaboration avec le groupe La Poste, pour lequel nous avons réalisé une épidémiologie des troubles musculo-squelettiques et une étude visant à caractériser les problèmes de retour à l'emploi des postiers après une absence prolongée. Nous avons aussi développé le protocole d'une étude de cohorte de mille facteurs, qui seront suivis dans le temps, pour répondre à la préoccupation des médecins du travail de La Poste, qui s'inquiètent de l'impact de l'évolution des conditions de travail et du métier des facteurs sur leur santé.
Nous faisons par ailleurs de l'évaluation sur le terrain des actions de prévention et de leur efficacité sanitaire et économique. Nous avons, dans ce domaine, un très gros projet à partir de la cohorte « Constances » gérée par l'INSERM, qui regroupe 200 000 assurés du régime général, ce qui en fait une base de données sur la santé unique au monde et de très grande envergure, puisque tout ce qui fait l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie est enregistré.
Nous travaillons enfin sur les problématiques liées au stress, comme dans cette étude récente, réalisée sur l'ensemble des services de réanimation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui nous a permis de mettre en évidence un lien entre le risque de transmission de maladies nosocomiales et le niveau de stress des soignants.
Cette énumération n'a rien d'exhaustif, mais elle vous offre un aperçu des activités de notre petit laboratoire, composé de huit permanents, quatre ou cinq doctorants, deux post-doctorants et actuellement une quinzaine de stagiaires de l'Institut Pasteur.
Pour ce qui est du contenu, je partage l'analyse qu'a développée mon collègue Alain Bergeret, à une toute petite nuance près : je ne pense pas que, si les financements étaient plus importants, nous n'aurions pas d'équipes pour les utiliser. 2 millions d'euros, pour un pays comme la France, c'est indigent – je le dis devant la représentation nationale. Trente projets par an : non. Pas dans un pays de l'importance du nôtre, qui comporte plus de vingt millions de salariés. Il y a là un vrai problème.
Pourquoi cette situation ? Il y a un lien indissoluble entre enseignement et recherche, et on ne peut pas réfléchir à l'un sans réfléchir à l'autre. Or la situation de la France est tout à fait particulière à cet égard : nous ne disposons pas d'école de santé publique. Entendez-moi bien : je ne dis pas qu'il n'y a rien ; il se fait énormément de choses dans les facultés de médecine, au CNAM, dans les facultés de sociologie, d'ergonomie, de psychologie. Nous ne sommes pas dans le désert, mais dans une dispersion des acteurs, une absence de coordination des programmes d'enseignement et des actions de recherche.
Ainsi que je l'ai déclaré à Mme Charlotte Lecocq, présidente de la mission sur la santé au travail, lorsque je parle d'école de santé publique, je ne parle pas de créer une nouvelle institution avec des murs, des professeurs et des diplômes. Il faut respecter ce qui existe déjà, mais nous avons besoin d'un lieu de coordination, qui identifie les besoins de formation et de recherche et qui aille chercher les compétences dans les universités, les facultés de médecine existantes, les laboratoires et les agences. Nous avons absolument besoin de cette école « d'assemblage ». Alain Bergeret évoquait à juste titre un problème de visibilité, rendu plus crucial par la disparition du département Santé au travail de Santé publique France. Tout dépendra de ce qu'il advient ensuite : si on mutualise les forces de l'ANSES et de Santé publique France et qu'on parvient à une masse critique plus importante, cela peut être une décision raisonnable.
Reste qu'aujourd'hui, la visibilité et la cohérence scientifique et pédagogique du champ de la santé au travail en France sont gravement déficientes. Tous les acteurs savent qu'il nous faut changer de modèle et de pratiques en santé au travail.
J'ai été directeur général de la santé et j'ai piloté nombre de processus de changement et d'évolution des modèles de pratiques en prévention ; je sais d'expérience qu'on ne peut espérer accroître l'efficacité des modèles et des pratiques et améliorer la protection des travailleurs sans une école de référence.
Je le répète, il ne s'agit pas de créer une école monopolistique, mais une école qui mette en réseau les forces existantes, insuffisantes mais néanmoins importantes. Les médecins du travail sont les premiers à être isolés en faculté de médecine, car la médecine du travail est le dernier des soucis des doyens. Il en va de même à l'INSERM, où la santé au travail est un domaine complètement marginal, mais aussi au CNRS. Il s'agit pourtant d'un enjeu essentiel pour la santé des entreprises, pour la santé de notre économie, pour la santé du pays. Cette situation est totalement anormale.
Le groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle en Seine Saint-Denis (GISCOP 93) est un dispositif qui porte uniquement sur les cancers d'origine professionnelle. Je me propose de vous présenter le GISCOP, après quoi je céderai la parole à Émilie Counil, pour un exposé des résultats concernant les expositions, puis à Anne Marchand pour les résultats concernant la déclaration maladie professionnelle. Benjamin Lysaniuk abordera ensuite la méthodologie et certains aspects géographiques, puis Annie Thébaud-Mony pourra vous exposer les préconisations et les recommandations du GISCOP répondant aux demandes de votre commission.
Notre dispositif de recherche-action est donc né en 2002 en Seine-Saint-Denis, un territoire longtemps industriel, à la suite du constat que ce département affichait un taux de surmortalité par cancer parmi les plus élevés du territoire national. Il répondait à un triple objectif, partagé par les chercheurs en santé publique et le conseil départemental de Seine-Saint-Denis : se doter des moyens d'étudier ces cancers, en démontrer l'origine professionnelle, mieux les prévenir.
Le GISCOP s'appuie sur un partenariat solide et durable avec des services hospitaliers du département et avec la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis. Il bénéficie du financement de plusieurs acteurs institutionnels, tels que la direction générale du travail (DGT) et la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère de la santé et, évidemment, le conseil départemental.
Notre démarche s'organise autour de plusieurs séquences : un signalement par les services hospitaliers de tous leurs patients résidant en Seine-Saint-Denis et à qui ont été diagnostiqués des cancers – broncho-pulmonaires ou urologiques pour l'essentiel ; une reconstitution, la plus fine possible, de l'activité professionnelle de ces salariés ou anciens salariés, poste par poste, période par période, depuis la sortie de l'école ou de l'apprentissage jusqu'à la date du diagnostic ; une expertise collective de ces parcours, pour identifier la présence ou non de cancérogènes reconnus dans l'activité de travail et la qualifier ensuite avec un certain nombre d'items. Cette expertise est réalisée par des ingénieurs-prévention, des hygiénistes industriels, des médecins du travail et des délégués des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Sur cette base, le comité d'expertise recommande aux personnes éligibles de faire une déclaration de maladie professionnelle, puis assure, dans le cadre de l'étude, le suivi du parcours d'accès au droit à réparation.
Depuis 2002, nous avons reconstitué un peu plus de 1 300 parcours professionnels, majoritairement des hommes, ouvriers, employés, encore en activité au moment du diagnostic pour 30 % d'entre eux.
Les expertises montrent que près de 85 % de ces salariés ou anciens salariés ont été exposés à au moins un cancérogène au cours de leur vie professionnelle. L'amiante est le cancérogène le plus présent, mais il faut également noter une forte présence de silice, d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, de benzène, de solvants chlorés et de fumées de soudage pour les hommes, de formaldéhyde pour les femmes – qui sont sous-représentées dans notre population.
L'un des résultats majeurs de cette étude est la très forte prévalence des multi-expositions dans ces parcours qui, pour nombre d'entre eux sont également des parcours hachés.
Je suis enseignante-chercheuse en épidémiologie et biostatistiques à l'École des hautes études en santé publique et je collabore avec le GISCOP depuis longtemps. J'ai donc pu, au cours des dernières années, effectuer plusieurs exploitations statistiques des différentes bases de données issues du dispositif, qui constituent un matériau de recherche original.
Tous les résultats que je vais vous présenter brièvement ici sont issus de ces analyses quantitatives. Elles sont conduites en lien étroit avec mes collègues qualitativistes, ce qui est indispensable car, si l'on veut connaître les modes de production des risques professionnels, une approche mixte conjuguant sciences humaines et sociales d'une part, et sciences biomédicales et sciences quantitatives de type épidémiologique d'autre part, est absolument nécessaire.
Mon collègue vient de vous présenter les grandes lignes du tableau de bord qui montrent que les patients sur lesquels s'est appuyée l'enquête sont fréquemment multi-exposés. Outre les différences observées entre hommes et femmes, on constate également de très fortes inégalités d'exposition et de multi-expositions entre catégories socio-professionnelles, résultat que confirme aujourd'hui l'enquête « Surveillance médicale de l'exposition aux risques professionnels » (SUMER), pour les expositions contemporaines. Par ailleurs, on parle souvent de la multi-exposition, mais il s'agit en fait de multi-expositions diverses. En effet, à partir des données de l'enquête analysées au niveau du poste de travail, nous avons mis en évidence une petite dizaine de cocktails différents, qui peuvent être propres à certains secteurs d'activité ou, au contraire, plus ubiquitaires – je précise ici que l'expertise collective sur laquelle repose l'évaluation des expositions s'appuie sur une liste ouverte d'une cinquantaine de cancérogènes avérés ou probables, tels qu'évalués par les instances scientifiques internationales.
Mais, si au lieu de prendre un instantané des postes de travail, on prend en compte l'inscription de ces postes dans les parcours professionnels, on s'aperçoit que les parcours multi-exposés sont extrêmement divers. On observe ainsi que des hommes et des femmes ont été durablement multi-exposés tout au long de leur parcours professionnel, tandis que d'autres l'ont été plutôt en début ou en seconde moitié de parcours, avec des combinaisons de cocktail parfois variées. Il semble donc extrêmement périlleux d'attribuer la maladie d'un patient qui a eu ce type de parcours heurté à un et un seul cancérogène, comme c'est le cas dans le système des tableaux sur lequel reviendra ma collègue Anne Marchand.
Un second enseignement de cette enquête est que ces phénomènes de multiexposition sont aussi à mettre en relation avec la précarisation professionnelle qui est à l'oeuvre depuis les années 1990. En nous fondant sur quatre dimensions décrivant les parcours professionnels, c'est-à-dire la continuité de l'emploi, la stabilité du parcours, la mobilité dans l'échelle des qualifications et la polyvalence de l'activité, nous avons pu dégager un groupe de patients dont les parcours étaient doublement précarisés, parce qu'ils pouvaient s'apparenter à des carrières d'intérimaires et parce qu'il s'agissait également des parcours les plus fortement multi-exposés.
Ce type de parcours se retrouve également dans la population générale, puisque nous avons pu reproduire cette classification statistique sur l'enquête « Santé et itinéraire professionnel » (SIP), en collaboration avec la DREES. Or – et c'est là le troisième enseignement que je souhaitais partager –, nous observons précisément que les patients ayant eu les parcours les plus instables ont également les plus grandes difficultés à obtenir une reconnaissance en maladie professionnelle, une fois leur déclaration faite. Ces difficultés sont également plus importantes lorsque, s'agissant du cancer du poumon, sur lequel nous avons le plus de données, le ou la patiente n'a pas été exposé plus de dix ans à l'amiante et qu'il ou elle a fumé. Or les études épidémiologiques abondent depuis longtemps, qui montrent les interactions – qu'on appelle des effets de synergie – entre les expositions à l'amiante notamment et au tabac. On peut donc s'attrister du fait que les connaissances accumulées en toxicologie comme en épidémiologie soient si peu mises en pratique dans l'examen des liens entre maladie et exposition professionnelle.
Pour finir ce rapide panorama que nous compléterons par l'envoi d'un document présentant les principaux chiffres sur lesquels s'appuie notre propos, nous observons une autre inégalité, structurelle, qui s'inscrit dans la durée et concerne les femmes. Si leurs postes de travail, comme leurs parcours, sont effectivement moins souvent exposés et multi-exposés que ceux des hommes, nous avons pu observer que les nombreux mécanismes qui concourent à l'invisibilisation des liens entre travail et cancer chez les hommes sont renforcés chez les femmes par un certain nombre de biais dans la construction des connaissances, biais que nous appelons biais de genre. Ces biais, qui se traduisent en particulier par une moindre inclusion des types d'emplois occupés par les femmes et les femmes elles-mêmes dans les enquêtes épidémiologiques portant sur les liens entre travail et cancer, conduisent à s'interroger sur l'effectivité de la prévention les concernant : comment prévenir en effet ce que l'on ne connaît pas ? Il contribue également à forger les difficultés particulières que rencontrent les femmes dans l'accès au droit à réparation.
Sociologue et historienne, j'ai accompagné durant cinq ans environ deux cents salariés et anciens salariés atteints de cancers broncho-pulmonaires et leurs proches, dans leur parcours d'accès au droit, tant auprès de l'assurance maladie que des autres dispositifs, comme la commission de réforme pour les fonctionnaires d'État et territoriaux ; je me centrerai surtout ici sur le régime général, malgré des difficultés flagrantes dans le régime de la fonction publique.
J'ai mené en parallèle une recherche historique sur plusieurs fonds d'archives, et notamment ceux de la Commission des maladies professionnelles créée en 1919. Je ne vais pas présenter ici ce travail historique, mais je voudrais quand même attirer votre attention sur deux aspects qui sont le plus souvent ignorés.
Le premier, c'est que le caractère plurifactoriel des maladies est identifié dès 1919, au moment des premiers débats sur l'extension aux maladies professionnelles de la loi de 1898 sur la réparation des accidents du travail ; s'il a fallu autant d'années de débats, durs et âpres, au sein de la représentation nationale, c'est bien que la plurifactorialité des maladies avait d'emblée été identifiée. La question s'est par exemple posée avec le plomb et une maladie aussi connue que les rhumatismes saturnins, pour laquelle le législateur est convenu, avec les médecins, que le lien de causalité ne pouvait être démontré de façon certaine, pas plus qu'on ne pouvait prouver que d'autres maladies étaient de façon certaine causées par le plomb. Il a donc élargi la loi sur la base d'un compromis, celui de la présomption d'origine, assortie d'une réparation forfaitaire. Les débats parlementaires de l'époque font très nettement apparaître que l'on n'est pas assuré que le plomb soit la cause de la maladie et que l'exposition au plomb n'est pas nécessairement produite dans le cadre du travail, mais aussi dans le cadre domestique.
Le second aspect est que le phénomène de sous-déclaration qu'a évoqué M. Bergeret est identifié dès les premières années d'application de la loi. Dans les bilans produits par le ministère du travail sur l'application de la loi de 1919, on constate dès les années 1920 une sous-déclaration des maladies professionnelle, clairement imputable au corps médical, qui fait montre de difficulté, de réticence, voire de résistance à rédiger les fameux certificats médicaux initiaux de maladie professionnelle, qui sont la pièce essentielle pour pouvoir déclarer ces dernières.
Cette difficulté des médecins à rédiger les certificats médicaux, il en est encore fait état dans les premiers rapports de la commission mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale en 1996 et 1997, ainsi qu'a dû vous le dire M. Jean-Pierre Bonin. Les sept rapports parus depuis abordent tous cette question de la formation des médecins et de leur difficulté à rédiger les certificats médicaux de maladie professionnelle. C'est pour cela qu'on a pu les qualifier de garde-barrières de l'accès au droit à réparation.
L'enquête du GISCOP 93 – qui est donc un dispositif de « recherche-action » – montre que 50 % des salariés ou anciens salariés atteints d'un cancer et pour lesquels le parcours professionnel a été reconstitué sont éligibles au droit à réparation ; ils sont donc orientés vers une déclaration. Les trois quarts d'entre eux déclarent leur cancer en maladie professionnelle et, parmi eux, les trois quarts encore obtiennent gain de cause.
M. Bergeret a rappelé les effets de la réparation sur la prévention. Lors du processus d'accès au droit à réparation, il est à noter que la majorité des personnes atteintes de cancer ne l'auraient pas déclaré en maladie professionnelle en dehors de ce dispositif pour plusieurs raisons. La première est qu'ils ne font pas le lien entre leur travail et leur maladie. Cet impensé s'explique par un ensemble de facteurs que je ne peux pas tous citer ici mais parmi lesquels on retrouve, outre les caractéristiques cliniques de la maladie, l'effet différé des risques cancérogènes et le fait que ces salariés ont le plus souvent ignoré qu'ils étaient exposés à des substances cancérogènes. Il leur est très difficile en effet d'imaginer qu'on puisse être exposé légalement à des substances cancérogènes, susceptibles de provoquer une maladie, le plus souvent mortelle.
La seconde raison est qu'ils ont souvent du mal à constituer un appareil de preuves. Si l'on voit en général la déclaration d'une maladie professionnelle comme une démarche administrative, les associations de victimes parlent, elles, de parcours du combattant. Non seulement les salariés doivent apporter les preuves de leur maladie et caractériser leur cancer non comme un simple cancer mais comme un cancer primitif – ce qui implique que les médecins aient fait les investigations nécessaires – mais il leur faut aussi prouver le lien entre la maladie et le travail. Or la majorité d'entre eux sont retraités et ont pu se défaire de leurs justificatifs sur les conseils mêmes des caisses de retraite, qui estiment qu'une fois la retraite calculée, il n'est plus nécessaire de garder les fiches de paie et les certificats de travail.
La plus grosse difficulté reste d'apporter la preuve de l'exposition, et je dois souligner à cet égard combien il est paradoxal de demander à ces victimes de fournir la preuve qu'ils ont été exposés sur leur lieu de travail, alors même que les pouvoirs publics reconnaissent une grosse défaillance dans le système de traçabilité des expositions professionnelles.
Les textes en vigueur ont en effet tendance à ne pas être appliqués. Ce fut le cas pour l'attestation d'exposition, supprimée depuis, mais qui, lorsqu'elle était censée s'appliquer, ne l'a été que par un très faible nombre d'employeurs. De même, l'article de la loi sur les maladies professionnelles qui, depuis 1919, oblige les employeurs à déclarer toutes leurs activités dangereuses en lien avec les tableaux n'est pas non plus appliqué, ainsi que cela est répété de rapport en rapport.
On constate enfin un clivage profond entre les mondes de la réparation et de la prévention. Ainsi, les acteurs qui accompagnent les salariés ou anciens salariés dans leurs démarches – par exemple, les services sociaux des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) – vont majoritairement les orienter vers des demandes d'invalidité plutôt que vers la maladie professionnelle. Cela pose non seulement le problème du niveau d'indemnisation, mais aussi celui de la compréhension du système, qui sépare radicalement le financement de l'invalidité et celui de la maladie professionnelle.
Au sein des caisses primaires d'assurance maladie, l'instruction des dossiers voit l'antagonisme entre deux cultures professionnelles. Ces caisses étant des organismes de droit privé, leur personnel y applique avant tout les règles et le droit de l'assurance maladie, mais les agents qui se spécialisent dans le droit des accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), appréhendent ces dossiers selon des enjeux radicalement différents, ce qui provoque un brouillage.
De même, les médecins conseils ne dépendent pas de la même ligne hiérarchique que les salariés administratifs des caisses d'assurance maladie. Dans certaines, n'étant pas spécialistes des maladies professionnelles, ils vont avant tout appliquer la logique de l'assurance maladie, qui est une logique de contrôle des dépenses d'assurance maladie, alors que l'indemnisation de la maladie professionnelle doit peser sur le budget AT-MP si l'on veut que la prévention fonctionne.
On est donc ici au coeur d'un espace de conflits, d'autant que l'instruction est contradictoire, ce qu'ignorent le plus souvent les assurés, qui font confiance à leur caisse alors que le résultat de l'instruction est avant tout le résultat d'un rapport de forces, sachant en outre que les employeurs exercent de très fortes pressions sur les caisses d'assurance maladie, en étant notamment à l'origine d'un très important contentieux.
On comprend donc que les conditions dans lesquelles sont susceptibles d'être instruits les dossiers ne permettent en rien de compenser l'inégal rapport de forces entre la victime malade et l'employeur, a fortiori lorsque, comme c'est le cas le plus souvent, la maladie professionnelle procède d'une multi-exposition.
La méthodologie utilisée par le GISCOP93 a fait la preuve de sa transposabilité dans divers contextes : auprès des dockers de Nantes-Saint-Nazaire, lors d'une expertise CHSCT pour risque grave dans deux établissements de France Telecom-Orange, et plus récemment dans le Vaucluse. Répondant à la demande des médecins onco-hématologues du centre hospitalier d'Avignon, nous avons mis en place une enquête permanente auprès de patients atteints de lymphomes non-hodgkiniens. Nous sommes en train de créer un GISCOP 84 avec la participation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de l'agence régionale de santé (ARS) et de plusieurs universités ou centres de recherche. Trente-quatre parcours ont d'ores et déjà été expertisés et plus de seize patients ont été orientés vers une déclaration de maladie professionnelle.
Géographe au CNRS, j'ai effectué un post-doctorat au GISCOP 93 portant sur l'identification des lieux d'exposition professionnelle aux cancérogènes en Seine-Saint-Denis. J'ai mené ce travail chronophage à partir de la base de données du GISCOP, qui n'était pas destinée initialement à faire l'objet de traitements spatiaux. Avec l'aide de ma collègue Émilie Counil et de plusieurs étudiants, j'ai pu démontrer la faisabilité de la spatialisation des lieux du risque avéré, pour reprendre les termes employés dans la proposition de résolution à l'origine de la création de cette commission d'enquête.
Nous avons démontré l'écart abyssal entre les courtes listes d'entreprises et d'industries ayant officiellement exposé leurs employés et leurs ouvriers et la triste réalité que des travaux comme ceux du GISCOP 93 mettent en lumière. Cette spatialisation, qui ne repose pas uniquement sur la cartographie, autorise un questionnement à partir du risque avéré, celui d'une exposition à un ou plusieurs cancérogènes. S'intéresser à la localisation des activités exposantes conduit à s'interroger sur la construction historique de ces territoires et, surtout, à entrevoir les possibilités de contaminations environnementales et à se pencher sur la vulnérabilité aux pollutions des populations en contact avec un poison.
J'encadre actuellement deux thèses de doctorat en géographie portant précisément sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. La thèse d'Axelle Croisé, faite en lien avec le GISCOP 93, intitulée provisoirement Rendre visibles les risques d'exposition professionnelle à des cancérogènes en Seine-Saint-Denis, vise à rompre l'invisibilité des cancers d'origine professionnelle en montrant les lieux d'exposition aux principaux cancérogènes recensés dans notre enquête permanente. La thèse de Léa Prost, en lien avec le GISCOP 84 en devenir, Approche géographique des variations spatio-temporelles des cas de lymphomes dans la région d'Avignon, vise à analyser les circonstances d'exposition professionnelle ou environnementale à des substances cancérogènes connues pour leur lien avec le développement de certains cancers. La prise en compte de la structuration du territoire et de son évolution – concentration de la population, type d'occupation des sols – permettra d'apporter des éléments de compréhension sur les circonstances d'exposition.
Ces deux travaux démontrent la fécondité des analyses spatiales réalisées à partir des lieux recensés systématiquement dans le cadre d'entretiens avec les patients. Ce savoir brise l'invisibilité des lieux d'exposition, autorise la formulation de nombreuses questions de recherche et constitue un formidable outil tant pour la prévention dans le cas des entreprises encore en activité que pour l'aide à la reconnaissance des maladies professionnelles.
Je m'appuierai sur l'expérience de quinze ans d'enquêtes continues au GISCOP 93, sur les premiers résultats des travaux menés dans le cadre du GISCOP 84 et sur les études effectuées à partir du « système d'information concret » de l'Association pour la prise en charge des maladies éliminables (APCME) du bassin de Fos, avec laquelle nous collaborons pour répondre à la question suivante : de quelle recherche avons-nous besoin pour briser l'invisibilité des cancers professionnels ?
Il s'agit sans nul doute d'une recherche scientifique indépendante, pluridisciplinaire, rétrospective et prospective pour la connaissance, la reconnaissance et la prévention des cancers d'origine professionnelle, autrement dit une recherche pour l'action ancrée dans les territoires. Une recherche qui ne peut être que publique et financée par des fonds publics, j'insiste sur ce point : les équipes ne sauraient être soumises à une logique d'appels à projets qui ne correspond évidemment pas à la nécessaire continuité des enquêtes permanentes qu'elles conduisent.
Je formulerai trois recommandations essentielles, en rapport avec les objectifs du GISCOP 93.
La première est la connaissance des activités réelles de travail, là où s'enracine le risque. Idéalement, il serait nécessaire de mettre en place dans chaque département un registre des cancers où seraient reconstitués les parcours professionnels et l'histoire résidentielle de chaque patient. Cela permettrait de mieux identifier les activités professionnelles conduisant à ces cancers et les lieux de travail à l'origine de risques environnementaux, mais aussi les inégalités face aux risques, qu'elles soient liées à la sous-traitance, au genre ou à la précarisation.
La deuxième recommandation porte sur la reconnaissance et l'indemnisation des cancers professionnels. Nos exposés vous ont montré l'énorme problème que rencontre la reconnaissance des cancers professionnels. Il faut arriver à ce que le système de réparation prenne en compte l'exposition à plusieurs cancérogènes au poste de travail, en s'appuyant notamment sur une expertise non plus exclusivement médicale mais surtout ergo-toxicologique.
Une inversion de la charge de la preuve s'impose : la preuve du caractère prépondérant du rôle du travail ne devrait pas reposer sur la victime qui, bien souvent, n'est pas à même de la fournir, mais sur les médecins qui auraient à démontrer que le cancer n'est pas d'origine professionnelle. Cela entraînerait un changement profond du fonctionnement du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle (CRRMP).
Autre point saillant : la nécessité d'accompagner les cas déclarés. Dans le cadre actuel du dispositif de reconnaissance des maladies professionnelles, il est quasiment impossible pour les victimes d'aller au terme du processus, qui bien souvent passe par le contentieux. Nous irions beaucoup plus loin dans l'établissement d'un lien éventuel entre déclaration et prévention si nous pouvions élaborer un corpus quantitatif et qualitatif à partir d'analyses systématiques des décisions favorables ou défavorables des CRRMP. Nous avons trop souvent le sentiment que, pour un même cancer, pour une même situation d'exposition et pour un même comité régional, un cas va être reconnu et l'autre non. Il s'agirait d'analyser les ressorts de ces décisions, en particulier les arguments qui ont pesé dans un sens ou dans un autre.
J'en viens à la troisième recommandation, relative à la prévention. J'insiste sur l'importance de dispositifs comme le GISCOP 93 ou les registres départementaux de cancers incluant une reconstitution des parcours professionnels. La maladie est un événement sentinelle qui doit être utilisé pour assainir les postes de travail, comme le soulignent les chercheurs de l'APCME. Ils encouragent la création de ce qu'ils appellent des « cadastres », dans la logique des recherches menées au sein du GISCOP autour de la géolocalisation du risque. Les institutions de contrôle doivent parvenir à contrôler effectivement les infractions qui sont malheureusement légion. Il ne devrait plus y avoir dans notre pays une seule situation de travail exposant à l'amiante. Or il en subsiste des centaines, voire des milliers. Le même constat vaut pour l'ensemble des cancérogènes avérés, sans parler de tous ceux qui nous sont imposés par le système de production.
Enfin, j'insiste sur le rôle du CHSCT dans la prévention des risques graves et dans le développement de l'expertise nécessaire à un travail de fond portant sur l'exposition professionnelle aux cancérogènes.
Dans cette table ronde, je me sens un peu comme un intrus car la FIRPS n'a aucune prétention à être un organisme de recherche. Cependant, la recherche n'est pas étrangère à mon parcours : j'ai travaillé pendant trois ans au CNRS en économie, discipline peu évoquée jusqu'à présent et qui a pourtant son importance, et j'ai participé aux Assises nationales de la recherche en 1982 qui ont constitué un grand moment de rencontre entre le monde de la recherche et ce qu'on appelait alors la demande sociale. C'est cette demande sociale que je vais très modestement essayer de mettre en avant aujourd'hui.
Pour commencer, quelques mots sur la création de la Fédération des intervenants en risques psychosociaux. À la suite des vagues de suicides à France Télécom et d'autres grandes entreprises, Xavier Darcos a lancé un plan de lutte contre le stress au travail et la question avait été posée au ministère du travail de savoir s'il fallait donner un label aux intervenants en risques psychosociaux. La réponse avait finalement été négative mais la profession, jugeant indispensable de réfléchir aux bonnes pratiques de prévention et d'intervention, a créé cette fédération, qui regroupe aujourd'hui une vingtaine de cabinets et 500 consultants spécialisés. Elle a la particularité tout à fait étrange de réunir en bonne intelligence des cabinets travaillant à la demande des directions des ressources humaines des entreprises et des cabinets agréés par les CHSCT, qui seront demain certifiés par les comités sociaux et économiques (CSE).
Nous n'avons pas produit de rapports de recherche mais nous avons élaboré des petits documents très opérationnels sur la prévention du suicide en entreprise, sur la prévention des risques psycho-sociaux lors des restructurations ou encore sur le bon usage des numéros verts, en mettant l'accent aussi bien sur la qualité et la prévention que sur la déontologie car il existe d'importants risques de dérives.
Je mets à part un document plus abouti portant sur le burn-out : disponible gratuitement sur notre site, il a déjà été téléchargé des milliers de fois, ce qui démontre qu'il y a une demande pour des repères stables. S'il y a un sujet sur lequel des inepties ont circulé, c'est bien le burn-out. Des enquêtes fantaisistes ont par exemple affirmé que 3 millions de Français en seraient victimes. Cela s'explique par les carences de la recherche.
Dans la suite de mon intervention, je vais essayer de refléter les besoins de nos clients, qui sont aussi bien des directeurs de ressources humaines que des CHSCT. Si l'on veut faire une politique de prévention utile, il faut commencer par documenter les risques. Si des progrès ont été accomplis en matière de prévention routière, c'est grâce aux analyses menées sur les causes de chaque accident de la route, avec les résultats que l'on connaît puisque le nombre de morts sur la route a été divisé par trois. En matière de santé au travail, nous sommes loin de tels progrès.
Les enjeux liés à la prévention des risques psychosociaux sont considérables : la compétitivité des entreprises – que je n'ai aucun état d'âme à placer en premier – ; l'équilibre des finances publiques, étant donné l'impact sur les comptes de la sécurité sociale ; le bien-être des salariés.
Le coût de la non-santé au travail appelle des recherches opérationnelles réalisées dans des délais rapides. Beaucoup d'entreprises sont prêtes à nouer des partenariats pour avancer sur ces questions.
Je prendrai l'exemple tout récent de l'entreprise Solvay. À la demande des médecins du travail de l'entreprise, un observatoire du surmenage a été mis en place, avec l'approbation de son directeur des ressources humaines (DRH), Jean-Christophe Sciberras, ancien président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Cela a permis d'identifier 33 cas de burn-out en 2016. Ce résultat – qui peut apparaître simple – a quelque chose de révolutionnaire : à ma connaissance, c'est la première fois qu'une entreprise française recense les cas de burn-out. Les identifier n'a pas été compliqué : si les grandes enquêtes nationales ont du mal à s'accorder sur une définition, à l'échelle d'une entreprise, les cas d'épuisement professionnel apparaissent toujours clairement aux représentants du personnel comme à la direction.
Rapporté à l'effectif total de l'entreprise – 6 500 personnes en France et en Belgique –, le ratio est d'une personne sur deux cent. Sur une carrière de quarante ans, en extrapolant, on aboutit à 20 % des effectifs. En proportion de la population active française, cela donnerait 125 000 cas par an, ce qui est une estimation assez proche de celles auxquelles nous sommes parvenus. Aucune étude sérieuse n'a été menée pour évaluer le coût d'un cas d'un burn-out. Intuitivement, je dirai qu'il s'élève à 50 000 euros. Si l'on multiplie cette somme par 125 000, cela fait 6,25 milliards d'euros à l'échelle de la France. Sur ce point, il y a un manque criant de données alors qu'elles sont essentielles.
La dernière enquête de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail sur les risques psycho-sociaux a produit des résultats intéressants. Elle montre des progrès dans la prévention de ces risques, mais dans certains domaines seulement. En matière de soutien social – l'une des grandes catégories utilisées dans le rapport Gollac –, il y a eu des améliorations qu'on peut mettre au crédit des directeurs des ressources humaines, sous la pression des CHSCT. À l'inverse, on observe une dégradation continue pour certains risques, comme le manque d'autonomie au travail, ce qui renvoie à l'organisation et à la stratégie des entreprises. Tant que les directions d'entreprise ou les directeurs de production ne seront pas mobilisés, il n'y aura pas d'autres progrès.
Pour les mobiliser, il existe plusieurs leviers.
Historiquement, le risque pénal a pu inspirer des craintes, mais il est désormais tenu sous contrôle par les DRH. Il n'est du reste pas souhaitable que la peur du gendarme soit le principal moteur de la prévention.
Il y a – innovation récente – le comité social et économique. Si j'en crois les propos qu'a tenus Mme Pénicaud pour le promouvoir, le CSE permettra de débattre dans une même instance des questions de santé au travail et des questions de stratégie de l'entreprise. Je ne suis pas sûr que cela soit très réaliste, mais suivons la ministre sur ce terrain. Cela voudra dire que demain, les représentants du personnel poseront des questions portant sur la santé au travail ou la prévention des risques psycho-sociaux non plus au directeur des ressources humaines mais au dirigeant de la société.
Toutefois, un autre levier me semble nécessaire : l'évaluation du coût de la non-santé au travail. Même les DRH les plus motivés peinent à convaincre les dirigeants d'améliorer la santé au travail car ils ont des difficultés à démontrer que le bien-être des salariés permet de rapporter plus d'argent et d'augmenter l'efficacité globale. Je ne suis pas cynique mais, pour aller plus loin, il faut absolument des arguments de ce type. Tant que les dirigeants ne seront pas convaincus que l'entreprise sera plus efficace si elle mène une meilleure politique de prévention, les progrès se feront attendre. Cela suppose d'avancer sur le terrain économique et sociologique, notamment à travers des études monographiques. Beaucoup d'entreprises sont prêtes à ouvrir leurs données.
La FIRPS a proposé de mettre en place un collège d'expertise sur les coûts de la non-santé au travail sur le modèle du rapport Gollac, qui a apporté une contribution décisive pour un coût dérisoire pour l'État. Il a déblayé le terrain et, désormais, les questions liées à l'élaboration de définitions et de catégories sont derrière nous. Voilà qui permet d'avancer avec des personnes de bonne volonté.
Cela suppose toutefois de résoudre quelques problèmes de méthode. Il faut poser la question de François Perroux : les coûts pour qui ? Prenons le cas d'un salarié victime de burn-out. Une partie des coûts pèsera sur lui : sa carrière sera compromise, il devra acquitter des restes à charge. Une autre partie reposera sur la protection sociale : l'évaluation de ces coûts devrait être assez facile mais cela suppose une ouverture contrôlée des bases de données et des moyens financiers, donc de faire sauter quelques verrous, même si la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a commencé à travailler sur ce sujet. Enfin, une troisième partie relève des entreprises, mais ces coûts sont assez compliqués à établir car ils sont mutualisés avec la sécurité sociale. Que le burn-out ait un coût élevé pour l'entreprise n'est pas toujours une évidence. Dans le cas de Solvay, M. Sciberras nous confirmera sans doute que les trente-trois victimes n'étaient certainement pas des salariés inutiles qui ne faisaient rien, bien au contraire puisque le burn-out affecte souvent des personnes très engagées dans la marche de l'entreprise et porteurs d'enjeux majeurs.
S'il y a un minimum de volonté politique, quelques avancées rapides peuvent être faites et elles sont nécessaires aussi bien pour les salariés que pour les dirigeants d'entreprise.

Je vous remercie pour la richesse de vos interventions qui rejoignent les préoccupations de cette commission d'enquête.
Les membres du GISCOP93 ont évoqué l'extension de leurs travaux à d'autres départements : selon quelles modalités ? Peuvent-ils être généralisés à l'échelle nationale ? Ses méthodes sont-elles transposables à d'autres pathologies que les cancers ?
Par ailleurs, j'aimerais savoir si vous rencontrez des obstacles dans l'accès aux données de l'assurance maladie. Comment, selon vous, améliorer l'utilisation de données aujourd'hui inexploitées ?
L'expérience a montré que les enquêtes permanentes ne peuvent se développer que sur une base territoriale en prenant appui sur une collaboration avec des services hospitaliers volontaires. C'est le chef du service d'hématologie du centre hospitalier d'Avignon qui nous a sollicités pour une collaboration après avoir eu connaissance des travaux que nous menions. Cela suppose que les services d'oncologie soient incités à se doter d'une cellule de reconstitution des parcours professionnels et que ceux-ci fassent l'objet d'une expertise par un collectif pluridisciplinaire. Si notre méthodologie s'est construite en deux temps – reconstitution des parcours professionnels puis expertise –, c'est que, très majoritairement, les patients atteints d'un cancer ne connaissent pas les expositions auxquelles ils ont été soumis. C'est le croisement des expériences des ingénieurs de prévention des caisses régionales d'assurance maladie, des médecins du travail et des délégués de CHSCT qui permet d'identifier les expositions aux cancérogènes.
Par ailleurs, nous obtiendrions de bien meilleurs résultats si chaque département était doté d'un registre recensant les cancers auquel serait accolé un GISCOP, selon diverses configurations. Le GISCOP 84, par exemple, repose sur une organisation différente de celle du GISCOP 93 car l'aire de recrutement des patients du centre hospitalier d'Avignon excède les limites du département.
Il est nécessaire de nouer des collaborations avec les institutions au plus près du terrain. Dès le départ, en Seine-Saint-Denis, nous avons ainsi développé des liens avec la caisse primaire d'assurance maladie, avec le service social de la caisse régionale d'assurance maladie et avec le service de prévention. L'ancrage territorial est décisif car c'est l'un des moyens de faire avancer la recherche pour l'action. C'est à travers ces coopérations que l'accompagnement des patients en vue de la reconnaissance de leur maladie professionnelle s'est opéré et que des questionnements sur la prévention ont surgi.
Bref, il est nécessaire de s'appuyer sur les services déconcentrés de l'État que sont les DIRECCTE, comme l'a fait le GISCOP 93 et comme le fera le GISCOP 84, ou sur les services territorialisés que sont les agences régionales de santé ou les caisses primaires d'assurance maladie.
Après, se pose le problème de l'accès aux données nationales – celles de l'assurance maladie ou celles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS). Le GISCOP 93 bute, par exemple, sur l'impossibilité d'accéder aux déclarations annuelles de données sociales (DADS) que doivent remplir chaque année les entreprises.
Nous nous heurtons à ces obstacles dans le cadre d'un projet de Partenariat institutions-citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) financé par la région Ile-de-France qui porte sur la contamination environnementale engendrée par les activités de l'usine de broyage d'amiante du Comptoir des minéraux et des matières premières (CMMP) à Aulnay-sous-Bois. Pour évaluer le nombre et l'âge des salariés qui ont travaillé dans cette entreprise, nous sommes entrés en contact à plusieurs reprises avec la CNAVTS qui nous oppose qu'elle ne peut nous fournir des données nominatives confidentielles et qui nous renvoie à l'agence régionale de santé. Nous ne cherchons pourtant à connaître ni les noms des salariés ni leurs adresses.
Le dispositif mis en oeuvre par le GISCOP 93 est-il transposable à d'autres pathologies ? Bien sûr. Le fondement de nos enquêtes est de considérer la maladie comme un événement sentinelle. Notre démarche peut donc être appliquée à des maladies cardio-vasculaires ou neurologiques – je pense aux pathologies causées par les pesticides.
J'ajoute que, plus on est proche des lieux d'exposition, plus les chances de développer une connaissance utile pour l'action sont grandes.
Beaucoup de CHU ont développé dans le cadre des consultations de pathologies professionnelles des interrogatoires systématiques de patients hospitalisés dans les services de pneumologie ou d'hématologie. Le centre régional de lutte contre le cancer (CLRCC) de la région Auvergne-Rhône-Alpes a, par exemple, mis en place de semblables dispositifs.
Avant de généraliser les registres départementaux, peut-être pourrait-on d'abord renforcer l'établissement d'un lien entre cancer et milieu de travail dans ceux qui existent déjà.
Nous avons eu le plaisir de collaborer une fois avec le GISCOP 93 et je peux vous confirmer que ses méthodes sont transposables.
Quand il y a un suicide sur le lieu de travail, nous intervenons souvent à la demande des CHSCT. Il ne s'agit pas pour nous d'identifier les causes du suicide – question intime qui appartient à la personne qui a choisi de mettre fin à ses jours –, ni même d'établir une responsabilité ou de déterminer s'il s'agit ou non d'un accident du travail. Consciemment ou inconsciemment, nous nous inspirons des méthodes du GISCOP en reconstituant le parcours d'exposition aux risques psychosociaux sur une longue durée, allant jusqu'à trente ans, et en recherchant d'éventuelles pluriexpositions. J'ai souvent constaté qu'une exposition ancienne à des situations traumatisantes pouvait susciter, dix, quinze, voire vingt ans plus tard la peur d'endurer à nouveau des souffrances extrêmes et de ne pas arriver à les supporter même si l'événement déclencheur paraît moins grave. C'est comme une cicatrice qui se rouvrirait. Et l'on peut tout à fait arriver à la conclusion qu'il n'y a aucun lien avec le travail, comme pour les cancers. L'usage d'une méthode ne préjuge pas des conclusions.
J'aimerais apporter quelques compléments pour la bonne information de votre commission.
La question du lien du cancer avec les expositions professionnelles soulevée par le GISCOP est très importante. Les données d'Eurostat montrent que notre pays a le taux de mortalité évitable avant soixante-cinq ans le plus élevé d'Europe, avec 92 décès pour 100 000 personnes contre 40 pour 100 000 pour la Suède, ce qui représente un écart considérable. Parmi les causes de mortalité des hommes d'âge moyen en France, le cancer arrive au premier rang. Une analyse épidémiologique d'ensemble amène à suspecter que les expositions professionnelles sont à l'origine de cette situation. Autrement dit, ce dont nous sommes en train de parler recouvre des problèmes dramatiques au niveau individuel et des problèmes d'équité dans la reconnaissance du préjudice causé par le travail, mais constitue aussi un énorme enjeu de santé publique, compte tenu de l'impact sur la perte d'espérance de vie des hommes en France.
J'appelle l'attention de la commission d'enquête sur un point particulier : notre capacité à générer des données qui ne sont pas exploitées. Cela renvoie à la faiblesse de l'appareil de recherche et des financements.
Ainsi, l'absence au travail – donnée dont toutes les entreprises disposent puisque les fiches de paie en tiennent compte – n'est pas analysée. Les documents uniques d'évaluation des risques – que remplissent environ la moitié des entreprises conformément à un décret de 2001 – ne sont analysés ni au plan régional ni au plan national. Les fiches d'exposition que les entreprises sont obligées d'établir ne sont pas davantage exploitées. Demander aux entreprises de remplir des formulaires dont on ne fait rien n'a évidemment aucun caractère incitatif. Cela contribue même à renforcer l'image d'une santé au travail à visée bureaucratique et non préventive.
Les rapports annuels des médecins du travail devraient être consolidés au niveau régional par les médecins inspecteurs mais, compte tenu des moyens dont ils disposent, ils ne sont pas en mesure de le faire.
Enfin, les registres de cancers pourraient servir de laboratoires pour généraliser la recherche de l'imputabilité des expositions professionnelles mais ils ne sont pas non plus utilisés.
Si les données que nous produisons ne sont pas traduites en actions de prévention, nous aurons des documents uniques mais pas de documents utiles.
Actuellement, les registres de cancers ne comportent aucune donnée relative à la profession des patients. Il n'y a donc rien qui permette de déterminer les facteurs de risque et d'agir en conséquence. La seule analyse utile que nous pourrions en faire serait une spatialisation mettant en évidence des concentrations de cas à certains endroits. Grâce à l'expérience que nous avons acquise depuis une vingtaine d'années, nous avons acquis la conviction que les enquêtes permanentes devraient déboucher sur des systèmes d'enregistrement départementaux tenant compte des parcours professionnels et résidentiels.
Une étude menée par l'Institut syndical européen pour la Confédération européenne des syndicats a montré qu'en Europe, il y avait en moyenne entre 100 000 et 150 000 décès par an causés par des cancers liés au travail. Elle a aussi établi les coûts considérables que cela engendrait – je n'ai pas les chiffres en tête, nous vous les communiquerons. En matière de santé publique, il est très important de prendre en compte le coût des cancers professionnels non reconnus.
Le GISCOP effectue des études sur les expositions aux cancérogènes avérés. Qu'il s'agisse de l'amiante, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, de la radioactivité ou du benzène, il n'y a plus à apporter la preuve que ces substances donnent le cancer. À partir du moment où des personnes y ont été exposées, elles devraient bénéficier d'une reconnaissance de droit. Du point de vue de la prévention, il ne faut pas attendre d'observer un nombre excessif de cancers « validés » dans telle ville ou dans telle entreprise pour protéger les travailleurs et la population. Cela relève de l'urgence.
Le cas de Fos-sur-Mer a été beaucoup évoqué sur la place publique. Ce matin même, j'étais amenée à donner mon avis sur un reportage consacré à cette pollution environnementale diffusé dans le cadre du Magazine de la santé de France 5. L'accent est mis sur la population tandis que les affections dont souffrent les travailleurs constituent un angle mort. Pourtant, à la cokerie ArcelorMittal, il y a eu en dix-sept ans, de 1998 à 2015, sur un effectif de 300 personnes, 39 cancers professionnels reconnus – 22 parmi les 200 salariés permanents et 17 parmi les 100 sous-traitants –, selon les chiffres de l'assurance maladie enfin obtenus par l'APCME.
Si les cancers développés par les travailleurs étaient considérés comme des événements sentinelles de la santé au travail et de la santé environnementale, nous ferions un grand pas vers notre objectif : briser l'invisibilité des cancers professionnels et environnementaux.
Je partage le constat établi par William Dab selon lequel beaucoup de données dorment alors qu'elles pourraient être assemblées et mises à la disposition de la recherche utile à l'action. Toutefois, il existe une tension entre la nécessité de disposer de données générales, issues du système de santé et des grandes enquêtes nationales, et celle d'élaborer des enquêtes ad hoc.
Pour cerner les inégalités sociales face au cancer, la France n'a que de faibles moyens. Prenons la mortalité par cancer. Les données du Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDC) géré par l'INSERM ne permettent pas d'établir un lien entre les causes du décès et le parcours professionnel. En outre, il y a eu une longue interruption dans le temps dans les possibilités d'appariement des différentes sources de données, notamment celles de l'échantillon démographique permanent et du CépiDC.
Pour croiser ces données, les chercheurs se heurtent à plusieurs problèmes. Il y a d'abord l'incomplétude des données relatives aux personnes nées ou décédées à l'étranger qui n'ont généralement pas les mêmes parcours professionnels. Une partie du spectre des inégalités sociales liées au travail ne peut donc être mis en évidence du fait d'un mécanisme d'invisibilisation statistique. Il y a ensuite une inadéquation des données disponibles qui ne permettent pas de reconstituer l'ensemble du parcours professionnel. Il y a encore les difficultés d'accès aux données, les procédures étant assez lourdes. L'ouverture des données de santé nous laisse toutefois espérer une amélioration.
Reste qu'il faudra continuer à mener des études ad hoc car il s'agit de populations qui demeurent invisibles dans l'appareil statistique national.
J'aimerais fixer quelques ordres de grandeur pour votre commission.
Santé publique France, utilisant la méthode de la fraction attribuable des risques, estime à 25 000 le nombre de cancers attribuables aux expositions professionnelles chaque année. Or il y a moins de 2 000 cancers reconnus en maladie professionnelle, soit un rapport de un à dix. Cet écart montre qu'il y a un dysfonctionnement profond dans la manière dont la prévention en santé au travail est prise en compte dans notre pays.
Précision supplémentaire : j'ai sous les yeux le rapport de Santé publique France : le nombre de 25 000 est établi à partir d'un nombre limité de substances cancérogènes – quatre seulement – et de localisations de cancers – moins de dix. Les combinaisons entre cancérogènes et localisations sont donc réduites, ce qui laisse supposer que la sous-déclaration est un phénomène plus important encore.

Comment faire la part entre la non-déclaration et la non-reconnaissance ? Nous savons que les travailleurs ont des difficultés à faire valoir leurs droits. Hier, les représentants des industries de la chimie nous expliquaient que les travailleurs se voyaient remettre un document leur offrant la possibilité de bénéficier d'un suivi a posteriori mais que peu en faisaient usage. C'est l'une des grandes problématiques de la prévention secondaire.

Selon les données dont nous disposons, 80 % des 1 800 cas reconnus de cancer sont liés à l'amiante, ce qui est considérable. Peut-être y a-t-il une sous-estimation des autres cas, compte tenu de la relative facilité à faire reconnaître les cancers liés à l'amiante – je ne veux pas dire, néanmoins, que ce n'est pas un parcours du combattant.
On a le sentiment que l'expertise sur la question de la santé environnementale monte en puissance. Mme Thébaud-Mony a souligné que cela peut conduire à un angle mort, car l'origine professionnelle d'un certain nombre de maladies passe à l'arrière-plan. Quel regard portez-vous sur l'évolution de la recherche et de son organisation ? Comment faire pour que la santé environnementale et la santé au travail ne s'opposent pas ? Confirmez-vous que c'est un vrai sujet ?
Mme Counil a dit en substance que les connaissances scientifiques sont trop peu utilisées. Est-ce un sentiment partagé ? Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce sujet ?
Le caractère multifactoriel de certaines pathologies a pu faire l'objet de débats – nous l'avons d'ailleurs constaté ici-même, à l'Assemblée nationale. C'est un phénomène qui est souvent invoqué en vue de ne pas reconnaître l'origine professionnelle d'une pathologie. Comment faut-il s'y prendre pour établir la réalité ? Le lien entre la présomption d'origine et l'indemnisation a été évoqué : jugez-vous que le système est satisfaisant ou, au contraire, qu'il a atteint ses limites ?
Nous n'avons pas encore abordé, ou de manière seulement périphérique, la question des fiches d'exposition, qui ont été en partie supprimées récemment. Y a-t-il un système de suivi et de déclaration qui serait plus efficace qu'un autre ? Que doit-on faire ? Après la série de réformes qui sont intervenues dans un temps extrêmement court, comment voyez-vous la situation ?
La cohorte « Constances » a été évoquée par M. Dab. Pouvez-vous revenir sur l'intérêt des recherches menées dans ce cadre ? Que pourrions-nous en tirer pour notre part ?
Notre préoccupation majeure, comme l'indique l'intitulé même de cette commission d'enquête, est de parvenir à éliminer les pathologies professionnelles qui peuvent l'être, grâce un travail de prévention allant jusqu'à une modification des postes de travail, des processus de production et de l'organisation, si nécessaire. Nous voulons formuler des propositions utiles. Il y a notamment la question de la recherche, sur laquelle vous avez mis l'accent : nous suivrons cette piste dans notre rapport. Je vous invite à nous faire part de propositions concrètes si vous le souhaitez.
Il y a ce que j'appelle souvent une conspiration du silence. Je ne le dis pas dans une perspective machiavélique, mais je pense qu'il existe un problème culturel autour de la notion de multifactorialité des maladies chroniques. C'est d'abord un problème de compréhension médicale et scientifique : le modèle pasteurien – un facteur, une maladie – est encore très prégnant dans notre pays et empêche le développement d'un raisonnement, en matière d'évaluation des risques, qui tienne compte du progrès des connaissances. Ce phénomène est, de fait, instrumentalisé. Sur ce point, je renvoie dos à dos le patronat et les organisations syndicales. En ce qui concerne le patronat, la sous-déclaration des maladies professionnelles, avec les implications financières que cela comporte, n'incite pas à faire évoluer le système des tableaux qui suit le modèle pasteurien. Il en est de même pour les organisations syndicales, pour la raison que vous avez évoquée. Nous sommes plusieurs ici, je crois, à avoir passé du temps avec ces organisations, à avoir essayé d'expliquer la réalité épidémiologique. Elles la comprennent, mais craignent que cela ne serve de prétexte à exonérer les employeurs de leur responsabilité au regard des expositions professionnelles. La situation est bloquée et je n'ai pas encore trouvé la clef pour en sortir – j'ai pourtant beaucoup réfléchi à cette question et j'en ai parlé avec de nombreux acteurs. Le terme de conspiration, que j'ai employé, est peut-être un peu fort, car il sous-entend une préméditation, mais il existe quand même une complicité objective qui bloque.
Une solution existe, au plan technique, à laquelle nous pourrions réfléchir : de même que l'on finira par avoir un dossier médical informatisé et accessible par internet, pourquoi n'aurait-on pas un dossier d'exposition professionnelle qui suivrait chacun de nous pendant toute sa vie ? Le fameux document unique, obligatoire, servirait à assurer le repérage des expositions. Cet outil technologique permettrait peut-être de faire évoluer notre vision et d'aller vers une meilleure prise en compte de la plurifactorialité des maladies.
« Constances » est l'une des plus grandes cohortes au plan mondial : elle concerne 200 000 assurés du régime général, qui ont été tirés au sort – il se trouve que je l'ai été. Je connaissais le dispositif, car la direction générale de la santé a donné le premier financement qui a permis de construire le protocole. Je le vis maintenant de l'intérieur. Il y aura un suivi sur la totalité de la vie : tous les événements de santé sont enregistrés, c'est-à-dire tout ce qui fait l'objet d'une transaction passant par la carte Vitale – les médicaments, les hospitalisations, mais aussi les absences au travail. L'histoire professionnelle ainsi réalisée est très complète : le premier entretien prend près d'une heure, ce qui est tout à fait remarquable. Un bilan de santé initial est établi dans l'un des centres d'examens de santé de l'assurance maladie, qui commencent donc à avoir une utilité (Sourires), puis un autre examen aura lieu tous les cinq ans – il concernera les données biologiques et radiologiques, ainsi qu'un examen clinique complet, une exploration fonctionnelle respiratoire et un électrocardiogramme. « Constances » est une plateforme à la disposition des chercheurs, et non un projet. Ce n'est pas non plus un dispositif de financement : si le conseil scientifique de « Constances » estime qu'un projet est éligible, il faut trouver un financement.
Mon laboratoire a développé un indicateur de mesure de l'implication des entreprises dans la prévention, sur le terrain. Il y avait déjà des travaux canadiens, britanniques, américains et australiens. Notre idée est d'injecter le score dans la cohorte pour regarder dans quelques années s'il y a un lien entre l'évolution de l'état de santé et l'implication concrète des entreprises en matière de prévention. Le conseil scientifique de « Constances » a donné une réponse positive, considérant que c'est une excellente idée, mais je n'arrive pas à trouver de financement. Chaque rapport d'évaluation souligne que le projet est bien construit, ambitieux et nécessaire, mais on nous dit qu'il n'est pas dans le champ de l'appel d'offres. Nous n'entrons pas dans le cadre de l'ANSES, qui a un appel d'offres portant sur les agents chimiques, physiques ou biologiques, car notre projet est transversal. L'INSERM trouve que c'est formidable, mais souligne qu'il est question de santé au travail, alors que l'appel d'offres porte sur la prévention générale. On avance en bricolant, comme le font tous les directeurs de laboratoire, mais il va falloir valider le score et l'injecter dans « Constances » à un moment donné. Que l'on trouve un lien ou non, il y a des implications pratiques importantes pour la prévention sur le terrain. Et pourtant, il n'y a pas un seul appel d'offres en France pour financer ce projet. La prévention sert-elle à quelque chose et peut-on le mesurer ? C'est quand même le b.a-ba.
Il existe deux types de multi-expositions : elles peuvent être professionnelles et non-professionnelles – c'est le cas auquel tout le monde pense – mais il y a aussi une multi-exposition professionnelle, comme les représentants du GISCOP93 l'ont souligné : cela peut concerner l'amiante et les fumées de soudure. Autre exemple : la manutention manuelle des charges lourdes et les postures – elles ne figurent pas, néanmoins, dans le tableau de maladies professionnelles correspondant. William Dab l'a rappelé : on ne peut plus dire « une maladie, un risque ». Pour un certain nombre de maladies, il faut arriver à faire en sorte que les tableaux deviennent multifactoriels, même si je sais que ce n'est pas facile et que cela bouscule tout ce que l'on a fait depuis un siècle – j'ignorais cependant les premiers débats de 1919, qui ont été rappelés tout à l'heure.
On parle depuis de nombreuses années de la réparation intégrale. On se rend compte qu'un certain nombre de réparations ont très largement dépassé en qualité celle des maladies professionnelles et des accidents du travail, mais toutes les tentatives d'amélioration se sont traduites par des échecs. On les a contournés avec des fonds d'indemnisation, comme le FIVA pour l'amiante, ou dans le cadre d'une faute inexcusable de l'employeur, mais ce ne sont pas des solutions idéales, loin de là. Il faudrait arriver à ce que la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles soit d'une qualité équivalente à celle des accidents de la vie courante ou d'autres cas non liés au travail.
Y a-t-il une opposition entre la santé au travail et la santé environnementale ? Je veux quand même rappeler que l'on a développé le concept de « travailleurs sentinelles » pour l'environnement, parce que les travailleurs sont plus exposés que la population générale. À Aulnay-sous-Bois, par exemple, il y a la question de la reconstitution du personnel de l'usine, mais toute la population qui vivait alentour a aussi été exposée. Il n'existe donc pas d'opposition entre santé au travail et santé environnementale. L'appel d'offres de l'ANSES que j'ai évoqué tout à l'heure porte, du reste, sur ces deux domaines. Si je vous ai dit que je suis le coprésident du comité des appels d'offres, c'est qu'il y a aussi un coprésident pour les questions liées à l'environnement.
Enfin, je voudrais souligner à mon tour, après William Dab, que l'on a besoin d'un pilote d'ensemble. La dispersion totale, dans tous les sens, n'est plus possible.

En ce qui concerne les expositions, Mme Counil a évoqué la dimension transversale et multifactorielle. N'est-ce pas précisément sur ce plan que le recours aux CRRMP présente un intérêt par rapport à l'utilisation des tableaux des maladies professionnelles ?
Lorsqu'une maladie figure sur un tableau, le CRRMP a pour mission de se prononcer sur une exposition qui ne s'est pas produite tout à fait de la manière décrite dans le tableau : pas selon la durée prévue ou hors du délai de prise en charge. On est un peu coincé. Quand une personne a une sciatique par hernie discale, par exemple, on va regarder si et dans quelles conditions elle a fait de la manutention – quand je parlais des postures tout à l'heure, c'était en pensant au CRRMP. En revanche, celui-ci est totalement libre quand une maladie n'est inscrite dans aucun tableau : il peut éventuellement additionner des expositions. C'est possible, mais il s'agit quand même d'un système de rattrapage, non contentieux. Le double mode de reconnaissance, par présomption d'origine et par preuve, est prévu par les législations française et européenne ainsi que par les conventions du Bureau international du travail, mais ce n'est pas très simple. Cela dit, créer des tableaux de maladie professionnelle pour les multi-expositions me paraît aussi une aventure.

Je ne veux pas pousser à ce que le débat s'engage sur ce point en particulier, mais ça me semble en effet un peu complexe intellectuellement et médicalement. On se demande parfois si les CRRMP ne pourraient pas jouer un rôle plus important dans le traitement de la transversalité. Mais il y a aussi la question de savoir pourquoi on n'aboutit pas toujours aux mêmes conclusions au sein d'un même CRRMP ou entre des CRRMP différents.
J'ai écouté attentivement ce qu'a dit Mme Thébaud-Mony sur ce sujet. J'ai été membre, et même président, de commissions chargées de travailler sur des guides destinés aux CRRMP – vous savez qu'ils sont élaborés depuis 1993. Les membres des CRRMP réclament à peu près depuis la même date une sorte de thésaurus qui leur permettrait de savoir ce qui a été décidé précédemment dans des situations identiques, et pour quelles raisons. C'est très difficile, car nous n'avons que des données squelettiques. Au plan national, elles portent seulement sur les maladies concernées et la reconnaissance ou non – il n'y a rien sur les dossiers eux-mêmes.
Je voudrais apporter un bref complément sur la question des liens entre santé-environnement et santé au travail.
Nous sommes tous convaincus, me semble-t-il, des liens forts qui existent entre ces deux sujets. Comme enseignante au niveau master et comme encadrante, ou co-encadrante, de doctorants, j'observe néanmoins que l'attractivité des questions de santé-environnement est plus forte que celles de santé au travail. Il y a peut-être des lieux très particuliers où ce n'est pas le cas, mais j'enseigne dans des masters de santé publique généralistes et internationaux, où l'on est plutôt intéressé par des questions de santé globale ou de prévention en lien avec l'alimentation et l'activité physique – tous les grands classiques de la santé publique. La santé au travail a beaucoup de mal à trouver sa place dans ce cadre : elle figure souvent dans des modules appelés « santé-environnement » et « santé-travail », dans lesquels elle demeure minoritaire.
Il y a sûrement un travail à faire sur les formations et leur architecture. Je suis certaine qu'il existe des formations où l'on trouve un bon équilibre – certaines sont même spécialisées en santé au travail –, mais il reste difficile d'attirer les jeunes et de les amener vers des thèses quand ces thèmes sont dilués dans la santé publique. Par ailleurs, nous sommes tous mis en compétition pour des ressources limitées. Ne pas trop diluer la santé au travail dans les questions de santé-environnement est donc un véritable enjeu.
Même si les deux aspects peuvent être intimement liés dans certains cas, comme celui de l'amiante – on l'a bien vu à l'usine d'Aulnay-sous-Bois – il y a souvent une large déconnexion. Je pense, par exemple, aux travaux sur les liens entre la pollution atmosphérique et la santé. Il faudrait prendre en compte à la fois la santé au travail et la santé-environnement, en évitant une situation de compétition, sur le plan de la recherche et de la santé publique, pour avancer le chiffre qui influera le plus sur l'attribution de ressources ou le déclenchement d'actions.
Quand j'ai évoqué l'insuffisante utilisation des connaissances accumulées, je faisais précisément référence à la question des multiexpositions : on continue à mettre en concurrence l'exposition au tabac et celle à l'amiante dans le cadre de l'examen qui a lieu au sein des CRRMP.
Les fractions attribuables ont été critiquées par beaucoup de travaux méthodologiques menés en matière d'épidémiologie, dans le cadre de communautés scientifiques différentes, car c'est un vaste champ. C'est un outil à la frontière entre le scientifique et le politique, reposant sur un certain nombre d'hypothèses conceptuelles et de choix méthodologiques qui sont susceptibles d'être critiqués, et qui rendent même, pour certains chercheurs, l'exercice relativement dangereux dans certains cas.
Je voudrais également souligner que le démantèlement annoncé de la direction de la santé au travail de Santé publique France, notamment avec une externalisation possible de l'équipe qui s'intéresse particulièrement aux expositions professionnelles, est pour nous un sujet de préoccupation, selon la reconfiguration qui sera choisie in fine.
L'équipe en question a produit des données à partir du croisement des parcours professionnels au sein d'un grand échantillon, en France, et des matrices emplois-expositions, dites « Matgéné », qu'elle a construites. Cela permettrait d'ores et déjà d'essayer de calculer des fractions attribuables par catégories socioprofessionnelles, au lieu d'avoir des fractions attribuables en population générale, qui reflètent une réalité très « moyennante » et ne correspondent pas à l'inégale distribution des expositions et du fardeau des maladies. C'est un petit pas que l'on pourrait faire à partir des données disponibles en France, même si les estimations ne seraient pas parfaites pour autant – et même si on pourrait aussi remettre en cause la démarche qui consiste à calculer des fractions attribuables, je l'ai dit.
Vous avez demandé pourquoi certaines personnes, notamment atteintes de cancer, mais c'est également vrai pour d'autres maladies, ne s'engagent pas dans une démarche d'accès au droit à réparation.

Oui, mais ma question était plus globale : pourquoi ne fait-on pas valoir, dans un premier temps, son droit au suivi médical ? Nous en avons parlé hier avec les industriels de la chimie. Des personnes ont droit à un suivi médical spécifique, mais il faut informer le médecin traitant, ce qui ne se fait pas.
Je voudrais aussi rebondir sur ce qu'a dit M. Dab au sujet du dossier médical partagé (DMP) – en soulignant que, pour une fois, ce n'est pas moi qui évoque cette question… Vous savez que nous souhaitons mettre en place le DMP à partir du mois d'octobre. Il nous a été dit qu'il serait intéressant de réaliser une véritable traçabilité des parcours professionnels complets via ce dispositif, non pas en allant des médecins traitants vers la médecine du travail, parce que cela pose des problèmes médico-légaux, mais de la médecine du travail vers les médecins traitants. Ce serait une avancée phénoménale. On rejoint un peu la question du registre, puisque l'on pourrait interconnecter la partie relative aux pathologies – avec les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et les remboursements – et ce qui concerne les expositions. C'est une mine d'informations qui me paraît très intéressante et très importante.
Le cancer, comme l'épuisement professionnel et beaucoup de maladies, est effectivement multifactoriel et il est impossible d'isoler une cause par rapport aux autres. Il y a une concurrence pour la représentation dominante d'une maladie. Pour le cancer, comme beaucoup d'autres maladies, la représentation qui s'est imposée – mais cela n'a pas toujours été le cas – est qu'il s'agit du résultat de comportements individuels.
Cette représentation dominante influe sur les médecins, qui sont en première ligne pour ouvrir leurs patients à la possibilité de déclarer et les éveiller à l'hypothèse d'une origine professionnelle de leur cancer. Le fait de privilégier une origine individuelle plutôt que collective, notamment professionnelle, correspond à une culture ancienne chez les médecins. Même si cela peut sembler trivial, le médecin veut avoir une possibilité d'agir sur quelque chose, et il est plus facile de le faire sur le comportement individuel du patient que sur des expositions cancérogènes au travail, en s'insérant dans un rapport de forces où l'on va être accusé d'être du côté des travailleurs ou des employeurs. Il est plus facile de se tourner vers les comportements individuels que sont le tabagisme ou l'hygiène de vie.
On revient donc au sujet de la fracture entre la santé environnementale et la santé au travail. Nous disons tous que c'est lié, mais il y a quand même des cadres juridiques distincts, qui influent fortement sur la possibilité de penser les liens et d'agir : en tant que salarié d'une entreprise, on peut se saisir du droit du travail, mais la réparation relèvera du droit de la sécurité sociale, et l'environnement correspond à d'autres droits encore, avec des corps constitués qui sont différents à chaque fois. Cette fragmentation juridique a une influence sur ce que les gens peuvent faire.
J'ai rappelé l'histoire de la multifactorialité pour souligner que cette question n'est pas nouvelle : je voulais nuancer de nombreux travaux selon lesquels elle est surtout liée à l'augmentation du nombre de cancers, des troubles musculo-squelettiques (TMS) et des risques psychosociaux, et que c'est dans un contexte d'apparition de maladies multifactorielles que le système de réparation est déstabilisé. En réalité, il a été conçu d'emblée dans un contexte de maladies multifactorielles. L'un des points de compromis a été d'instaurer une réparation forfaitaire. Elle ne suffit plus aujourd'hui parce que, comme l'a rappelé M. Bergeret, elle entre en tension avec d'autres formes de réparation qui, elles, sont intégrales. Avec la réparation forfaitaire, on voit que la valeur d'un corps abîmé au travail est finalement moindre que dans d'autres cadres, ce qui pose un vrai problème éthique.
Pourquoi les gens ne cherchent-ils pas à accéder à leurs droits ? Il y a la représentation dominante que j'ai évoquée, mais aussi le fait que l'on propose une indemnisation, et non une réparation du préjudice subi. C'est paradoxal : au lieu de soutenir les victimes, on fait reposer sur elles tout le fonctionnement du système de réparation et son imbrication avec la prévention. Si l'on ne déclare pas, cela pèse sur notre représentation des maladies et sur la prévention. On devrait donc aider les gens à déclarer. Aujourd'hui, ils ont le sentiment d'être considérés par certains acteurs comme mus par l'appât du gain s'ils veulent le faire : comme ils sont déjà pris en charge par la sécurité sociale au titre des affections de longue durée et que beaucoup de choses sont mises en place pour eux, pourquoi devraient-ils essayer, en outre, d'accéder à un droit qui permettrait d'obtenir de l'argent ? Les gens intègrent ça. La majorité d'entre eux nous disent : pourquoi demanderais-je de l'argent, puisque cela ne réparerait rien et que je suis déjà pris en charge par la sécurité sociale ?
Pour les convaincre de déclarer, il faut redonner du sens à la démarche. Quand on relie la réparation à la prévention, c'est-à-dire quand les gens peuvent s'approprier l'idée que cela sert aussi à la prévention et donc aux autres, et quand on montre que le financement ne pèse pas sur l'assurance maladie, mais sur le budget de la branche AT-MP, alors il devient possible de s'engager dans un processus de déclaration. Mais on ne présente les choses que sous l'angle de l'indemnisation. Au sein du secteur AT-MP, il y a par ailleurs des agents qui ne sont pas très au clair sur les différences de financement : même au sein de la sécurité sociale, cela ne se diffuse pas.
Les tableaux de maladies professionnelles sont de type « mono-exposition », mais il y a un tableau dit « d'ambiance », qui est le 44e, me semble-t-il – il concerne les mineurs de fond – où l'on n'a pas essayé de distinguer entre différentes expositions. C'est déjà une ouverture intéressante.
Le système complémentaire des CRRMP peut jouer un rôle important, à côté des tableaux, qui sont compliqués, y compris quand il s'agit de les construire, mais il faudrait que la composition des comités évolue fortement. La création de ce système complémentaire a fait l'objet de beaucoup de débats et de rapports. La demande était notamment qu'il n'y ait pas qu'une vision exclusivement médicale au sein des CRRMP. Annie Thébaud-Mony a par exemple évoqué l'utilité d'un apport en ergotoxicologie. Les comités sont aujourd'hui composés d'un médecin-conseil de l'assurance maladie, qui n'est pas du tout spécialisé dans les conditions de travail ni dans les expositions professionnelles, d'un médecin hospitalier qui peut être rhumatologue mais doit traiter des dossiers de cancers, et d'un médecin inspecteur régional du travail, qui a bien du mal à assurer la représentation qui lui revient, car ces médecins sont de moins en moins nombreux.
Avec une composition des CRRMP exclusivement médicale, on est dans une culture de la causalité médicale qui n'est pas du tout le propre de la reconnaissance des maladies professionnelles. Quand on va au contentieux, on voit bien qu'il y a une tension entre les causalités du point de vue juridique et du point de vue médical : elles ne sont pas du tout identiques. La causalité médicale porte sur quelque chose d'exclusif, ce que l'on ne retrouve pas dans le cadre de la poly-exposition. La causalité juridique repose sur des faisceaux d'indices concordants, ce qui peut amener à une reconnaissance par la justice quand elle n'a pas eu lieu dans le cadre du CRRMP.

Je m'interroge sur la façon d'aborder les choses tout au long des parcours professionnels : il serait notamment intéressant de sensibiliser les travailleurs aux risques encourus. Il y a aussi la question, évoquée par M. Cochet, de la valorisation de l'apport que représentent les travailleurs pour les entreprises, notamment sous l'angle des arrêts de travail, et donc le sujet de l'information des entreprises elles-mêmes.
Je voudrais revenir sur les risques psychosociaux, qui ont été peu abordés jusqu'à présent au sein de cette commission – c'est d'ailleurs pour y remédier que nous vous avons invité, monsieur Cochet. J'ai lu avec attention un certain nombre de fascicules de la FIRPS. Le risque psychosocial et les principes de son évaluation sont encore méconnus, ainsi que vous l'avez souligné. Je ne connaissais pas la démarche engagée par les laboratoires Solvay, qui est très intéressante : d'après ce que vous disiez, on arrive à évaluer facilement les risques – je ne parle pas de la responsabilité, en revanche.
Comme cela a été dit tout à l'heure, on se place dans une logique de réparation, la plupart du temps. Dans le cas du burn-out, on sait que les conséquences peuvent être durables, comme pour un cancer, bien évidemment, mais la partie « réparation » est peut-être moins importante que la partie « prévention ». Je voudrais donc revenir sur les travaux que vous avez réalisés dans ce domaine, monsieur Cochet – mais M. Bergeret souhaitera peut-être dire un mot aussi. Y a-t-il des pistes pour avancer en matière de prévention et de détection précoce des problèmes, dans l'intérêt tant du patient que de l'organisation du travail ?
Vous avez expliqué tout à l'heure qu'un événement parfois minime peut conduire à la « décompensation » d'une pathologique sous-jacente. Comment peut-on donner l'importance nécessaire à tout le travail de prévention qui doit être mené pour les pathologies psychosociales ? Pardon si ma question est un peu vaste et un peu vague, mais je souhaite que l'on puisse aborder ces sujets.
Il y a un élément que j'ai oublié d'évoquer au sujet de Solvay : l'étude a conclu que cette entreprise connaît deux fois plus de cas d'épuisement professionnel que d'accidents du travail de nature physique et que la durée d'arrêt est trois fois plus longue. On compte les accidents physiques, y compris dans des entreprises où ce sujet peut être devenu marginal, soit parce que beaucoup de prévention a été faite, soit parce que l'on a externalisé, alors que paradoxalement le vrai sujet n'est plus toujours celui-là. Si l'on s'en tient aux chiffres que je viens de citer, l'enjeu de l'épuisement professionnel est six fois plus important que celui du risque physique dans le cas de Solvay – c'est une entreprise chimique qui a réalisé beaucoup d'efforts de prévention.
Autre donnée intéressante, Solvay souligne qu'un point sur les accidents du travail est régulièrement inscrit à l'ordre du jour du comité exécutif et que, pour la première fois, il a ainsi été question des cas d'épuisement. Autrement dit, l'entreprise travaille sur la culture des dirigeants, ce qui constitue un vrai levier. Le professeur Dab a produit sur ce sujet, il y a quelques années, un rapport qui n'a pas pris une seule ride – c'est d'ailleurs très grave, car cela signifie que l'on n'a pas tellement avancé sur la formation des dirigeants aux sciences humaines du travail et à la connaissance du travail.
La prévention du burn-out est très compliquée. J'ai en tête de nombreuses situations : quand on commence à se dire qu'un collègue est au bord du burn-out, il est très difficile de le rattraper. Si l'on aborde le sujet avec lui, il y a une chance sur deux qu'il s'effondre, car on l'aide à constater la situation dans laquelle il se trouve. À ce stade, c'est très difficile. Dans le domaine de la prévention, en revanche, on peut faire beaucoup de choses qui renvoient au management du travail et à des questions de culture qui sont fondamentales.
Par exemple, je pense que de nombreux projets devraient être confiés à un binôme plutôt qu'à une seule personne. Le chef ou la cheffe de projet est, en effet, particulièrement exposé : il a des enjeux importants, des délais à tenir et des moyens toujours contraints. On pourrait donc proposer à des entreprises de confier des projets à des binômes – il faut bien sûr que ce soit des gens qui s'entendent bien et qui soient complémentaires. Je suis convaincu que c'est une mesure efficace de prévention du burn-out. Quand on est deux sur un projet, celui qui a un coup de pompe peut faire une pause, en sachant que l'autre va assurer ; on est complémentaire et cela aide aussi à prendre du recul. C'est un modèle qui présente donc de nombreux avantages, mais il est incompréhensible pour les dirigeants, car on est dans une culture bonapartiste : un chef est forcément tout seul et la décision se prend dans ce cadre.
Il y a pourtant des contre-exemples. J'ai vu récemment le cas d'un poste partagé entre deux femmes – comme par hasard, ce sont plutôt des femmes qui arrivent à le faire. Elles sont chacune à mi-temps, ou plus exactement à 60 % car elles ont besoin que leur temps de travail se recoupe un peu. Elles n'ont qu'une seule adresse mail, avec un libellé bizarre qui combine leurs prénoms. Elles ont « fait leur trou » dans l'entreprise. Tout le monde sait que le poste est tenu par deux personnes, du lundi au mercredi pour l'une, du mercredi au vendredi pour l'autre. Cela entre dans les moeurs, mais c'est un changement culturel énorme : on change un peu d'univers… Il me semble que ces deux personnes, qui occupent un poste à responsabilité, sont particulièrement protégées du burn-out.
Il existe beaucoup d'autres possibilités, qui renvoient notamment à la question de la reconnaissance. Dire que l'on ne met pas de pression n'est pas une bonne idée. Il y a des gens qui adorent être « charrette », mais on doit vérifier qu'ils sont en état de le faire, cela ne doit pas durer pas trop longtemps et il faut aussi qu'il y ait des remerciements, même quand on n'atteint pas l'objectif. C'est la culture du management et la manière de travailler qui sont en jeu. Globalement, plus on coopère, mieux c'est.
Dernier exemple, même les directeurs des ressources humaines commencent à s'apercevoir qu'on est allé beaucoup trop loin sur les entretiens annuels d'évaluation. Quand un métier repose sur la coopération, de tels entretiens individuels n'ont aucun sens : il faudrait plutôt un entretien annuel d'équipe. Sinon, on exacerbe la contradiction entre le travail fait en coopération et la reconnaissance que l'on veut, d'une manière tout à fait artificielle, assurer dans un cadre strictement individuel. Cela implique des changements importants : si on les réalise, on changera de monde, et les entreprises seront plus efficaces et plus coopératives. Certains modèles innovants peuvent, paradoxalement, contribuer à prévenir le burn-out et les risques psychosociaux.
Je crois que vous m'avez interpellé tout à l'heure, monsieur le président.
En ce qui concerne l'épuisement professionnel, un des enjeux pour le corps médical, et au-delà pour l'ensemble de la population, est de ne pas mettre ce mot à toutes les sauces. On a connu un peu la même situation avec le harcèlement : tout le monde était harcelé à une époque, mais on parle moins de cette question, désormais. On met plutôt en avant le burn-out, un peu dans toutes les situations. Il faudrait arriver à savoir à quoi cela correspond vraiment. On a un peu avancé en France, car la Haute Autorité de santé (HAS) a fait réaliser une fiche sur le dépistage et la prise en charge de l'épuisement professionnel. Néanmoins, il y a un vrai problème.
Je suis moins compétent que M. Cochet en ce qui concerne la prévention primaire, mais je vois bien dans mon domaine – je suis responsable de la surveillance du personnel d'un centre hospitalier universitaire de grande taille – le rôle joué par l'intensification du travail. À l'hôpital, on fait maintenant en 35 heures ce que l'on faisait auparavant en 39 heures, et c'est tout simplement un désastre. Or il faut conserver des moments où l'on se parle. On y arrivait quand deux équipes se recouvraient – c'est une version quotidienne de ce que M. Cochet vient d'expliquer : deux équipes qui se suivent doivent avoir le temps de se transmettre des informations. Comme on ne peut plus le faire, on recrée artificiellement d'autres systèmes, après avoir détruit la communication, ce qui amène nécessairement à l'épuisement. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais nous le vivons au quotidien.

Et cela rejoint la problématique managériale. La relève entre équipes n'existe plus à l'hôpital ?
Elle existe, mais elle a beaucoup pâti de la nécessité d'aller plus vite.
Je voudrais revenir sur l'une des questions de M. Dharréville et sur l'un des points soulevés par Mme Counil.
Dans le cadre d'une recherche de financement liée au GISCOP 84, j'ai eu l'occasion de regarder, avec un collègue sociologue, Moritz Hunsmann, différents appels à projets de recherche qui se veulent équilibrés entre la santé-environnement et la santé au travail. Hormis, peut-être, celui de l'ANSES, qui est assez bien équilibré du point de vue des thématiques, tous les autres appels à projets placent la santé au travail dans une position qui en fait une sous-catégorie de la santé environnementale : les fléchages des thématiques sont totalement déséquilibrés.
S'agissant de l'utilisation des connaissances scientifiques, je crois que l'on peut aussi retourner un peu la perspective : il y en a parfois qui sont difficilement diffusables. J'en ai fait l'expérience en ce qui concerne l'identification précise des lieux d'exposition professionnelle à des cancérogènes : je ne peux pas diffuser les cartes, car je suis tenu par des contraintes relevant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Un mot, encore, sur un sujet qui n'a été abordé qu'en filigrane : celui de la traçabilité des expositions. Un certain nombre d'outils ont été supprimés par les lois Macron, Rebsamen, El Khomri et les dernières ordonnances, notamment les fiches et les attestations d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR), ce qui pose un vrai problème. Je rappelle que le dernier épisode en date est la suppression des risques chimiques dans le cadre du compte pénibilité.
Il a été question du suivi post-professionnel, mais je voudrais aussi mettre l'accent sur le suivi post-exposition. C'est un droit reconnu à la fois par le code du travail et par celui de la sécurité sociale, avec certains aménagements : une personne exposée à un CMR doit être suivie pendant toute sa vie professionnelle et post-professionnelle. Un point était ressorti de la conférence de consensus sur le suivi post-professionnel des personnes exposées à l'amiante, en 1999 : il fallait organiser un droit dans un cadre collectif. On l'a fait à Clermont-Ferrand, en particulier pour les ouvrières d'Amisol. Cette usine historique a fermé ses portes en 1974, mais le collectif des anciennes ouvrières continue à faire l'objet d'un suivi organisé, en lien avec les caisses d'assurance maladie et les consultations de pathologies professionnelles et de pneumologie des services hospitaliers. Pour les autres travailleurs français, en revanche, c'est un droit individuel qui doit être exercé. Mais comment peut-on demander à en bénéficier quand on n'a pas d'informations sur les risques auxquels on a été exposé, que ce soit de la part de son employeur, la plupart du temps, ou des médecins du travail – on le constate souvent, hélas. Un droit existe, mais il est inexploitable en l'état actuel.
Enfin, je voudrais revenir sur le jugement rendu en appel sur la catastrophe AZF, qui concernait aussi des risques industriels. C'est un procès de la sous-traitance : à Paris, comme à Toulouse précédemment, les juges ont relevé que, parmi les infractions commises par les responsables de l'usine, la plus grave était de n'avoir donné aucune information sur les produits dangereux manipulés par les travailleurs sous-traitants. Le droit à l'information est totalement nié aujourd'hui. C'est pourtant un sujet important, en lien avec le sujet de la traçabilité et du droit au suivi post-professionnel, qui est si peu utilisé. Il y a là un gisement pour la recherche : si le suivi post-professionnel était vraiment un droit que les travailleurs peuvent exercer, on aurait une source de données pour des études sur ce qui se passe pendant la vie professionnelle et par la suite, notamment dans la perspective de la prévention secondaire, grâce à l'identification des pathologies issues de l'exposition aux risques.

Nous avons évoqué hier, avec les industriels de la chimie, la question de l'information des sous-traitants. Comme je l'ai dit précédemment, il est important d'informer en permanence les travailleurs sur les risques qu'ils encourent. En ce qui concerne le dossier médical partagé et la traçabilité, je voudrais souligner que le médecin traitant va pouvoir avoir accès à l'exposition, et donc potentiellement à des recommandations de suivi. C'est aussi un sujet que nous avons abordé hier : apparemment, les patients ne font pas valoir leur droit à un suivi post-exposition auprès de leur médecin traitant, et c'est là que le bât blesse. Je parlais tout à l'heure des personnes à la retraite : ce n'est pas seulement dans ce cadre qu'il faut raisonner, mais après l'exposition en général. Nous sommes tout à fait conscients de la nécessité de remédier au biais qui existe aujourd'hui, à la fois dans l'intérêt de la santé individuelle et à des fins d'épidémiologie et de prévention.

Je voudrais remercier tous les participants à cette table ronde pour leur apport – et pour avoir cité en particulier l'APCME et le territoire de Fos-sur-Mer auquel je suis si attaché. Je pense en particulier au travail de Marc Andéol – vous avez sans doute échangé avec lui, et j'espère que nous aurons l'occasion de le recevoir.

En effet, vous ne pouviez pas faire davantage plaisir au rapporteur. (Sourires). Je veux aussi vous remercier vraiment pour ce temps d'échange, qui a finalement été assez long – presque trois heures d'audition. C'était important afin d'aller dans le détail d'un certain nombre de sujets.
L'audition s'achève à 15 heures 50
————
Membres présents ou excusés
Réunion du jeudi 24 mai 2018 à 13 heures
Présents. – Mme Delphine Bagarry, M. Julien Borowczyk, M. Pierre Dharréville
Excusés. – M. Bertrand Bouyx, M. Régis Juanico, Mme Stéphanie Rist, Mme Hélène Vainqueur-Christophe