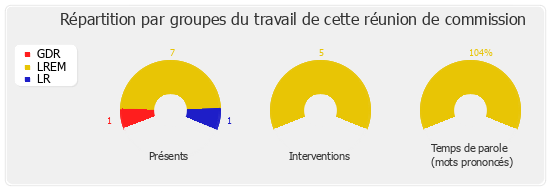Mission d'information sur l'aide sociale à l'enfance
Réunion du jeudi 2 mai 2019 à 17h15
Résumé de la réunion
La réunion
Mission d'information de la Conférence des présidents sur l'aide sociale à l'enfance
Jeudi 2 mai 2019
La séance est ouverte à dix-sept heures trente.
Présidence de M. Alain Ramadier, président de la mission d'information de la Conférence des présidents
————

Au moment de commencer cette table ronde, je remercie nos invités de leur présence, et les prie d'excuser ceux de nos collègues qui, ayant dû rejoindre d'autres commissions, ne pourront malheureusement pas prendre part à la dernière partie de nos débats.
Nous recevons à présent dix professionnels de la santé, pour cette table ronde que nous avons souhaité consacrer à la question très importante de la détection, de la prévention et de la prise en charge de la santé des enfants qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Dans un souci de clarté, je vous propose d'effectuer un premier tour de table très succinct, afin de rappeler à partir de quelle position et de quelle spécialité vous vous exprimez. Nous aborderons ensuite de manière plus approfondie les questions de fond qui nous préoccupent.
Merci de nous recevoir pour cette audition. Je suis pédiatre et médecin de protection maternelle et infantile (PMI) en Seine-Saint-Denis, et coprésident du SNMPMI.
Médecin généraliste et médecin de PMI en Meurthe-et-Moselle, je suis coprésidente du SNMPMI.
Je suis médecin de PMI, médecin coordinateur du groupe petite enfance et handicap pour la métropole de Lyon, et coprésidente du SNMPMI.
Pédopsychiatre, je suis mandatée par l'Association des psychiatres de secteur.
Étant pédopsychiatre, j'appartiens au conseil d'administration de l'Association des pédopsychiatres de secteur infanto-juvénile, et je travaille dans un service de pédopsychiatrie dans l'Essonne.
J'ai travaillé trente-deux ans dans une collectivité comme médecin de PMI, chef de service, puis directeur enfance et famille. Après avoir été directrice générale du groupement d'intérêt public Enfance en danger, je suis actuellement directrice d'une école de formation en protection de l'enfance, ainsi que membre expert de la Haute Autorité de santé.
Pédiatre et médecin légiste, j'anime l'unité médico-judiciaire pédiatrique de l'Hôtel-Dieu à Paris. Je suis en outre expert près la cour d'appel de Paris, et agréée par la Cour de cassation.
Je suis psychologue au sein de l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel-Dieu à Paris et présidente de l'association Centre de victimologie pour mineurs.
Pédiatre, je coordonne l'unité d'accueil des enfants en danger du CHU de Nantes, qui est aussi une unité d'accueil médico-judiciaire, dont les travaux comprennent des auditions filmées.
Pédiatre, médecin légiste et expert près la cour d'appel de Rennes, j'exerce au CHU de Rennes et dans l'unité médico-judiciaire pour mineurs du Mme Rey-Salmon à l'AP-HP. Je représente ici la Société française de pédiatrie médico-légale que nous avons fondée, avec des collègues français et nord-américains.

Députée de l'Isère, j'ai exercé plusieurs métiers dans ma longue vie professionnelle. J'ai pris ma retraite avant d'être élue. Éducatrice spécialisée de formation, j'ai travaillé, dans un établissement, pour l'aide sociale à l'enfance, puis j'ai exercé des responsabilités au département de l'Isère, pour finir directrice de ce que l'on appelait, à l'époque – elle a depuis changé de nom –, la direction insertion famille, qui regroupait, depuis leur fusion, la direction enfance famille et la direction du développement social.

Je suis députée des Hauts-de-Seine. Avant d'être élue, j'ai accompli un double parcours, en entreprise privée et dans l'humanitaire, notamment dans une association qui vient en aide à des enfants à travers le monde. Je me suis donc consacrée plutôt à l'aide humanitaire internationale, mais je me suis aussi investie au sein de La Voix de l'enfant, en tant qu'administratrice. Je suis encore aujourd'hui administratrice d'une association qui vient en aide à des enfants victimes de violences sexuelles.

Je vous remercie encore de votre présence. Je vous propose maintenant d'en venir au fond. Nous disposons d'un peu moins de deux heures pour débattre. J'insisterai notamment auprès des organisations qui ont souhaité être représentées par plusieurs de leurs membres pour que la durée des interventions permette à chacun de s'exprimer. Vous êtes venus nombreux, c'est une excellente chose, mais cela nécessite un peu d'organisation. Je vous propose donc une base de dix à quinze minutes par organisation, de manière à ce que la rapporteure, mes collègues et moi-même, éventuellement, puissions vous interroger.
Je ferai une présentation rapide de la PMI et de l'action des services de PMI en protection de l'enfance. Ces services, rattachés aux conseils départementaux, mènent des actions de prévention et de promotion de la santé auprès des enfants de moins de six ans et de leurs parents, des femmes enceintes, des couples ou futurs couples, et des adolescents.
Leurs principes directeurs sont la proximité, la gratuité, l'accessibilité. Les équipes sont pluridisciplinaires et travaillent avec un large réseau. L'approche est globale -- médicale, psychologique et sociale ; les actions sont individuelles et collectives. Les services de PMI sont ouverts à tous, avec une attention particulière aux familles en situation de vulnérabilité.
Le rôle des services de PMI dans la protection de l'enfance est d'abord un rôle de prévention. L'action préventive de la PMI contribue fortement à la protection de l'enfance. Elle intervient très en amont des difficultés pouvant conduire à une situation de danger. Deux aspects, fondamentaux et historiques, distinguent la prévention conduite en PMI de la finalité de protection de l'enfance. D'une part, la PMI est instituée pour assurer à l'enfant les conditions d'un développement optimal de sa santé, et celles de son développement physique, intellectuel, affectif et social. Son périmètre dépasse ainsi largement le champ de la protection de l'enfance. D'autre part, la PMI offre des services à tous les enfants et toutes les femmes enceintes, prioritairement dans le registre de la promotion de la santé et de la prévention en santé.
La prévention en PMI n'est donc pas orientée vers la recherche d'un risque particulier, mais elle est globale et très personnalisée. En cas de difficulté repérée, notre regard n'est pas seulement soucieux du trouble, mais aussi de tout ce qui, chez l'enfant et dans son entourage, peut constituer un levier.
L'approche par la santé et le prendre-soin est très importante, car elle rejoint la première préoccupation de tout parent : est-ce que mon bébé grandit bien ? Est-ce que mon bébé est en bonne santé ? Cet abord très précoce, en périnatalité, par la santé et le développement de l'enfant, permet l'accompagnement à la parentalité.
« Les mères nourrissent leurs petits de lait et de songes. » Cette phrase est citée par Dominique Lardière, pédiatre de PMI, dans un texte que nous vous avons remis. La PMI accompagne bien les familles sur ces deux registres. Le regard bienveillant et contenant des professionnels sur le développement de l'enfant vient soutenir l'attention des parents à leur enfant et à ses besoins.
Lors de visites à domicile ou de consultations, l'observation des liens entre parents et enfants, l'écoute des parents, de leurs questionnements, de leurs inquiétudes éventuelles, l'observation fine du bébé, la prise en compte globale de la famille – santé physique, psychologique, difficultés sociales – permettent d'ajuster la prise en charge afin de prévenir les difficultés d'une relation potentiellement porteuse de risques pour le développement de l'enfant.
De même, les centres de planification et d'éducation familiale (CPEF) peuvent repérer les violences conjugales et leurs répercussions sur la santé des enfants. Ils assurent également une mission de prévention des grossesses non désirées, contribuant ainsi à éviter des situations de maltraitance potentielle.
La PMI a un rôle de dépistage et d'accompagnement. Les professionnels de PMI sont, grâce à leur formation et à leur expérience, particulièrement à même d'évaluer la qualité des interactions entre parents et enfants, et de reconnaître la sémiologie fine des souffrances précoces du bébé et du jeune enfant, qui peuvent laisser craindre des faits de carence ou de maltraitance dont les signes peuvent apparaître sur le plan physique comme sur le plan relationnel.
Les praticiens de PMI ont l'avantage de travailler à plusieurs, dans des équipes pluridisciplinaires. Lors des consultations, le regard du médecin est toujours complété par ceux de la puéricultrice, du psychologue, et, éventuellement, d'autres professionnels. Ils peuvent se donner le temps de l'observation, et sont spécifiquement formés aux signes de retrait ou de troubles neuro-développementaux. Nos locaux sont adaptés à la prise en charge de bébés et de jeunes enfants.
Notre état d'esprit, lorsque nous présumons une difficulté, vise au repérage d'une souffrance, au sens où il s'agit de s'allier à elle, et non seulement de repérer des défaillances. Pour favoriser ou renouer l'accordage précoce entre bébé et parents, il est nécessaire de tisser une alliance entre la famille et les professionnels.
Lorsque les difficultés sont repérées, les professionnels de PMI peuvent notamment mobiliser le réseau des professionnels du social et de la santé, en travaillant en interaction avec nos collègues du conseil départemental, du service social et de l'aide sociale à l'enfance, et en lien avec tous les professionnels de santé, ceux des maternités, et avec les médecins libéraux et hospitaliers.
Ainsi, une aide ménagère peut être envoyée pour soulager une mère débordée, un accès aux droits peut être rétabli, en lien avec l'assistante sociale ; une dépression ou une dépendance peut être orientée vers un collègue psychiatre ou vers un conseiller en protection infantile. Une mesure d'aide sociale ou éducative en protection administrative peut également être demandée par les parents, ou être proposée et mise en place avec leur coopération. Dans les cas les plus sévères, l'équipe de PMI peut procéder à un signalement en vue d'une mesure de protection judiciaire.
Des adolescents en souffrance psychique peuvent également être repérés par les professionnels des CPEF, qu'ils soient en situation d'addiction, de décrochage scolaire, de conduites sexuelles à risque, ou qu'ils présentent des signes révélateurs de violences sexuelles ou de maltraitance physique ou psychologique. Ainsi, en cas de danger, une mesure administrative ou de protection pourra être proposée pour ces jeunes.
La PMI a un rôle dans l'évaluation. Les services sociaux départementaux et les services de PMI évaluent les situations des enfants signalés à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP), la PMI étant impliquée pour les enfants jusqu'à six ans. À la réception d'une information préoccupante, les professionnels – assistante sociale et puéricultrice – procèdent à une évaluation de la situation centrée sur l'enfant, sa santé, son développement et son épanouissement, ses besoins et ses droits. L'objectif est de déterminer si l'enfant se trouve dans une situation de danger ou de risque pour son développement futur, et si une aide peut être proposée.
Les services de PMI ont également un rôle dans le suivi de la santé et l'accompagnement des enfants faisant l'objet d'une mesure éducative administrative ou d'une mesure de protection judiciaire. Les services de PMI peuvent assurer le suivi en matière de santé. Les missions et les partenariats très larges des équipes de PMI facilitent ce suivi avec tous les professionnels de santé qui entourent l'enfant, et avec tous ses milieux de vie – domicile, structures d'accueil, crèche, halte-garderie, école…
Il est indispensable de rappeler que les besoins fondamentaux d'un enfant bénéficiaire d'une mesure d'aide ou de protection éducative ne sont pas différents de ceux de tout enfant : il doit bénéficier d'une prise en charge qui assure la continuité de ses repères dans ses figures d'attachement, bénéficier de conditions de vie qui permettent son développement psychomoteur et psychoaffectif, recevoir des soins de qualité qui lui permettent de se construire et d'être respecté en tant que sujet, bénéficier d'un climat relationnel et d'un environnement stable pour que ses rythmes et ses besoins premiers soient respectés.
Cependant, les études et les rapports qui se multiplient depuis une quinzaine d'années montrent que les enfants confiés présentent des troubles multiples, avec notamment une surreprésentation des troubles psychoaffectifs et du comportement. Selon les études, 13 % à 15 % des enfants confiés ont un dossier à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), c'est-à-dire sept fois plus que dans la population générale. C'est dire l'importance et la légitimité de la présence des professionnels de la PMI, auprès des travailleurs sociaux de l'ASE, dans la mise en oeuvre de l'orientation et du suivi médical de ces enfants. Les repères du développement de l'enfant, notamment très jeune, sont souvent méconnus des travailleurs sociaux.
Les autres dimensions du travail de la PMI en matière de protection de l'enfance consistent notamment à participer à la dimension santé du projet pour l'enfant prévu par la loi du 14 mars 2016. Les CPEF peuvent également assurer, auprès des mineurs accueillis par l'ASE et des jeunes majeurs, un suivi en matière de santé sexuelle et reproductive.
Les services de PMI rencontrent néanmoins certaines difficultés. Leurs équipes peuvent être fragilisées dans l'exercice de leurs missions si les professionnels sont trop mobilisés par les évaluations de la protection de l'enfance, au détriment des activités de prévention globale.
Les familles peuvent hésiter à faire confiance à la PMI par crainte d'un regard évaluatif et jugeant. Par exemple, si la puéricultrice est identifiée dans le quartier comme évaluant des risques de danger, il peut être un peu compliqué de lui ouvrir la porte pour une visite postnatale. C'est ce qu'ont bien pris en compte la loi de mars 2016 et le décret sur l'évaluation des informations préoccupantes (IP), qui prévoient de différencier les professionnels qui évaluent de ceux qui accompagnent la famille.
Plus généralement, l'action de la PMI est entravée par l'insuffisance des moyens consacrés à la prévention en santé. La mission menée par Mme Peyron sur l'évaluation de la politique de PMI devrait formuler des propositions pour renforcer le dispositif de PMI. À propos du financement de la PMI, et à titre d'exemple la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) évalue la dépense de santé en 2017 à 199,3 milliards d'euros et celle consacrée aux soins préventifs à 9,1 milliards d'euros. La dépense de PMI serait évaluée entre 400 et 500 millions d'euros par la mission Peyron. Une augmentation de 200 millions d'euros de la dépense de PMI par le biais d'un financement fléché représenterait une augmentation de 2,2 % des dépenses de prévention, et seulement de 0,1 % de toutes les dépenses de santé. Cela devrait être à la portée d'une politique cherchant à revivifier la prévention, tant pour sa finalité propre que pour sa contribution à la protection de l'enfance.
L'API est l'Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile, dont l'action relève du sanitaire. Elle a été créée en 1984, mais je n'en retracerai pas l'histoire, son site est facile à consulter pour qui souhaite savoir d'où nous venons.
Notre association est, avec d'autres, à l'origine de la constitution d'un collège national de pédopsychiatrie, au sein de la Fédération française de psychiatrie. Il fait fonction d'interface avec les pouvoirs publics, en faisant remonter nos préoccupations, tant cliniques qu'institutionnelles. Nous avons ainsi, par l'organisation d'états généraux en avril 2014, mis en avant que 465 000 enfants étaient suivis en 2011. Il est vrai que nos chiffres ne sont pas réactualisés chaque jour, mais nous signalions déjà, à l'époque, une augmentation des demandes qui dépassait nos capacités d'accueil et d'évaluation. Les états généraux ont abouti à dix propositions, dont bon nombre devraient être reprises par le débat qui nous réunit aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de les répéter, mais nous les mettrons à votre disposition, notamment celles sur la prévention.
L'API est également à l'initiative de journées dans le territoire, ou participe à leur organisation. Ainsi les journées annuelles de perfectionnement de la psychiatrie publique, organisées au ministère. Elles ont accueilli, en septembre dernier, le docteur Martin-Blachais, venue nous présenter son rapport sur les besoins fondamentaux de l'enfant. Cela m'amène à parler tout de suite de notre rôle dans les procédures de la protection de l'enfance.
Les préoccupations spécifiques de la pédopsychiatrie publique concernent la symptomatologie induite par les carences et la maltraitance. Cette symptomatologie peut être résumée schématiquement en sept grandes catégories de troubles durables, c'est-à-dire des troubles qui se prolongent bien au-delà des prises de mesures environnementales, et qui se manifestent différemment selon l'âge de l'enfant et la durée d'exposition au dysfonctionnement environnemental. Chacun de ces troubles nécessite des mesures de prévention et de prise en charge thérapeutique spécifiques, afin d'en améliorer le pronostic. C'est ce que font nos équipes. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps de citer ces sept catégories mais, si cela vous intéresse, je pourrai les développer plus tard.
Ces troubles psychiques sont susceptibles d'être évités. Comme cela vient d'être dit, de nombreux progrès ont déjà été faits, depuis des décennies, grâce à un repérage de plus en plus précoce. Malgré ces progrès, nous pouvons encore nous trouver face à des troubles déjà installés. Dans ce cas, des mesures thérapeutiques adéquates permettent d'éviter des conséquences graves et des séquelles à distance, qui sont très coûteuses en termes de morbidité, de pathologies somatiques, de soins psychiatriques au long cours, de répercussions transgénérationnelles, ou encore de handicaps… Je pense que d'autres intervenants pourront traiter, dans la suite de cette audition, des conséquences à l'âge adulte. Pour cela aussi, j'ai apporté une liste, si vous voulez en parler plus tard.
Avant de donner la parole à mon collègue le docteur Pavelka, qui développera les apports concrets et théoriques des équipes de la pédopsychiatrie publique investies au quotidien dans la protection de l'enfance, je termine sur des constats. La mise en place du secteur infanto-juvénile, avec son maillage dans le territoire national, avait la prévention dans ses gênes. Cette pédopsychiatrie publique de secteur a donc largement participé au développement du dépistage, de plus en plus précoce, des signes de souffrance et de troubles psychiques par les professionnels de l'enfance. Pour ce faire, la pédopsychiatrie est très impliquée dans un travail d'articulation avec les équipes de PMI et les services de médecine scolaire et de pédiatrie, dont des représentants ont également été conviés à cette audition. Nos collègues témoigneront sûrement de cette collaboration nécessaire. Il en va de même de notre collaboration avec les services de l'ASE, sachant que les enfants bénéficiant d'une mesure de protection nécessitent souvent plus de concertation entre les équipes, et l'organisation rapide de soins.
L'énumération des nombreuses améliorations que nous pourrions envisager ici serait trop longue. Cependant, notre expérience clinique nous permet de témoigner et de participer activement aux travaux du Conseil national de la protection de l'enfance sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Je crois d'ailleurs qu'une audition de membres de ce conseil a déjà eu lieu. L'avis du CESE intitulé Prévenir les ruptures de parcours en protection de l'enfance a également souligné l'importance de faire appel aux services de pédopsychiatrie pour de nombreuses situations. Il signale en outre le manque de moyens et la grande hétérogénéité de l'offre de soins dans le territoire.
C'est dans le même sens que nous insistons, pour dire que, si notre sujet d'aujourd'hui est la protection de l'enfance, c'est-à-dire celle des enfants déjà repérés, nous avons encore à améliorer ce repérage et à accélérer les procédures de prise en charge ; ce alors que la pédopsychiatrie publique ne peut actuellement apporter à tous les enfants qui consultent, protégés ou non, les soins dont ils devraient bénéficier, faute de structures et de moyens humains suffisants.
Dans l'impossibilité de faire face à toutes ses missions, que ce soit dans le champ sanitaire ou dans le champ médico-social, elle est malmenée sur le plan budgétaire. Une logique économico-financière à court terme – je ne la détaillerai pas, cela a été fait – est peu propice aux suivis longs et au travail coordonné dont a besoin la population des enfants protégés. L'idée que l'on puisse encore redéployer, alors que nous sommes à l'os depuis des années, serait absurde ; de même, le décloisonnement entre secteurs sanitaire et médico-social n'est pas une bonne idée, car c'est la complémentarité des équipes qui est garante du meilleur soin : loin d'être la plus coûteuse, elle est la plus efficace.
Depuis sa création, la pédopsychiatrie contribue directement à l'évolution des pratiques de la protection de l'enfance, que ce soit par son action ou par les théorisations et les concepts qu'elle a développés. Ils permettent de mieux comprendre, de mieux identifier, et peut-être de mieux prendre en charge des situations qui, d'ordinaire, présentent des éléments impensables. Le nombre d'hospitalisations d'enfants protégés en pédopsychiatrie est considérable. Dans l'hôpital psychiatrique de l'Essonne, dans les années 1960, 90 % des enfants hospitalisés étaient des enfants protégés. Dans les années 1970, 70 % des enfants réhospitalisés ont été aussi des enfants protégés.
Cette baisse progressive du nombre d'hospitalisations est concomitante de l'augmentation des suivis en ambulatoire en pédopsychiatre. Aujourd'hui, 30 % des adolescents hospitalisés dans notre unité sont protégés. Dans un CHU parisien, 25 % des enfants qui fréquentent l'hôpital de jour bénéficient de mesures de protection. On est donc en présence d'une sorte de recouvrement de fait entre la pédopsychiatrie et la protection de l'enfance. Ce n'est pas seulement une articulation qu'il faudrait penser, mais une vraie coopération dans ce champ de recouvrement.
La pédopsychiatrie contemporaine repose sur deux pieds, ou sur deux systèmes de repères importants : sur la psychopathologie, c'est-à-dire la connaissance des dynamiques psychologiques et relationnelles, d'une part, et, d'autre part, sur les neurosciences, c'est-à-dire sur les observations des manifestations de notre vie psychique dans le cerveau et dans les circuits neuronaux, notamment celles des aspects hormonaux et génétiques de ces problèmes.
Les recherches dans ces deux domaines ont d'ores et déjà montré que l'exposition de l'enfant aux maltraitances et à des soins parentaux gravement inadéquats est néfaste pour son développement physique, affectif, intellectuel et social – vous connaissez cette formule inscrite dans la loi. Elle se traduit également par des dysfonctionnements hormonaux, neuronaux et par des atteintes cérébrales objectivables.
Pour ces raisons, il faut centrer la protection de l'enfance – je le dis un peu rapidement – sur l'enfant, d'abord et toujours, et sur les parents, quand cela est possible. Par exemple, la question du retour au domicile doit être toujours pensée, mais toujours en rapport avec les capacités des parents à l'assumer.
Les deux fondements disciplinaires dont j'ai parlé, la psychopathologie et les neurosciences, ont conduit aux conclusions qui ont permis l'inscription dans la loi de cette formule : « garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, […] soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social ». C'est une manière un peu sommaire de le dire, mais je crois que la pédopsychiatrie y a beaucoup contribué.
Concrètement, tous les dispositifs ambulatoires ou semi-ambulatoires d'hospitalisation, ou d'hospitalisation alternative, en pédopsychiatrie, sont évidemment accessibles aux enfants protégés. Mais, la plupart du temps, ils y sont accueillis après leur entrée en protection et la séparation d'avec leur famille ; beaucoup plus rarement avant, parce que les parents de ces enfants ne réalisent pas leurs difficultés parentales ; ils ne cherchent ni n'acceptent d'aide, faute d'admettre que l'intérêt de l'enfant puisse être différent du leur. Nous n'accueillons donc ces enfants qu'une fois qu'ils ont été pris en charge. Or nous ne sommes pas en mesure, aujourd'hui, de prioriser ces prises en charge, alors que ce serait amplement justifié.
Je voulais souligner l'existence, en pédopsychiatrie, de deux dispositifs plus particulièrement destinés aux enfants protégés. Le premier est l'unité d'hospitalisation mère-bébé. Les unités de ce type prennent en charge les bébés et leurs parents en crise psychiatrique périnatale. Elles permettent de bien discerner si la parentalité est empêchée de manière temporaire et limitée, ou s'il s'agit d'une dysparentalité durable, qui nécessitera une séparation et une protection. C'est là un des rôles de ces unités.
Le second dispositif, ce sont les unités d'accueil familiales thérapeutiques (UFT), unités réglementaires des services de pédopsychiatrie, prévues pour accueillir et soigner les enfants qui sont déjà en situation de séparation, pour accompagner leurs familles d'accueil, ainsi que leurs parents, dans leurs rencontres et dans les liens qu'ils continueront à entretenir avec leurs enfants après la séparation. Ce dispositif est une manière de transformer la séparation protectrice en une séparation thérapeutique. D'une certaine manière, très modestement, je peux dire que nous pensons que ce dispositif est une sorte de préfiguration de la manière dont devraient fonctionner les accueils familiaux en général : soutien aux familles d'accueil, accompagnement des parents et de l'enfant.
Il y a aujourd'hui un peu plus de 800 places dans les UFT de France. Leur répartition est très déséquilibrée : notre département, par exemple, dispose de 50 places, mais c'est beaucoup moins que celui de Seine-Maritime, qui a à peu près la même taille et dispose de plus de 100 places d'accueil familial thérapeutique, ce qui est bien plus près des besoins des enfants protégés.
La pédopsychiatrie contribue aussi à la protection de l'enfance par des interventions de formation et de soutien aux professionnels de l'aide sociale à l'enfance, ainsi que par des interventions relevant d'activités d'intérêt général, qui sont autorisées par le statut de praticien hospitalier.
Cette collaboration autour des articulations, dont j'ai parlé, présente cependant des difficultés et a besoin de soutiens, car les professionnels qui se sont destinés à l'un de ces deux champs – protection de l'enfance ou pédopsychiatrie – n'ont pas aujourd'hui les mêmes repères conceptuels, pas plus qu'ils n'ont eu la même formation ; ils n'ont pas non plus les mêmes outils de travail. Il me semble que cela ne facilite pas la coopération. Évidemment, la violence inouïe des phénomènes que l'on rencontre dans ce champ fait aussi partie des difficultés de la collaboration, parce que, au-delà de nos formations, elle touche chacun de nous de manière personnelle.
Il faut reconnaître aussi le potentiel d'amélioration de la pédopsychiatrie, mais nous pourrons en parler plus tard. J'évoquerai simplement, pour terminer, une expérience très intéressante, dont les conséquences n'ont pas encore été assez étudiées : c'était un projet, soutenu par Simone Weil, d'un secteur unifié de l'enfance, c'est-à-dire d'un dispositif qui allie la pédopsychiatrie à la protection de l'enfance. Il a été mis en pratique dans le 14e arrondissement, mais n'a pu se poursuivre, pour des raisons budgétaires et à cause de difficultés de coopération entre institutions. Je crois cependant qu'il faudrait revenir sur cette expérience.
L'évocation de cette expérience me ramène un peu en arrière : 1974, le service unifié de l'enfance. C'était effectivement une belle idée, mais, sur le terrain, elle a été extrêmement compliquée à mettre en pratique, faute peut-être de volonté politique et de volonté institutionnelle. L'organiser s'est révélé compliqué, d'autant que s'est produite, au même moment, la séparation des différents acteurs du fait de la décentralisation. Elle n'a pas été un élément facilitateur lorsqu'il s'est agi de remettre autour de la table les même acteurs qui, après la décentralisation, relevaient d'institutions différentes.
Pour faire le lien avec les interventions précédentes, je voudrais vous parler de la démarche de consensus que nous avons conduite à la demande de Mme Laurence Rossignol. De fait, le corpus législatif et réglementaire français – le code de l'action sociale et des familles, en tout cas – n'a intégré que très tardivement les principes de la Convention internationale des droits de l'enfant, longtemps après sa signature par la France, en 1990. Il a fallu attendre la loi du 5 mars 2007 pour voir apparaître, à l'article 2 de cette loi, les grands principes de la Convention internationale : l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit primer sur toute autre considération, la nécessité du respect de ses droits et la prise en compte de ses besoins.
La notion de ces besoins et celle des conditions nécessaires au bon développement physique, psychologique, cognitif et social de l'enfant, évoqué tout à l'heure, sont donc très récentes dans notre code de l'action sociale et des familles. Ses dispositions ont évidemment été consolidées par la loi du 14 mars 2016, dont l'article 1er définit la protection de l'enfance : elle a pour objectifs la prise en compte de l'intérêt de l'enfant, le respect de ses droits et la satisfaction de ses besoins, afin de garantir son développement.
Il me semble donc que nous avons finalement constitué – assez tardivement – une véritable doctrine de la protection de l'enfance. Elle peut désormais servir de référence pour tous les acteurs, et pas seulement pour ceux du secteur social : cette référence peut être partagée avec le secteur de l'éducation nationale, comme avec ceux des activités de loisirs, bref, avec tous les acteurs qui, de près ou de loin, travaillent avec des enfants, et accompagnent des parents dans le cadre de mandats ou de missions qui vont de la prévention à la protection.
Nous avons ainsi entrepris une démarche de consensus – je rejoins ici les interventions précédentes – en tenant compte non seulement de la diversité des champs et des compétences professionnelles, mais aussi, à l'intérieur des champs professionnels, des différentes écoles de pensée, que nous avons entendues. Pour en revenir à l'articulation, déjà évoquée, entre neurosciences et approche plus psycho-développementale, nous avons été fort surpris – puisqu'il s'agissait d'une démarche de consensus, qui présupposait l'existence d'un dissensus – de constater qu'il y avait, en fait, énormément de convergences entre les différentes écoles de pensée et les différents acteurs, beaucoup plus que nous ne l'imaginions : nous n'étions plus devant les postures des années 1970, où l'on était très attaché à certaines écoles, mais tout cela pouvait tricoter ensemble. On pourrait dire que, d'une certaine façon, les neurosciences viennent aujourd'hui confirmer un certain nombre d'éléments intuitifs qui avaient été dégagés dans d'autres champs professionnels. Il existe désormais, me semble-t-il, une convergence scientifique pour appréhender la question des besoins de l'enfant et la manière dont son environnement peut être favorable ou défavorable à sa construction en tant que personne, en tant que sujet singulier susceptible de développer l'ensemble de ses potentialités. Je vous renvoie au rapport, que je ne vais évidemment pas développer ici.
Je dirai simplement que nous avons réussi, collectivement – nous étions quinze experts, dont un Belge, une Anglo-Saxonne et une Italienne – à faire aboutir cette réflexion, grâce à laquelle notre corpus législatif comporte désormais un texte de référence sur les besoins fondamentaux de l'enfant. Il répond à la question de ce que recouvre cette notion. Nous avons d'abord souhaité définir les besoins fondamentaux universels, communs à tous les enfants, quelle que soit leur situation, avant de nous concentrer sur ceux des enfants bénéficiant de mesures de protection. Nous sommes aujourd'hui parvenus à l'idée que sept besoins doivent être satisfaits pour qu'un enfant puisse bien grandir, et que, parmi ces sept besoins, trois constituent ce que nous avons appelé le métabesoin de sécurité : si ses besoins physiologiques, ses besoin de protection contre toute forme de violence, quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit l'auteur, et ses besoins de continuité affective et relationnelle ne reçoivent pas de réponse appropriée, cette carence compromettra la satisfaction des quatre autres besoins, qui conditionnent sa capacité de grandir sans perte de chances, avec l'ensemble de ses potentialités, dans un environnement qui lui soit favorable, et où ses droits soient préservés et son intérêt défendu.
Au-delà de cette question, je trouve, pour avoir beaucoup arpenté le territoire national, ces derniers temps, pour présenter le rapport, que cette approche par les besoins rencontre désormais un accueil favorable. Il me semble qu'elle peut constituer un instrument fédérateur pour l'ensemble des acteurs, quelle que soit leur profession d'origine, pour appréhender la situation d'un enfant et déterminer s'il a besoin d'une intervention tierce, extérieure, quelle que soit sa nature – sociale, éducative ou sanitaire. Cette approche pourrait constituer aujourd'hui le corpus partagé par l'ensemble des acteurs.
Nous avons ainsi réfléchi à un cadre de référence national qui permettrait d'appréhender la situation des enfants. Comme l'indiquait le docteur Pavelka, il doit intégrer trois dimensions qui, d'ailleurs, existent déjà dans la loi du 5 mars 2007 : il s'agit de prendre en considération la situation du mineur, mais aussi les capacités des parents et leurs compétences pour répondre de façon appropriée, dans l'exercice de leur parentalité, aux besoins de l'enfant ; il faut, troisièmement, prendre en considération l'axe de l'environnement. C'est sur ces trois dimensions qu'il convient de travailler pour appréhender la situation d'un enfant, et voir quels seront éventuellement les leviers sur lesquels on pourra s'appuyer pour soutenir l'intervention, qu'elle soit intrafamiliale ou qu'elle doive venir de l'extérieur de la famille.
Notre rapport contient sept recommandations et trente-huit propositions. Je ne les citerai évidemment pas toutes. Mais si je devais aujourd'hui – deux ans après ce rapport, qui date de février 2017, après le rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE), après le plan pauvreté et le rapport du Centre national de la protection de l'enfance (CNPE) – faire passer quelques messages, je distinguerai les trois champs de la prévention, de la prise en charge et de l'information.
Sur le plan de la prévention, il me semble que beaucoup de choses ont été faites. La situation a certes pu évoluer de façon défavorable dans certains territoires, mais on a depuis longtemps commencé à travailler sur la grossesse, sur la périnatalité, sur la coordination des acteurs – je pense notamment aux staffs médico-psychosociaux qui fédèrent des personnels intra-hospitaliers et des acteurs de terrain. Il me semble cependant – et nous l'avons beaucoup entendu pendant nos travaux – qu'une action de santé publique serait légitime : la prise en considération de la dépression maternelle périnatale, qui touche aujourd'hui près de 15 % des femmes enceintes. Cette donnée statistique justifie pleinement une action de santé publique. Il faudrait que l'on travaille avec les acteurs à une systématisation du dépistage précoce de la dépression périnatale. Notre rapport proposait d'ailleurs une collaboration, sur ce point, entre la Haute Autorité de santé (HAS) et les sociétés savantes afin de mettre en place un dispositif de dépistage de la dépression maternelle.
J'en viens – en sautant un grand pas – à une deuxième question, qui est pour ainsi dire à la jonction de la prévention et de la protection : celle des internats scolaires. Certains mineurs sont aujourd'hui pris en charge dans des maisons d'enfants à caractère social (MECS), au titre de la protection de l'enfance, alors que, si l'on avait des internats scolaires de semaine, ils pourraient y être accueillis du lundi au vendredi, leur situation familiale n'étant pas dégradée au point d'interdire leur retour dans leur environnement familial le week-end. Ces enfants pourraient cependant expérimenter d'autres cadres et d'autres modes de vie, tout en bénéficiant d'un environnement scolaire adapté – nous dirons aussi quelques mots des performances scolaires des enfants pris en charge, une fois qu'ils sont dans le dispositif. On éviterait ainsi la stigmatisation dont, on le sait bien, ces enfants sont souvent victimes, tout en leur offrant une prise en charge moins lourde : une place en maison d'enfants à caractère social coûte à peu près 58 000 euros par an, un internat scolaire 15 000 euros. On pourrait donc très utilement faire bénéficier certains enfants de ces internats scolaires, dont l'organisation pourrait s'inspirer du modèle des internats de réussite éducative, et qui seraient, encore une fois, des outils beaucoup plus banaux, si je puis dire, que l'entrée en protection de l'enfance et l'accueil en maison d'enfants à caractère social.
Quant au parcours de prise en charge, notre rapport s'accorde, au sujet de la santé des enfants, avec ce qui vient d'être dit : une fois les enfants placés sous le régime de la protection, on s'aperçoit qu'ils ont de très grosses difficultés de santé. Je vous renvoie aux travaux cités dans notre rapport comme, par exemple, sur les tout petits, le travail de Daniel Rousseau à la pouponnière d'Angers. Il montre que, lorsque les enfants arrivent à la pouponnière, ils ont en moyenne 21 mois ; leur situation a été identifiée comme extrêmement préoccupante douze mois plus tôt, mais il a fallu attendre douze mois pour qu'ils arrivent à la pouponnière. Daniel Rousseau montre à quel point ces enfants, lorsqu'ils arrivent, sont déjà profondément cassés, avec des troubles fixés, dont on sait très bien qu'il sera beaucoup plus compliqué de les guérir, pour leur permettre de reprendre un développement normal, que si l'on avait pu intervenir plus précocement. Toutes les situations ne le requièrent pas, évidemment, mais c'est le cas de celles où l'enfant est exposé à un environnement extrêmement délétère, très attentatoire à sa sécurité physique et psychique, et qui le met en très grand danger.
On sait, de même, après un certain nombre d'études, qu'un enfant sur deux qui arrivent en protection de l'enfance a subi des violences intrafamiliales, des maltraitances, voire des abus sexuels. On sait aussi que ce chiffre est probablement très en-deçà de la réalité, puisqu'une fois que les enfants ont été accueillis et sont en sécurité, on recueille des révélations secondaires : les maltraitances qu'ils ont subies n'apparaissent pas toutes au moment de l'admission, mais se révéleront secondairement, pendant leur prise en charge.
On sait donc que certains enfants ont déjà connu des parcours de vie extrêmement difficiles, et arrivent en très grande difficulté. Quant à la médicalisation qui intervient alors - je ne parle même pas de leur prise en charge thérapeutique – les chiffres sont absolument ahurissants : 1,6 % des mineurs placés dans des établissements sont sous antidépresseurs, soit huit fois plus que dans la population générale ; 7,2 % des enfants sont sous neuroleptiques, soit vingt-quatre fois plus que dans la population générale. Cela doit nous amener à nous interroger sur l'efficience des interventions précédentes.
Nous avons évoqué, enfin, la question de la compréhension entre acteurs appartenant à des champs professionnels différents. Eh bien, je crois que la formation, et plus particulièrement la formation interinstitutionnelle, transversale, autour de concepts partagés – et il me semble que nous disposons désormais de ces concepts – peut être une solution pour mieux nous comprendre, et pour coopérer efficacement, en nous complétant mutuellement.
Merci beaucoup d'avoir pensé aux unités médico-judiciaires (UMJ), ce n'est pas forcément évident lorsqu'il s'agit de protection de l'enfance. Je serai assez brève sur notre intervention. Une UMJ pédiatrique est pluridisciplinaire : elle regroupe des pédiatres, des puéricultrices, des psychologues, pour un positionnement résolument pédiatrique. Nous avons, c'est vrai, des liens privilégiés avec le parquet et la brigade de protection des mineurs. Ce sont nos interlocuteurs au quotidien, le principe de notre fonctionnement commun étant le décloisonnement. Il est extrêmement important de comprendre que nous formons une alliance fondée sur le décloisonnement.
Que fait-on dans une UMJ ? Je déclinerai la réponse en cinq points. La vocation de l'UMJ la destine d'abord à une activité de constat médico-légal. Nous voyons des enfants placés en urgence, le lendemain ou le surlendemain de ce placement, afin de les examiner et d'évaluer une incapacité totale de travail, qui sera ensuite utilisée pour qualifier les faits au pénal.
Il faut donner du sens à ces examens – c'est la chose extrêmement importante pour moi –, de manière à ce qu'ils s'inscrivent dans un vrai parcours de l'enfant. En matière d'agression sexuelle, par exemple, nous avons fait le choix de ne pas avoir de salle d'audition avec des policiers. À Paris, nous avions déjà la brigade des mineurs à 200 mètres de chez nous, ce n'était vraiment pas très loin ; et, d'autre part, eu égard au nombre d'agressions sexuelles examinées par les UMJ – plus de 300 par an –, nous aurions eu des policiers chez nous toute la journée. Nous avons donc choisi une autre forme de collaboration, fondée sur la cohérence du parcours de soins. Mélanie Dupont vous dira que nous avons créé des outils grâce auxquels la brigade de protection des mineurs peut visionner les examens, et qui nous permettent de les expliquer et de renforcer la continuité du sens de notre démarche.
Notre deuxième activité de constat, très importante à mes yeux, concerne les mineurs non accompagnés, dont nous devons notamment évaluer l'âge physiologique, puisque le Conseil d'État a décidé que nous devions poursuivre cette tâche. C'est pour nous une activité assez importante et assez soutenue, pluriquotidienne. Nous voyons parfois les enfants dans des hôtels, ce qui me préoccupe beaucoup. Ils y sont, de fait, non accompagnés, conformément au qualificatif qui leur est assigné. Je suis très inquiète pour ces jeunes qui vivent à l'hôtel.
Nous avons également une activité de soin – dans « médico-judiciaire », il y a aussi « médical ». Lors de l'examen des enfants, nous nous efforçons d'évaluer rapidement – faute de moyens humains et de temps – leurs besoins psychologiques. Mélanie Dupont vous en dira davantage en présentant sa fonction.
Dans cette UMJ, on voit aussi des adultes, notamment des femmes victimes de violences conjugales, là encore de façon pluriquotidienne, malheureusement. Il nous arrive d'émettre des signalements, ou de transmettre des informations préoccupantes à partir de l'UMJ elle-même, pour dénoncer une situation qui nous paraît vraiment inquiétante, notamment lorsque des enfants semblent en danger dans leur famille. Nous sollicitons parfois aussi le parquet pour pouvoir examiner d'autres enfants qui vivent dans l'entourage du cas dont nous sommes saisis, afin de nous assurer qu'ils ne sont pas eux aussi victimes de mauvais traitements.
Nous avons, troisièmement, une activité de conseil auprès de nos collègues, notamment des hôpitaux pédiatriques, qui font fréquemment appel à nous. En revanche, nous recevons peu de demandes d'autres secteurs – l'éducation nationale, par exemple, nous sollicite très peu, ce qui est peut-être dommage. Nous assurons également une activité de formation en lien avec la ville de Paris. Nous formons notamment, depuis l'unité médico-judiciaire (UMJ), de nombreux acteurs de la protection de l'enfance.
Nous travaillons, enfin, à la prévention. Il est vrai que les UMJ arrivent souvent trop tard, après que la prévention primaire a échoué. Je dirai cependant quelques mots du syndrome du bébé secoué, dont nous avons à traiter 240 à 320 cas par an, avec 20 % à 30 % de mortalité, et des séquelles extrêmement lourdes pour 75 % des survivants. Il y a donc vraiment des actions de prévention à mener en direction des parents, sans attendre l'étape de la maternité, où c'est trop tard, à mon avis. Il faut vraiment intervenir avant l'accouchement, notamment pour évoquer la question des pleurs de l'enfant et de leur gestion. On pourrait ainsi éviter un certain nombre de victimes tous les ans.
Je vais vous présenter le travail des psychologues dans les UMJ, où ils sont présents depuis la réforme de la médecine légale. Leur activité consiste principalement à dispenser des soins, mais aussi à évaluer les situations, et à réorienter les victimes, le cas échéant, notamment au sein du secteur public. Ils assurent des prises en charge thérapeutiques, puisqu'il y a des psychothérapies au sein des UMJ.
M'occupant exclusivement d'enfants et d'adolescents, je suis fréquemment en rapport avec l'ASE. On a tendance à penser que des enfants qui font l'objet de procédures judiciaires sont déjà potentiellement protégés, mais, comme le disait Caroline Rey-Salmon, ces procédures donnent souvent lieu à de nouvelles révélations : pour ces enfants qui viennent pour des coups et blessures, ou pour du harcèlement à l'école, la procédure est l'occasion de dire ce qui se passe à la maison. Nous transmettons donc beaucoup d'informations préoccupantes (IP) et de signalements, après lesquels nous maintenons évidemment des liens avec les enfants qui, une fois placés, peuvent venir en thérapie au sein de l'UMJ, si nous considérons que c'est pertinent. Il s'agit en particulier de répondre aux difficultés soulevées par la question de la continuité et de la stabilité des soins. Le simple fait de pouvoir joindre quelqu'un par téléphone s'avère parfois compliqué, alors que le jeune peut être demandeur d'un suivi ou d'une prise en charge, que ne permet pas forcément l'organisation du service dans lequel il est placé. Tels sont les traits généraux de l'activité des psychologues au sein des UMJ, mais cette activité obéit, par ailleurs, au fonctionnement propre de chacune.
Outre le Collège des psychologues de médecine légale, existe l'association Centre de victimologie pour mineurs, dont je voudrais maintenant vous parler. Elle contribue à la formation et à l'information, en proposant des outils, notamment aux jeunes et à leurs familles – nous venons par exemple de réaliser un tutoriel expliquant ce que sont les violences sexuelles –, mais aussi et surtout aux professionnels. Il peut arriver que des professionnels, des éducateurs, par exemple, qui amènent les enfants aux UMJ, ne sachent pas ce qu'est un examen gynécologique. C'est plutôt logique, puisqu'ils ne sont pas confrontés, en général, à ce genre de situations. Nous créons donc des outils pour aider les professionnels dans l'accompagnement des jeunes victimes de violences. Face à des situations extrêmement lourdes émotionnellement, ils ont besoin d'outils et d'une formation adéquate pour pouvoir accompagner les jeunes de la meilleure manière, ou, en tout cas, de manière adaptée. D'où l'importance de contribuer à la formation, comme beaucoup de personnes autour de cette table le proposent. Nous organisons aussi des colloques, mais notre but principal reste bien de fournir des outils pratiques aux professionnels, et de les rassurer : il s'agit de mettre en sécurité les professionnels pour qu'ils puissent mettre en sécurité les enfants.
Je vous remercie de nous avoir invités. Beaucoup de choses ont été dites sur les conséquences très graves qu'entraîneront, tout au long de leur vie, les violences subies par les enfants. Je vais vous parler de l'unité que je coordonne, avant de céder la parole à ma collègue Martine Balençon, présidente de la Société française de pédiatrie médico-légale, à laquelle plusieurs d'entre nous appartiennent, après l'avoir cofondée.
Mon unité est implantée dans un centre hospitalier et rattachée à son service de pédiatrie. Nous accomplissons le travail de constat dont a parlé le Mme le Dr Rey-Salmon. Étant en province, nous ne recevons pas autant d'enfants. Leur parcours médico-judiciaire permet, chez nous, qu'ils soient entendus dans une salle d'audition protégée intégrée aux locaux de la consultation pédiatrique. L'enregistrement n'est obligatoire que dans les cas de violences sexuelles. Il faudrait qu'il le soit pour toutes les violences, comme de nombreux parquetiers le préconisent, mais il n'est pas pratiqué de manière systématique.
L'originalité de notre unité – qu'elle partage cependant avec d'autres, comme celles d'Orléans ou d'Angers – est que nous assurons aussi une mission de dépistage à l'intérieur de l'hôpital. L'unité a donc une double entrée : elle peut être sollicitée pour un constat judiciaire, c'est-à-dire pour un examen, sur réquisition, éventuellement précédé d'une audition de l'enfant par les services enquêteurs ; mais nous formons aussi une équipe de ressources pédiatriques multidisciplinaires, dédiées à l'enfant, qui réunit des psychologues, des assistantes sociales, des pédiatres et pédiatres légistes, qui travaillent en lien étroit avec l'unité de pédopsychiatrie du service de pédiatrie. Ces professionnels constituent, à l'intérieur de l'hôpital, des ressources complémentaires. Celui de Nantes reçoit 35 000 passages d'enfants de moins de 15 ans et 3 mois aux urgences pédiatriques, soit entre 120 et 140 passages par jour. Or on sait que, parmi ces enfants qui viennent pour une jambe cassée, un mal au ventre, une tentative de suicide, une agitation, ou tout autre chose, certains – leur nombre varie, selon les études, de 4 % à 16 % – sont victimes de violences, toutes confondues, et qu'il faut pouvoir les dépister.
Nous ne prétendons pas être exhaustifs, parce que l'on peut toujours se tromper, d'autant plus que la maltraitance, comme le disait le docteur Pavelka, se caractérise par l'impensable : l'impossibilité de la penser, l'impossibilité de la voir et de l'entendre. Notre cerveau fait beaucoup de travail pour nous y rendre sourds. Pour lever ces blocages, il faut des équipes très formées, très soudées et très capables de se parler, en particulier de ce que cette violence nous fait, à nous. Sinon, on ne verra pas, et on pourra laisser passer des enfants gravement maltraités, sans nous en rendre compte.
Cette fonction de personnels ressources, que nous remplissons, était préconisée par la mesure 11 du plan « Violences 2017-2019 » : il prévoyait qu'il y ait un médecin référent pour la protection de l'enfance dans chaque hôpital. Je pense qu'il faudrait en réalité prévoir une équipe référente ressource dédiée à l'enfant, en milieu pédiatrique : les enfants n'étant pas considérés comme des mini-adultes par le reste de la médecine, il n'y a pas de raison pour qu'ils soient reçus, pour le dépistage ou le constat de violences, dans des services adultes.
Il s'agit donc d'une mission de dépistage et de soins d'urgence – de réanimation psychique et de dépistage somatique d'urgence –, après lesquels nous orientons les enfants vers nos collègues d'autres institutions. Nous formons aussi une équipe ressource pour les professionnels de l'extérieur, par exemple pour un médecin généraliste qui se trouverait confronté à une situation difficile. S'il dépistait une leucémie chez un enfant, il l'adresserait au service de cancérologie de l'enfant du CHU ou de l'hôpital le plus proche ; il n'y a pas de raison pour que, pour un ensemble de pathologies aussi graves, avec des conséquences aussi graves que celles induites par la maltraitance, les hôpitaux n'offrent pas des ressources analogues, et qu'un plan de santé ne soit pas prévu par les agences régionales de santé (ARS), pour y associer non seulement les hôpitaux, mais l'ensemble du réseau de santé.
Nous travaillons en lien étroit avec le conseil départemental et l'ASE, puisque notre fonctionnement est défini dans le cadre très précis d'une convention signée en 2010 entre l'ARS, le CHU de Nantes, le tribunal et le conseil départemental. De ce fait, nous avons des rapports très fréquents avec le médecin référent pour la protection de l'enfance, avec les services de la protection maternelle et infantile, et avec les responsables de l'ASE. Cela nous permet de mettre très rapidement à l'abri un enfant, en cas de suspicion. Les services de PMI nous renvoient par exemple des cas de bébés secoués – un bleu sur la joue d'un bébé peut, on le sait, représenter un signe d'alerte très grave, présageant de violences futures. Il faut alors mettre l'enfant à l'abri et établir un bilan : on n'en est pas encore au stade du signalement, mais à observer comment va cet enfant, avec ses parents, en se demandant s'il faut en tirer un diagnostic de danger, et alerter les services compétents.
Nous faisons aussi beaucoup de formation. Étant adossés à un service d'urgence, nous sommes ouverts vingt-quatre heures sur vingt-quatre, de sorte que les médecins peuvent toujours nous adresser leurs patients. Cette idée d'équipe ressource me semble vraiment importante à reprendre dans le futur plan : tous les hôpitaux doivent en être dotés. De même que l'on ne concevrait plus qu'un service de pédiatrie n'ait pas un spécialiste en diabétologie, en endocrinologie ou en cancérologie de l'enfant, il faut des équipes référentes – pas un service, mais bien des équipes ressources mobiles, capables d'aller dans tous les services de l'hôpital mère-enfant.
J'ai eu l'honneur de participer au rapport sur les besoins fondamentaux de l'enfant préparé sous la direction du docteur Martin-Blachais. En plus de ces besoins, les enfants protégés ont des besoins spécifiques, liés aux expériences négatives qu'ils ont vécues. Comme le disait le docteur Martin-Blachais, leur santé est déjà entamée quand ils arrivent au service de protection de l'enfance : une étude de l'observatoire départemental de Loire-Atlantique montre, par exemple, que 16 % des enfants du département sont suivis en orthophonie, mais ce n'est le cas que de 4 % des enfants protégés, alors que de nombreuses études montrent que la plupart des enfants qui entrent en protection de l'enfance présentent des troubles du langage et un retard, sous ce rapport, allant d'un à deux ans. On imaginerait donc que 30 %, voire 35 % d'entre eux fassent l'objet d'un suivi orthophonique, d'autant que notre département est plutôt riche et plutôt attentionné. Ce n'est pourtant pas le cas.
Pour répondre à ces besoins spécifiques, il faut encore plus de moyens. C'est pourquoi nous tentons une expérimentation, conformément à l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, afin d'améliorer la santé des enfants protégés, en nous appuyant sur le réseau de santé, ses pédiatres, ses médecins généralistes, ses psychiatres, ses psychologues, suivant le modèle des réseaux « Grandir ensemble », au service des grands prématurés, ce afin d'assurer un suivi systématique de la santé des enfants protégés, et un dépistage somatique et psychique de leurs troubles, de manière à ce que leur santé soit prise en compte dès le début.
Voilà donc ce qu'il faut savoir de nos équipes référentes. J'ajouterai simplement – le docteur Balençon le développera – qu'en prenant en compte la dimension du soin dès le constat, on limite les séquelles à long terme. Lorsque nous constatons des violences, nous ne faisons pas simplement fonction d'auxiliaires de justice, nous contribuons déjà au soin, par la façon dont nous accueillons les enfants, dont nous leur parlons, dont nous les examinons, pour les orienter ensuite. Pour cela, les liens avec les services l'ASE sont très importants : nous recevons des administrateurs ad hoc et des éducateurs. Cette acculturation réciproque, par laquelle nous augmentons notre expérience, chacun à sa place, à partir de sa formation de départ, fait que l'on s'occupe mieux, ensemble, des enfants protégés.
J'interviens ici en ma qualité de présidente de la Société française de pédiatrie médico-légale. Évoquer cette spécialité devant une commission où il s'agit de protection de l'enfance peut paraître un peu incongru, mais, en termes de santé, elle constitue souvent le mode d'entrée en protection de l'enfance. On parle beaucoup de la sortie, aujourd'hui, mais il me semble également important de parler de l'entrée, voire du mode de retour.
L'idée de cette association a germé tranquillement dans l'esprit d'une dizaine de pédiatres et de médecins légistes français, depuis un peu moins de dix ans. Elle a vu le jour en 2016, sous le statut prévu par la loi de 1901. Elle réunit aujourd'hui soixante-cinq membres, pédiatres, médecins légistes, ou professionnels dotés de cette double valence. Elle compte également des médecins référents pour la protection de l'enfance, ou d'autres médecins intéressés par les violences faites aux enfants.
Elle a été créée avec la volonté très forte de prendre en charge le retentissement des violences sur la santé de l'enfant, violences qui ne sont pas toujours identifiées, mais ont des conséquences funestes, comme l'ont dit mes collègues.
Nous sommes également partis du constat que les enfants victimes de violences ne retiennent que rarement l'attention des médecins, pédiatres ou généralistes : on sait que moins de 5 % des signalements émanent de ces praticiens. Nous constations également que, pour développer une activité pédiatrique au sein de services de médecine légale qui reçoivent le tout-venant des coups et blessures, examinent victimes et auteurs, ou déterminent des âges osseux – activités évoquées tout à l'heure par Mme Rey-Salmon – il fallait un apport spécifique, analogue aux compétences spécifiques des magistrats chargés des mineurs dans le monde judiciaire.
Le rapport rendu par Alain Grevot au défenseur des enfants a fortement souligné l'effet funeste que peut avoir, sur la santé globale des enfants, le clivage des spécialités : certains pédiatres étaient dans l'incapacité de voir la clinique de la violence, et les constats de coups et blessures dressés en aval devaient encore, paradoxalement, intégrer la notion de croissance, de développement de la victime.
Partant de cette clinique de la violence, qui fait tout de même partie de la culture commune aux pédiatres et aux médecins légistes, nous avons souhaité nous fédérer, et réfléchir autour d'une démarche intégrée autour de l'enfant. Cette démarche va de la prévention, dont il a été question tout à l'heure, au dépistage et à l'expertise, puisque nous avons également constaté que l'on prévient bien ce que l'on connaît bien ; que l'on diagnostique ce que l'on pourra prendre en charge ultérieurement ; que, pour faire une bonne expertise en pédiatrie médico-légale, il faut de bonnes connaissances pédiatriques et de bonnes connaissances médico-légales ; que la compétence commune de pédiatrie médico-légale, enfin, est véritablement essentielle.
Nous nous sommes bien sûr concertés avec la Société française de pédiatrie et la Société française de médecine légale, afin de ne pas perpétuer des clivages, mais d'instaurer une véritable association professionnelle.
Notre idée est aussi que, pour reconnaître les violences, il est essentiel de savoir comment on les traite, et que, pour constituer des dossiers solides, il faut aussi une expérience de leur traitement. Il était donc essentiel, pour les expertises, d'intégrer les violences dans les schémas de développement, et le développement dans l'analyse des violences.
Une autre idée nous a guidés dans cette préparation : comme le disait tout à l'heure Mme Rey-Salmon, lorsque l'on parle de pédiatrie médico-légale, on parle de médical et de légal. Il ne nous paraît pas éthique, aujourd'hui, de dissocier le constat du soin : si un enfant fait l'objet d'un constat, il ne nous paraîtrait pas éthique – cela figure d'ailleurs dans le rapport d'Istanbul – qu'il n'entre pas immédiatement dans un processus de soins. De même, en pédiatrie médico-légale, il est important que, si la présomption d'innocence doit présider à l'examen du dossier du mis en cause, la présomption de nécessité de soins doit présider à la prise en charge de la victime.
Notre association contribue également à la formation, à l'occasion, notamment, de journées annuelles. Nous participons au congrès annuel de médecine légale et de pédiatrie, et préparons actuellement un ouvrage collectif qui vise à mettre en oeuvre, ou en tout cas en mots, ce que je viens de vous présenter.

Merci beaucoup. Avant de donner la parole à notre rapporteure et à Florence Provendier, je vous présente les excuses de Monique Limon, qui a dû partir, mais nous a laissé sa question.

Merci à toutes et tous. Les sujets sont variés, certains m'ont fait rêver, comme l'UMJ pédiatrique, dont je rêverais pour tous les territoires. Malheureusement, on en est encore loin : chez moi, on est en train d'ouvrir une UMJ tout court. C'est dire qu'il reste du travail.
Je voudrais revenir sur la PMI, où il semble, de même – vous nous direz ce qu'il en est –, que l'on soit loin de pouvoir répondre aux besoins. Toutes les auditions que nous avons conduites ont fait ressortir un manque de professionnels, que ce soit en PMI ou en pédopsychiatrie. Cela semble très inquiétant pour la prise en charge de ces enfants. J'aimerais donc savoir si vous avez détecté des solutions, ou des organisations palliatives à mettre en place, que ce soit avec l'aide de personnels infirmiers, qu'il faudrait peut-être renforcer, ou de psychologues… Nous devons chercher les moyens de répondre aux besoins de tous ces enfants qui passent par vos services.
J'aimerais aussi savoir comment les professionnels de la PMI travaillent avec les autres services départementaux, car c'est, là aussi, un point important. J'ai bien entendu votre insistance, madame Vabres, sur l'importance des pôles ressources. J'en suis convaincue, d'autant plus que certains des médecins que j'ai rencontrés avant vous se sont montrés très inquiets devant la procédure d'IP. Ils ne savent pas forcément comment elle doit être engagée, ni dans quels cas ils sont tenus de le faire, et ils s'interrogent sur les risques que cela entraînerait pour eux. Je voudrais donc vous entendre sur ce point.
Quant à la pédopsychiatrie, je connais plusieurs cas d'enfants qui relevaient de l'aide sociale en France, et qui ont été envoyés en Belgique. J'aimerais comprendre pourquoi nous sommes obligés d'envoyer nos enfants vers cette filière belge de la protection de l'enfance. Qu'est-ce qui manque pour les accueillir chez nous ?
Les difficultés de la PMI et l'hétérogénéité de ses capacités d'offre de soins préventifs dans le territoire ont été à l'origine de la demande de Mme Buzyn qu'un rapport sur l'évolution de la politique de PMI soit préparé par l'une de vos collègues, Mme la députée Michèle Peyron. Nous l'avons rencontrée à de nombreuses reprises, dans le cadre d'ailleurs d'un regroupement plus large, avec des collègues d'autres professions – puéricultrices, sages-femmes, psychologues et autres acteurs de la PMI… Nous avons travaillé ensemble et avons transmis à Mme Peyron des propositions et un argumentaire, que je pourrais laisser à votre disposition.
Il est certain que, sur de nombreux sujets – gouvernance du dispositif, questions financières, questions de démographie professionnelle – nous avons rencontré des difficultés, sur lesquelles je ne m'appesantirai pas, mais dont vous pourrez pendre connaissance dans notre document. Nous y avons ajouté une vingtaine de préconisations très précises pour essayer d'en sortir à moyen et à plus long terme. Nous attendons donc la publication du rapport de Mme Peyron, pour savoir dans quel sens elle préconise d'aller.
La protection de l'enfance, dans l'ensemble de ses missions, a évidemment fait partie des enjeux évoqués avec Mme Peyron. L'aspect paradoxal de la situation, que vous avez peut-être perçu dans les présentations rapides que nous venons d'en donner, tient au fait que nous avons un dispositif de prévention sanitaire très généraliste et universel, qui intervient très en amont pour prendre en compte l'ensemble des questions de santé et de développement de l'enfant, afin d'assurer ce que l'on appelle une prévention développementale auprès des enfants et de leur famille ; en même temps, des questions très spécifiques se posent, notamment en protection de l'enfance. Comment est-il possible de remplir cette mission globale, sans nous laisser absorber par une partie de nos missions ? Dans certains départements, par exemple, faute de professionnels, ou à cause d'orientations locales, les collègues puéricultrices ne seront plus en mesure d'effectuer des visites de prévention postnatale ou même, en lien avec les sages-femmes, prénatale, très précoce, mais seront absorbées par des missions d'évaluation des informations préoccupantes – qui font partie des missions de la PMI –, voire même par des espèces de contributions à des missions d'aide éducative à domicile pour les jeunes enfants, qui dépassent de loin ce que devraient être les compétences de la PMI.
Ce paradoxe est lié à de nombreuses questions, que je n'ai pas le temps de développer, touchant l'organisation des services et, encore une fois, les orientations consécutives à la décentralisation. Elle a été une très bonne chose, sur laquelle nous ne proposons évidemment pas de revenir, mais elle pose la question de savoir comment conduire des politiques adaptées au contexte local, tout en préservant l'homogénéité d'une politique nationale de prévention et de protection de l'enfance. La question se pose pour la PMI, pour la pédopsychiatrie dans sa dimension préventive, et pour l'aide sociale à l'enfance. Je pense que le Conseil national de protection de l'enfance était une forme de réponse, pour essayer d'aller dans le sens d'un partage et d'une élaboration plus collective, au niveau national, des réponses en matière de protection de l'enfance.
Il faut trouver aussi les moyens d'élaborer de façon plus concertée, entre les départements et le ministère de la santé, une politique de prévention en matière de santé familiale et infantile. Là aussi, nous espérons que le rapport de Mme Peyron permettra de progresser en ce sens.
Pour ce qui est de nos rapports avec les services sociaux de l'enfance, il est important que, comme notre consoeur l'a dit, le soin soit pensé dès le départ. Nous y travaillons actuellement dans nos services. On a cru trop longtemps que le simple fait de soustraire l'enfant à son milieu, avec ses négligences ou ses difficultés éducatives, était suffisant. En réalité, on perd du temps. Nous conduisons actuellement un travail de formation transversale entre professionnels de l'enfance et travailleurs sociaux, ces derniers ne disposant pas des repères du développement de l'enfant. C'est pourtant un élément très important. Notre travail vise aussi à leur offrir des formations sur les particularités de l'enfant confié, qui font qu'il se trouve sept fois plus en situation de handicap, au minimum. Il s'agit ainsi, par les formations que nous leur proposons, de leur apporter l'appui de nos connaissances sur le développement de l'enfant.
Au sujet des informations préoccupantes (IP), Mme Balençon a rappelé que les médecins sont à l'origine de moins de 5 % des signalements. Or, tous les enfants passent par le système de santé. Il y a donc vraiment un problème, qui tient à l'ignorance, à l'obscurantisme et au défaut de formation des médecins en la matière. On sait, grâce à des études, que, dans les pays socialement et économiquement comparables au nôtre, 10% des enfants sont victimes de violences, tous milieux confondus. C'est plus que pour une maladie chronique, comme le diabète, par exemple. Or la formation consacrée aux maladies chroniques, comme le diabète ou l'infarctus du myocarde, est énorme dans nos facultés, mais la part des formations consacrées aux victimes de violences est vraiment très faible. Le plan 2017-2019 prévoyait d'alerter la Conférence des doyens sur cette impérieuse nécessité d'augmenter la formation des médecins. Or, à ma connaissance, nous en sommes toujours au même point. Il faut vraiment faire porter notre effort là-dessus.
Je profite du fait que je suis la seule, à cette table, à n'être pas médecin, pour dire que le propos du Mme Rey-Salmon ne vaut pas uniquement pour les médecins, mais pour tous les professionnels chargés d'enfants et d'adolescents, ou, tout simplement, de familles. J'enseigne la psychologie et, justement, la maltraitance et le psycho-traumatisme à des étudiants en psychologie. Je trouve incroyable qu'en formation initiale les universités ne proposent presque rien sur ces sujets, même pas des modules pratiques expliquant ce qu'est un signalement et la procédure à suivre, ou sur ce qu'est une IP et sur les services auxquels l'adresser… Ces choses parfaitement pratiques devraient être enseignées aux psychologues, aux infirmières, aux éducateurs, aux assistants sociaux, bref, à tout travailleur social, et pas seulement à ceux qui seront en contact avec des enfants, mais, en général, avec des familles. Car il arrive que les adultes disent des choses que la protection de l'enfance doit prendre en compte. Que faire face à un adulte qui décrit une situation inquiétante ? Que doit faire un professionnel à ce moment-là, même s'il n'a pas vu l'enfant ? Voilà qui devrait faire l'objet d'un enseignement destiné à tous ces professionnels, en formation initiale, et non continue.

Une première question, de la part de ma collègue qui a dû partir : comment faire pour donner toute sa place à la PMI dans le dispositif d'aide sociale à l'enfance, en lien avec l'ensemble des acteurs ? Nous discutions à voix basse, tout à l'heure, tout en vous écoutant. Je lui ai demandé ce qu'il faudrait faire, à son avis, pour faire avancer les choses. Elle m'a répondu que la clef, c'était la PMI, et m'a dit de vous demander comment il fallait s'y prendre, selon vous, pour donner davantage de place à la PMI, afin qu'elle joue son rôle de coordination et qu'elle facilite la concertation entre l'ensemble des acteurs.
J'en viens à mes propres questions. Je suis sensibilisée, pour ma part, à tous les problèmes des violences faites aux enfants. J'y ai travaillé, je vous le disais, au niveau international et, quand, avec mes collègues de différents pays du monde, je me suis penchée sur les problèmes de violences, je me suis rendu compte que celles dont les enfants sont victimes ne sont pas propres aux pays dits en voie de développement, mais qu'on les retrouve aussi dans nos pays dits développés. Comment est-il donc possible, selon vous, de mieux détecter les violences faites aux enfants, qu'ils soient placés ou non, puisqu'il s'agit d'un problème récurrent, quelle que soit la place de l'enfant dans notre société ?
Comment pourrait-on, par ailleurs, faciliter l'accès des enfants victimes aux professionnels de santé – pédopsychiatres, médecins, ou autres –, sans qu'ils aient à passer par un tiers ? Il existe bien des numéros d'appel, mais on constate aujourd'hui que beaucoup de cas passent entre les mailles du système, ce qui est regrettable. Que pourrait-on donc imaginer et mettre en place, selon vous, pour que les signaux d'alerte que peut lancer un enfant ne restent pas sans suite ?

Vous évoquiez, docteur Martin-Blachais, l'existence de pouponnières. J'en avais déjà entendu parler un peu, mais j'aimerais connaître votre avis sur le développement de ce système, qui soulève d'importantes interrogations, puisqu'il est destiné à des bébés.
Second point, sur le suivi psychologique. Lors de notre première audition, nous avons entendu huit enfants de l'ASE. Sur les huit, une seule, je crois, a bénéficié d'un suivi du début jusqu'à la fin. Elle était d'ailleurs la seule, je pense, à paraître très positive. Pourquoi n'y a-t-il donc pas de suivis réguliers ? J'imagine que c'est un problème de moyens, mais auriez-vous des solutions ? À l'heure où l'on parle d'e-médecine, un suivi à distance vous paraîtrait-il envisageable ? Quand les effectifs sont insuffisants, on peut se tourner vers ce genre de solutions. Qu'en pensez-vous, et quelles pistes proposeriez-vous pour répondre à ce problème ?
Les enfants passent par les services de santé. Ce sont les professionnels qui, n'étant pas formés, comme le disait Mélanie Dupont, ne voient pas leur situation. Ils ont de la gadoue dans les yeux et des lunettes de soleil. Les enfants vont chez des médecins traitants, ou à la médecine scolaire. Le problème, c'est qu'on ne les voit pas. Si l'on n'a pas reçu d'enseignement sur la maltraitance, et si l'on ne sait pas qu'elle touche 10 % des enfants des pays industrialisés, tous milieux sociaux confondus, et qu'elle est plus difficile à identifier dans les milieux sociaux favorisés – auxquels appartiennent les participants à cette table ronde –, parce que l'on y sait mieux la dissimuler, alors on voit en face de soi quelqu'un de semblable à soi, et l'on n'est pas capable d'imaginer ce dont l'enfant est victime. Tant que l'on ne sait pas que cela existe, on est incapable de le diagnostiquer. Un médecin qui n'aurait jamais entendu parler de l'infarctus du myocarde ne saurait pas ce que c'est. Il en va de même de la maltraitance : la déceler suppose une formation adéquate.
Quant au parcours de santé, il faudrait bien sûr y consacrer des moyens plus importants, mais on peut déjà s'appuyer sur de réelles ressources : malgré la persistance de déserts de santé, nous avons des généralistes, des puéricultrices, des psychologues… On manque fortement de pédopsychiatres, évidemment, mais, en amont, au plan somatique, un enfant peut être bien suivi, dès le début, avec un vrai plan de santé. Il n'est pas normal qu'un enfant en protection de l'enfance ne voie un médecin qu'une fois par an, voire une fois tous les deux ans. Je parle simplement d'un médecin généraliste, qui le pèse, écoute son coeur et l'examine au plan somatique, et qui puisse, du même coup, déceler un problème psychologique et adresser l'enfant plus précocement à nos collègues pédopsychiatres, sans attendre que sa situation ne se soit fortement dégradée.
Le remboursement des psychologues libéraux serait une autre piste. D'où le plan dont nous avons proposé l'expérimentation, conformément à l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 : l'idée serait de créer un réseau de professionnels volontaires, formés, représentant plus particulièrement les spécialités qui ne relèvent pas du droit commun, comme les psychologues et les psychomotriciens. Nous voulons expérimenter des forfaits, dont le coût ne sera pas énorme par rapport à ce que coûte à la société, ensuite, le fait de n'avoir pas soigné ces enfants à temps, que ce soit en frais de santé, ou à cause des difficultés qu'ils rencontrent en tant que citoyens, ou des risque de répétition, comme l'a dit Mme Martin-Blachais.
Nous avons un réseau de santé très performant, mais qui mérite de meilleures formations et l'instauration d'examens systématiques, de manière à ce que l'on n'attende pas, pour amener l'enfant chez un praticien, que son comportement présente des troubles devenus socialement insupportables, alors qu'il s'agit de symptômes de souffrance qui auraient pu être pris en charge bien en amont. Il suffirait pour cela que l'enfant soit présenté à un médecin trois fois par an, qu'il voie un ophtalmologiste et bénéficie systématiquement de tous les bilans nécessaires, notamment orthophonique, avec un vrai suivi systématique de prévention et une vraie coordination de soins. Voilà comment, avec quelques moyens supplémentaires, très modestes, on pourrait améliorer la santé des enfants confiés à la protection de l'enfance.
Dernier point : de même que le docteur Rey-Salmon a insisté sur la prévention du syndrome du bébé secoué, je préconise, plus largement, une démarche de prévention dans les maternités, pour promouvoir l'éducation sans violence. Les futurs parents doivent apprendre comment réagir lorsqu'un enfant se roule par terre, ou fait une crise. Qu'il s'agisse des pleurs du bébé ou du soi-disant caprice du plus grand, la résolution de ces problèmes requière un apprentissage, afin que les enfants soient éduqués sans violence. Beaucoup de parents nous disent : « si je ne lui donne ni fessées ni gifles, il va devenir délinquant », alors que de nombreux travaux démontrent que, dans les pays qui ont banni les violences corporelles depuis longtemps, il y a moins de délinquance. Voilà ce que les parents ne savent pas. Quand on le leur dit, ils sont très étonnés. Or ces choses peuvent être dites en prévention, bien en amont, y compris d'ailleurs en sciences de la vie et de la terre (SVT) : la plasticité cérébrale, comme les neurosciences, devrait y être abordée. Un petit film de quatre minutes sur la plasticité cérébrale a été montré au ministère il y a deux ans ; il pourrait l'être à des enfants de maternelle. Cela fait partie des éléments que l'on pourrait enseigner dès l'école, pour faire comprendre que l'on peut élever un enfant sans violence, et que les expériences négatives sont mauvaises pour le cerveau.
Le dépistage des maltraitances suppose une bonne connaissance de la clinique de la violence, donc, indéniablement, l'acculturation dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais cette consigne s'adresse au collectif : les enfants maltraités passent plus souvent et plus longtemps dans les systèmes de santé, il faut donc que les médecins qui les reçoivent aient des solutions de traitement. Or, on ne peut s'attendre à ce qu'un médecin diagnostique une maladie rare s'il n'en connaît pas le traitement. C'est ce que nous disions tout à l'heure au sujet de l'infarctus du myocarde.
Il serait donc important que nos confrères puissent se rapprocher d'une équipe référente en matière de violences faites aux enfants, notamment dans le milieu hospitalier. Ce serait conforme à la mesure 11 du plan « Violences ». Plutôt que d'un praticien isolé, il doit s'agir d'une équipe en pédiatrie médico-légale, précisément. Ce serait très bénéfique, puisque l'on ne voit et l'on ne traite que ce que l'on connaît.
Beaucoup de questions se posent au sujet du suivi. J'ai la conviction qu'il est très lié à la prise en charge initiale : il sera chaotique, si la prise en charge initiale n'est pas très bonne. D'où l'importance considérable de cette culture commune dans la prise en charge initiale, qui est une prise en charge médicale, pédiatrique, médico-légale parfois, par le biais du constat, et pédopsychiatrique. Je travaille, par exemple, dans une unité où, en coopérant étroitement avec des pédopsychiatres, nous parvenons à un dépistage très fort du psychotrauma, simple ou complexe. Il est vrai que le suivi pédopsychiatrique ne se fera pas forcément dans notre unité, mais, dans tous les cas, les choses auront été bien posées initialement. Or les moyens du suivi dépendent aussi de cette étape initiale et de son organisation.
Enfin, l'ARS de ma région, la Bretagne, crée actuellement, autour des groupements hospitaliers de territoires (GHT), un groupe de travail sur l'enfance en danger, dont je suis responsable. Il s'organisera par niveaux de soins, comme ceux qui existent en périnatalité, et sera rattaché à un CHU de niveau 3, qui traite certains dossiers beaucoup plus graves, et conduit des travaux de recherche susceptibles d'inspirer des formations. Le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur les morts violentes d'enfants a formulé la proposition que les ARS se saisissent de ce sujet. C'est ce qu'a fait celle de Bretagne, pour la coordination des GHT, en tout cas, en créant ces équipes référentes qui forment un maillage. Elles sont aussi en lien avec celles qui s'occupent des violences faites aux femmes. Sur ce sujet, la HAS s'apprête à faire paraître des recommandations auxquelles j'ai contribué au titre de la Société française de pédiatrie médico-légale. Un travail important peut être fait, en la matière, sur la coordination. Cela dit, il faut que les coordinateurs voient aussi des patients.
Je voudrais simplement ajouter un mot sur les adolescents. Lorsque l'on parle de maltraitance, on pense surtout aux très jeunes enfants. Or, elle touche énormément d'adolescents et d'adolescentes. Ils arrivent souvent à l'hôpital pour des troubles du comportement, des tentatives de suicide, des fugues, leurs cas ayant d'emblée un volet psychiatrique. Or, nous avons peu de ressources pédopsychiatriques, et il faudrait vraiment une évaluation pédiatrique de ces jeunes par des équipes formées pour repérer les maltraitances. Si je me suis intéressée à la maltraitance de l'enfant, c'est parce que j'étais dans un service de médecine pour adolescents, et que j'accueillais les tentatives de suicide. C'est là que j'ai découvert l'immensité de la maltraitance. Je voudrais donc vraiment que l'on accorde une attention particulière aux adolescents et au repérage, à travers les troubles des conduites et des comportements, des violences qu'ils subissent.
Un mot sur la prise en charge des consultations de psychologues : j'y suis favorable – sans prétendre, évidemment, représenter tous les psychologues de ce pays – à condition qu'ils soient formés et travaillent en lien avec les équipes.
Quant aux forfaits, je mettrais quand même un bémol : il me semble difficile de dire à un patient : « Vous avez dix séances avec le psy, et c'est tout. » Comment peut-on dire cela à un enfant dont l'un des principaux symptômes consiste justement en troubles de l'attachement ? C'est déjà extrêmement compliqué pour lui de se mettre en lien avec son thérapeute et d'avoir confiance en lui ; si, en plus, on lui dit ensuite : « de toute façon, c'est jusqu'à tant, et c'est tout », autant vous dire que ça ne marchera jamais.
Je commencerai par les pouponnières, car j'ai cru comprendre – vous me direz si c'est juste – que vous vous interrogiez sur les caractéristiques des pouponnières en tant que structures à caractère résidentiel collectives. S'agissant de petits enfants, peut-être vous interrogiez-vous sur la raison pour laquelle ils ne sont pas accueillis en milieu familial ? Était-ce bien votre arrière-pensée ?
Dans ce cas, je dois vous dire, pour avoir beaucoup travaillé comme expert dans différents réseaux européens, que je n'ai pas toujours partagé la position européenne actuelle, qui prône la désinstitutionalisation à tout crin, c'est-à-dire la lutte contre toutes les formes collectives d'accueil résidentiel au profit de l'accueil individuel. Je crois qu'il faut raison garder, et conserver un éventail de dispositifs qui permette de choisir celui qui correspondra le mieux à l'intérêt particulier de l'enfant. Il y a des enfants pour qui une situation d'interaction familiale d'accueil n'est pas la meilleure solution : ceux, par exemple, qui ont vécu des relations d'attachement extrêmement délétères peuvent se trouver en difficulté dans une telle situation, alors que le groupe peut, au contraire, être une réponse appropriée. Il ne faut donc pas chercher à les placer tous dans des situations de face-à-face et de relation duelle.
J'entends, en revanche, vos interrogations sur l'accueil de ces enfants. Il faut savoir que ceux que l'on accueille en pouponnières, dont je parlais tout à l'heure, ont été confrontés à des problèmes relevant, sinon de la violence ou de la maltraitance, de pathologies de l'attachement ou des troubles de la dysparentalité, dont je souhaiterais que l'on parle aussi. Ces pathologies peuvent ne pas s'exprimer par des faits de violence, en tout cas pas tels qu'on les imagine, sous forme de violence physique, mais ils n'en engendrent pas moins une violence insidieuse, qui attaque la construction psychique de l'enfant. Du fait des transactions relationnelles extrêmement pathogènes qu'ils ont pu construire dans leur milieu familial d'origine, ces enfants ne peuvent pas toujours, du jour au lendemain, rétablir de nouveaux modes relationnels avec un autre environnement, fût-il bienveillant, bien composé, et plein de générosité. Même s'ils ont vécu des formes de relations extrêmement délétères dans leur famille d'origine, c'est le modèle qu'ils ont connu et sur lequel ils se sont construits. Le temps de leur permettre de se défaire de ce type de relations et d'en construire d'autres, il faut pouvoir les placer dans un environnement de contenance, dans un environnement de soins, et parfois les amener à entrer dans des phases régressives, afin qu'ils repartent sur d'autres bases.
Tout cela nécessite une structure et des compétences professionnelles, une très grande proximité et un très grand travail d'équipe, là aussi, pour que les professionnels ne s'engagent pas dans des mouvements émotionnels personnels, intersubjectifs, avec ces enfants chez qui on n'arrive pas à décrypter ce qui se passe, et pour qu'ils ne les leurrent pas. La pouponnière est donc parfois une bonne réponse. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain – excusez-moi pour cette trivialité –, car je crois qu'il faut parfois disposer d'un panel de solutions diverses.
J'ajoute simplement deux mots, sur la question de la formation et sur celle des réponses de soin. Nous avons évoqué, dans notre rapport, la nécessité que les enfants qui ont été victimisés puissent bénéficier d'un accompagnement et de soins ; nous avons même évoqué la possibilité de leur ouvrir l'accès à des soins dans le secteur libéral, puisque, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le secteur public rencontre aujourd'hui de très grandes difficultés pour répondre aux besoins de soins. Mais nous avions introduit, à titre préalable, le critère de la formation de ces professionnels. Or nous n'avons pas aujourd'hui, en France, suffisamment d'équipes formées aux psychotrauma et capables de prendre en charge ces enfants. C'est toute la difficulté, et c'est aussi une difficulté éthique pour nous : il faut certes repérer les victimes, mais surtout pouvoir leur apporter la réponse d'une prise en charge appropriée. Or nous manquons de professionnels adéquatement formés, que ce soit dans le secteur sanitaire ou le secteur psychologique. D'où notre proposition de recourir à l'activité libérale. Nous avions été jusqu'à proposer un panier de soins qui facilite le recours à ces professionnels libéraux, à condition, encore une fois, qu'ils disposent d'une formation particulière.
Sur le suivi psychologique des enfants par l'ASE, des questions se posent depuis toujours sur la posture des psychologues dans ses équipes : sont-ils là pour faire de l'accompagnement thérapeutique ? Très souvent, ce n'est pas ce que l'on attend d'eux. Ou alors il faut que leurs missions institutionnelles, définies dans leurs fiches de postes, soient claires. Les services de l'ASE auxquels ils appartiennent sont plutôt là pour aider à la compréhension de la situation du jeune, ou du plus jeune. Cette activité s'articule à celles du secteur de soins, elle y contribue, mais n'est pas centrée sur la réponse thérapeutique.
La question se pose donc aujourd'hui : les services de l'aide sociale à l'enfance doivent-ils eux-mêmes se constituer des équipes de soignants pour répondre aux difficultés actuelles d'accès aux soins ? Elles concernent une grande partie des enfants qui ont des difficultés psychiques, comme de ceux qui sont porteurs de handicaps – on sait que c'est aujourd'hui le cas de 25 % à 30 % des enfants confiés à l'ASE –, et sont d'autant plus vulnérables qu'ils ont connu des parcours délétères.
Il y a un grand écart entre la présomption de la nécessité de soins, que je découvre dans les propos ma consoeur, et le fait que seule une jeune majeure, sur les huit que vous avez entendus, ait dit avoir été accompagnée psychologiquement. Cet écart pose la question de savoir s'il faut proposer aux enfants protégés un accompagnement ou des soins psychiques au sein de l'ASE, ou plutôt ailleurs. Ce n'est pas une sorte de luxe que l'on proposerait. L'une des conséquences de la séparation et de la protection est la possibilité offerte à l'enfant de rejouer, de reprendre la question du lien pathologique, au sein de la structure dans laquelle il est placé, que ce soit une famille ou une institution. Une psychopathologie du lien va donc forcément apparaître. D'où la nécessité de l'accompagnement.
Si cette pathologie n'apparaissait pas, l'enfant raterait une occasion de se reconstruire et de reprendre son développement. Les comportements ou les paroles par lesquels elle se manifestera, dans la famille d'accueil ou dans une institution, ne seront pas seulement une reprise des problématiques anciennes, mais aussi, parfois, un agir révélateur. Il a été question des révélations faites par les enfants une fois accueillis ; or celles-ci ne passent pas toujours par des paroles, mais parfois seulement par des actes, ou par les comportements des enfants dans leur famille d'accueil. Une lecture psychologique de ces situations est donc nécessaire.
Il existe encore aujourd'hui un problème de formation : les professionnels socio-éducatifs de la protection de l'enfance, à partir des outils qu'ils ont acquis, ont encore souvent le sentiment qu'il faut éviter de psychologiser, de psychiatriser, mais qu'il faut s'efforcer d'éduquer ou de rééduquer. Nous devons au contraire chercher à faire progresser la protection de l'enfance vers un modèle d'aide psycho-sociale à l'enfant…
…ou plutôt d'aide médico-psycho-sociale.
Quant aux autres questions qui ont été posées, je me ferai un plaisir de ne pas répondre à celle sur le déficit de professionnels pédopsychiatres. Il est réel, mais quelles sont les solutions ? J'aimerais les connaître. L'API ne les a pas ; elle a, en revanche, lutté, encore récemment, pour que le changement de la maquette de la formation en psychiatrie ne s'opère pas, une fois de plus, au détriment de la pédopsychiatrie. Cette lutte a été vaine. Or il s'agit d'un point très important pour nous. Par ailleurs, les budgets de l'hôpital public, qui sont très difficiles à identifier, ne rendent pas attractive la spécialité de pédopsychiatrie à l'hôpital public.
Quant aux maltraitances violentes, qu'elles soient physiques ou psychologiques, la psychopathologie parentale vise à éviter certains comportements qui sont violents, mais ne sont pas perçus comme tels. Ces parents ne sont pas méchants, mais ils pensent, par la violence qu'ils exercent, faire au mieux pour leur enfant. C'était très clairement dit dans les témoignages que vous avez entendus.
Il me semble, enfin, que les huit jeunes qui vous ont parlé vous ont dit une chose très intéressante : « Écoutez-nous, l'enfant doit être entendu, mais ne suivez pas forcément ce que nous disons. » Si on lui demande : « Veux-tu être séparé de ta mère ? », l'enfant répondra, lorsque l'on viendra le chercher : « Non, je veux rester. » Devenu adulte, il dira que l'on n'aurait pas dû le laisser auprès d'elle. La lecture de leurs propos doit intégrer ceux qu'ils tiennent après-coup. Les enfants demandent parfois à être extraits du dispositif de protection de l'enfance, notamment par une adoption simple. Il faut se demander s'il ne vaut pas mieux améliorer le dispositif de protection de l'enfance. Il me semble, pour ma part, que ce serait bien préférable.
Je voudrais répondre à la question sur la collaboration avec les services de PMI que Mme Limon a posée avant de partir. Sur le terrain, nous passons des conventions avec les PMI pour conduire un travail commun, en particulier sur des lieux d'accueil parents-enfants. Le manque de moyens oblige évidemment toujours à définir des priorités. Nous dégageons du temps pour cette collaboration, très importante pour nous, mais elle pourrait être étendue, à condition de trouver l'énergie pour obtenir les moyens nécessaires.
Quant aux départs vers la Belgique, on en revient, là encore, au manque de places en France, tout simplement. La réponse peut sembler un peu bête, mais ce n'est pas par choix que des enfants sont envoyés à l'étranger. Encore est-ce très difficile : il faut un travail de préparation d'un an, de deux ans, voire de trois ans, avant de trouver une place en Belgique. Voilà mon témoignage de terrain, en tant que responsable d'un centre médico-psychologique (CMP) : il faut énormément de temps pour trouver la bonne institution, ou tout simplement une institution.
Quant à l'idée de recourir à des infirmiers pour renforcer les équipes, je rappelle que le secteur s'est constitué, depuis les années 1960, à partir d'équipes pluri-professionnelles. Un pédopsychiatre ne travaille pas tout seul. Dans la psychiatrie publique, en tout cas, nous travaillons en équipes, avec tous les corps de métier – moins cependant avec les orthophonistes, autant le dire ici, puisque, avec le numerus clausus, nos équipes publiques ne recrutent plus d'orthophonistes, entre autres.
Je remercie beaucoup mes confrères de leurs interventions. Il est vrai que les équipes de PMI sont pluridisciplinaires, mais, par manque de professionnels, elles n'assurent pas le suivi des enfants placés. Les psychologues, par exemple, n'en ont pas les moyens. Il arrive aussi souvent qu'une confusion se produise : on considère qu'un enfant déjà pris en charge par le service social à l'enfance n'est pas prioritaire. Or il n'y a rien de plus délétère pour l'enfant que de rester isolé, sans partenariat avec la pédopsychiatrie ou avec la pédiatrie. C'est une chose à souligner : pour l'instant, les services de PMI se consacrent plutôt à la supervision des équipes, et leurs psychologues à l'aide à l'orientation et aux projets de soins des enfants, ainsi qu'aux projets personnalisés d'accueil des enfants placés.
On n'a pas parlé des effets délétères des violences conjugales. Or c'est la principale chose que je vois dans ma pratique de médecin de PMI. Je voudrais dire aussi que, si la PMI a toute sa place dans l'accompagnement de l'enfance, dès le départ, notamment dans les projets personnalisés pour les enfants, sa mission primaire consiste dans la prévention généraliste. Si on l'empêche de l'accomplir, on en perdra le bénéfice. Il faut donc renforcer la PMI, qui n'est pas actuellement en mesure de mener de front ces deux types d'actions. Nous appelons donc de nos voeux un renforcement de nos équipes.
Pour avoir participé, depuis bien des années, à diverses auditions, comme beaucoup de mes collègues présents, je pense, malheureusement, que, pour tous nos services publics, que ce soit les services de PMI, ceux des conseils départementaux, ceux de pédopsychiatrie, ou en général ceux des hôpitaux publics – c'est un peu désolant de devoir vous le dire, et il ne s'agit certes pas de tout ramener à cela – la question des moyens de la prévention et du soin en France est vraiment posée.
Pour ce qui est de la prévention, en tout cas, les pouvoirs publics nous disent en permanence qu'il faut remettre la prévention au niveau du soin – à supposer que l'on puisse ainsi les opposer, de façon un peu caricaturale, alors qu'ils ne s'opposent pas. En réalité, on court toujours après ces moyens insuffisants. Je n'irai pas plus loin là-dessus, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais je vous laisserai notre document sur la PMI.
Je voudrais revenir rapidement sur certains points qui viennent d'être évoqués. Sur la formation, vous nous demandiez vers qui un enfant peut se tourner lorsqu'il est victime, ou lorsqu'il sait que l'un de ses camarades l'est. La culture sur ces questions doit être développée chez tous les acteurs de l'enfance – qu'ils appartiennent à l'éducation nationale, au secteur de la santé, ou à d'autres secteurs d'accueil – de façon à ce que l'enfant puisse, le cas échéant, trouver auprès d'une personne de confiance l'appui nécessaire pour pouvoir parler. Cela suppose qu'il y ait, peut-être dans son milieu de vie, quelqu'un dont il soit proche, pour une raison ou une autre, et à qui il puisse se confier ; ou alors une personne jouissant d'une culture suffisante pour comprendre les signes que peut présenter un enfant, pour repérer chez lui que quelque chose ne va pas, et pour aller vers lui. Il faut que l'enfant puisse aller vers des adultes formés, et que des adultes formés puissent aller vers les enfants qui présentent des difficultés.
Pour les médecins, certains outils existent, mais le développement professionnel continu devrait en faire partie. La Haute Autorité de santé a par exemple édité, il y a deux ou trois ans, un document très bien fait, je trouve, à l'intention des médecins généralistes, sur la manière de repérer des signes de maltraitance, ou, en tout cas, de se poser la question de savoir si un enfant en est victime, ou risque de l'être. Mais les médecins connaissent-ils ce document ? Ces thématiques sont-elles suffisamment développées dans les formations postuniversitaires ? Je n'en suis pas certain.
Vous nous interrogiez sur l'information préoccupante. La législation sur ce sujet a évolué. Il était arrivé, dans le passé, que des médecins soient sanctionnés par le conseil national de leur ordre pour avoir transmis des signalements. Aujourd'hui, un médecin qui transmet un signalement ou une information préoccupante ne doit plus pouvoir être sanctionné par l'ordre, pourvu qu'il l'ait fait suivant les règles de déontologie. Or les médecins ne le savent pas : je lisais hier dans Le Quotidien du médecin la réaction d'un confrère qui disait : « Oui, mais on va être sanctionné si on fait une information préoccupante. » Cela veut dire que cette législation, qui date au moins de quatre ou cinq ans, n'est pas connue des médecins de terrain. Il y a donc vraiment tout un travail de formation et de culture professionnelle à accomplir.
Un mot, enfin, concernant les parents. L'une de mes collègues présentes disait tout à l'heure qu'il fallait renforcer la prévention et expliquer en quoi l'éducation, si elle est violente, comporte des risques. Il faut en effet accomplir ce travail d'explication et de prévention, mais aussi offrir des lieux de parole aux parents, parce que, parfois, pour certains d'entre eux, le travail d'explication et de conviction ne suffit pas. Ils sont de chair et de sang, et leurs propres conflits internes peuvent être avivés par les comportements consécutifs aux difficultés que l'enfant rencontre à ce moment-là. Il faut qu'il y ait auprès d'eux des professionnels auxquels ils puissent faire appel, et qu'ils puissent participer à des groupes de parole facilement accessibles, dans des lieux d'accueil parents-enfants. Il faut, enfin, développer aussi tout ce secteur-là, non pour former les parents au métier d'être parent, parce que ce n'est pas un métier, mais pour leur offrir des lieux d'expression, de dialogue avec d'autres parents, d'échanges d'expériences, où des professionnels soient également présents pour les aider à élaborer ce qui est en train de se passer avec leur bébé ou avec leur enfant. Lorsque ces groupes existent, on voit comment des choses qui ont l'air de se nouer peuvent se dénouer très rapidement. Encore faut-il que ces dispositifs soient développés.

Lorsqu'un enfant est placé, doit-on maintenir ses liens avec ses parents ? C'est une question sur laquelle on a entendu tout et son contraire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez.
Seconde question : il arrive que des difficultés surgissent après le placement. On sait très bien, notamment, que certains enfants reproduisent les schémas des comportements qu'ils ont subis – des violences sexuelles, par exemple – sur leurs camarades. J'ai entendu des présidents de départements dire qu'ils ne savaient pas gérer de tels cas, et qu'il fallait des systèmes intermédiaires, parce que ces enfants ne pouvaient être accueillis dans les mêmes foyers que les autres. Connaissez-vous de telles structures intermédiaires, entre l'hospitalisation et les foyers ordinaires ? Ou sauriez-vous comment traiter ces enfants ? C'est un problème extrêmement préoccupant, sur lequel j'aimerais entendre votre avis. Les UMJ reçoivent-elles parfois les retours de professionnels sur des enfants qu'ils ont pris en charge, avec leurs difficultés, ou des retours d'enfants que vous avez déjà vus, et qui reviennent ?
Il arrive en effet, malheureusement, que les UMJ voient revenir les mêmes enfants, parce que leur situation n'as pas été évaluée et suffisamment prise en compte. Quand les équipes se rendent compte de cela, c'est terrible. Elles ne peuvent que se demander si, cette fois-ci, la prise en charge fonctionnera, et nous sommes inquiets pour ces jeunes.
Pour répondre à votre première question, je pense que certains liens familiaux ne doivent pas être maintenus, parce qu'ils sont trop toxiques. Mais une évaluation doit précéder toute décision en la matière, et déterminer éventuellement dans quelles conditions et de quelle manière des liens peuvent être maintenus. Mais je suis convaincue qu'avec certains parents, c'est impossible.
J'ai sur ce point une certaine expérience, qui me vient de mon travail à l'accueil familial thérapeutique. On y distingue le maintien du lien et celui de la relation, ou des relations. La France n'ayant pas décidé de déchoir de leur parentalité les personnes incapables de s'occuper de leurs enfants du fait de leur maladie mentale – ce serait une sorte de double peine –, il est très important de savoir bien travailler, en tenant compte du fait que le lien est inaliénable et construit la personne. La filiation, même avec une personne malade, est un élément qui permet de se construire, pourvu que les relations avec cette personne fassent l'objet d'une vigilance particulière, dans le cadre de la mesure de protection et de séparation. Cette mesure instaure une distance et peut suspendre les relations pour un certain temps ; elle le fera certainement dans les moments où la psychopathologie des parents est exacerbée. Mais la technique de médiation des rencontres, qui est assez bien maîtrisée, permet aux équipes qui savent travailler avec cet outil de maintenir des relations entre l'enfant et les parents, ou, lorsque les relations ne sont pas possibles, de maintenir le lien et de le travailler.
L'enfant finit très régulièrement par comprendre que cette personne est bien son père ou sa mère, mais qu'elle a des difficultés psychologiques. C'est autre chose que la référence de filiation à cette personne. Cette différence permet de dire « Voilà, c'est ma mère, elle est malade. » Parmi les jeunes adultes que vous avez auditionnés, plusieurs étaient en mesure de le dire. Cela montre qu'ils ont bénéficié, peut-être sans le savoir, d'un accompagnement.
Dès lors que le droit français ne prévoit pas, pour ces parents, une déchéance rapide de leur autorité parentale, des techniques peuvent être mises en oeuvre, mais elles sont coûteuses. L'accueil familial thérapeutique est un dispositif qui le permet. Les accueils familiaux spécialisés peuvent aussi se doter de ce moyen de médiation des rencontres. Il existe même, mais c'est très rare, des accueils familiaux de l'ASE qui se donnent les moyens de travailler de cette manière, mais cela est très rare, et dépend des personnes, car le système ne le favorise pas. Je suis prêt, si vous le souhaitez, à vous en parler plus longuement.

Nous vous remercions vivement pour cette table ronde très riche. Si des points n'ont pas été abordés, ou si vous avez des documents à nous transmettre, nous les examinerons avec beaucoup d'intérêt. Merci encore pour le temps que vous nous avez consacré.
La réunion s'achève à dix-neuf heures trente.
————
Membres présents ou excusés
Mission d'information de la Conférence des présidents sur l'aide sociale à l'enfance
Réunion du jeudi 2 mai 2019 à 17 h 30
Présents. – Mme Delphine Bagarry, M. Lionel Causse, M. Guillaume Chiche, M. Olivier Damaisin, Mme Elsa Faucillon, Mme Perrine Goulet, Mme Monique Limon, Mme Florence Provendier, M. Alain Ramadier.
Excusés. - M. Paul Christophe, Mme Jeanine Dubié, Mme Françoise Dumas.