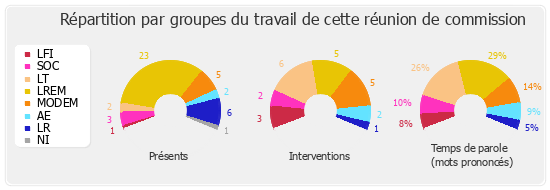Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du mercredi 26 janvier 2022 à 9h30
La réunion
La commission entend MM. Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et Olivier Garnier, directeur général des statistiques, des études et de l'international de la Banque de France, sur la conjoncture économique, et Mme Yasmine Arsalane, analyste « énergie » de l'Agence internationale de l'énergie, sur les marchés de l'énergie.

Mes chers collègues, nous renouons en ce début d'année avec ces auditions « Au cœur de l'économie » qui nous offrent l'occasion d'évoquer la conjoncture économique de façon générale et de nous intéresser à des questions d'actualité plus spécifiques.
Je remercie vivement MM. Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE et Olivier Garnier, directeur général des statistiques, des études et de l'international de la Banque de France, de bien vouloir, une fois de plus, se prêter à l'exercice, dans cette période particulièrement intéressante. Je remercie également Mme Yasmine Arsalane, analyste « énergie » à l'Agence internationale de l'énergie (AIE), de participer à cette session pour évoquer les marchés de l'énergie, dont l'évolution récente nous préoccupe et suscite tant l'action des pouvoirs publics que de nombreuses interrogations.
Compte tenu de la richesse de notre programme, je propose de procéder en deux temps : nous écouterons d'abord MM. Tavernier et Garnier, sur les questions de conjoncture, puis Mme Arsalane s'exprimera sur l'énergie.
Comme nous le faisons traditionnellement, j'évoquerai les prévisions de court terme et Olivier Garnier celles de moyen terme, en s'appuyant sur les prévisions de la Banque centrale européenne et de la Banque de France. Je rappellerai donc tout d'abord les dernières prévisions de croissance publiées, à la mi-décembre, par l'INSEE, puis je vous présenterai l'impact des évolutions récentes de la pandémie sur ces prévisions. Je me concentrerai ensuite sur la situation des ménages et des entreprises, les tensions qui existent sur l'offre et l'inflation.
Si nous considérons les variations du produit intérieur brut (PIB) observées dans les principales économies occidentales et en Chine depuis 2016 et jusqu'au troisième trimestre 2021, nous constatons, après une forte chute au deuxième trimestre 2020, une remontée progressive mais assez forte, notamment en France au troisième trimestre 2020, qui a conduit de nombreuses économies à retrouver leur niveau de PIB d'avant-crise. L'Espagne est un peu en retard en raison de la spécialisation de son économie dans l'activité touristique, tandis que l'activité des États-Unis et de la Chine est supérieure à celle observée avant la crise, mais il faut rappeler que ces deux pays ont une démographie et une croissance potentielle supérieures à celles des pays européens. Si la France a retrouvé son activité d'avant-crise au troisième trimestre 2021, elle a quand même perdu environ deux points d'activité.
Nos prévisions de la mi-décembre anticipaient une croissance trimestrielle autour de 0,4 % ou 0,5 % pour le dernier trimestre 2021 et les deux premiers trimestres 2022. Ainsi, la croissance annuelle serait de 6,7 % en 2021 et l'acquis de croissance à la mi-2022 de 3 %. Le chiffre de 6,7 % de croissance en 2021 n'est pas définitif : les premières estimations pour le compte trimestriel du quatrième trimestre 2021 seront publiées ce vendredi et la campagne de publication des comptes annuels aura lieu au printemps, mais, d'après nos estimations, le PIB français se situerait au deuxième trimestre 2022 à un niveau supérieur de 1,4 % à ce qu'il était avant la crise.
L'évolution de l'activité normale diffère en fonction des secteurs : celle du secteur de l'information et de la communication est largement supérieure à son niveau d'avant la crise tandis que le secteur agroalimentaire garde le même niveau d'activité. En revanche, le secteur de l'hébergement et de la restauration et celui des matériels de transport – automobile ou aéronautique – continuent de souffrir de la situation actuelle.
L'analyse des composantes de la demande montre que la consommation des ménages a retrouvé son niveau d'avant la crise et que l'investissement des entreprises, ainsi que la consommation publique, atteint des niveaux supérieurs à ceux d'avant la crise. En revanche, les flux d'échanges –importations et exportations – restent en deçà de leur niveau d'avant-crise ; cela s'explique notamment par une moindre activité touristique.
Les développements récents de la crise sanitaire pourraient faire craindre un ralentissement de l'activité plus marqué que prévu au début de cette année 2022. La recrudescence de l'épidémie est susceptible d'affecter à la fois l'offre, en raison des difficultés d'approvisionnement, des limitations du transport international, des jauges ou de l'absentéisme des actifs, qu'il s'explique par la maladie ou par des questions de garde d'enfants, et la demande, en raison d'un éventuel attentisme des acteurs économiques et de la prudence des consommateurs, dont certains peuvent être réticents à retourner dans les magasins. Il faut cependant souligner que les effets économiques des vagues successives, quoique massifs, sont allés en s'amenuisant : on apprend à vivre avec le virus, et le consensus des épidémiologistes tend à considérer qu'omicron pourrait annoncer des jours meilleurs.
À ce stade, les données disponibles ne révèlent pas de choc majeur. Les enquêtes de conjoncture de l'INSEE montrent qu'en ce mois de janvier 2022, la vague des variants delta et omicron a pesé sur le climat des affaires de certains services, notamment de l'hébergement et de la restauration. Les recherches de mots-clés sur internet suggèrent une tendance à la baisse de l'activité dans la restauration, l'hébergement ou le transport aérien, mais l'analyse des montants agrégés de transactions par carte bancaire ne suggère pas de choc majeur même si l'activité du secteur de l'hébergement, par exemple, reste pénalisée. Quant aux brusques variations observables dans le secteur de l'habillement et des chaussures, elles ne sont pas inquiétantes car elles tiennent aux dates des soldes, qui varient d'une année à l'autre.
En conclusion, les enquêtes de conjoncture et les enquêtes qualitatives ne révèlent pas de choc massif à la suite de la nouvelle vague des variants delta et omicron, réserve faite d'un moindre optimisme dans le secteur de l'hébergement.
J'en viens à la situation des ménages et des entreprises. L'emploi a moins baissé que l'activité au cours de l'année 2020 et au début de l'année 2021. Il s'est rétabli plus rapidement qu'anticipé : dès la fin du mois de juin 2021, il était supérieur de 0,6 % à son niveau de 2019. La situation est cependant différente selon les secteurs : l'emploi est un peu inférieur à son niveau de 2019 dans le secteur de l'industrie, il tend à revenir à son niveau d'avant la crise dans le secteur tertiaire marchand et il est même plus élevé qu'avant la crise dans le secteur de la construction et dans le secteur tertiaire non marchand. Les prévisions actuelles font état d'une hausse de l'emploi en ce début d'année 2022 plus modérée que lors des trimestres précédents. De façon surprenante, l'emploi très dynamique n'a pas conduit à une baisse du chômage au troisième trimestre de l'année 2021 ; cela s'explique par un afflux de population active. Nous ne sommes donc pas confrontés au phénomène de « grande démission » observé dans d'autres pays, notamment anglo-saxons. Cet afflux de population active est en partie lié au fort accroissement du nombre de personnes en alternance. Nous n'anticipons pas, à ce stade, la poursuite de cette tendance. Nous estimons donc que le taux de chômage va diminuer pour s'établir à 7,6 % au deuxième trimestre de cette année.
Le revenu des ménages a globalement été préservé. Le pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages n'a pas pâti de l'effondrement du produit intérieur brut. Il a même augmenté de 2 % en 2021.
Nous prévoyons en revanche une légère baisse ponctuelle du revenu des ménages au début de l'année 2022, liée à la recrudescence de l'inflation mais aussi à des phénomènes comptables : nos comptes de la fin de l'année 2021 intégreront une nouvelle baisse de la taxe d'habitation, pour certains ménages, ainsi que la totalité de l'indemnité inflation qui, pour des raisons de comptabilité en droits constatés, est intégralement rattachée au quatrième trimestre 2021, même si une partie ne sera versée qu'au début de cette année 2022. Nous avons donc un revenu un peu exceptionnel au quatrième trimestre 2021 et, en contrepartie, une baisse ponctuelle du pouvoir d'achat des ménages au premier trimestre de l'année 2022.
Le taux d'épargne des ménages a été élevé tout au long de la crise. Il n'est pas encore revenu à son niveau habituel – avant la crise – de 15 % du revenu disponible brut ; il s'établit toujours aux alentours de 17 %, mais pourrait redescendre à 16 %. Cela représente toujours un excès d'épargne d'environ 170 milliards d'euros, voire davantage, qui tient au fait que le revenu des ménages a été préservé mais sans qu'ils aient pu consommer normalement.
Le taux de marge des entreprises a été assez élevé au tournant de l'année 2021, lorsque les aides de l'État aux entreprises ont atteint leur niveau maximal. Il revient désormais à 32 % de la valeur ajoutée, à peu près son niveau moyen au cours des années 2015 à 2018. Le niveau de 2019, qui était plus élevé, ne doit pas faire illusion : il intégrait, en double compte, à la fois le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et la baisse des cotisations patronales qui a remplacé ce crédit d'impôt – il est donc préférable de se référer aux années 2015 à 2018.
Des tensions subsistent dans l'industrie, qui nous apparaissent lorsque nous considérons l'évolution de la proportion d'entreprises qui se déclarent confrontées à des difficultés de demande ou d'offre. La France connaît plutôt, en général, des régimes de contrainte par la demande ; cela a été le cas depuis 1992, sauf lors de l'éclatement de la bulle internet au début des années 2000 ou en 2007. Au contraire, en 2021, situation assez inédite, on constate une hausse significative du pourcentage d'entreprises qui se déclarent confrontées à des difficultés d'offre, jusqu'à ce qu'il atteigne 50 % à la fin de l'année – très peu d'entreprises, en revanche, se déclarent confrontées à des difficultés de demande. Nous n'observons un léger recul que dans le cadre de notre premier point d'enquête trimestriel de l'année 2022, que nous venons de publier.
Ces difficultés d'offre sont tout d'abord liées aux difficultés d'approvisionnement, qui demeurent élevées dans de nombreux secteurs. Le cas le plus grave est celui des matériels de transport, dont 70 % des entreprises ont pu connaître des difficultés d'approvisionnement – la proportion tend certes à diminuer. Les difficultés demeurent réelles dans beaucoup d'autres secteurs industriels, notamment celui des biens d'équipement mais aussi celui du bâtiment, atteignant des niveaux inédits. Un début d'amélioration peut cependant être espéré au début de cette année 2022.
Autres difficultés d'offre, les difficultés de recrutement demeurent élevées, et, dans l'industrie et les services, plus fortes qu'avant la crise. Nous avions commencé à parler de tensions de recrutement dans l'industrie en 2018 et 2019. Leur réalité est encore plus nette aujourd'hui. Elles atteignent à peu près le même niveau dans le secteur du bâtiment, et, pour l'instant, aucun signe n'annonce une amélioration de la situation.
Ces tensions, qui ne sont évidemment pas uniquement nationales, contribuent à créer un environnement plus inflationniste. Je vous parlerai, pour ma part, de l'indice des prix à la consommation (IPC), tandis qu'Olivier Garnier évoquera les indices de prix à la consommation harmonisé (IPCH) utilisés par l'Eurosystème, qui sont supérieurs de quelques dixièmes de points.
En 2021, l'inflation atteignait 1,6 % en moyenne annuelle et 2,8 % en décembre en glissement annuel. La progression des prix de l'énergie, notamment du prix de pétrole, comptait pour beaucoup, mais nous avons également connu une forte hausse du prix des matières premières, alimentaires et industrielles, ainsi qu'une très forte accélération de l'évolution des prix de production, à la fois pour les entreprises industrielles et pour les prix de production agricoles, avec une hausse de 16 % en un an. Si la volatilité des prix de production agricoles est traditionnellement plus forte, la hausse observée dans l'industrie est inédite depuis des années, voire des décennies. Cela aura nécessairement des conséquences sur les prix de détail. Nous pouvons donc nous attendre à une augmentation des prix des biens manufacturés et de l'alimentation en 2022.
S'agissant des prix de l'énergie, il est difficile de faire des prévisions, d'autant qu'une partie d'entre eux sont plafonnés. Les prix du gaz sont connus. Les prix du pétrole dépendent beaucoup des tensions géopolitiques. Nous avions anticipé une stabilité de ces derniers mais ils se situent sans doute à un niveau légèrement supérieur à nos anticipations aujourd'hui. Reste, parmi les composantes de l'IPC, le prix des biens et services, qui pèse le plus. Son évolution dépendra du rythme des hausses de salaire et de l'enclenchement ou non d'une spirale des prix et des salaires. Les soldes d'opinion sur les évolutions attendues des prix de vente sont tous à la hausse, y compris en ce qui concerne le commerce de détail, un peu moins dans les services que dans l'industrie et incidemment dans le bâtiment.
S'agissant des salaires, une enquête de conjoncture dans l'industrie montre que les chefs d'entreprise s'attendent à une progression plus rapide que par le passé, sans qu'elle soit alarmante à ce stade.
Selon nos prévisions, au cours des six prochains mois, l'inflation serait comprise entre 2,5 % et 3 %, en glissement annuel. Les prix de l'énergie, qui étaient déflationnistes en 2020 et très inflationnistes en 2021, contribueraient plus faiblement à l'inflation d'ensemble, notamment en raison du plafonnement des prix de l'électricité et du gaz. Les prix des produits alimentaires contribueraient à l'inflation mais aussi celui des produits manufacturés.
Mon propos s'inscrira dans un horizon temporel plus vaste, dans la mesure où, dans le cadre de l'Eurosystème, nous réalisons des projections à trois ans. Nos dernières prévisions, qui remontent à la mi-décembre, courent ainsi jusqu'en 2024. À la demande de M. le président Éric Woerth, et conformément au mandat de la banque centrale, je vous parlerai également de l'inflation, mais je tiens à rappeler tout d'abord nos projections de croissance.
Après une hausse du produit intérieur brut estimée à 6,7 % en 2021, nous attendons une croissance de 3,6 % en 2022, de 2,2 % en 2023 et de 1,4 % en 2024. Cela signifie que le rattrapage se prolongera en 2022 et 2023, car, si nous sommes certes revenus au niveau antérieur à la crise, nous n'avons pas atteint le niveau que nous aurions atteint conformément à la tendance d'alors. C'est, selon nous, à l'horizon 2023 que nous reviendrons à la tendance de l'année 2019 et que nous retrouverons le rythme de croissance potentielle observé avant la crise.
Quelles sont les conséquences de ces prévisions de croissance sur l'inflation ? Dans le cadre de l'Eurosystème, nous travaillons non pas sur l'indice des prix à la consommation utilisé par l'INSEE mais sur l'indice des prix à la consommation harmonisé. Il se trouve que nous observons actuellement, de manière un peu inhabituelle, un écart sensible entre les deux : à la fin du mois de décembre 2021, la hausse de l'IPC était de 2,8 % tandis que celle de l'IPCH était de 3,4 %. L'explication est simple : l'indice harmonisé exclut un certain nombre de postes de consommation compris dans l'IPC, ce qui donne aux prix de l'énergie un poids plus important. Lorsque les prix de l'énergie augmentent rapidement, l'IPCH augmente donc plus rapidement que l'IPC. Lorsque cet effet sera résorbé, l'écart entre les deux indices se réduira.
Si nous parlons donc de l'IPCH, nous observons un pic d'inflation en 2021 et 2022, qui résulte principalement des prix de l'énergie. Il s'effacera à l'horizon des années 2023 et 2024. Les prix des marchés de futures nous permettent effectivement non de vraiment prévoir quel sera le prix de l'énergie mais d'anticiper une légère baisse à cette échéance.
Quant à l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'IPCH hors énergie et hors alimentation, après le pic des années 2021 et 2022, elle devrait s'établir, comme l'inflation totale, à un niveau sensiblement plus élevé qu'en 2019 et2020. Elle passerait d'environ 0,5 % à un niveau « inférieur à mais proche de » 2 %.
Ces observations valent également si nous considérons plus précisément l'inflation dans les services, soit celle qui dépend le plus directement des salaires : son taux passerait d'environ 1 % au milieu des années 2010 à plus de 2,5 % en 2023 2024.
Les projections recouvrent donc deux évolutions concomitantes : le repli de l'inflation dans le secteur de l'énergie, avec la stabilisation des prix de l'énergie, et la remontée de l'inflation dans les services, mais aussi celle de l'inflation hors énergie et hors alimentation.
À l'horizon 2023-2024, nous reviendrions non pas à la situation antérieure à la crise actuelle mais à celle des années 2002 à 2007, période durant laquelle l'inflation dans les services était comprise entre 2,5 % et 3 % et l'inflation sous-jacente légèrement inférieure à 2 %. Ce serait compatible avec une inflation totale proche de 2 %. C'est le premier message à retenir de nos projections : nous revenons non pas à une inflation très basse mais à un régime un peu différent.
Cela se retrouve en matière de salaires. Il ne faut trop pas regarder le salaire moyen par tête au cours de la période actuelle, car l'activité partielle crée des distorsions entre le numérateur et le dénominateur – le salaire diffère beaucoup selon le nombre d'heures payées. On peut toutefois comparer la situation avant la crise et celle à l'horizon 2023‑2024. Avant la crise, le salaire moyen par tête augmentait de 2 % par an, les gains de productivité étaient de 1 % et les coûts salariaux unitaires progressaient de 1 % – soit la différence entre la progression du salaire et les gains de productivité. Dans le nouveau régime d'inflation que j'évoque, le salaire moyen par tête augmenterait plutôt de 3 % par an, les gains de productivité seraient plutôt de 1 % et les coûts salariaux unitaires progresseraient donc d'environ 2 %. L'inflation serait donc là aussi proche de 2 %.
Évidemment, la réalisation de cette projection peut être contrariée par de nombreux aléas. La crise en Ukraine influe sur les prix de l'énergie, pas seulement sur les prix du pétrole mais aussi ceux du gaz. Or notre prévision est basée sur l'hypothèse d'une stabilisation des prix de l'énergie.
Il existe aussi des difficultés d'approvisionnement, inégales selon les secteurs et d'une durée que nous savons incertaine : elles ne vont pas durer indéfiniment, mais peuvent se prolonger plusieurs années dans certains secteurs, comme les semi-conducteurs ; il s'agit davantage d'une question de mois dans d'autres secteurs. La taille et la durée de cette bosse d'inflation que ces difficultés d'approvisionnement peuvent entraîner sont donc incertaines.
Un autre élément clé réside dans ce que les économistes appellent la boucle prix-salaires, qui joue notamment dans le secteur des services où les salaires sont la plus grande composante des coûts. Là encore, les anticipations peuvent jouer un rôle. C'est un autre aléa.
À plus long terme, se pose la question de la mondialisation et de la « démondialisation ». Certains commentateurs commencent effectivement à parler de « démondialisation », mais cela n'a rien d'évident lorsqu'on regarde les chiffres du commerce mondial, qui reste dynamique malgré les difficultés d'approvisionnement. Par ailleurs, dans le contexte actuel, la mondialisation pourra s'accentuer dans le domaine des services, car le numérique peut permettre plus facilement d'avoir des salariés en télétravail aux quatre coins du monde.
La question de la transition climatique est également très importante, car elle aura nécessairement des effets sur les prix. La question est de savoir quels seront ces effets. S'agira-t-il d'effets sur les prix relatifs ou d'effets durables sur l'inflation ?
Quelques mots, maintenant, sur la zone euro, puisque, dans le cadre du mandat de la Banque centrale européenne (BCE), c'est bien sûr l'inflation dans la zone euro qui importe. En 2022, nous prévoyons une inflation de plus de 3 % en moyenne annuelle ; elle était de 5 % en décembre, tirée par les prix de l'énergie. Elle reviendrait en dessous de 2 % à l'horizon 2023-2024. Il en irait de même pour l'inflation sous-jacente
À l'intérieur de la zone euro, nous constatons des écarts assez sensibles. La progression de l'ICPH est de 3,4 % en France, contre 5,7 % en Allemagne, 4,2 % pour l'Italie, 6,7 % en Espagne, et 5,0 % dans l'ensemble de la zone euro. L'inflation a donc moins accéléré en France que dans d'autres pays. Cette moindre inflation n'est pas liée à l'inflation sous-jacente, puisque celle-ci, en France, est un peu supérieure à ce qu'elle est en Italie et surtout en Espagne. En revanche, dans ces deux mêmes pays, la hausse des prix de l'énergie a été beaucoup plus forte. Cela tient notamment au fait qu'en France le prix des carburants comprend une part importante de taxes, qui sont proportionnelles non pas au prix mais à la quantité, ce qui joue un rôle amortisseur dans un contexte de hausse des prix ; cela tient aussi aux mesures prises pour réduire le coût pour les ménages de l'électricité et du gaz.
Le cas de l'Allemagne est différent. La hausse des prix de l'énergie y est équivalente à celle observée en France, alors que l'inflation des prix hors énergie y est beaucoup plus forte. Cela tient à la baisse de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mise en œuvre en Allemagne en 2020, qui a été suivie, en 2021, d'un relèvement de cette même TVA. Ce mouvement a temporairement « dopé » l'inflation. Cependant, à l'horizon 2023-2024, l'inflation resterait supérieure à 2 % – cette projection a été faite avant l'accord de la nouvelle coalition gouvernementale sur la hausse du salaire minimum. Si l'objectif est une inflation à 2 % pour la zone euro, il n'est pas anormal que le pays dont le taux de chômage est le plus bas ait une inflation supérieure à ce seuil, tandis que ceux qui ont un chômage plus élevé connaissent une inflation légèrement inférieure ; c'est un phénomène attendu dans une union monétaire.
Au niveau mondial, la zone euro se trouve dans une situation intermédiaire entre, d'une part, les États‑Unis, et, dans une moindre mesure, la Grande-Bretagne et, d'autre part, le Japon. Les États-Unis ont un taux de chômage de 4 %, aggravé par le phénomène de la « grande démission », et l'économie, « dopée » par la politique budgétaire, y est en surchauffe ; c'est d'ailleurs pourquoi la réserve fédérale appréhende la situation différemment de la BCE. À l'opposé, le Japon ne connaît toujours pas d'inflation, et l'esprit déflationniste y reste prégnant. On peut d'ailleurs relever que l'Europe n'est donc nullement en voie de « japonification » contrairement à ce que certains prétendaient il y a encore peu de temps.
Quant à la politique monétaire et aux décisions annoncées par le Conseil des gouverneurs du 18 décembre 2021, il faut retenir, tout d'abord, l'arrêt de tous les programmes d'urgence mis en place au printemps 2020 face à la pandémie. Le programme d'achats d'urgence pandémique, dit PEPP, s'achèvera à la fin du premier trimestre 2022, malgré un lissage de la décrue des achats d'actifs pendant une phase transitoire. Le montant des achats résultant de l'ensemble des programmes d'achats d'actifs s'élevait à 90 milliards d'euros par mois en 2021 ; au dernier trimestre de l'année 2022, il devrait être de 20 milliards d'euros par mois. Les achats nets des amortissements seront donc réduits. En ce qui concerne le programme de prêts exceptionnels aux banques, dit TLTRO 3 ( Targeted Longer-Term Refinancing Operations ), un taux bonifié permet à celles-ci d'emprunter à -1 %, soit un taux plus favorable que celui de la facilité de dépôt de la BCE, qui est de -0,5 %, à condition d'accroître d'un certain montant leurs prêts. Ce taux bonifié disparaîtra au mois de juin. Une certaine flexibilité est cependant maintenue dans les achats d'actifs : la période de réinvestissement du programme PEPP a été prolongée – elle devait s'achever à la fin de l'année 2023 ; ce sera à la fin de l'année 2024. De plus, dans le cadre de ces réinvestissements, l'Eurosystème pourrait, en fonction de l'évolution des conditions de financement, ne pas suivre la clé de répartition du capital de la BCE et acheter plus de titres de tel pays et moins de tel autre en cas de mouvements injustifiés sur les titres d'une juridiction. Enfin, demeure la possibilité de reprendre les achats nets du programme PEPP, par exemple en cas de reprise pandémique.
Pour le moment, nous avons des indications sur la politique de taux d'intérêt, des critères – guidance – ont été donnés pour justifier une remontée des taux : cette remontée n'interviendrait que si l'inflation paraissait devoir passer durablement au-dessus de 2 %. Dans cette hypothèse, les autorités monétaires feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour ramener l'inflation à la cible de 2 %.

Sur l'inflation, pourriez-vous nous rappeler la façon dont est traité le logement ?
Ensuite, vous dites que nous retrouvons le rythme de croissance quitté en 2019 mais à combien chiffrez-vous les pertes de production et les pertes fiscales essuyées entre-temps, soit le coût de la crise ?
Par ailleurs, l'augmentation des salaires est la résultante d'une politique économique globale, notamment de la productivité et de l'inflation. Peut-on considérer que les prix vont augmenter durablement ? Je pense que nous dépasserons les 2 % – l'inflation est l'expression de tensions dans le monde, qui sont fortes –, mais sommes-nous, selon vous, entrés dans une phase longue d'inflation ?
Selon vous, la désépargne se retrouve-t-elle dans le niveau de la consommation, dans les importations et dans l'investissement ? J'ai l'impression que c'est le cas.
Enfin, les prix de production ne pourront être compensés que par de la productivité, y compris en France. Pouvons-nous compter sur une augmentation de la productivité, sans laquelle il n'y aura pas d'augmentation durable des salaires ?

Je fais mienne la question du président Woerth sur les salaires.
Il semble que l'inflation en France soit moindre que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis et en Allemagne. Pouvez-vous nous rappeler quelle est l'action des politiques monétaires aux États-Unis et dans la zone euro face à des niveaux d'inflation supérieurs aux cibles ?
Ensuite, comment expliquez-vous la différence, notamment au mois de novembre dernier, entre l'évolution des prix à la consommation hors énergie et celle des prix de l'énergie ? Une réflexion est à mener sur la composition et l'équilibre interne de ces indices. C'est un sujet sensible, notamment pour le législateur.
Quant à la situation du marché du travail, qui continue de s'améliorer, quels paramètres ont, selon vous, été durablement modifiés pendant la crise ?

Il faut se féliciter de la situation économique au sortir de cette crise sanitaire. Le taux de croissance se maintient à un niveau exceptionnel, et le chômage demeure à un niveau relativement bas. Cette conjoncture démontre la résilience de l'économie française, que nous devons aux mesures d'accompagnement mises en œuvre pendant la crise. Des risques se présentent néanmoins, notamment l'inflation. Si celle-ci était de retour, cela conduirait la BCE à relever ses taux. Quel en serait l'impact sur la croissance française ?
De plus, je m'inquiète de la conjoncture mondiale. Il semble que les États-Unis et l'Europe n'aient pas la même perception de la situation. Les États-Unis ont relevé leurs taux, quand l'Europe préfère patienter. Cette désynchronisation des réactions des banques centrales nous expose-t-elle à des risques ? Et considérez-vous que la position de la BCE est justifiée ?
Enfin, je m'associe aux questions relatives aux conséquences de l'accélération de l'inflation sur le pouvoir d'achat. Doit-on craindre une boucle prix-salaire et une autoalimentation de la hausse des prix ? Considérez-vous que l'économie française est assez robuste pour accepter une augmentation importante des rémunérations ?

Je voudrais remercier à mon tour MM. Tavernier et Garnier pour leurs présentations respectives fort intéressantes.
Ma question, relative à l'inflation, s'adresse à M. Garnier. Certains économistes nous disent : « Attention, ne comparons pas la situation actuelle avec ce qui a pu se passer dans les années soixante-dix mais retournons quelques décennies en arrière et regardons ce qui s'est passé dans les années trente. » Ils relèvent en outre que l'inflation ne toucherait pas de manière identique tous les secteurs de notre économie française et sont amenés à considérer que la crise actuelle contribuerait en fait à exacerber une tendance déflationniste à moyen et long terme de notre économie. Certains avancent même l'hypothèse que nous serions désormais dans une phase cyclique d'évolution dépressive. Quel regard portez-vous sur ces thèses ?

Une nouvelle fois, ces réunions « au cœur de l'économie » montrent leur intérêt, qu'il s'agisse notamment d'analyser la conjoncture, de faire le point sur l'activité bancaire ou de se pencher sur l'inflation…
Ma première question porte sur le risque d'une inflation importée des États-Unis. Y sommes-nous exposés ? L'inflation est effectivement bien plus élevée dans ce pays.
La deuxième concerne les nouvelles habitudes professionnelles. Vous avez évoqué très rapidement l'impact du télétravail. Est-ce là un phénomène durable ou conjoncturel ?
Ma troisième question s'adresse à M. Garnier. Comment les marchés bancaire et financier se comportent-ils ? Vous n'avez pas évoqué ce sujet. Anticipent-ils des difficultés ou des évolutions favorables ?
Enfin, puisque l'INSEE annonçait ce matin que le moral des ménages baissait très légèrement en janvier, pouvez-vous nous donner quelques précisions ?

Merci, messieurs, pour ces deux présentations très éclairantes.
Disposez-vous, compte tenu des perspectives d'inflation pour cette année 2022, d'une estimation en euros sonnants et trébuchants de la baisse du pouvoir d'achat par décile de revenu ?
Par ailleurs, l'inflation est inférieure de deux points, en France, à ce qu'elle est en Allemagne. Cela s'explique sans doute, pour partie, par l'énergie, mais, en ce qui concerne l'alimentation, l'existence en France de quatre grandes centrales d'achats qui exercent une pression – qui affecte les agriculteurs – sur les prix vous paraît-elle une explication possible ? Y en a-t-il d'autres ?
La hausse des prix de production constatée en 2021 m'inquiète fortement. Si nous avons un objectif de relocalisation, que je défends comme d'autres sans doute, comment celui-ci peut-il être pris en compte dans un business plan pour l'industrie ? De vraies questions se posent. Si nous étions en mesure de relocaliser plus en France, ou au moins en Europe – je pense entre autres aux semi-conducteurs –, cela permettrait-il d'atténuer cet effet de hausse de prix ?
Enfin, nous savons que l'inflation pose un problème en cas de trop grande décorrélation de l'évolution des prix avec les taux d'intérêt. Alors que le montant des rachats d'actifs va passer de 90 milliards d'euros à 20 milliards d'euros par mois, avez-vous des échanges avec vos homologues allemands, concernant l'évolution des taux d'intérêt dont ils peuvent avoir une vision différente ?

Je remercie également les deux intervenants pour leur présentation très claire.
Ma première question s'adresse à M. Olivier Garnier. Vous évoquiez, monsieur, des aléas, notamment la possibilité d'une boucle prix-salaires. Si cette éventualité se concrétisait, voyez-vous cela comme un effet provisoire et bénéfique ou comme une tendance de plus long terme ? Cela pourrait-il poser des risques sur l'économie de notre pays ou, au contraire, constituer une évolution souhaitable ?
Par ailleurs, la politique des banques centrales est-elle susceptible d'alimenter une bulle spéculative ? Le cas échéant, comment prennent-elles en compte ce risque et comment pourrions-nous le limiter au maximum ?
En outre, faut-il s'inquiéter du fait que le rendement des obligations allemandes à dix ans a récemment franchi à la hausse le seuil de 0 % ? Quelle politique la Banque centrale européenne devrait-elle adopter ?
Enfin, pensez-vous toujours que les effets de pénurie et d'augmentation des prix qui affectent les matières premières seront transitoires ? Quels éléments pourraient corroborer une telle analyse ?

Êtes-vous certains, messieurs, que cette hausse d'inflation n'est qu'une bosse ? Vous projetez un retour à des taux de l'ordre de 1,7 % mais, avec la réduction de la production des logements dans les métropoles, la tendance n'est pas à la stabilisation des loyers. Il y a aussi le problème de l'énergie. Peut-on dire, avec de fortes tensions sur le marché électrique, qu'on va revenir à la situation antérieure, y compris en France ?
Deuxièmement, selon vos prévisions, nous retrouverions des taux de croissance potentielle de l'ordre de 1,5 % et 1,6 %, mais la hausse de la productivité devrait atteindre 1,2 % selon vos projections. Ne resterait-on pas plutôt à des taux de croissance potentielle de l'ordre de 1 % ou 1,2 % ?
Troisièmement, et il s'agit peut-être là du sujet le plus grave, ne nous acheminons-nous pas vers un relèvement des taux d'intérêt en Europe, du simple fait que ce mouvement a déjà commencé aux États-Unis ? Avec un niveau d'inflation de 7 %, on ne voit pas comment la réserve fédérale américaine ne continuerait pas à le relever – une hausse d'un point, par paliers de 0,25, est déjà programmée. On ne voit pas comment la zone euro pourrait résister à un effet de contagion et échapper à une remontée des taux, grosso modo à partir du milieu de cette année.

Pour faire face à l'inflation, M. Bruno Le Maire a annoncé une hausse du taux d'intérêt du livret A, qui passerait de 0,5 % à 1 %. Cette mesure nous paraît un peu cynique : pendant cinq ans, ce taux a été inférieur à celui de l'inflation, ce qui a représenté un manque à gagner pour les plus modestes, pour les petits épargnants. Au regard de la perspective d'une inflation à 2 % qui se maintiendra à moyen terme – éventuellement au-delà, mais vous nous répondrez sur ce point –, cette augmentation vous paraît-elle suffisante ? Avec une inflation à 2,5 %, les petits épargnants finiraient par perdre 1,5 % de leur épargne soit 5,5 milliards d'euros. Je rappelle que l'encours moyen du livret A est de 5 500 euros. Est-ce donc suffisant ? Est-ce là une bonne manière pour le pouvoir d'achat et l'épargne des Français ?

Merci, messieurs, pour la qualité de vos exposés.
Pensez-vous que l'inflation soit transitoire ou plus durable, temporaire ou permanente ? Vous avez évoqué une bosse, mais je fais mienne l'interrogation de M. de Courson.
Quant au marché du travail, pensez-vous que l'économie française puisse être confrontée à une « grande démission », sur le modèle de cette vague de départs volontaires qui perturbe le marché américain de l'emploi ?
En ce qui concerne les échanges extérieurs, quelle analyse faites-vous des difficultés de notre balance des transactions courantes et de notre position extérieure nette ?
Par ailleurs, les modèles de prévision macroéconomique sont calibrés sur des données antérieures à la pandémie qui pourraient ne plus être bien adaptées pour saisir des changements structurels majeurs de notre économie. Cela ne remet-il pas en cause, par conséquent, l'évaluation de notre croissance potentielle et celle de notre déficit structurel ?
En matière de politique monétaire, la révision de la politique de quantitative easing à travers une réduction des achats du PEPP et des TLTRO doit-elle, selon vous, être rapide et massive, parce que beaucoup de liquidités ont été injectées dans le circuit économique, ou plus progressive et mesurée pour éviter des trous d'air dans la distribution des liquidités sur le marché européen ?

Quels effets les évolutions de l'inflation, selon vos prévisions, pourraient-elles avoir sur notre balance extérieure et comment cette dernière pourrait-elle évoluer ?

L'alternative est connue. Si la priorité continue d'être le soutien à l'économie et à la reprise, alors la politique monétaire suivie doit être extensive, au risque du maintien, voire d'un regain, de l'inflation. Si, au contraire, on adopte une politique restrictive, alors les effets sur la demande, l'investissement et le pouvoir d'achat seront obligatoirement négatifs. Dans ce contexte, quelle politique de taux anticipez-vous ? Pensez-vous que la réserve fédérale américaine relèvera ses taux – cela est à peu près acquis – et cessera ses achats d'obligations, voire commencera à vendre ces titres ? Quelle sera la réponse des Européens ? Quelles seront les conséquences pour la France avec le passage du risque déflationniste au risque inflationniste, tout cela ayant un impact direct sur la conjoncture générale et plus prosaïquement sur la gestion de la dette publique en France.

Merci, messieurs, pour ces présentations. Je souhaite revenir sur la situation de l'embauche en France. Grâce aux aides massives du Gouvernement pour la protection des entreprises, en particulier le chômage partiel, l'activité et l'emploi ont très fortement redémarré. On dénombre près de 2,5 millions d'embauches entre les mois d'octobre et de décembre 2021 – un record depuis les années 2000. C'est bien la conséquence des actions et des réformes en faveur de l'emploi malgré les crises des gilets jaunes et du covid.
J'appelle l'attention sur les stations de ski, au fort besoin de personnel. Elles rencontrent des difficultés de recrutement dans le secteur de l'hôtellerie et la restauration. Vous avez souligné des divergences sectorielles avec une reprise plus faible dans ce secteur, comme dans l'industrie. Ce manque de main-d'œuvre peut-il pénaliser la croissance et affaiblir notre économie ? Dans quelle mesure s'explique-t-il par la crise économique liée au covid ?

Monsieur Tavernier, ce matin dans Les Échos, vous évoquez les anticipations autoréalisatrices, notion qui me paraît importante : « plus on en parle, plus cela risque d'arriver », dites-vous. Cela montre l'importance du discours politique. Pourriez-vous revenir devant notre commission sur cette notion et la part que les anticipations autoréalisatrices prennent effectivement à l'évolution de la situation économique ?
J'aimerais également revenir sur l'impact de l'inflation sur les inégalités et leur renforcement. Vous dites qu'il existe des amortisseurs très importants mais qu'il serait possible que la grande pauvreté soit aggravée. Qu'est-ce qui vous faire dire cela ? Quels sont les éléments qui devraient nous inquiéter ?

Malgré le fait que le relèvement des taux d'intérêt semble être plutôt une conséquence mécanique de l'inflation, vous évoquez la capacité du Conseil des gouverneurs à ajuster la politique monétaire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Sommes-nous « entre deux doctrines » ? Revenons-nous aux anciens dogmes, que nous avons connus des années soixante-dix à aujourd'hui, visant à la maîtrise de l'inflation, ou sommes-nous à l'aube d'une nouvelle doctrine et de nouvelles orientations ?

Concernant la croissance potentielle, le gouverneur de la Banque de France est revenu récemment sur le chiffre de 0,5 %. À une époque, on cherchait 1 % de croissance potentielle supplémentaire durable. Considérez-vous que les facteurs de production peuvent être mobilisés pour aboutir à ce niveau ou des changements plus profonds de notre structure économique et sociale sont-ils nécessaires ? Cela me semble probable.
Un certain nombre de questions portent sur la mesure de l'inflation elle-même, sur l'IPC et sur l'IPCH.
L'une des principales différences entre l'IPC et l'IPCH, par exemple pour les produits de santé, est que le premier inclut tous les prix, en retenant la pondération du panier des ménages, y compris si ces produits sont remboursés par la sécurité sociale ou par des assureurs complémentaires, tandis que l'IPCH ne retient, au titre du prix des produits de santé, que le reste à charge pour les ménages. C'est une différence importante. Si la santé a plus de poids dans l'IPC que dans l'IPCH, l'énergie, en contrepartie, en a moins dans l'IPC que dans l'IPCH. En général, cela ne se voit pas, mais quand les prix relatifs varient de façon brutale comme c'est le cas aujourd'hui pour l'énergie, ce simple effet de structure explique que l'IPCH augmente de quelques dixièmes de plus que l'IPC. Le jour où le prix de l'énergie baissera ou évolue moins vite – cela arrive quand même – que l'ensemble, nous constatons l'effet l'inverse. Sur longue période, les deux évoluent de concert.
Les modalités de prise en compte des prix du logement dans l'indice des prix à la consommation sont un sujet récurrent, connu du grand public, dont se saisissent régulièrement certains polémistes. La Banque centrale européenne le traite dans le cadre de sa revue stratégique. L'IPC, comme son nom l'indique, porte sur les prix à la consommation ; s'agissant du logement, la consommation recouvre le paiement des loyers par les ménages effectivement locataires ainsi que les dépenses afférentes au logement – les assurances, les abonnements, les fluides, etc. Les opérations d'acquisition de biens en sont à l'inverse exclues. À titre de comparaison, le périmètre des dépenses retenues diverge concernant le déflateur des prix à la consommation car il est également tenu compte, dans le cadre de cet indicateur utilisé en comptabilité nationale, des loyers fictifs que les propriétaires occupant leur logement se versent à eux-mêmes, ce qui conduit les loyers à occuper un poids relatif plus important dans la consommation des ménages.
En conséquence, une augmentation du montant des loyers est retracée de manière plus visible et prononcée dans le déflateur de la consommation que dans l'IPC. Nous pourrions imaginer aligner les modalités de calcul des dépenses de logement de ces deux indicateurs. Cependant, le ressenti de la population en matière de logement se focalise plutôt sur l'évolution des prix à l'achat du neuf ou de l'ancien et le poids dans le budget des ménages du remboursement des emprunts immobiliers. Cela pose une difficulté statistique car ces dépenses ne relèvent pas de la consommation mais d'une question de trésorerie, car la contrainte provoquée par le remboursement de l'emprunt s'accompagne en parallèle de la constitution d'un actif. Cette difficulté est d'autant plus importante qu'un achat d'immobilier ancien s'accompagne automatiquement d'une vente, généralement réalisée par un ménage.
Les attentes concernant une éventuelle intégration des prix d'achat des biens immobiliers dans le périmètre de l'IPC ne peuvent donc être satisfaites ; les conventions internationales, que nous respectons, ne prévoient pas que l'IPC recouvre un tel périmètre. Nous tentons de traiter ce sujet dans d'autres enquêtes relatives aux dépenses contraintes des ménages – remboursements d'emprunts, assurances, abonnements – et nous constatons dans ce cadre que le poids de ces dépenses est différent selon la situation des ménages, qu'ils soient locataires, propriétaires occupants ou propriétaires ayant achevé de rembourser leur emprunt. La BCE invite effectivement, dans le cadre de sa revue stratégique, à calculer un prix du logement qui pourrait être intégré dans l'IPC. À moins de considérer que nous pourrions intégrer à cet indicateur les loyers fictifs des propriétaires occupants, les seuls prix à l'achat de logements neufs ou encore le coût des travaux importants de maintenance réalisés par les propriétaires, je suis réservé quant à cette possibilité.
En définitive, cette question est complexe : nous sommes confrontés à un écart entre, d'une part, ce que nous mesurons selon une méthode conforme aux conventions internationales et qui s'explique au point de vue économique et, d'autre part, le ressenti des ménages s'agissant des éléments pesant sur le pouvoir d'achat. Je ne suis pas certain, soit dit en passant, que ce qu'ont appris sur les bancs de l'école ceux qui, dans cette salle, sont économistes, à savoir que l'augmentation des prix de l'immobilier pouvait générer un effet de richesse, se vérifie et que la hausse de la valeur du logement que l'on occupe rende plus heureux. Cette analyse mériterait d'être reconsidérée car nous constatons de plus en plus que l'effet de la hausse des prix de l'immobilier est plutôt un effet défavorable sur l'accession à la propriété qu'un effet d'enrichissement.
Élaborer des prévisions de l'évolution du pouvoir d'achat en fonction des déciles de revenus est particulièrement complexe. Nous pouvons en revanche analyser les effets d'une évolution des prix relatifs sur les ménages selon leur situation et leur composition. Concernant la hausse du prix de l'énergie, les ménages les plus affectés sont naturellement ceux qui se chauffent au fioul et utilisent davantage leur véhicule à essence. La hausse du prix de l'énergie est plus spécifiquement défavorable aux ménages les moins aisés, aux seniors, aux personnes habitant dans des petites villes et dans des territoires ruraux. Ces éléments ne suffisent néanmoins pas à définir comment évoluera le pouvoir d'achat dans le futur car il nous faudra tenir compte de l'évolution des revenus.
Il est important de comprendre qu'en l'absence d'évolutions salariales et d'apparition de boucle prix-salaires, l'inflation que nous connaissons a pour unique origine la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, qui se répercute sur les prix de vente au détail. C'est un phénomène mondial qui ne résulte pas d'un écart entre les salaires et le niveau de productivité, et qui n'implique pas de préoccupation particulière en matière de compétitivité ni n'appelle de réponse particulière en matière de rémunération.
Quant au bon niveau de rémunération du travail non qualifié, il est intéressant de constater une convergence des niveaux des salaires minima et des niveaux des salaires moyens ou médians dans les différents pays. Ceux qui avaient des salaires minima bas tendent à les augmenter et les pays comme la France où la situation est inverse ont tendu à la réduire par rapport au salaire moyen ou médian, et ont mené une politique de réduction des cotisations. La spécificité française concernant le niveau élevé du coût relatif du travail non qualifié est donc en voie d'atténuation.
Le produit intérieur brut a retrouvé, approximativement, son niveau d'avant-crise. Nous aurions pu, dans l'hypothèse où la crise n'aurait pas eu lieu, profiter d'environ 2 % de croissance en deux ans. Cet élément nous amène à considérer que le terrain perdu du fait de la crise approche donc 2 points. À l'occasion de la présentation du projet de loi de finances pour 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance avait annoncé un chiffre s'élevant à 2,25 %, que je considérais un peu élevé. De plus, les ordres de grandeur se situent autour d'un point pour les secteurs durablement affectés par la crise – événementiel, tourisme –, ce qui laisse à penser que le terrain perdu s'élèverait plutôt à 1 point,
Je n'ai pas d'avis définitif concernant l'effet du télétravail sur la productivité, notamment car nous manquons encore de travaux « micro » et d'études sociologiques pour les apprécier. Nous avons aussi vécu une période où le télétravail était réalisé de manière contrainte ; nous commençons seulement à le déployer de manière organisée.
Nous n'observons pas, dans le cadre de nos enquêtes, de retrait de la population active vis-à-vis du marché du travail, au contraire de la situation observée aux États-Unis, malgré les débats actuels sur la reconsidération du rapport au travail dans la société. La coexistence d'un taux d'emploi élevé et d'un nombre important d'entreprises faisant part de difficultés pour embaucher constitue cependant un mystère. C'est une question sur laquelle nous devons travailler. Une hypothèse explicative réside dans le fait que nous avons connu une période durant laquelle il était aisé d'embaucher, ce qui amènerait les entreprises à surréagir face à leurs difficultés actuelles. Au reste, peu d'établissements ferment faute de main-d'œuvre, même dans les stations de ski. Une autre explication peut être trouvée dans le fait que de nombreuses aides ont été conçues, à raison, pour que les entreprises connaissant une baisse de leur niveau d'activité sauvegardent leurs emplois – je pense notamment aux secteurs concernés par l'activité partielle de longue durée. En conséquence, les entreprises exerçant dans des secteurs qui ne connaissent pas une baisse d'activité doivent recruter sur un marché du travail de taille plus réduite, en raison d'une moindre fluidité de circulation des salariés entre les différents secteurs d'activité.
L'enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages du mois de janvier, qui vient de paraître, indique que le moral des ménages est passé de 100 à 99. J'en retiens que les ménages perçoivent l'amélioration de l'état du marché du travail. Bien qu'il s'élève à 8 points, le taux de chômage n'est plus une préoccupation pour l'opinion publique ; cela peut nous étonner, dans la mesure où nous n'avons pas atteint le plein-emploi et où certains pays enregistrent de meilleurs résultats. Nous ne notons pas non plus d'alerte concernant la situation financière personnelle des ménages : les résultats sont légèrement au-dessus de la moyenne, malgré la recrudescence de l'inflation.
Enfin, je ne suis pas certain que le titre choisi par Les Échos soit le plus pertinent. Il est toutefois vrai que nous sortons d'une période durant laquelle l'inflation était durablement peu élevée.
Auparavant, ces questions d'ancrage des anticipations d'inflation, au cœur des discours des banques centrales, ne posaient pas réellement de difficultés. Désormais, la façon dont les entreprises vont modifier leurs étiquettes ou les salariés se conduire au cours des négociations salariales dépendra, de façon cruciale, de l'impact de ce choc d'inflation – plutôt ponctuel initialement et lié aux matières premières, à l'énergie ou difficultés d'approvisionnement – sur les anticipations du régime d'inflation à venir. C'est en ce sens que nous pouvons avoir un phénomène autoréalisateur.
À propos de la grande pauvreté, nous avons fait une enquête sur le terrain auprès des bénéficiaires de l'aide alimentaire et avons posé des questions sur ce sujet au cours de nos enquêtes auprès des ménages. Il me semble que nous allons aussi publier prochainement des statistiques sur le sujet, avec le profil des bénéficiaires de l'aide alimentaire. Je constate que, si la pauvreté n'a pas l'air d'avoir augmenté au niveau macroéconomique, les associations sur le terrain expriment des inquiétudes. La conjecture suivante peut probablement être faite : ceux qui étaient déjà pauvres ont dû subir une précarité croissante depuis le début du confinement.
Je commencerai par les sujets de politique monétaire en rappelant les conditions indiquées par le Conseil des gouverneurs pour définir sa politique de taux d'intérêt. En effet, c'est bien en fonction des données et des perspectives sur l'inflation que la politique monétaire est déterminée, et non en fonction d'une doctrine particulière. Une première condition concerne les perspectives d'inflation à dix-huit mois : si l'inflation est anticipée à un niveau supérieur à 2 % à cet horizon, alors une hausse des taux d'intérêt pourrait se justifier. Il y a néanmoins une deuxième condition : il ne faut pas seulement que les prévisions d'inflation dépassent les 2 % à cet horizon de dix-huit mois mais que ce soit également le cas à l'horizon de trois ans. Ainsi, une « bosse d'inflation », comme celle que nous observons actuellement, ne justifie pas à elle seule une modification des taux d'intérêt. Enfin, une troisième condition concerne l'inflation sous-jacente : il ne faut pas que ce surcroît d'inflation soit uniquement dû aux prix de l'énergie.
Les anticipations d'inflation sont également importantes : si les marchés anticipent une hausse de l'inflation, alors les taux nominaux remontent. Encore récemment, les anticipations d'inflation sur les marchés, mesurées par les swaps d'inflation, atteignaient 1 % ; elles sont aujourd'hui plutôt proches de 2 %, ce qui est compatible avec notre objectif.
Cela signifie que les taux d'intérêt atteignent un niveau historiquement bas. S'il y avait une remontée des taux, ce serait à partir de taux d'intérêt réels très bas : avec des taux d'intérêt nominaux à court terme négatifs et une inflation supérieure à 2 %, les taux réels sont en effet très négatifs. Nous partons donc d'une situation très accommodante : dans ce contexte, une remontée des taux d'intérêt s'apparenterait plus à un retrait du stimulus qu'à un resserrement de politique monétaire.
Quel est l'impact de cette situation sur les marchés financiers ? Aujourd'hui, les valorisations sont, sans doute, influencées par les niveaux très bas des taux d'intérêt. Cependant, les marchés commencent, notamment aux États-Unis, à anticiper un relèvement des taux par la réserve fédérale et à corriger cette orientation. Aussi, le rôle d'une banque centrale est surtout de donner de la prévisibilité aux agents économiques et aux marchés financiers. Nous ne sommes pas sous dominance des marchés : ce ne sont pas eux qui empêcheront les banques centrales de relever leurs taux. Il faut cependant que cela soit fait de façon ordonnée.
Le taux du livret A est déterminé à la fois par l'inflation et le taux d'intérêt interbancaire à court terme, actuellement autour de - 0,5 %. Le taux de 1 % constitue une moyenne entre le taux d'inflation – mesuré au cours des six mois précédents – et le taux d'intérêt interbancaire. Nous parlons bien de moyenne d'inflation : pour que le taux d'intérêt du livret A dépasse, dans le futur, 1 %, il faudrait que l'inflation aille bien au-delà de 2,5 % ou alors que le taux d'intérêt interbancaire augmente.
Nous parlons moins du livret d'épargne populaire, destiné aux ménages aux revenus modestes. Il est pourtant doté d'une formule qui protège le pouvoir d'achat et son taux a été relevé à 2,2 %, compte tenu de l'inflation au cours des six derniers mois.
Je ne crois pas qu'il y ait de risque d'inflation importée depuis les États-Unis. En effet, ce pays importe plus qu'il n'exporte. Les risques d'inflation importée viennent plutôt des matières premières ou de pays comme la Chine – de laquelle nous avons plutôt importé, jusqu'ici, de la désinflation. Nous avons déjà eu, dans le passé, des écarts d'inflation assez sensibles avec les États-Unis.
Le sujet est un peu différent pour les taux d'intérêt car la contagion se fait plutôt via les taux d'intérêt à long terme. Il faut noter, aujourd'hui, de nombreuses anticipations de remontée des taux de la réserve fédérale américaine. Pourtant, les taux d'intérêt à long terme ont encore peu augmenté – ce qui peut d'ailleurs constituer un problème pour la réserve fédérale. Le risque de contagion est donc, pour le moment, assez limité. Il ne faut pas oublier qu'en cas d'écart de taux d'intérêt entre les États-Unis et l'Europe c'est le taux de change qui joue le rôle de variable d'ajustement : les anticipations de remontée des taux aux États-Unis par rapport à l'Europe conduisent à une appréciation relative du dollar. Nous constatons d'ailleurs que le cours actuel de l'euro face au dollar est inférieur à son niveau historique.
Quant au caractère durable ou non de l'inflation, je pense qu'il faut distinguer, dans le durable, ce qui correspond à notre objectif et ce qui va au-delà de celui-ci. Le surcroît d'inflation est plutôt positif s'il nous permet d'atteindre une inflation autour de 2 % à moyen terme – pendant la dernière décennie, l'inflation est restée trop basse trop longtemps. À l'inverse, pour la composante qui dépasse cet objectif, notre rôle de banque centrale est d'agir pour éliminer cet excès.
Le gouverneur de la Banque de France a souligné, la semaine dernière, que la croissance du PIB devrait revenir vers son niveau d'avant-crise, c'est-à-dire un niveau trop bas pour assurer à la fois la consolidation de nos finances publiques et la poursuite de la progression du pouvoir d'achat. Nous avons besoin d'une croissance potentielle plus élevée. Pour cela, l'enjeu se situe autour du facteur travail plutôt que du facteur capital. En France, le taux d'emploi reste encore trop bas par rapport à certains pays, notamment pour les jeunes et les plus de soixante ans. Il y a donc une réserve de croissance du côté de la formation et de la formation professionnelle.

Merci, messieurs. Nous sommes très heureux que vous ayez accepté notre invitation.
Nous allons maintenant évoquer les marchés de l'énergie.
La sécurité énergétique est au cœur du mandat de l'Agence internationale de l'énergie, créée en réponse à la crise pétrolière des années 1973 et 1974.
Depuis plusieurs mois, les prix du gaz, du pétrole et de l'électricité sont extrêmement volatils et ont atteint des sommets historiques. Nous avons connu un premier épisode d'énergie chère à l'automne, très lié à la reprise économique mondiale. La croissance du PIB mondial a atteint 6 % et poussé la demande à la hausse alors que l'offre ne suivait pas forcément. La pandémie a laissé des traces sur les infrastructures et les chaînes d'approvisionnement sont bousculées. Cela a créé des tensions à travers le monde.
Cette situation a été compliquée par des conditions météorologiques parfois extrêmes. Dans certaines régions du monde, des inondations ont restreint la production habituelle d'énergie. Dans d'autres, comme au Brésil ou en Chine, ce sont des sécheresses, qui ont entraîné une production hydroélectrique plus faible. Ces pays ont donc demandé plus de gaz.
En Europe, l'hiver 2020-2021 a été relativement rigoureux et ce sur une plus longue période qu'habituellement. En conséquence, les stocks de gaz ont été particulièrement entamés. Or, au cours de l'été, le contexte de forte demande mondiale a retardé le processus de reconstitution des stocks, d'autant que la production de gaz naturel liquéfié (GNL) a plutôt été orientée vers l'Asie, où les prix sont plus élevés et la demande plus forte.
Le deuxième épisode est une crise principalement européenne. L'Europe est au cœur de tensions liées aux incertitudes sur le niveau d'approvisionnement, notamment l'approvisionnement par le gaz russe, puisque la Russie est le principal fournisseur de l'Europe. En conséquence, au mois de décembre 2021, le prix du gaz était six fois plus élevé qu'au mois de juin précédent. Cette hausse de prix s'est ensuite transmise aux prix de l'électricité, le prix du mégawattheure étant, sur le marché européen, établi en fonction de son coût marginal de production : en cas de pic d'activité, les centrales au gaz sont appelées en dernier pour répondre à ce pic. Ces effets en cascade ont conduit à des prix très élevés.
Depuis le mois de décembre dernier, nous constatons une petite détente grâce à des afflux de GNL depuis les États-Unis. Ils restent cependant très inférieurs à ce que pourrait fournir la Russie. Or, par rapport au quatrième trimestre de l'année 2020, la Russie a réduit ses livraisons de gaz à l'Europe de 25 %. Certes, elle a rempli ses obligations contractuelles, mais les gazoducs ne sont pas remplis au maximum alors que les prix sont très élevés. Il y a eu des problèmes sur quelques pipelines, mais également une demande très forte de gaz en Russie, en lien avec la reprise économique. Néanmoins, les tensions géopolitiques et économiques sont les facteurs principaux avec la crise ukrainienne, le projet de pipeline Nord Stream 2 et la question des contrats à long terme que la Russie souhaite conserver, à l'inverse de Bruxelles.
Nos analyses montrent que la Russie pourrait augmenter d'un tiers ses livraisons de gaz, ce qui équivaut à environ trois millions de mètres cubes supplémentaires. Cela représente environ 10 % de la consommation de gaz mensuelle en Europe. Le cas échéant, cela compléterait les livraisons complémentaires de gaz naturel liquéfié (GNL) et permettrait une détente durable des marchés du gaz. La leçon de cette crise est que l'Europe s'est insuffisamment préoccupée de ses stocks de gaz pour se préserver de l'influence d'un seul pays sur son approvisionnement. Pour le pétrole, la réglementation européenne impose un minimum de stocks ; il serait envisageable d'appliquer ce mécanisme au gaz – de telles règles existent déjà pour le gaz en France.
Voilà pour la crise actuelle.
S'agissant désormais des aspects plus prospectifs, un élément particulièrement intéressant concerne la transmission de la volatilité du prix du gaz à l'électricité. Selon nos analyses à plus long terme, à l'horizon de l'année 2030, les niveaux de prix du pétrole et de l'électricité resteront liés. Elles se fondent sur une série de scénarii.
Le premier scénario repose sur les engagements environnementaux pris en amont de la COP26, notamment la neutralité carbone de l'Union européenne ou celle, à horizon 2060, de la Chine. En Europe, le pacte vert à l'horizon de l'année 2030 va se traduire par une augmentation de la demande d'électricité d'environ 20 %, tandis qu'il sera répondu à la demande aux deux tiers par les énergies renouvelables.
Quel est l'impact pour le gaz ? Le parc installé devrait diminuer de 20 %. En revanche, les unités pilotables vont devoir s'adapter à des fluctuations plus fortes de la demande mais également de l'offre, qui résultera plus d'énergies renouvelables intermittentes et variables. Le gaz s'effacera lorsque le soleil brille ou que le vent souffle, mais devra compenser des conditions météorologiques moins favorables, et ce de manière plus fréquente. L'usage du gaz devrait donc rester important.
Mon deuxième message porte sur les risques structurels des engagements européens qui font état d'une neutralité carbone totale à l'horizon 2050. Les investissements actuels en pétrole et en gaz sont plutôt calibrés sur une demande stagnante, puis décroissante. Il ne devrait pas y avoir de nouveaux investissements dans les carburants fossiles au-delà de ce qui a déjà été approuvé. Or le déficit est important en matière d'investissements bas carbone : il conviendrait de multiplier par trois ces investissements au cours de la présente décennie. Si de tels investissements devaient encore être reportés, nous nous retrouverions encore dans une situation d'instabilité et de turbulences en matière de prix.
Mon dernier message concerne les prix aux consommateurs. Actuellement, un « ménage type » au niveau mondial dépense environ 1 200 dollars américains par an pour répondre à ses besoins énergétiques. Or une moindre dépendance aux énergies issues de sources fossiles doit protéger les consommateurs des chocs. Dans un scénario inertiel qui repose sur une poursuite de l'utilisation intensive d'énergies fossiles, nos analyses montrent qu'une hausse de 15 % de la facture énergétique des ménages serait à prévoir. En revanche, une trajectoire compatible avec la neutralité carbone ferait baisser cette même facture de 10 %, grâce à une moindre dépendance aux hydrocarbures et une meilleure efficacité énergétique. Selon nos calculs, un choc de prix sur les marchés mondiaux du gaz serait atténué de 30 % dans un scénario bas carbone. Bien évidemment, cette transition a un coût certain. Un accompagnement par les pouvoirs publics est donc indispensable, notamment un accompagnement des ménages les plus modestes.

Il y a une sorte de paradoxe français : nous produisons beaucoup d'énergie, au premier chef nucléaire, donc a priori décorrélée des prix du gaz. Cependant, le prix de l'énergie est déterminé en dernier lieu par le coût de la mise en œuvre marginale des centrales à gaz. Ne pourrait-on pas raisonner autrement ? Avez-vous des comparaisons, en matière de prix du mégawattheure, entre les différents pays ? Nos prix sont-ils inférieurs ? Comment nous situons-nous ? Enfin, quant au scénario de neutralité carbone, je comprends que les énergies renouvelables permettraient une moindre dépendance aux hydrocarbures et donc une atténuation des chocs mondiaux, mais vos modélisations intègrent-elles vraiment le coût des investissements en la matière ?

Je vous remercie, madame, pour cette présentation utile et bienvenue. Vous avez bien présenté l'intérêt pour nos concitoyens d'une restructuration du marché. C'est essentiel, à long terme.
J'ai cependant quelques questions. Comment peut-on expliquer de telles divergences de prévisions sur l'évolution des prix entre les observateurs ? Et, en ce qui concerne l'évolution des prix du gaz, devons-nous craindre un rallye de long terme ou s'agit-il plutôt d'une bosse de court terme ? Par ailleurs, pouvez-vous détailler les scénarii que vous inspirent la crise ukrainienne et ses impacts sur le prix du gaz ? Subsidiairement et sur un plan plus politique, l'Agence internationale de l'énergie a-t-elle émis un avis sur les réponses apportées par les politiques publiques à la hausse des prix de l'énergie en général ? Je veux parler du bouclier tarifaire, du plafonnement de la hausse des prix à 4 % ainsi que de l'indemnité inflation concernant le fioul et du rehaussement de l'indemnité kilométrique. Avez-vous formulé d'autres propositions ou aviez-vous eu à connaître d'autres propositions qui vous avaient parues pertinentes, notamment en termes de baisse de la fiscalité sur les carburants ?

J'ai compris de vos propos, madame, qu'il fallait d'autres politiques publiques pour accompagner cette inflation… mais j'aimerais une vraie réponse sur ce point. Vous avez également évoqué le fait que cette crise est européenne. L'Union européenne envisage-t-elle donc de modifier, à très court terme, des directives, des règles, techniques ou économiques ?
À plus long terme, privilégiez-vous certains investissements plutôt que d'autres ?

Pourriez-vous, madame, revenir sur le problème du marché du gaz ? C'est le gaz qui a déclenché tout cela, et c'est lié à la stratégie politique de la Russie, mais ne pourrait-on s'affranchir progressivement de tout approvisionnement gazier russe ? Il n'y a pas de problème de production mondiale : les réserves sont estimées à cent années de consommation. Pourquoi les Européens ne s'organisent-ils pas pour accroître les importations d'Afrique, voire des États-Unis ?

La transition énergétique passe par le développement des véhicules électriques, mais l'augmentation des prix de l'électricité amène les consommateurs à s'interroger sur la pertinence de l'achat de ce type de véhicule. Qu'en pensez-vous ?
Plus globalement, comment appréhendez-vous les effets de la transition énergétique sur l'inflation ? Existe-t-il des instruments efficaces pour limiter les effets d'une telle transition sur les prix de l'énergie ?

Le contrôle ou le blocage momentané des prix à court terme ne pourrait-il pas être une solution ? À plus long terme, ne pensez-vous pas nécessaire d'affranchir le secteur de l'énergie de la logique du marché ? La logique de marché empêche d'avoir une véritable politique de l'énergie, et créer, comme le veut cette logique, des intermédiaires supplémentaires entre producteurs et consommateurs est une aberration.

Par rapport au surenchérissement énergétique, les règles européennes nous interdisent-elles d'aider nos industries ? Je pense à des situations particulières dont j'ai à connaître sur mon territoire.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs les députés, pour ces questions.
Effectivement, le coût de production d'électricité en France qui repose, majoritairement, sur le nucléaire est beaucoup plus bas que dans les pays voisins. Cependant, la France reste exposée à l'Europe, étant interconnectée, et, dans un passé récent, nous avons assisté à des baisses de moyens de production d'électricité en France, notamment une indisponibilité du nucléaire qui a conduit la France a importé plus d'électricité qu'habituellement et l'a donc exposée aux fluctuations constatées sur les marchés.
Cela étant, en raison de cette moindre exposition, l'augmentation des prix au consommateur final a été bien moindre que dans les pays voisins – aux Pays-Bas, par exemple, ces prix ont augmenté de quasiment 150 % par rapport à la même période de l'année précédente.
Des questions m'ont été posées sur les perspectives de long terme et la méthodologie de ces prévisions parfois très divergentes. Il n'est jamais tout à fait évident d'établir des prévisions. Différents modèles sont utilisés. Pour notre part, nous évitons de faire des prévisions, nous envisageons plutôt différents scénarios, avec des marges d'incertitude, et d'en déduire différentes options.
L'Europe peut-elle se passer de la Russie pour son approvisionnement ? Nous l'avons vu pendant cette crise, une partie du GNL est beaucoup plus concurrentielle que le gaz fourni par pipeline en provenance de Russie. Cela profite aux pays émergents d'Asie car les prix sont plus hauts, et, dans nos prévisions, nous pensons que cet appétit pour le gaz des grands émergents asiatiques va perdurer, car il est très cohérent avec leur politique énergétique qui vise à se passer du charbon, pour des raisons climatiques et surtout pour des raisons de pollution atmosphérique en milieu urbain. Le gaz concurrentiel va donc être plutôt attiré vers les pays émergents d'Asie ; nous ne pourrons donc pas tout de suite nous passer de la Russie. Cela n'empêche évidemment pas de diversifier ses sources d'approvisionnement ni, surtout, avec des mesures d'efficacité énergétique ou d'électrification de certains usages, de diminuer notre dépendance au gaz. Et je rappelle une nouvelle fois l'importance du stockage, comme moyen de flexibilité dans ces périodes de tension.
Quant à la dépendance des marchés aux prix du gaz, en raison de ce mécanisme d'ordre de mérite de rémunération par la source marginale, cela permet une grande efficacité, en ce sens que les différents opérateurs peuvent recouvrir leurs coûts. Avec la transition énergétique, la tendance du prix de l'électricité est plutôt à la baisse, du fait d'un plus grand déploiement des renouvelables. D'autres mécanismes de rémunération sont donc envisagés pour les unités de production ; on peut penser aux mécanismes de capacité à valoriser la flexibilité qu'offre le gaz, ce qui va plus loin que la valeur énergie qui est reflétée dans ces prix de l'énergie. On peut donc envisager que ces mécanismes de détermination du prix qui aujourd'hui dépendent beaucoup du coût marginal puissent évoluer et, si des réformes plus structurelles sont menées, que ces marchés du gaz soient découplés de celui de l'électricité.

Le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz parce que les centrales à gaz permettent d'écrêter les pointes, mais prenez l'exemple français : les centrales à gaz produisent à peu près 2 % ou 3 % de l'électricité française. Dès lors, n'est-il pas quelque peu aberrant de fixer des prix de l'électricité en fonction d'un minuscule marché ? Et, pendant ce temps-là, la France, quand toutes nos centrales fonctionnent, exportent beaucoup : 15 % de son électricité quand toutes nos centrales tournent. Certes, actuellement, c'est différent, mais c'est parce que dix ou onze réacteurs sont à l'arrêt, pour des raisons diverses et variées, si bien que notre production d'électricité a chuté et que nous en importons.

Nous savons que le nucléaire représente environ 70 % de la production d'électricité, mais pouvons-nous savoir quelle part de la consommation représente l'électricité d'origine nucléaire ?

Quelle est la part du gaz russe dans les achats européens ? Par ailleurs, est-ce que l'Union européenne va prendre des mesures au cours des six prochains mois ou sont-ce les États qui devront continuer à faire des efforts et à mettre en place des compensations ?
La part du gaz russe dans les importations européennes de gaz est de 40 %, ce qui est considérable – mais la France en dépend bien moins que la moyenne des pays européens.
Quant au mécanisme des prix, ces 2 % ou 3 % de gaz en France qui déterminent les prix montrent, finalement, qu'il ne s'agit pas tant de produire de l'électricité à partir du gaz que de répondre à un certain besoin de flexibilité. Le prix reflète ce que serait l'impact sur les économies d'une absence de ces centrales, si nous n'avions que les autres moyens, qui n'ont pas cette capacité d'augmenter la production ou de s'effacer quand c'est nécessaire. Ce coût marginal élevé reflète ce que vaut l'assurance d'avoir une électricité fiable à tout moment.
Aujourd'hui, les principaux revenus des producteurs d'électricité leur sont procurés par le marché de gros, qui, lui, est censé refléter uniquement la valeur de l'électricité produite dans son ensemble. Pour l'instant, il a cette fonction de refléter à la fois la valeur de l'électricité produite mais aussi la valeur de sa disponibilité à tout moment, en cas de pointe, pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande. Une possibilité serait d'envisager un prix qui reflète mieux les différentes valeurs de l'électricité : la valeur énergie, la valeur flexibilité et la valeur disponibilité à tout moment.
Il n'est pas possible de distinguer la part du nucléaire dans la consommation d'énergie : une fois l'énergie produite par les centrales, elle se retrouve sur le réseau, et il est très compliqué de distinguer dans la consommation les parts respectives de la production de nos centrales nucléaires et des importations.
L'Union européenne a très récemment fait des propositions à propos du gaz, notamment en vue d'une coordination de ses membres pour des achats groupés de gaz. L'Agence internationale de l'énergie promeut pour sa part l'idée d'un taux minimum réglementaire de remplissage des sites de stockage de gaz, éventuellement assorti d'un contrôle – à qui appartiennent ces sites ? Les marchés se sont vivement inquiétés, dernièrement, du bas niveau du stockage de gaz en Europe, mais une grande partie des sites appartiennent à Gazprom.

Je réitère mes questions de tout à l'heure : que pensez-vous de la possibilité d'un blocage des prix à court terme et de la création d'un pôle public de l'énergie ? Quels problèmes ces deux solutions poseraient-elles ?

Selon le document que vous nous avez fait parvenir, madame, l'AIE envisage la possibilité d'une rétraction du marché du pétrole et des autres énergies fossiles, qui passerait d'environ 1 250 milliards de dollars en 2020 à 850 milliards de dollars en 2030, tandis que celui des énergies renouvelables passerait de 140 à 880 milliards de dollars. Je souhaite une telle évolution mais cette projection me paraît très optimiste : la possibilité technique, les moyens financiers et la volonté politique sont-ils bien au rendez-vous pour en faire une réalité ?

Alors que la constitution de réserves pétrolières pour trois mois est obligatoire, aux frais des entreprises, il n'y a pas d'obligation de stockage du gaz – même s'il y a des stocks. Une idée serait donc d'appliquer au gaz une obligation analogue, d'autant que nous avons de grandes capacités de stockage, notamment dans les anciens gisements de gaz français. Où en sont donc les discussions en Europe à ce propos ?
En ce qui concerne la possibilité d'un blocage des prix et d'une sortie de la logique de marché, un bouclier a effectivement été mis en place pour protéger les consommateurs, ce qui a permis – la comparaison avec les pays voisins le montre très clairement – la hausse des prix par rapport à la situation d'avant la crise. Nous ne préconisons pas de distordre la concurrence dans une situation normale. À long terme, ce sont effectivement des signaux prix clairs et non volatils qui détermineront le sens des investissements, et principalement des signaux émis par les pouvoirs publics, telle la mise en place d'une tarification carbone qui signalera une préférence pour les sources non carbonées. Les instruments mis en œuvre pour protéger le consommateur face à une conjoncture particulière n'entrent pas dans notre mandat ; il s'agit là d'un mandat de politique économique. Du point de vue des marchés de l'énergie, pérenniser de telles logiques contrarierait une visibilité de long terme en vue de la transition énergétique.
Quant à sortir d'une logique de marché, le système énergétique est finalement moins exposé qu'on ne le pense à une telle logique. Ainsi, moins de 5 % des investissements dans les infrastructures énergétiques, les réseaux de gaz et d'électricité, se font en étant exposés directement au marché ; à hauteur de 95 %, c'est le fait d'entreprises d'État, ou ce sont des investissements protégés des règles de marché par des réglementations diverses édictées par l'État ou les organismes supranationaux. Les mesures de soutien aux énergies renouvelables en sont des exemples. Ainsi, la plupart des investissements sont régulés.
M. Castellani m'interrogeait sur notre scénario « net zéro », dans lequel l'électricité est vraiment au cœur de la transition énergétique. D'une part, la demande d'électricité pour la mobilité et pour décarboner certains secteurs qui reposent aujourd'hui sur des combustibles très émetteurs sera de plus en plus forte. Si elle n'est pas accompagnée d'une mutation complète de la manière dont on produit l'électricité à travers le monde, nous allons reporter les émissions, par exemple de la mobilité, vers le secteur électrique si l'électricité est produite à partir du charbon.
Quel est le degré de réalisme de ces projections ? Notre but, ce n'est pas de prédire ce qui se passera. Nous indiquons ce qu'impliquent nos engagements : si nous visons vraiment la neutralité carbone à l'horizon 2050, alors le charbon ne doit plus être utilisé pour la production d'électricité en 2040 au niveau mondial, et bien plus tôt pour les économies avancées. Cela implique que le gaz naturel, lui aussi émetteur, pourra être employé dans une période de transition, notamment en remplacement du charbon dans les grandes économies d'Asie, mais qu'il doit aussi disparaître. Cela implique, à l'inverse, un déploiement sans précédent des sources bas carbone, en particulier l'éolien et le solaire, qui représenteront presque 70 % à eux seuls de la production d'électricité mondiale. Il ne s'agit pas de dire que c'est ce qui se passera, il s'agit de montrer quels sont les défis qui en résultent, qu'il s'agisse des chaînes de production de panneaux solaires, de la recherche-développement relative aux batteries, des besoins en flexibilité, multipliés par quatre. Ce sont ces besoins et ces opportunités que nous anticipons grâce à ce scénario, et par comparaison avec les autres scénarios.

Merci beaucoup, madame, pour toutes ces explications sur un sujet complexe et pleinement d'actualité.
Je remercie également très chaleureusement l'INSEE en la personne de Jean-Luc Tavernier et la Banque de France en la personne d'Olivier Garnier. Pendant plusieurs années, ils ont animé ce cycle « Au cœur de l'économie » avec beaucoup de brio. Cela nous fut bénéfique, dans notre travail de législateur.
Nous ne devrions pas nous revoir dans ce cadre au cours de la précédente législature, mais il restera nécessaire, au cours de la prochaine législature, que notre commission se saisisse pleinement des sujets économiques.
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du mercredi 26 janvier à 9 heures 30
Présents. - M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Julien Aubert, M. Jean-Louis Bricout, Mme Émilie Cariou, M. Michel Castellani, M. Philippe Chassaing, M. Francis Chouat, M. François Cornut-Gentille, M. Charles de Courson, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, M. Benjamin Dirx, Mme Stella Dupont, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Romain Grau, M. Brahim Hammouche, M. Patrick Hetzel, M. Alexandre Holroyd, M. Christophe Jerretie, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Marie Lebec, Mme Patricia Lemoine, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Patrick Loiseau, Mme Véronique Louwagie, Mme Marie-Ange Magne, Mme Lise Magnier, M. Jean-Paul Mattei, Mme Cendra Motin, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Zivka Park, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Christine Pires Beaune, M. François Pupponi, Mme Valérie Rabault, M. Robin Reda, M. Xavier Roseren, Mme Sabine Rubin, M. Laurent Saint-Martin, M. Éric Woerth
Excusés. - M. Damien Abad, M. Alain Bruneel, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Jennifer De Temmerman, M. François Jolivet, Mme Frédérique Lardet, M. Marc Le Fur