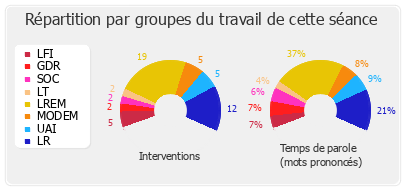Séance en hémicycle du mardi 28 mai 2019 à 9h30
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à neuf heures trente.

La parole est à M. Loïc Prud'homme, pour exposer sa question, no 729, relative à l'enseignement de la langue des signes française.
M. Loïc Prud'homme débute son intervention en s'exprimant en langue des signes.

Je m'excuse auprès de nos 400 000 concitoyens qui « signent » pour l'imperfection de ma maîtrise de la LSF, la langue des signes française. Cependant, j'ai fait, en quelques jours, plus d'efforts que le Gouvernement n'en a fait depuis deux ans afin que les sourds et les malentendants ne restent pas exclus, malgré la loi du 11 février 2005, qui n'est toujours pas appliquée.
Au-delà de la reconnaissance de la LSF dans la Constitution, je voudrais vous parler de ce qui empêche quotidiennement plusieurs centaines de milliers de personnes d'être des citoyens à part entière.
Certes, d'une façon générale, l'accessibilité des personnes en situation de handicap a progressé, mais pour les sourds et malentendants, porteurs d'un handicap invisible, les réponses et les aménagements restent, eux aussi, invisibles, et pour cause : ils n'existent pas, ou presque.
Ces citoyens sont exclus des services publics : dans les mairies ou les hôpitaux, aucun agent n'est bilingue français-LSF. Dans ces lieux, il est plus facile d'être un touriste anglophone qu'un citoyen français sourd !
Ils sont également exclus de l'éducation depuis leur plus jeune âge : absence de réel choix d'un enseignement en LSF, absence d'alternative présentée aux parents, hormis la pose d'implants pour les jeunes enfants. La plupart d'entre nous l'ignorent, mais l'accès à l'écrit est un réel problème pour ces citoyens. Il est donc indispensable de développer la pratique de la LSF par les agents publics, ainsi que la traduction des services publics en ligne.
Dans l'éducation nationale, les rares enseignants qui se forment à la LSF le font bénévolement, sur leur temps de repos.
M. Loïc Prud'homme termine son intervention en s'exprimant de nouveau en langue des signes.

La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées.
Monsieur le député, je vous remercie pour votre question, qui va me permettre de vous faire part des avancées concrètes que nous avons obtenues vers la pleine participation des personnes sourdes et malentendantes à notre société.
Depuis le 8 octobre 2018, cinq millions de personnes sourdes ou malentendantes disposent d'une heure de communication gratuite par mois via des traducteurs de la conversation dans la langue de leur choix. Cette obligation de mise en accessibilité vise aussi les services d'accueil des services publics et des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros. Il s'agit d'une avancée historique vers la pleine citoyenneté des personnes concernées. Le déploiement dans les services publics est en cours. Parcoursup, la cellule Aide handicap école, le standard du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministère de la culture, ses écoles, dix musées, la Bibliothèque nationale de France, le ministère des affaires étrangères ont d'ores et déjà été mis en accessibilité. Tous les ministères sont mobilisés ; ils s'y sont d'ailleurs engagés lors des comités interministériels du handicap.
Le 22 février 2019, l'accès au service d'urgence 114 en conversation totale a été ouvert – je me suis rendue à Grenoble pour l'occasion. Le 114 est un service public qui permet aux personnes sourdes ou malentendantes d'accéder à l'ensemble des centres d'appel d'urgence français – le 15, le 17, le 18 – , en métropole et en outre-mer. Ce service est unique en Europe. Il ouvre des perspectives inédites d'accessibilité au service public. Il s'agit, là encore, d'une avancée majeure, qui va faciliter l'accès des personnes aux soins.
À l'école, la situation évolue. Le numéro vert Aide handicap école est désormais accessible pour les parents sourds. L'adaptation des programmes en langue des signes française est prévue pour octobre 2019. L'arrêté relatif à l'enseignement optionnel de la LSF en seconde et dans le cycle terminal a été publié. Il prévoit un enseignement de trois heures hebdomadaires, avec une évaluation soumise au régime du contrôle continu. Les pôles d'enseignement pour les jeunes sourds, qui sont en cours de déploiement, permettent deux types de parcours complet, de la maternelle au lycée.
Concernant l'école inclusive, les associations de parents d'enfants sourds et de professionnels ont participé à la concertation. Je les ai toutes reçues. Des réunions spécifiques ont déjà été organisées, d'autres sont à venir.
Dans les universités, l'accès est facilité par l'expérimentation d'outils adaptés à ces étudiants.
Tous les chantiers que nous engageons prennent en considération les attentes des personnes concernées, que ce soit pour l'emploi, la mobilité ou les droits à vie.
Monsieur le député, nous agissons pour simplifier le quotidien de tous et de chacun. Nous sommes tous mobilisés pour améliorer les conditions actuelles et assurer la pleine participation de tous nos concitoyens à tout.

Je vous remercie pour votre réponse, madame la secrétaire d'État. Néanmoins, un rapport de l'ONU de 2019 pointe les carences de l'interprétariat, ainsi que le fait que si l'on s'occupe beaucoup de l'incapacité des personnes en situation de handicap, on travaille moins à rendre notre société plus inclusive.
J'entends vos arguments, mais permettez-moi de considérer que ceux de l'ONU sont plus objectifs – je pense que si nos places étaient inversées, vous feriez de même, et ce serait légitime. Je le répète, ce rapport de l'ONU souligne l'existence de nombreuses carences.
Après une première manifestation, au printemps, devant l'Assemblée nationale, les associations de sourds et malentendants se mobiliseront de nouveau le 20 juin prochain. Je vous propose de rencontrer une délégation de leurs membres ; je suis même prêt à l'accompagner afin que l'on puisse avancer en la matière. D'ailleurs, je vous rappelle que je vous ai posé une question écrite relative à la reconnaissance de la LSF dans la Constitution.

Il s'agit, en effet, d'un sujet très important, que nous avons évoqué la nuit dernière. Nous avons fait part des actions de notre institution, dans la continuité des travaux du groupe de travail que vous avez piloté.

La parole est à Mme Fadila Khattabi, pour exposer sa question, no 737, relative à l'aide au permis de conduire des apprentis.

Ma question s'adresse à Mme la ministre du travail.
Avec l'adoption de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, tout apprenti âgé de 18 ans ou plus peut désormais bénéficier d'une aide de l'État, à hauteur de 500 euros, pour passer son permis de conduire. Il s'agit là d'une mesure forte, qui reflète l'engagement du Gouvernement en faveur de la mobilité, une mobilité indispensable pour l'insertion professionnelle des jeunes. Grâce à la réforme de l'apprentissage et à cette aide à l'obtention du permis de conduire, le Gouvernement contribue à réduire de manière significative les inégalités.
Cette démarche contribue aussi à l'amélioration du pouvoir d'achat des familles et de celui de nos jeunes concitoyens. Aussi, faut-il tout mettre en oeuvre pour faciliter l'accès à ce permis de conduire, qui est déterminant pour l'accès à l'emploi.
D'ailleurs, des aides similaires existent dans certains territoires. C'est notamment le cas en Bourgogne-Franche-Comté, où la région prévoit une aide de 500 euros pour les jeunes apprentis ou lycéens qui suivent une formation professionnelle et souhaitent passer leur permis de conduire. En tant que députée de la Côte-d'Or, je me réjouis que la présidente de la région ait choisi de maintenir cette aide au financement du permis, facilitant ainsi la mobilité des jeunes. Il me semble important d'encourager toutes les collectivités qui proposent ce type de mesure à poursuivre leur accompagnement financier, en complément de l'aide proposée par l'État.
Ma question est donc la suivante : compte tenu de l'aide financière déployée par l'État, et des dispositifs existants, peut-on envisager que ces aides soient cumulables, par exemple dans le cadre d'un guichet unique ? Comment les engagements des fonds de l'État et ceux des collectivités peuvent-ils s'articuler en vue de rendre les politiques publiques encore plus efficaces ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées.
Madame la députée, veuillez excuser l'absence de Muriel Pénicaud.
L'aide au permis de conduire est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Destinée aux apprentis majeurs inscrits dans une école de conduite pour passer leur permis, elle a pour objectif, comme vous le soulignez, de faciliter les déplacements entre leur domicile, leur centre de formation d'apprentis et leur employeur.
Le bénéfice de l'aide au permis de conduire pour les apprentis est subordonné au respect, à la date de la demande, des conditions cumulatives suivantes : être âgé d'au moins 18 ans ; être titulaire d'un contrat d'apprentissage en cours d'exécution ; être engagé dans la préparation des épreuves du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules de la catégorie B.
L'aide, d'un montant de 500 euros, est financée par France compétences, qui passe une convention avec l'Agence de services et de paiement. Les centres de formation d'apprentis – CFA – versent l'aide à l'apprenti ou à son école de conduite, et l'Agence est chargée de verser l'aide aux CFA, par remboursement de l'aide déjà versée à l'apprenti. On essaie ainsi de simplifier la « tuyauterie » administrative pour l'apprenti : c'est une source de lisibilité du dispositif.
Cette aide de 500 euros vient en complément des autres dispositifs existants. Elle est cumulable avec toutes les autres aides perçues par l'apprenti, y compris celles liées au transport, qui peuvent être versées par les collectivités ou les branches professionnelles. Par exemple, les jeunes qui effectueront une mission d'engagement volontaire proposée par une association identifiée par la région Auvergne-Rhône-Alpes et oeuvrant dans des domaines comme la lutte contre la pauvreté, l'aide aux personnes malades ou handicapées, le lien entre les générations, verront leur engagement récompensé : la région pourra financer une partie de leur permis de conduire ou le passage du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, le BAFA.
Comme vous le mentionnez à juste titre, en Bourgogne-Franche-Comté, les jeunes âgés de 16 à 25 ans, inscrits dans une auto-école bourguignonne ou franc-comtoise, engagés dans un parcours professionnel ou demandeurs d'emploi, rattachés au foyer fiscal parental ou émancipés fiscalement peuvent obtenir une aide au financement du permis B, à hauteur de 500 euros, et cela afin de faciliter leur accès à l'autonomie. Cette aide est cumulable avec l'aide au permis.
La région Hauts-de-France propose, elle aussi, un prêt afin d'aider les 18-30 ans à passer leur permis de conduire. Concrètement, cette aide prend la forme d'un prêt d'un montant pouvant aller jusqu'à 1 000 euros, versé en deux fois et non renouvelable. Elle peut être cumulée avec d'autres dispositifs.
Lié à l'ANFA, l'Association nationale pour la formation automobile, par un accord de branche, IRP Auto assure la protection sociale des professionnels et soutient les jeunes salariés apprentis. Les apprentis peuvent bénéficier d'une aide au permis auto d'un montant allant jusqu'à 300 euros, et 200 euros supplémentaires s'ils participent à une session de sensibilisation à la sécurité routière. La demande doit être faite avant l'obtention du permis de conduire, durant la période d'apprentissage professionnel.
Tout le monde se mobilise pour compléter ces aides.
Le permis à 1 euro est un prêt dont les intérêts sont pris en charge par l'État. Il a été mis en place par l'État, en partenariat avec les établissements prêteurs et les écoles de conduite, pour aider les jeunes de 15 à 25 ans. Il permet à ceux-ci de bénéficier d'une facilité de paiement. Le coût total de la formation au permis ne change pas, mais l'établissement financier avance l'argent et l'État paie les intérêts.
La bourse au permis de conduire concerne les jeunes âgés de 18 à 25 ans, plus particulièrement ceux qui ne disposent pas de ressources personnelles ou familiales suffisantes pour financer leur préparation au permis de conduire. Elle consiste en la prise en charge par la municipalité du lieu de résidence d'une partie du coût de la formation, en contrepartie d'une activité d'intérêt collectif durant 40 à 50 heures, effectuée dans une structure identifiée.
Vous le voyez, tout est mis en oeuvre pour favoriser la mobilité professionnelle, qui est si importante pour réussir son insertion professionnelle.

Merci pour toutes ces informations, madame la secrétaire d'État. Merci pour le travail collaboratif des pouvoirs publics, en vue de répondre aux attentes de nos concitoyens et de faciliter leur tâche sur le plan administratif. On le sait, la mobilité est la première clé de réussite pour l'insertion professionnelle.

La parole est à Mme Valérie Bazin-Malgras, pour exposer sa question, no 748, relative au marché du travail.

Plein emploi en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas ; taux de chômage au plus bas depuis cinquante ans aux États-Unis, avec un taux autour de 3 % ; moyenne à 5,2 % pour les pays de l'OCDE : on pourrait se dire que le marché de l'emploi se porte bien dans les économies occidentales et que la crise est désormais un souvenir douloureux lointain. Pourtant, la France accuse un taux de chômage de 8,8 % !
Elle a, par ailleurs, le taux de prélèvements obligatoires le plus élevé de l'OCDE, avec plus de 46 %, soit douze points au-dessus de la moyenne. Ce que les statistiques nous enseignent, les Français nous le disent également dans les territoires : le travail ne paie pas assez !
Je viens d'une circonscription viticole. Trop souvent, on constate que la différence entre le SMIC et le niveau des prestations sociales que touchent les personnes privées d'emploi est insuffisante pour inciter quelqu'un à accepter un emploi de vendangeur, par exemple. Ces secteurs manquent pourtant cruellement de main-d'oeuvre et doivent recruter en masse des travailleurs venant des pays de l'Est. Dans le département de l'Aube, de nombreux viticulteurs doivent faire appel à des prestataires de services pour embaucher plusieurs milliers de travailleurs détachés pendant la période des vendanges. Les employeurs ne décolèrent pas de devoir en arriver là, alors qu'il existe un chômage de masse dans notre pays. Ils préféreraient mobiliser la main-d'oeuvre locale pour faire vivre les traditions viticoles locales et le territoire, plutôt que d'avoir recours à une main-d'oeuvre venue de très loin.
Pourtant, en France, les artisans, les commerçants, les patrons de PME témoignent tous de difficultés de recrutement. Il y aurait entre 200 000 et 330 000 offres qui ne trouveraient pas preneurs faute de candidats. Il existe, en France, des trappes à inactivité qui n'incitent pas nos concitoyens à retrouver le chemin de l'emploi.
Quelles réponses le Gouvernement propose-t-il pour que le travail paie vraiment, et que les efforts et le mérite soient pleinement récompensés ? Comment entendez-vous vous attaquer aux trappes à inactivité qui freinent le dynamisme du marché du travail ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées.
Madame la députée, le problème que vous soulevez est au coeur de l'action du ministère du travail. Pour le résoudre, il est nécessaire de stimuler la croissance, de la rendre riche en emplois et inclusive, et de faire en sorte que le travail paie. Tel est le sens des réformes menées par le Gouvernement depuis son arrivée au pouvoir.
Les ordonnances pour le renforcement du dialogue social ont ainsi permis de réduire les craintes des TPE et des PME à embaucher. Par ailleurs, en améliorant les compétences des actifs faiblement qualifiés, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a augmenté le montant du compte personnel de formation alloué aux actifs peu diplômés, le portant à 800 euros par an contre 500 euros auparavant, et le plan d'investissement dans les compétences, destiné à la formation de 2 millions de demandeurs d'emploi peu diplômés et éloignés du marché du travail, vont améliorer l'accès aux emplois plus qualifiés, donc mieux rémunérés.
D'ailleurs, nous constatons d'ores et déjà les premiers résultats, le taux de chômage étant tombé à 8,7 %, soit un point de moins qu'il y a deux ans.
Pour amplifier l'impact de ces réformes, nous lançons, sous l'autorité de M. le Premier ministre, la mobilisation nationale et territoriale pour l'emploi, destinée à résoudre, avec les collectivités territoriales et les partenaires sociaux, les problèmes concrets qui se posent sur le terrain. Il s'agit notamment de lever les freins à l'emploi que sont la recherche d'un logement, d'un moyen de transport, d'un apprenti ou d'une garde d'enfant. Par ailleurs, la réforme de l'assurance chômage, en cours d'élaboration, permettra de mieux lutter contre l'emploi précaire.
Enfin, selon une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, les ménages français gagneront en moyenne 850 euros de pouvoir d'achat en 2019, dont 440 euros directement liés à des mesures du Gouvernement. C'est la plus forte hausse depuis 2007.
Je termine en ajoutant que nous sommes présents, aujourd'hui, au Salon Handicap, emploi & achats responsables, afin d'inciter les entreprises à embaucher, plus encore qu'elles ne le font, des travailleurs handicapés, en mettant à leur disposition toutes les prestations d'emploi accompagné.

Je vous remercie pour votre réponse, madame la secrétaire d'État, mais elle ne nous dit rien sur la façon de mobiliser les personnes privées d'emploi, par exemple pour faire les vendanges, tâche que chacun peut accomplir et pour laquelle on fait venir, en Champagne, près de 10 000 travailleurs détachés. Telle est bien notre préoccupation dans le département : comment faire travailler dans les vignes les personnes privées d'emploi, lorsque les viticulteurs en ont besoin ?

La parole est à Mme Valérie Lacroute, pour exposer sa question, no 747, relative au commissariat de Fontainebleau.

La situation particulièrement dramatique du commissariat de police de Fontainebleau, dont l'état de vétusté ne permet pas aux fonctionnaires de travailler et de recevoir les usagers dans des conditions dignes, appelle une réponse urgente de la part du ministère de l'intérieur. Le contexte est devenu alarmant ces derniers mois, avec l'effondrement d'un mur d'enceinte qui a mis hors d'usage sept véhicules de fonctionnaires et anéanti un bâtiment modulaire d'accueil du public, obligeant certaines unités à travailler dans d'autres commissariats de la circonscription. Pire encore, à la suite des récents orages, une partie des plafonds des bureaux situés aux étages est tombée sous la pression de fuites d'eau.
À maintes reprises, j'ai souligné, avec l'appui des élus, que les policiers ne pouvaient pas travailler dans de bonnes conditions. Victimes et malfaiteurs cohabitent : c'est inimaginable et inacceptable. Aussi, il est nécessaire que le commissariat de Fontainebleau fasse l'objet d'une reconstruction.
Deux sites sont envisagés, dont l'un est situé à Avon, à proximité de la gare SNCF de Fontainebleau-Avon, à 1,5 kilomètre du centre-ville de Fontainebleau et au centre du périmètre d'intervention du commissariat. Cette option, la plus fiable et la plus aboutie techniquement, est reconnue par le SGAMI – secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur – dans un rapport rendu en 2017. De surcroît, le financement serait en grande partie assuré par un fonds de concours de la ville d'Avon, ce qui est un atout en cette période de budget contraint.
Au regard du rapport rendu par le SGAMI, j'en appelle à la responsabilité du ministre de l'intérieur pour décider, dans les meilleurs délais, du lieu d'implantation du futur commissariat.

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur.
Chaque jour, les policiers s'engagent, avec courage et un sens élevé de l'intérêt général, pour faire appliquer les lois et protéger les Français, dans un contexte de plus en plus difficile et violent.
Les conditions de travail des policiers sont, pour le ministre de l'intérieur, une préoccupation de premier plan. Ces derniers doivent, en effet, pouvoir bénéficier de commissariats à la hauteur des exigences et de leur engagement opérationnel, très important. En la matière, c'est aussi la qualité de l'accueil des victimes qui est en jeu. Or trop de locaux de police sont encore inadaptés, vétustes.
C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de mobiliser d'importants moyens financiers. La police nationale est ainsi dotée d'un budget immobilier de près de 200 millions d'euros par an au titre de la programmation triennale. Cet effort ne suffira évidemment pas à répondre à tous les besoins, mais l'ambition est là. Les efforts sont engagés au bénéfice direct des policiers de terrain qui, progressivement, verront le visage de leurs commissariats changer.
S'agissant de la situation du commissariat de Fontainebleau, le ministère a mis en oeuvre des travaux destinés à assurer aux agents de bonnes conditions de travail et à leur garantir toute la sécurité nécessaire. Des travaux d'aménagement et de confortement du bâtiment, ainsi que des travaux de réhabilitation plus lourds, ont ainsi été menés. Un audit structurel du bâtiment, réalisé par une société spécialisée, est également en cours. Les travaux qui seront identifiés comme nécessaires seront réalisés sans délai. D'ores et déjà, des diagnostics visuels du bâtiment ont été réalisés, le 16 mai 2019, par un bureau d'études, dont les conclusions ne remettent pas en cause l'exploitation du bâtiment en l'état. Un rapport avait également été remis en début d'année 2019 sur les installations électriques, qui ne soulèvent pas d'inquiétudes particulières.
S'agissant des décisions plus structurantes que vous avez évoquées, et qui pourraient conduire à engager des travaux de plus grande ampleur, depuis de longues années, vous l'avez souligné aussi, différentes hypothèses sont à l'étude. Le ministère de l'intérieur a actualisé ces options, et la préfète de Seine-et-Marne est mandatée pour instruire le dossier et faire part au ministre de ses recommandations. Sur ce dossier, désormais ancien, l'objectif est de disposer de perspectives claires d'ici à la fin de l'année.
Soyez assurée, madame la députée, que la situation du commissariat de police de Fontainebleau retient toute l'attention de Christophe Castaner et la mienne.

Merci pour votre réponse, monsieur le secrétaire d'État. Le Gouvernement, nous en sommes bien conscients, a engagé des travaux d'urgence dans ce commissariat, et je vous en remercie. Mais il ne vous a pas échappé qu'un syndicat de police et des agents ont défilé la semaine dernière dans les rues de Fontainebleau pour alerter sur les conditions dangereuses dans lesquelles ceux-ci exercent leur métier. C'est quand même une grande première.
Il ne vous a pas échappé non plus que les collectivités, à commencer par la ville d'Avon, ont présenté, pour la reconstruction du bâtiment, un dossier financier qui tient la route. Il y a là un enjeu entre les deux communes concernées mais, selon le dossier dont je viens de parler, le commissariat, il faut y insister, serait implanté au coeur de son périmètre d'intervention, c'est-à-dire à proximité de la gare, lieu où l'on a parfois à déplorer des situations de danger.
J'ai également pris connaissance, hier soir, d'une information qui m'inquiète tout particulièrement et dont on parlera certainement dans les prochains jours : le regroupement des commissariats de Fontainebleau, Nemours, Montereau-Fault-Yonne et Moret-Loing-et-Orvanne, qui auraient donc une direction commune.

J'ignore si cette initiative vient du Gouvernement, mais elle ne fait qu'aviver l'inquiétude des élus et des agents concernés.

La parole est à Mme Agnès Firmin Le Bodo, pour exposer sa question, no 758, relative à la police de sécurité du quotidien au Havre.

En février 2018 était officiellement lancée la police de sécurité du quotidien. Il s'agissait de « replacer le service du citoyen au coeur de l'action des forces de sécurité » en renforçant la présence policière dans les quartiers de reconquête républicaine et en prévoyant des DCPP – délégués à la cohésion police-population – , chargés de faire le lien entre la population et les forces de sécurité, notamment par des actions de prévention. Des renforts en effectifs étaient également prévus.
Au Havre, deux quartiers de reconquête républicaine, la Mare-Rouge et le Mont-Gaillard, ont été désignés dans ce cadre. Or, après un peu plus d'un an, les attentes restent vives, associées à la crainte de ne voir qu'un empilement de dispositifs plutôt que l'augmentation de forces en présence. Certes, deux DCPP effectuent un travail de concertation et de proximité mais, pour le moment, les effectifs n'ont pas été augmentés et l'impatience grandit.
Par ailleurs, le ministre avait annoncé une collaboration renforcée avec les collectivités locales et les polices municipales, notamment via des expérimentations sur l'ouverture du fichier des permis de conduire et du fichier des immatriculations. Quels en sont les résultats ? S'ils sont positifs, comme on l'entend, quand sera-t-il possible d'étendre cette solution à d'autres villes ?
Enfin, il faut être extrêmement vigilant sur le transfert de forces de police qui, pour renforcer efficacement leur présence dans certains quartiers, viendraient à manquer dans d'autres, où pourraient, dès lors, migrer des trafics et d'autres délinquances. Aussi, je souhaiterais avoir des précisions quant au moment où arriveront les renforts d'effectifs au Havre, dans les quartiers de la Mare-Rouge et du Mont-Gaillard.

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur.
Comme vous le savez, madame la députée, le Gouvernement a fait de la sécurité une priorité. Cette action s'appuie notamment sur la police de sécurité du quotidien, renforcée, dans certains secteurs confrontés à des problèmes de délinquance particuliers, par les quartiers de reconquête républicaine. La ville du Havre bénéficie, à cet égard, d'un QRR dans les secteurs Mont-Gaillard et Mare-Rouge, et le dispositif monte en puissance.
Des patrouilles en VTT circulent depuis le 1er janvier, et une présence systématique de la police au sein des comités de quartier du QRR permet de renforcer le lien avec les habitants. Grâce aux délégués à la cohésion police-population, que vous avez mentionnés, les partenariats avec les associations et les particuliers s'intensifient : signature en janvier d'une convention avec l'association d'aide aux victimes AVRE 76 ; mise en place de groupes de partenariat opérationnel pour lutter contre les trafics de drogue dans les halls d'immeubles ou les rodéos urbains.
La police de sécurité du quotidien s'appuie également sur des moyens humains supplémentaires, avec des renforts nets d'effectifs. Ainsi, la circonscription de sécurité publique du Havre sera renforcée, tant pour la remettre à niveau, avec vingt-huit postes supplémentaires prévus, que pour assurer le plein déploiement du QRR, avec vingt postes supplémentaires. À partir du 17 juin 2019, pour en venir plus précisément à l'une de vos questions, dix policiers supplémentaires seront mobilisés, auxquels se joindront trente-huit autres dès le 1er septembre 2019.
S'agissant de l'accès des polices municipales aux informations contenues dans le fichier national des permis de conduire et dans celui des immatriculations, il fait l'objet, comme vous l'avez rappelé, d'une expérimentation engagée depuis le début de l'année 2019 dans onze communes volontaires, réparties entre neuf départements métropolitains. Certains policiers municipaux, après désignation individuelle par le maire et délivrance d'une habilitation par le préfet du département, ont pu consulter les données relatives aux permis de conduire.
En raison de contraintes techniques, ils n'ont pu accéder aux données relatives aux certificats d'immatriculation qu'un mois plus tard. À la suite de cette expérimentation, des travaux informatiques sont intervenus pour mettre en service une version évoluée du portail web à partir duquel s'effectue la consultation des deux fichiers. Son déploiement pourra donc intervenir – c'est en tout cas l'objectif – au mois de juin 2019 ; nous veillerons donc à l'assurer progressivement.
La mobilisation d'effectifs dans un certain nombre de territoires, vous avez raison, ne doit pas se faire au détriment d'autres territoires. De fait, le déploiement d'effectifs dédiés dans les quartiers de reconquête républicaine ne signifie nullement que l'on délaisse les autres quartiers. Je rappelle d'ailleurs que la cellule de lutte contre les trafics de stupéfiants, qui gangrènent nos quartiers, a vocation à travailler dans l'ensemble des départements où se trouvent les quartiers de reconquête républicaine.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, pour cette réponse très précise. Quarante-huit agents supplémentaires, je l'ai bien noté, arriveront dans le territoire, en deux vagues : dix agents le 17 juin, et trente-huit autres en septembre. Ancienne adjointe à la sécurité, je tiens à saluer l'importance et l'effectivité du travail de lien entre la police et la population au sein des QRR, autrefois appelés « ZSP » – zones de sécurité prioritaire. Le résultat en est la preuve.

La parole est à Mme Caroline Janvier, pour exposer sa question, no 739, relative à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour certaines communes du Loiret.

Je souhaite alerter sur la situation humaine et financière difficile des familles installées dans des communes du Loiret qui n'ont pas été reconnues en état de catastrophe naturelle à la suite du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols de l'été 2018. Nombreux sont les témoignages documentés de foyers qui constatent de lourdes dégradations, souvent irréversibles, de leurs habitations : affaissement et déstructuration des murs, fissuration grave, fentes traversantes laissant passer air et humidité, affaissement de dallages, huisseries ne fonctionnant plus. Certaines maisons sont soutenues par des étais afin d'éviter leur effondrement.
La situation de ces familles doit nous interpeller, car les réparations représentent des sommes si importantes qu'elles ne peuvent les engager elles-mêmes.
L'intensité anormale de l'agent naturel à l'origine des dégâts atteste pourtant pleinement du caractère exceptionnel de ces événements. En 2016, les communes du département du Loiret ont été touchées par d'importantes inondations, suivies, depuis 2017, d'épisodes de sécheresse significatifs. Pour les mois de septembre et d'octobre 2018, le déficit de pluie atteignait 82 %. Aussi, depuis le 12 octobre 2018, la préfecture du Loiret a-t-elle reconnu le cas de force majeure s'agissant de la sécheresse.
La non-reconnaissance de certaines communes, pourtant fortement touchées par ces phénomènes, nourrit un sentiment d'injustice et d'abandon. Ce statu quo ne saurait perdurer.
Une démarche de révision des critères mis en oeuvre par les ministres compétents en matière de sécheresse et de réhydratation des sols devait aboutir avant la fin de l'année 2018. Je souhaiterais, comme les nombreuses familles du Loiret concernées, savoir quelle pourra être l'issue des dossiers des foyers touchés dans les zones encore non reconnues.
Quel est, en outre, l'état des travaux visant à affiner les critères et les mesures afin de mieux cartographier les sinistrés et leur permettre d'être accompagnés par leurs assureurs ?

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur.
Un épisode de sécheresse-réhydratation des sols a touché le territoire métropolitain au cours du second semestre 2018. Pour le département du Loiret, 191 demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été déposées à ce titre.
Pour décider de la reconnaissance d'une commune en état de catastrophe naturelle, l'autorité administrative est tenue de se prononcer sur l'intensité anormale de l'agent naturel à l'origine des dégâts, et non sur l'importance de ceux-ci. La reconnaissance intervient seulement lorsque le caractère exceptionnel de l'événement est avéré au regard des critères en vigueur.
La démarche interministérielle visant à adopter de nouveaux critères en matière de sécheresse-réhydratation des sols a abouti : une circulaire exposant le contenu de la nouvelle méthodologie a été diffusée le 10 mai 2019 aux préfets de département.
Cette révision permet de prendre en compte, dans l'analyse des demandes communales, les informations techniques les plus pertinentes du point vue scientifique, en intégrant les progrès les plus récents réalisés par Météo-France en matière de modélisation hydrométéorologique. L'amélioration de cette modélisation permet une meilleure représentation des processus physiques régissant l'eau dans les sols.
La nouvelle méthode va ainsi permettre d'utiliser les connaissances scientifiques les plus récentes en mobilisant les outils de modélisation de Météo-France les plus performants ; de retenir les critères géotechniques et météorologiques scientifiquement les plus solides pour caractériser l'intensité d'un épisode de sécheresse des sols tout en s'assurant de leur lisibilité par les sinistrés ; de mieux caractériser les épisodes de sécheresse-réhydratation des sols sur les périodes automnale et hivernale ; de raccourcir significativement, ce qui répond à votre question, les délais d'instruction des demandes communales grâce à l'adoption d'un critère météorologique pouvant être mis en oeuvre au cours d'une année civile.
Ces nouveaux critères sont utilisés dès cette année pour analyser les demandes au titre de l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols de l'année 2018. L'instruction effective des 4 271 dossiers déposés en France métropolitaine a débuté en mois de mai 2019. Les services de l'État sont mobilisés afin que l'essentiel des demandes soit traité d'ici à l'été.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, pour ces précisions. Je suivrai donc avec attention les 191 demandes émanant du Loiret, espérant que, d'ici à cet été, les familles concernées obtiendront des réponses très précises.

La parole est à Mme Véronique Hammerer, pour exposer sa question, no 740, relative à l'expérimentation de méthanisation par mélanges de boues.

Le 1er février 2018, M. Nicolas Hulot a lancé un groupe de travail sur la méthanisation qui avait vocation à définir des orientations politiques et des mesures de nature à favoriser le développement de cette filière. C'est ainsi qu'a émergé l'objectif d'accélérer les projets de méthanisation en vue de « faire baisser les coûts de production et de développer une filière française ».
Cette proposition s'appuie sur plusieurs moyens, parmi lesquels la généralisation de la méthanisation des boues de grandes stations d'épuration et l'élargissement des gisements pour la méthanisation. Selon le dossier de presse à l'appui de ce projet, le potentiel méthanogène de ces boues est important en ce qu'elles représentent un fort gisement. Le même document indique que « les mélanges d'intrants deviendront donc possibles parce qu'ils sont nécessaires à la bonne performance de la méthanisation mais seulement dans des conditions de sécurité renforcées pour les terres agricoles en cas d'épandage du digestat ».
Pourtant, certaines structures volontaires pour développer ce type de méthanisation n'obtiennent pas les autorisations nécessaires. Pour ma part, je suis convaincue que des expérimentations obéissant à la fois au principe de précaution et à des critères précis nous permettraient d'adopter un positionnement clair sur le sujet.
La station d'épuration de Porto, du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Cubzadais-Fronsadais, qui se trouve dans ma circonscription, est l'initiatrice d'un projet de méthanisation ambitieux susceptible d'alimenter 300 foyers. Situé sur un territoire dépourvu d'autres méthaniseurs concurrentiels, il fonctionnerait par approvisionnement local en biodéchets, avec un taux maximal défini. Ces critères, ajoutés à l'obligation de contrôle des méthaniseurs, à un encadrement et à une autorisation du retour au sol via un plan d'épandage, permettraient d'expérimenter en toute sécurité la méthanisation par mélange des boues avec des intrants.
Je partage l'idée que la nécessaire transition écologique et solidaire doit s'appuyer sur des solutions locales et respectueuses du principe de précaution. En la matière, l'expérimentation permet, me semble-t-il, l'innovation. C'est pourquoi je souhaite connaître le cadre expérimental et territorial que le ministère entend mettre en place pour permettre à la méthanisation de contribuer à la diversification du mix énergétique.

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Madame la députée, vous appelez fort justement mon attention sur les difficultés que rencontrent certains porteurs de projets de méthaniseurs qui souhaitent pouvoir les alimenter en mélangeant des déchets alimentaires produits par les ménages et des boues de station d'épuration.
La méthanisation est, vous l'avez rappelé, une filière prometteuse aux bénéfices multiples, tant en termes environnementaux que de création d'emplois. La production de biogaz doit effectivement prendre une part importante dans la transition énergétique, en s'appuyant notamment sur l'obligation de généralisation du tri à la source des biodéchets, qui a été avancée à la fin 2023 par la révision de la directive-cadre européenne relative à la gestion des déchets. Ces biodéchets présentent, en effet, un potentiel de valorisation élevé. Leur tri à la source est donc indispensable pour une valorisation sous forme de méthanisation puis de réutilisation comme fertilisant de qualité élevée. En conséquence, la filière dispose à la fois d'un soutien fort de la part du Gouvernement et d'un cadre réglementaire adapté à ses enjeux.
À la suite des travaux, que vous avez rappelés, du groupe de travail sur le développement de la méthanisation lancé par Nicolas Hulot et successivement repris par Sébastien Lecornu puis moi-même, le Gouvernement a acté, au début de cette année, des orientations portant sur les mélanges en amont de la méthanisation, qui tiennent compte des retours de l'ensemble des parties prenantes concernées. Il en ressort que le mélange de boues issues de différentes stations d'épuration sera rendu possible alors qu'il est interdit à ce jour, sauf dérogation préfectorale, souvent obtenue au terme d'une procédure administrative trop lourde.
Il est également prévu de faciliter le mélange de ces boues avec d'autres déchets organiques similaires issus de l'assainissement, qui représentent un potentiel de développement de la méthanisation non négligeable. Cette mutualisation facilitée entre plusieurs stations d'épuration permettra, en outre, de contribuer à la diversification des ressources de production d'énergies renouvelables.
Cependant, le mélange de boues issues de stations d'épuration urbaines avec des biodéchets n'apparaît pas pertinent au regard de la montée en puissance d'une filière autonome des biodéchets, qui permet un usage de qualité, présente des garanties plus élevées en matière de prévention des pollutions et donc une valeur économique accrue des digestats qui en sont issus. C'est d'ailleurs pour ces raisons que la nouvelle directive-cadre européenne sur les déchets de 2018 interdira de tels mélanges d'ici à quelques années.
Il n'apparaît donc pas pertinent de permettre l'émergence de projets de méthanisation dont le modèle économique serait uniquement basé sur le mélange de boues de stations d'épuration et de biodéchets alors que cette pratique sera, à terme, proscrite au niveau européen. En revanche, tout projet de méthanisation fondé essentiellement sur des boues de stations d'épuration ou lié à une activité agricole peut être soutenu.

Madame la secrétaire d'État, je vous remercie pour votre réponse. J'aurais aimé que l'on puisse expérimenter ce procédé, mais je comprends que l'on prend le chemin de l'impossibilité de mélanger intrants et boues. Je le regrette vivement, car la station de Porto, dans ma circonscription, aurait pu disposer d'un outil très intéressant en portant ce type de projet. J'en prends acte.

La parole est à M. Rodrigue Kokouendo, pour exposer sa question, no 743, relative à la gestion des déchets des travaux du Grand Paris.

Je souhaite appeler l'attention du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur la question des déchets dans le cadre des travaux du Grand Paris et de ceux des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Ce sont, en effet, plus de 40 millions de tonnes de déchets inertes que vont générer les 300 chantiers du Grand Paris et ceux des infrastructures des Jeux olympiques.
La Seine-et-Marne, qui dispose d'infrastructures de stockage et de traitement des déchets performantes, reçoit aujourd'hui plus de 80 % de ces déchets non dangereux liés aux activités économiques produits en Île-de-France. En raison d'une « limite aux capacités annuelles d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes » prévue par le code de l'environnement, en 2020, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne doit pas être supérieure à 70 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010. En 2025, elle ne doit pas être supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage également en 2010.
Ces chantiers exceptionnels nécessitent donc d'importantes capacités de stockage complémentaires, ce qui contrevient à la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Aussi, je m'inquiète de savoir comment ces déchets pourront être régulièrement traités. Sachant que les capacités des centres de stockage sont limitées, et que des limites réglementaires ou des refus administratifs pas toujours bien motivés font obstacle aux demandes d'extension, on peut craindre une forte augmentation des déchetteries sauvages.
J'aimerais donc savoir comment la gestion de ces déchets, sous ses aspects financiers et territoriaux, a été organisée.

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur le député, vous avez interrogé M. François de Rugy : ne pouvant être présent, il m'a chargée de vous répondre.
Votre question porte sur les déchets issus des deux projets majeurs que sont la réalisation du Grand Paris Express et l'accueil par la France des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, et leur impact sur les capacités de stockage des déchets non dangereux.
Je suis très sensible aux enjeux de gestion des déchets sur nos territoires. Le modèle linéaire « fabriquer, consommer, jeter » se heurte à l'épuisement des ressources de la planète et à l'accroissement des impacts sur nos écosystèmes et sur nos concitoyens. Il convient donc de changer de modèle et d'améliorer la performance de nos systèmes de collecte et de traitement des déchets, au quotidien, mais également lors de la tenue d'événements exceptionnels tels que les Jeux olympiques de 2024.
Tout d'abord, la gestion des déchets du Grand Paris est un sujet dimensionnant du projet, dont la Société du Grand Paris a bien mesuré les enjeux. Aujourd'hui, la très grande majorité des déchets générés sont des déblais pouvant faire l'objet d'une valorisation dans le cadre de projets d'aménagement ou de comblement de carrières en Île-de-France ou dans des régions limitrophes ou, à défaut, être admis en installation de stockage de déchets inertes. L'envoi des déchets restant en installation de stockage des déchets non dangereux doit, par conséquent, rester l'exception.
De leur côté, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 sont pensés et prévus dès l'origine pour être exemplaires sur le plan environnemental. Mes services travaillent aux côtés de la direction de l'excellence environnementale du Comité d'organisation des Jeux olympiques afin d'anticiper les spécificités d'un tel événement et d'accompagner le déploiement de solutions innovantes.
S'agissant de la mise en place des infrastructures, les déchets de chantier devront être réduits au strict minimum grâce à un travail de prévention. Ainsi, dans son dossier de candidature, le pétitionnaire s'est-il volontairement engagé à recycler 95 % des déchets générés, ce qui va au-delà des 70 % imposés par la réglementation.
Enfin, en ce qui concerne la gestion des déchets résultant de la fréquentation exceptionnelle lors de la tenue des Jeux, je serai, avec le ministre d'État, particulièrement attentive à ce que les solutions mises en oeuvre minimisent la production de déchets à la source et évitent le gaspillage alimentaire, et à ce qu'un tri à la source systématique soit instauré.

Je remercie le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, ainsi que vous-même, madame la secrétaire d'État, pour l'intérêt que vous portez au traitement des déchets. Tout ce qui touche à l'écologie et à l'environnement devenant primordial, nous espérons que ces dossiers seront traités comme il se doit.

La parole est à M. Jacques Cattin, pour exposer sa question, no 746, relative à la concession hydro-électrique du lac Noir d'Orbey.

Par arrêté préfectoral du 20 avril 2009, l'État a accordé à Électricité de France – EDF – le renouvellement, pour cinquante ans, de la concession pour l'exploitation des ouvrages hydrauliques et de la station de transfert d'énergie par pompage entre le lac Blanc et le lac Noir, situés sur le ban de la commune d'Orbey dans le Haut-Rhin. Cette concession prévoit, dans ses articles 4 et 10, l'obligation pour le concessionnaire de produire de l'énergie dans un délai maximal de cinq ans après approbation du projet par les services de l'État. La nouvelle usine devait ainsi pouvoir redémarrer en 2019.
Le concessionnaire, après avoir démoli l'ancienne usine hydro-électrique située au lac Noir, a, semble-t-il, renoncé à son projet de remise en service. Cette information donnée verbalement par l'ancien secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique lors d'une de ses visites en Alsace, n'a depuis pas été confirmée par les services de l'État. La question de l'annulation de la concession accordée à EDF et de sa remise en concurrence selon les règles du droit européen reste donc posée. L'ancien secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique avait pris l'engagement, devant le comité de pilotage de fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, de relancer le dossier, sans résultat concret à ce jour.
Se pose également la question de l'indemnisation des collectivités locales concernées dans cette affaire. De fait, les pertes de recettes fiscales liées à ce projet sont importantes, de l'ordre de 1,3 million d'euros par an. La responsabilité de l'État, qui tarde à faire appliquer une loi le contraignant à annuler la concession accordée à EDF, et à lui demander de l'indemniser ou, à défaut, de lui remettre une installation fonctionnelle, comme le prévoit l'acte de concession, est clairement engagée.
Aussi, je souhaite connaître la suite que l'État va donner à ce dossier, l'intérêt de la commune d'Orbey et de la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg étant clairement en jeu. À une échelle plus large, pour le département du Haut-Rhin, déjà très affecté par la fermeture prochaine de la centrale nucléaire de Fessenheim, le report ou l'abandon de ce projet lié aux énergies renouvelables constituerait un préjudice d'autant plus important.

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Je tiens tout d'abord à rappeler notre attachement à l'hydro-électricité, première source d'électricité renouvelable, énergie compétitive et importante pour le système électrique par sa flexibilité et pour les territoires. Le développement de capacité de stockage de l'électricité sous la forme de stations de transfert d'énergie par pompage – STEP – constitue un enjeu majeur.
En ce qui concerne la concession hydroélectrique du lac Noir, la centrale d'origine a été construite entre 1928 et 1933. À la suite de plusieurs accidents, l'ancienne centrale a été définitivement mise à l'arrêt en 2002. La concession actuelle a été attribuée en 2009. Le concessionnaire a déjà engagé d'importants travaux sur le site pour la rénovation des prises d'eau et l'enlèvement des anciens bâtiments devenus inutilisables.
Aujourd'hui, le concessionnaire considère que le projet de 2009 n'est plus en phase avec les évolutions du contexte économique de la production hydroélectrique et ne présente pas de rentabilité avérée. Afin de pouvoir relancer le site, et conformément aux engagements pris par le Gouvernement dans le cadre du comité de pilotage en lien avec la fermeture de la centrale de Fessenheim, nous souhaitons qu'un nouveau projet hydro-électrique puisse y voir le jour.
Le lancement d'un nouveau projet nécessite néanmoins, au préalable, le désengagement du concessionnaire actuel. Dans ce but, et afin d'éviter une situation de blocage durable, j'ai engagé des discussions avec EDF pour déterminer les conditions de résiliation amiable de cette concession. Ces discussions arrivent à leur terme et aboutiront sous forme d'un protocole d'accord dans lequel l'État souhaite qu'EDF s'engage sur les points suivants : assurer la surveillance et l'entretien du site après la résiliation de la concession jusqu'à ce qu'un nouveau projet soit défini ; transférer à l'État les études réalisées sur le projet actuel afin d'accélérer le lancement d'un nouveau projet ; indemniser les collectivités au titre du manque à gagner des recettes fiscales, qui a été évalué à 3,07 millions d'euros.
Les services de l'État en région prendront prochainement contact avec la commune d'Orbey et la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg afin de leur présenter les modalités de cette résiliation et celles du lancement d'une nouvelle concession. Dès que ces discussions auront abouti, nous relancerons une nouvelle concession sur ce site afin de contribuer au développement de la première source d'électricité renouvelable en France.

Je vous remercie pour votre réponse qui était attendue, madame la secrétaire d'État. J'espère qu'une suite y sera donnée.

La parole est à Mme Clémentine Autain, pour exposer sa question, no 730, relative au terminal 4 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.

Cent vingt-six millions de passagers, c'est ce que prévoit d'accueillir l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à l'horizon 2037, une fois que le terminal 4 sera achevé. C'est le double du trafic actuel, pourtant déjà considérable, ce qui pose la question de la volonté politique du Gouvernement en matière de développement du territoire mais aussi de lutte contre le dérèglement climatique.
Le projet de terminal 4 est déjà bien avancé puisque, d'après Aéroports de Paris – ADP – , les travaux débuteront dès 2021. Or, à ce stade, l'information et le débat démocratique avec les habitants sont bien peu de chose – et c'est un euphémisme. J'en veux pour preuve la réunion publique qui s'est tenue à Villepinte en avril dernier et qui a réuni – tenez-vous bien ! – six participants. Ce défaut de concertation pose évidemment un problème démocratique de taille, alors que le sujet est crucial.
Le développement du transport aérien à une telle échelle impose, en effet, un minimum de réflexion sur des enjeux environnementaux, sanitaires, de formation et de qualité des emplois. On parle de 40 000, 45 000, voire 50 000 emplois qui seraient créés. Il est difficile d'avoir une vision claire : combien d'emplois et lesquels ? L'argument de la dynamique économique pour le territoire est évidemment à considérer avec intérêt. Reste que les conditions de travail et la sous-traitance préoccupent d'ores et déjà les salariés, et le déficit de formation de notre territoire empêche l'accès d'un grand nombre d'habitants à ces opportunités. C'est d'ailleurs pourquoi je défends, depuis plusieurs années, la création d'un pôle universitaire, juste au-dessous de Roissy, au Nord-Est de la Seine-Saint-Denis.
Dans le même temps, l'enjeu environnemental me paraît totalement mis sous le boisseau alors qu'il est au coeur des mobilités de demain. Doubler le nombre de passagers, c'est démultiplier le trafic et les nuisances qu'il occasionne. De nombreuses questions restent sans réponse, tant pour les élus que pour les habitants concernés alors que la taille du futur terminal 4 sera supérieure au seul aéroport d'Orly en nombre de passagers. C'est donc bien la vision du développement du territoire – environnement, démocratie, dynamisme économique – qui est en jeu.
Pourquoi attendre 2023 pour l'application des descentes continues d'avion, qui devraient réduire les nuisances sonores ? À quand une étude d'impact sérieuse et indépendante sur la santé des riverains de ces super-aéroports ? Surtout, à quand un vrai débat public et démocratique sur ce projet majeur pour toute la région Île-de-France ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Élisabeth Borne, ministre auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, ne pouvant être présente, elle m'a chargée de vous répondre.
Je souscris pleinement à la nécessité d'échanges sur les projets les plus importants à l'échelle régionale ou nationale, comme celui du terminal 4 de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Les investissements d'ADP sont menés au rythme de l'augmentation du trafic et dans le respect des contraintes environnementales encadrant l'activité de l'aéroport. Face à la saturation de certains terminaux aux heures de pointe, le groupe ADP a lancé le projet de réalisation d'un nouveau terminal – « T4 » – pour répondre à la demande de trafic au-delà de 2028. Le calendrier de construction prévoit un début des travaux en 2021 et un phasage du projet par modules de capacité avec une mise en service totale en 2037. Dans sa phase d'exploitation, le T4 pourrait représenter jusqu'à 50 000 nouveaux emplois directs, alors que l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle est le siège de 90 190 emplois directs en 2016 et d'environ 1 240 entreprises.
Je ne partage pas votre opinion sur la concertation publique qui s'est déroulée de mi-février à mi-mai. Bien que non soumis à une obligation d'organisation d'un débat public, ADP a souhaité soumettre le projet à un processus de concertation publique dont la Commission nationale du débat public – CNDP – a approuvé les modalités, le calendrier et le dossier support. ADP a également pris en compte les éléments de cadrage de l'Autorité environnementale. Ainsi, le périmètre initial de la concertation a notamment été élargi et un volet santé ajouté.
Dix réunions publiques et quatre ateliers thématiques publics ont été organisés, de même que des ateliers ou cafés et stands participatifs. Un site internet a été ouvert et plusieurs supports d'information distribués. Les services du ministère des transports ont participé à plusieurs réunions publiques et se sont coordonnés avec ADP tout au long de la concertation. Il appartient désormais à ADP de prendre en compte l'ensemble des contributions reçues ; la CNDP s'en assurera.

Je tiens à souligner la faiblesse de la réponse sur le choix stratégique d'ouvrir ce terminal et donc d'accroître le trafic à Roissy. Nous devons, en effet, obtenir une réponse du Gouvernement sur l'opportunité de créer le terminal 4. Je vous rappelle que notre territoire est déjà censé accueillir des projets comme EuropaCity, au triangle de Gonesse, avec des centres commerciaux, des hôtels – bref, encore un projet consumériste et menant à une hyper-densification – , ou encore une vague de surf artificielle à Sevran, sans parler du Charles-de-Gaulle Express et des problèmes qui continuent d'affecter la ligne du RER B en attendant sa construction. Tout cela est révélateur d'un enjeu de développement de notre territoire à propos duquel je n'ai pas entendu de réponse du Gouvernement : quelle est donc la véritable opportunité de ce choix stratégique pour la région Île-de-France ?
Ensuite, en ce qui concerne le débat démocratique, j'entends bien qu'il est difficile de le mener.

Je n'entends pas minimiser les efforts déjà réalisés mais force est de constater que sur des questions aussi importantes, il n'y a pas de débat politique et démocratique.

La parole est à M. Pierre-Henri Dumont, pour exposer sa question, no 745, relative à l'effondrement d'habitations à Oye-Plage.

Dans la commune de Oye-Plage, à la frontière du littoral entre le Nord et le Pas-de-Calais, des centaines de maisons se fissurent et personne ne sait pourquoi. Le maire de la commune vous a écrit, comme il avait écrit à vos prédécesseurs, sur ce sujet. Je vous ai moi-même écrit, comme j'avais écrit à vos prédécesseurs. Pourtant, aucune réponse concrète ne nous est parvenue et les Ansériens vivent dans l'angoisse et la crainte de voir leur maison s'effondrer. Ce sont les habitations de 120 ménages, réparties dans un rayon de 3 kilomètres, qui sont concernées par ces fissures ; 120 couples qui ont travaillé toute leur vie pour s'acheter une maison et qui voient leurs économies s'évaporer à mesure que les fissures lacérant leurs murs s'agrandissent, rendant leur bien invendable, inhabitable.
Ces habitants, réunis en association, ne peuvent plus attendre que l'État, muet, se défausse, une fois de plus. Par trois fois, l'état de catastrophe naturelle demandé n'a pas été accordé. Aujourd'hui, ils veulent des réponses concrètes à leur malheur, malheur qui détruit leur moral, leur santé, leur vie et pas simplement leurs habitations.
Les acteurs locaux pointent du doigt l'exploitation d'une gravière de sable à proximité immédiate de la zone touchée. Depuis 1989, ce sont 2 millions de mètres cubes qui en ont été extraits. Beaucoup pensent que cette gravière est alimentée par des veines de sable pissard, sable qui a la particularité de toujours revenir au même niveau lorsqu'on l'extrait. Cette gravière serait donc alimentée, au fur et à mesure de son extraction, par du sable des alentours, par exemple du sable qui proviendrait de sous les fondations des maisons fissurées, fondations qui reposeraient donc, dorénavant, sur du vide. Les victimes ansériennes veulent savoir pourquoi leur maison se fissure, et l'hypothèse de l'impact de la gravière sur cette catastrophe ne peut être validée que par une étude du Bureau de recherches géologiques et minières – BRGM.
J'ai deux questions : allez-vous accorder au BRGM les fonds nécessaires pour lancer une étude à Oye-Plage afin de comprendre cette situation de péril et ainsi infirmer ou confirmer l'hypothèse de la responsabilité de la gravière ? Que proposez-vous aux propriétaires des biens atteints par ces fissures pour compenser leur perte financière ?

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Vous avez appelé l'attention du Gouvernement sur la situation de certains logements dans la commune de Oye-Plage, dans le Pas-de-Calais, situés à proximité d'une exploitation de carrière de sable, qui ont subi des dommages importants.
Vous m'interrogez sur les possibles liens de causalité entre cette carrière et les dommages. Je tiens à préciser que ce dossier est connu de longue date des services de l'État dans le Pas-de-Calais. Ces derniers ont réuni, à de très nombreuses reprises, les différents protagonistes pour tenter de trouver l'origine des troubles, rechercher une solution particulière pour certains citoyens en grande difficulté, mettre en oeuvre des outils de surveillance de l'évolution des dommages ou accompagner les acteurs locaux dans le montage de dossiers de reconnaissance de catastrophe naturelle.
Au début du mois d'avril 2019, le sous-préfet a réuni ses services pour identifier la faisabilité d'une nouvelle étude complète qui intégrerait une étude des sols au droit des maisons les plus impactées, analyserait les caractéristiques géotechniques des sables, et approfondirait les recherches d'une éventuelle causalité entre l'activité de la carrière et les dommages. Un échange a ensuite eu lieu, la semaine dernière, entre les services de l'État et les collectivités, mairie et communauté de communes. Les différentes études et expertises, qu'elles aient été commanditées par l'État ou dans le cadre des procédures judiciaires engagées, n'ont pas permis, à ce stade, d'établir de lien de causalité entre l'exploitation de la carrière et les dommages causés aux maisons.
Ainsi, l'origine identifiée des dommages pendant les premières années pourrait être naturelle en raison de l'évolution de la nappe phréatique et du défaut de structure de certaines habitations. En revanche, s'agissant des dégâts ayant débuté à partir des années 2000, l'origine de la modification de l'état géologique du sous-sol n'a pu être établie à l'heure où je vous parle, et les incertitudes restent importantes.
L'autorisation d'exploitation de la carrière arrive à échéance en mai 2020, et les six derniers mois seront consacrés à sa remise en état. Le sous-préfet de Calais a rappelé ses obligations à l'exploitant, au mois de décembre dernier, ainsi que les échéances prévues. Par ailleurs, la dernière inspection, réalisée au mois d'octobre 2018, par l'inspection des installations classées de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement – DREAL – Hauts-de-France n'avait pas mis en évidence de non-conformité.
Dans le cas où elle déterminerait l'origine des troubles causés aux habitations, la nouvelle étude permettrait de résoudre le problème de la perte de capital immobilier des propriétaires des maisons endommagées. En effet, soit l'origine anthropique est identifiée, et la responsabilité de l'exploitant sera alors engagée, soit l'origine naturelle est identifiée, et il conviendra, dans ce cas, de reconduire une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle. Comme vous le constatez, les services de l'État se sont fortement mobilisés pour trouver une solution, et ils le sont toujours.
À dix heures trente, M. Hugues Renson remplace M. Sylvain Waserman au fauteuil de la présidence.

Qu'on soit bien d'accord sur le problème : des maisons construites depuis près d'un siècle, qui n'ont jamais bougé avant l'exploitation de la gravière, ont commencé à se fissurer dès le début de son exploitation. D'où mes deux questions essentielles. Le BRGM sera-t-il mandaté pour effectuer les études et, si oui, à quelle échéance ? Que les dégâts aient été causés par la gravière ou par des phénomènes plus naturels, les habitants se verront-ils tous proposer une solution, que ce soit le rachat de leur bien ou leur relogement ? À ces deux questions, qui me paraissent légitimes, je n'ai pas encore de réponse, et que dire des habitants qui les attendent depuis de très nombreuses années et vivent dans l'angoisse de ne pas savoir de quoi leur avenir sera fait.

La parole est à Mme Aude Bono-Vandorme, pour exposer sa question, no 733, relative à la médecine du travail des personnels de l'éducation nationale.

Je souhaite appeler l'attention du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la santé des personnels relevant de son ministère. En tant qu'employeur, il est tenu de prendre toutes les mesures afin de les protéger tout au long de leur carrière, ce à quoi, je le sais, il est attaché.
Malgré la mise en place de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, depuis 2011, la médecine de prévention pour les personnels enseignants reste une mission difficile à remplir en raison d'une pénurie de médecins de prévention – on compte un médecin pour 15 000 enseignants – , de la vétusté des locaux, voire des matériels médicaux, et d'un manque de moyens de fonctionnement.
La médecine du travail se doit pourtant d'organiser une visite médicale tous les cinq ans pour les agents de l'éducation nationale, comme le prévoit le décret no 95-680 du 9 mai 1995. Cette obligation n'est pas ou plus remplie et, souvent, sur une carrière entière, la seule visite est la visite d'aptitude, effectuée au moment du recrutement. Pourtant, prévenir les dangers et garantir aux enseignants un réel suivi médical est un élément essentiel du bien-être au travail. Il est de la responsabilité de l'employeur de s'assurer du bon état de santé de ses agents et de leur capacité à encadrer au mieux des classes de vingt à trente enfants.
La situation est donc préoccupante pour les enseignants eux-mêmes, mais aussi pour les élèves, a fortiori pour les plus jeunes, qui seront d'ailleurs de plus en plus nombreux avec la future obligation de scolarisation des enfants à partir de trois ans.
Aussi, j'aimerais que le ministre puisse nous fournir un bilan relatif à la surveillance médicale des agents de son ministère, et indiquer les mesures qu'il compte prendre en la matière, avec la détermination à oeuvrer pour eux qu'on lui connaît.

La parole est à M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Vous posez une question très importante, et je souscris à tout ce que vous avez dit. La médecine de prévention est, pour moi, un sujet de préoccupation, d'autant que nous partons d'une situation négative.
La difficulté de recruter des médecins de prévention n'est pas spécifique à l'éducation nationale. Tous les ministères sont confrontés à une situation que connaît aussi le monde de l'entreprise. Elle s'explique par le fait que les médecins qualifiés en médecine du travail sont en nombre insuffisant pour couvrir les besoins. La démographie médicale est telle qu'il est difficile d'identifier le nombre des médecins de prévention disponibles, au moins à court terme.
C'est la raison pour laquelle nous avons engagé des actions destinées à doter l'ensemble des académies de services de médecine de prévention au sein desquels il est fait appel à différents professionnels de santé : médecins de prévention, infirmiers en santé au travail, psychologues du travail. On recense actuellement dans les académies quatre-vingt-sept médecins de prévention, neuf collaborateurs médecins, vingt-quatre psychologues du travail et vingt et un infirmiers en santé au travail.
Pour améliorer la couverture en médecins de prévention de toutes les académies et rendre plus attractives les fonctions de médecin de prévention, les recteurs d'académie ont la possibilité de fixer leur rémunération par référence à la grille applicable aux médecins du travail des services interentreprises de médecine du travail, dite grille PRESANSE, voire de proposer une rémunération supérieure à cette grille dans les zones de désert médical ou lorsque le poste de médecin de prévention est resté vacant depuis plus d'un an.
Par ailleurs, nous encourageons l'accueil, au sein des services de médecine de prévention, de collaborateurs médecins. Ce dispositif est destiné à recruter des médecins non qualifiés en médecine du travail auxquels est proposée une formation universitaire qui leur permet d'acquérir cette qualification. Il permet aussi de soutenir le travail des médecins de prévention existants.
De plus, pour aider les recteurs d'académie à recruter davantage de médecins de prévention et à les accompagner tout au long de leur parcours professionnel au sein des services de l'éducation nationale, une circulaire ministérielle encourage à constituer, autour des médecins de prévention, des équipes pluridisciplinaires afin de participer au suivi médical des personnels.
Enfin, nous venons d'éditer un guide méthodologique dédié aux infirmiers en santé au travail leur permettant de réaliser, sous le contrôle des médecins de prévention, des entretiens infirmiers. Ce guide est en cours de diffusion dans toutes les académies. La réalisation de ces entretiens participera directement au renforcement du suivi médical des personnels.
Ce dispositif s'inscrit pleinement dans la continuité du plan d'action pluriannuel du 28 mars 2017 pour une meilleure prise en compte de la santé et la sécurité au travail, arrêté par le ministère chargé de la fonction publique, et des orientations stratégiques ministérielles de l'éducation nationale en matière de politique de prévention des risques professionnels.
Je suis, évidemment, de très près cette question qui va de pair avec tout ce que nous faisons en matière de bien-être au travail, comme les actions volontaristes que nous engageons en relation avec les mutuelles afin d'accompagner nos enseignants. C'est là un des sujets qui doivent donner lieu à progrès dans les prochaines années, à travers la gestion des ressources humaines de proximité actuellement mise en place par la direction des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale.

La parole est à Mme Blandine Brocard, pour exposer sa question, no 741, relative à la mise sous contrat des établissements accueillant des élèves handicapés.

Si notre majorité a exprimé le désir profond que l'école soit un lieu inclusif, ouvert à tous et permettant à chacun d'acquérir les clés lui permettant de construire son avenir et de devenir une femme ou un homme autonome et responsable, force est de constater qu'en ce qui concerne l'inclusion des élèves en situation de handicap – et alors que les besoins vont croissants – , notre République a, aujourd'hui comme hier, de très grandes difficultés à accueillir tous les enfants concernés. Ce qui est déjà vrai pour l'école élémentaire l'est encore davantage pour le collège ou le lycée.
Je n'ignore pas tous les efforts aujourd'hui consentis par le Gouvernement pour tenter de rattraper notre retard en matière d'unités adaptées. Cependant, malgré les ULIS – unités locales d'inclusion scolaire – , les UEE – unités d'enseignement externalisées – ou les UEMA – unités spécialisées dans l'autisme – , nous savons bien que ce rattrapage demandera encore de très nombreuses années.
Permettez-moi de conter l'histoire d'un homme extraordinaire qui, confronté au handicap de sa fille de 13 ans et aux années d'attente que le manque de places en établissement spécialisé lui promettait, a décidé, avec d'autres parents, de prendre les choses en main. De leur persévérance est né le collège NESCENS. Dans le département du Rhône, cet établissement privé hors contrat accueille, à partir de 12 ans, les enfants qui présentent des troubles intellectuels et cognitifs légers ou moyens, et peut les mener à l'autonomie et l'insertion professionnelle. Des professeurs de l'éducation nationale spécialisés dans les questions de handicap vont y intervenir ainsi que du personnel soignant. Des fonds ont été réunis, et des locaux ont été aménagés. L'académie a autorisé l'ouverture de l'établissement, et j'ai pu assister, il y a quelques jours, à ses premières portes ouvertes.
Pourtant, malgré le soutien plein et entier du rectorat à cette expérimentation, cet établissement ne peut, à ce jour, signer de contrat avec l'État qu'au terme de cinq longues années, parce que telle est la règle actuelle. L'inspectrice concernée ainsi que la rectrice ont estimé qu'une seule année d'exploitation devrait permettre de mener les évaluations nécessaires avant de faire de NESCENS un établissement sous contrat.
Monsieur le ministre de l'éducation nationale, je connais votre engagement à l'endroit des enfants en situation de handicap, et vous connaissez le soutien de notre assemblée à la cause de ces enfants. Ne pourrions-nous pas envisager un critère « handicap » spécifique, qui permettrait, tout en contrôlant, bien sûr, les établissements concernés, de soutenir ce type d'initiative en ramenant à un an le délai avant la signature d'un contrat ? Une telle possibilité permettrait au rectorat de déroger à la procédure classique sans créer une distorsion vis-à-vis d'autres établissements.

La parole est à M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Madame la députée, je vous remercie de tout ce que vous avez dit sur les enjeux majeurs que constitue l'école inclusive, pour laquelle nous pouvons nous permettre d'évoquer quelques éléments optimistes pour la rentrée prochaine.
À l'occasion de l'examen du projet de loi pour une école de la confiance, j'ai eu l'occasion de présenter la véritable transformation de notre système. Dès le mois de septembre prochain, il proposera des statuts plus favorables pour les personnels accompagnants, la création de postes supplémentaires, des contrats bien meilleurs que les contrats précaires antérieurs, une formation plus forte, et une préparation davantage en amont de la rentrée du lien avec les familles. Tous ces éléments doivent aboutir à un véritable service public de l'école inclusive que nous voulons construire.
Ce service public de l'école inclusive n'exclut pas les écoles privées sous contrat qui peuvent participer à ce service public. Avec ma collègue Sophie Cluzel, nous avons organisé, à partir du mois d'octobre 2018, une concertation intitulée : « Ensemble pour une école inclusive ». Dans les conclusions rendues au mois de février dernier, ce type de question a, bien évidemment, été abordé, comme il l'a été jeudi dernier, lors de la réunion que nous avons eue, avec Sophie Cluzel et tous les recteurs et dirigeants des agences régionales de santé, afin de préparer la rentrée de 2019.
En partant du projet exemplaire d'un habitant de votre circonscription, vous me demandez s'il serait possible d'assouplir la règle exigeant que, avant que l'État passe un contrat avec un établissement scolaire privé, celui-ci ait fonctionné pendant au moins cinq ans. Cet assouplissement serait justifié par le fait que l'établissement se spécialise dans la scolarisation d'enfants en situation de handicap.
Le code de l'éducation prévoit déjà un régime administratif particulier pour certains établissements scolaires privés, à la condition que l'ARS – agence régionale de santé – ait reconnu que ces établissements dispensent un enseignement adapté au handicap de leurs élèves. Si cette première condition est remplie, l'établissement peut alors solliciter de passer un contrat simple avec l'État, c'est-à-dire un contrat qui obligera l'établissement à organiser l'enseignement « par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public ». Ce contrat obligera aussi l'éducation nationale à rémunérer les enseignants de l'établissement. Comme le précise régulièrement le Conseil constitutionnel, pour ne pas contrevenir au principe d'égalité de traitement, seuls les établissements d'enseignement privés qui respectent les obligations du service public peuvent être aidés financièrement par les collectivités publiques. Cela va de soi.
S'agissant du projet que vous venez d'évoquer, celui qui en est l'initiateur a adressé à mes services un courriel, le 29 janvier dernier, confirmant qu'il accueillerait ses premiers élèves au mois de septembre 2019. Lorsque l'établissement aura ouvert, les services de l'État compétents localement, c'est-à-dire non seulement l'académie mais aussi l'ARS et le préfet, travailleront en pleine concertation pour trouver une solution qui soit la plus conforme à la fois aux intérêts des élèves de cet établissement et de leurs familles, à la réglementation en vigueur, et à la mise en oeuvre du principe de l'inclusion, encore réaffirmé récemment dans l'hémicycle.

Je vous remercie, monsieur le ministre, au nom de tous ces enfants et de toutes les familles qui attendent beaucoup. Ils ont vraiment besoin d'avoir accès à ce genre d'établissement dans le laps de temps nécessaire à la mise en place de l'école inclusive à laquelle je sais que vous travaillez beaucoup.

La parole est à M. Gaël Le Bohec, pour exposer sa question, no 744, relative à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Ma question s'adresse à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Après la phase d'écoute que fut le grand débat national, organisé à l'initiative du Président de la République, nous entrons dans la phase de prise de décisions, à partir des constats dressés. Est ressortie, en particulier, la nécessité de répondre aux préoccupations quotidiennes de nos concitoyens en donnant une place prépondérante à l'échelon des territoires ; communes, communautés de communes et régions doivent ainsi voir leurs prérogatives renforcées. Il s'agit aussi de rendre les pouvoirs publics plus agiles, plus efficaces.
En novembre dernier, j'ai adressé un courrier aux ministres concernés, faisant part de mon incompréhension s'agissant de la décision rendue par la Commission nationale d'aménagement commercial sur un projet d'implantation d'une grande surface alimentaire à Guignen, commune rurale de ma circonscription de près de 4 000 habitants. En juillet 2018, la direction départementale d'aménagement commercial avait rendu, à l'unanimité, un avis favorable à cette implantation, considérant le projet vertueux dans ses aspects de développement durable et d'insertion paysagère et architecturale. Quelques mois plus tard, le préfet abondait dans le même sens ainsi que la DDTM – la direction départementale des territoires et de la mer – , dont on connaît les exigences, notamment en termes de développement durable, le projet étant de surcroît soutenu par tous les élus locaux et par toute la population. Or, le 4 avril, à Paris, la Commission nationale d'aménagement commercial a mis un coup d'arrêt au projet, anéantissant neuf mois de travail résultant de différentes phases d'écoute et de concertation entre l'ensemble des acteurs locaux. Neuf mois de travail détruits par une instance nationale, écrasant ainsi les différents échelons locaux !
Par cette décision prise loin du terrain, c'est tout le développement et le dynamisme d'une zone rurale qui sont remis en cause. En l'espèce, certaines motivations semblent clairement descendre du jacobinisme, voire du centralisme parisien : « La desserte par les transports en commun ne peut être considérée comme assurée » – mais elle ne l'est pas pour la plupart des supermarchés en circonscriptions rurales !
Plus largement, à l'issue du grand débat national, quelles réponses peuvent être apportées pour que les instances locales ne se retrouvent plus dépossédées de leur pouvoir décisionnel ?
Vous abordez un sujet ô combien important : la territorialisation de nos politiques publiques. En matière d'aménagement du territoire, cette territorialisation est essentielle. Il s'agit bien de partir des projets définis par les territoires, pas d'imposer aux territoires des projets définis depuis Paris. Beaucoup a déjà été fait pour ce changement d'approche, notamment avec le dispositif Action coeur de ville, qui soutient vraiment des projets issus des territoires. À la sortie du grand débat, le Président de la République a appelé à un acte supplémentaire de décentralisation, ce qui montre à quel point le volet prépondérant reconnu aux territoires est important.
Vous m'interrogez sur le cas particulier de la position de la Commission nationale d'aménagement commercial sur un projet porté par la commune de Guignen. Il s'avère que la commission départementale d'aménagement commercial avait d'abord donné un avis défavorable en 2014, puis deux avis favorables. Ces avis ont donné lieu à des modifications du projet initial, notamment au regard de l'emprise foncière et du nombre de places de parking prévu. La direction départementale des territoires, service que je pilote, ainsi que la préfecture, vous l'avez rappelé, ont rendu un avis positif, tenant compte des modifications effectuées. Pour autant, et par trois fois, la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis négatif, tout en soulignant, néanmoins, les améliorations du projet. C'est qu'elle prend en considération d'autres critères que ceux de la DDT et de la commission départementale dans leur accompagnement des élus locaux – on voit là que les services déconcentrés sont bien dans une logique d'accompagnement des élus locaux. La commission nationale se réfère notamment aux dispositions du code de commerce, dans le souci, notamment, d'éviter une dévitalisation du centre-bourg – un autre objectif de notre politique d'aménagement du territoire, que chacun partage.
Cela dit, la commission départementale ou les porteurs du projet peuvent porter un recours pour comprendre la position de la commission nationale et voir comment faire avancer le dossier. Soyez assuré que mes services et ceux de la préfecture seront aux côtés des élus locaux pour avancer en ce sens.

La parole est à Mme Marietta Karamanli, pour exposer sa question, no 755, relative au contrat État-région Pays de la Loire Sarthe Le Mans.

Je souhaite appeler l'attention du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les projets et les programmes pris en compte par le contrat d'avenir conclu entre l'État et la région des Pays de la Loire, suite à l'abandon du projet de nouvel aéroport près de Nantes. Ce contrat, s'il inscrit des crédits en vue d'améliorer l'axe ferroviaire Nantes-Paris par l'installation d'une nouvelle signalisation et d'une protection de la ligne entre Nantes et Le Mans, laisse de côté la question des autres axes régionaux à partir du Mans. Ainsi, il ne prévoit que les travaux d'urgence sur la ligne Le Mans-Alençon, pour un montant de 3,8 millions. L'état actuel de cette ligne est dû à la corrosion des traverses soutenant la voie, ce qui conduit, depuis 2017, à décider de zones de ralentissement, augmentant d'autant la durée des trajets et diminuant les possibilités de rotation des matériels. Aucun crédit n'est inscrit en l'état pour une rénovation d'ensemble de la ligne, alors qu'elle dessert pas moins de trois régions : Pays de la Loire, Normandie et Centre-Val de Loire.
Parallèlement, au titre des investissements autoroutiers en Sarthe, le contrat ne fait que confirmer la réalisation du diffuseur de Connerré, dont la décision avait déjà été annoncée en 2017.
Enfin, concernant les activités de formation et de recherche nécessaires pour préparer l'avenir, je constate qu'aucun projet structurant n'a été retenu impliquant directement et durablement la recherche, l'innovation et les secteurs de pointe du département.
En conséquence, je souhaiterais, d'abord, que les travaux ferroviaires nécessaires à la revitalisation de l'axe Le Mans-Alençon, en direction de Caen et Tours, soient bien envisagés et réalisés ; ensuite, que des crédits soient programmés sur projets pour conforter la recherche, l'innovation et la formation sur les territoires manceau et sarthois, notamment dans les secteurs du numérique, des objets intelligents, de l'automobile de demain et des écosystèmes de mobilité. Il faut que la région des Pays de la Loire et l'État s'accordent sur ces priorités, qui sont nécessaires pour consolider l'attractivité du Mans et de la Sarthe. J'espère une réponse opérationnelle et porteuse d'avenir.
Vous interrogez le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le contrat d'avenir qui doit accompagner les Pays de la Loire, suite à la décision prise concernant le réaménagement de l'aéroport actuel. L'ambition portée par ce contrat relève, pour moi, de deux ordres : d'une part, des actions d'application immédiate, et, d'autre part, des actions à plus long terme pour développer les infrastructures de transport, notamment à l'échelle régionale et interrégionale. Outre le transport, j'insisterai sur trois défis que vous connaissez très bien : la transition numérique, le développement économique – que vous avez évoqué – et la transition écologique.
S'agissant du transport, pour la Sarthe, votre département, de multiples projets ont d'ores et déjà été confortés ou décidés au titre du contrat d'avenir. Je pense, en premier lieu, au renforcement des liaisons ferroviaires entre la Sarthe et la région parisienne, avec notamment deux engagements du Gouvernement : déployer, sur la ligne Nantes-Paris, le système européen de signalisation dit ERTMS2, issu du savoir-faire français auquel on tient tant et qui permettra d'augmenter le trafic ; faciliter l'accès des Sarthois aux aéroports parisiens, en renforçant la capacité et la robustesse de la ligne Massy-Valenton. Je pense, en deuxième lieu, à la fiabilisation des liaisons entre la Sarthe et Nantes, avec notamment la mise aux standards de protection LGV de la ligne ferroviaire existante – comme vous le savez, c'est un point essentiel.
Et puis, le contrat d'avenir prévoit de nouveaux engagements ferroviaires, notamment la rénovation de la ligne ferroviaire Le Mans-Alençon, qui n'était pas initialement prévue au contrat de plan. Des réflexions sont déjà engagées entre les régions concernées pour aller le plus loin possible en ce domaine, et je sais combien vous êtes attentive à ce que ces réflexions soient suivies d'actions concrètes.
Outre le transport, je voudrais mettre l'accent sur des points liés au développement économique, donc à l'attractivité – si tant est qu'il faille encore renforcer celle de votre beau territoire. Notre ministère a beaucoup oeuvré à l'accélération du déploiement du numérique et de la téléphonie mobile : plus de 140 nouveaux sites vont être installés sur la période 2019-2021. De surcroît, des villes de votre territoire sont incluses dans le plan Action coeur de ville, et la Sarthe comporte 3 des 141 territoires identifiés par le Gouvernement pour dynamiser les industries d'avenir. Quant à l'éducation, l'actuel plan État-région prévoit des crédits en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche, qu'il importe de bien utiliser pour développer ces secteurs dont vous avez souligné à très juste titre l'importance.

La parole est à M. Stéphane Testé, pour exposer sa question, no 734, relative au fonds de dotation pour l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques.

Ma question s'adresse à Mme la ministre des sports et porte sur l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, probablement le plus grand événement jamais organisé par notre pays dans toute son histoire. Ces jeux représentent une formidable opportunité, tant ils possèdent ce pouvoir unique de changer la société, d'accélérer le développement d'un territoire, de générer de l'activité économique et d'améliorer l'environnement.
Il faut saisir la chance de cette dynamique exceptionnelle pour construire une société plus durable, plus unie et plus ouverte. À Paris, comme en Île-de-France et dans le reste du pays, il doit donc y avoir un avant et un après 2024. C'est à l'aune de cet héritage que nous pourrons juger du succès des Jeux de Paris.
Bien évidemment, cet héritage ne doit pas concerner que la ville de Paris, mais toute l'Île-de-France et même tout le pays. Il doit être territorial et agir comme accélérateur du développement urbain, ce qui passe par la création de nouveaux logements et de nouveaux espaces de loisirs et de culture, par la construction de locaux d'entreprises et de commerces, et également par le développement d'infrastructures de transport et d'équipements sportifs.
Outre l'aspect du développement urbain, cet héritage doit aussi être environnemental et humain en bénéficiant au plus grand nombre. Le comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, le COJO, a annoncé, fin janvier, la création d'un fonds de dotation pour l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Il s'agit d'actions spécifiques en faveur de la population, avec trois objectifs ainsi intitulés : « le sport pour bouger plus », « le sport pour éduquer » et « le sport pour changer de regard », notamment sur le handicap. Ce fonds est alimenté par le COJO mais aussi ouvert aux sponsors qui pourront financer des actions.
Dans le budget actuel, la direction « Impact et héritage » est dotée de 50 millions d'euros. Dans mon département de la Seine-Saint-Denis, de nombreuses collectivités locales et de nombreuses associations m'ont d'ores et déjà fait part de leur intérêt pour candidater à ce fonds afin de mener à bien certains projets. Je souhaite donc savoir comment les collectivités locales et les associations pourront candidater à ce fonds et à partir de quelle date.
Vous m'interrogez sur un sujet très important et que vous suivez, je le sais, de près, parce que vous êtes un passionné de sport, mais surtout parce que vous vous battez, depuis le premier jour, pour que l'événement exceptionnel que sont les Jeux Olympiques ait des retombées sur le territoire de la Seine-Saint-Denis.
Votre département est en effet l'un de ceux pour lesquels les retombées et l'héritage des Jeux Olympiques sont essentiels. Cet héritage porte d'abord sur des valeurs sportives : vos propos l'ont souligné, le comité d'organisation et le ministère de l'éducation, qui les promeuvent déjà depuis plusieurs mois, continueront à les mettre en avant.
Il constitue aussi un héritage en matière d'emplois dont les effets s'exercent dès aujourd'hui. Monsieur le député, vous étiez à mes côtés et aux côtés de Mmes les ministres des sports et du travail, lorsqu'il y a quelques semaines nous avons lancé la grande mobilisation des Jeux Olympiques en faveur de l'emploi, notamment pour les territoires qui accueilleront les épreuves et abriteront les infrastructures.
Cet objectif est essentiel car, si nous ne parvenons pas à l'atteindre, l'héritage des Jeux Olympiques n'aura pas été inclusif, pour n'avoir pas bénéficié à celles et à ceux qui auront, plus que d'autres, accueilli les épreuves.
Le troisième volet de l'héritage concerne les infrastructures – non seulement les infrastructures sportives, mais aussi les infrastructures environnementales et les logements.
Monsieur le député, lors de l'examen du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique – ELAN – , vous avez contribué à créer un permis de construire à « double détente » permettant de construire des infrastructures mais aussi leur future transformation en logements. Rien qu'en Seine-Saint-Denis, plus de 4 000 logements et un écoquartier constitueront une part de l'héritage des Jeux Olympiques. Cet apport est très important.
Je suis aussi convenu avec l'organisation des Jeux Olympiques, notamment avec celles et ceux qui fabriquent les infrastructures, que ces logements seront dans une large mesure bâtis avec des matériaux biosourcés, notamment du bois.
Vous avez également évoqué le fonds de dotation dédié à l'héritage des jeux, qui est destiné à créer un effet d'entraînement que vous avez fort bien présenté. Ce fonds annoncé par le COJO lors du conseil d'administration du début d'année a déjà été en partie abondé, mais il est prévu de trouver d'autres financeurs. Il sera effectif à partir du prochain conseil d'administration qui aura lieu le 27 juin 2019, dans un peu plus d'un mois.
Ce fonds devant permettre de financer des actions bénéficiant à la population s'articule autour de deux axes phares, les Jeux Olympiques exemplaires, et les Jeux Olympiques et Paralympiques catalyseurs du changement.
Je suis certain que vous nous aiderez à le rendre pleinement efficace.

La parole est à M. Fabien Lainé, pour exposer sa question, no 752, relative aux vols et trafics de biens culturels.

Le 1er mars 2019, des vases sacrés et des hosties ont été dérobés dans l'église de Sainte-Eulalie-en-Born, dans les Landes. Quelques jours plus tôt, le 27 février 2019, des pièces anciennes d'orfèvrerie religieuse ont été dérobées dans l'église Saint-Sauveur de Sanguinet. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, ce sont plusieurs lieux de culte et sites historiques qui ont été victimes de vols organisés.
Ces vols répétés ne touchent pas cette seule région mais se produisent à l'échelle nationale, voire internationale, malgré les efforts de l'office central de lutte contre le trafic des biens culturels – OCBC – et de la direction centrale de la police judiciaire – DCPJ.
Un vol d'objet religieux a lieu en France toutes les vingt minutes, et le trafic illicite des biens culturels est souvent considéré par les médias comme le troisième trafic dans le monde, après celui des drogues et celui des armes.
Parallèlement au marché de l'art conventionnel que sont les ventes aux enchères, la vente d'objets d'art sacré et d'intérêt historique prolifère sur internet. Plusieurs sites d'annonces de vente ou de petites annonces de particuliers commercialisent ainsi des objets de provenance non référencée et souvent douteuse.
Une plateforme de vente en ligne internationale propose par exemple, pêle-mêle, une vierge en bois polychrome du XVIIe siècle, un reliquaire en or du XVIIIe siècle, une statuette en bronze d'époque gallo-romaine, un chapiteau en bois Haute époque, une paire de colonnes d'autel en bois doré, et même des bijoux phéniciens en bronze datant du premier siècle avant notre ère.
On peut dès lors se demander s'il ne serait pas utile de mettre en place, pour ces sites de commercialisation, une obligation de vérification qui permettrait de garantir la traçabilité des objets et, ainsi, de lutter contre le pillage, le vol, le recel et la commercialisation illicite des biens culturels.
Monsieur le ministre, quelles sont les solutions que le Gouvernement envisage pour faire face à ces trafics qui se déroulent, notamment, sur internet ?
Je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer sur un sujet important et qui, pour le ministère de la culture, constitue un enjeu fondamental. La lutte contre le vol et le trafic de biens culturels va d'ailleurs de pair avec la prévention des pillages et la mise en sûreté des lieux protégés, au sens du code du patrimoine.
Vous avez évoqué des faits survenus dans des églises, notamment en Nouvelle-Aquitaine ces deux dernières années. À ce sujet, je souhaite saluer l'intense coopération qui a lieu contre de tels vols, tant en France qu'à l'étranger, entre les services de police et de gendarmerie, les douanes, les opérateurs du marché de l'art et mon ministère, aussi bien d'ailleurs au niveau de l'administration centrale que des directions régionales.
Tous ces services se mobilisent pour que les propriétaires prennent conscience de l'attention qu'ils doivent porter à leur patrimoine mobilier, car certains d'entre eux ne mesurent pas le danger que courent leurs biens. Ils sont donc encouragés à mettre ceux-ci en sûreté, mais aussi à tout faire pour récupérer les éléments de leur patrimoine volés ou disparus, même si les vols ont été commis il y a très longtemps.
S'agissant des vols dans les églises, on constate que, s'ils continuent à se produire, leur nombre a fortement diminué. En effet, les faits de vol de ce type sont passés de plus de 600 par an sur tout le territoire dans les années 2000, à une fourchette annuelle comprise entre 100 et 140 faits de vol. Cette baisse s'accompagne d'un changement de la nature des biens volés, qui sont de plus en plus souvent des objets constitués de métaux.
Lorsqu'un bien culturel est volé, la documentation le concernant doit être communiquée le plus rapidement possible au service spécialisé de l'OCBC et au service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale – SCRCGN.
J'ai demandé à mes services d'examiner ce qu'il conviendrait de faire pour que nos compatriotes soient mieux informés en cas de vol. En effet, l'information dont ils auraient besoin n'est pas assez suffisamment accessible et votre question, monsieur le député, donne à penser qu'elle doit également être améliorée.
La documentation communiquée permet d'enregistrer l'objet dans la base nationale de données sur les oeuvres d'art volées qui, ensuite, alimente la base internationale d'Interpol à laquelle le public a accès depuis 2009, et qui vient d'être rénovée.
Cette remontée rapide d'informations produit des résultats indéniables puisque, depuis plusieurs années, il n'est pas rare que les responsables de vols soient très rapidement appréhendés. Le dispositif mis en place a permis de récupérer beaucoup plus d'objets volés qu'on ne le faisait auparavant, tous n'étant cependant pas retrouvés.
Concernant les objets d'art mis en vente sur internet, il est absolument nécessaire que nous responsabilisions les plateformes, de la même façon que nous le faisons dans d'autres domaines comme la lutte contre les propos haineux, les « infox » ou le piratage.
La formation et la sensibilisation des différents acteurs concernés sont très importantes pour prévenir les vols et les actes de malveillance.
Il pourrait aussi être intéressant de faire évoluer le cadre législatif et réglementaire en sanctionnant plus durement le vol, la dégradation de biens culturels et la lutte contre le trafic de biens culturels nationaux et internationaux.
Enfin, nous entendons continuer à responsabiliser les plateformes et à informer le grand public des dispositifs leur permettant de récupérer leurs biens volés. Mon ministère se tient, sur ces sujets, à votre disposition.

La parole est à M. Bernard Perrut, pour exposer sa question, no 749, relative aux moyens pour le secteur du grand âge.

Ma question s'adresse à Mme la ministre des solidarités et de la santé.
Le rapport sur le grand âge a le mérite de formuler des propositions nombreuses et de proposer, sur ce sujet très important, des pistes de réflexion. Il s'agit là d'un chantier immense qui prendra du temps, alors qu'à mon sens nous en manquons.
Les difficultés structurelles et conjoncturelles signalées quotidiennement partout en France obligent en effet à prendre des mesures de façon urgente. La situation n'est plus tenable dans nombre d'établissements. En raison des personnels en sous-effectif chronique, de l'épuisement de nombreux salariés, de la multiplication des arrêts maladie nombreux et de l'absentéisme, les aides-soignants ne parviennent plus à faire correctement leur travail.
L'insuffisance criante des moyens accordés aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes – EHPAD – a de graves conséquences pour celles-ci. Leur accompagnement se détériore, et elles courent même le risque d'être victimes de maltraitance.
La difficulté à recruter du personnel qualifié et le recours toujours croissant à l'intérim témoignent du malaise du secteur en matière de ressources humaines. La consultation que j'ai conduite dans ma circonscription du Rhône a montré que les personnels des EHPAD, dont les niveaux de rémunérations sont très bas, sont épuisés moralement et physiquement.
Aussi souhaiterais-je connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour revaloriser ces métiers et les rendre attractifs en faisant de la qualité de vie au travail dans ce secteur un objectif, afin que les résidents des EHPAD aient accès à une offre de qualité.
Par ailleurs, nous devons rendre plus accessible le coût des EHPAD pour les résidents et leurs familles. Comment sera financé l'effort en faveur de ces établissements, qui ne peut plus attendre ?
Le vieillissement est une chance, mais il est aussi un défi. C'est pourquoi je souhaite vous entendre sur ce sujet qui, à tous, nous importe.

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé.
Monsieur le député, c'est précisément pour répondre à l'urgence sur laquelle vous appelez notre attention que la ministre des solidarités et de la santé a présenté, le 30 mai 2018, une feuille de route pour les personnes âgées qui, d'une part, comporte des mesures destinées à améliorer immédiatement leur qualité de vie et, d'autre part, ouvre une réflexion, associant l'ensemble des acteurs du secteur et la société, sur le défi que représente l'anticipation du vieillissement et de la perte d'autonomie.
Le rapport remis par Dominique Libault à l'issue de la concertation Grand âge et autonomie qu'il a conduite entre octobre 2018 et mars 2019, et qui a associé des citoyens, des personnes âgées et des professionnels du secteur, met particulièrement en évidence les difficultés que rencontrent les aides-soignantes – vous les avez longuement évoquées dans votre question – , et qui concernent la durée de leur intervention, leur temps de déplacement et les indemnités kilométriques qu'elles touchent, notamment dans certaines zones rurales.
En réponse à ce rapport, le Gouvernement a indiqué qu'il engagerait rapidement un grand plan national des métiers dans le but de revaloriser tous les métiers du grand âge et, ainsi, d'accroître leur attractivité.
Les effectifs des personnels devraient tout d'abord grossir afin d'augmenter leur temps de présence auprès des personnes. Quatre autres leviers seront également actionnés en vue de modifier en profondeur les métiers du grand âge.
Le premier concerne la capacité des employeurs à recruter les professionnels nécessaires, et consistera à attirer vers ces métiers les personnes en recherche d'emploi et à mobiliser les dispositifs d'insertion professionnelle.
Le deuxième levier a trait à la prévention de la pénibilité du travail et à l'amélioration de la qualité de vie au travail. À cet effet, seront notamment pris en compte les travaux qu'a réalisés la mission Qualité de vie au travail dans les services d'aide à domicile, qui associe les acteurs du secteur, en vue de définir et de mettre en oeuvre des actions concrètes qui amélioreront la qualité de vie au travail des professionnels du secteur médico-social travaillant à domicile. Dans ce domaine, nous ne devons pas, en effet, procéder de manière cloisonnée.
Le troisième levier est l'évolution des formations et des compétences en vue de mieux préparer les professionnels aux attentes nouvelles. Cette montée en compétences et cette évolution des métiers pourront s'accompagner de revalorisations salariales.
Le quatrième et dernier levier est la diversification des perspectives de carrière offertes aux professionnels.
Une personnalité qualifiée sera nommée pour animer la discussion entre toutes les parties prenantes concernées par les métiers du grand âge. Comme l'a annoncé le Président de la République, un projet de loi ambitieux – j'en suis convaincu – sera ensuite présenté afin de garantir le financement durable de la perte d'autonomie, car c'est bien de cela qu'il s'agit, ainsi que de repenser l'offre d'accompagnement au bénéfice des personnes.

Je vous entends bien, monsieur le secrétaire d'État, et je ne peux qu'approuver votre volonté et les propositions du rapport, ainsi que le vaste tableau que celui-ci dresse de la situation. Mais ma question portait sur la réactivité du Gouvernement face à l'urgence.
Lorsque l'on se rend aujourd'hui dans des établissements, on ne peut que constater la pénibilité du travail, l'absence de reconnaissance des métiers, l'insuffisance d'aides-soignantes, les problèmes de marché de l'emploi et de formation. Si nous attendons le texte de loi que vous annoncez – quand viendra-t-il, d'ailleurs ? – pour remédier à ces difficultés, je crains qu'il ne soit alors trop tard. Voilà pourquoi je vous demande dès à présent si des mesures peuvent être financées et mises en oeuvre rapidement, indépendamment de ce projet de loi. Certes, la situation à long terme pourra être prise en considération, je n'en doute pas, et nous nous y attacherons unanimement. Mais vous ne montrez pas la réactivité dont je vous ai demandé de faire preuve pour répondre aux attentes exprimées dans les établissements.

La parole est à M. Stéphane Demilly, pour exposer sa question, no 757, relative à la lutte contre les déserts médicaux.

Je souhaite alerter une nouvelle fois le Gouvernement à propos du problème des déserts médicaux.
Pour que ma question soit claire, je partirai d'un cas concret. À Ercheu, commune de 820 habitants située dans la Somme – le plus beau département de France – , on recherche un médecin désespérément depuis le départ à la retraite du précédent. Et si ce médecin se fait attendre, ce n'est pas faute d'implication de la commune : celle-ci a beaucoup investi dans la communication, pour informer de cette vacance, et dans la création d'un local de santé ; pourtant, rien, rien du tout ! Ce cas n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais il est symptomatique de la situation de nombreuses communes – qui ne sont plus uniquement de petites communes, car, vous le savez, monsieur le secrétaire d'État, la gangrène de la désertification médicale gagne les gros bourgs et les petites villes... sauf peut-être dans le Sud de la France, au bord de la mer !
En dépit des efforts qu'elles déploient, notamment pour construire des infrastructures flambant neuves, chaque semaine, de nouvelles communes sont privées de praticiens. L'incitation matérielle ne suffit donc pas ou plus à lever les freins à l'installation de nouveaux médecins.
Or les conséquences de l'absence de médecin sont bien connues : je ne citerai que le renoncement aux soins, l'allongement des distances à parcourir, des délais insupportables avant de pouvoir obtenir un rendez-vous, ou encore, bien sûr, la saturation des urgences, qui apparaissent souvent comme l'unique recours.
Aujourd'hui, un Français sur dix vit dans un désert médical – et les déserts médicaux ne font que s'étendre – tandis que près d'un médecin généraliste sur deux a plus de 55 ans. Vous l'avez compris, il est urgent d'agir ! Face au phénomène, on ne peut pas uniquement compter sur la hausse du numerus clausus : l'arrivée de médecins nouvellement formés ne permettra pas à elle seule de pallier les prochains départs à la retraite, ni de faire face à l'augmentation des besoins liés au vieillissement de la population.
Le problème, me répondrez-vous, n'est pas nouveau : la situation est connue, et l'alarme a déjà été donnée à de nombreuses reprises – je l'ai moi-même fait en plusieurs occasions ici. Mais, justement, plus nous attendons, plus la situation empire.
Quand va-t-on donc agir, et comment ? Quelles mesures d'urgence vont être déployées pour enrayer le phénomène au plus vite, ne pas laisser vides des cabinets médicaux et empêcher que ne s'instaure une France à deux vitesses en matière d'accès aux soins ?

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé.
Je vous remercie, monsieur le député, de votre question, qui fait écho à l'inquiétude qu'inspire à nombre de nos compatriotes une démographie médicale en baisse. Vous avez voulu partir d'un cas concret, à juste titre, car peu d'approches sont plus parlantes ; je vous apporterai de même des réponses très concrètes, en particulier concernant votre département de la Somme.
Afin d'améliorer l'accès aux soins, l'agence régionale de santé des Hauts-de-France met ainsi en oeuvre plusieurs mesures qui relèvent du plan « ma santé 2022 » et du projet régional de santé.
Dans les zones dites en tension, l'ARS soutient les installations par l'intermédiaire de deux types de contrats : le contrat d'engagement de service public – CESP – , aux termes duquel les étudiants de médecine et d'odontologie perçoivent une bourse d'un montant brut de 1 200 euros par mois en contrepartie de leur installation dans un territoire défini comme sous-dense en professionnels de santé pour la durée du versement de l'aide ; et le contrat de praticien territorial de médecine générale – PTMG. En Hauts-de-France, le nombre de CESP conclus a été multiplié par quatre depuis 2012 : 223 CESP – et 57 PTMG – ont été signés.
Le contrat de médecin adjoint – en renfort temporaire d'un médecin déjà installé – , aujourd'hui limité aux zones à fort afflux touristique ou aux cas d'épidémie, sera étendu à l'ensemble des zones sous-denses. Dans les Hauts-de-France, ce dispositif, déjà déployé dans l'Oise, s'appliquera aux quatre autres départements de la région en 2019-2020.
Les stages en médecine générale sont également encouragés afin de faire découvrir aux étudiants des territoires et une pratique. Dans les Hauts-de-France, 100 % des étudiants externes en médecine effectuent un stage chez un médecin généraliste ; 460 maîtres de stage en médecine générale accueillent ainsi des internes.
De même, les coopérations entre professionnels de santé sont facilitées. Il s'agit notamment de former des infirmiers dans le cadre du protocole Asalée – Action de santé libérale en équipe – dans les zones sous-denses, afin de leur permettre d'acquérir des compétences qui seront ensuite reconnues par le biais de rémunérations spécifiques. Douze protocoles de coopération sont autorisés à ce jour dans les Hauts-de-France, pour la vaccination, la radiologie et l'ophtalmologie.
L'ARS a également lancé l'initiative « filière d'excellence santé », qui vise à accroître les chances de réussite de lycéens originaires de territoires prioritaires : ils sont accompagnés de la classe de seconde à la première année commune aux études de santé – PACES. Six lycées participent à l'expérimentation depuis 2015 ; l'un d'eux est situé dans la Somme, à Montdidier, et l'a rejointe en 2016 – peut-être en êtes-vous déjà informé, monsieur le député ; plus de 400 lycéens de première et de terminale ont bénéficié du dispositif.
La télémédecine représente quant à elle une opportunité pour compléter l'offre de consultation des médecins en cabinet en réduisant les contraintes géographiques et démographiques. Plusieurs expérimentations en ce sens ont été lancées et sont financées par l'ARS, dont la télé-expertise pour la détection des tumeurs cutanées dans l'Aisne, l'Oise et la Somme : grâce à ce dispositif, 91 médecins généralistes peuvent demander une expertise à distance à des confrères dermatologues ; à ce jour, plus de 500 avis de dermatologie ont ainsi été rendus, dont 70 % en moins de quarante-huit heures.
Le soutien aux maisons de santé pluriprofessionnelles – MSP – , qui réunissent des professionnels de santé ayant choisi de travailler ensemble et de façon coordonnée au sein d'une même structure, est un autre axe fort de notre politique d'accès aux soins. Dans ce domaine, l'ARS des Hauts-de-France accompagne tous les porteurs de projet, et d'abord ceux dont le projet concerne les zones sous-denses ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans la Somme, vingt-quatre MSP sont en activité à ce jour.
Enfin, le plan d'accès aux soins prévoit que tous les professionnels de santé bénéficient, par téléphone ou par internet, d'un point d'information unique, de manière à pouvoir construire leur projet professionnel et personnel. Il existe aujourd'hui un guichet unique de ce type par département ; il y en a donc un dans la Somme au sein de la région Hauts-de-France.

La parole est à M. Christophe Naegelen, pour exposer sa question, no 759, relative à la formation en pratique avancée pour les infirmiers.

Monsieur le secrétaire d'État, j'ai interpellé le Gouvernement à de nombreuses reprises au sujet de l'hôpital et de la maternité de Remiremont, et je reviendrai très prochainement vers vous à propos de l'hôpital de Gérardmer, toujours animé de la même volonté que les territoires ruraux aient accès aux soins comme les autres territoires. Je tiens à vous alerter aujourd'hui à propos d'un autre cas, un cas précis.
Le développement de la pratique avancée pour la profession infirmière fait partie des solutions affichées par le Gouvernement pour lutter contre les déserts médicaux. Pourtant, le financement de la formation d'infirmier en pratique avancée – IPA – est insuffisant. Ainsi, l'agence régionale de santé du Grand Est avait annoncé qu'elle en prendrait en charge le coût pour les trois années à venir, mais les crédits budgétés pour l'année 2019 se révèlent très insuffisants. De plus, il arrive que l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier, l'ANFH, refuse elle aussi de prendre en charge la formation à cause de son coût élevé. En conséquence, alors que le nombre de places est lui aussi insuffisant, l'accès à la formation d'IPA est malheureusement restreint.
Par exemple, dans la vallée de la Moselle, un territoire carencé en médecins, particulièrement dans les hôpitaux locaux de Bussang et du Thillot, une infirmière serait volontaire pour suivre la formation, mais il lui a été répondu qu'il n'y avait pas assez de crédits pour cela, ni de l'ARS ni de l'ANFH, et que, de toute façon, il n'y avait plus de place disponible.
Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres ; il montre que, si l'intention est bonne, il faut aussi que l'État consacre les moyens nécessaires à sa réalisation.
Que comptez-vous donc faire afin d'améliorer l'accès des volontaires à la formation ? Comment prévoyez-vous de revaloriser le salaire des IPA ? Pourrez-vous accorder une attention toute particulière aux zones sous-denses, notamment dans les Vosges ? Pouvez-vous dès à présent m'éclairer sur le cas précis que j'ai évoqué ?

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé.
Permettez-moi, monsieur le député, de réaffirmer que la prise en charge de la formation au diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée fait l'objet d'une attention particulière tant de l'ARS du Grand Est que de l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier, l'ANFH. Il s'agit d'accompagner et de soutenir le lancement d'un projet dont les conséquences sur l'accès aux soins seront majeures.
Depuis octobre 2018 – date de la création, au sein des seize premières universités accréditées, du master conduisant au diplôme d'État d'IPA – , trente étudiants ont été accueillis à l'Université de Nancy, dont deux sont originaires des Vosges. Trois proviennent de l'exercice libéral, neuf des établissements de santé privés et dix-huit des établissements de santé publics. L'ARS du Grand Est s'est engagée à prendre en charge l'ensemble des frais afférents aux deux premières promotions – frais de scolarité, pédagogiques et de remplacement des professionnels en formation. Afin d'encourager la participation des infirmiers libéraux, elle leur a par ailleurs alloué une subvention de 60 000 euros. Soixante-dix étudiants étant attendus pour la rentrée 2019, l'ARS aura ainsi engagé 5,6 millions d'euros pour les deux premières promotions d'IPA.
Pour sa part, l'ANFH a financé quatre prises en charge en formation : deux en Alsace, une en Champagne-Ardenne et une en Lorraine. Les demandes iront croissant et il est important, s'agissant des infirmiers exerçant dans les établissements publics de santé, que l'ANFH puisse s'associer à la prise en charge des nouveaux besoins.
S'agissant des demandes de congé de formation professionnelle soumises directement par les agents candidats et du contenu de leur dossier, à compter de 2020, une délégation spécifique du fonds d'intervention régional – FIR – viendra relayer les premières initiatives des régions, notamment pour accompagner les infirmiers issus du secteur libéral, dont l'éligibilité sera déterminée par l'ARS.
Soyez donc assuré, monsieur le député, qu'au sein de mon ministère comme de l'ARS du Grand Est et de l'ANFH, une attention particulière est accordée à l'accompagnement de ce projet et au soutien à lui apporter.

Merci de votre réponse, monsieur le secrétaire d'État. Mais elle manque de précision s'agissant du cas exact que j'ai cité, celui d'une vallée carencée en professionnels et de personnes qui y sont volontaires pour suivre la formation mais sont privées de moyens et de places. Vous parlez de soixante-dix étudiants en 2019 ; n'est-il pas possible de leur en adjoindre d'autres, notamment l'infirmière dont j'ai parlé, appelée à jouer un rôle essentiel dans les hôpitaux du Thillot et de Bussang, où, je le répète, nous manquons cruellement de médecins ?
À onze heures trente, M. Sylvain Waserman remplace M. Hugues Renson au fauteuil de la présidence.

La parole est à M. David Habib, pour exposer sa question, no 756, relative aux rapports de Santé publique France sur le bassin de Lacq.

Je souhaite appeler votre attention, monsieur le secrétaire d'État, sur une situation très particulière : celle de Santé publique France, organisme placé sous votre autorité. Disons-le franchement, les interventions de cet organisme m'ont mis très en colère. Ne voyez aucune malice dans mon propos ; j'espère qu'il n'y en aura aucune non plus dans votre réponse ; mais ce sentiment est, je crois, partagé par les autorités représentant l'État sur place.
Cet organisme d'État a été mandaté par le Gouvernement à la suite d'un rapport de la chambre régionale des comptes consacré à la gestion de la communauté de communes de Lacq-Orthez dont j'assurais la présidence. Le magistrat a considéré que la situation financière était excellente, mais il a aussi souhaité en savoir davantage sur les conséquences sanitaires de l'exploitation du gisement de gaz de Lacq. C'est tout !
À partir de ce moment-là, ce dossier a éveillé l'intérêt d'un certain nombre d'associations de protection de l'environnement – dont l'une qui est particulièrement à la recherche de lumière médiatique, et que par conséquent je ne citerai pas ici : qu'elle reste dans son obscurité, c'est certainement le meilleur service que l'on puisse rendre aux Béarnais ! Cette association s'est emparée de ce dossier et a développé une expression publique sur la question de la santé et du travail. L'État, comme toujours, par faiblesse, a répondu à ces interrogations en confiant à Santé publique France le soin d'établir une photographie des questions sanitaires dans le bassin de Lacq. Cette faiblesse n'est pas la vôtre : il y avait alors un autre gouvernement, une autre majorité – que je soutenais, par ailleurs.
J'avais, à l'époque, exprimé mes réserves au Gouvernement et au préfet. Quel est l'intérêt de cette étude ? Soit les services de l'État connaissent l'existence d'un risque, et alors il faut intervenir tout de suite et demander l'interruption des activités, en vertu du principe de précaution : la santé doit primer, ce n'est pas négociable. Mais s'il n'y a pas de risque, alors il ne faut pas cultiver un sentiment d'insécurité sanitaire sur ce territoire !
L'État a néanmoins pris la décision de lancer cette étude. Le 11 mai dernier, en période de réserve électorale, un rapport préliminaire de Santé publique France a été publié. Ce que l'on y lit, ce sont des propos dignes du café du commerce ! Pas le début d'une statistique avérée ; pas le début d'un cas sur lequel il y aurait eu accord des autorités sanitaires. La parole est donnée à des pharmaciens et des médecins, qui disent qu'il se passe quelque chose, mais sans que jamais leur nom ne soit cité : impossible de vérifier l'authenticité de ces propos !
Avec le soutien des élus, des industriels et des organisations syndicales, je vous le dis, monsieur le secrétaire d'État : soit il se passe quelque chose, et vous devez nous le dire et intervenir immédiatement pour faire cesser les activités industrielles ; soit il ne se passe rien, et vous devez calmer cet organisme. Dites à Santé publique France, qui confie à des élèves de première année de sociologie le soin de réaliser ce type de rapport, qu'ils réservent leur expression à d'autres territoires que le bassin de Lacq, qui a tant donné à notre pays !

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé.
À malice, malice et demie, monsieur le député.
Sourires.
Ne préjugez pas de ce que pensent de Santé publique France les services locaux de l'État !
Je vais essayer de vous répondre en objectivant autant que possible le processus en cours.
Vous l'avez rappelé, le bassin de Lacq concentre de multiples activités industrielles, et de nombreux emplois, depuis plusieurs décennies ; à ce titre, il fait l'objet d'un suivi continu par les autorités. La maîtrise des conséquences de ces activités sur la santé constitue une priorité pour l'État.
En réponse à une saisine de la direction générale de la santé concernant l'opportunité d'une surveillance épidémiologique autour du bassin industriel de Lacq, Santé publique France a développé une approche mixte, qui combine les approches qualitatives et quantitatives. Je vais me permettre de développer ce point, en réponse au jugement que vous émettez sur les premières conclusions qui ont pu filtrer dans la presse – sans que je sache par quel biais celle-ci a pu en avoir connaissance.
Trois études ont ainsi été engagées : une analyse du contexte local ; une étude exploratoire de morbidité ; une étude géographique de mortalité.
L'objectif de la première étude est d'identifier les perceptions, interrogations et attentes des différents acteurs locaux, à l'égard des liens entre santé et environnement autour du site industriel. Pour établir ce rapport, Santé publique France s'est appuyée sur une étude qualitative par entretiens semi-directifs. Ceux-ci, au nombre de trente-neuf, ont été menés auprès de différentes catégories de parties prenantes : représentants d'administrations de l'État, élus locaux – vous, peut-être – , acteurs industriels, représentants syndicaux de salariés, professionnels de santé, riverains, associations de défense de l'environnement et de la santé.
Ce rapport s'est également appuyé sur certains résultats du programme ACTER « accompagner les changements vers des territoires résilients », qui associe le CNRS et l'université de Pau.
L'importance de l'axe emploi-économie émerge chez tous les interviewés, en référence à une histoire industrielle très ancrée localement. Des craintes nées de l'arrêt d'activités et de la reconversion en cours des activités industrielles locales sont également exprimées : vous vous en êtes fait le relais ici. L'axe santé-environnement apparaît comme une préoccupation croissante, avec des niveaux d'inquiétude variables selon les acteurs interrogés. Il est relayé notamment par les deux principales associations consultées.
Les résultats des études épidémiologiques sont attendus, même si une absence de conclusion causale est probable, du fait de limites méthodologiques – multifactorialité, effets cocktails. Une transparence sur les méthodes et les conditions de réalisation des études épidémiologiques est particulièrement attendue, ainsi qu'une meilleure information des professionnels de santé locaux sur les polluants et leur impact sur la santé.
Enfin, une évaluation de la fréquence de certains symptômes ou pathologies, ne figurant pas nécessairement dans les bases de données utilisées par les épidémiologistes, a été plébiscitée. Une étude de santé déclarée sera envisagée prochainement pour tenter d'y répondre.

La parole est à M. Paul-André Colombani, pour exposer sa question, no 751, relative à la clinique de Porto-Vecchio.

Je souhaite alerter le Gouvernement, ainsi que mes collègues, sur la situation préoccupante de la clinique de Porto-Vecchio.
Cet établissement privé de santé, absolument incontournable dans le sud de la Corse, perçoit de l'argent public de l'agence régionale de santé – ARS – afin d'assurer un service public en matière d'urgences et de maternité.
Or ce service public fonctionne mal, coûte cher, et s'endette de façon chronique. L'État signe un chèque en blanc sans remettre en cause le modèle de financement. Cette situation n'est pas tenable, mais l'ARS est pour l'instant contrainte de payer rubis sur l'ongle, sous peine de mettre en faillite la clinique et le service public qui va avec. Les usagers de l'extrême sud et les quelque 200 employés sont ainsi pris en otage par un modèle de financement qui est un tonneau percé.
Je ne donne ici qu'un rapide exemple : les charges locatives annuelles s'élèvent à 1 million d'euros, ce qui paraît disproportionné pour une surface commerciale à Porto-Vecchio. Cela laisse imaginer qu'il y aurait ici, peut-être, une « part des anges » dont le contribuable est en droit de se demander où elle s'envole.
Un audit a été commandé par la direction générale de l'offre de soins, donc payé par le ministère. Pourtant, la direction de la clinique me dit que l'audit est leur propriété privée. L'ARS me dit ensuite qu'il n'est pas transférable à cause du « secret industriel et commercial », mais que je pourrai le consulter à la direction régionale des finances publiques. Celle-ci me répond que cet audit n'est pas en sa possession. Je trouve extrêmement grave et désobligeant que la représentation nationale se fasse ainsi mener par le bout du nez, à la recherche d'un audit introuvable. Les citoyens, et notamment les Porto-Vecchiais, ont droit à une plus grande transparence.
Je suis favorable à ce que plus d'argent soit mobilisé en faveur de la santé, mais pas en faveur de rentes privées, surtout quand c'est au détriment des moyens qui doivent être engagés dans des hôpitaux publics, comme à Bonifacio mais aussi à Ajaccio et Bastia.
Sans réponse concrète, je me réserve la possibilité de saisir officiellement la Cour des comptes.

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé.
Nous nous rejoindrons certainement sur deux points, monsieur le député : d'une part, la clinique de Porto-Vecchio est un établissement de référence pour le sud de la Corse ; d'autre part, elle doit encore trouver son modèle économique.
Tout d'abord, la disparition de la clinique de Porto-Vecchio ne nous semble pas envisageable : la Haute Autorité de santé reconnaît la qualité des pratiques professionnelles et l'agence régionale de santé la nécessité de maintenir les activités, notamment d'urgence et de maternité.
Depuis la disparition des concessions de service public, la situation géographique et la faiblesse de l'activité compromettent de manière structurelle, c'est vrai, l'équilibre budgétaire de l'établissement. Une amélioration de l'organisation interne et du fonctionnement avec les médecins du territoire et les autres établissements de Corse doit toujours être recherchée ; la solution n'a pas encore été trouvée.
Un plan de retour à l'équilibre ambitieux doit être mené à bien. Une articulation complémentaire des activités d'urgence et de SMUR constituerait, nous semble-t-il, une piste importante d'efficience. Au regard des éléments qui nous ont été transmis, il apparaît nécessaire d'explorer cette piste.
Cette réorganisation devrait permettre à la clinique de trouver un équilibre budgétaire dans le droit commun. Dans ce cadre nouveau, le plan de retour à l'équilibre, ainsi que les conditions d'exercice des missions de service public et leur financement, seront contractualisés.
Enfin, permettez-moi d'ajouter que la situation spécifique de cette clinique justifie un soutien de l'État. Celui-ci appuie ainsi structurellement cet établissement par le versement d'une aide annuelle de 3,5 millions d'euros.
Nous souhaitons, vous l'avez compris, conforter cet établissement médico-chirurgical, acteur de référence en Corse du sud, mais un équilibre financier doit être trouvé.

Merci de votre réponse, monsieur le secrétaire d'État ; elle manque néanmoins de précision, notamment concernant l'accès à l'audit. J'espère que Mme Buzyn, qui est en déplacement en Corse aujourd'hui, nous apportera davantage de réponses. Il n'est pas normal que nous n'ayons pas accès à ce document.
Je vous le redis : ce système de financement est obsolète ; il engendre un déficit structurel, et il faut le changer. Ses conséquences sont délétères, tant sur les patients que sur les employés.
D'autres modèles existent, à La Ciotat, à Saint-Tropez, bientôt à Carpentras : des cliniques et des hôpitaux peuvent coexister dans les mêmes établissements, sans mélange d'argent public et d'argent privé. Tout le monde accomplit son travail de façon claire. Ce modèle peut facilement être transposé à Porto-Vecchio, à condition qu'il existe une volonté forte de l'État, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Ces problèmes doivent être réglés très rapidement, car les dysfonctionnements s'accumulent et finissent par aboutir à des drames humains, parfois fatals. J'ai ici une pensée pour M. Canonicci et pour sa famille.

La parole est à M. Frédéric Petit, pour exposer sa question, no 753, relative aux divorces de couples franco-allemands.

Ma question porte sur les cas de divorce chez les couples franco-allemands. Vous le savez, ma circonscription comprend l'Allemagne, l'Europe centrale, les Balkans ; j'habite moi-même à Varsovie. Des Français se sont installés dans ces pays, parfois depuis longtemps, ils s'y marient, ils y voient grandir leur famille, mais parfois aussi, ils divorcent. Depuis deux ans maintenant, je suis saisi d'un grand nombre de cas extrêmement douloureux de ces divorces pour lesquels le jugement est rendu en Allemagne, principalement à cause de décisions peu claires, plus administratives que judiciaires, systématiquement rendues en faveur du parent allemand.
Ces décisions assez déséquilibrées ont de graves conséquences pour les parents et les enfants, sans parler du sentiment subjectif, certes, mais terrible, de se sentir discriminé par une machine administrative.
Or, depuis quelques mois, cette douleur n'est plus seulement subjective : le Parlement européen a largement approuvé le 28 novembre 2018 la résolution sur le rôle du Jugendamt dans les litiges familiaux binationaux entre la France et l'Allemagne. Le constat des eurodéputés est sans appel : les pétitions pour des discriminations de parents non allemands se sont multipliées, l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas pris en compte objectivement ; on constate l'existence de procédures et attitudes discriminatoires, des documents ne sont pas traduits, les délais sont irréalistes. La double culture et la deuxième langue maternelle sont niées.
Ce sujet dépasse les compétences d'un député, puisqu'il s'agit de procédures judiciaires. Médiateur de formation, j'ai d'abord encouragé, au cas par cas, la mise en place de médiations, et j'ai même soutenu un projet pilote de co-médiation biculturelle qui semble se développer aujourd'hui de façon autonome.
Mais, dans le contexte actuel de rapprochement entre les deux pays et afin d'assurer équité et justice dans le règlement des divorces entre la France et l'Allemagne, je pense que le Gouvernement doit s'investir en particulier, comme le propose le Parlement européen, pour développer des échanges et des formations communes aux fonctionnaires des deux administrations qui s'occupent de la famille et de la protection de l'enfance.
Monsieur le secrétaire d'État, quelles sont les pistes envisagées par le Gouvernement dans ce domaine ?

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé.
Monsieur le député, permettez-moi de répondre en lieu et place d'Amélie de Montchalin, qui est en déplacement pour des raisons liées au scrutin de dimanche dernier.
Dans toute l'Union européenne, le nombre de couples binationaux ne cesse d'augmenter, ce qui traduit probablement – et nous pouvons nous en réjouir – le développement d'une identité européenne.
Le droit européen n'ignore pas cette réalité ; il évolue régulièrement pour tenir compte des besoins particuliers des familles concernées et afin que les décisions de divorce ou celles relatives à l'autorité parentale soient rendues en vertu de règles communes dans tous les pays de l'Union européenne.
Il existe ainsi plusieurs règlements relatifs au droit de la famille, qui permettent de déterminer le juge compétent et la loi qui doit être appliquée. Je pense notamment au règlement dit Bruxelles II bis, dont la refonte est en cours, qui porte sur le divorce et la responsabilité parentale, ou au règlement du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux, qui est entré en application le 29 janvier dernier.
Ces instruments comportent aussi des règles permettant d'assurer la reconnaissance transfrontière des décisions de justice dans l'espace européen. Ces règles s'imposent à tous les juges de l'Union européenne et consacrent la notion clé d'intérêt supérieur de l'enfant, à laquelle je suis particulièrement attaché. Elles sont un outil pour que les divorces entre des époux de nationalité différente puissent se régler dans l'équilibre et la sécurité juridique.
Avec votre question, j'entends néanmoins que ces objectifs ne sont pas toujours atteints et que le manque de connaissances sur le droit et les pratiques des États voisins peut être une source de difficultés et de souffrance pour les personnes concernées.
L'Union européenne fournit pourtant de nombreuses informations sur le droit de chaque État, avec le portail internet e-Justice, qui est accessible à tous, notamment aux professionnels du droit. Elle finance et organise, par le biais du Réseau européen de formation judiciaire, des formations et des stages pour que les magistrats de l'Union connaissent mieux les textes européens et puissent découvrir concrètement le système judiciaire des autres États.
Chaque année, des magistrats français vont ainsi rencontrer des collègues allemands dans leur juridiction et, réciproquement, des magistrats allemands sont accueillis en France. Ces stages améliorent les liens de confiance mutuelle, comme la connaissance des systèmes judiciaires.
En France, le ministère de la justice s'efforce de faire connaître ces outils auprès des magistrats. L'Allemagne participe elle aussi activement à organiser la coopération entre autorités judiciaires.
J'ajoute qu'un magistrat de liaison français est en poste en Allemagne et qu'un de ses homologues allemands travaille en France. Ces magistrats concourent tous deux à faciliter les échanges et à favoriser l'entraide judiciaire internationale entre nos deux pays.
Votre question met en lumière la nécessité de poursuivre les efforts en ce sens, afin que les magistrats français et allemands puissent traiter de manière équilibrée les dossiers transfrontières qui leur sont confiés, dans l'intérêt des enfants et de leurs parents.
Il me semble qu'il existe, au sein du Parlement européen, un poste de coordinateur sur les droits de l'enfant, dont la fonction première est de faire office de médiateur dans le cas de divorces transfrontaliers. Sa titulaire actuelle s'apprêtant à partir, du fait des élections, j'aurai à coeur, par mes attributions, de faire en sorte qu'une candidature française soit proposée.
Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères soutiendra donc la poursuite d'un dialogue actif avec ses partenaires européens, notamment avec ses partenaires allemands, afin de rendre plus efficaces encore les outils indispensables qui ont été développés en matière familiale dans l'intérêt des familles multiculturelles de l'Union européenne que vous représentez.

Je vous remercie de ce petit signe amical aux familles biculturelles. Je crois cependant que la réponse n'est pas judiciaire. Les difficultés que j'ai décrites trouvent leur origine dans le rôle du Jugendamt, une institution propre à l'Allemagne. Loin de s'affronter, il faut que nos administrations collaborent. Il est ici bien question des administrations, non des magistrats car, une fois les jugements rendus, il faut veiller à leur application, qui engage deux traditions administratives différentes.

Monsieur le président, mon temps de parole de quatre minutes n'est pas achevé !
Le Jugendamt, créé avant la Première guerre mondiale, n'a pas été modifié depuis. Nous avons besoin que les administrations qui appliquent les décisions de justice fassent un effort de compréhension. Il s'agit non pas d'une non-reconnaissance de décisions de justice, mais d'administrations dans le domaine du droit de la famille, dont les représentants ne doivent pas se faire la guerre mais se former ensemble. Il faut donc mettre en place des formations communes.

Je vous remercie, monsieur le député. Je rappelle que le temps de parole est limité à six minutes pour l'ensemble des interventions autour d'une question.

La parole est à M. Stéphane Mazars, pour exposer sa question, no 736, relative à la viticulture en terrasses.

Monsieur le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, les élections européennes sont déjà derrière nous et les futurs programmes de la politique agricole commune – PAC – seront en discussion très prochainement. À ce titre, et comme je l'ai fait auprès de vos prédécesseurs, je souhaite insister sur la particularité des vignobles en forte pente.
Dans mon département de l'Aveyron, la majeure partie des vignes est située sur des pentes assez raides, ayant fait l'objet d'aménagement en terrasses pour la plupart. À titre d'exemple, ces terrasses représentent aujourd'hui plus de 85 % de la surface du vignoble de Marcillac et 80 % de celui des côtes de Millau. Mon département n'est pas le seul, la viticulture européenne se caractérise également par des vignes situées sur des sols en pente.
Or, comme vous le savez, ce type de viticulture a non seulement dessiné des paysages remarquables mais aussi joué un rôle fondamental dans la préservation des sols et la gestion de l'eau, rôle qu'il continue de remplir.
Mais de telles particularités ont un coût : les vendanges n'y sont pas mécanisables et la vitesse des tracteurs y est réduite de moitié par rapport aux vignobles de plaine.
Aussi, face à une concurrence croissante et à des coûts incompressibles, le risque est bien réel que ces parcelles soient abandonnées. Faute d'exploitation, elles finiraient par se dégrader, ce qui entraînerait, à terme, le déclin de ces territoires, qui vivent notamment de l'écotourisme.
Pour toutes ces raisons, les représentants de la filière des viticulteurs en terrasses souhaitent que la nature exceptionnelle et remarquable de leurs exploitations et productions soit défendue et soutenue dans le cadre des négociations de la nouvelle PAC.
Monsieur le ministre, pourriez-vous rassurer les viticulteurs de vignes en terrasses en apportant, via les mesures agroenvironnementales et climatiques, votre soutien à une viticulture qui souffre de handicaps naturels certains mais qui est garante de l'avenir de territoires ruraux dynamiques ?
Monsieur le député, je vous remercie pour cette question, très importante, car elle touche à l'écotourisme, à l'agrotourisme et à l'entretien des paysages naturels. En effet, chaque fois que l'agriculture recule, une friche s'installe, qui détériore le paysage.
Vous vous interrogez sur les mesures qui pourraient être prises pour soutenir la viticulture en terrasses et de forte pente. C'est un enjeu sur lequel je me mobilise dans le cadre des négociations de la PAC.
La viticulture française fait partie de notre patrimoine ; elle est notre histoire. Il suffit de voyager en France pour profiter des merveilleux paysages qu'elle contribue à former. Je connais les difficultés, nombreuses, que rencontre cette filière, notamment en raison des aléas du climat ou, comme vous l'évoquez ici, de la situation géographique.
Comme vous le savez, il n'existe pas de classement en « vignoble de montagne », et il est improbable que nous ne l'obtenions. En revanche, les handicaps naturels de la viticulture sont attestés et reconnus par le classement en zone de montagne, qui a permis aux viticulteurs de bénéficier des indemnités compensatoires de handicaps naturels – ICHN – , lesquelles, avec les mesures agroenvironnementales et climatiques – MAEC – , font partie intégrante du second pilier de la PAC.
Avec le Président de la République, je l'ai rappelé ici à plusieurs reprises, nous nous battons pour maintenir à l'identique le budget de la future PAC. La France est opposée à la diminution des montants alloués au second pilier. Si nous parvenons à obtenir ce budget, nous pourrons aider les viticulteurs en terrasses grâce aux ICHN et aux MAEC.
Je connais bien ces coteaux difficilement exploitables, et c'est pourquoi je souscris à votre demande. Je veux donc rassurer les viticulteurs qui vous ont interpellé : dans le cadre de la PAC, la France fera tout son possible afin que ces handicaps naturels puissent être pris en compte.

Connaissant votre engagement sur ce dossier, je sais que la voix de la France portera dans le cadre de la négociation de la nouvelle PAC. Je me réjouis également de la représentation au Parlement européen des membres de la famille politique que nous avons soutenue, notamment de Jérémy Decerle, ancien président des Jeunes agriculteurs, qui sera très mobilisé sur tous ces sujets, avec les députés français et les responsables nationaux.
Comme vous l'avez dit, il est important de maintenir à un bon niveau le budget du second pilier de la PAC car celui-ci permet de mobiliser des moyens au profit de l'aménagement de nos territoires et de nos paysages, dont la beauté est partout reconnue, et d'une agriculture de plus en plus durable, responsable et de qualité. Nous rejoignons là les préoccupations nationales, avec l'adoption de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, dite EGALIM.
Je vous remercie donc, monsieur le ministre, de vos propos très encourageants pour ce secteur agricole.

La parole est à M. Julien Dive, pour exposer sa question, no 750, relative aux inquiétudes des agriculteurs.

Monsieur le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, alors que les élections européennes se sont achevées voici quarante-huit heures, les négociations de la prochaine programmation 2021-2027 de la politique agricole commune – PAC – seront le premier chantier qui occupera les députés européens. Comme cela a été dit, une menace pèse sur son budget, pour plusieurs raisons dont certaines liées au Brexit. Or une diminution, si elle était avérée, pourrait faire courir un vrai risque à nombre de nos paysans, déjà très exposés sur le marché mondial.
La PAC, vous le savez, n'est pas une politique d'aide sociale, mais probablement la première des politiques intégrées de l'Union européenne. Sur la scène internationale, c'est un rempart qu'il convient de préserver, même si son fonctionnement doit sans doute être réformé. Tous nos concurrents internationaux – Brésil, Chine, États-Unis – ont instauré une politique d'aides à leur agriculture, qui garantit un prix minimal à leurs exploitants.
Vous le savez, un exploitant français, exposé à la volatilité des marchés, ne peut pas résister. Citons d'abord l'exemple de la filière de la betterave à sucre, pour laquelle j'avais alerté Stéphane Le Foll en 2016, puis Stéphane Travert.
La fin des quotas betteraviers en Europe, qui assuraient une stabilité des prix, a précipité les planteurs dans une violente crise. Les annonces de fermetures d'usines, comme à Cagny, en Normandie ou à Eppeville, dans les Hauts-de-France, constituent autant de catastrophes non seulement pour les emplois, directs et indirects, de ces sucreries, mais aussi pour les planteurs.
Les députés de tous les bancs de cet hémicycle, de la gauche à la droite, se sont mobilisés, à l'instar de la Confédération générale des planteurs de betteraves – CGB – , pour proposer un plan de reprise au groupe allemand Südzucker. Celui-ci, pourtant, vous le savez car vous connaissez bien le sujet, préfère contourner la loi Florange et laisser mourir ses sites.
Aussi, monsieur le ministre, je vous prie, ainsi que M. le ministre de l'économie et des finances, de durcir le ton face à ces industriels étrangers qui ne respectent pas la loi française. Je vous demande aussi de reconsidérer la position du Gouvernement sur l'éthanol et les carburants biosourcés, notamment l'E85, car dans ce domaine nous n'allons pas assez loin.
Il y a quelques jours, j'ai encore essuyé des revers à ce sujet lors de la discussion du projet de loi d'orientation des mobilités en commission. Le Gouvernement rejette systématiquement les amendements que nous déposons, alors que ceux-ci pourraient créer de vrais débouchés pour les filières agricoles, particulièrement pour la filière betteravière.
Venons-en à un second exemple, celui des pommes de terre. Depuis cinq ans, j'alerte vos prédécesseurs ainsi que les syndicats agricoles sur le fait que des exploitants belges, traversant la frontière, viennent chaque année sous-louer illégalement des terres agricoles dans le Nord et, de plus en plus, dans l'Ouest de la France. En proposant un loyer de 1 500 ou 2 000 euros par hectare, ils profitent du malaise économique de nos paysans.
Les conséquences de cette pratique sont graves : outre la spéculation foncière, qui empêche les jeunes de s'installer, elle a un fort impact écologique car la présence de plants non homologués en France peut conduire à une jachère noire dans certains territoires. Elle a aussi des conséquences structurelles très lourdes, puisqu'elle crée une concurrence déloyale, sur laquelle j'ai le sentiment que tout le monde ferme les yeux. Je demande aux pouvoirs publics de s'emparer de tous ces sujets.
Je vais tenter, dans le peu de temps qui me reste, de répondre à l'ensemble de vos questions. D'abord, je l'ai dit, la France veut le maintien du budget de la PAC, mais elle souhaite surtout que celle-ci demeure une politique européenne, et non une juxtaposition de politiques nationales.
En ce qui concerne le protectionnisme et les négociations commerciales, vous connaissez la position du Président de la République : il s'est opposé à l'ouverture de négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis au motif que ces derniers ne respectent pas l'accord de Paris sur le climat ; de même, il a prévenu que la France ne signerait pas un traité avec le Mercosur qui mettrait en cause notre agriculture ainsi que nos standards sanitaires et environnementaux.
Le dossier de la betterave est très complexe. Je reçois dans les prochains jours les dirigeants du groupe Südzucker pour essayer de les convaincre de revoir leur position. Il est inacceptable de contourner la loi, de refuser de fermer des sucreries et d'empêcher les planteurs et la CGB – Confédération des planteurs de betteraves – de les reprendre. Je regrette que Sudzücker ait refusé leur offre de reprise. Bruno Le Maire et moi allons de nouveau mettre la pression sur les dirigeants de Südzucker afin qu'ils revoient leur position. Dans le cas contraire, ils devront payer car la France les a aidés. Nous ne laisserons pas faire.
Enfin, concernant les pommes de terre, nous sommes parfaitement informés de la situation en Belgique. J'ai demandé aux services du ministère de faire preuve d'une grande sévérité car la faible qualité peut causer des problèmes sanitaires. Aujourd'hui, le code rural interdit de sous-louer des terres à des fins commerciales. Nous comptons faire respecter la loi.

La parole est à M. Jean-Noël Barrot, pour exposer sa question, no 754, relative au droit de préemption des SAFER.

Je souhaite vous interroger sur les terres agricoles, notamment en Île-de-France, qui sont de plus en souvent l'objet de comportements prédateurs d'investisseurs soit pour alimenter la spéculation foncière, dans le cas d'investisseurs étrangers, soit pour utiliser lesdites terres à d'autres fins, y compris pour détourner les règles d'urbanisme.
Dans ma circonscription, dans les Yvelines, pas un trimestre ne passe sans que l'une de ces situations ne nous soit rapportée. C'est le cas récemment d'un terrain situé au coeur d'un plateau agricole, à cheval sur les communes de Saint-Lambert-des-Bois, Saint-Forget et Chevreuse et qui couvre une surface d'environ 4 hectares. Le montant des promesses de vente s'élève à 250 000 euros, soit 65 000 euros l'hectare – dix fois le prix moyen agricole dans le secteur. L'acquéreur n'a évidemment pas l'intention de poursuivre la culture sur ces terres.
Il existe un rempart contre de tels comportements : les SAFER – sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural – peuvent préempter les terres lorsqu'elles jugent que leur usage futur ne serait pas conforme à la stratégie agricole de la France. Cependant, ce droit de préemption peut être contourné dès lors que la transaction s'effectue au travers d'une cession de parts de SCI. C'est le cas dans l'exemple que je viens de citer.
J'invite donc le Gouvernement à trouver des solutions pour lutter contre ce procédé désormais bien connu et qui s'amplifiera dans les années à venir, à mesure que les terres agricoles deviendront des objets de plus en plus prisés par les investisseurs.
Votre question s'inscrit dans le cadre de la future loi sur le foncier agricole sur laquelle nous travaillerons ensemble, je l'espère. Elle porte sur le détournement du droit de préemption des SAFER.
Aujourd'hui, des prédateurs fonciers achètent des terres agricoles. Ce n'est pas acceptable. Le Gouvernement défend l'objectif « zéro artificialisation » des terres, notamment aux abords des métropoles. Nous devons conserver les terres agricoles pour nourrir nos concitoyens et assurer notre autonomie alimentaire. C'est la raison pour laquelle nous devons être intransigeants.
La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014, dont j'avais été le modeste rapporteur au Sénat, prévoyait une meilleure information, plus complète, des SAFER. Mais aujourd'hui, cela ne suffit pas. J'ai évoqué avec le président de la Fédération nationale des SAFER la spéculation sur les terres agricoles.
Dans le cadre de la future loi sur le foncier agricole, nous travaillerons, avec tous les groupes politiques, les associations, et les syndicats agricoles afin de trouver les moyens juridiques de lutter contre la spéculation dont les investisseurs étrangers ne sont pas toujours responsables.
Le travail conséquent mené par la mission d'information commune sur le foncier agricole a déjà permis de dégager un consensus sur la nécessité de rénover nos outils de régulation. Les moyens pour y parvenir n'ont certes pas fait l'unanimité. Je salue Jean-Bernard Sempastous qui en était le président. Les divergences qui sont apparues à la fin de la mission ne sont pas gênantes, toutes les propositions sont versées au dossier.
J'espère que la grande consultation sur le foncier en France qui doit débuter la semaine prochaine permettra d'apporter des réponses à vos questions. Je sais, monsieur Barrot, que vous ne manquerez pas de vous engager à nos côtés pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés : favoriser l'installation des jeunes, faciliter l'accès aux terres, et maintenir l'agriculture traditionnelle.
Installation, transmission, interdiction de la spéculation, zéro artificialisation : voilà une belle feuille de route sur laquelle nous pourrions travailler ensemble.

La parole est à Mme Huguette Bello, pour exposer sa question, no 732, relative à l'indemnisation des agriculteurs d'outre-mer.

Ma question concerne les indemnisations versées aux agriculteurs de La Réunion qui ont subi une catastrophe naturelle. Elle porte aussi bien sur les délais que sur les modalités de calcul.
Les délais de paiement peuvent dépasser une année en raison d'une succession de contrôles. En effet, après avoir attendu la fin de la campagne sucrière pour disposer des éléments chiffrés, les planteurs transmettent leurs demandes aux services de la DAAF – direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt – de La Réunion qui procède alors à une première instruction. Celle-ci dure entre deux et trois mois, puis elle est suivie d'un nouveau contrôle effectué, cette fois, par le ministère des outre-mer. Ensuite, le ministère des Finances procède à ses propres vérifications avant la mise en paiement.
C'est ainsi, par exemple, que les planteurs de canne à sucre qui ont subi des pertes à cause du passage de la tempête Fakir en avril 2018 commencent tout juste ces jours-ci à être indemnisés.
Il est évident qu'un tel délai est incompatible avec les exigences du calendrier agricole. Faute de trésorerie suffisante pour investir en temps voulu dans leurs champs, les planteurs n'ont plus d'autre choix que d'abandonner la culture de la canne. C'est le scénario que vivent en ce moment même une centaine d'entre eux. La situation n'est pas plus réjouissante pour les maraîchers.
La deuxième difficulté concerne les modalités de calcul des indemnités. La perte est évaluée pour chaque exploitant en se référant à sa production an cours des cinq dernières années. Sont pris en compte non seulement le tonnage mais aussi la richesse en sucre. La récolte de l'année est alors rapportée à la moyenne dite « olympique », c'est-à-dire celle qui exclut la meilleure et la moins bonne des récoltes. Si la perte de récolte est supérieure à 25 %, le planteur pourra prétendre à une indemnisation. En deçà, il devra supporter seul les conséquences de la catastrophe naturelle. Ce pourcentage, fixé par circulaire interministérielle, contraint lui aussi de nombreux planteurs à mettre fin à leurs activités.
Ces deux difficultés ont en commun de ne pas être insurmontables, d'où mes deux questions.
Le délai d'indemnisation ne pourrait-il pas être ramené à des proportions plus raisonnables ? Pourquoi en effet doubler les contrôles effectués par les services déconcentrés de l'État par une intervention du ministère des outre-mer ?
Le taux de 25 % ne devrait-il pas être révisé et diminué de moitié afin de ne pas mettre en danger un trop grand nombre d'exploitations ?
Ces questions sont cruciales au moment où le sucre réunionnais, comme la betterave ici en France, doit faire face, avec la fin des quotas, à une concurrence mondiale de plus en plus vive.
Vous m'interrogez sur les conséquences des catastrophes naturelles pour les agriculteurs dans les régions d'outre-mer, en particulier leur indemnisation.
Je vous apporte une première réponse qui devrait vous satisfaire : la tempête Fakir qui s'est abattue l'année dernière sur l'île de La Réunion a causé des dégâts très importants – le maraîchage, l'arboriculture et l'horticulture sont les filières qui ont été les plus touchées. Au regard de la situation, l'état de catastrophe naturelle a été retenu pour quinze communes de La Réunion et le fonds de secours pour l'outre-mer a été mobilisé. Les paiements correspondant aux indemnisations des exploitants de canne ont été versés dans le courant du mois de mai, selon un calendrier accéléré, conformément à l'engagement pris par la ministre des outre-mer en novembre 2018. Les syndicats agricoles locaux ont d'ailleurs manifesté leur satisfaction aux services de l'État – je les en remercie.
Ensuite, une réflexion est engagée au niveau national pour modifier le système d'indemnisation des dégâts liés aux catastrophes naturelles afin, d'une part, de responsabiliser les agriculteurs, et d'autre part, d'obtenir de meilleurs taux de compensation des pertes subies par un effet de levier sur les fonds communautaires. Il faut maintenir les contrôles en veillant à ce qu'ils soient adaptés – il faut, en effet, des éléments d'évaluation objectifs.
Le travail engagé, qui associe le ministère des outre-mer et le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, s'inscrit dans un calendrier accéléré. Notre objectif est d'indemniser de la meilleure manière et le plus rapidement possible les agriculteurs, en métropole et dans les outre-mer.

La parole est à M. Jean-Philippe Ardouin, pour exposer sa question, no 742, relative au gel dans les vignes du cognac.

Dans les nuits du 4 au 6 mai dernier, le gel a encore frappé durement le vignoble charentais. De nombreux secteurs ont été touchés, notamment en Charente-Maritime autour des communes de Saintes et de Matha, et en Charente, autour de Cognac et de Jarnac.
Les surfaces concernées représentent 10 à 15 % du vignoble, à des degrés divers. Même si l'épisode de gel apparaît moins important qu'en 2017, où plus d'un quart du vignoble avait été lourdement endommagé, certaines parcelles de vignes sont plus durement touchées qu'en 2017 ou lors du fléau de la grêle de 2018.
Les conséquences sur la récolte s'annoncent désastreuses. La venue tardive de cet épisode gélif, juste avant les Saints de glace, alliée à la grande précocité de la croissance de la vigne après un hiver des plus doux – sûrement en raison du réchauffement climatique – ne permet pas d'être optimiste pour les années à venir.
Les services déconcentrés de l'État accompagnent les viticulteurs et je les en remercie. Des mesures fiscales et sociales devront être prises comme les années précédentes : exonération exceptionnelle de la taxe sur le foncier non bâti ou aménagement d'échéanciers de règlement des cotisations dues à la Mutualité sociale agricole. Cependant, ces mesures classiques et utiles doivent être complétées par d'autres, simples et rapides à mettre en oeuvre, qui sont attendues par les exploitants viticoles en grande difficulté. De premières avancées ont été obtenues par la majorité, comme la déduction fiscale pour épargne de précaution dans la loi de finances pour 2019. Pourtant, étonnamment, les viticulteurs, notamment ceux, très majoritaires, sous la forme sociétaire, ne peuvent pas encore en disposer.
Compte tenu de la fréquence très rapprochée de ces épisodes de gel ou de grêle, il semble opportun d'étendre à tous les dispositifs d'épargne de précaution, afin que chacun puisse anticiper, pour sa trésorerie, le recours à cette épargne.
Envisagez-vous, monsieur le ministre, de mettre à l'étude l'extension de mesures fiscales concrètes et rapides telles que l'épargne de précaution et de compléter les dispositifs existants, en vue de sauvegarder et de pérenniser l'activité des 50 000 personnes qui vivent du cognac ?
Monsieur Ardouin, je tiens tout d'abord à assurer très sincèrement les viticulteurs de Cognac et, plus largement, tous les agriculteurs touchés par le gel de mon soutien et de celui du Gouvernement, qui répondra présent. La répétition de ces phénomènes rend nécessaire le développement d'outils de gestion des risques et des variations de revenu tels que l'épargne de précaution que nous avons créée l'année dernière – vous l'avez évoquée.
Pour être plus précis, plusieurs mesures, notamment d'ordre fiscal, sont susceptibles de répondre à la demande que vous formulez.
Tout d'abord, en cas de perte de récolte sur pied par suite notamment du gel, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles atteintes est accordé au contribuable pour l'année en cours, sur réclamation auprès des services fiscaux du département. Cette mesure est simple : le dégrèvement est proportionnel à l'importance des pertes constatées sur la récolte de l'année ; il est accordé pour l'année du sinistre et, le cas échéant, pour les années suivantes, si les effets du sinistre s'étendent sur plusieurs années.
Afin de répondre aux difficultés conjoncturelles rencontrées par les viticulteurs de Cognac à la suite de l'épisode de gel survenu dans le vignoble charentais les nuits du 4 au 6 mai 2019, je demanderai au ministre de l'action et des comptes publics, s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l'année 2019, d'examiner avec bienveillance les demandes de dégrèvement dûment justifiées présentées par les professionnels concernés.
J'appellerai en outre son attention sur l'intérêt de faire bénéficier les agriculteurs touchés, en fonction de leur situation, de mesures de bienveillance, notamment sous la forme de délais de paiement ou de remises gracieuses eu égard aux différents impôts et taxes auxquels ils sont assujettis.
Enfin, je précise que le dispositif de déduction pour épargne de précaution, que vous avez créé dans le cadre de la loi de finances pour 2019 à l'issue de la réforme de la fiscalité agricole, peut être utilisé par les exploitants individuels ainsi que par les sociétés et groupements agricoles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, sous réserve qu'ils soient imposés selon un régime réel d'imposition.
Nous savons très bien que les calamités risquent d'augmenter dans les années qui viennent, notamment en raison du réchauffement climatique et de l'ensemble des aléas météorologiques. C'est pourquoi, dans le cadre de la révision de la politique agricole commune, je travaille avec mes collègues européens et les syndicats agricoles français à l'instauration d'un système assurantiel fort, qui s'ajoutera au filet de sécurité existant. Ce système assurantiel permettra de répondre aux demandes des agriculteurs lorsqu'ils sont touchés par des épisodes climatiques de cette nature, gel ou autre. Aujourd'hui, la loi ne le permet pas totalement ; l'assurance dépend des filières et n'est pas obligatoire. Je souhaite que ce système assurantiel soit le plus solide possible.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse. Je sais que le Gouvernement et vous tout particulièrement êtes attentifs à ce sujet et à une profession qui est non seulement tributaire, comme beaucoup, des contraintes économiques, mais dépend en outre étroitement des conditions climatiques, qui peuvent se révéler dramatiques. Il importe donc d'appliquer ces mesures pour accompagner et aider ce secteur d'activité agricole et viticole. Il s'agit de pérenniser ces professions, qui jouent un rôle fondamental pour notre ruralité et nos territoires.

La parole est à M. Didier Le Gac, pour exposer sa question, no 735, relative aux actions des associations animalistes et à la protection des agriculteurs.

Monsieur le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, je souhaite appeler votre attention sur les actions que mènent en ce moment certaines associations à l'encontre de nos agriculteurs. Depuis plusieurs mois, on assiste en Bretagne, comme sur l'ensemble du territoire, à une multiplication d'actions choc à l'encontre des exploitations agricoles. Sous couvert de dénonciation de mauvais traitements qui seraient infligés aux animaux, ces associations s'introduisent par effraction dans les exploitations. Dans ma circonscription du Finistère, on a recensé, depuis le début de l'année, plusieurs intrusions dans des élevages avicoles et, surtout, porcins.
Jeudi dernier encore, l'association Direct Action Everywhere a diffusé sur internet une vidéo mettant en scène l'un de nos collègues – eh oui, monsieur le ministre, un député ! – dans une porcherie des Côtes-d'Armor, dans laquelle il était entré sans autorisation, en toute illégalité.
Ces agissements, qui relèvent de l'agri-bashing, à savoir du dénigrement permanent de la profession, suscitent la colère et l'incompréhension de nos agriculteurs.
Chacun doit respecter la loi, mais, avant tout, chacun doit respecter l'autre. C'est pourquoi ces pratiques doivent être condamnées et sanctionnées. Les associations doivent d'abord respecter le travail des agriculteurs.
Bien évidemment, en cas d'attaque de cette nature, les agriculteurs doivent porter plainte. Néanmoins, si nos agriculteurs doivent activer le levier judiciaire quand ils sont confrontés à ces intrusions, ils veulent avant tout montrer et démontrer à tous qu'ils n'agissent pas contre le bien-être animal.
En effet, ne nous y trompons pas : nos éleveurs appliquent rigoureusement la réglementation en vigueur et sont, vous le savez, engagés dans des plans de filière, avec des objectifs clairs pour améliorer encore le bien-être de leurs animaux, qu'ils n'ont d'ailleurs jamais négligé ; ils sont en conformité avec les règles sanitaires et de biosécurité, ce qui permet d'éviter les épizooties, comme la fièvre porcine africaine en ce moment. Bref, leurs journées de travail sont rythmées par les soins qu'ils apportent à leurs animaux.
De plus, la transition vers une organisation plus raisonnée de nos productions se fera, mais elle doit se faire les uns avec les autres, non les uns contre les autres. Selon un sondage récent, 82 % des Bretons ont une bonne image de leurs agriculteurs. S'ils sont en quête d'informations, nos agriculteurs sont prêts à les leur donner, notamment en ouvrant leur exploitation.
La pression ainsi exercée, qui vise à marquer le refus de certains modes d'élevage et à les supprimer, est intolérable. En outre, elle se révèle particulièrement contre-productive, car elle expose en définitive nos producteurs français à subir une concurrence accrue des produits importés, issus d'animaux élevés à l'étranger dans des conditions souvent bien plus discutables.
Ces intrusions provoquent un climat de tension véritable. Compte tenu de l'accélération du phénomène, monsieur le ministre, le Gouvernement entend-il procéder à un renforcement du dispositif pénal pour protéger les agriculteurs face à ces agissements inacceptables ?
Je tiens tout d'abord à vous saluer, monsieur Le Gac, pour votre engagement et le sens de votre question. Vous l'avez posée dans la sérénité, en exposant factuellement ce qui s'est passé et en essayant de comprendre et, surtout, de trouver des réponses. Comme vous et vos collègues siégeant sur les différents bancs de l'Assemblée, tous les membres du Gouvernement luttent contre l'agri-bashing – c'est, je crois, un terme de patois du Finistère ?
Sourires.
Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais il n'est pas acceptable que l'on s'attaque à des personnes et à leur outil de travail. En l'espèce, le Gouvernement fera preuve d'une vigilance et d'une sévérité à toute épreuve. Il y a quelques semaines, Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, a adressé une instruction à tous les procureurs de la République pour les inciter à la plus grande fermeté vis-à-vis de ceux qui attaquent les boucheries ou s'introduisent dans les élevages. Je me suis rendu récemment sur un marché parisien, où un jeune boucher s'était fait agresser et frapper ; du sang avait été renversé sur tous ses produits, qui avaient dû être jetés.
Il est indispensable que les éleveurs et les agriculteurs touchés portent plainte. Dans mon département, j'ai moi-même installé, à titre expérimental, un comité qui rassemble les acteurs concernés, notamment le procureur de la République, la justice, la police et la gendarmerie. Nous allons voir comment cet observatoire de lutte contre l'agri-bashing pourrait être généralisé à l'échelle nationale.
Vous avez souligné à juste titre que les éleveurs aiment leurs bêtes et travaillent du mieux qu'ils peuvent. Ils sont les premiers responsables du bien-être animal, dont on parle souvent. Pour ma part, je voudrais que l'on parle aussi du bien-être des éleveurs. Il faut qu'on arrête de les montrer du doigt et de les attaquer. Nous serons intransigeants à cet égard.
Un député de la République est entré par effraction dans un élevage, de façon honteuse. Je le dis ici, monsieur Le Gac : cela aussi doit être condamné. Dans le respect de la séparation des pouvoirs, j'estime que ce n'est pas l'image que doit donner un député ; ce n'est absolument pas acceptable.
Le cadre législatif répressif est suffisant en la matière. Toutefois, compte tenu de la généralisation du problème à l'ensemble de nos territoires, il a été demandé à la justice et à la police de renforcer la prévention des débordements et d'apporter une réponse systématique et individualisée aux faits.
Mme la garde des sceaux a demandé que la mise en cause de la responsabilité pénale des associations militantes puisse être envisagée le cas échéant, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, en cas d'infraction commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. En complément de la peine d'amende, la peine d'affichage de la décision prononcée pourra être utilement requise, en application de l'article 131-39 du code pénal.

La parole est à Mme Béatrice Piron, pour exposer sa question, no 738, relative aux stages courts pour les étudiants.

Madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, l'effort de professionnalisation est primordial pour l'insertion future des étudiants, car les employeurs attendent, en sus de solides connaissances académiques, une première expérience en milieu professionnel, même pour le recrutement d'un junior. Fortes de ce constat, un nombre croissant d'universités et d'écoles supérieures ont intégré la réalisation d'un ou plusieurs stages dans leur cursus de formation, au cours de la licence ou du master.
La durée du stage varie de quelques jours à six mois, qui est la durée maximale. Selon la durée, les contraintes ne sont pas les mêmes pour l'employeur : au-delà de deux mois, il doit verser une gratification au stagiaire.
Les employeurs recrutent très volontiers, pour cinq ou six mois, des stagiaires en fin d'études, ce qui leur permet souvent d'envisager une embauche à l'issue du stage. Ces stages longs sont un vrai « plus » pour les entreprises. En revanche, les entreprises proposent très peu de stages d'une durée inférieure, ce qui rend très difficile la recherche d'un stage pour les étudiants qui doivent obligatoirement en réaliser un en cours d'études. Il semble que la gratification constitue un obstacle à l'obtention d'un stage de plus de deux mois, car il est complexe pour une entreprise de former et d'indemniser un stagiaire pour trois mois seulement.
La formation d'un stagiaire est exigeante : elle nécessite du temps et des moyens que les entreprises ne peuvent pas toujours mobiliser sur une période courte, d'autant qu'elles n'en tirent aucun avantage immédiat, puisque les stagiaires ne resteront pas.
La recherche de stage est donc très difficile pour les étudiants concernés. Ils candidatent spontanément auprès de nombreuses entreprises, mais, souvent, ne reçoivent pas de réponse. Ils mobilisent au mieux leur réseau personnel. Toutefois, ils ne disposent pas toujours du réseau adéquat.
Les universités et les écoles exigent la réalisation de ces stages pour valider un diplôme, mais l'accompagnement qu'elles fournissent en la matière est souvent peu satisfaisant. Certains étudiants qui ont achevé et validé leur formation académique ne sont pas diplômés parce qu'ils n'ont pas effectué de stage. Or on constate qu'ils n'ont parfois reçu aucune assistance de la part de leur établissement.
Dès lors, madame la ministre, pourriez-vous nous indiquer quels dispositifs d'incitation existent pour encourager les entreprises à accueillir des étudiants qui ne réalisent pas forcément un stage de fin d'études ? Par ailleurs, quels moyens les universités et les écoles supérieures mobilisent-elles pour accompagner la professionnalisation de leurs étudiants ? Elles peuvent notamment lier des relations avec le monde de l'entreprise. Elles pourraient, au minimum, proposer un volume d'offres de stage, ce qui serait utile, voire indispensable, pour les étudiants qui ne disposent pas de réseau familial.

La parole est à Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Vous avez soulevé, madame Piron, une question essentielle, celle de l'accès aux stages et, plus largement, de la professionnalisation et de l'insertion des jeunes. C'est, vous le savez, une priorité des politiques publiques que nous menons depuis mai 2017. Le thème de la professionnalisation a d'ailleurs fait l'objet d'une large concertation, qui s'est conclue par la remise du rapport de MM. Rodolphe Dalle et François Germinet.
La professionnalisation et l'insertion passent souvent par des périodes d'immersion en milieu professionnel ainsi que par la possibilité d'inscrire ces périodes comme partie intégrante des diplômes. L'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence, qui a rénové les dispositions applicables en la matière, permet désormais de reconnaître et de valoriser l'expérience professionnelle dans le cadre d'un diplôme.
Cela étant, vous avez raison, il faut aller plus loin et étendre le champ des propositions en matière de stages. C'est pourquoi la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants du 8 mars 2018 a créé les observatoires de l'insertion professionnelle des établissements d'enseignement supérieur, chargés notamment de diffuser les offres de stage. Ce matin, une charte sur l'amélioration de l'orientation pour le secondaire et le supérieur a été signée avec l'Association des régions de France, afin que les établissements puissent tisser plus de contacts avec le monde socioéconomique et mettre des offres à la disposition des étudiants. C'est déjà le cas dans de très nombreux établissements, qui ont recruté des personnes spécialement chargées d'accompagner les jeunes étudiants dans leur recherche de stage, puis dans leur recherche d'emploi. Des sites internet ont aussi été mis en place dans la plupart des établissements. Par ailleurs, nous encourageons les possibilités de rencontres entre les entreprises et les étudiants : j'en veux pour preuve l'événement qui s'est tenu il y a quelques jours à Nantes, où plus de 900 rendez-vous ont été organisés.
Le sujet de la gratification peut constituer un problème, mais je rappelle que celle-ci a été mise en place, entre autres raisons, pour éviter que les entreprises n'accumulent les stagiaires et afin que ces derniers soient rétribués pour leur participation au développement de l'entreprise.

Je vous remercie, madame la ministre, et j'espère que de nombreux étudiants trouveront un stage cet été.

La parole est à M. Jean-Paul Lecoq, pour exposer sa question, no 731, relative à la fusion des universités normandes.

Madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la possible fusion des universités normandes constitue un enjeu majeur pour la qualité des formations en Normandie. Ce projet, lancé par le président de la région et la précédente préfète, soulève inquiétude et incompréhension parmi nombre d'étudiants, d'enseignants, d'employés de ces universités et de personnes concernées, notamment au Havre. Alors que la COMUE – communauté d'universités et établissements – Normandie Université existe depuis 2014 et permet déjà un travail intense entre tous les acteurs de l'éducation supérieure en Normandie, la fusion des universités de Caen, Rouen et Le Havre n'en finit pas de faire parler d'elle.
La COMUE permet une mise en réseau saluée par tous ; c'est un véritable organe de coopération, et c'est sur cette base concrète que la communauté universitaire avance depuis plusieurs années. Actuellement, chacune des trois universités est assise sur un large bassin de vie et d'emplois dont la densité de population est souvent équivalente à un ou plusieurs départements de taille moyenne. Les formations comme les secteurs de recherche sont connectés aux acteurs économiques et institutionnels locaux. Nous ne sommes pas sur une échelle identique à celle d'autres projets de fusion universitaire, qui s'inscrivent au sein d'une même métropole ou d'un même département.
Outre la perte d'autonomie, la fin des synergies avec les acteurs locaux, la centralisation des services supports et la perte de débouchés locaux pour nombre d'étudiants, cette fusion entraînerait la spécialisation des centres universitaires. Surtout, aucun des éléments avancés ne permet, à ce jour, d'établir clairement en quoi cette fusion pourrait améliorer les conditions et la qualité de l'enseignement offertes aux élèves, à leurs familles ou aux personnels des services de l'éducation en Normandie. Qui plus est, elle ne semble pas s'accompagner de dotations supplémentaires en faveur du système éducatif.
Le principal argument avancé consiste à soutenir que, plus une université est importante, plus elle est visible, et plus grande sera son attractivité internationale. Or la quantité ne fait pas la qualité, surtout dans un contexte où les Français aspirent à davantage de proximité. Il ne fait aucun doute qu'en regroupant des formations au sein d'une gigantesque machine, on fera primer la quantité sur la qualité de la formation. Or sans la qualité, adieu la visibilité à l'international ! Nous avons donc tout à perdre dans ce projet.
Le but inavoué de cette fusion semble être, comme toujours, la recherche d'économies budgétaires. Elle n'est pensée en aucun cas pour le bien-être des étudiants, des chercheurs, du personnel et des enseignants. Pis, cela risque d'éloigner les centres de décision les uns des autres, de conduire à une gestion, au sein des facultés, discipline par discipline, et, partant, de faire reculer la transversalité des savoirs que les universités tentent de favoriser depuis plusieurs années. La transversalité se développe souvent en lien avec le tissu économique : n'est-ce pas ce que nous souhaitons, les uns et les autres ? Les syndicats du personnel et des étudiants se sont d'ailleurs élevés contre ce projet de fusion, qui fait quasiment l'unanimité contre lui.
Madame la ministre, où en est ce projet ? Pourriez-vous nous indiquer quelle est la position actuelle de l'État quant à la fusion des universités de Rouen, Caen et du Havre ?

La parole est à Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Comme vous l'avez rappelé à juste titre, monsieur le député, la COMUE « Normandie Université », qui a vu le jour en 2014, a permis d'intensifier la coopération entre établissements à l'échelle régionale, notamment pour qu'ils développent des orientations académiques communes. Grâce à cet effort, la COMUE a pu répondre à de nombreux appels à projets et a rencontré quelques succès notables, notamment dans le domaine des nouveaux cursus universitaires ou s'agissant de « Normandie Valorisation », qui a pour objet la valorisation de la recherche académique.
En janvier 2018, les échecs des candidatures normandes aux appels à projet « IDEX-ISITE » – initiatives d'excellence et initiatives dans le domaine de la science, de l'innovation, des territoires et de l'économie – et à ceux concernant les écoles universitaires de recherche ont toutefois soulevé des inquiétudes. Le recteur, la préfète et le président de la région ont cosigné un courrier adressé aux membres de la communauté d'établissements pour leur faire part de leur crainte d'un « lent et silencieux déclassement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie ». Ils ont en particulier déploré un défaut d'ambitions et ont invité les établissements à envisager des scénarios de rapprochement, voire de fusion. J'ai mandaté Bernard Dizambourg pour accompagner ces établissements dans la construction de leur projet. Cela étant, je veux réaffirmer mon attachement – que vous connaissez – à l'autonomie des universités. Le projet devra donc se construire et émerger à partir des établissements ; je n'exercerai aucune pression particulière.
Pour capitaliser et consolider les acquis, la possibilité de faire évoluer la COMUE – notamment son mode de gouvernance – a été évoquée. C'est désormais possible grâce à l'ordonnance du 12 décembre 2018, qui permet la création d'un établissement public expérimental. Pour favoriser l'adhésion de tous, il faudra par ailleurs que les missions et les projets communs, bien plus que les structures, soient mis en avant.
Les universités de Caen et de Rouen ont choisi d'inscrire leur progression dans le cadre d'une fusion. L'université du Havre pourra continuer à travailler avec ces deux universités fusionnées ou choisir de les rejoindre – cela fera partie, je n'en doute pas, des discussions qui auront lieu préalablement à l'élection des conseils au sein des trois universités, au printemps 2020. Chaque établissement devra se positionner. Ce qui est certain, c'est qu'il faut encourager la coopération entre eux et oeuvrer à ce qu'ils bénéficient d'une meilleure visibilité. Bien entendu, rien ne sera imposé aux établissements.

Prochaine séance, cet après-midi, à quinze heures :
Questions au Gouvernement ;
Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi de transformation de la fonction publique ;
Suite de la discussion de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale.
La séance est levée.
La séance est levée à douze heures quarante.
Le Directeur du service du compte rendu de la séance
de l'Assemblée nationale
Serge Ezdra