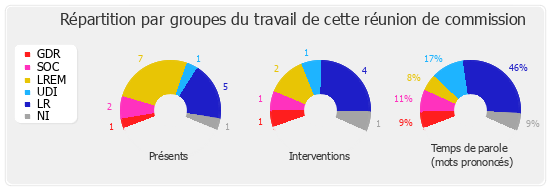Mission d'information sur l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l'épidémie de coronavirus-covid 19 en france
Réunion du mardi 21 juillet 2020 à 12h00
La réunion
Mission d'information de la conférence des Présidents sur l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l'épidémie de Coronavirus-Covid 19
Présidence de M. Julien Borowczyk
La mission procède à l'audition du colonel Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) et du médecin-colonel Patrick Hertgen, vice-président chargé du secours d'urgence aux personnes et du service de santé et de secours médical.

Mes chers collègues, nous auditionnons le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), le colonel Grégory Allione, qui est aussi directeur départemental du service d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône. Nous allons également entendre le médecin-colonel Patrick Hertgen, vice-président de la FNSPF chargé du secours d'urgence aux personnes et du service de santé et de secours médical, qui exerce actuellement comme médecin sapeur-pompier à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Dans les situations de crise, les sapeurs-pompiers sont au front. Ils font face aux urgences, en liaison avec les préfets et les départements. Or, récemment, différents éléments d'un rapport consacré à la crise sanitaire sont parus dans la presse, extraits d'un retour d'expérience de la gestion de la crise sanitaire du point de vue de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Ce document portait de très vives critiques sur l'organisation de la gestion de crise. Vous nous avez fait parvenir la synthèse finale, qui apporte des nuances sur lesquelles nous reviendrons, et que vous aurez l'occasion d'exposer ; il n'en demeure pas moins que s'exprime ainsi un malaise des sapeurs-pompiers, qui se sont sentis mis de côté dans la réponse à la crise sanitaire. À lui seul, ce point, qui peut paraître paradoxal, mérite toute notre attention.
Avant de vous donner la parole, messieurs, je vais vous demander de prêter serment. En effet, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».
(M. Grégory Allione et M. Patrick Hertgen prêtent serment.)
La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui compte 281 000 membres, et, au-delà, l'ensemble des sapeurs-pompiers de France, ont souhaité faire un retour d'expérience sur ce que nous avions vécu pendant la crise. Je rappelle que les sapeurs‑pompiers réalisent 4,1 millions d'interventions dans le domaine du secours d'urgence aux personnes. Nous avons la prétention de dire qu'ils sont des acteurs de la santé des territoires, avec 7 000 unités opérationnelles réparties dans l'ensemble des départements. Nous les avons appelés récemment les « soldats de la vie » parce que nous considérons qu'ils sont les premiers acteurs de l'urgence – avec d'autres partenaires. Ils ont été les premiers à constater les effets du covid-19 sur nos anciens et sur l'ensemble de la population. Au moment même où nous parlons, ils effectuent encore des opérations taguées « covid » dans le système d'information. Cela veut dire que la maladie est toujours présente.
Vous avez parlé du retour d'expérience et du document dont le contenu s'est retrouvé dans la presse. Je considère, comme je l'ai rappelé au Sénat la semaine dernière, qu'un seul et unique document émanant des sapeurs-pompiers de France doit être la base notre propos : celui que nous vous avons transmis hier soir. C'est celui-ci qui constitue le retour d'expérience des sapeurs-pompiers de France.
Nous avons souhaité souligner le fait que, lors de la crise, a été utilisé un modèle de gestion qui n'est pas celui que nous connaissions jusqu'à présent. Nous nous en étonnons. Nous pensons que la crise a été plus administrée que gérée, et ce pour une seule et unique raison : le choix a été fait de confier le déroulement des opérations à celles et ceux qui, certes, administrent la santé au quotidien, notamment les agences régionales de santé (ARS), mais qui n'ont pas pour habitude de gérer des crises.
La façon de procéder a été très éloignée des principes guidant habituellement la gestion des crises, qui sont au nombre de trois.
Premièrement, le commandement unique. Comme vous le savez, le maire est le directeur des opérations de secours, épaulé par le commandant des opérations de secours ; si la crise dépasse le cadre de la commune, c'est le préfet qui prend la main ; si elle revêt une dimension nationale, c'est le Premier ministre qui intervient, avec tous les outils dont dispose le ministre de l'intérieur, pour prendre en compte tous les aspects interministériels.
Deuxièmement, la déclinaison territoriale qui revient aux préfets.
Troisièmement, la mobilisation de la totalité des forces locales : les élus et leurs services en première ligne, les forces de sécurité intérieure, les professionnels de santé lorsqu'il le faut, les bénévoles et les associations, mais aussi les partenaires sociaux.
Nous avons relevé que la participation des sapeurs-pompiers avait été peu souhaitée. Cela a même été dit par certaines personnes lors des auditions, ici même ou au Sénat. Visiblement, à les en croire, en matière d'urgence, les sapeurs-pompiers ne savent pas faire – alors même qu'ils effectuent 4,1 millions d'interventions chaque année au bénéfice de la population.
En outre, on a essayé d'assécher nos services de santé, notamment en appelant ses membres à participer à la réserve sanitaire, alors que ce sont eux qui garantissent, avec les services d'aide médicale urgente (SAMU), l'aide médicale d'urgence. Ce sont eux également qui, en ce moment même, relancent la phase de test dans les territoires, alors que certaines ARS manquent de main-d'œuvre. Les infirmiers sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers formés à cette mission vont tester la population. Pourquoi n'ont-ils pas été appelés à le faire au tout début de la crise ? Les associations agréées de sécurité civile ont été utilisées par les ARS, alors que, comme leur nom l'indique, il s'agit d'associations. Lorsqu'il a fallu les mobiliser, elles étaient attirées par d'autres choses, notamment des compensations financières dont le ministère de l'intérieur ne disposait pas, d'ailleurs.
Finalement, tout ne s'est pas trop mal passé sur le territoire, mais pour une seule et unique raison : une forte réactivité, la souplesse et la polyvalence des uns et des autres – et le fait qu'ils ont coopéré parce qu'ils se connaissaient. La semaine dernière, certains parlementaires ont été tentés de parler d'une guerre supposée entre « blancs » et « rouges », dont il est sans arrêt question dans les médias. Il serait dommage de donner l'image d'un débat de cour de récréation, alors qu'il s'agit d'une discussion autour de positions différentes et qu'il y va des principes fondamentaux qui permettent de gérer l'urgence au quotidien, ainsi que les situations de crises.
Cela ne s'est pas trop mal passé, disais-je, parce que les sapeurs-pompiers, les hospitaliers, les acteurs du secteur médico-social, l'ensemble du monde de la santé, toutes celles et ceux qui font la santé du quotidien, se connaissent, s'apprécient et ont les mêmes valeurs, pour faire en sorte d'accomplir leur mission jour après jour. Cette réussite au niveau local s'explique par le lien solide qui existe avec les préfets, qui organisent la réponse de l'État sur le plan économique et social, mais aussi sur le plan de la santé et celui de l'urgence. Ce sont les préfets qui, lorsqu'ils ont pu le faire, ont organisé les opérations et fait en sorte que les sapeurs‑pompiers soient sollicités.
Cette réussite est aussi due à l'agilité et à la robustesse des SDIS, qui ont une vingtaine d'années d'existence – depuis la loi de 1996 qui a départementalisé l'organisation des services d'incendie et de secours. Ils sont animés par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Celle-ci doit continuer sa mue et être renforcée.
La performance de notre système de sécurité civile s'explique aussi par son caractère hybride, avec la possibilité de recourir au volontariat qui permet d'agréger des compétences : il doit être défendu pour continuer à répondre aux enjeux de protection civile dans les territoires. Le maillage territorial, d'ailleurs, a contribué lui aussi à la réussite.
Enfin, je voudrais insister sur la qualité des liens entre les sapeurs-pompiers et le monde hospitalier, car si nous avons fait preuve d'une grande agilité, d'une grande souplesse et d'une adaptation sans faille dans les territoires, il faut relever que ceux qui servent dans les hôpitaux n'ont pas été en reste, dans un moment où on nous demandait de nous passer de beaucoup de choses et de faire appel au « système D ».
Quant aux enseignements que nous tirons de la crise, nous pensons, d'abord, qu'il faut refondre notre système de santé, accroître son agilité, renforcer la proximité et la territorialisation, qui a été oubliée au cours des vingt ou trente dernières années : il faut faire en sorte que les acteurs de terrain, privés ou publics, puissent répondre aux enjeux de santé, plutôt que de s'en tenir au « tout-urgences ».
Ensuite, nous en appelons au respect du credo en matière de gestion de crise, à savoir l'attribution claire au ministère de l'intérieur du pilotage opérationnel des crises sur le territoire national, au bénéfice du Gouvernement. En effet, nous avons connu, pendant la crise du covid‑19, la même chose qu'au moment de l'incendie de Lubrizol et de la catastrophe de Brétigny‑sur‑Orge : une difficulté de gestion liée au fait que l'ensemble des ministres ou des secteurs administratifs souhaitaient intervenir, voire accaparer la question technique dont ils ont la charge et qu'ils administrent habituellement, alors que ceci n'a rien à voir avec la gestion de crise.
Enfin, nous proposons une nouvelle ambition en matière de protection civile, faisant des sapeurs-pompiers les acteurs majeurs des urgences pré-hospitalières et de la gestion des crises. Notre pays doit privilégier les systèmes à la fois réactifs, garantissant l'agilité territoriale et permettant de planifier et de se projeter dans le long terme. Il faut conforter les trois principes fondamentaux de la doctrine de gestion de crise que sont l'unité du commandement, la déclinaison territoriale et la mobilisation de toutes les forces. On doit s'appuyer sur des piliers essentiels pour gérer une crise : respecter le pilotage de la gestion de crise autour des préfets et des préfets de zone ; développer la résilience de la population, que la FNSPF appelle de ses vœux depuis la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, ce qui passe notamment par une politique de développement du volontariat qui permette de se donner enfin des ambitions en matière de protection civile dans tous les territoires ; enfin, reconnaître la capacité des SDIS en matière médicale, notamment en distinguant un numéro de l'urgence, le 112, dont ils auraient la charge, avec les autres acteurs du secteur, et un numéro de la non-urgence, le 116 117, réservé au service d'accès aux soins – M. le ministre de la santé vient d'évoquer, en clôture du Ségur de la santé, une expérimentation en la matière.

Je voudrais d'abord revenir sur l'organisation de votre communication. Nous avons entendu parler d'un rapport, qui n'a pas été rendu public mais qui a donné lieu à de nombreuses fuites dans les médias. Excusez-moi de vous le dire, mais cela me fait penser à une opération de communication.
Nous avons maintenant pour base de travail la synthèse que vous nous avez envoyée hier. Est-ce à dire que nous ne travaillons plus sur certains faits évoqués dans le premier document, notamment une surmortalité avérée dans le cadre de la prise en charge par les SAMU ? Considérez-vous toujours que les transports de patients relèvent, comme cela a été lu dans la presse, de l'« esbroufe » ? Pensez‑vous que le dimensionnement de votre communication en amont permet d'envisager une meilleure coopération entre les blancs et les rouges – même si cette coopération, dans les territoires, est en général plutôt bonne. Nous traversons une période qui, a priori, doit plutôt nous amener à un travail en commun, au bénéfice de nos concitoyens.
Estimez-vous, comme vous avez eu l'occasion de le dire, que certains appels n'ont pas été transférés et que le 18 n'a pas été utilisé à sa juste mesure ? Sur le site internet de vos services, sont indiqués les cas dans lesquels on peut joindre les pompiers : malaise, blessure grave, départ de feu, accident de la route, noyade, inondation.
Le docteur Braun, du service du SAMU, nous disait lors de son audition qu'il y avait eu une augmentation de 20 % des appels au 18. Confirmez-vous ce chiffre ? Dans le même temps, en moyenne, dans les centres du 15, le nombre d'appels a triplé.
Il était question dans le rapport de « perte de chance » : maintenez-vous ces termes ? Le docteur Braun a évoqué la double régulation entre la permanence des soins (PDS) et l'aide médicale d'urgence (AMU) et a indiqué que, dans les cas relevant d'appels pour urgence grave, en particulier les arrêts cardiaques, il n'y avait pas eu de surmortalité.
Par ailleurs, assez récemment, un mouvement de grève a eu lieu au sein des sapeurs-pompiers, dont l'un des motifs était le trop grand nombre de transports sanitaires qu'ils devaient effectuer, ce que je peux tout à fait entendre. Avez-vous eu connaissance de transferts d'appel du 18 vers le 15 pendant la crise ?
Vous avez parlé de notre « communication ». Le texte en question était un document de travail. Notre fédération rassemble 281 000 membres. Il y a une vingtaine de commissions, et toutes ont travaillé. Le document qui s'est retrouvé dans la presse a été obtenu par un seul média, d'ailleurs bien connu au ministère de l'intérieur car, pendant la gestion de crise, il a fait état de difficultés, sur la base d'informations que moi‑même je ne possédais pas. Le plus souvent, je prends avec des pincettes ce que dit la presse, notamment la presse satirique.
Je le répète, le document que nous vous avons envoyé est la base d'un retour d'expérience sérieux ; il est étayé, fondé sur des données précises, y compris concernant les transferts d'appel et les temps de réponse. À cet égard, comme je l'ai dit au Sénat, n'importe quel autre numéro aurait été saturé à cause du covid-19, et ce pour une seule et unique raison : quand vous faites passer tous les appels – urgents et non urgents – dans le même tuyau, il est impossible de faire face ; je laisserai la parole au docteur Hertgen pour développer cette question.
C'est la raison pour laquelle nous préconisons de distinguer entre l'urgent et le non urgent en adoptant un système fondé sur deux numéros, en éduquant les citoyens. Tant que l'on considérera que notre population n'est pas capable de déterminer elle‑même ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas, on continuera avec le même schéma, que nous sommes les seuls au monde à appliquer – car ce n'est pas le système qui a été développé dans les autres pays européens, ou dans les pays anglo-saxons. Dans la synthèse, vous trouverez des références à d'autres pays européens qui ont fait le choix de distinguer entre l'urgent et le non urgent et n'ont jamais été mis en difficulté.
S'agissant des transferts en TGV, je laisserai mon collègue médecin s'exprimer. Pour ma part, je me contenterai de poser quelques questions. Des colonnes de renfort, au titre de la solidarité entre les territoires prévue par la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, étaient prêtes à partir, à l'image de celles que nous organisons lorsque se déclarent des feux de forêt. Celles-ci comprenaient des ambulances, et nos médecins étaient mobilisés. Pourquoi ont‑elles été annulées ? De la même manière, comment se fait-il que, dans le Doubs, un médecin sapeur-pompier ait été débarqué d'un hélicoptère de la sécurité civile, au prétexte qu'il fallait un médecin du SAMU ? Tous les médecins sortent de la faculté avec le même diplôme et prêtent le même serment : ont-ils des capacités moindres lorsqu'ils sont sapeurs-pompiers que lorsqu'ils sont habillés en blanc ?
Enfin, je tiens à vous rassurer : non, nous n'avons pas envie d'être en conflit perpétuel. M. le ministre de la santé a fait des annonces qui vont dans le bon sens. Nous attendons que ce que le Président de la République avait demandé en 2017, s'agissant du numéro d'urgence, soit mis en œuvre.
Notre fédération nationale se veut, depuis 1882, le reflet de ce que vivent les sapeurs‑pompiers sur le territoire. Les sapeurs-pompiers sont des éponges de ce qui se passe dans la société. Nous faisons remonter à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec beaucoup de politesse et de respect, diverses choses que nous percevons et qui concernent aussi bien la médecine de ville que les ambulanciers et les associations agréées de sécurité civile.
J'ai la double qualité de médecin et de sapeur-pompier. Et parfois, dans le microcosme de la médecine d'urgence, s'exprimer en qualité de médecin, urgentiste qui plus est, est quelque chose de périlleux lorsqu'on porte l'uniforme bleu.
On doit pouvoir débattre et sortir de la pensée unique sans pour cela être accusé de vouloir déclencher une guerre. Nous souffrons, d'une manière générale, d'être systématiquement renvoyés dos à dos avec nos contradicteurs dès lors que nous exprimons une divergence – quand je dis « nous », je fais référence à la Fédération nationale des sapeurs‑pompiers de France, et j'indique au passage que je m'exprime devant vous en ma seule qualité de représentant de notre fédération. Ceux qui défendent la doctrine actuelle en matière de médecine d'urgence en France sont exactement les mêmes que ceux dont je lisais les articles dans les années 1980, lorsque j'étais étudiant en médecine. La politique de la médecine d'urgence, formalisée dans la loi du 6 janvier 1986 et conçue dès la fin des années 1960, n'a pas varié. Je voulais d'abord dresser ce constat : il est impossible de débattre sans être renvoyé dos à dos avec nos contradicteurs. Cela stérilise la construction intellectuelle qui doit présider à notre organisation.
J'ai lu un certain nombre de réactions – dont, pour une part, j'ai été la cible –, car la communauté médicale s'est émue de ce qui avait été relaté dans la presse, dont notre président vient de vous indiquer les limites. Je tiens donc à préciser, au nom des sapeurs-pompiers, qu'aucun d'entre eux n'a mis en doute le dévouement et le professionnalisme de nos collègues acteurs hospitaliers, notamment ceux des SAMU, ou des médecins libéraux. Cela ne veut pas dire toutefois que tout va bien et que nous devons continuer à suivre un modèle qui date d'une quarantaine d'années et qui est obsolète. Cette crise, comme c'est le cas en général avec les crises, a révélé les forces et les faiblesses de notre système.
S'agissant des numéros d'urgence, nous disons qu'on ne peut pas mettre dans la même file d'attente les appels pour un arrêt cardiaque et ceux pour une grippe. Cela signifie que nous adhérons au principe d'une plus-value médicale, désignée comme une « régulation médicale », pour analyser des situations dans lesquelles nos compatriotes se tournent vers le service de santé en lui demandant ce qu'ils doivent faire. Nous ne repoussons pas la science, nous ne repoussons pas la médecine par principe ; nous disons que, pour notre part, nous sommes chargés d'autre chose : notre rôle est de porter secours, en réponse à une sollicitation, le plus souvent téléphonique – elle passera bientôt par d'autres médias. Sur la base de ce constat, on en arrive assez rapidement à la question des numéros d'appel. Derrière cette question, il n'y a pas seulement une guerre de clochers ni même une guerre des chefs, alors que tout le monde s'entendrait bien sur le terrain – ce qui est le cas, du reste : dans l'écrasante majorité des cas, les choses se passent bien. Moi aussi je suis sur le terrain – avec un uniforme bleu, et non pas blanc – et puis donc en témoigner : cela fonctionne. Mais le principe et l'organisation qui en découle doivent évoluer. On doit sortir d'une pensée unique. Le fait est qu'il n'existe pas, dans le paysage de la médecine d'urgence en France, une autre pensée audible. Si les services du ministre de la santé cherchent à avoir une analyse technique sur la médecine d'urgence, celle qu'ils se voient proposer émanera des mêmes acteurs qui, depuis les années 1980, défendent la vision à laquelle naturellement ils adhèrent, puisque ce sont eux qui l'ont conçue. Or, comme cela m'a été rappelé assez récemment, on est rarement à la fois le concepteur et le développeur d'un système, puis celui qui en assure la mutation.
Le système en question doit évoluer. Nous, sapeurs‑pompiers, sommes chargés de répondre aux appels au secours. Les personnes qui nous appellent peuvent avoir besoin de nous car elles se trouvent dans une situation qui ne peut pas attendre quinze ou trente secondes – c'est là pour nous le premier marqueur de l'urgence. Il y a six jours, les représentants du syndicat SAMU Urgences de France sont venus vous expliquer des principes médicaux. Nous estimons pour notre part qu'un système qui prétend donner une réponse à une situation d'urgence immédiate – je citerai notamment l'arrêt cardiaque, car c'est la pathologie la plus exigeante, et qui constitue donc un marqueur – doit être en mesure de le faire en quinze secondes si possible, et au maximum en trente secondes. C'est la Société américaine de cardiologie, qui émet des recommandations depuis des années dans ce domaine qui le dit. Un système efficient, au début de la chaîne des secours, doit donc commencer par répondre très vite – je passe sur les étapes suivantes, qui consistent à détecter l'arrêt cardiaque puis à mettre en œuvre la chaîne des secours. Voilà ce qu'un numéro d'urgence doit être en mesure de faire, et nous le disons en tant qu'attributaires du 18 – tout en sachant que nous décrochons assez souvent aussi le 112. Nous pensons que ces deux numéros doivent être associés à autre chose qu'à l'accès aux soins.
La prétention à être le « leader participatif » – c'est l'expression que j'ai entendue – et à recevoir absolument toutes les sollicitations de santé, de la plus aiguë à la moins importante, nous paraît incompatible avec l'efficacité. C'est ce que nous avons observé. Proposer une réponse médicale, c'est très bien ; avoir une expertise, c'est parfait. Mais conférer au 15 la charge globale de l'interrogation des citoyens quant à leur état de santé – est-ce qu'ils toussent, ont-ils de la fièvre, doivent-ils aller à l'hôpital ou pas ? –, faire passer ce flux, dont le volume est extraordinairement élevé, par la même porte d'entrée que celle dont l'objectif est de répondre à un arrêt cardiaque – pour ne citer que cette pathologie, mais j'aurais pu tout aussi bien donner l'exemple d'une personne ayant reçu un coup de couteau dans le thorax, de quelqu'un qui est tombé du troisième étage d'un immeuble, ou encore de la victime d'un accident grave –, c'est faire courir le risque de la saturation. Or c'est ce qui s'est passé, et c'est ce que nous avons écrit.
Il faut pouvoir débattre de tout cela, y compris en portant la contradiction, parce qu'il y va non seulement de la crise du covid-19, mais aussi, plus largement, de la santé publique dans le domaine de l'urgence et du soin non programmé. Ce n'est pas pour cela qu'il faut tomber dans l'invective. D'ailleurs, ce n'est certainement pas à des parlementaires que j'ai besoin de dire que le débat et la contradiction sont productifs.
En ce qui concerne les transferts en TGV, nous trouvons un peu étonnant qu'une communication aussi extraordinaire – un écusson spécial, destiné à être apposé sur l'épaule, a même été fabriqué pour ces opérations – soit faite autour de ce mode de transport, et ce pour la seule raison qu'il est spectaculaire et relativement novateur. C'est d'autant plus vrai que cette communication contraste singulièrement avec ce qui s'est fait par ailleurs. Nous observons aussi que, lors de ces opérations, on a soigneusement évité de montrer des sapeurs-pompiers. Pourquoi ? Parce que c'est une guerre d'image, parce qu'il faut montrer qu'on est présent, qu'on est spectaculaire, qu'on est innovant. Notre réseau a donc souligné qu'il y avait une énorme part de communication dans ces transferts. Ce n'est pas dire qu'il ne fallait pas transférer des patients. Moi-même, je ne suis pas assez qualifié, et surtout je n'ai pas assez d'informations pour savoir s'il était opportun de transférer des patients pour maintenir les capacités hospitalières de réanimation dans certains endroits, mais je présuppose que les personnes qui l'ont décidé l'ont fait en conscience. En revanche, les modalités de ces transferts, avec les enjeux d'image qui les sous-tendaient, n'étaient pas toujours le fait des personnes qui, d'un point de vue stratégique, déterminaient la nécessité de libérer des ressources hospitalières.
Nous préférerions avoir plus de communication sur les résultats des centres d'appel et les performances qu'ils affichent. En effet, j'ai entendu dire, mercredi dernier, que tout s'était très bien passé et qu'il n'y avait eu aucune attente, mais nous n'avons vu aucun chiffre. Nous préférerions que la transparence soit faite sur ce point : cela éviterait de devoir éteindre l'écran où s'affichent les délais d'attente lorsque le Président de la République vient visiter un centre d'appel.

Permettez-moi tout d'abord, de rendre hommage à l'action individuelle et collective des sapeurs-pompiers. Nous avons la chance d'avoir un modèle de sécurité civile qui, dans bien des circonstances, a fait la preuve de son efficacité. Je puis en témoigner pour l'avoir observé à maintes reprises au niveau local – et ce n'est pas parce que j'ai présidé pendant neuf ans le SDIS des Alpes-Maritimes que je manque d'objectivité. Les questions qui peuvent se poser tiennent non pas à un défaut d'action ou à quoi que ce soit qui serait de leur fait, contrairement à d'autres institutions, pour lesquelles la question mérite d'être abordée, mais visent plutôt à savoir pourquoi vous n'avez pas été davantage mobilisés, car vous êtes toujours en première ligne dans les crises, et nous connaissons votre efficacité.
Sur la forme, nous avons reçu hier votre synthèse de ce rapport qui a beaucoup fait parler. Les termes les plus saillants, peut-être inutilement polémiques, ont disparu : pourquoi ce premier projet a-t-il été transmis, puis modifié ? Contenait-il des erreurs ?
Ensuite, vous formulez des propositions de réforme qui doivent être les leçons à tirer de cette crise, notamment s'agissant des numéros d'appel. Nous avons entendu les médecins, notamment les syndicats de médecins libéraux, qui défendent le 116 117 pour un service d'accès aux soins différent d'un numéro d'urgence. Nous avons également entendu les urgentistes, la semaine dernière, qui défendent le principe du numéro unique en avançant un argument qui, quand on n'est pas soi-même médecin, peut s'entendre : quand on effectue la régulation, il faut être en mesure d'évaluer la gravité d'un appel car, derrière une demande banale, peut se cacher une pathologie naissante très grave, par exemple d'ordre cardiaque. Dans cette logique, il faudrait donc avoir immédiatement au bout du fil un professionnel : en somme, plus le système est centralisé, mieux c'est. Que répondez-vous à cet argument ?
J'aimerais avoir connaissance des éléments précis qui vous ont permis de parler de saturation. Vous en citez certains, notamment concernant la durée d'attente avant que l'on décroche.
Quel modèle vous paraîtrait le plus pertinent en matière de gestion de crise, à la fois au niveau central et au niveau local. Au niveau central, il y a eu le ministre de l'intérieur et le ministre de la santé, et une multiplication des cellules de crise : plusieurs des personnes qui vous ont précédées en audition ont soulevé le problème posé par l'absence d'un pilotage unique. De même, au niveau local, la dualité ARS-préfet fait débat : elle a été la source de difficultés – que vous soulignez dans votre rapport –, dans certains territoires. Pourriez-vous nous fournir quelques éléments prospectifs, mais aussi les éléments précis, d'ordre technique, qui vous ont conduits à dresser cette analyse très critique de la gestion de la crise ?
La Fédération a été auditionnée à maintes reprises depuis que j'en suis le président, et en 2003, à l'issue de la canicule, mon prédécesseur l'avait été lui aussi. Nous avons créé un groupe de travail dont le pilotage est centralisé, et auquel l'ensemble des documents remontent. Celui qui a été diffusé n'est ni le premier ni le dernier qui a circulé dans le réseau. La sémantique utilisée dans le travail préparatoire était propre au groupe et n'avait pas à être diffusée. Le seul responsable, c'est celui qui est devant vous, c'est-à-dire moi-même, et le document validé par mes soins est celui que vous avez entre les mains. Je considère que le terme « esbroufe » pouvait être utilisé par un groupe de travail, mais qu'il n'avait pas à se retrouver sur la place publique ; d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dorénavant, nous parlons d'« opération de communication ». J'en reste là en ce qui concerne le prérapport et la communication malencontreuse.
S'agissant de la gestion de crise, je m'adresse à des élus de terrain, car vous êtes élus locaux ou l'avez été ; vous savez très bien que, lorsque survient un événement, le maire l'accapare en tant que directeur des opérations de secours, mais que, dès l'instant où l'événement en question nécessite des moyens de plus grande ampleur, l'autorité préfectorale a l'habitude de gérer la crise, et ce quel qu'en soit le type : ce n'est pas parce que la crise a une origine sanitaire, naturelle ou industrielle que la gestion doit en revenir au ministère qui administre le dossier. Est-ce que l'incendie de Lubrizol a été géré par le ministère de la transition écologique et solidaire ? Non. Alors que celui-ci instruit l'ensemble des dossiers permettant l'ouverture des établissements entrant dans la catégorie des installations classées. C'est le préfet qui exerce la direction des opérations de secours et qui met à l'ouvrage l'ensemble des services permettant de créer un périmètre de sécurité – les forces de police –, d'établir un diagnostic pour savoir si, parmi les blessés, il y a des cas urgents et, le cas échéant, les évacuer vers les centres hospitaliers – en liaison avec le SAMU.
Pour en revenir un instant à la régulation, il est important de se souvenir du contexte de 1986, lorsque la loi relative à l'aide médicale urgente a mis en place le système actuel. L'hôpital n'avait pas opéré sa mue. La médecine de ville était présente dans l'ensemble des territoires ; il y avait des médecins que l'on appelait « de campagne ». La réponse médicale n'avait donc rien à voir avec celle que nous connaissons. Par ailleurs, on ne parlait pas encore du vieillissement de la population. Les sapeurs-pompiers n'avaient pas encore développé leur organisation comme ils ont pu le faire grâce à la départementalisation, qui leur permet de proposer un haut niveau de service. Quand on compare le contexte d'alors au contexte actuel, on se dit que la régulation doit certes être faite, mais dans le but d'apporter une plus-value du médecin ; elle doit permettre, au regard d'une pathologie évoquée par téléphone ou que le sapeur-pompier décrit, en relation téléphonique avec le médecin urgentiste, d'orienter la victime – qui va devenir patient – vers le meilleur plateau technique disponible, en fonction de la pathologie observée, et avec le meilleur vecteur pour permettre soit de gagner du temps soit de faire en sorte que la personne concernée soit évacuée plus loin, si on n'est pas en mesure de l'accueillir dans le ressort de compétence initial.
Vous nous avez demandé quelle serait la solution optimale pour gérer la crise. Tout se planifie, tout s'anticipe. Le plan pandémie grippale existe depuis 2011. Or il n'a pas été déclenché. Cela ne veut pas dire qu'il fallait l'observer à la lettre, car la grippe H1N1, qui avait conduit à sa rédaction, n'avait pas la même cinétique que le covid-19. En tout état de cause, les sapeurs-pompiers, les policiers, les gendarmes et les soldats disposent de ce qu'on appelle, en gestion de crise les « fondamentaux », mais aucune situation opérationnelle n'est écrite à l'avance : ils doivent faire preuve de capacité d'adaptation. C'est ce que nous aurions dû faire : déclencher le plan pandémie grippale et nous adapter, avec un commandement unique et une seule direction des opérations de secours.
Comme vous l'avez dit, il y a eu plusieurs salles de crise, plusieurs structures qui auraient pu permettre de gérer la crise, mais auxquelles l'ensemble des services ne participait pas. Ainsi, le 17 mars, a été ouverte la cellule interministérielle de crise (CIC), dont l'objectif est justement de gérer la crise sur l'ensemble du territoire. Le ministère de la santé y était représenté une fois par semaine, lorsqu'il avait le temps. Autrement dit, le partage d'informations n'était pas optimal.
Lorsque nos forces armées dirigent une opération, quel que soit le contexte, ce n'est pas l'unité spécialisée qui gère la crise : il y a un commandant qui prend tout le recul nécessaire, étudie l'ensemble des paramètres et interagit avec l'aviation, la marine et l'unité spécialisée. Lorsqu'un sapeur-pompier gère un événement en rapport avec un produit chimique, il s'agit d'un officier ayant le recul nécessaire et l'ensemble du spectre de la gestion de crise, bénéficiant des conseils techniques de celui qui en sait plus sur la nature du produit en question et ses conséquences. Ce que l'on peut dire, tout simplement, c'est qu'en l'espèce, on a confié au conseiller technique la gestion de crise, alors qu'il n'avait pas le recul nécessaire. En gestion de crise, on parle de l'« effet tunnel » pour décrire le phénomène psychologique qui se manifeste : à un moment donné, on ne voit plus l'ensemble des paramètres, on s'enferre dans les paradigmes auxquels on est habitué, on se focalise sur la recherche de la lumière, au bout du tunnel, en occultant tout le reste. C'est aussi simple que cela.
Vous nous avez demandé sur quels éléments nous nous étions fondés en ce qui concerne les appels. Nous aurions voulu nous appuyer sur des éléments objectifs publiés par les services. Nous aurions voulu nous fonder, par exemple, sur ce qui, à l'heure de l'open data, peut se concevoir, à savoir un affichage transparent des performances des services chargés de répondre au 15, au 18 et au 17, et peut-être même au 112. Cela nous semble de nature, en premier lieu, à assurer la transparence de l'action publique et, en second lieu, à engager un débat intellectuel plus argumenté que lorsqu'on a recours à des arguments d'autorité. Mais nos contradicteurs ne publient pas de chiffres permettant de savoir en combien de secondes ils répondent et font une première analyse.
En l'absence de ces données, nous avons demandé à notre réseau d'observer. Dans la synthèse qui vous a été transmise, nous publions quelques-unes de ces observations. Évidemment, elles ne sont pas très larges, car nous n'avons pas toutes les données concernant les appels. Cela dit, elles montrent, notamment dans certains grands services, y compris certains qui sont administrés par les concepteurs du service d'accès aux soins, des résultats totalement hors de proportion avec les objectifs et les prétentions affichés. On nous dit qu'il n'y a pas eu d'attente. Cependant, nous avons observé des délais : jusqu'à douze minutes quarante secondes dans un service – pas tout le temps, il est vrai.
On ne saurait fonder un système robuste sur des performances qui, en premier lieu, ne sont pas affichées, et qui en second lieu, selon nos observations, sont hors de proportion avec les ambitions. Dire cela, j'y insiste, ce n'est pas jeter la pierre à ceux qui œuvrent dans ces services, c'est simplement affirmer qu'il faut pouvoir sortir du système de pensée actuel, et observer des résultats. Or, y compris dans les auditions que vous avez organisées il y a quelques jours, je n'en ai pas trouvé.
Le principal argument avancé par nos contradicteurs, déjà développé il y a plusieurs mois et répété devant vous, consiste à refuser de donner aux citoyens la responsabilité de décider si leur appel relève ou non de l'urgence. Or, dans 90 % des cas environ, les personnes qui se dirigent vers un service public ont une idée assez fidèle de l'urgence attachée à leur demande. On pourrait disserter longuement sur cette proportion, produire des études – je dirai peut-être un mot de l'une de celles qui ont été produites à l'appui des tests de nos contradicteurs mais en tout été de cause il en reste donc 10 %. On nous dit : « La personne qui appelle parce qu'elle est un peu gênée fait peut-être un infarctus, et nous seuls » – quelle prétention – « urgentistes hospitaliers, savons le détecter ; donc, tout doit passer par nous » – c'est le « leadership participatif ».
Certes, un engourdissement, une difficulté à articuler peuvent être les premiers signes d'un accident vasculaire cérébral, qui, bien entendu, nécessitera une prise en charge et un parcours de soins, mais, dans les systèmes ayant un numéro pour les appels au secours et autre pour l'accès aux soins, les opérateurs savent eux aussi parfaitement distinguer ces signes avant‑coureurs. C'est d'ailleurs faire injure à mes collègues qui sont en charge aujourd'hui de la permanence des soins, et demain de l'accès aux soins, que d'imaginer qu'ils ne soient pas capables de détecter des cas graves au motif qu'on s'adresse à eux sans forcément penser au pire, car c'est le b.a-ba. En prolongeant le raisonnement, un médecin généraliste recevant un appel devrait passer lui aussi par un centre 15, parce que seul celui-ci serait en mesure de déterminer s'il s'agit d'une urgence. L'argument ne nous paraît donc pas fondé. Nous sommes pour un système dans lequel le 112 serait dédié aux secours interservices – y compris les hospitaliers –, et le 116 117 au service d'accès aux soins.

Connaissant bien le SDIS de mon département pour en avoir été vice-président pendant une quinzaine d'années, j'ai pu mesurer l'évolution de l'aide à la personne. Comme vous l'avez rappelé, colonel, la démographie médicale a chuté considérablement au cours des dernières années. Par ailleurs, la permanence des soins ambulatoires n'est pas à son maximum.
La mise en place du 116 117 soulève des oppositions. Selon moi, il faut l'institutionnaliser, comme le demandent les médecins libéraux.
Entre l'élaboration du plan pandémie grippale, en 2011, et la crise de 2020, y a-t-il eu des expérimentations de terrain, à l'image de ce qui s'était passé entre 2005 et 2011, sous l'égide de la délégation interministérielle à la lutte contre la grippe aviaire (DILGA) ? Dans votre rapport, vous dites qu'il manque un pilotage unique – c'est-à-dire, en réalité, un délégué interministériel. Le 15 est sous la responsabilité de l'ARS, les sapeurs-pompiers sous la responsabilité du préfet : y a-t-il eu des blocages entre les ARS et les préfets ?
Enfin, l'équipement dont vous disposiez contre le covid-19 était-il satisfaisant, notamment en matière de masques ?

J'ai bien entendu tout ce que vous avez dit à propos du rapport rendu public le 7 juillet. Vous avez eu raison d'évoquer les modalités d'expression de votre fédération, et personne ne peut vous faire grief de l'épisode en question. Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de sujets que vous avez évoqués méritent que nous ayons un débat. Je pense notamment à la question des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Dans la synthèse qui nous a été distribuée, on lit une phrase qui est forte mais rend compte, effectivement, de la situation que nous avons connue localement. Selon vous, les ARS « ont trop longtemps négligé les EHPAD, laissant seules les collectivités territoriales face au décès en nombre des personnes âgées ». Qu'entendez-vous précisément par là ? Pourquoi affirmez-vous que les ARS n'ont pas donné aux préfets, dans les départements, les informations suffisantes pour coordonner les opérations de secours dans les EHPAD ? Était-ce, selon vous, un choix politique dicté par l'impréparation à la crise ? Votre fédération a-t-elle lancé l'alerte auprès des autorités nationales ? Avez-vous eu connaissance d'une note d'une ARS, en date du 19 mars, indiquant qu'il était possible « que les praticiens sur-sollicités soient amenés à faire des choix difficiles et des priorisations dans l'urgence concernant l'accès à la réanimation » ? Enfin, avez-vous eu connaissance de refus d'hospitalisation des résidents en EHPAD ?

Toujours, quelle que soit l'ampleur de la crise, les forces de sécurité civile, et plus précisément les sapeurs-pompiers et sapeurs-pompiers volontaires ont su répondre brillamment présents, bien souvent au péril de leur propre santé. Si, dès les premiers jours, la question du manque de moyens matériels – notamment de masques et de tests – pour les sapeurs-pompiers a été soulevée, votre récent rapport fait lui un diagnostic très caustique de la crise. Il en a peut-être surpris plus d'un, mais pas moi. Vous y dressez un certain nombre de constats, malheureusement pas nouveaux, sur lesquels je souhaiterais que vous reveniez.
S'agissant de l'organisation, vous regrettez que le plan pandémie grippale de 2011, qui confie la conduite opérationnelle de ce type de crise au ministère de l'intérieur et à la chaîne territoriale des préfets, n'ait pas été appliqué, alors même que les acteurs y étaient préparés. Le choix d'enfermer cette question dans le secteur de la santé et de son ministère, en donnant compétence aux ARS, qui n'étaient pas prédestinées à la gérer, aurait conduit aux dysfonctionnements que nous connaissons.
Vous dénoncez également la chaîne de décision, trop complexe et sans commandement unique. Vous écrivez : « Les événements ont été administrés, plus que gérés, conduisant à privilégier un rôle de supervision aux dépens de la prise d'initiatives et de responsabilités des acteurs de terrain. »
Vous le savez, un texte visant à consolider notre modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers est en préparation à l'Assemblée nationale. Dans cette perspective, et pour éviter des dysfonctionnements similaires lors des prochaines crises, je souhaiterais que vous nous précisiez votre vision de la relation qui doit exister entre les services de santé et les forces de sécurité civile, que ce soit en termes de gestion de crise, de transport de personnes – et je voudrais que vous reveniez sur les équipements, notamment la distinction entre les bleus, les blancs et les rouges s'agissant des hélicoptères –, mais aussi de simplification des numéros d'appel.

Je voudrais saluer à mon tour l'action des sapeurs-pompiers et leur engagement face à la diversité des risques. Vous avez évoqué un certain nombre de choix de gestion qui ont été faits, vous tenant à une place qui, selon vous, n'est pas habituellement celle des sapeurs-pompiers dans une crise. Quelles auraient été les conséquences concrètes d'un autre fonctionnement pour la population. Cela nous aurait-il permis de mieux anticiper, mais aussi de mieux dimensionner un certain nombre de réactions face à la crise ?
Par ailleurs, j'imagine que vous aviez votre propre matériel de protection individuelle. Avez-vous des réserves ? Avez-vous pu faire appel au fonds stratégique ? Comment s'est passée, pour vous, la gestion des stocks de masques ?
Vous avez évoqué la question des plateformes d'appel. Connaissez-vous un endroit où les choses fonctionnent comme vous l'indiquez, avec la plateforme 112 d'un côté et le 116 117 de l'autre ? Pourriez-vous, à cet égard, nous donner des éléments sur lesquels nous appuyer pour poursuivre notre réflexion ?
Enfin, dans la synthèse, vous évoquez des débauchages. Cette pratique est assez surprenante. Je voudrais savoir dans quel cadre elle a eu lieu, et si vous pouviez nous transmettre des éléments concrets.

Je ne voudrais pas que, de cette audition, on ne retienne que les éléments de communication, comme c'est le cas depuis le début, et la polémique sur le rapport. Vous avez effectué plus de 100 000 interventions pendant la crise ; vous étiez sur le terrain. Pour ma part, j'ai envie de vous entendre sur ces interventions, sur vos rapports avec les acteurs locaux. Vous indiquez que, dans l'ensemble, cela s'est extrêmement bien passé, notamment avec les services déconcentrés de l'État. J'aimerais donc que vous soyez un peu plus précis sur ces interventions au cours d'une crise inédite. Vous vous êtes adaptés, vous avez été agiles, comme d'ailleurs beaucoup d'autres organisations dans tous les secteurs. Je ne suis pas en train de vous demander de positiver votre rapport, mais je trouve que des choses effectivement très positives peuvent être tirées de vos 100 000 interventions.

Je me joins aux remerciements de mes collègues. Il me semble tout à fait clair que les sapeurs-pompiers ont été relégués derrière les médecins du SAMU, comme d'ailleurs ont été relégués, pendant toute cette crise, les médecins généralistes. Qu'avez‑vous pensé de la stratégie de communication, destinée aux citoyennes et aux citoyens, et qui consistait à dire : « Si vous n'allez pas bien, faites le 15 » ? Avez-vous réagi ? Si oui, comment et auprès de qui ?
Les pompiers ont effectué 100 000 interventions liées au covid-19 : pouvez-vous nous dire quelques mots sur leur typologie ? Qu'en a-t-il été dans des régions comme le Grand Est où il existait déjà une histoire particulière entre les SDIS et le 15, malheureusement, en raison du crash du mont Sainte‑Odile ? Il est vrai qu'on tire toujours le meilleur de crises comme celle‑là.
Enfin, concernant les transports sanitaires en TGV, aviez-vous, de votre côté, l'information selon laquelle des lits étaient disponibles et, qu'on n'était pas obligé de transporter les personnes dans d'autres régions françaises, voire à l'étranger ?
En ce qui concerne le 116 117 et le 112, nous avons l'impression que bon nombre d'acteurs de terrain souhaitent cette dichotomie entre les appels d'urgence et les appels non urgents relevant du conseil médical et de l'offre de soins ; les médecins libéraux, l'ensemble des acteurs sociaux, les départements de France, les maires, vos sapeurs-pompiers la souhaitent, de même que le Président de la République, qui en avait parlé en 2017. Nous sommes tous d'accord sur ce schéma, mais il ne se concrétise pas. Il convient de se demander pourquoi.
Pour ce qui est du plan pandémie grippale, non, il n'y a pas eu d'expérimentation de terrain. Certains d'entre vous, qui ont présidé aux destinées de SDIS, savent que nous avions des stocks stratégiques – notamment dans nos pharmacies –, que nous faisions tourner. Nous avons l'outrecuidance de penser que le système de gestion de crise qui existe dans notre pays est optimal parce que, lorsque surviennent des inondations, des tremblements de terre, des feux de forêt, et même une pandémie grippale, jusqu'à présent, il a fonctionné. Toutefois, en effet, nous avons dû nous adapter.
Avons-nous eu suffisamment d'équipement ? Au début, on nous disait qu'il fallait s'en passer, que ce n'était pas utile, de même que les tests, alors même que certains, notamment l'OMS, disaient déjà : « testez, testez, testez ». Le port du masque se développe de nouveau, on nous le recommande en tous lieux, alors qu'il y a quelques mois on allait jusqu'à considérer que les sapeurs-pompiers ne devaient pas en avoir ; pourtant, le virus était partout et leurs opérations amenaient les pompiers au contact de la population – par exemple quand nous faisions ce que nous appelons un « check covid » sur quelqu'un tombé à bicyclette et à qui nous trouvions de la fièvre : les 100 000 interventions taguées « covid » recouvrent ce genre d'événement. Les pompiers étaient les premiers exposés. En effet, je suis désolé de le dire mais qui intervient au quotidien auprès de la population, si ce n'est les ambulanciers privés et les sapeurs-pompiers ? Or, à tous ceux-là, on a dit qu'il était inutile de porter des masques.
Dans certains endroits, les sapeurs-pompiers ont dû protéger leurs bottes avec des sacs plastiques et nettoyer eux-mêmes leur tenue. Effectivement, il y a eu de la solidarité ; heureusement ! Les territoires ont travaillé les uns avec les autres, les services se sont entraidés. Certains SDIS ont prêté des tenues à nos collègues des hôpitaux, d'autres ont donné non seulement des tenues mais aussi des masques FFP2 à des ambulanciers privés. Certes, nous avons mis ces moyens publics à la disposition du privé, mais pour une raison simple : parce que nous étions en état de guerre, qu'il fallait faire des choix, et que nous étions les uns et les autres face à cette maladie dont nous ne connaissions pas les conséquences. La Fédération nationale a dû écrire à maintes reprises pour dire qu'il nous fallait des masques FFP2, réservés aux soignants. Nous avons également écrit plusieurs fois pour dire qu'il fallait tester les sapeurs‑pompiers parce qu'ils étaient au contact des malades. Nous avons dit à plusieurs reprises qu'il fallait reconnaître le covid-19 comme une maladie professionnelle, comme c'est le cas pour les soignants. Nous avons souvent été écoutés, quelquefois aussi mis au rancart. Le ministre Olivier Véran a pris la mesure des choses et, dorénavant, il nous prend en considération. La prise en charge des tests sérologiques par l'assurance maladie est un fait nouveau : cela veut dire que les sapeurs-pompiers sont dorénavant considérés comme des acteurs de la santé, des acteurs de terrain.
À propos des EHPAD, je ne peux pas ne pas évoquer le fait que nous intervenons tous les jours dans les EHPAD. Nous savons exactement quand l'infirmière quitte l'établissement : après dix-huit heures, ce sont les sapeurs-pompiers qui sont appelés pour venir chercher les personnes âgées. À cet égard, monsieur le président, je voudrais revenir sur la grève que vous avez évoquée tout à l'heure. Nos détracteurs disent souvent que nous nous sommes mis en grève parce que nous ne souhaitions plus intervenir pour le transport de personnes. Ce n'est pas cela : simplement, nous ne voulons plus faire de transport indu. Dans l'exemple que je vous donnais à l'instant, nous savons très bien que l'infirmière a quitté les lieux à dix-huit heures, parce qu'on envoie une ambulance pour prendre la personne et l'acheminer, alors que tout au long de la journée on n'a pas trouvé de vecteur, parce que l'ambulancier privé ne pouvait pas venir au fond de la vallée alpine ou pyrénéenne, ou même au cœur de notre pays. Nous ne demandons pas d'en faire moins : nous réclamons simplement de faire au plus juste, c'est-à-dire ce qui est du domaine de l'urgent. Si c'est de l'assistance, c'est à la caisse primaire d'assurance maladie d'en assumer la charge, pas aux collectivités. Cela fait partie, effectivement, des sujets de discussion que nous avons.

Vous ne m'avez répondu : comment expliquez‑vous qu'il y ait eu des retransferts du 18 vers le 15 ?
Tout simplement parce qu'il s'agissait de missions qui n'étaient pas les nôtres.
Concernant les choix difficiles qu'il a fallu faire, je filerai la même métaphore que tout à l'heure : c'est ce qui se passe lorsqu'on est en situation de guerre. De la même manière, lors d'une intervention, si un chef d'agrès, devant une façade en feu, n'a à sa disposition qu'un seul fourgon pompe tonne et une seule échelle, qu'il entend crier des gens piégés dans deux appartements, avec d'un côté une personne âgée et de l'autre quelqu'un de plus jeune avec un enfant en bas âge, où dresse-t-il l'échelle, selon vous ? La conduite à tenir n'est écrite nulle part, mais il fera un choix. Les médecins, de même que les sapeurs-pompiers, font des choix au quotidien. J'en suis désolé, mais cela fait partie de leur art. Pendant la période dont nous parlons, il y a certainement eu des choix à faire. De surcroît, nous n'étions pas dans une période normale, il faut le comprendre ; c'est ainsi, d'ailleurs, que nous n'étions pas non plus dans une phase où il s'agissait d'administrer. Dans de telles circonstances, il y a les fondamentaux, et au moment où l'on prend la décision, le bon sens et le pragmatisme.
Monsieur Morel-À-L'Huissier, nous n'avons pas porté un diagnostic caustique : nous avons dressé un constat. Il ne s'agissait pas de blesser qui que ce soit. Le document vise à constater et à mettre en évidence des faits dans le but de progresser. Nous aurions pu produire un texte qui satisfasse tout le monde – mais ce qui s'est passé était-il totalement satisfaisant ? Même si nous avons toutes et tous fait preuve d'intelligence, d'adaptabilité et de réactivité pour permettre à notre pays de résister le plus possible à ce virus que l'on ne connaissait pas – et que, d'ailleurs, on ne connaît pas encore totalement –, l'organisation n'a pas été satisfaisante. Vous l'avez souligné : on aurait pu utiliser le plan pandémie grippale, même s'il fallait sans doute l'améliorer en tenant compte de l'état actuel de la science et de ce que l'on avait vécu depuis sa conception. De notre point de vue, une seule entité doit piloter la crise : le ministère de l'intérieur. Sur notre territoire, c'est à lui que revient la gestion de crise. Il a à sa disposition tous les outils nécessaires, toutes les forces.
La distribution de matériel aurait-elle pu être plus performante ? S'agissant des masques, la distribution a été confiée à des transporteurs privés ; par moments, ils ont mis du temps à arriver, car certains des transporteurs ont invoqué leur droit de retrait. Or, au sein de la direction générale de la sécurité civile, existent les établissements de soutien opérationnel et logistique (ESOL), et, dans tous les territoires, il y a les sapeurs-pompiers. Nous nous sommes d'ailleurs proposés pour distribuer les masques. Je puis vous assurer que, là où il y a eu une forme de coordination entre l'autorité préfectorale, ayant à sa disposition les ESOL et les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI), et les collectivités territoriales – notamment les départements et les communes –, la distribution a été faite par les sapeurs-pompiers, et il n'y a jamais eu de déficit de masques. Certes, l'expérience de ce qu'avait vécu la région Grand Est a permis à certaines régions et certains départements de s'adapter, mais si l'on avait fait confiance aux territoires et aux acteurs qui les animent au quotidien, on aurait pu mettre en œuvre des dispositifs beaucoup plus performants. Cela vaut aussi, d'ailleurs, pour les acteurs locaux faisant partie d'états-majors, comme c'est mon cas : il faut savoir se forcer à faire confiance à celles et ceux qui agissent sur le terrain. C'est aussi cela qui a manqué, par moments, dans la gestion de crise.
Effectivement, monsieur Dharréville, dans le choix qui a été fait pour la gestion de crise, nous n'avons pas eu la place qui est la nôtre habituellement : alors que nous sommes les acteurs du secours d'urgence aux personnes, on a considéré que nous ne devions pas être présents – c'est l'exemple du médecin qu'on a fait descendre d'un hélicoptère.
S'agissant d'ailleurs des hélicoptères de la sécurité civile, se pose la question du renouvellement de la flotte, en dehors des deux appareils qui ont été remplacés à la suite de crashs dramatiques. Ce sont eux qui assurent les secours au quotidien : pendant la crise, 50 % des transferts interhospitaliers ont été effectués par les hélicoptères de la sécurité civile. Vous ne le savez pas car cela n'a jamais été dit.
Il faut réfléchir à la mise en place de stocks stratégiques, de manière coordonnée, et non pas pour répondre soit aux besoins des pompiers, soit à ceux de l'hôpital, soit à ceux des EHPAD. Dans la dernière partie de la synthèse, nous évoquons justement la question de la protection civile et de la gestion de crise. La proposition de loi que vous avez évoquée, monsieur Morel-À-L'Huissier – il y en a même deux qui portent sur le même sujet – pourrait s'attacher à la modernisation de la sécurité civile et à l'augmentation de la résilience de nos territoires, car c'est fondamental. Plutôt que de parler du passé, il faut préparer l'avenir, faire face au rebond de l'épidémie que l'on observe et qui se reproduira peut-être tant qu'il n'y aura pas de vaccin.
Où les plateformes téléphoniques fonctionnent-elles selon le modèle que nous proposons ? En Haute-Savoie, par exemple : une plateforme unique reçoit les appels au 112 et au 116 117, mais aussi les sollicitations liées à des difficultés sociales. Les différents services restent identifiés et identifiables, mais ils utilisent le même logiciel, leurs employés travaillent sur la même plateforme, boivent le même café, se saluent et font même du vélo ensemble. Pendant la crise du covid-19, ils ont répondu ensemble aux appels, qu'ils soient destinés au 15, au 18, au 112 ou au 116 117 ; ils étaient unis pour faire face. Or, en Haute-Savoie, il n'y a pas eu de difficultés, ni humaines ni structurelles. Peut-être faut-il retenir cette leçon.
Monsieur Démoulin, vous avez évoqué nos 100000 interventions. Certes, elles se sont très bien passées, mais lorsqu'on n'est pas ensemble, interconnecté sur la même plateforme, quand on n'échange pas, cela crée un certain nombre de difficultés. Je reprends l'exemple du cycliste auquel nous venons en aide. Au moment d'intervenir, nous ne disposons pas d'informations selon lesquelles il aurait de la fièvre ou présenterait d'autres symptômes. Nous sommes donc en tenue normale – avec en plus, désormais, un masque chirurgical, mais aussi des gants –, et non en tenue covid – en « tenue C ». Nous nous rendons compte que la personne présente des troubles. Nous faisons alors appel à un véhicule du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), qui arrive avec à son bord un médecin ; celui-ci descend en tenue covid‑19 et nous apprenons que le cycliste avait été testé positif. Voilà un exemple de ce que nous vivons : il n'y a pas d'interconnexion, d'échange d'informations.
Cela se passe très bien parce que les gens ont la même envie de servir : que l'on soit médecin ou sapeur-pompier. C'est la même chose pour l'ensemble des élus qui composent cette assemblée et pour les élus dans les territoires : vous vous êtes engagés parce que vous aviez envie de servir nos concitoyens, parce que vous aviez une certaine idée du service de la population. Nous aussi nous promouvons sans cesse cet engagement citoyen.
Certes, monsieur Démoulin, la crise était inédite, mais comme l'étaient par leur ampleur, en 2016, les feux de forêt dans certains départements du sud : nous devons nous adapter sans cesse. Le côté inédit ne doit pas nous faire oublier qu'il faut planifier, anticiper, et pour cela travailler régulièrement – nous devrons sans doute organiser des exercices sur le territoire.
Dans le Haut-Rhin, il y a eu énormément de bonne volonté, mais c'est aussi parce que, tous les jours, le SAMU et le SDIS travaillent ensemble. C'est peut-être cette intelligence territoriale qui nous a permis, par moments, d'éviter le pire.
La FNSPF porte la voix des pompiers de France, mais si vous demandez au directeur départemental du Haut-Rhin ou au général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris comment cela s'est passé, ils vont diront eux aussi un certain nombre de choses, et nous nous rejoindrons probablement autour de certains des constats dressés dans notre rapport.
S'agissant du tri en réanimation, je tiendrai un discours qui vous surprendra peut-être, car je vais soutenir mes confrères hospitaliers, qui se sont défendus, à juste titre je pense, de l'accusation qui leur a été faite d'avoir en quelque sorte volontairement laissé mourir les gens, particulièrement dans les EHPAD. Même si j'ai quelques divergences avec eux s'agissant des principes d'organisation, je ne pense pas une seconde qu'ils aient abandonné délibérément, de manière cynique, les résidents des EHPAD. Il y a deux questions de nature différente, sur lesquelles je voudrais insister : l'accès aux soins dans les EHPAD, d'une part, et les critères d'admission en réanimation de l'autre.
L'accès aux soins dans les EHPAD est un enjeu qui dépasse largement la question du covid‑19. Je dirai simplement que, depuis une trentaine d'années que j'exerce en qualité de médecin urgentiste, j'observe que les EHPAD attirent moins l'attention que les accidents de la route, parce que c'est moins spectaculaire et parfois plus ingrat. L'accès aux soins n'y est pas toujours facile, nous le constatons tous les jours. S'agissant des EHPAD, nous avons donc été les spectateurs de quelque chose que nous connaissons déjà habituellement.
Quant aux critères d'admission en réanimation, un médecin réanimateur a proposé une belle image : en réanimation, vous passez d'une rive à l'autre, et le gué est un peu difficile à franchir. Encore faut-il pour cela qu'il y ait une autre rive : la réanimation constitue un ensemble de soins extrêmement lourds, douloureux et invasifs, et il y a un intérêt à y être admis s'il existe un espoir. Le choix de l'admission en réanimation, en d'autres termes de la limitation ou non des soins, se pose là encore de manière générale, indépendamment de la question du covid‑19, et je ne pense pas, sincèrement, que les choix qui ont été faits auraient été différents en dehors de la crise.
En ce qui concerne les débauchages : il fallait produire des images – et, pour exprimer les choses très clairement, montrer du blanc. Cela dit, autant il n'a pas été souhaité d'afficher des sapeurs-pompiers, et encore moins des professionnels de santé chez les sapeurs-pompiers, autant on nous a diffusé des demandes de concours à la réserve sanitaire. Pour mémoire, il y a un peu moins de 5 000 médecins sapeurs-pompiers en France, un peu plus de 6 000 infirmiers sapeurs-pompiers – et, sur ce nombre, plusieurs centaines de professionnels, l'essentiel étant constitué de volontaires –, mais aussi des pharmaciens et d'autres cadres de santé. Toutes ces professions sont donc représentées chez nous et ce n'est pas ce qui était souhaité sur les images. Je suis un promoteur de la réserve sanitaire mais, plutôt que de nous solliciter directement, on a essayé de préempter nos ressources. Voilà ce que nous avons dénoncé. Il s'agit très clairement d'une mauvaise pratique, mais nous y sommes habitués : il y a une petite dizaine d'années, on a pris des médecins de sapeurs-pompiers pour en faire des médecins correspondants du SAMU – autrement dit, on leur a mis une autre étiquette. C'est exactement la même chose.
Vous nous avez demandé ce que nous avons pensé de la consigne concernant le 15, et si nous avons réagi. Le Gouvernement a créé un numéro vert pour informer la population – schématiquement, il était destiné à reproduire les informations transmises par d'autres vecteurs – et, en cas de doute concernant l'état de santé, donner pour consigne d'appeler le 15. Nous ne doutons pas une seconde que, si ce choix a été opéré, c'est que, depuis des années, il y a un mouvement qui tend à faire du 15 la plateforme absorbant, autour du fameux « leadership participatif », l'ensemble du soin non programmé – je n'y reviens pas. Comme nous avions constaté de longs délais de réponse, nous avons ajouté un élément : on a dit aux personnes qu'ils pouvaient aussi, en cas d'urgence immédiate, appeler le 112 – et non pas le 18, pour ne pas donner l'impression d'engager une confrontation. Nous n'avons rien fait d'autre que de rappeler une consigne française mais aussi, excusez du peu, européenne. Or cela nous a valu d'être attaqués comme rarement par nos contradicteurs habituels, qui nous ont dressé des procès en détournement : « Vous êtes des salopards ! Encore de la récupération pour votre 112 ! » Le 112 n'est pas notre numéro ; nous ne plaidons pas pour que tout nous revienne, et nous ne souhaitons pas être les leaders participatifs – autrement dit l'entité qui décide de l'allocation des moyens, car le véritable enjeu est là.
Nous disons simplement que, si l'on veut travailler sur la question de l'urgence immédiate pour faire face à des situations comme celle à laquelle nous avons été confrontés hier – je fais référence au dramatique accident de la circulation –, sans parler des personnes qui s'effondrent à cause d'un arrêt cardiaque et pour lesquelles trente secondes de différence dans les délais vont être déterminantes pour la survie, ou la qualité de la survie, il faut le faire avec les autres acteurs, notamment les sapeurs-pompiers. À cela, on nous oppose l'entre-soi de personnes qui ont la prétention d'être les seuls aiguilleurs de ressources. Ils récusent les plateformes communes, avec à l'appui un certain nombre de motifs dont aucun ne résiste très sérieusement à la contradiction. Apporter cette contradiction, ce n'est pas être en guerre, je le répète, c'est simplement considérer que le système doit évoluer.
Le choix ayant été fait du 15, nous n'avons jamais pensé qu'il fallait diverger par rapport au message du Gouvernement – les sapeurs-pompiers sont légitimistes par habitude et par culture. Nous y avons donc diffusé la consigne et pensons encore que c'était le bon choix. En revanche, nous y avons ajouté une référence au 112, pour l'extrême urgence. Maintenant nous souhaiterions que puisse s'ouvrir le débat et que puisse se faire entendre une autre parole médicale que celle des concepteurs du modèle conçu il y a quarante ans, qui affichent des ambitions extraordinairement séduisantes, mais refusent malheureusement d'afficher les performances des systèmes dont ils sont les gestionnaires.

Je souhaite revenir sur la régulation des appels. Nous avons entendu votre critique du tout-hôpital, du tout sur le 15, qui risque d'entraîner un engorgement, notamment quand les appels sont multipliés par trois ou par quatre. Je voudrais que nous abordions le bilan des plateformes communes. Vous avez dit à l'instant, colonel, en citant l'exemple de la Haute-Savoie, qu'il n'y avait pas eu de difficulté là-bas. Je pense, pour ma part, à la plateforme commune des Vosges, que je connais bien. Avez-vous des éléments chiffrés, s'agissant des délais moyens de réponse – je parle du temps mis pour décrocher et pour apporter une réponse médicale –, qui viendraient corroborer votre position, laquelle nous semble par ailleurs tout à fait logique ?
La crise a mis en évidence le problème des EHPAD, où s'est concentrée la moitié des 30 000 décès. Le SDIS et les EHPAD dépendent des départements : on aurait très bien pu imaginer une synergie utilisant les sapeurs‑pompiers. Il nous a semblé comprendre que vous n'aviez pas vraiment été sollicités par l'administration centrale : qu'en est-il des collectivités locales ?

Dans le rapport dont il a été question, vous évoquez les quatre ESOL, qui n'ont pas été utilisés : pouvez-vous préciser de quelle manière ils auraient pu l'être ?
Il existe de très nombreux acteurs de la santé au quotidien dans les territoires, et il faut sortir du tout-urgences, de l'assignation aux urgences de l'ensemble des acteurs et des transports de malades. C'est ce qui semble se préparer ; la précédente ministre de la santé, déjà, l'avait souhaité dans sa réforme du système hospitalier. La crise du covid-19 n'a fait que révéler les difficultés que le système connaissait déjà : nos collègues hospitaliers sortaient d'une grève car les hôpitaux sont sursollicités, le nombre de lits insuffisant et les urgences saturées, sans parler de la place de nos anciens. La question du tout-hôpital est un sujet de société. Il y va de la répartition de la médecine de proximité dans les territoires : c'est la question de savoir où on installe la maison médicale et comment on regroupe certains acteurs de la santé, y compris les infirmiers, qui, de notre point de vue, devraient jouer un rôle plus important.
Pendant la crise, j'ai essayé, avec l'ordre des infirmiers, de négocier une avancée concernant l'établissement des actes de décès. Il s'agit d'un acte médical, puisque c'est le médecin qui doit le signer. Or vous connaissez toutes et tous la difficulté qu'il y a à trouver un médecin pour le faire, notamment le soir et le week-end. Nous avons donc tenté de faire admettre que les infirmiers pourraient s'en charger. Cela a été refusé. Peut-être aurait-il pourtant été judicieux de profiter de la crise pour s'adapter, et de continuer par la suite à fonctionner de cette façon, car la difficulté des maires à trouver des médecins est bien réelle. Voilà un autre exemple du genre de difficultés que nous avons rencontrées.
Je pourrais citer une quinzaine de départements où il existe des plateformes communes : outre la Haute-Savoie et les Vosges, dont il a été question, il y en a une dans le Tarn‑et‑Garonne, par exemple. Qui plus est, dans ce département, le président du SDIS est aussi le chef du service du SAMU, et il fait travailler ensemble les uns et les autres, pour répondre à l'urgent, au non urgent et à l'aspect social, avec le 115. Dans le Tarn‑et‑Garonne, on apporte ainsi une réponse globale. Nous pourrions tout à fait vous dire qu'il faut continuer à travailler chacun dans son coin, et vous demander des moyens – c'est-à-dire du personnel –, alors que ce n'est peut‑être pas aux urgences qu'il en faut : c'est peut-être dans les étages, dans les blocs de réanimation – je ne sais pas, je ne suis pas un professionnel de santé.
Lorsque c'était possible, parfois même au détriment des accords préalables, nous avons œuvré dans les EHPAD, avec les collectivités territoriales, notamment pour tester le personnel et les résidents. Comme vous l'avez rappelé, monsieur le président, je dirige un SDIS, et nous avons la chance, dans le département où j'exerce, d'être siège à la fois de l'ARS et de la préfecture de région, ce qui a beaucoup facilité les choses, parce que les gens se connaissaient. Les tests nous ont permis d'isoler très vite certaines personnes et de faire en sorte que nos anciens soient pris en charge de la meilleure manière possible.
Avec les 250 000 sapeurs-pompiers, les unités militaires de la sécurité civile et les ESOL, qui sont des plateformes logistiques prêtes à monter des tentes et à aligner des véhicules pour transporter des malades, on dispose d'une véritable « force armée » de la protection civile du quotidien. Or celle-ci n'a pas été utilisée. Cela aurait pu faciliter les choses. Du reste, dans les départements où les sapeurs-pompiers ont joué un rôle de plateforme, travaillant main dans la main avec les collectivités territoriales et l'ensemble des acteurs locaux, cela a permis de distribuer des masques à la population. C'est ce qui s'est passé en Mayenne, notamment, dont on parle actuellement, et dont le président du conseil départemental, Olivier Richefou, est également président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.
Pour en revenir aux EHPAD, les associations agréées de sécurité civile ont été impliquées, de même que notre réseau fédéral et nos unions départementales. Ils ont distribué des masques et acheté des respirateurs. Tout cela a été fait pour répondre à la crise avec une grande et belle intelligence qui peut être la fierté de notre pays. La résilience ne se décrète pas : ce sont celles et ceux qui font le quotidien dans les territoires qui se sont adaptés pour répondre aux défis qui se présentaient à eux. La proposition de loi que nous avons évoquée devrait permettre de mettre un peu plus en avant l'engagement citoyen, ce qui permettrait d'augmenter nos performances si nous devions vivre de nouveaux des événements dramatiques.

Je voudrais revenir sur la question des certificats de décès, car il en a déjà été question à l'Assemblée nationale. Les médecins légistes refusaient toute modification du dispositif, mais un amendement a été adopté – je suis bien placé pour le savoir – qui autorise les médecins à la retraite et les médecins volontaires à s'organiser, au niveau des plateformes gérées par les conseils départementaux de l'ordre des médecins, auxquelles ont accès le 15, le 18 et les élus locaux.
Au tout début de la crise, dans mon département de la Loire, qui était fortement touché, j'ai rencontré des pompiers qui, contrairement à ce que vous nous avez expliqué, me disaient que leur tâche était très compliquée, parce qu'ils devaient assurer des transports de personnes, gérer de nombreux équipements et faire face à la nécessité absolue d'observer un protocole de désinfection complet des véhicules. Je n'ai donc pas vécu la même situation que celle que vous avez décrite.
En ce qui concerne le plan pandémie grippale de 2011, élaboré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), je voudrais mettre en avant une chose qui y était indiquée noir sur blanc : les préfets s'appuient sur les ARS, en particulier pour la mise en œuvre du plan blanc élargi. Or c'est là une des choses qui, à mes yeux, a fonctionné parfaitement bien : on est passé de 5 000 à 10 000 lits de réanimation, pour un maximum de 7 300 personnes hospitalisées en réanimation. Quel est votre regard sur cette application du plan pandémie grippale ?
Quelle a été l'augmentation de l'activité du 18 pendant la crise ? Avez-vous des chiffres à cet égard ? Le docteur Braun nous disait qu'il n'y avait pas eu d'augmentation du nombre de morts par arrêt cardiaque – vous insistiez, monsieur Hertgen, cher confrère, sur le fait qu'il s'agissait d'un marqueur important.
La question du numéro unique est revenue plusieurs fois lors des auditions. S'il est vrai qu'il y avait beaucoup plus de médecins, notamment dans les territoires, au milieu des années 1980, les appels n'étaient pas non plus les mêmes : on observe une sursollicitation des numéros d'urgence et il est exact de dire que la question de leur réorganisation est importante. Cela dit, je voudrais vous citer un exemple très récent. Il s'agit d'un patient souffrant d'un cancer du poumon connu et suivi, qui a appelé le 15 pour une toux et des douleurs diffuses. Il a été orienté vers la permanence des soins, c'est-à-dire vers un médecin généraliste. Pendant la régulation, il a fait un arrêt cardiaque. Que fait-on dans une situation comme celle-là quand on a deux numéros différents ? En l'espèce, évidemment, le transfert vers l'aide médicale d'urgence a été immédiat, puisque le collègue en charge était à côté.
Pour finir, j'ai trouvé que vous étiez très focalisés sur les aspects médiatiques et visuels. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment faire pour améliorer les choses et avancer. Je suis un peu inquiet – je vous le dis honnêtement –, car nous avons auditionné les médecins du SMUR, et je n'ai pas entendu dans leurs propos de choses aussi clivantes que les vôtres. Vous disiez tout à l'heure, à juste titre, que nous avions tous la même envie de servir ; j'aimerais que nous ayons tous aussi celle de progresser ensemble au sortir de la crise. Vous nous avez beaucoup décrit un monde difficile – très difficile même –, dans lequel, me semble‑t‑il, tout le monde a la place. Peut-être le 15 a-t-il pris le dessus, mais c'est naturel, aussi bien parce qu'il a été recommandé par les autorités que parce que les gens ont ce numéro en tête. Nous devons sortir de tout cela par le haut. Or je vous ai entendu critiquer beaucoup vos relations avec les urgentistes, ce qui n'était pas le cas de ces derniers.
S'agissant des certificats de décès, je ne me prononçais pas sur le bien-fondé de la demande des infirmiers, car je n'ai pas la compétence en la matière mais je voudrais faire un parallèle avec ce que nous avons connu dans les années 2000, quand nous demandions à pouvoir poser les défibrillateurs semi-automatiques : on nous le refusait au motif que c'était un acte médical. Dorénavant, on en trouve partout, y compris ici ; il y en a dans tous les établissements recevant du public parce que c'est un outil qui permet de sauver une personne faisant un arrêt cardiaque. De la même manière, nous devons continuer à progresser : il faut savoir s'en remettre à la compétence médicale mais par moments il faut autoriser d'autres acteurs du secours d'urgence – les infirmiers, mais aussi d'autres acteurs de la médecine de proximité – à effectuer certains gestes, car cela permettrait de gagner beaucoup en efficacité, mais surtout en rapidité.
En ce qui concerne les équipements, bien entendu, c'était difficile pendant la gestion du covid-19, et ça l'est encore, car nous continuons à effectuer des opérations taguées « covid », notamment des transports de personnes qui sont soit testées positives, soit présentent tous les symptômes de la maladie. Bien sûr qu'il est compliqué de décontaminer une ambulance ; bien sûr qu'il est difficile de maintenir un centre spécifique pour le traitement de l'alerte, comme à Saint-Étienne, et un centre départemental opérationnel, en cloisonnant et en faisant en sorte que les équipes ne soient pas porteuses de la maladie et ne la transmettent pas. Cette complexité est dorénavant celle de notre quotidien – d'ailleurs, c'est la première audition que nous faisons en portant le masque.
Je n'aurai pas l'outrecuidance de me prononcer sur l'efficacité du plan blanc et sur la récupération des lits, même si, comme Mme Wonner, nous avons entendu dire qu'au moment même où des véhicules transportaient des patients, ou qu'on cherchait des lits en Pologne, certains étaient encore disponibles, notamment parce que le secteur privé n'avait pas été sollicité. Toutefois, n'est-ce pas plutôt à la commission d'enquête qu'il appartient de voir de quoi il retourne ? Pour notre part, nous n'avons pas connaissance de ces données. En ce qui concerne le plan pandémie grippale, oui, il faut le remettre au goût du jour en tenant compte de ce que nous venons de vivre.
Nous pouvons comprendre que les propos de Patrick Hertgen ou les miens apparaissent clivants – même si, en l'occurrence, je ne pense pas l'avoir été. Nous exerçons tous, les uns et les autres, des responsabilités. Nous construisons des réponses opérationnelles, nous travaillons avec des collègues, qu'ils soient en bleu, en blanc ou en rouge. Nous avons pour ambition de servir, mais aussi de construire : considérez que c'est le seul objectif de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, même si parfois, et c'est peut-être là notre défaut, nous agissons avec beaucoup de passion.
Monsieur le président, vous avez considéré, et vous n'êtes pas le seul, que j'ai été clivant. Devant une autre chambre du Parlement, il y a quelques jours, se sont tenues des auditions sur un sujet extrêmement proche, et on nous a dit : « Au moins, le débat est animé, cela nous change des discours lénifiants. » Alors, effectivement, j'aurais pu m'adresser à vous tous en tenant des propos lénifiants, en disant en substance que nous avions beaucoup travaillé…

J'ai dit que vous aviez été clivants, mais pas envers nous : je pensais en particulier aux urgentistes. Pensez-vous que ce genre de propos est à même de vous amener à travailler ensemble ?
C'est bien comme cela que je l'avais compris, monsieur le président. Les choses sont dites depuis assez longtemps et, dans notre microcosme, chacun connaît à peu près ma façon de penser. Je m'exprime ainsi parce qu'il me semble que nous devons sortir de la pensée unique. On peut effectivement dire les choses de manière plus sobre, mais cela consiste trop souvent à se congratuler, à donner un satisfecit à ses tutelles et puis à laisser faire, c'est‑à‑dire, en réalité continuer à dysfonctionner, sans regarder de quoi il retourne, car cela voudrait dire engager le combat.
Je ne souhaite pas particulièrement, dans mon exercice, m'opposer à mes confrères ; j'ai défendu des positions sur lesquelles je souhaite simplement qu'un débat soit ouvert. Je voudrais qu'une autre version que celle des représentants des urgentistes hospitaliers soit entendue, car il existe des urgentistes ailleurs. Je pense, d'ailleurs, que beaucoup de mes confrères hospitaliers exerçant dans des SAMU et dans des SMUR ont des positions assez proches des nôtres, mais qu'ils ne peuvent pas le dire. En effet, pour être dans le milieu depuis trente ans, je puis vous assurer que le médecin urgentiste hospitalier qui adopterait une position publique consistant à dire que le tout‑régulation médicale, le tout au 15 est peut-être un peu excessif, qu'il existe des techniques plus modernes et efficientes, verrait sa carrière achevée. Cet urgentiste aurait des difficultés à recruter s'il est chef de service, à être recruté s'il ne l'est pas encore, à devenir praticien hospitalier, et aurait bien du mal à s'exprimer dans un congrès ou à publier dans une revue. J'ai prêté serment tout à l'heure ; je tiens des propos que l'on me reprochera peut-être, mais que j'essaie d'assumer en les argumentant. Je travaille tous les jours avec des confrères qui exercent dans les SAMU et dans les SMUR. Ce ne sont ni des adversaires ni des concurrents ; je dis simplement que le système dans lequel ils servent, pour l'écrasante majorité avec grande conviction et professionnalisme, est devenu obsolète à certains égards : même s'il affiche une modernité en ayant recours à des applications, des vidéos, quelques opérations spectaculaires, ses fondements mêmes sont totalement obsolètes. Dire cela, ce n'est pas insulter ceux qui servent ce système ; c'est simplement considérer que nous pouvons agir de manière un peu plus efficiente.

Avez-vous constaté une augmentation de l'activité au 18 ? Si oui, dans quelle mesure ? Confirmez-vous qu'il n'y a pas eu de surmortalité par arrêt cardiaque, comme nous l'a dit M. Braun ?

Comment les quatre ESOL auraient-ils pu s'intégrer dans la stratégie de crise ?
Par ailleurs, je ne partage pas le sentiment du président de notre mission d'information. La parole est libre – c'est même l'objectif de cette mission et chacun doit exprimer ses sentiments, son vécu, ses passions et ses vérités. Après, chacun fera la part des choses.
Je ne dispose pas des statistiques intégrales du 18, mais les professionnels observent que la courbe des appels a suivi globalement celle des sollicitations auprès des autres numéros : une augmentation globale, mais absolument pas considérable pendant la phase aiguë – entre fin février et fin mars –, et sans aucune commune mesure avec ce qu'ont connu nos camarades répondant dans les centres 15 ; ensuite, un effondrement de la sollicitation et de l'activité opérationnelle, de la même manière que nos confrères hospitaliers, notamment urgentistes, de début avril jusqu'au déconfinement. Nous n'avons jamais été placés en position de rupture capacitaire. J'en profite pour dire que, si nous avions été les destinataires de l'ensemble de ces appels, nous aurions été dans la même situation que le 15 : nous ne sommes pas plus vertueux par principe.
Je voudrais dire aussi, car je ne l'ai pas encore fait, que les services de réanimation sont ceux qui ont porté le plus gros effort, et qu'ils ont été réellement le facteur limitant. C'est à l'ensemble du personnel des réanimateurs – y compris les infirmières et les aides-soignantes –qui, vous l'avez souligné à juste titre, ont quasiment doublé leur capacité, que l'on doit de ne pas avoir eu plus de décès. Les services d'urgence dans leur ensemble, quant à eux, ont connu une énorme diminution de leur activité : celle-ci était encore inférieure à ce que l'on connaît dans la plus calme des journées du mois d'août. En somme, une fois que tout le monde s'était adapté, il n'y a plus eu d'appels.
Pour répondre à M. le rapporteur en ce qui concerne les ESOL, je rappellerai toute la force des unités opérationnelles que sont les casernes de sapeurs‑pompiers, au bénéfice de la sécurité civile, en y ajoutant les associations agréées. Les ESOL sont des plateformes proposant des moyens mis à disposition par l'État, complétés par ceux des SDIS. Quand l'autorité préfectorale s'est vue confier, avec les moyens dont elle dispose – notamment les gendarmes et les pompiers – les opérations de logistique, elle n'a jamais failli, il n'y a jamais eu de délai d'attente, de réception et de conditionnement. Les stocks ont été sécurisés grâce aux forces de police et de gendarmerie, la distribution a été réalisée grâce à la mobilisation de l'ensemble des sapeurs-pompiers, notamment lors de la phase de confinement, pendant laquelle les sapeurs-pompiers volontaires étaient tous disponibles. L'engagement citoyen et les associations agréées de sécurité civile ont également contribué à la résilience. Les ESOL sont donc de véritables plateformes, qu'il faut développer, renforcer, sécuriser et continuer à mettre en œuvre avec les forces de sécurité intérieure, que ce soient les policiers, les gendarmes ou les sapeurs-pompiers.
En effet.
Membres présents ou excusés
Mission d'information sur l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l'épidémie de Coronavirus-Covid 19
Réunion du mardi 21 juillet 2020 à 12 heures
Présents. - M. Julien Aubert, M. Éric Ciotti, Mme Josiane Corneloup, M. Nicolas Démoulin, M. Pierre Dharréville, M. Jean-Pierre Door, Mme Anne Genetet, M. David Habib, Mme Annaïg Le Meur, Mme Sereine Mauborgne, Mme Michèle Peyron, M. Jean‑Pierre Pont, M. Boris Vallaud, Mme Martine Wonner.
Excusés. - M. Olivier Becht, M. Joachim Son-Forget.