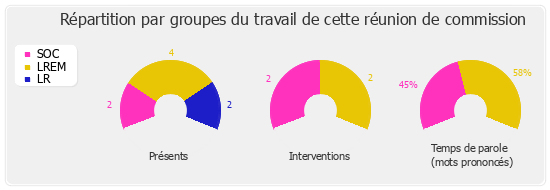Commission d'enquête relative à l'état des lieux, la déontologie, les pratiques et les doctrines de maintien de l'ordre
Réunion du mercredi 14 octobre 2020 à 15h00
Résumé de la réunion
La réunion
La séance est ouverte à 15 heures 05.
Présidence de M. Jean-Michel Fauvergue, président.
La Commission d'enquête entend à l'occasion d'une table ronde, des chercheurs :
- Mme Vanessa Codaccioni, maîtresse de conférences en science politique à l'Université Paris 8
- M. Emmanuel Blanchard, maître de conférences au département de science politique de l'Université de Versailles-Saint-Quentin et à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
- M. Cédric Moreau, maître de conférences en sociologie du droit à l'École normale supérieure
- M. Fabien Jobard, sociologue, directeur de recherche au CNRS
- M. Christian Mouhanna, chargé de recherche au CNRS, directeur du centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales

Mes chers collègues, nous commençons cette nouvelle série d'auditions en recevant plusieurs chercheurs spécialisés dans différentes matières sur les questions liées aux forces de l'ordre : Mme Vanessa Codaccioni, maîtresse de conférences en science politique à l'Université Paris ; M. Christian Mouhanna, chargé de recherche au CNRS, directeur du centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales ; M. Cédric Moreau de Bellaing, maître de conférences en sociologie du droit à l'École normale supérieure ; M. Emmanuel Blanchard, maître de conférences au département de science politique de l'Université de Versailles-Saint-Quentin et à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et M. Fabien Jobard, sociologue, directeur de recherche au CNRS.
Cette table ronde, ouverte à la presse, est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale.
Avant de vous céder la parole pour une brève intervention liminaire qui précédera nos échanges sous forme de questions-réponses, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Je vous invite donc à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».
(Mme Vanessa Codaccioni, M. Emmanuel Blanchard, M. Cédric Moreau de Bellaing, M. Fabien Jobard et M. Christian Mouhanna, prêtent simultanément serment.)
Mesdames, messieurs les membres de la commission d'enquête, je vous remercie tout d'abord de nous avoir sollicités, mes collègues et moi-même, dans le cadre de cette commission sur le maintien de l'ordre. C'est en tant que socio-historienne de la répression et des violences d'État que je m'y exprimerai. C'est d'ailleurs à ce titre, je suppose, que certains membres ont souhaité m'auditionner aujourd'hui, ainsi qu'à propos de mes travaux sur les procès des policiers impliqués dans des violences.
Des cycles répressifs ou des événements particulièrement meurtriers marquent l'histoire du maintien de l'ordre, tout comme la gestion des quartiers populaires par la police et par l'État la marque également. Il ne fait aucun doute qu'avec son lot de personnes blessées, mutilées ces dernières années, mais aussi de morts, ces événements marqueront cette histoire et plus généralement notre histoire.
J'évoquerai les termes de « violences » et d'« empêcher » parce qu'ils me semblent importants.
Bien que souvent niées par le pouvoir, les violences policières sortent de l'invisibilisation grâce au travail des journalistes, des citoyennes et des citoyens, et des associations. Elles sont aujourd'hui bien documentées, à tout le moins pour le mouvement des Gilets jaunes ; on en connaît le terrible bilan, on en connaît aussi, et c'est important, les principales causes grâce aux chercheurs qui sont autour de cette table : contexte d'intervention, équipements et armement, type de communication avec les manifestants, stratégie de maintien de l'ordre décidée en amont par les préfets, forces et unités en présence, cadre légal de l'usage de la force, etc.
La nouvelle doctrine du maintien de l'ordre malheureusement ne changera rien aux violences, pas plus qu'elle ne limitera les atteintes à l'exercice de la liberté de manifester.
J'en viens au terme « empêcher ». Il renvoie au caractère préventif du maintien de l'ordre et à son caractère liberticide. Cette forme de répression en amont a toujours existé. Par exemple, pendant la guerre froide, la quasi-totalité des manifestations communistes était interdite, ce qui n'a pas empêché les communistes de participer à des manifestations par centaines, pas plus que n'a été empêchée la quasi‑totalité des manifestations pendant la guerre d'Algérie dont, vous le savez, certaines se sont déroulées dans des conditions catastrophiques conduisant à de nombreux morts. De nos jours, cette politique préventive est systématique en temps de paix et touche tout l'espace protestataire, en partie par l'application des méthodes et des dispositifs de la lutte antiterroriste à la répression des contestations politiques.
Nos méthodes actuelles de lutte antiterroriste sont préventives, c'est-à-dire qu'elles visent à empêcher que des attentats ne soient commis avant que leurs auteurs ne passent à l'acte. Cela nous paraît tout à fait normal mais nous en connaissons aussi les dérives : criminalisation de l'intention, criminalisation de possibles futurs actes, criminalisation des liens et des appartenances. C'est exactement la même logique punitive qui est utilisée aujourd'hui contre les mouvements sociaux, comme le montrent surtout les interdictions de manifester. Non seulement certaines manifestations sont interdites – c'est de plus en plus souvent le cas – mais les interdictions individuelles de manifester se sont aussi multipliées ces dernières années. Heureusement, la « loi anti-casseurs » qui a été votée a été en partie vidée de sa substance par le Conseil constitutionnel. Il subsiste toutefois son article 2 qui permet à la police judiciaire de procéder à des fouilles de sacs, de bagages, de voitures, en amont d'une manifestation. Ce sont des fouilles de même nature qui, avant la promulgation de la loi, ont conduit à arrêter et à garder à vue des centaines et même des milliers de Gilets jaunes, permettant ainsi de les neutraliser temporairement pour qu'ils ne puissent pas rejoindre le lieu des mobilisations.
Surtout, nous assistons à un phénomène circulaire entre maintien de l'ordre brutal et réactif et maintien de l'ordre préventif car si le maintien de l'ordre en France peut être répressif, il n'en poursuit pas moins un but dissuasif. Combien de personnes ont hésité ces dernières années à manifester de peur de perdre un œil, une main, un pied, d'être sévèrement blessées, mutilées ou tuées par la police ? Des centaines, plutôt des milliers, voire des dizaines de milliers.
L'enjeu est triple : premièrement, assurer l'intégrité physique des manifestantes et des manifestants et de la population en neutralisant la potentialité mutilante, voire meurtrière, des forces de l'ordre, et surtout en faisant respecter les conditions d'usage de la force dite légitime, l'absolue nécessité de la proportionnalité.
Deuxièmement, favoriser le plein exercice de la liberté de manifester par la limitation drastique des interdictions et par la limitation des atteintes dont elles sont l'objet – je pense en particulier à la pratique de la nasse.
Enfin et surtout, j'insiste sur ce point qui me paraît vraiment très important, permettre de voir et de juger l'action des forces de l'ordre, et ce à la fois en ne portant pas atteinte à la liberté d'informer et au droit de filmer les policiers, mais aussi et surtout en instaurant des conditions de jugement des forces de l'ordre et des conditions d'enquête sur leurs agissements qui répondent aux demandes de justice des victimes, de leur famille et de la population.
Monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les membres de la commission d'enquête, je vous remercie de me donner la parole dans le cadre de cette commission d'enquête, d'autant plus que ma présence n'avait aucun caractère d'évidence.
Je m'explique. Historien, je ne suis pas spécialiste du maintien de l'ordre à l'époque contemporaine. Spécialiste des temps d'exception – colonisation, guerre d'Algérie –, je ne reviendrai pourtant pas sur les longues périodes d'état d'urgence que nous avons récemment connues et qui n'ont pas été sans conséquence sur les pratiques du maintien de l'ordre. Vanessa Codaccioni en a dit deux mots et nous pourrons y revenir lors des questions.
Je souhaiterais cependant aborder rapidement trois points qui me semblent importants si l'on ne se résout pas à ce que le nouveau schéma national du maintien de l'ordre (SNMO) soit centré sur des considérations techniques et tactiques.
La première remarque n'a rien d'original puisqu'elle a été évoquée dans le débat public et au sein même de cette commission, notamment par des syndicats de policiers et des représentants d'associations de gendarmes : la déprofessionnalisation du maintien de l'ordre est patente et a été relevée par les experts les plus en phase avec les représentations et revendications des policiers et gendarmes.
Compagnies républicaines de sécurité et gendarmes mobiles ont vu leurs effectifs fortement réduits ces dernières décennies – moins 7,5 % sur la seule période 2010-2015 – et ces professionnels du maintien de l'ordre sont de plus en plus accaparés par des missions éloignées de leur cœur de métier, réduisant d'autant leur temps de formation, crucial pour des unités dont la cohésion est le noyau même de la professionnalité. Je ne fais ici que paraphraser le rapport de la Cour des comptes, publié en février 2017.
A contrario, face à la recrudescence des mouvements sociaux, des effectifs de plus en plus nombreux, dont l'objet n'est pas le maintien de l'ordre et qui n'y ont jamais été formés, sont engagés dans les situations les plus délicates, dont la juste appréciation ne peut être que le fait de professionnels chevronnés.
Pour l'historien que je suis, la « doctrine » française du maintien de l'ordre – le mot est apparu dans le débat public depuis quelque temps – n'est pourtant pas simple à identifier. Mais si l'on considère qu'après les événements de mai-juin 1968, elle aurait dû constituer une forme d'opérationnalisation des principes éthiques du préfet Grimaud – je ne reviens pas sur la circulaire bien connue qui porte son nom – et qu'il s'agit de la mise en œuvre de techniques de distanciation ou plutôt de juste distance pour préserver tant manifestants que policiers, nous sommes loin du compte. Le remplacement d'une grenade par une autre ne modifiera en rien cette déprofessionnalisation des mises en scène et usages de la force.
Ma seconde remarque renvoie en particulier à l'introduction du nouveau schéma national du maintien de l'ordre. Dans ce qui m'a été donné de lire, je relève, comme il est souvent dit dans le débat public, que ce sont « les manifestants qui ont choisi d'aller au contact et d'élever le niveau de violence dans les interactions avec les forces de l'ordre ». Bien que l'historien que je suis ait parfaitement conscience des atteintes que subissent aussi de nombreux policiers et gendarmes, il ne peut que s'interroger sur de telles assertions.
Des travaux récents – faute d'avoir le temps de lire de gros livres d'histoire ou de sociologie, on peut se replonger dans les archives de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) – concordent dans la description de manifestants qui sont de moins en moins équipés pour prendre le dessus dans un combat, rapproché ou non, avec les forces de l'ordre. Pour évoquer des exemples concrets, on peut rappeler que les coups de feu venant des rangs manifestants ouvriers n'étaient pas rares jusque dans les années 1950. Au cours des décennies suivantes, agriculteurs et pêcheurs ont régulièrement fait montre de leur refus du caractère pacifique ou même réglé de la manifestation. Il n'était pas rare que les fusils soient de sortie lors de manifestations de viticulteurs. Pour livrer un exemple précis, je rappelle ce qu'il s'est passé à Montredon, au cœur du vignoble de Corbières, en mars 1976, où les viticulteurs firent parler la poudre, et la fusillade croisée dura près de vingt minutes. Il y eut deux morts tués par balles : un CRS et un viticulteur. À la suite de ces événements tragiques, la France fut frappée d'une forme de sidération, d'une prise de conscience. Si l'on remonte les dernières décennies à grand pas, on constate que l'évolution la plus frappante, y compris au cours de ces dernières années, tient aux manifestants dits « équipés », un terme utilisé régulièrement. Aujourd'hui, un manifestant équipé est une personne qui vient manifester avec du matériel de protection bien plus qu'avec des armes, de quelque nature qu'elles soient : armes par destination ou autres.
Il faut garder en tête l'évolution des équipements, ceux des forces de l'ordre comme ceux des manifestants. Il suffit de se reporter aux images d'il y a quelques décennies si l'on veut analyser les évolutions des violences manifestantes sans postuler qu'elles seraient inédites. Il ne s'agit pas de nier la violence, mais de la caractériser par rapport à ce qu'elle a pu être.
Bien que je ne sois pas forcément d'accord avec l'idée que le niveau de violence se soit élevé, il n'en reste pas moins – et c'est ma troisième remarque – que les manifestations ont changé ; elles sont devenues de plus en plus imprévisibles pour les forces de l'ordre, qui le disent régulièrement, et c'est indéniable. On a, en effet, assisté à une informalisation progressive du répertoire manifestant et au retour de l'indiscipline comme moyen de se faire voir et entendre, voire d'affirmer sa force.
Le cortège discipliné tenait bien davantage à la force des syndicats et au mouvement social qu'aux techniques d'un maintien de l'ordre largement délégué aux services d'ordre syndicaux. Un tel niveau d'auto-contrainte dans les cortèges et dans les manifestations s'entendait uniquement lorsque les centrales syndicales étaient en mesure d'obtenir au moins partiellement satisfaction aux revendications du moment.
Quand les évolutions économiques et les politiques publiques affaiblissent ces mêmes syndicats, voire les délégitiment, la coproduction du maintien de l'ordre devient impossible et les forces de police en sont réduites à tenter de rétablir un ordre et non plus à maintenir l'ordre – la distinction est essentielle –, rétablir un ordre dont la déstabilisation apparaît comme la seule tactique efficace pour une partie des manifestants et manifestantes.
À cet égard, toujours dans cette idée d'un effort de coproduction qui n'est plus pensé, nous avons assisté, selon moi, à un tournant le 1er mai 2019. Si le service d'ordre de la principale centrale syndicale, notamment dans la rue – en cas de contestation, il faut savoir s'il s'agit de la CFDT ou de la CGT, mais dans la rue, c'est indéniablement la CGT – est considéré comme un adversaire, les forces de l'ordre s'exposent à un isolement inédit.
Le schéma national du maintien de l'ordre ne pourra qu'être fragile, voire dangereux pour les forces de l'ordre elles-mêmes s'il est fondé sur des prémisses technicistes et antagonistes, ne laissant pas place à la coproduction de l'ordre inauguré il y a plus d'un siècle, lors de la deuxième manifestation Ferrer, le 17 octobre 1909.
Monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les membres de la commission, je ne veux pas parler pour mes collègues qui s'exprimeront après moi mais, à la suite de Mme Vanessa Codaccioni et de M. Emmanuel Blanchard, je crois, pour travailler sur ces thèmes en sociologie, en histoire ou en sciences politiques, que l'on peut dresser un diagnostic commun, celui d'une crise du maintien de l'ordre, en tout cas de moments effervescents du maintien de l'ordre actuel.
Plusieurs interprétations peuvent en être livrées qui, toutes, me semble-t-il, sont à prendre en considération ; M. Emmanuel Blanchard vient d'en évoquer un certain nombre. Les premières concernent les transformations organisationnelles du maintien de l'ordre, notamment la dépossession relative des forces spécialisées dans la mission spécifique du maintien de l'ordre, mission spécifique au profit d'autres forces qui ne sont pas formées spécifiquement à ces situations. Le phénomène n'est pas totalement nouveau, mais il s'est considérablement accéléré ces dernières années. Les responsables des CRS et des gendarmes mobiles s'en sont vivement plaints en 2018 et en 2019.
Une autre transformation organisationnelle passe par l'accroissement continu d'exigences d'interpellations en maintien de l'ordre, qui, lui non plus, ne date pas d'hier. En 2005, cette attente des autorités politiques vis-à-vis des forces de police a connu une accélération. À ce jour, on peut considérer qu'elle structure davantage encore les tactiques de maintien de l'ordre, comme le prouvent en partie les recommandations du nouveau SNMO.
L'évolution de l'armement abondamment commentée rejoint le premier point que j'ai évoqué. Il suffit de se reporter aux chiffres relatifs aux munitions de lanceurs de balles de défense (LBD) tirées pendant le mouvement des Gilets jaunes en fonction des services qui les ont utilisées pour s'en convaincre. Voilà un premier ensemble d'interprétations.
Le second ensemble rattache la crise du maintien de l'ordre à une situation critique plus large de l'institution policière. Le rapport de François Grosdidier et Michel Boutant de 2018 sur le malaise policier a montré que des problèmes d'organisation du travail ont été pointés à de nombreuses reprises lors des situations qui ont abouti à des confrontations particulièrement vives au cours de ces dernières années.
On est également en droit de s'interroger sur les modalités par lesquelles les forces de police exercent une réflexivité sur leurs propres pratiques. Quelque chose avait été tenté au niveau de la préfecture de police avec la cellule Synapse qui a pris fin pour des raisons exogènes qui méritaient d'être soulevées.
Cet ensemble d'éléments qui concernent la crise du maintien de l'ordre se rattache aux difficultés, notamment organisationnelles, que rencontre en général l'institution policière.
Le troisième ensemble d'interprétations s'attache à la compréhension de la crise du maintien de l'ordre au regard des transformations qui frappent les mouvements sociaux depuis quelques années. La manifestation de rue a été à ce point ritualisée en France que les stratégies de maintien de l'ordre sont parfois déstabilisées lorsque des groupes ne se plient plus à ses normes, parfois même en favorisent le basculement dans les affrontements. Ce constat s'est accéléré récemment, les responsables de la gendarmerie et de la police ayant regretté et signalé les problèmes de coordination et de communication avec une partie des protestataires à l'occasion de la commission d'enquête parlementaire de 2015 ; à l'inverse, nous avons assisté à une moindre compréhension des dispositifs et des stratégies de maintien de l'ordre de la part des manifestants, surtout lorsqu'il s'agissait de primo-manifestants. Ce fut le cas du mouvement des Gilets jaunes.
Le dernier ensemble d'interprétations porte sur le regain de conflictualité politique qui semble également caractériser les mouvements sociaux de ces dernières années. À cet égard, je rejoins M. Emmanuel Blanchard sur la nécessaire mise en perspective historique qui permet de relativiser certains diagnostics, tout en constatant que les situations évoluent et que la défiance à l'encontre des organisations syndicales et partisanes produit de nouvelles formes protestataires qui viennent rencontrer un phénomène qui n'est pas totalement homogène et qui concerne l'institution policière, ce que j'ai appelé « la tentation du face‑à‑face » qui affecte une partie de la sécurité publique et qui se retrouve parfois au niveau du maintien de l'ordre.
Que pouvons-nous tirer de ces quelques éléments de diagnostic lorsqu'on les regarde avec les yeux du sociologue ?
Première conclusion, nous constatons une évolution de la division du travail à l'intérieur de l'institution policière qui se signale par une spécialisation à l'interpellation au détriment des logiques collectives qui fondaient les principes du maintien de l'ordre. Cela suppose de poser la question de leur reformulation ou de leur discussion, pas uniquement par à-coups. À de nombreux égards, il me semble que le schéma national de maintien de l'ordre, si son élaboration a pu soulever ces questions, finit avant tout par prendre acte de ce qui se pratique déjà.
Deuxième conclusion : il me semble que plusieurs éléments ont concouru à extraire les forces de l'ordre, du moins partiellement, de leurs fonctions d'interposition, c'est-à-dire de leur position tierce, entre les protestataires et les objets de ces protestations. C'est à la reconstruction de cette position tierce que l'analyse du maintien de l'ordre semble pousser, posant les vastes questions de la formation policière et des dispositifs à mettre en place dans les situations de maintien de l'ordre. Cela suppose aussi de sortir d'une logique selon laquelle on considère que deux camps se font face, ce qui ne doit pas être le cas. Enfin, il me semble nécessaire de rejoindre une des tendances qui, historiquement, a caractérisé l'évolution du maintien de l'ordre et qui a été largement documentée par les historiens, notamment par les historiens du XIXe siècle, selon laquelle les forces de l'ordre ont été constituées comme l'étalon du niveau de violence accepté et acceptable à l'occasion des mouvements de protestation collective au regard de leurs propres pratiques. Cela signifie ne plus faire des forces de l'ordre de simples forces qui réagissent, qui s'adaptent aux violences des personnes et des groupes auxquels elles sont confrontées, mais bel et bien celles qui donnent l'étalon du niveau de conflictualité, étant entendu que ce niveau de conflictualité doit être le plus bas possible.
Il faut également prendre toute la mesure de ce que disent nombre de responsables policiers et gendarmiques depuis longtemps : il est rare que des problèmes politiques et sociaux puissent avoir pour seule réponse des réponses policières. Bien sûr, cela excède les travaux de cette commission, mais non les missions de l'institution qu'est l'Assemblée nationale.
Monsieur le président, madame la rapporteure, je vous remercie très chaleureusement de nous avoir conviés à exposer nos vues sur les questions qui font l'objet de cette commission et à répondre à vos questions.
Je n'ai pas préparé de propos introductif, étant entendu que nous sommes cinq, que le temps est limité et que vous souhaiterez sans doute nous poser des questions. Je me contenterai de rappeler quelques étapes de mon travail sur ces questions qui, selon moi, livrent des éléments d'information sur l'évolution du maintien de l'ordre en France.
En 1995, avec Olivier Fillieule, nous avons réalisé, pour le compte de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure, une enquête sur le maintien de l'ordre, essentiellement auprès des cadres du maintien de l'ordre à Paris et des directions centrales. Les institutions policières étaient à l'époque très secouées par l'affaire Malik Oussekine, le tabassage à mort d'une personne qui rentrait chez elle pendant une manifestation. La doctrine qui prévalait alors était exprimée notamment par Jean-Marc Berlioz, haut fonctionnaire de la police nationale, qui déclarait que le maintien de l'ordre consistait tout simplement à montrer le plus de forces possible pour ne pas avoir à s'en servir.
Un peu plus de dix ans plus tard, j'ai travaillé auprès de divers acteurs sur la transformation du maintien de l'ordre, exclusivement à Paris, notamment après les épisodes des mobilisations lycéennes et étudiantes de 2006 contre le contrat première embauche. La situation avait considérablement évolué : d'une part, le caractère massif des forces déployées par les unités constituées commençait à passer au second rang. On parlait alors de binômialisation du maintien de l'ordre, c'est-à-dire la formation des escadrons de gendarmerie et des CRS en binômes, équipes légères d'intervention en section de protection et d'intervention qui autorisaient une plus grande mobilité, notamment pour interpeller les manifestants. L'interpellation des manifestants était donc confiée essentiellement aux unités professionnelles. On en trouve trace dans l'une des dernières pages du SNMO.
C'est ainsi qu'en 2008, nous avons vu émerger très fortement, dans un contexte documenté par Christian Mouhanna dans son article Culture du chiffre et police des étrangers, les impératifs d'interpellation et de judiciarisation. Les forces de police et de gendarmerie intervenaient à l'occasion de désordres de toute nature, dans un contexte très fortement marqué par les épisodes émeutiers qui avaient secoué la France en 2005, mais aussi et surtout peut-être en 2007, à Villiers-le-Bel, lorsque des forces de police et de gendarmerie avaient été visées par des tirs d'armes à feu. Rappelons que le flash-ball et le lanceur de balles de défense ne faisaient pas partie des armements policiers en 2008.
Enfin, au cours de ces deux dernières années, dans le cadre d'une recherche confiée par le Défenseur des droits à ce qui est devenu l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice qui vit ses dernières semaines, mon collègue Olivier Fillieule et moi-même avons de nouveau travaillé sur le maintien de l'ordre. Nous avons constaté le passage au second rang des unités constituées, qui forme l'une des lignes rouges du SNMO. Les escadrons de gendarmerie mobile et les CRS sont cantonnés à des postes fixes de barrages, de protection de bâtiments et autres, tandis que l'essentiel de la mobilité en manifestation, en vue notamment de l'interpellation, est confié à des forces de sécurité publique, essentiellement des forces de police nationale qui interviennent en contexte urbain. Les directions de la sécurité publique s'appuient alors essentiellement sur les ressources constituées par les forces de sécurité publique, les forces de police ordinaires, dirons-nous.
Un autre point repose sur le renforcement des logiques de judiciarisation, qui figurent dans le schéma national de maintien de l'ordre. Je ne reviens pas sur la brutalisation du rapport aux manifestants ; il vient d'être évoqué et je souscris en tout aux propos de M. Emmanuel Blanchard. La brutalisation est évidente et accompagne un processus de transformation des manifestations ; nous n'assistons pas nécessairement à une augmentation de la violence des manifestants contre les forces de l'ordre. Regardez les photographies de mai 1968 et vous verrez que les manifestants sont souvent mieux pourvus en équipements offensifs et défensifs que les policiers qui sont en face d'eux.
En 2016, je travaillais en Allemagne au Centre Marc-Bloch. Nous sommes intervenus avec Olivier Fillieule dans le débat français pour indiquer que d'autres manières de faire existaient en Europe et qu'elles tendaient à la désescalade, un terme qui, depuis la parution de notre article en 2016, s'est largement diffusé dans le débat français, notamment parce que l'on s'est rendu compte à cette occasion qu'un mouvement, j'ose le terme, « de civilisation » du maintien de l'ordre était à l'œuvre au sein des polices européennes, dont la France se tenait à l'écart.
À cette occasion, nous avions notamment évoqué l'Allemagne. Je rappelle que c'est dans ce pays que naissent les black blocs et que des tirs sur des fonctionnaires de police de Essen se sont soldés par deux morts à Francfort en 1987. C'est un pays qui a connu des évolutions assez semblables à celles de la France.
Pour conclure, je me réjouis qu'une commission ait été créée par l'Assemblée nationale. J'espère qu'elle saura faire la place à l'ensemble des personnes intéressées au débat public. J'ai suivi d'un peu loin les travaux d'élaboration du schéma national de maintien de l'ordre. Je trouve que le SNMO qui, par bien des aspects, est une production intéressante a été une occasion manquée de rencontre, notamment avec la société civile. Je ne crois pas être le seul ici à partager cette opinion. J'espère que votre commission d'enquête sera l'opportunité de réparer cette occasion manquée.
Monsieur le président, madame la rapporteure, je m'associe aux remerciements formulés par mes collègues pour cette invitation et pour l'écoute que vous voulez bien nous accorder, ce qui est d'autant plus intéressant que voilà plusieurs années que nous travaillons sur ces sujets et que nous avons parfois l'impression de ne pas toujours être entendus. Je vous remercie donc de prendre en compte nos remarques.
Je ne répéterai pas ce qui a été dit, je me glisserai plutôt dans des interstices pour compléter certains aspects.
En premier lieu, de quel point de vue nous exprimons-nous ? Il nous est souvent reproché d'être des intellectuels en chambre. À l'instar d'un certain nombre de mes collègues, j'ai observé de visu, physiquement, un certain nombre de manifestations – pour des raisons pratiques, essentiellement à Paris – mais aussi mené, j'y insiste, des entretiens auprès de policiers et de gendarmes de terrain comme à des postes de responsabilité. Ce qui peut paraître comme étant des éléments à charge contre les policiers ne doit pas être considéré ainsi ; il s'agit aussi d'un questionnement et d'une remise en cause qui viennent des policiers et gendarmes eux-mêmes. J'y insiste et je pense que mes collègues en seront d'accord. Certains policiers et gendarmes déplorent le comportement de leurs collègues. Si, vu de l'extérieur, on a l'impression d'une institution très solidaire et unie, il ne faut pas prendre cette impression pour argent comptant. Cette institution est traversée par de nombreux tiraillements et difficultés. Il importe de le relever.
À cet égard, j'évoquerai le poids des considérations hiérarchiques, peu évoqué jusqu'à présent.
En tant qu'observateur, je formulerai une première remarque rapide sur le constat d'un durcissement qui est peut-être le fait des manifestants mais aussi plus fortement celui des forces de l'ordre. Avant les manifestations des Gilets jaunes dont on a bien vu la violence, se sont déroulées dans Paris des manifestations de lycéens issus de milieux plutôt aisés, de quartiers plutôt tranquilles. À cette occasion, nous avons assisté, en quelque sorte, à une répétition de ce qu'il allait se passer quelques mois plus tard avec les Gilets jaunes, autrement dit une répression policière parfois assez dure, dénoncée par certains policiers eux‑mêmes. Des lycéens ont été placés en garde à vue dans des conditions dont la légalité était plus que douteuse, certains ont été interpellés parce qu'ils portaient des lunettes de piscine – on pourrait multiplier les exemples. Il ne s'agit nullement de remettre en cause le travail policier, mais de dresser des constats clairs dont nous pouvons témoigner pour y avoir assisté.
À cette époque-là, dans Paris, de jeunes lycéens, garçons et filles, qui manifestaient, étaient confrontés à une dure répression de policiers très équipés alors qu'ils étaient eux-mêmes plutôt sous-équipés, contrairement aux Gilets jaunes quelques semaines plus tard.
Dans la mesure où cette commission d'enquête traite de déontologie, je voudrais insister sur ce point, ayant moi-même, pour le compte de plusieurs directions de la police nationale, mené des travaux sur la déontologie vue par les policiers. À cet égard, je voudrais poser la question du nouveau code de déontologie en place depuis 2014, et du malaise ressenti par les policiers au regard de ce code.
Qu'est-ce qu'un code de déontologie si on se place du point de vue des différentes armées qui s'en sont dotées ? Je vais être un peu simpliste, les juristes m'en excuseront. Ce code souligne les circonstances dans lesquelles il est autorisé de ne pas obéir à sa hiérarchie parce que les ordres dérogent à un certain nombre de principes du droit ou des droits de l'homme, qui sont considérés comme supérieurs aux ordres donnés par cette hiérarchie. Or, on constate que la moitié des articles du nouveau code de déontologie, contrairement aux précédents qui avaient été rédigés sous l'autorité de Pierre Joxe, souligne qu'il faut obéir à la hiérarchie. La seconde partie développe la notion de discernement sur laquelle je n'ai pas le temps de revenir ici, à moins que vous ne souhaitiez m'interroger sur le sujet. Pour résumer, il ne s'agit pas d'un outil qui permettrait aux policiers de refuser, dans telle ou telle circonstance, les ordres de leur hiérarchie.
Je le souligne parce que l'on constate ce que l'on pourrait appeler « une politisation du maintien de l'ordre », l'utilisation du maintien de l'ordre non dans une logique exclusive de sécurité mais parce que le gouvernement, à tort ou à raison, s'étant senti menacé, a réagi, voire surréagi. Cela se traduit également à l'échelon local par des tensions avec certains membres de la hiérarchie intermédiaire qui sont prêts à appliquer ces directives, mais en tenant compte du contexte local, voire en restreignant, de temps à autre, l'usage de la force. En d'autres lieux, au contraire, la hiérarchie, soit pour faire plaisir aux échelons supérieurs, soit parce qu'elle a peur, incite les forces de l'ordre, les hommes de terrain, à être plus durs qu'ils ne le seraient spontanément.
Je ne reviens pas sur l'épisode de Nice. Sur le terrain, y compris à Paris, au moment des manifestations des Gilets jaunes, certains gendarmes mobiles ou policiers CRS ont exprimé leur malaise, estimant qu'on leur demandait d'accomplir des actes auxquels ils n'adhéraient pas. Cette interrogation des policiers a été au surplus relayée par le fait qu'il ne s'agissait pas de « la clientèle » habituelle des forces de police et de gendarmerie, autrement dit des jeunes issus des quartiers dits sensibles, mais de personnes appartenant plus ou moins aux mêmes milieux sociaux qu'eux. C'est ce que j'appelle « la crise du déjeuner du dimanche midi », lorsque les membres des forces de police se retrouvent mis en accusation par leur famille, leurs cousins, des amis issus des mêmes milieux qu'eux et qui ont, a priori, confiance dans la police car on sait bien que la confiance dépend du groupe social auquel on appartient.
On peut s'interroger sur le traitement des Gilets jaunes ou d'autres mouvements sociaux, tels que les mouvements écologistes qui avaient l'air gentil au départ, sur le traitement des réunions du vendredi et du samedi qui ont été gérées de plus en plus sévèrement, pour ne pas dire parfois violemment. Beaucoup de policiers s'interrogent actuellement ; je pense que cela reflète en partie le malaise policier.
Des personnes, plutôt proches, en tout cas sympathisantes de la cause policière, se retrouvent placées devant une grande incompréhension qui se mue parfois en une haine des services de police parce qu'elles se demandent pourquoi elles ont été traitées si durement alors qu'elles venaient seulement témoigner d'un malaise. Je ne reviens pas sur la genèse du mouvement des Gilets jaunes. L'impression qui domine parmi ces manifestants et que relaient certains policiers, c'est celle d'avoir été traités comme on aurait dû traiter une minorité de personnes plus violentes si l'on retient l'hypothèse que des groupes s'immiscent dans ces manifestations pour commettre des actes de violence. On peut s'interroger sur l'assimilation par les services de maintien de l'ordre d'une majorité plutôt bienveillante à une minorité agissante, considérée comme insupportable par un certain nombre de personnes.
Cette politisation du maintien de l'ordre met mal à l'aise une large partie des citoyens, y compris ceux qui n'adhèrent pas à des formes de délinquance, et des professionnels – on pourrait revenir de manière plus approfondie sur leur malaise. Cette politisation pose la question des relations hiérarchiques et de l'autorité au sein de ces institutions. Comment réagir en tant que professionnels quand des ordres contreviennent à leur savoir-faire professionnel dans un premier temps et à leur idée du respect des droits de la personne dans un second temps ?

Merci de vos témoignages à tous. Merci également, monsieur Mouhanna, de cette définition du code de déontologie. Elle vous est propre, il fallait l'oser ! C'est un code de désobéissance.
. L'étude commanditée par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été présentée devant les directeurs des services de la police nationale. Il est intéressant de comparer les codes de déontologie militaire à la genèse de ce que l'on a appelé les codes de déontologie. Nous avons interviewé Pierre Joxe à ce sujet et des personnes qui avaient été à l'origine du code de 1983. Il convient de relever que celui de 2014 pose des problèmes par rapport à ce que devrait être un code de déontologie. Je suis tout à fait d'accord pour une définition des rapports hiérarchiques ; elle a sa place dans nombre d'autres codes mais pas dans un code de déontologie. Il me semblait nécessaire de le préciser.

Vous avez soulevé plusieurs problématiques, présenté des observations qui, dans l'ensemble, se rejoignent, et nous vous en remercions. En revanche, vous n'avez donné que très peu de solutions ou de débuts de solution aux problèmes relevés. Avez-vous des suggestions à faire, des solutions à proposer, sur les points que vous avez soulevés ?
Je suis sollicité par mes collègues pour vous offrir des pistes de solution, ce dont je les remercie chaleureusement.
On peut tout d'abord s'inspirer des expériences étrangères. Particulièrement sujette aux tumultes et aux affrontements entre policiers et schwarze Block, une ville comme Berlin – Berlin Ouest dans un premier temps, Berlin réunifiée ensuite – a tenté une politique de longue haleine pendant quinze ans afin de pacifier le rapport aux manifestants. Cette politique repose sur un certain nombre de dispositions et de réformes, et en premier lieu sur un impératif de communication permanente avec l'ensemble des manifestants et non uniquement avec les organisateurs.
Depuis le début du XXe siècle, une communication est instaurée entre forces de police et manifestants mais elle est uniquement envisagée avec les organisateurs déclarants de la manifestation ou les grandes organisations. Emmanuel Blanchard avait raison d'évoquer les images du 1er mai de 2019 lorsque des services d'ordre de grandes organisations syndicales ont été pris à partie par des forces de l'ordre. Ces images sont très marquantes au regard de l'histoire du maintien de l'ordre.
Communiquer avec l'ensemble des manifestants suppose la plus grande transparence possible sur les manœuvres engagées par les forces de l'ordre, qui ne sont pas conçues pour piéger les fauteurs de troubles, mais menées pour assurer la jouissance de la manifestation par l'ensemble des participants. Cet impératif de communication se traduit par la mise en place d'une kommunikationsteam et d'une communication par voie électronique, sur Twitter notamment, par sms, panneaux divers, etc. Cela pourra être l'occasion d'utiliser la 5 G généralisée qui s'annonce.
De ce point de vue, le schéma national du maintien de l'ordre prend acte des évolutions et des enseignements, mais cela suppose de former des agents et de les immobiliser dans un contexte de crise des effectifs du maintien de l'ordre. Or nous ne sommes plus en mesure de montrer la force pour ne pas avoir à s'en servir, puisque les escadrons de gendarmerie mobile (EGM) et les compagnies républicaines de sécurité ont été atrophiés au fil des trente dernières années sous l'effet de facteurs divers.
À Hambourg, au G20 de 2017, auquel j'étais convié en qualité d'observateur, pas moins de 300 policiers étaient affectés à la communication avec l'ensemble des manifestants. La communication vise à justifier et à expliquer les manœuvres en cours et donc, en arrière-plan, à penser autrement le sens de la manœuvre. Nous ne sommes pas en terrain militaire, nous sommes en terrain essentiellement civil et politique. Ainsi que le disait Cédric Moreau de Bellaing, l'action des forces de police a pour finalité de se poser en tiers entre les protestataires et l'objet de leurs protestations, qui est bien souvent l'exécutif, et non comme le bras armé de l'exécutif. Il est important de penser la manœuvre comme s'inscrivant dans ce cadre.
Deuxièmement, une solution pourrait consister en l'augmentation des capacités d'action des unités constituées. À partir des années 90 et surtout dans les années 2000, sous le ministère puis la présidence de Nicolas Sarkozy, il a été considéré qu'elles coûtaient trop cher et que l'on allait donc les évider. Cela a touché les forces dotées d'organisations syndicales et les militaires dont on a fermé des escadrons de gendarmerie mobile. Par ailleurs, on a banalisé leurs missions. Or l'un des points fondamentaux d'un maintien de l'ordre réussi ne tient pas au statut mais à la professionnalisation des forces. Si être CRS ou gendarme mobile n'est pas une garantie à vie d'exercer ces missions dans le plus pur respect de la déontologie, c'est toutefois être formé à ce métier, notamment aux dynamiques et à la cohésion de groupe, aux situations qui suscitent la peur, l'angoisse, l'énervement, la fatigue. Telle est la formation au maintien de l'ordre. Ce n'est pas être formé à « faire de la courette » pour interpeller tel ou tel, ce sont là d'autres formations, d'autres métiers.
De ce point de vue, les options prises par le schéma national de maintien de l'ordre ne sont pas toujours très claires. L'option qui consiste à affecter à des tâches stationnaires les unités de force dites mobiles – mobiles en ce sens qu'on peut les convoquer sur l'ensemble du territoire – et à confier l'essentiel des manœuvres de mobilité aux forces de police urbaine, parfois à la gendarmerie départementale, implique un effort de formation et de professionnalisation et suppose de les budgéter très largement. Or aucun élément budgétaire ne figure dans le SNMO. Olivier Fillieule, Patrick Bruneteaux et moi-même nous sommes manifestés à ce propos car le budget reste le nerf de la guerre.
Dans un certain nombre de pays, à commencer par l'Allemagne, il n'existe pas, à proprement parler, d'unités de forces mobiles comme la France en est dotée, et c'est le principe de réversibilité qui s'applique. C'est ainsi qu'une unité de police – la gendarmerie n'existe pas – peut être affectée à une mission de sécurisation, de voisinage, de police de proximité, bürgernahe Politzei en allemand, c'est-à-dire « la police proche des citoyens », bref une mission de police urbaine au quotidien, ou bien une mission de maintien de l'ordre, ce qui implique de la former à la mesure des enjeux.
De quel budget s'arme le schéma national de maintien de l'ordre lorsqu'il insiste sur la nécessité de confier la manœuvre aux unités de police urbaine ? Ce n'est pas parce qu'il est écrit « gendarme mobile » ou « CRS » sur le dos de la chemise, de la casquette ou aux épaulettes de la tenue que ces personnes sont aptes au maintien de l'ordre, non, c'est bien parce qu'elles ont été formées dans ce but.
En ce qui concerne les gendarmes mobiles, je rappelle qu'il existe des exigences de repos et que 20 % des escadrons stationnent dans les territoires et départements d'outre-mer. À l'heure actuelle, les escadrons qui se déploient ont à peine la capacité de former trois pelotons, soit cinquante-cinq personnels actifs au sol, au contact de la manifestation. Le temps de formation, comme il a été souligné dans le rapport Rufin et par la Cour des comptes, s'atrophie d'année en année. Il convient donc de restaurer la formation, la cohésion de groupe et l'esprit de maintien de l'ordre ainsi qu'il avait été envisagé au départ.
Les évolutions que nous vivons actuellement sont très fortement marquées par deux événements historiques à l'échelle contemporaine. D'une part, les révoltes de la jeunesse dans les banlieues il y a quarante ans. Quand je m'entretenais avec des cadres policiers dans les années 90, leurs faits d'armes tenaient dans les manifestations de sidérurgistes, de gauchistes après mai 68 ; c'était la Corse, Aléria, Montredon. Aujourd'hui, les directions départementales de la sécurité publique (DDSP), pour la plupart, ont été formées à l'émeute urbaine dans la grande périphérie des agglomérations françaises. On peut relever dans le SNMO que les évolutions sont très marquées par cette dichotomisation de la manifestation : tant qu'il ne se passe rien, c'est une manifestation ; dès qu'il se passe quelque chose, nous basculons dans l'émeute. Or, c'est une mauvaise manière d'appréhender les choses, d'autant que cette analyse est attisée, d'autre part, par un second phénomène historique qui tient à l'omniprésence et à l'immédiateté de l'image, à commencer par celles diffusées par les chaînes d'information en continu : à propos d'une manifestation à Nantes, une chaîne sous-titrait « Nantes, vives tensions. » et l'on se rendait compte en regardant les images que le même feu de poubelle tournait en boucle. Ce n'est pas sain. Les journalistes font leur métier, ils veulent conquérir des téléspectateurs, des parts de marché, ils font ce qu'ils veulent, mais les responsables politiques doivent réagir face à de tels procédés avec mesure. De même pour la communication s'agissant de Facebook, YouTube et les reportages immédiats.
Auparavant, on assistait à une gestion patrimoniale du maintien de l'ordre ; autrement dit, on tolérerait de petits désordres si leur répression était susceptible de générer plus de désordres qu'il n'y en avait au départ. C'est ainsi que l'on pouvait tolérer des bris de vitrines, des destructions ou des dégradations. Aujourd'hui, je le reconnais volontiers, il est très difficile de les tolérer, dans la mesure où trois chaînes professionnelles sont présentes sur les lieux, relayées par des youtubeurs de toutes sortes, et que les mêmes images défilent en boucle. La responsabilité est essentiellement du côté des exécutifs, du ministère de l'Intérieur, des préfets, de la préfecture de police. Elle doit consister à décréter que la situation étant maîtrisée, on réagira plus tard, que l'on poursuit son action et à expliquer ce qui se passe, qu'un feu de poubelle est un feu de poubelle. Ce ne sont pas les forces du chaos qui se déchaînent comme on pourrait le croire de prime abord. Voilà donc quelques éléments destinés à nourrir la discussion.
Un historien qui prétendrait avoir des solutions pour le présent sortirait de son cadre professionnel, à l'instar d'un spécialiste de police scientifique ou d'un membre des brigades anti-criminalité qui décréterait avoir un point de vue professionnel sur le maintien de l'ordre. Il me semble qu'il s'agit là d'un élément de poids, même si, en creux, nombre de nos propos suggèrent des pistes, qui ont été développées par M. Fabien Jobard.
Nous tournons autour de deux questions principales, dont la professionnalisation. Si on parle de déprofessionnalisation, c'est qu'il existe des manières de reprofessionnaliser, auxquelles, bien sûr, il faut donner un contenu. Si, en ma qualité d'historien, je ne traite pas du présent, je m'autoriserai cependant à me projeter dans un futur un peu utopique : il existe des habilitations de police judiciaire. Pourquoi ne pas instaurer des habilitations au maintien de l'ordre ? Faire du maintien de l'ordre nécessiterait des heures de formation et une technicité reconnue. Il ne faut plus considérer que le maintien de l'ordre est le métier potentiel de tous les agents de la police nationale, car c'est bien à ce stade que nous sommes parvenus ces dernières semaines, y compris s'agissant des agents de police municipale qui ont été engagés plusieurs samedis, lors des manifestations dites des Gilets jaunes.
Je ne creuserai pas ce qui a très bien été développé par Fabien Jobard. Monsieur le président, vous avez indiqué que nous nous serions contentés de constater sans proposer. Il me semble pourtant que l'ensemble des personnes à cette table partagent une ligne assez forte qui forme une seconde piste, à savoir la nécessité de désenclaver le maintien de l'ordre. Or la proposition du schéma national du maintien de l'ordre pensée et élaborée n'a pas été concertée. J'ai entendu dans cette même salle les syndicats de police regretter de ne pas avoir été consultés.
Imaginons un schéma national du maintien de l'ordre qui s'élaborerait en associant la société civile, les manifestants au travers des syndicats et autres organisations. On pourrait ainsi penser le maintien de l'ordre, non comme une simple technique policière, mais comme une coproduction de l'ordre entre ceux qui défendent un droit fondamental et des façons de revendiquer et des policiers qui, comme les premiers, attendent que leur intégrité physique et leurs droits soient respectés.
Quelque chose dans la façon processuelle dont a été pensé ce nouveau schéma du maintien de l'ordre empêche de déboucher sur des solutions, en ce sens où il est très enclavé et très techniciste. On nous parle de tel type de matériels, de telles techniques, sans jamais associer les personnes ni les organisations qui, pourtant, sont fondamentales pour maintenir l'ordre et non pas simplement le rétablir. Le schéma que nous avons sous les yeux pense beaucoup plus en termes de rétablissement de l'ordre qu'en termes de maintien de l'ordre. La proposition consisterait à revenir à un schéma qui, dans la façon dont il serait pensé, déboucherait sur des solutions relevant du maintien et non plus du rétablissement de l'ordre, ainsi que rappelé par M. Jobard et par nos interventions dans lesquelles on peut puiser des éléments, même s'ils nécessitent d'être opérationnalisés.
Je voudrais réagir à plusieurs des points évoqués à l'instant. Deux termes me semblent importants : exceptionnaliser et interdire. Monsieur le président, vous dites que nous n'avons rien proposé.

Je n'ai pas dit que vous n'aviez rien proposé. C'est la seconde fois que je l'entends ; je vais donc rétablir mon propos, peut-être me suis-je mal exprimé.
Vous avez établi un constat. À l'issue de ce constat, quelles sont vos propositions ? M. Blanchard a avancé des propositions portant sur la méthode, il a évoqué ce que nous avions fait et la façon dont nous devrions procéder à l'avenir. Nous aurions aimé entendre des solutions sur le fond.
En fait, vous connaissez déjà les propositions qui iraient dans le sens d'une amélioration du maintien de l'ordre, tel qu'éviter de radicaliser le mécontentement lors des manifestations. Comme l'a relevé Fabien Jobard, est-il nécessaire d'interpeller quelqu'un qui brise une vitrine, autrement dit peut-on mettre en balance l'atteinte à des biens et l'intégrité physique des manifestants ? Une vitrine vaut-elle un œil, une main, un pied ? Je le dis de manière un peu abrupte, mais telle est la vraie question. Je rappelle que les États doivent protéger la vie des manifestantes et des manifestants.
L'une des solutions pour éviter l'atteinte au droit à la vie serait d'exceptionnaliser des pratiques de violence qui radicalisent les mécontentements lors des manifestations. Par exemple, des pays européens n'interpellent pas systématiquement des individus afin de ne pas radicaliser les manifestants.
On sait aussi que la pratique de la nasse radicalise les mécontentements, voire peut déboucher sur d'autres violences et des débordements. Le Défenseur des droits s'est d'ailleurs exprimé sur cette pratique, dont il doute des fondements légaux. Je rappelle que la Cour européenne des droits de l'Homme s'est pronocée en 2012 sur ce sujet, rappelant que cette pratique ne pouvait être autorisée que dans des circonstances très exceptionnelles, lorsque de graves troubles sont sur le point d'éclater. Or, nous constatons que cette pratique de la nasse s'est banalisée et qu'elle radicalise le mécontentement. Après avoir manifesté pendant des heures, les manifestants ne repartent pas tranquillement dans des conditions apaisées.
Nous pourrons dire la même chose du type d'armement utilisé par la police. La police française est l'une des plus armées, voire elle est surarmée ; elle utilise des armes de guerre dont les autres pays européens ne disposent pas. Le nouveau schéma de maintien de l'ordre institue un superviseur pour autoriser les tirs de LBD, mais les LBD n'en restent pas moins une arme de guerre. Par ailleurs, en termes d'image, voyez dans quelles conditions sont utilisés les LBD, marquant à vie des personnes dans leur chair ! Il n'est pas étonnant que leur utilisation puisse paraître inacceptable. Je dirai exactement la même chose des grenades de désencerclement. Certes, on en a supprimé une pour la remplacer par un autre, la GM2L, mais elle n'en reste pas moins une grenade de désencerclement qui, au surplus, déstabilisera sensoriellement les manifestants. Là encore, dans quel but conserve-t-on ce type d'arme, classée arme de guerre ?
Les conditions de jugement des forces de l'ordre me semblent occuper une place essentielle. L'un des objectifs de ce débat est, prétendument, de restaurer la confiance entre la police et la population. Une partie de la population a peur de la police et considère que les policiers restent impunis et que leurs violences ne sont pas sanctionnées, qu'il y a deux poids, deux mesures. La question des procédures judiciaires, en cas de plaintes d'abus policiers, est centrale. Là encore, on est loin du compte si nous nous référons aux préconisations du commissaire aux droits de l'homme européen ou aux critères de procédures et de jugement des policiers établis par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un sujet qui mériterait que l'on s'y attarde parce que, même si, personnellement, je ne suis pas favorable à des sanctions pénales ni à la répression, nous savons que des peines dissuasives sont susceptibles de ramener à la raison certains membres des forces de l'ordre.

Vous venez de livrer des solutions précises en évoquant l'exceptionnalité des violences et leur laisser-faire, ce qui peut se concevoir et qui se pratique déjà parfois. Laisser brûler une poubelle pour éviter un désordre plus important se fait déjà parfois. Cela étant, il y a exceptionnalité et exceptionnalité. Le commerçant qui, derrière la vitrine de son magasin, craint pour sa vie ne perçoit pas forcément les choses de la même manière.

Oui, il vaut mieux le dire, il vaut mieux tout dire ici. Nous sommes dans une commission où il faut tout dire.
Retirer aux policiers une catégorie d'arme, pourquoi pas ? Mais, dès lors, comment vont-ils intervenir sans armes ? Il convient d'y réfléchir.
Éviter les procédures judiciaires ou faire en sorte qu'elles soient accélérées revient à remettre en cause le pouvoir des magistrats de suivre ces affaires et à ne pas leur faire confiance – même si, j'en suis d'accord avec vous, il convient de soulever ce problème. On peut partir de ce présupposé, et d'ailleurs certains l'ont fait. Il faut trouver des solutions, mais des solutions équilibrées de part et d'autre. Le maintien de l'ordre a vocation à maintenir l'ordre et suppose de ne pas tout laisser faire. C'est là que réside toute la difficulté.
Je note un petit problème. D'aucuns militent pour la professionnalisation, M. Jobard nous dit que les policiers ne sont pas professionnalisés. Je rappelle qu'ils suivent des formations.
D'où mon insistance sur les budgets ; le sujet reste épineux. Dans cette maison même, des rapports dénoncent le fait que l'on peut de moins en moins former des policiers auxquels on demande toujours davantage.
La question est de savoir s'il faut des unités spécialisées. Tout le monde s'accorde à dire que celles qui interviennent au titre du maintien de l'ordre doivent être professionnalisées et formées.

Actuellement, des équipes – les CRS et les gendarmes mobiles – sont professionnalisées et formées. La problématique porte sur les unités qui font du maintien de l'ordre et que l'on devrait mieux former. J'en suis d'accord.
S'agissant du lanceur de balles de défense, je ne veux pas vous apporter la contradiction, si ce ne sont les informations que nous avons reçues au tout début des rencontres sur le schéma national. Des policiers allemands et espagnols nous ont montré des images d'émeutes et de manifestations violentes, avec usage des LBD.
Les Espagnols les ont retirés des armes utilisées après avoir constaté les dégâts qu'ils avaient provoqués lors de l'évacuation de la Puerta del Sol en 2011 et, en Allemagne, on n'utilise jamais les LBD lors des manifestations, jamais !

Il ne s'agit pas de justifier, mais de dire la difficulté de croire à une situation idéale.

Je vous remercie, car il est important pour nous qui travaillons sur ces sujets de les mettre plus largement en perspective et de vous entendre sur les actions à imaginer pour assurer le maintien de l'ordre de manière plus satisfaisante.
Après vous, il me semble important de le redire : la détérioration du lien entre police et population cause le plus grand tort aux policiers chargés du maintien de l'ordre. Il est souvent affirmé que les bonnes relations entre la police et la population conditionnent l'efficacité de la sécurité publique. Je retrouve cette idée dans vos propos : si on veut améliorer ces relations et les conditions dans lesquelles s'effectue le maintien de l'ordre, c'est pour que la population aille mieux, mais c'est aussi pour que les fonctionnaires qui en sont chargés travaillent dans des conditions plus acceptables. Nous avons connu, au cours de la dernière période, des incidents extrêmement violents de part et d'autre et assez spectaculaires à l'encontre des commissariats. Cela montre combien la détérioration de ce lien est préjudiciable à tout le monde et notamment aux policiers.
Comment lutter contre l'omniprésence des images que vous avez évoquée ? Certains policiers ont demandé la possibilité de filmer systématiquement. Une telle mesure serait-elle susceptible d'améliorer les choses ? Selon vous, serait-il possible de revenir à la doctrine Grimaud, dont nous semblons nous être quelque peu éloignés ?
Quel regard portez-vous sur la judiciarisation du maintien de l'ordre ? Le dernier schéma pose la question de savoir comment plus facilement préparer, en quelque sorte, la comparution des manifestants devant les magistrats. J'ai compris ce que vous reprochiez au code de déontologie ; si nous devions proposer une modification du code, quelles évolutions proposeriez-vous ?
S'agissant de l'amélioration des relations entre la police et la population, je serai un peu caricatural, mais au moins cela présentera-t-il l'avantage de la clarté. Jusqu'au début des années 2000, la police française de maintien de l'ordre fonctionnait plutôt bien, à l'inverse de la relation de la police du quotidien et de la population dans certains quartiers, notamment dans les quartiers sensibles.
Le diagnostic d'une dégradation des relations entre la police et la population a été dressé la première fois en 1977 par la commission Peyrefitte ; l'exercice a été réitéré avant la création de la police de proximité à la fin des années 90 et a fait l'objet d'analyses, y compris par des personnes comme le préfet Lambert et d'autres encore quand ils dressaient le bilan de leur carrière.
Selon les témoignages de mes collègues, la police du quotidien, qui ne marchait pas trop bien, ne s'est pas inspirée de la police du maintien de l'ordre ; on a plutôt assisté au phénomène inverse. Cela s'est traduit notamment par l'utilisation des brigades anti-criminalité unités assez controversées dans leur action dans les quartiers dits sensibles. Ces brigades anti-criminalité sont désormais utilisées au maintien de l'ordre. Il en va de même des LBD. Les unités de maintien de l'ordre s'inspirent de doctrines et de pratiques utilisées dans les banlieues, qui n'ont fait qu'accentuer la difficulté des relations entre la police et la population.
Les caméras, la technologie en général, ne sont pas inutiles, mais elles ne suffiront pas et ne seront pas la solution miracle pour l'apaisement de toutes les tensions. En effet, ce n'est pas parce que l'on équipera les policiers de caméras que les tensions en seront pour autant apaisées. La méthode a été évaluée en Suisse, au Canada et dans d'autres pays encore. Nous pourrions mener une évaluation en France si on nous en donnait des moyens et si on nous demandait de le faire. Si la technologie peut contribuer à diminuer les tensions, cela ne suffit pas, tout simplement parce qu'il est nécessaire de recréer ce lien à travers des campagnes de communication.
J'en viens à un point essentiel de votre question qui tient à la judiciarisation du maintien de l'ordre. Beaucoup de discours, encore maintenant, portent sur la justice rapide. Il s'avère que je travaille sur l'institution judiciaire depuis un grand nombre d'années. La notion de justice rapide mériterait d'être approfondie dans la mesure où l'on s'aperçoit que la comparution immédiate ne permet pas un travail de justice de qualité, du point de vue tant des auteurs que des victimes. J'insiste sur les victimes qui en sont très insatisfaites. Je reprends votre exemple du bijoutier dont la vitrine a été brisée et qui constate que les personnes interpellées passent en comparution immédiate. Surtout si elle est blessée, cette personne n'ira pas témoigner à l'audience et pensera que ses droits de victime n'ont pas été respectés.
Instaurer des procédures de justice rapide ne résoudra pas la question des manifestations ; au contraire, juger nécessite de prendre son temps et d'analyser les faits. Quand il y a des fumigènes, du bruit, etc., on voit bien que les images vidéo ne suffisent pas. Un travail de la justice qui passerait par des interpellations sur le long terme de personnes qui ont été reconnues, identifiées sur la base de témoignages, évidemment, est nécessaire. Que l'institution judiciaire sanctionne, certes, mais ce travail ne peut intervenir en réaction immédiate. Au surplus, la participation de la justice à l'écriture de certaines circulaires qui interviennent en amont des manifestations pose question, tant du point de vue du droit et de la justice que du point de vue de l'opérationnalité. Est-ce répondre à l'efficacité que de demander d'interpeller ou de contrôler les personnes qui portent des lunettes de piscine ? La question de l'efficacité nous préoccupe aussi.
Ce n'est donc pas par une justice rapide mais, au contraire, par une justice qui prendra le temps d'analyser, de prendre des décisions, que nous pourrons éventuellement apporter quelque chose, d'autant que la justice, dans le temps immédiat, sera toujours en décalage. On a inventé le traitement en temps réel dans les années 90, mais il est toujours en décalage parce qu'aucun magistrat n'est sur place pour condamner à l'instant T.
Sur le code de déontologie, je me ferai l'écho de questionnements des professionnels : jusqu'où peut-on aller quand un supérieur hiérarchique demande, par exemple, de charger une foule qui semble, du point de vue des professionnels policiers, plutôt calme ? La question s'est posée très concrètement. Nous avons reçu à ce sujet des témoignages de gendarmes, mais également de policiers – qui, sans doute, ont plus de difficultés à l'exprimer. On retrouve cette préoccupation chez des responsables policiers et gendarmes. Peut‑on refuser d'obéir à un préfet ou à un supérieur hiérarchique, non pas parce que tel ou tel aurait des velléités d'anarchisme ou ne respecterait pas les règlements de l'institution mais parce que, pour différentes raisons – panique, volonté de faire plaisir au politique ou déconnexion du terrain – il peut arriver qu'un responsable hiérarchique se trompe ?
Il faut indiquer aux policiers où se situent les limites et énoncer des règles – telle est la fonction d'un code de déontologie –, expliquer jusqu'à quel point il faut à tout prix obéir à sa hiérarchie. Placé dans une zone grise, le sujet mérite une discussion avec la hiérarchie, nécessite de demander la confirmation de l'ordre, une supervision, un contrôle, etc. Il peut arriver que la ligne rouge soit dépassée. Dans cette hypothèse, quand bien même la hiérarchie ordonnerait de faire ceci ou cela, les professionnels pourraient refuser parce que les chefs aussi peuvent se tromper. Telle est la question qu'il convient de poser si on veut parler de déontologie. Pour les policiers qui ne respectent ni les règles ni l'autorité, des règles administratives existent qui permettent de les sanctionner – et ils le sont de manière assez dure. Mais avoir le droit de refuser un ordre au nom de principes supérieurs me paraît essentiel.

En cas d'ordre illégal, il existe depuis très longtemps un devoir de désobéissance. Comment l'articulez-vous avec votre propos ?
Je ne prétends pas vous donner la solution toute faite, c'est là un débat qui doit réunir professionnels de la sécurité, policiers et gendarmes qui disposent des témoignages que j'ai évoqués, ce n'est pas moi qui les ai inventés. Ce sont des témoignages directs, dont certains sont d'ailleurs parus dans la presse. Il s'agit de concevoir ensemble. C'est une réflexion qu'il conviendrait également de mener avec les élus du peuple, à différents niveaux, sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ce serait également l'occasion de soulever les questions liées aux armes, aux techniques et aux limites – jusqu'où doit-on aller pour protéger une poubelle ? faut-il charger ? – et surtout poser la question des limites de l'utilisation de certains outils.
Je précise que nombre des points que nous avons évoqués dans nos analyses se fondent essentiellement sur les propos des policiers et des gendarmes. Nous ne défendons pas un point de vue extérieur qui ne prendrait pas en considération le contexte parfois difficile des interventions policières.
S'agissant de la spécialisation de la profession dont il a beaucoup été question, ce sont les policiers, les responsables des CRS et des gendarmes mobiles eux-mêmes qui ont mis en avant que les interventions des forces non spécialisées, non formées au maintien de l'ordre, pouvaient être un problème.
J'entends bien que la relation peut parfois être ambiguë. Par exemple, des responsables CRS ou des gendarmes mobiles diront que le fait que des unités procèdent aux interpellations les arrange d'une certaine manière car cela leur évite de dégarnir leurs dispositifs et donc d'envoyer des effectifs procéder à l'interpellation et de présenter l'interpellé aux officiers de police judiciaire (OPJ). Lorsque ces unités, prélevées dans les brigades anti-criminalité ou les compagnies de sécurisation et d'intervention (CSI), font du maintien de l'ordre, ce ne sont pas nous, universitaires, qui regardons cela de manière circonspecte ; ce sont les policiers eux-mêmes qui mettent en avant les problèmes que cela entraîne.
La question se pose dans les mêmes termes pour l'usage des lanceurs de balles de défense. Des articles de presse se font écho de policiers et de gendarmes qui expriment parfois leur malaise face à l'utilisation de ces armes. La représentante du ministère de l'Intérieur, auditionnée au Conseil d'État début 2019, a livré les premiers chiffres du nombre de munitions tirées. La gendarmerie a très rapidement publié ses propres chiffres, suivie par le service central des CRS, qui a indiqué que les CRS étaient loin d'avoir utilisé massivement ces munitions. Nous nous appuyons bien sur la parole des policiers et des gendarmes.
Sur le sujet de l'omniprésence des images, j'irai dans le même sens. Il s'agit d'un constat, je ne suis pas certain qu'installer des caméras sur les casques des policiers soit une solution. En 2016, pendant les manifestations contre la « loi Travail », des policiers ont demandé l'autorisation d'installer des GoPro sur leurs casques pour montrer des images de violences commises par les manifestants. L'évolution est inéluctable mais ne fera que déplacer les controverses.
La doctrine Grimaud qui suscite débat ne peut que passer par une transformation des pratiques, laquelle repose sur nos propositions relatives à la formation. Nous pourrions adopter la démarche comparative des services de police européens, pas nécessairement de maintien de l'ordre, confrontés à des phénomènes de violence, tels que la lutte contre le hooliganisme, qui ont expérimenté un travail réflexif collectif entre les forces de police, la population et parfois des groupes posant problème aux forces de police.
Favoriser d'un débat public sur un mode autre que celui de la controverse après des événements graves serait de nature à contribuer à améliorer le maintien de l'ordre.
Je poursuis sur la doctrine Grimaud car il est important de la resituer dans le contexte historique afin de rendre leur rôle aux élus et au ministre de l'Intérieur. En 1968, le préfet Grimaud a été défait politiquement. Nous évoquons différentes visions du maintien de l'ordre qui traversent la société, les gouvernements et les forces de police. Les visions du maintien de l'ordre sont très différentes. Certes, Maurice Grimaud restera préfet de police jusqu'en 1971, mais le nouveau ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, sera favorable à une vision tout autre du maintien de l'ordre : un maintien de l'ordre spectaculaire, judiciarisé, caractérisé par des interpellations, un maintien de l'ordre dans lequel force reste à la loi, selon les termes qui sont utilisés, même s'il s'agit de contourner le droit pour que force reste à la loi.
Ici, la doctrine Grimaud fait plutôt référence à une vision patrimoniale du maintien de l'ordre où le capital le plus important est le capital humain, où l'intégrité physique des policiers est considérée comme précieuse car il faut savoir que Marcel Grimaud était très attaché à ses policiers. S'il a pu écrire la lettre envoyée aux policiers parisiens en mai 1968, c'est parce qu'il était soutenu par le principal syndicat de police de l'époque. Cela ne l'empêchera pas d'être défait politiquement les années suivantes, comme le montrent l'affaire des viticulteurs dans les Corbières à Montredon à la fin des années 70 et l'affaire Malik Oussekine en 1986.
Nous voyons bien le balancement entre le maintien de l'ordre qui doit être, j'ose le mot, « viriliste », spectaculaire, où ce qui compte n'est pas tant que la manifestation se déroule le moins mal possible que l'image donnée de forces de l'ordre non mises en péril. Marcel Grimaud concevait le maintien de l'ordre comme la capacité à supporter ce qui serait insupportable pour des non-professionnels du maintien de l'ordre, à l'image des injures ou des lancers de projectiles. D'où la question de la formation que nous avons soulevée.
Dans le cadre du SNMO, il est évident que le ton qui sera donné par le ministre de l'Intérieur est primordial. Depuis quelques décennies, le ministre de l'Intérieur se présente comme le premier flic de France, ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps. Si cette tonalité n'est pas contrebalancée par d'autres visions portées notamment à l'Assemblée nationale par les élus de la nation, les professionnels qui seront en mesure de se faire entendre seront plutôt ceux qui seront en faveur de l'interpellation, de la judiciarisation et de l'armement puisque le SNMO repose sur un dialogue entre professionnels du maintien de l'ordre, la société civile ayant très largement été mise à l'écart. Ceux qui sont pour la patrimonialisation, la mise à distance, la préservation de l'intégrité physique seront mis en difficulté s'ils ne se peuvent pas s'appuyer sur des paroles politiques fortes puisque, in fine, c'est bien ce qui arbitrera entre des visions qui ont toujours cohabité au sein même du corps policier au fil des décennies.
Je voudrais revenir sur la question des images. Vous avez évoqué la possibilité pour les policiers de se filmer ou d'être porteurs de caméras. Mon collègue Christian Mouhanna vous l'a dit, dans plusieurs pays, l'expérience n'est pas concluante, y compris aux États-Unis, où les policiers sont filmés. Les caméras embarquées dans leur voiture n'ont malheureusement jamais empêché ce qu'on appelle, à tort, les bavures policières.
Donc, filmer, pourquoi pas si cela peut offrir des images d'une scène sous un autre angle, mais je tiens à vous alerter sur les dangers que représente la nouvelle stratégie de maintien de l'ordre qui encadrera le droit de filmer les policiers car elle touche à la liberté d'informer. Les journalistes sont actuellement vent debout contre le SNMO, et à raison, puisque leur identité devra être confirmée, ils devront posséder une carte de presse, être accrédités auprès des autorités, mettant en péril le travail de nombreux journalistes qui ne seront pas reconnus comme tels et la mission des observateurs des droits humains censés observer les manifestations.
Pour conclure sur ce point, des caméras sur les policiers pourquoi pas, mais préservons la liberté d'informer des journalistes.
Je veux revenir sur la question de la déjudiciarisation. Nous avons assisté à un fait extrêmement frappant pendant les manifestations des Gilets jaunes : un nombre inédit de 3 000 personnes ont été arrêtées, gardées à vue mais surtout jugées dans le cadre de la comparution immédiate qui, il faut le dire, est indigne de notre système judiciaire.
La comparution immédiate consiste en vingt-neuf minutes d'audience, soit un temps trop court pour que les avocats préparent la défense de leurs clients. Les accusés eux-mêmes ne peuvent se défendre en si peu de temps. C'est une justice punitive ; en effet, on s'aperçoit que le nombre de peines de prison ferme ainsi que celui des mandats de dépôt ont progressé. Ayant assisté à des comparutions immédiates et pu avoir accès à certains dossiers, j'ajoute que l'une des peines les plus appliquées aux Gilets jaunes a été l'interdiction de manifester à Paris pendant plusieurs années. On en revient à une forme de répression préventive.
L'un des grands crimes ou délits des Gilets jaunes a été la participation à « un groupement en vue de commettre des dégradations et des violences. » C'est, dirons-nous, l'héritage de la loi anti-bandes de Christian Estrosi de 2010 qui criminalise des intentions et des actes futurs. C'est ainsi que des Gilets jaunes ont été arrêtés parce qu'ils avaient un gilet jaune dans leur voiture ou parce qu'ils étaient en possession de genouillères ou d'un masque. Être arrêté pour ce type de délit est dangereux dans un régime démocratique.
De nombreux amis ou collègues avocats soulignent également le délit d'outrage, un délit problématique dans notre pays, utilisé par les policiers à la fois pour criminaliser des manifestants mais aussi pour se dédouaner lorsqu'ils sont eux-mêmes accusés d'abus dans l'usage de la force.
Il conviendrait de nous pencher sur ces deux délits. Il y aurait beaucoup à dire, mais je ne suis pas avocate.

Monsieur Mouhanna, je suis content que vous ayez indiqué dans vos propos introductifs que ce qui pouvait être entendu comme des propos à charge contre les forces de l'ordre ne devait pas forcément être pris en tant que tels car j'avoue les avoir un peu pris ainsi pour ce qui me concerne ! Je vais donc essayer de vous faire part de mon interprétation, même si je suis assez d'accord avec certaines des assertions des uns et des autres.
Monsieur Blanchard, il n'est pas rare de constater, avez-vous déclaré, que les manifestants ne sont plus équipés pour tenir tête aux forces de l'ordre, sous-entendu « contrairement à ce qui était le cas auparavant ». Nous comprenons que l'égalité des armes serait un élément important.
Certains d'entre vous, dans cette salle, ont participé à un documentaire récent sur le maintien de l'ordre, actuellement projeté au cinéma. Je m'empresse de préciser que je l'ai vu, sans quoi les réseaux sociaux m'inviteront plus ou moins gentiment à aller le voir ! J'ai donc bien vu ce documentaire qui traite largement du monopole de la violence légitime.
Notre contrat social implique que le policier et le gendarme aient des pouvoirs exorbitants. Le droit pénal, qui est produit notamment dans cette maison, rappelle qu'insulter ou blesser un policier ou un gendarme ne revient pas à insulter ou à blesser un tiers : cela constitue une circonstance aggravante. C'est bien la preuve que les forces de l'ordre ne sont pas sur un pied d'égalité avec les autres citoyens, d'un point de vue strictement juridique. Aussi, me semble-t-il, il n'y a pas d'égalité des armes et je pense que notre contrat social repose sur l'adage : force doit rester à la loi. Je ne suis pas gêné par l'idée que le maintien de l'ordre organise ce monopole de la violence désarmant les manifestants.
En tant que sociologues – même si vous ne l'êtes pas tous, vous portez tous un regard sociologique sur ces sujets –, vous devriez vous interroger sur une forme de banalisation ou de regard porté par une partie de notre société sur les forces de l'ordre et en contrepoint sur l'extraordinaire demande d'autorité qu'elle réclame. Voilà ma réaction.
J'en viens à ma question, qui s'adresse plus spécifiquement à M. Blanchard en sa qualité d'historien. Il s'agit d'une question ouverte, je n'ai pas d' a priori quant à la réponse.
Vous sembliez dire qu'en regardant dans le rétroviseur, nous constaterions que certaines violences manifestantes étaient plus importantes dans le passé, pendant les manifestations de 1968, par exemple. Est-il possible de porter un regard à caractère plus scientifique ? Concrètement, pouvons-nous mesurer les dégâts causés – le nombre de voitures brûlées, de personnes blessées –, les coûts engendrés, par exemple, entre les manifestations des Gilets jaunes et celles de mai 68 ? Des études comparatives ont-elles été réalisées sur le nombre de voitures dégradées en 2019 et en 1968, sur les remboursements des assurances ? Les chiffres permettraient des comparaisons.

Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui.
Il me semble que vos propos sont très intéressants pour accéder à une compréhension la plus juste possible sur ce manque de confiance et ce malaise dont vous avez tous fait état dans les relations entre les forces de l'ordre et la population.
En tant que parlementaires, nous sommes là pour trouver des réponses dans le cadre de cette commission. Nous poursuivons tous, me semble-t-il, le même objectif, qui consiste à trouver des solutions, ce à quoi vous avez largement contribué au cours de cette audition, en tout cas, nous allons pouvoir y réfléchir.
Il n'en reste pas moins que je vous poserai plusieurs questions.
Vous avez évoqué les manifestants d'un côté, les forces de maintien de l'ordre de l'autre. Nous avons le sentiment que des personnes s'immiscent dans ces manifestations pour uniquement contrarier l'ordre et pour casser. Je les appellerai « les casseurs », même si ce terme présente un caractère générique.
Ainsi que cela nous a été rapporté au cours d'autres auditions, les personnes ayant pour fonction de maintenir l'ordre peuvent être dans une relation « de confiance mutuelle » avec celles qui viennent manifester, dont des femmes et des enfants. Que des casseurs s'introduisent dans les manifestations pour y provoquer du désordre devient problématique. Depuis quand assistons-nous à ce phénomène ? Comment maintenir l'ordre dans ce contexte de violence suscité par des personnes extérieures à la manifestation ?
Je crois beaucoup à l'idée que vous avez présentée sur la communication, qui serait certainement un relais de confiance entre les manifestants et les agents du maintien de l'ordre.
J'entends bien vos arguments sur les LBD et sur les grenades de désencerclement. Vous parlez beaucoup de l'Allemagne. Dans les moments de violence, policiers et gendarmes doivent être dotés, si ce n'est de telles armes, en tout cas de moyens pour se défendre et protéger leur intégrité. Pourriez-vous citer un exemple de moyens qui doivent obligatoirement être donnés aux personnes qui sont là pour nous protéger et se protéger elles-mêmes ?
Vous avez, par ailleurs, opéré une distinction entre manifestations et émeutes, et relevé le mauvais emploi des termes. Aussi j'aimerais obtenir quelques éléments supplémentaires. Faut-il réfléchir en termes de degré ? Vous dites utile de tolérer du désordre, mais il est compliqué précisément d'établir à quel moment le désordre est tel qu'il nécessite d'intervenir.

J'ai un lourd passé de manifestant derrière moi, ayant commencé à manifester à quinze ans, au tout début des années 70, à une période où, je peux en témoigner – vous l'avez du reste souligné pour certains d'entre vous – les manifestations étaient parfois extrêmement violentes. Mais je ne dis pas pour autant que c'était bien. Je me souviens parfaitement des sidérurgistes, pour ne parler que d'eux. J'étais présent. Je me souviens du mouvement autonome à l'époque, qui n'était pas constitué de black blocs mais des anarcho-je-ne-sais-quoi qui mettaient le feu à des bâtiments. Des incendies avaient été provoqués au cours de quelques manifestations. Disant cela, je ne justifie rien, j'essaie seulement de replacer les choses dans leur contexte.
Vous avez cité le préfet Grimaud et sa doctrine ; aussi, je me permettrai une petite réflexion à ce sujet. À l'époque, à Paris en tout cas, au cours des trois semaines de mai 1968, les manifestants étaient principalement des étudiants, des filles et fils de bourgeois. C'était les enfants des personnes au pouvoir à l'époque qui manifestaient. La situation est un peu différente de nos jours.
À l'époque, le pouvoir a souhaité limiter les dégâts et éviter les morts – nous avons toutefois eu à déplorer la mort d'un commissaire de police à Lyon et d'un ouvrier à Flins. De mémoire, on il n'y a pas eu de décès d'étudiants.
Je reviens à l'interrogation de notre collègue Camille Galliard-Minier sur la différence à opérer entre manifestations et émeutes. J'ai en mémoire les images récentes de l'Arc de Triomphe. Moi qui suis de gauche et dont le cœur balance un peu du côté des Gilets jaunes, j'ai vu des images d'émeutes. Cela n'avait rien à voir avec une manifestation : on attaquait bille en tête, on cassait du flic. Je suis officier de réserve de gendarmerie, je n'aurais pas aimé être sous les projectiles.
Tirer des balles de défense sur une foule pour la disperser alors qu'on lui a demandé de partir et qu'elle n'obtempère pas peut se discuter. À cet égard, nous avons eu à connaître des usages de LBD très discutables. Mais quand il s'agit pour les forces de maintien de l'ordre de se protéger d'agressions susceptibles d'être mortelles, parce que les projectiles lancés pourraient causer de gros dégâts, il est nécessaire qu'elles disposent du matériel adéquat. Il ne s'agit pas vraiment d'une question, je voudrais vous faire réagir à mes propos.
Je vous remercie de votre intervention à double titre : d'une part, cela me permet de préciser mes propos qui auraient pu être mal compris ; d'autre part, parce que la question que vous dites poser en sociologue est très intéressante sociologiquement mais assez insoluble – je vais y revenir.
Contrairement à ce qui est indiqué en introduction du SNMO, il est compliqué de postuler a priori que les manifestants actuels seraient plus violents que ceux d'autrefois, « autrefois » renvoyant à des périodes très différentes. Qu'il y ait des violences, des violences extrêmes, des phénomènes émeutiers, bien sûr, et l'on peut trouver des moments paroxystiques de violence à chacune des époques. Nous pourrions citer les manifestations de 1934 ou la manifestation contre le général Ridgway en 1952.
J'ai constaté qu'une partie des manifestants est aujourd'hui équipée de façon relativement spectaculaire, qu'il s'agisse de leurs attributs de manifestant ou de leur manière de se protéger. Ils ne viennent pas manifester habillés comme ils le sont tous les jours. Ils viennent équipés. Ce sont avant tout des équipements défensifs alors que dans les manifestations qui avaient lieu jusqu'aux années 80, les manifestants étaient équipés de matériels offensifs. Je n'ai pas justifié leur attitude dans mes propos, je n'ai pas porté un point de vue légal sur la question, je me suis contenté d'observer.
Le débat visant à déterminer qui est le plus violent entre le Gilet jaune de 2019, le sidérurgiste de 1979, le viticulteur de 1976, le communiste de 1952 ou le manifestant d'extrême droite de 1934 est quasiment insoluble. Du point de vue matériel, monsieur Gouttefarde, vous étiez sur une piste extrêmement intéressante, mais elle devient une impasse dans la mesure où les biens ne sont plus assurés de la même façon. Nous ne pouvons pas trouver la réponse dans les polices d'assurance, puisqu'on a connu une élévation du taux d'assurance des biens ; en outre, la façon dont nous défendons nos biens aujourd'hui est de les assurer et de réclamer leur remboursement en cas de dommage, ce qui n'était pas le cas à d'autres époques.
La question des violences physiques est également très compliquée à mesurer. Même si nous sortons d'épisodes extrêmement douloureux pour les forces de l'ordre, nous ne mesurons pas d'élévation tendancielle d'atteinte à l'intégrité physique grave des policiers et des gendarmes dans notre pays. C'est difficile à dire quand la police est en deuil et a subi ce que je considère comme des outrages extrêmes, mais il convient de le rappeler, ce qui ne revient pas pour autant à justifier les comportements qui conduisent à ces atteintes graves quand bien même seraient-elles relativement rares.
Les sociologues posent une question, à laquelle je ne répondrai pas : la violence progresse-t-elle ou notre sensibilité à la violence évolue-t-elle en raison même du régime des images, qui lui-même change ? Les images de 1934, quand il y en a – elles sont rares – sont des images fixes, ce ne sont pas des images filmées et ne sont pas des images en temps réel. Un ensemble de facteurs a évolué. In fine, la façon d'analyser de la représentation parlementaire et de la société en général détermine si la violence est tolérable.
Un problème grave tient à la distorsion entre les analyses de fractions croissantes de la société. Voilà dix ans, les personnes qui mettaient en cause les violences policières appartenaient à des champs très circonscrits et très honorables – il ne s'agit pas de considérer qu'ils ne le sont pas – de l'espace politique.
Avant d'aller manifester, des personnes, parce qu'elles partageaient le quotidien des membres des forces de l'ordre ou par positionnement politique, étaient en faveur des forces de l'ordre ; elles se sont retournées ensuite, tenant des discours bien plus « radicaux » – j'utilise le terme parce qu'il est très souvent utilisé – que ceux des personnes qui, depuis des années, tenaient un discours critique des forces de l'ordre. C'est cela qui est problématique. Nous touchons là à des questions de représentations. Si les représentations entre les forces de l'ordre et des fractions de plus en plus larges de la société se creusent, il arrivera un moment où il sera compliqué que le maintien de l'ordre soit la coproduction de l'ordre que j'ai évoquée précédemment.
J'ajouterai un élément sur ces différences de perception, sans m'appuyer sur des modèles étrangers ou tirés de l'histoire. Il faut analyser la façon dont est gérée une grande partie des manifestations d'agriculteurs ces dernières années en France. Pour travailler avec la gendarmerie, nous constatons une certaine tolérance. Je ne tiens pas du tout un discours anti-agriculteurs, je veux seulement montrer la différence d'appréciation.
Les agriculteurs manifestent avec du gros matériel et commettent des destructions. Je vous rejoins sur les coûts qui parfois peuvent être élevés. Cela se gère à l'amiable avec les syndicats agricoles et très peu de personnes sont mises en cause ou judiciarisées. On observe une certaine tolérance, je ne dis pas que c'est bien ou mal, comparé à d'autres types de population – c'est que j'entendais quand je parlais de politisation. Un choix est fait de tolérer ou non, on pose le curseur, on décide des limites. Ce n'est pas totalement neutre. On laisse les agriculteurs commettre des actes que l'on considérerait comme intolérables si d'autres populations les commettaient.
Je réagirai sur le monopole de la violence, développé par le sociologue Max Weber, qui soulève la question de la légitimité. À votre argument juridique, on pourrait opposer l'article 12 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, cité abondamment dans les films, et d'autres articles qui affirment que la force publique ne doit pas être utilisée au profit de ceux qui la composent ou la dirigent. Certes, force doit rester à la loi, mais pour parvenir à régler certains problèmes, il arrive que l'on aille un peu trop loin. Ce qui peut être acceptable dans l'interprétation des patrouilles de police dans les banlieues se retrouve dans les questions de maintien de l'ordre. Il convient de poser la question dans le débat public et se demander jusqu'à quel point on peut tolérer certains actes. La poser fait partie de la communication tout comme le débriefing devrait faire partie d'échanges entre les professionnels policiers et la population. On tolère qu'une sous-préfecture soit détériorée, brûlée par certaines populations alors que l'on considère de tels actes intolérables quand une autre population les commet. On pourrait parler de la destruction de commissariats par des populations qui n'appartiennent pas à la catégorie des jeunes de banlieue, non pour dire que c'est mieux ou moins bien, mais pour montrer qu'il existe des différences de traitement.
Retenir certaines des solutions adoptées par les gendarmes pour gérer les manifestations agricoles en les transposant aux manifestations urbaines peut être une source d'inspiration intéressante.
Vous avez demandé comment faisaient les policiers allemands pour rétablir l'ordre. Ils disposent de deux armes : d'une part, le nombre. Vous serez surpris en regardant des photos de manifestations dont on peut s'attendre qu'elles soient tendues : manifestations d'extrême droite, d'extrême gauche et très souvent manifestations et contre-manifestations. C'est le lot des manifestations problématiques en Allemagne. Les policiers sont donc en surnombre. Il y a de cela un peu plus de vingt ans, la police et la gendarmerie me disaient qu'il fallait montrer leurs forces pour ne pas avoir à s'en servir. Je puis vous assurer que les policiers allemands n'ont pas à s'en servir.
Autre équipement privilégié : le canon à eau. Je précise que si la puissance du jet du canon à eau est réglée au maximum, il s'agit d'une arme très douloureuse. À Stuttgart, en 2010, un manifestant s'est fait énucléer et a perdu l'usage de ses deux yeux. Du reste, l'État du Bade-Wurtemberg s'est fait condamner et a indemnisé le manifestant, si ma mémoire est bonne, à hauteur de 120 000 euros. C'est une arme, un moyen qui permet d'éloigner les foules, – et la réponse à votre question est dans votre question même – à la différence du LBD qui est une arme de légitime défense de soi ou d'autrui, ce n'est pas une arme de gestion des foules. Il s'agit là d'un sujet dont nous nous sommes longuement entretenus avec vous, monsieur le président.
Dans le domaine du maintien de l'ordre, l'intervention policière repose sur le principe de l'opportunité et du discernement. On ne peut pas considérer que la moindre infraction doit faire l'objet d'une sanction immédiate au prétexte que force doit rester à la loi. Force restera à la loi en dernière instance, pour ainsi dire, sur le long terme. Les institutions ne sauraient être menacées. S'agissant de la mise en mouvement de forces à vocation répressive destinées à faire cesser des infractions, cela doit rester du domaine de l'appréciation in concreto, sur le moment, et non pas un précepte général tel que force doit rester à la loi, sauf à se placer dans une dynamique d'escalade garantie.
La séance est levée à 17 heures.
Membres présents ou excusés
Présents. - Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Camille Galliard-Minier, M. Fabien Gouttefarde, M. Jérôme Lambert, Mme Constance Le Grip, Mme George Pau-Langevin, Mme Laurence Vanceunebrock
Excusé. - M. Christophe Naegelen