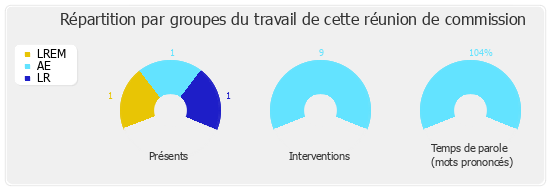Mission d'information sur la résilience nationale
Réunion du jeudi 18 novembre 2021 à 15h00
Résumé de la réunion
La réunion
MISSION D'INFORMATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS SUR LA RÉSILIENCE NATIONALE
Jeudi 18 novembre 2021
La séance est ouverte à quinze heures
(Présidence de M. Alexandre Freschi, président de la mission d'information)

La question du recul de l'industrie française est depuis longtemps présente dans le débat politique. Elle a cependant pris une acuité singulière au cours de la crise sanitaire. La perturbation, voire l'arrêt, de différents flux industriels et commerciaux a mis en relief comme jamais les vulnérabilités de notre tissu industriel. Des dépendances sont apparues dont nous n'avions pas forcément conscience. En d'autres termes, la résilience de notre économie et de notre production est devenue un enjeu central, aussi bien dans la réponse à la crise que dans la définition de notre politique économique.
D'une certaine manière, le Gouvernement s'est livré durant ces deux dernières années à un exercice de résilience grandeur nature : il a fallu encaisser le choc de la pandémie tout en élaborant des réponses à la fois sur le court, le moyen et le long terme. L'objectif de ces mesures est non seulement de diminuer notre vulnérabilité à de nouveaux chocs comparables, mais aussi de remédier aux fragilités systémiques mises en évidence par la crise.
À cet égard, la séquence qui va du plan d'urgence au plan de relance et au plan France 2030 s'inscrit indubitablement dans une dynamique de résilience face au réchauffement climatique et à de futures crises de toute nature, qui exigent un renforcement significatif de notre autonomie en matière de production industrielle et d'approvisionnement.
Madame la ministre, nous attendons de cette audition qu'elle nous éclaire sur l'analyse que fait le Gouvernement des vulnérabilités systémiques de notre économie et sur la stratégie appliquée pour y remédier, en ce moment si particulier de l'histoire de notre pays. Dans le contexte d'une économie mondialisée où prévaut une logique de flux, comment construire une résilience nationale face à des risques et des menaces susceptibles de perturber ou d'interrompre ces flux ?
La période récente a mis en évidence un enjeu particulièrement important, celui de la capacité de nos industries à adapter leur production en réponse à une situation de crise. Nous pensons, bien entendu, aux équipements médicaux et à la production pharmaceutique, mais c'est en réalité la quasi-intégralité de l'économie, de l'agroalimentaire aux télécommunications, de l'énergie à l'électronique, du secteur bancaire aux industries mécaniques, qu'il convient de passer en revue pour évaluer sa capacité à se transformer en cas de choc majeur.
J'en ai été convaincue dès le début de la crise sanitaire, plus fortement encore à son acmé, et je persiste à le croire aujourd'hui alors qu'elle est moins virulente mais pourrait resurgir à tout moment : nous devons apprendre de cette crise, entendre les messages qu'elle nous envoie, en particulier quant à la nécessité de nourrir une plus grande ambition industrielle pour notre pays et pour l'Europe.
Je reviendrai sur ce sujet plus en détail, mais nous devons auparavant nous interroger sur la définition même de la résilience ; pour bâtir une résilience nationale, nous devons définir les objets sur lesquels nous devons être résilients.
Comme nombre de concepts – l'indépendance, la souveraineté, l'autonomie stratégique –, la résilience est aujourd'hui sur toutes les lèvres ; elle est parfois perçue par les Français comme traumatique. Évaluer notre résilience, c'est expertiser notre préparation à répondre à des risques connus, mais également à nous adapter, à plier sans jamais rompre face à des scénarios de crise inimaginables. C'est très exactement ce qu'il s'est passé avec cette pandémie, qui a frappé tous continents au même moment.
Évaluer notre résilience, c'est aussi se préparer aux crises de toute nature : crises sanitaires et catastrophes naturelles, cyberattaques, accidents industriels, problèmes géopolitiques… C'est anticiper l'élaboration de doctrines et de protocoles de réponse qui nous permettront de faire face aux crises, en agissant sur plusieurs leviers. En termes de disponibilité d'équipements ou de produits critiques, nous devons disposer soit de stocks, soit de la capacité à fabriquer ou à nous approvisionner en produits identifiés comme critiques. Je pense, bien évidemment, aux masques sanitaires mais, plus généralement, cela peut concerner, à l'échelle nationale ou européenne, le secteur de l'énergie, les médicaments, ou encore les denrées alimentaires périssables ; autrement dit, tous les produits indispensables doivent être disponibles en quantité suffisante pour satisfaire les besoins de nos entreprises et de la population, l'objectif étant de maintenir notre activité pendant un délai raisonnable.
Il faut être en mesure de mobiliser les talents humains, les experts des services de l'État comme du secteur privé, des personnes capables d'intervenir sur les activités privées en mode dégradé, car il faut imaginer des organisations avec un nombre contraint de personnes mobilisées, des accès restreints aux sites professionnels, le recours au télétravail et aux communications numériques à distance. Cela implique de désigner à l'avance des référents en cas de crise, mais également de les former et de les préparer à affronter de tels événements.
La résilience est donc notre capacité à rester, quoiqu'il arrive, souverains et le plus indépendants possible pour protéger les Français. Elle s'apprécie face à des crises ponctuelles – ou, en tout cas, qui n'ont pas vocation à durer – mais également dans le contexte de dysfonctionnements plus durables. Que se passerait-il, par exemple, si les ressources en eau ou en matières premières critiques – nécessaires pour assurer la transition écologique et énergétique – venaient à manquer ?
Il est donc impératif de tirer les premiers enseignements de la crise sanitaire que nous traversons. Vous comprendrez que j'aborde ce point sous le prisme industriel. L'abandon de notre industrie – livrée à une concurrence internationale, dans bien des cas, déloyale – et le processus de désindustrialisation sont à l'œuvre depuis plusieurs décennies. La crise n'a fait que mettre en lumière ce phénomène, et la reconquête industrielle est d'ailleurs l'un des objectifs fixés par le Président de la République depuis le début du quinquennat. La désindustrialisation a été contrebalancée par un accès facile et bon marché à des produits autrefois fabriqués sur notre territoire et désormais importés. Cela se traduit négativement sur notre balance commerciale, mais aussi sur notre empreinte carbone, qui a augmenté de 20 % entre 2000 et 2016, période au cours de laquelle 1 million d'emplois industriels ont été détruits. Nous avons subi la double peine : plus de carbone et moins d'emplois !
La crise récente a mis en lumière la profondeur des dégâts causés par ces trente années de capitulation industrielle et le déclassement de notre outil productif. Je pense aux principes actifs des médicaments, qui sont produits à plus de 80 % hors d'Europe et, pour l'essentiel, en Chine et en Inde. La soudaineté de la crise, accentuée par la fermeture des frontières nationales, a mis en évidence la dépendance de l'industrie française à cet égard. Il en va de même des protéines que nous importons, à plus de 50 %, pour nourrir les élevages français. Par ailleurs, nous traversons actuellement une crise concernant la fourniture en semi-conducteurs. Ces derniers sont l'arbre qui cache l'immense forêt des tensions d'approvisionnement sur des productions certes à faible valeur ajoutée par rapport aux produits finaux que nous assemblons, mais indispensables à des productions aval. Les semi-conducteurs sont partout : dans nos robots ménagers, les airbags de nos voitures, les jouets de nos enfants, etc.
Sur la disponibilité de matériaux critiques et de produits de première nécessité, nous avons subi des défaillances dans la gestion des stocks. Ce fut le cas pour les masques sanitaires, dont les stocks avaient été réduits au cours des deux quinquennats précédents ; on avait considéré que ces biens à faible valeur ajoutée étaient immédiatement disponibles. Nous avons également connu des tensions sur des médicaments comme les curares ou sur des produits sanitaires comme les blouses ou les gants en nitrile. En ces domaines, l'analyse en termes de résilience n'a pas été menée.
À côté de ce constat sur nos manques et nos défaillances, la crise a contribué à révéler l'importance centrale et la solidité de notre industrie.
Elle a d'abord permis de mettre fin au mythe du fabless et d'une France sans usine. Le passé nous a prouvé que ce modèle n'était ni souhaitable, ni soutenable. Lorsque l'on sépare la recherche et le développement des usines de production, on constate, quelques dizaines d'années après avoir transféré la production, que les sites de recherche et développement finissent par suivre et à s'implanter sur le lieu de la production.
Nous sommes également revenus sur l'idée selon laquelle la France ne serait pas un pays où on pourrait produire de manière compétitive. On peut retrouver de la compétitivité à la faveur de la numérisation des lignes de production. Le blocage ne vient pas nécessairement, comme on le dit beaucoup, du coût du travail ; tout l'enjeu est de fabriquer des produits à valeur ajoutée qui nous permettent de nous distinguer et de créer un avantage compétitif. Ce n'est pas valable pour toutes les productions, mais, pour un certain nombre d'entre elles, la France est capable de le faire. Nous avons visité, avec le Président de la République, l'usine Genvia, installée sur le site de Schlumberger, près de Béziers. Le coût de la production des équipements du secteur pétrolier y est de 25 % inférieur à celui supporté par les premiers compétiteurs mondiaux, parce que toute la ligne a été pensée et robotisée en s'appuyant sur les compétences des ingénieurs, des techniciens et des ouvriers qualifiés dont nous disposons en France. Mais, pour cela, il faut s'équiper.
Le secteur industriel est l'un des seuls à avoir fonctionné quasiment à plein régime pendant la crise sanitaire, y compris pendant la période de confinement. Je tiens à souligner la mobilisation exceptionnelle des industriels, qui ont poursuivi la production en s'adaptant aux protocoles sanitaires pour assurer la protection de leurs salariés, tout en étant capables de se mobiliser pour produire en quelques jours du gel hydroalcoolique et, en quelques semaines, des masques ainsi que les écouvillons nécessaires aux tests PCR. Nous avons une base industrielle capable de faire preuve d'agilité en situation de crise et de fabriquer des produits qu'elle ne réalise pas habituellement.
Inversement, les entreprises nous disent combien elles ont été agréablement surprises par la réactivité, l'agilité et la capacité de l'État à intervenir massivement et rapidement, de manière pragmatique, pour préserver notre économie sous l'impulsion du « quoi qu'il en coûte » affirmé par le Président de la République. Les dispositifs déployés ont eu une efficacité considérable : ils ont permis de limiter au maximum le chômage et ont rendu possible le rebond de croissance que nous connaissons aujourd'hui.
Face à ces constats sur nos forces et nos faiblesses, nous devons déployer une stratégie volontariste et déterminée pour la réindustrialisation de la France, l'implantation sur notre sol d'industries nouvelles et performantes et l'anticipation des risques.
La reconstruction de l'industrie passe par une politique déterminée d'augmentation de la production industrielle sur le territoire. Avec le plan France Relance, nous avons bâti une approche stratégique de relocalisation. Nous n'avons évidemment pas une vision naïve. Il ne s'agit pas de rebâtir à l'identique une industrie qui est partie, ni de vouloir se positionner sur toutes les formes de production. Notre vision des relocalisations, qui s'appuie d'ailleurs sur une large concertation avec les fédérations, les organisations syndicales et les experts économiques, repose sur deux piliers : la maîtrise de la chaîne de fabrication de produits critiques, d'une part ; la capacité à retrouver de la compétitivité grâce à l'innovation, d'autre part. Il nous faut, par ailleurs, maîtriser nos approvisionnements en matières premières pour être le plus autonome possible dans les secteurs de production que je viens d'évoquer.
Nous avons ainsi identifié cinq secteurs critiques : l'électronique, la santé, la 5G, l'agroalimentaire et les intrants critiques. À ce jour, j'ai accompagné 624 projets de relocalisation, qui ont été rendus possibles depuis septembre 2020 grâce au plan de relance, ce qui a permis de créer ou conforter près de 77 000 emplois partout en France. Tous dispositifs confondus, une entreprise industrielle sur trois qui emploie plus de cinq ETP – équivalents temps plein – bénéficie d'un dispositif du plan France Relance, ce qui représente plus de 10 000 sociétés.
Je pense également à l'action que nous avons menée dans le domaine de l'industrie de la santé. Pendant la crise, nous avons appliqué le dispositif capacity building, qui nous a amenés à investir près d'un demi-milliard d'euros pour financer des projets de recherche et développement, ainsi que l'industrialisation de produits de santé, afin de lutter contre l'épidémie. C'est l'un des efforts qui a permis au continent européen de devenir le premier producteur mondial de vaccins contre la covid. Nous avons pris notre part dans ces lignes de production de vaccins. Entre 2005 et 2015, la part de marché mondial de la France en production de produits de santé a été divisée par deux. Dans ce contexte, le Président de la République a annoncé un investissement de 7 milliards d'euros en faveur des produits de santé dans le cadre du comité stratégique des industries de santé, ce qui représente un effort inédit. Le prix du médicament ne doit plus être la variable d'ajustement et les patients ne doivent plus attendre un an de plus que les Allemands ou les Italiens pour avoir accès à des molécules innovantes.
À plus long terme, des investissements seront menés dans le cadre du plan France 2030, dans des secteurs ou concernant des productions que nous avons choisis en étroite concertation avec des économistes, des experts de la prospective, ainsi qu'avec les entreprises et les organisations syndicales. L'objectif est de se projeter dans les nouvelles filières industrielles à bâtir en France. Nous avons tous en tête l'hydrogène décarboné, mais je pourrais également évoquer les enjeux autour de l'avion décarboné et, plus généralement, de la décarbonation de notre industrie.
Bâtir notre résilience ne consiste pas seulement à réagir pour redonner de l'élan à notre économie nationale, c'est aussi se préparer à affronter une crise en faisant preuve d'une efficacité accrue avec moins de moyens et sans dénaturer les valeurs qui fondent notre union nationale. Nous avons innové dans nos méthodes de travail pendant la crise ; il faut conserver ce qui a bien fonctionné et tirer les enseignements de ce qui a moins bien marché.
Ainsi, la création de la task force vaccins, qui associait des personnels issus des secteurs public et privé, certains d'ailleurs à titre bénévole, a permis de mener la négociation des contrats de fourniture de vaccins dès l'été 2020, mais surtout de travailler à l'industrialisation des lignes de production, en étroite interaction avec nos voisins européens, et de faire face à des difficultés d'approvisionnement en composants critiques. Cette méthode directe, agile et réactive – cette task force m'était directement rattachée – est une bonne façon de travailler en période de crise. Nous pourrions également dresser l'inventaire, secteur d'activité par secteur d'activité, de ce qui a fonctionné et de ce qui a moins bien marché. Ce serait précieux pour le collectif.
Nous avons également mobilisé et accompagné les industriels pour pallier nos difficultés dans une logique de coopération public-privé. S'agissant des masques sanitaires, nous sommes passés d'une production hebdomadaire de 3,5 millions en janvier 2020 à 100 millions en 2021. Nous avons financé onze projets pour accroître nos capacités de production en matières premières, qui constituait le point bloquant, mais nous n'avons pas financé les lignes de production elles-mêmes. Nous sommes remontés jusqu'à la matière première, qui subissait une faille de marché. Puis, nous avons passé une commande de près de 1 milliard de masques pour permettre aux entreprises qui se lançaient de se « dérisquer » sur les investissements qu'elles engageaient.
Enfin, nous devons nous inscrire dans un cadre européen car, face à la Chine et aux États-Unis, il faut jouer collectif. Cela s'est concrétisé par le lancement de l'Airbus des batteries électriques, le plan Nano2022 sur l'électronique ou la prénotification du programme sur l'hydrogène bas-carbone. Nous n'allons pas en rester là puisque, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, nous prévoyons d'engager une démarche du même type sur le cloud, les produits de santé et une nouvelle génération de produits en matière d'électronique et d'intelligence artificielle embarquée. Je remets à l'ordre du jour au niveau européen le sujet des matières premières critiques puisque, pour le dire de manière quelque peu caricaturale, il ne faudrait pas remplacer une dépendance au pétrole et au gaz naturel par une dépendance au lithium et au cobalt.
Nous devons également continuer de travailler à l'échelle européenne sur la question de la loyauté de la concurrence ; le mécanisme d'inclusion carbone aux frontières et le règlement sur les subventions des gouvernements étrangers à des entreprises qui pratiquent le dumping ou ont accès à nos marchés publics entrent en ligne de compte pour renforcer notre autonomie stratégique.
Enfin, il faut prévoir les grandes évolutions de nos usages et de nos productions industrielles pour anticiper les risques que nous ne connaissons pas encore. Il y a vingt ans, une coupure d'électricité, c'était des bougies dans la cuisine de votre grand-mère, puisque vous aviez du gaz naturel pour la cuisinière et du fioul pour le chauffage ; dans dix ans, en cas de coupure d'électricité, vous ne pourrez ni appeler, ni vous déplacer, si votre voiture est électrique, ni vous chauffer. Il faut comprendre que, dans le cadre de la transformation que nous menons, nous faisons apparaître de nouveaux risques qu'il faut d'ores et déjà anticiper dans notre plan de marche.
Pour conclure, bâtir la résilience de notre pays implique de faire évoluer notre rapport au risque. Le principe de précaution n'est pas, à mon sens, la meilleure façon de construire la résilience. L'inaction peut créer incidemment une dépendance. À titre d'exemple, alors qu'un site de fabrication de produits de santé est souvent classé Seveso, on est confronté à un risque d'injonction paradoxale : d'un côté, on veut plus d'usines de produits pharmaceutiques et, de l'autre, moins de sites Seveso. L'enjeu est toujours d'adopter une approche bénéfice-risque et d'anticiper les risques possibles pour nos populations.

L'objectif de notre mission d'information est d'évaluer la manière dont notre pays est en mesure de faire face à des chocs de forte intensité, frappant une très grande partie du pays dans la durée. On pense aux risques identifiés depuis un certain temps dans les revues de sécurité nationale, qu'ils soient de nature sanitaire, climatique, technologique, ou qu'ils prennent la forme de cyberattaques, voire de guerres, puisqu'il est question aujourd'hui du retour des conflits majeurs, et même de formes d'hybridité.
Nous procédons à cette évaluation à la lumière de la crise sanitaire. On estime qu'elle aurait pu présenter une intensité bien plus forte puisque, si ce virus est très contagieux, d'autres sont plus létaux. De surcroît, nous n'avions pas d'adversaires stratégiques en tant que tels. Les routes maritimes n'ont pas été coupées et nous n'étions pas confrontés à des adversaires qui cherchaient à mener des attaques cinétiques ou ayant pour objet la désinformation. Nous pourrions donc être confrontés à des risques encore plus importants.
Les premiers témoignages que nous avons recueillis mettent en avant des facteurs de résilience : s'agissant de la planification, tous les acteurs que nous avons auditionnés ont dit leur satisfaction quant au rôle de chef de file assumé par l'État pendant la crise. Quand rien ne va, il faut un chef pour fixer une direction, des moyens d'intervention et de la force morale.
Le sujet qui nous intéresse plus particulièrement est la manière dont il est possible de faire face à notre dépendance à la technologie, car l'un des facteurs de moindre résilience tient à nos modes de consommation et de production actuels. Nous nous sommes progressivement habitués à vivre dans une société de flux et non de stocks. Lors de la guerre froide, nous avions l'habitude de stocker dans les arsenaux militaires pour être en mesure de faire face à un conflit, le moment venu ; aujourd'hui, dans la société du « zéro stock », nous nous trouvons assez rapidement confrontés à des situations extrêmement difficiles touchant l'ensemble des domaines vitaux – l'énergie, la santé, l'alimentation, le cyber… – et ce, dans un contexte de désindustrialisation, même si des signaux positifs ont été enregistrés ces dernières années. Nous visons un objectif de réduction de la dépendance motivé non pas seulement par des raisons économiques ou liées à l'emploi, mais aussi par des considérations tenant à la souveraineté. Cela change le spectre, puisque ce n'est pas tant la part de l'industrie en tant que telle qui nous importe, que la capacité à produire l'ensemble des produits critiques. Notre vision est donc plus exhaustive.
Vous avez évoqué trois axes : stocker, fabriquer et importer. Face à une crise qui peut s'inscrire dans la durée, fabriquer est la seule solution envisageable. On peut certes se protéger en diversifiant les sources d'importation, mais une telle stratégie montre ses limites lorsque tout le monde veut la même matière en même temps. Quant au stock, il est par nature temporaire et est toujours calculé en situation nominale. Lorsque la consommation augmente brusquement, des stocks qui paraissaient importants deviennent dérisoires. Cela dit, nous vivons dans un monde ouvert et assumons certaines dépendances ; il importe toutefois que celles-ci soient acceptées collectivement.
Enfin, je relève comme vous, madame la ministre, la capacité à se transformer que chacun a manifestée pendant la crise, et la manière dont vous avez su vous réinventer. Vous avez mené une action énergique, aussi bien concernant les masques que les vaccins. Les industriels de tous les secteurs que nous avons reçus ont souligné votre action, comme celle d'autres ministères, des services de l'État et des administrations, comme la direction générale de l'armement (DGA).
L'objectif de cette audition est d'abord, à mes yeux, de déterminer qui définit la stratégie visant à limiter la dépendance industrielle et comment cette stratégie est élaborée.
S'agissant de la base industrielle et technologique de défense (BITD), je sais que la DGA veille de manière exhaustive à tous les composants nécessaires à la fabrication, par exemple, d'un Rafale ou d'autres équipements critiques. Elle mène un travail complet de recensement : la plus petite PME critique qui connaît des difficultés est identifiée et un travail est engagé. Les dépendances sont connues et assumées.
Hors armement, comment s'effectue le référencement de tout ce qui peut être nécessaire pour renforcer la résilience de notre pays ? Comme cela est-il réalisé à l'échelle de votre ministère et, éventuellement, comment ce travail peut-il être mené au niveau interministériel ?
Pour sélectionner les six secteurs stratégiques ciblés par le plan de relance, nous avons effectué un recensement à partir de trois sources. Premièrement, nous avons travaillé à l'échelle des filières ; je vous rappelle que, dans le cadre du conseil national de l'industrie, je pilote dix-neuf filières. Deuxièmement, nous avons interrogé les experts académiques et du secteur privé, notamment ceux issus de sociétés de conseil qui interviennent à l'international et peuvent, de ce fait, disposer d'un benchmark international. Troisièmement, nous avons analysé les données relatives aux importations et aux exportations, ainsi que celles liées à certaines problématiques, en parcourant la liste des produits et des sous-produits, afin d'identifier les impasses.
Nous souhaitons passer de l'échelle nationale à l'échelle européenne. Nous avons sollicité la Commission européenne, qui a rendu une première série de travaux, assez génériques. Nous estimons qu'il faut atteindre une granularité plus fine pour identifier des impasses ou, au contraire, des capacités de résilience plus larges qui s'appuieraient sur un certain nombre de sites en Europe.
Sur cette base, nous avons conduit une analyse assez fine des besoins de l'économie française et des risques d'impasse des filières de la santé, de la chimie et de l'électronique. Il s'agissait, d'une part, de déterminer les sources de vulnérabilité, intrant critique par intrant critique. Pour certaines matières chimiques, il n'existe qu'un site de production mondial. Les conséquences d'un événement tel qu'un incendie sont bien plus lourdes qu'on ne l'imagine, à plus forte raison s'il n'existe pas de produit de substitution ou si ce dernier nécessite des certifications et des homologations. En effet, s'il est parfois possible de trouver une autre solution technique, il faut prendre en compte le temps d'homologation requis pour passer tous les tests de sécurité, de santé, d'adaptation… C'est la situation que nous avons connue, s'agissant des produits de santé, pendant le confinement. Les masques ont été homologués et certains produits de santé ont fait l'objet de décisions de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), qui devait, à tout le moins, apporter une garantie de sécurité aux Français.
Nous avons établi une liste des produits de santé et des produits chimiques dont le niveau de granularité assez fin nous a permis de bâtir l'appel à projets « résilience ». Dans le domaine de l'agroalimentaire, par exemple, nous privilégions les protéines destinées à l'alimentation animale parce que nous nous sommes livrés à cet exercice d'identification des intrants critiques. Nous avons des points de faiblesse, sans doute plus structurels, liés au fait que les chaînes mondiales de production sont si éclatées que nos industriels ne connaissent souvent que leurs sous-traitants de premier ou de deuxième rang. Cela signifie qu'un composant peut manquer à l'appel faute d'avoir été repéré. Cela relève du niveau 2 de l'autonomie stratégique : c'est un blocage susceptible de paralyser une usine et d'avoir un impact économique, mais pas nécessairement d'arrêter un pays.
Les 624 projets de relocalisation que nous avons sélectionnés concernent la santé, l'agroalimentaire, les intrants critiques, l'électronique, la 5G et le nucléaire. Il ne s'agit pas de relocaliser pour relocaliser, car nous avons par ailleurs, au travers du dispositif Territoires d'industrie, des projets de relocalisation qui sont de bons projets économiques mais qui ne correspondent pas nécessairement à des fabrications susceptibles de manquer à l'appel lors d'une crise. Nous avons d'ailleurs fait glisser du compartiment « produits critiques » à la catégorie « bons projets économiques » des dossiers que nous avons envie d'accompagner dans le cadre d'une politique industrielle dynamique, mais pour lesquels le critère de criticité n'intervient pas dans la sélection du dossier.
Si l'on veut aller plus loin, il faut remonter encore d'un cran, c'est-à-dire revenir aux matières premières. Après en avoir discuté avec M. Alexandre Saubot, président de France Industrie, j'ai chargé M. Philippe Varin d'établir un diagnostic des besoins des filières industrielles en matières premières critiques, liés aux enjeux de la transition énergétique. Nous l'avons fait pour les batteries électriques et les éoliennes, pour lesquelles nous avons des besoins considérables. Nous le ferons également pour l'aéronautique, qui a besoin d'éléments particuliers, tels que le titane, pour ses alliages.
Il s'agit de repartir de la classification des éléments de Mendeleïev et d'étudier ce qui peut manquer à l'appel afin d'anticiper les besoins. Nous observons, à cet égard, deux phénomènes. Premièrement, des pays ou de grandes entreprises réservent des ressources en matières premières minières : je pense notamment à la Chine, qui en réserve au Chili, en Argentine et en Indonésie par des contrats à moyen terme. Deuxièmement, des pays commencent à instituer des barrières douanières sur les produits critiques, notamment ceux nécessaires à la construction de batteries électriques, comme le nickel, le lithium et le cobalt. Nous assistons au démarrage d'une course à l'approvisionnement en certaines matières premières, dont l'Europe ne doit pas être absente, car ses ressources minières ne correspondent pas à ses besoins – et encore faudrait-il qu'elle décide de les exploiter, ce qui est un autre sujet.

Nous comprenons bien que vous avez engagé une démarche exhaustive et que nous bénéficions d'un sursaut grâce au plan de relance. Cette démarche existait-elle, sous certaines formes, auparavant ou est-elle totalement inédite ?
Par ailleurs, alors que le plan de relance vise deux objectifs – le développement industriel, y compris pour des produits non vitaux, et l'indépendance stratégique –, quel niveau de priorité avez-vous accordé à des produits vitaux dont nous ne disposions pas ?
Comment cette démarche s'inscrit-elle dans un cadre interministériel ? Par exemple, sur la question des protéines et de l'alimentation, comment articulez-vous votre action avec le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, qui a un haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge, lui aussi, de la résilience ?
Enfin, comment cette démarche de souveraineté et de relocalisation peut-elle, indépendamment des équipes politiques, devenir une politique de l'État inscrite dans la durée ?
Nous avions diagnostiqué de manière anticipée les impasses de production s'agissant des produits de santé, sur la base du constat, sur lequel Agnès Buzyn avait travaillé, de la pénurie de médicaments. De fil en aiguille, notre diagnostic s'est étendu à la filière de la chimie, qui est souvent l'une des filières embarquées dans la production de produits de santé. Chemin faisant, nous avons relevé d'autres impasses. La crise sanitaire a accéléré le caractère systématique de cette approche.
L'interministériel fonctionne à plein en ce domaine. Par exemple, s'agissant des produits de santé, nous sommes en mesure de dire que telle molécule peut manquer, mais nous ne sommes pas capables d'affirmer qu'elle est critique. La liste des molécules d'intérêt thérapeutique majeur est établie par les services compétents du ministère de la santé, leur vision étant elle-même alimentée par leurs contacts directs avec les prescripteurs, les associations de patients et les fabricants de produits de santé. Ils ont une vision à 360 degrés de ces sujets ainsi que de la dynamique des maladies.
Il est important d'avoir à la fois une photographie de la situation à un instant t et une vision dynamique. Ainsi, en matière de produits de santé, les besoins pour faire face à l'enjeu central de l'antibiorésistance peuvent évoluer, et il faut l'anticiper. Il convient d'avoir toujours une double approche : celle des besoins critiques à un instant t, et de ceux qui pourraient le devenir.
En matière d'alimentation, nous engageons cette démarche en totale transparence avec le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, dont les experts sont associés à la sélection des dossiers.
S'agissant de la décarbonation, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la transition écologique, qui dispose d'équipes spécifiques : il exerce la tutelle du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN), qui sont les grands experts français sur ces sujets. Nous avons dressé les mêmes constats et avons additionné nos expertises pour définir une réponse complète.
Pour construire une action publique solide, il faut dresser un diagnostic précis. Objectivement, je pense que ce gouvernement a fait preuve d'anticipation, y compris en agissant comme un aiguillon du secteur privé, par exemple concernant la réflexion à mener sur les contrats à moyen terme pour nos batteries électriques. Nous avons interrogé les filières pour avoir une meilleure compréhension de toutes les chaînes de valeur.
Notre boîte à outils se compose, aujourd'hui, du plan de relance, et comprendra, demain, le plan d'investissement France 2030. Ce dernier traite de sujets tels que la santé, les métaux critiques ou encore l'agroalimentaire. Il faudra s'assurer, dans la durée, que les montants sont proportionnés aux sujets, et que les outils sont les bons. À cet égard, il faudra se poser les questions suivantes : convient-il d'intervenir sous forme de fonds propres, de subventions, de prêts, faut-il animer les acteurs privés afin qu'eux-mêmes se positionnent sur ces marchés ? S'agit-il, au travers de la taxonomie, d'apporter des financements et de l'épargne privée pour développer ces projets ?
Dans la conduite de France 2030, les enjeux, en termes de gouvernance, sont aussi l'interministérialité, l'anticipation des risques les plus prégnants et l'identification des filières critiques les plus importantes. Nous avons une idée de ce qui pourrait nous manquer pour consolider l'existant ; en revanche, s'agissant de l'avenir, nous n'avons pas encore forcément fait le tour de ce dont nous aurons besoin pour bâtir les nouvelles filières. Je ne peux pas vous dire que j'ai pris en compte tous les intrants critiques nécessaires pour bâtir la filière de l'hydrogène décarboné. Cela dépendra des techniques, de la façon dont ce plan est appliqué, du rythme de développement des projets, des échecs et des succès des uns et des autres. Il est donc nécessaire de refaire le point régulièrement et de faire preuve d'agilité dans la conduite des projets en intégrant le principe de résilience qui, à mon sens, est plus efficace que le principe de précaution. Le principe de précaution est probablement un frein dans le cadre de la réflexion sur le rapport bénéfice-risque.
Enfin, il ne faut pas uniquement réfléchir en termes de budgets et de problèmes, mais aussi penser aux autorités de validation. Il faut se demander si elles disposent d'effectifs suffisants, si elles suivent une méthode, si on peut les outiller pour qu'elles puissent traiter plus vite un plus grand nombre de dossiers et s'assurer plus rapidement de la sécurité des produits arrivant sur le marché. Les nombreuses mesures prises pendant le confinement mériteraient d'être examinées de plus près. Par exemple, comment l'ANSM a-t-elle été capable de valider certains produits aussi vite ? Quelles conclusions peut-on en tirer pour définir un mode de fonctionnement en temps normal ?

Peut-on dire, madame la ministre, que, d'une certaine manière, dans l'organisation interministérielle, vous êtes la cheffe de file de la souveraineté industrielle et êtes chargée d'animer la réflexion sur ce sujet avec d'autres ministères, comme la santé et l'agriculture ?
Comment inscrire cette démarche dans la durée, à l'échelle de l'organisation de l'État ? Quel rôle doit jouer, par exemple, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) sur la question des masques, dont il a eu la responsabilité ?
Comment dresser ce diagnostic et cette stratégie à l'échelle européenne ?
J'ai eu l'occasion de gérer des risques sanitaires à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et des risques économiques au moment de la crise de 2008-2009, ce qui, je crois, m'a rendue plus agile dans la gestion de la crise du covid. La réponse à cette dernière a été pilotée par un certain nombre de personnes qui étaient en prise directe avec les événements : le Président de la République, le Premier ministre, le directeur de cabinet du Premier ministre, le ministre de la santé, moi‑même et d'autres, appuyés de task forces, comme le commando vaccin.
S'agissant de l'inscription dans la durée, il faut se demander comment entraîner et former le collectif public à faire face à de telles crises. Nous pourrions, à cette fin, analyser les actions entreprises sur le terrain par les communes. Nous disposerions ainsi d'éléments de comparaison très larges puisque, dans nombre de communes et de territoires, une agilité et une inventivité extraordinaires ont été déployées. Nous pourrions identifier les profils des équipes qui ont manifesté ces qualités et comprendre pourquoi cela semble avoir mieux fonctionné chez eux que chez d'autres.
Il convient de bâtir une organisation permettant d'assurer de la formation et d'effectuer des exercices, mais surtout sans rigidifier les choses.
Dans les dossiers que j'ai eu à gérer, qu'il s'agisse de la fabrication des masques et des vaccins, du sourcing des vaccins et des écouvillons ou encore de la fourniture en gel hydroalcoolique, à aucun moment le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de l'économie et des finances n'a été associé. En revanche, nous avons travaillé en grande proximité avec le SGDSN. La culture du risque ne s'est pas encore totalement diffusée au sein des administrations centrales.
S'agissant de l'articulation entre administrations centrales, services déconcentrés et collectivités locales, on a parfois constaté une très grande agilité mais aussi, à l'inverse, des dysfonctionnements qui ont fait perdre du temps et rendu les situations plus difficiles.
Il faut animer un collectif et insuffler une culture, en essayant de sortir du champ de l'appréciation juridique. Notre grande rigueur juridique a pu, à certains égards, être un obstacle à l'agilité et à la prise de risque.
À l'échelle européenne, nous sommes au tout début de l'histoire. Nous avons construit certaines choses au fil de l'eau. Ainsi, le Président de la République a lancé un collectif de quatre pays pour réfléchir à un approvisionnement commun en vaccins. J'ai été chargée d'y représenter la France et, au moment où ce collectif a été prêt à signer son premier contrat d'approvisionnement, j'ai négocié l'inclusion de l'Union européenne. Il nous paraissait nécessaire que ce contrat soit transmis à l'Union européenne pour éviter de limiter la garantie de l'approvisionnement à quatre pays, à l'exclusion des vingt‑trois autres. Cela aurait posé un problème majeur en termes de solidarité, et aurait créé un risque de marché noir et de tension aux frontières.
Lorsque la Commission européenne a hérité de cette responsabilité, elle a décidé de créer une Joint Negotiation Team qui comprenait un nombre limité de pays – les quatre premiers, auxquels trois autres se sont ajoutés – et un Steering Board associant les vingt‑sept membres. Cette gouvernance a été inventée pour l'occasion. La Joint Negotiation Team a plutôt bien fonctionné. Elle a tenu une réunion par semaine, voire plus, si nécessaire ; les sept pays étaient en mesure de prendre des décisions rapidement, de les proposer au Steering Board et de « challenger » la Commission européenne.
Avec HERA – Health Emergency Response Authority –, nous franchissons un pas, puisque nous construisons ce qui pourrait être l'autorité en charge d'anticiper puis de gérer des crises sanitaires majeures, sur le modèle de l'agence américaine BARDA – Biomedical Advanced Research and Development Authority –. Cette dernière constitue l'exemple d'une organisation puissante et adaptée à la crise. Il s'agit d'une agence indépendante dans son mode de fonctionnement, dotée de personnels aux compétences extrêmement pointues, souvent issus du privé. Elle assume des missions définies depuis une dizaine d'années, qui incluent le risque de pandémie. Elle se caractérise par ses capacités d'intervention, sa grande agilité et l'extrême rigueur de ses travaux.
La BARDA s'est engagée très rapidement dans les essais cliniques, mais a imposé des modalités de réalisation très strictes aux laboratoires pharmaceutiques, tout en les finançant massivement – ce que nous ne pouvions pas nous permettre de faire, malgré le covid, en raison des règles européennes sur les aides d'État. L'agence a souhaité que chaque étude clinique, et donc chaque candidat vaccin, puisse être comparé au mieux. Elle a structuré la conduite des études de manière à pouvoir traiter plus rapidement les données et à atteindre le stade de l'autorisation de mise sur le marché.
De même, la BARDA a réfléchi très tôt aux lignes de fabrication. Nous l'avons fait, pour notre part, en post-approvisionnement. En revanche, les Américains ont aussi utilisé le levier du blocage des exportations sur tous les composants. Ils ne se sont pas contentés de mettre en place la ligne de production, ils ont également protégé les composants – capsules en aluminium, bouchons en plastique et autres tubes en verre utilisés dans l'industrie pharmaceutique –, ce qui a complexifié la production sur les autres continents.
C'est un modèle intéressant, qui s'appuie sur une vision scientifique, une expertise industrielle, un levier juridico-législatif, un contrôle des exportations et un travail d'anticipation. C'est en effet une administration dont le métier est d'anticiper les crises et de concevoir des plans pour faire face aux risques. Mais cela vaut pour une crise sanitaire. Je ne sais pas quelle organisation nous définirions pour réagir à une cyberattaque ou à une catastrophe naturelle qui frapperait des installations critiques et aurait des répercussions sur le reste du monde. C'est dans ces domaines qu'il faut élaborer des scénarios et laisser une place à l'agilité.

Je note que, dans l'organisation gouvernementale, vos objectifs, au début du quinquennat, en tant que ministre déléguée chargée de l'industrie, étaient logiquement centrés sur le développement économique, la balance commerciale et l'emploi. Même si la question de la souveraineté n'était pas absente, sa pondération s'est trouvée tout à coup surélevée. Cela illustre le fait que la résilience est un état d'esprit, une capacité à rebondir et à s'adapter. La résilience est intrinsèquement une question de culture. Les personnes que nous avons auditionnées ont souvent mis en avant la qualité des services de l'État, de la planification, de la sécurité civile, la réactivité des armées. Le facteur d'amélioration réside sans doute dans la diffusion de la culture de la résilience, tant à l'échelle nationale qu'à celle des acteurs locaux, des entreprises, des collectivités, jusqu'aux citoyens, qui doivent se sentir investis d'une mission lorsque le pays en a besoin.
À l'échelle nationale, nous avons su évoluer, en faisant preuve de réactivité et de souplesse mais, à mon sens, il nous reste des conclusions à tirer pour déterminer comment l'État pourrait se réorganiser afin de gagner durablement en robustesse et en résilience.
Le rapport au droit, vous l'avez dit, est un sujet important. Nous constatons une évolution récente du rôle des juridictions vis-à-vis des gouvernants. En tant que ministre, vous êtes-vous, à un moment donné, sentie bridée dans certaines de vos décisions compte tenu de votre responsabilité juridique ?
J'ai pris, en conscience, les décisions qui me semblaient les plus appropriées pour protéger les Français. J'ai pris la responsabilité de considérer qu'il était plus important d'assurer cette mission de protection que de surpondérer un risque juridique. Ainsi, pour la fourniture d'équipements de protection, des marchés publics ont été passés en urgence, dont on peut imaginer qu'ils n'ont pas été parfaitement établis dans les règles de l'art. L'urgence étant avérée, il m'a paru essentiel d'avancer. Toutefois, étant issue d'un corps de contrôle du ministère de l'économie et des finances, je sais que c'est un sujet sur lequel il va falloir travailler parce que vous ne pouvez pas demander à des fonctionnaires, qui appliquent le droit avec rigueur, de changer de pied du jour au lendemain, de privilégier le bon sens et de prendre des risques de temps en temps, surtout si un corps de contrôle le leur reproche par la suite et s'ils en subissent les conséquences sur leur carrière.
La résilience renvoie à un état d'esprit, à une culture du raccourci et au sens de l'intérêt général. Si ce dernier prime sur le reste, la résilience doit amener à s'interroger collectivement et à ne pas agir exactement comme c'est écrit. Cela signifie qu'il faut prendre des décisions collectives et avoir un double regard.
La direction des affaires juridiques du ministère nous a fait quelques remarques, et nous avons été amenés, en tant que ministres, à signer des notes pour protéger nos directions d'administration centrale contre un éventuel risque juridique, lié à la lecture que l'on pouvait faire d'un texte. La résilience ayant partie liée à la culture, il ne faudrait pas la réduire à une question d'organisation. Rien n'est moins résilient qu'une organisation trop planifiée. C'est toute la difficulté dans un État démocratique, où s'exercent le contrôle parlementaire et le contrôle judiciaire.
Il faut donc trouver les justes équilibres et prévoir des degrés d'adaptation sur le terrain. Plusieurs préfets ont pris des initiatives qui leur semblaient adaptées à la nature du terrain, même si elles contredisaient légèrement une orientation de la cellule interministérielle de crise, tandis que d'autres se sont conformés aux indications de cette dernière. Il s'agit de définir un espace de liberté en s'assurant qu'il n'outrepasse pas les règles de bonne gestion et le respect de nos grands principes.

Le droit protège en situation nominale, mais il ne faut pas qu'il soit bloquant en cas d'urgence. Des dispositifs exceptionnels sont prévus dans le domaine de la défense ; il est possible, notamment, de se passer des marchés publics en cas de besoin opérationnel urgent. Mais, même dans ce secteur, les normes ont envahi le champ opérationnel, ce qui crée parfois de graves difficultés. Ainsi, hors opération spéciale, il n'est plus possible de transporter de soldats à l'arrière d'un camion ; je pense également à la directive européenne sur le temps de travail, qui vise à contingenter le nombre d'heures effectuées par les militaires. Même dans ce secteur éminemment régalien, où la mission prime, le danger existe que le droit bride l'efficacité opérationnelle.
Vous avez abordé un sujet essentiel. Nous devrons sans doute envisager, dans le cadre de la séquence juridique de cette mission d'information, la possibilité de déroger au droit commun et de recourir à un dispositif tel que l'état d'urgence pour accorder des pouvoirs exceptionnels. Il peut aussi être intéressant de réfléchir à la prise de risque en situation ordinaire car c'est une culture que l'on peut développer en dehors des circonstances exceptionnelles.
Quelles grandes impasses votre diagnostic a-t-il fait ressortir ? Des décisions ont-elles été prises, dans certains secteurs, en matière de stocks ou de diversification des importations ? Par exemple, nous ne produisons pas de pétrole, mais nos réserves de 90 jours sont potentiellement utilisables autrement qu'à des fins stratégiques.
Peut-on s'autoriser à sortir de la mondialisation dans certains domaines ou, à tout le moins, à leur appliquer une régulation extrêmement forte ? Dans le cadre de l'exception culturelle française, nous nous sommes autorisés à nous immiscer dans les cycles de production pour préserver notre industrie. Pourrait-on adopter une telle démarche dans d'autres secteurs ou, au moins, appliquer des stratégies d'achat prioritaire ?
On a souvent une image d'Épinal du fonctionnement des grands ensembles économiques, notamment outre-Atlantique. On nous présente SpaceX comme l'entreprise d'un génie qui se serait mis à développer seul des fusées. À y regarder de plus près, on se rend compte que cette société a bénéficié de transferts de technologies, d'aides financières et de garanties de commandes. La question est donc de savoir comment concilier une approche très libérale – car nous sommes tous convaincus ici que la vitalité de notre secteur économique en dépend – et un rôle assumé de l'État. Autrement dit, il s'agit d'exercer une régulation assez forte dans certains secteurs sans entraver l'initiative privée.
Je partage cette approche. C'est en tout cas la ligne de crête que nous essayons d'emprunter. Il convient d'objectiver les risques et les externalités.
Il faut d'abord se demander combien on est prêt à investir pour se prémunir contre le risque de rupture d'approvisionnement. S'agissant des biens et des équipements critiques, cet investissement est destiné à bâtir une stratégie à trois étages. Le premier étage consiste à diversifier l'approvisionnement. Le deuxième étage concerne la constitution de stocks, qui doivent être dynamiques – c'est probablement cette dimension qui a manqué s'agissant des masques. Le stock doit être partiellement rechargé chaque année, et sorti dans les mêmes proportions. Le troisième étage est la capacité à fabriquer. Cela peut se matérialiser soit par des lignes de production existantes, soit par la capacité à bâtir des lignes de production en cas de difficulté. Avoir des machines sous cocon – ce qui induit un coût d'entretien du matériel et, pour ainsi dire, des savoir-faire – est une façon de se prémunir contre les risques de rupture.
Lorsque le risque se matérialise, vous engagez vos dernières démarches d'approvisionnement. Si les frontières se ferment, vous puisez dans votre stock et, pendant ce temps, vous sortez les machines et redémarrez la production. Cette démarche s'entend pour des biens qu'il n'est pas très compliqué de produire, comme des équipements de protection ou des produits de santé. Nous avons – c'est probablement un point à étudier – des pharmacies internes aux hôpitaux qui, bien qu'ayant de petites capacités de production, disposent de savoir-faire et d'une expertise. Il faut veiller à maintenir leurs équipements dans la durée, à faire en sorte que leurs savoir‑faire ne se perdent pas et qu'ils soient capables de remédier aux conséquences des impasses de production sur de courtes périodes. Cela permettrait d'éviter les très fortes tensions que l'on a connues, par exemple, au sujet des curares.
Ce sont des réponses parmi d'autres ; il n'y a pas de réponse unique. C'est toute une construction qu'il faut concevoir.
Les externalités servent à maintenir dans la durée un système fonctionnant correctement. Elles représentent le coût de la destruction de notre industrie alors même qu'elle est compétitive, par exemple en raison du dumping pratiqué par certains pays. C'est tout le sens du règlement européen sur les subventions étrangères, que nous soutenons. Les externalités, c'est, par exemple, le coût de la tonne de carbone qui n'est pas correctement pris en compte aujourd'hui, ce qui nous incite à privilégier des exportations lointaines ou des productions au charbon alors que le prix serait bien plus élevé si l'on prenait en considération tous les effets et toutes les retombées sur notre économie et notre planète. Une des réponses consiste à mener une politique plus ambitieuse pour assurer la loyauté de la concurrence.
Il est plus facile de maintenir une production française si on paie le prix du risque de la rupture d'approvisionnement et si la production française et européenne n'est pas soumise à une concurrence déloyale liée au subventionnement massif de certains pays. Il faut pouvoir maintenir des équivalences d'échange avec des pays qui jouent avec les mêmes règles du jeu que nous, c'est-à-dire qui imposent des contraintes environnementales et sociales à leurs producteurs et se retrouvent dans nos valeurs. À ces conditions, le libre-échange peut participer utilement à la résilience.
S'agissant des stratégies d'achat, nous avons beaucoup travaillé, dans le secteur public, sur les clauses sociales et environnementales. J'ai poussé pour que le cahier des clauses administratives générales comporte une clause environnementale obligatoire et une clause sociale optionnelle, toutes deux ayant la vertu de protéger juridiquement l'acheteur public. Nous devrons accompagner les acheteurs publics quant à la façon de les utiliser et d'objectiver systématiquement les critères. Il faut se pencher, par exemple, sur la formation des acheteurs publics au sein du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Il faut aussi se demander dans quelle mesure une direction pivot, comme la direction des affaires juridiques de Bercy, pourrait jouer un rôle d'expert. Autre question : comment les régions, qui ont la compétence économique et des équipes d'achat assez structurées, peuvent-elles jouer un rôle d'accompagnement et de conseil de leurs collectivités locales et partager les bonnes pratiques ?

Nous avons également étudié ce qui se pratique au ministère de la défense pour un porte-avions. Le Charles de Gaulle a été mis en service il y a plus de vingt ans ; le prochain, le porte-avions de nouvelle génération, le sera dans quinze ans. Dans l'intervalle, il est impératif, pour maintenir la filière, que la DGA assure son animation, ne serait-ce que pour donner temporairement du travail à des entreprises au travers de plans de recherche.
J'ajouterai deux points que vous avez peu ou prou évoqués. Le premier est celui de la réversibilité des entreprises. Vous avez parlé de machines sous cocon et de la capacité d'adapter la production en cas de difficulté. Le second, qui me semble important et qui est peu abordé, est celui du lissage des commandes. Si je prends l'exemple de la filière nucléaire, la dernière centrale a été mise en service il y a plus de vingt ans. On engage à présent la remise en route des EPR. Le fait de devoir réapprendre des savoir-faire et former des soudeurs présente un coût supérieur à celui qu'aurait représenté l'entretien de ces compétences de base, si l'on avait construit des centrales dans les années 2005, 2010 ou 2015. Mais peu importe : quoi que l'on fasse, la résilience a un coût.
Il faut embarquer tout le monde dans la stratégie de la résilience parce que, in fine, ce sont les citoyens qui paient ce que nous décidons. Les acteurs locaux, les entreprises doivent être associés. Comment impliquer tout le monde dans cette stratégie ? Comment faire en sorte que chacun accepte d'en payer le coût ? Je rappelle qu'à l'issue de la crise du H1N1, nous avions tous compris la nécessité de stocker des masques mais que, quelques années après, nous avions déjà oublié. On oublie vite, c'est la condition humaine. Comment cultiver l'esprit de résilience ?
À mon sens, dans les années à venir, la gestion des risques sera cruciale tant pour la performance des administrations que pour celle des entreprises.
Cela emporte plusieurs conséquences. La première d'entre elles concerne la formation. La résilience est une culture, qui s'acquiert par la répétition et un certain état d'esprit. L'approche bénéfice-risque, qui est employée dans certains métiers, permet d'éviter l'écueil du juridisme pour le juridisme. Si l'on démontre que le fait d'appliquer la règle risque d'avoir un effet moins favorable, au regard de l'objectif de protection de la population, que le fait de s'en écarter, cela permet de prendre la décision sur un fondement objectivé. Il faut aussi manifester une culture de l'agilité dans la décision. Ce sera probablement un sujet à approfondir dans les prochaines années pour la fonction publique, et pas seulement la fonction publique de l'État. Mme Amélie de Montchalin, ministre de la transformation et de la fonction publiques, a déjà lancé une réflexion sur la formation initiale et continue des cadres.
Au sein des entreprises, cela devrait se développer naturellement, mais l'État peut anticiper les choses en sollicitant les filières et les institutions, comme l'Association française des entreprises privées (AFEP) ou le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), pour que les pratiques de marché prennent en considération les risques majeurs auxquels les sociétés auront à faire face. Nous le faisons déjà dans le rapport sur les risques pour les entreprises cotées. Il faut identifier ces grands risques et déterminer comment on les réduit, soit par des processus opérationnels, soit par des mécanismes d'assurance. Cet exercice doit être relevé d'un cran et surtout devenir plus opérationnel. Le questionnement est souvent limité à une ou deux directions – celles de la conformité et des risques. Le risque peut être perçu comme relevant des fonctions supports, sans être au cœur de l'activité de l'entreprise.
Il faut donc faire évoluer les choses en matière de formation initiale, de formation continue, d'anticipation, de reporting et de diffusion de cette culture au plus près du terrain. J'ai bon espoir. Il y a dix ans, la responsabilité sociale et environnementale était un sujet cloisonné dans des directions d'état-major ; aujourd'hui, vous ne pouvez pas être dirigeant d'une unité opérationnelle sans mettre en question votre bilan carbone, votre marque employeur et votre impact sur le territoire. Ces sujets vont gagner en ampleur, mais il nous appartient de trouver les voies et moyens de construire et de diffuser plus rapidement la culture de la résilience.

Existe-t-il une cellule de veille sur les futurs enjeux stratégiques industriels ? Au cours des trente dernières années, nous sommes passés à côté de certains d'entre eux par manque de vigilance. Comment éviter de se retrouver, dans trente ans, dans la situation que nous avons connue ces derniers mois ?
D'abord, au sein de la direction générale des entreprises, nous disposons de l'instrument assez puissant qu'est l'animation des dix-neuf filières industrielles. Cela nous permet de mettre à jour continûment nos connaissances des tendances des marchés, des risques que font courir les transformations technologiques et des enjeux justifiant la mobilisation des acteurs du privé dans le cadre de projets collectifs.
Ensuite, il me semble que, dans le cadre du plan France 2030, il y aurait une place pour une cellule prospective sur les ruptures technologiques, à l'image de ce qui est pratiqué au niveau européen par une organisation privée, le JEDI – Joint European Disruptive Initiative –, qui identifie les ruptures à venir grâce à des panels d'experts internationaux. C'est essentiel pour élever continûment le niveau des décideurs publics et pour fournir aux entreprises privées des connaissances qu'elles n'auraient pas nécessairement les moyens de se procurer.
Par ailleurs, on ne porte pas suffisamment le regard sur les conséquences et les angles morts des grandes transformations que nous menons. Par exemple, on a intuitivement l'idée qu'il faudra monter en compétences. Si ces dernières ont été mentionnées en matière de la formation à la culture de la résilience, elles ne l'ont pas été dans le cadre de la réflexion sur les grandes transformations. Pour construire l'industrie de demain, il faut se demander quelles compétences seront nécessaires pour développer une filière, mais aussi quelles nouvelles dépendances et nouveaux risques entraînera l'émergence de cette dernière. À titre d'exemple, la digitalisation de l'économie augmente les effets potentiels d'une cyberattaque, le développement du cloud accroît le risque de perte de la data souveraine, le développement de l'électrification des procédés amplifie le risque de se trouver en difficulté si on n'a pas une autre solution activable et disponible en cas de panne majeure, d'incident ou d'attaque terroriste.
C'est une culture qu'il faut développer, y compris dans les détails du quotidien. Si vous n'avez que des volets électriques, que se passe-t-il le jour où se produit une panne d'électricité dans une maison, comment échappez-vous à un incendie ? Il faut être capable de repenser la sobriété technologique comme une porte de sortie en cas d'attaque sur l'une des technologies dont nous sommes dépendants. En allant un cran plus loin, on peut aussi se poser la question des compétences de M. et Mme Tout-le-monde, de leur aptitude à avoir les bons réflexes, en cas de crise, dans un environnement qui s'est technologisé.

La véritable résilience, en définitive, c'est la performance, la compétence, la capacité d'être devant et d'avoir des personnes motivées par leur travail. Aujourd'hui, alors que l'on évoque les relocalisations, on constate que nos entreprises rencontrent des difficultés pour recruter ; si nous ne sommes pas tous en mesure d'augmenter les volumes de travail, nous aurons du mal à atteindre nos objectifs.
Les règles de conformité peuvent inciter les entreprises à appréhender le risque, mais il faut bien définir ce dernier et déterminer s'il intéresse la nation. Nous avons récemment travaillé, au sein de la commission de la défense, sur les règles de conformité du secteur bancaire, dans le cadre du financement de la BITD. Ces normes ont pour conséquence de rendre de plus en plus de banques très frileuses lorsqu'il s'agit de financer les entreprises de défense. On pourrait imaginer que, demain, des banques ne souhaitent plus financer l'industrie agroalimentaire pour des raisons liées au bien-être animal. La prise en compte d'un risque par une entreprise n'est pas forcément bonne pour la nation. Il faut veiller à ce que la base industrielle ne soit pas trop focalisée sur la gestion des risques, de tous les risques, y compris de ceux qui ne sont pas forcément positifs pour nous.
J'en reviens au cas d'école des masques. Nous vivons dans un monde de plus en plus interconnecté, caractérisé par de nombreux déplacements et un nombre croissant de zoonoses. L'arme bactériologique peut même être utilisée – il suffit de suivre les débats sur le laboratoire P4 à Wuhan pour s'en convaincre. Vous avez parlé de l'action de l'État, du financement de la production de matières premières, de la commande de 1 milliard de masques pour « dérisquer » les entreprises productrices. Cette stratégie public-privé, dont nous vous sommes reconnaissants, a porté ses fruits, puisqu'elle a permis de faire passer la production de masques de 3 à 100 millions par semaine.
Il convient à présent de voir comment cette action peut être menée dans la durée. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) rembourse les masques lorsqu'ils sont prescrits sur ordonnance ou si l'on a été cas contact. Un pharmacien m'indiquait que le financement octroyé par la sécurité sociale ne lui permet pas d'acheter des masques français, car ils ont un coût légèrement supérieur aux masques vendus à l'étranger. Si nous avons su, temporairement, accroître les capacités de production, il est à craindre que nous ne sachions pas inscrire l'effort dans la durée, en raison de stratégies d'achat public qui visent à accroître la performance à moindre coût. Comment faire en sorte que la commande publique soit compatible avec l'achat de masques fabriqués en France ?
L'objectif de la commande publique est d'apporter un moyen de protection, mais elle est également source d'externalités à l'égard d'entreprises locales. Pourrait-on imaginer que les règles de financement des masques dépendent de leur lieu de production ou, à tout le moins, concevoir un système qui permette d'inscrire une forme de préférence nationale ou européenne de production ? Cela éviterait que, dans cinq, dix ou vingt ans, le secteur industriel ne soit, à nouveau, plus en mesure de faire face à nos besoins.
Comme je l'ai indiqué, nous avons travaillé en profondeur sur la commande publique. Nous avons intégré dans le cahier des clauses administratives générales des clauses environnementales et sociales, ce qui est une façon de rééquilibrer la compétition en faveur des masques français. Il est également possible d'insérer le critère de risque de rupture d'approvisionnement et de prévoir des allotissements afin de retenir deux candidats attributaires. Cela permet de répondre à un objectif de compétitivité-prix vis-à-vis d'un certain nombre de fournisseurs, et d'instituer un circuit court, afin de se prémunir contre le risque de rupture d'approvisionnement avec un autre producteur.
Une circulaire est en cours de rédaction au ministère des solidarités et de la santé, qui vise à aider les établissements publics de santé à se prémunir contre le risque de rupture d'approvisionnement grâce à la commande publique. On peut, à cette fin, acheter des masques fabriqués en France ou, éventuellement, de l'autre côté de la frontière. Il ne faut pas se l'interdire, évidemment.
S'agissant du financement dans la durée, je n'ai pas la réponse s'agissant du cas particulier des pharmaciens, d'autant que je n'ai pas en tête ce qu'ils représentent en termes de fourniture et de consommation de masques par rapport à des établissements de santé de long séjour, des maisons de retraite et des établissements de santé de court séjour. La commande publique permet de s'appuyer sur ces établissements de santé.
Les collectivités locales ont aussi un rôle à jouer. En regardant les commandes récentes, on a eu la surprise de constater que de grandes collectivités locales – je pense à certaines mairies – ont acheté des masques en Chine après s'être émues de ne pas disposer de masques français. Il est aussi de la responsabilité du politique d'opérer un pilotage stratégique de la commande publique.
Dans leur rapport sur la commande publique, votre collègue Sophie Beaudouin-Hubière et la sénatrice Nadège Havet ont fait des propositions pour favoriser la prise en compte de la dimension stratégique de la commande publique. Elles montrent que cette dernière a un rôle à jouer pour éviter les ruptures d'approvisionnement. Elles mettent en évidence son impact économique, qui doit être pris en compte dans son pilotage. Elles suggèrent qu'elle ne soit pas laissée à la décision exclusive des services d'experts, auxquels on fixerait un objectif d'économies pur et simple, et recommandent que l'on intègre, dans notre vision des choses, l'impact de la commande publique sur les territoires, son effet sur l'environnement et sur la création d'emplois.
Cela doit, bien évidemment, se faire en parfaite cohérence avec les règles européennes. De fait, nous y travaillons aussi à l'échelle européenne. La Commission tient compte du fait que la commande publique doit être facilitée pour les PME, par exemple. Elle est également consciente de l'importance des clauses environnementales ; c'est un enjeu du Conseil « compétitivité » qui se tiendra au cours des prochaines semaines. La Commission a aussi à l'esprit les enjeux de réciprocité de la commande publique et prépare un texte à ce sujet dans le cadre du Conseil « commerce », que présidera M. Franck Riester. L'objectif est d'assurer une concurrence loyale.
On a donc des instruments à notre disposition, mais on ne les utilise probablement pas suffisamment. Il faut aller plus loin, en assurant une animation régulière. Le conseil exécutif de la région, du département, ou la réunion exécutive des grandes agglomérations doivent se pencher sur la commande publique. Les ministères, dont l'empreinte est importante en la matière, doivent assurer un pilotage, comme le fait la défense depuis un certain temps.

Cela fait des années que les collectivités territoriales recourent aux clauses sociales et environnementales, non pas pour des questions de résilience, mais parce qu'elles veulent faire travailler les entreprises locales. Moi-même, en tant que maire ou président d'EPCI, j'ai eu l'occasion de le faire, et cela a plutôt bien fonctionné. J'ai toutefois l'impression que c'est parfois une manière détournée de traiter le problème. Elle peut être suffisante dans certains domaines, mais je me demande si, dans des secteurs hautement stratégiques, on ne devrait pas aller beaucoup plus loin, le cas échéant par la loi, en actionnant un des deux leviers suivants. Premièrement, on pourrait assumer un fort subventionnement de la production, comme on le fait, depuis l'après-guerre, dans le secteur agricole – l'objectif étant d'assurer notre autonomie alimentaire en conservant la production sur place. Deuxièmement, on pourrait assumer le fait d'accorder la priorité aux productions locales au moyen d'outils réglementaires – le rapport de Mmes Beaudoin-Hubière et Navet est extrêmement intéressant à cet égard.
Ma dernière interrogation concerne l'aspect juridique. Le dirigeant d'une entreprise située dans ma circonscription, qui produit du matériel médical critique, me disait que les organismes de contrôle français sont beaucoup plus pointilleux à l'égard des marchandises fabriquées en France que pour les biens importés, ce qui, à ses yeux, est déloyal pour notre industrie. Il semble que les Américains, par le biais de la FDA – Food and Drug Administration –, contrôlent non seulement ce qui est produit sur le territoire des États-Unis, mais recourent en outre à une forme d'extraterritorialité, puisqu'ils contrôlent et agréent, en faisant usage de pouvoirs de police, l'ensemble des produits qu'ils importent – l'objectif étant qu'importateurs et producteurs nationaux soient, au minimum, placés sur un pied d'égalité. J'ai d'ailleurs tendance à croire qu'ils sont plus sévères avec les producteurs étrangers.
N'aurions-nous pas une action à mener à l'égard des organismes de contrôle pour qu'ils développent leur activité de conseil – cela a déjà bien été engagé – et que cet outil réglementaire soit utilisé pour mettre les entreprises étrangères sur un pied d'égalité avec les entreprises françaises ?
Les clauses environnementales représentent, aujourd'hui, moins de 25 % du marché ; la place des clauses sociales est encore plus faible. La marge de progrès n'est donc pas négligeable. On peut affiner l'examen en prenant en compte la taille des collectivités. Cela signifie qu'il faut accompagner les acheteurs. Je ne lance pas la pierre aux uns ou aux autres. Je suis consciente que la notion de sécurité juridique est très importante pour les acheteurs.
Les autorités françaises de contrôle ont la réputation d'être très sérieuses et très rigoureuses dans leurs modalités de contrôle des marchandises importées, ce qui n'est pas forcément le cas partout en Europe. Des entreprises nous disent que, lorsque les produits entrent par tel pays, les contrôles sont nettement moins rigoureux que les nôtres. Cela appelle une action au niveau européen. Le Président de la République a d'ailleurs souhaité que l'autorité de contrôle des produits alimentaires ne soit pas seulement propre à la France, mais européenne.
Dans notre pays s'opère un double contrôle, celui des douanes et celui de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). À titre d'exemple, les douanes ont bloqué beaucoup de masques importés qui ne respectaient pas les normes de qualité attendues. Nous avons un vrai savoir-faire en la matière. De même, nous avons eu à connaître beaucoup d'affaires récentes de fraude à la francisation ou sur la qualité des produits.
Faut-il revoir les priorités de ces administrations ou renforcer leurs moyens pour répondre à un certain nombre d'objectifs ? Il faut prendre en compte le rapport qualité-prix ou bénéfices-risques. On peut penser qu'en affectant plus d'argent public, on obtient un niveau de service nettement supérieur, qui permet de mieux protéger les entreprises françaises.
Je n'ai pas de réponse complètement instruite sur cette question. En tout état de cause, la DGCCRF est une direction extrêmement importante, dans la mesure où elle protège le consommateur mais également les entreprises contre la concurrence déloyale. On pourrait lui demander de vérifier, dans l'exercice de son contrôle, que le principe de loyauté de la concurrence a été respecté – nous avons commencé à le faire avec mon collègue Alain Griset. Cela suppose de renforcer les tâches à forte valeur ajoutée – comme les contrôles complexes – tout en réduisant celles qui présentent une valeur ajoutée moins élevée – je pense aux contrôles simples qui ne sont pas nécessairement source de bénéfice public. On peut aussi, tout simplement, équiper les contrôleurs de tablettes performantes, ce qui leur permettrait de gagner du temps sur la partie administrative du contrôle et sur la réalisation des contrôles complexes.
Par ailleurs, nous sommes en train de rapprocher les laboratoires des douanes et de la DGCCRF pour que ces administrations partagent une même philosophie et bénéficient de formations communes. Cela renforcera la lutte contre la fraude.
La réunion se termine à seize heures quarante.
Membres présents ou excusés
Mission d'information sur la résilience nationale
Présents. – Mme Marine Brenier, M. Alexandre Freschi, M. Thomas Gassilloud