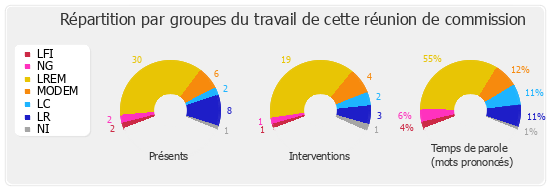Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Réunion du mercredi 19 juillet 2017 à 16h30
La réunion
Mercredi 19 juillet 2017
La séance est ouverte à seize heures trente.
(Présidence de M. Bruno Studer, président de la Commission)
La commission des Affaires culturelles et de l'Éducation procède à l'audition de Mme Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Madame la ministre, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir cet après-midi, conscients de la chance que nous avons de pouvoir bénéficier de votre expertise forgée tout au long d'une carrière remarquable, au sein d'une université exemplaire. Cette expérience est sans aucun doute un atout considérable pour relever les défis qui sont devant nous.
Votre action se situe au coeur du projet porté par le Président de la République, qu'il s'agisse de la formation initiale ou de la formation continue, et vous avez d'ores et déjà dessiné une méthode, que nous sommes curieux de connaître davantage.
Nous sommes également impatients de découvrir les voies que vous allez emprunter pour répondre aux besoins pressants qui se font sentir actuellement. Vous avez déjà eu l'occasion, lors de la séance de questions au Gouvernement de tout à l'heure, d'apporter des réponses au sujet de l'admission post-bac.
Permettez-moi de vous poser une question à propos de l'état de la recherche dans notre pays. Quelle politique comptez-vous déployer pour stopper la fuite des cerveaux et, plus encore, attirer chercheurs et ingénieurs afin de nourrir l'innovation française ?
Nous le savons, l'Éducation nationale a des difficultés à recruter des enseignants dans les filières scientifiques. Je serais extrêmement heureux si vous pouviez nous donner des pistes d'amélioration.
Je vous laisse maintenant la parole pour présenter votre projet, madame la ministre.
Mesdames, messieurs les députés, laissez-moi tout d'abord vous dire le plaisir et l'honneur qui sont les miens de vous présenter en quelques mots les grandes orientations de la feuille route qui m'a été confiée.
Tout d'abord, je tiens à souligner que notre tradition d'excellence dans l'enseignement supérieur comme dans la recherche est internationalement reconnue. Notre système d'enseignement supérieur est extrêmement efficace. Nos diplômés n'éprouvent aucune difficulté pour partir travailler à l'étranger – ce qui a son revers. Nous sommes entre la cinquième et la septième place dans les classements mondiaux pour la qualité de notre recherche. Notre opérateur national, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), est l'organisme qui rassemble le plus de publications au niveau international.
Je suis très fière que ce ministère soit de plein exercice et qu'il associe l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation.
Je commencerai par évoquer l'enseignement supérieur et la réussite de nos étudiants.
Notre système d'enseignement supérieur fonctionne bien, à une – regrettable –exception près qui est celle de l'accès au cycle de licence à l'université. Je pense en particulier aux problèmes liés au tirage au sort et à l'admission post-bac (APB), dont j'ai découvert l'ampleur lors de ma prise de fonctions – je dis « l'ampleur » car le tirage au sort existe depuis la mise en place du système APB en 2002.
Autre grand sujet de préoccupation : le fait que 60 % des étudiants entamant une licence échouent à obtenir leur diplôme. C'est un gâchis humain, social et financier. La première chose à laquelle je me suis attelée est le lancement d'une grande concertation pour repenser totalement l'accès à l'enseignement supérieur et le premier cycle universitaire. Nous poursuivons l'objectif de mettre en place un système qui accompagnera la réussite de l'ensemble des étudiants car sans accompagnement, leur échec est quasiment certain. Lancée cette semaine, la concertation s'achèvera dans trois mois et permettra d'apporter des modifications rapidement pour que la rentrée 2018 se fasse sans tirage au sort.
Repenser la formation dans l'enseignement supérieur, c'est aussi changer l'idée selon laquelle lorsqu'on n'a pas obtenu son diplôme de plus haut grade à vingt-trois ou vingt-cinq ans, on a raté sa vie. Il s'agit de mettre en place un système d'enseignement supérieur dans lequel chacun peut revenir tout au long de sa vie. C'est une dimension qui me tient particulièrement à coeur. Certains étudiants, on le sait, déplorent à l'issue de leurs études de ne pas trouver d'emploi à la hauteur de leurs qualifications.
Nous voulons également accompagner l'ensemble des bacheliers. Les bacheliers des filières professionnelles n'ont actuellement pas d'autre choix, sauf dans quelques régions où une expérimentation est menée, que de se diriger vers une licence générale non sélective alors qu'ils trouveraient davantage leur place pour réussir dans des formations courtes plus professionnalisantes.
Ce sont autant de sujets que nous devons aborder sans tabou.
Je souhaiterais également que l'engagement étudiant soit mieux valorisé. Nous devons reconnaître cette formidable chance que nous avons de compter près d'1,6 million de jeunes qui ont envie de s'engager. Nous pourrons compter sur des outils déjà existants comme le service civique ou les contrats aidés. Il faut aider les étudiants à mettre en valeur cet à-côté de leur vie académique qui va contribuer à faire d'eux des citoyens à part entière.
Pour que tout cela fonctionne, il faut développer les passerelles entre les différentes formations, qu'il s'agisse des formations bac-3bac+3, des écoles ou des universités. Les étudiants doivent pouvoir circuler de manière fluide entre les différentes structures d'enseignement supérieur.
Il sera par ailleurs nécessaire de revenir sur les regroupements instaurés par la loi de 2013. Ils ne reposent que sur trois formes : les fusions, les associations valant rattachement ou bien les communautés d'universités et d'établissements, lesquelles placent l'ensemble des structures souhaitant se rassembler autour d'un projet commun, sous un régime de type universitaire, formule qui n'est pas adaptée à tous les établissements d'enseignement supérieur. Il s'agit de mettre en valeur le projet plutôt que la « boîte » qui le contient. Dans cette perspective, vous aurez à voter, dans le futur projet de loi d'habilitation pour la simplification des relations entre les pouvoirs publics et les usagers, des dispositions prévoyant la possibilité de mettre en place une phase d'expérimentation pour les sites qui le souhaitent, de manière qu'ils puissent s'organiser comme ils le veulent, en conservant si nécessaire leur personnalité morale afin de porter un projet, au lieu d'avoir d'abord à trouver la structure administrative adéquate, ce qui constitue souvent un blocage. Pour plus de liberté, le contrôle s'exercera a posteriori plutôt qu'a priori, sur la base d'un petit nombre d'indicateurs qui permettront de suivre l'avancée des projets.
En ce qui concerne la recherche, nous devrons être en mesure de redonner de véritables missions nationales aux organismes de recherche nationaux. Nous continuerons par ailleurs à promouvoir la recherche sur projet, sous forme libre à travers des projets blancs ou à travers le financement par projet soutenu par l'Agence nationale de la recherche (ANR).
Il nous faudra également participer pleinement à la définition de la politique scientifique et de recherche européenne. Cela suppose de travailler très en amont, avec l'ensemble des partenaires européens, pour définir ensemble les priorités. Nous nous attacherons d'abord au niveau national, puis au niveau bilatéral, enfin au niveau européen afin d'aboutir à un meilleur taux de succès : nous devons contribuer à ce que les axes de recherche promus par les instances européennes soient ceux pour lesquels nous sommes en bonne place.
Par ailleurs, il me paraît essentiel que nous continuions à soutenir de grandes infrastructures de recherche sur lesquelles pourront se reposer des projets européens. Dans certains domaines de recherche en effet, les États seuls ne sont pas en mesure de financer la totalité des investissements exigés ; ils doivent combiner leurs forces.
L'innovation est pour moi quelque chose de fondamental, et j'entends l'innovation dans tous les sens du terme.
Il s'agit d'abord de l'innovation au sens classique : tout ce qui permet d'aller de la recherche académique au marché avec l'accompagnement que cela nécessite en termes d'ingénierie, de recherche-développement et d'instruments de transfert. Le paysage actuel est extrêmement complexe. Il y a énormément d'outils, dont je ne suis pas sûre qu'ils soient tous aussi efficients les uns que les autres. Certains se chevauchent et appellent une simplification.
Nous serons amenés à soutenir les collaborations entre les laboratoires académiques et la recherche-développement dans les entreprises. Cela supposera d'approfondir les liens entre les sites d'enseignement supérieur et de recherche et les territoires dans lesquels ils s'insèrent, notamment dans le domaine de la formation professionnelle et des schémas de développement régionaux. Ce seront autant d'opportunités d'insertion professionnelle pour les étudiants, à tous les niveaux de formation.
Enfin, il faudra continuer à travailler à la reconnaissance du doctorat par le monde de l'entreprise.
Il s'agit ensuite de l'innovation pédagogique. Nous vivons une véritable révolution. Ceux d'entre vous qui ont la chance d'enseigner dans le supérieur savent que pendant les cours, les étudiants consultent leurs ordinateurs ou leurs téléphones pour vérifier les informations données par l'enseignant. Nous devons donc imaginer l'enseignement supérieur autrement. Encourager l'approche par projet et l'approche par compétence, aider nos étudiants à mieux utiliser les informations en leur apprenant à les trier, à les hiérarchiser, à les utiliser pour les transformer en concept intellectuel, voici autant de pistes qui s'offrent à nous, au-delà des cours magistraux qui ont prévalu les siècles précédents. La révolution de l'innovation pédagogique n'est pas que numérique, loin de là, même si elle s'appuiera aussi sur le numérique. Elle exige que nous libérions notre créativité pour enseigner autrement.
Il s'agit enfin de l'innovation structurelle. Il ne faut pas s'interdire de remettre en question l'organisation actuelle. Plutôt que de nous contenter de dire que les choses ont toujours été ainsi, explorons des voies nouvelles en nous appuyant sur les administrations et les personnels techniques et administratifs : ils savent souvent ce qui peut être amélioré mais ne sont jamais consultés. Ne restons pas figés dans des structures en silo qui rendent le dialogue impossible. L'avenir de la recherche et de l'enseignement supérieur passera par la transdisciplinarité.
Je terminerai par l'espace, qui relève aussi de mon ministère. Il est essentiel de faire la démonstration de son importance dans la vie quotidienne des citoyens.
Autre point essentiel : la France et l'Europe doivent conserver un accès autonome à l'espace. Je prendrai deux exemples concrets.
Le programme Ariane 6 comprend la mise sur orbite de satellites Galileo appelé à devenir en Europe le GPS de demain. Il est très important que la France et l'ensemble des pays européens demandent que ce système de navigation soit intégré dans tous les équipements utilisant la géolocalisation, à l'instar des États-Unis et de la Chine qui utilisent leur propre système de navigation.
Le programme Copernicus, quant à lui, nous permettra de collecter des données à partir de l'observation de la terre depuis l'espace, données essentielles pour la surveillance du climat et des évolutions environnementales.
Il n'est pas question pour moi d'élaborer une énième loi. L'enseignement supérieur et la recherche n'ont pas besoin d'une loi supplémentaire. Il s'agit plutôt de procéder à quelques aménagements législatifs.
Je mènerai ma mission de façon interministérielle. Je travaillerai avec mon collègue ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, pour tout ce qui va concerner l'entrée dans le supérieur mais aussi la formation des enseignants. La désaffection des étudiants pour les études scientifiques est un grand sujet de préoccupation. J'attribue cette évolution au fait qu'il est de plus en plus difficile de distinguer les croyances de la connaissance scientifique, d'où la nécessité de remettre les sciences à l'honneur. Ma collaboration s'étendra à la quasi-totalité des ministères puisque, comme vous le savez, de très nombreux établissements d'enseignement supérieur sont en co-tutelle avec d'autres ministères. Rien d'étonnant à cela : l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation sont pour moi au coeur de tout.

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, chaque enfant doit, où qu'il soit, d'où qu'il vienne, pouvoir bénéficier d'une éducation afin d'être le meilleur possible et d'aller au bout de ses possibilités. C'est cela l'excellence républicaine.
Pour commencer mon intervention, je tiens à saluer votre décision d'en finir avec le tirage au sort pour l'accès à l'université, système qui remettait en cause la méritocratie républicaine. D'autres pesanteurs limitent toujours cette ambition méritocratique qui est l'un des socles de la République. Nous parlons beaucoup, et à juste titre, du système d'admission post-bac, et des milliers d'élèves, pourtant méritants, qui n'ont toujours pas pu s'inscrire dans les universités. Je pourrais également souligner la baisse constante de la part des élèves issus des milieux populaires dans les grandes écoles. Alors, oui, la République est un combat de tous les instants et je sais, madame la ministre, que vous êtes particulièrement attentive à cette ambition. Nous vous en remercions.
Le Président de la République, lors de la campagne électorale, a annoncé son souhait de faire de la France la patrie de l'innovation, de la recherche et du futur. Cet objectif est partagé par les parlementaires du groupe La République en marche. Il participe enfin d'une vision et d'une ambition claire pour notre pays.
Madame la ministre, vous êtes l'ancienne présidente de l'université de Nice-Sophia-Antipolis, expérience à laquelle le député des Alpes-Maritimes que je suis est particulièrement sensible.
J'aurai deux questions courtes : d'une part, quelles sont les premières mesures que vous comptez prendre pour répondre à l'objectif fixé par le Président de la République, alors même que le contexte budgétaire est particulièrement contraint ? D'autre part, comment envisagez-vous les liens entre entreprise et université, question qui me tient à coeur en tant qu'ancien entrepreneur ?

Madame la ministre, au nom du groupe Les Républicains, je tiens à vous remercier pour votre exposé liminaire. Permettez-moi de revenir brièvement sur le fiasco du portail APB, après les deux questions au Gouvernement qui lui ont été consacrées tout à l'heure.
Rappelons les faits : 87 000 bacheliers se retrouvent sans affectation, dont 10 000 ont comme premier voeu une filière non sélective. C'est inacceptable, d'autant plus que 50 % des étudiants, mal informés ou mal orientés, échoueront en première année d'université. Comment comptez-vous concilier égalité des chances et mérite républicain ?
En 2015, nos anciens collègues Dominique Nachury et Emeric Bréhier avaient rédigé un excellent rapport sur les liens entre lycée et enseignement supérieur. Entre autres préconisations, figuraient une plus grande ouverture des établissements d'enseignement sur le monde professionnel et une meilleure information des enseignants sur les filières du supérieur et les métiers de demain. Quelle est votre position sur le système dual et sur la formation en alternance dans le supérieur ?
Faire émerger une culture commune au cycle bac-3bac+3 en permettant les échanges de services entre les enseignants du secondaire et du supérieur me semble une idée intéressante. Ne pourrait-on pas envisager des mobilités permettant aux professeurs agrégés des lycées d'enseigner dans les premiers cycles universitaires et à des enseignants-chercheurs d'intervenir dans les lycées, notamment dans les classes préparatoires ? Il est vrai que la loi organique relative aux lois de finances ne permet pas vraiment la fongibilité des budgets et que l'annulation de 331 millions de crédits pour l'enseignement supérieur est un mauvais signal avant les annonces budgétaires pour 2018. Quels objectifs et indicateurs de performance constitueront vos priorités pour le prochain projet de loi de finances ?

Madame la ministre, je voudrais, au nom du groupe Mouvement Démocratique et apparentés, vous remercier de venir à notre rencontre mais aussi me féliciter que le Gouvernement compte dans ses rangs une ministre biologiste, du sud de la France, qui a été engagée à très haut niveau dans l'administration universitaire et qui a manifesté lors de son parcours scientifique un intérêt particulier pour la cellule de Sertoli !
Nous nous félicitons aussi de l'intitulé même de votre ministère, qui nous rappelle l'urgence de réunir recherche et innovation dans un pays classé quatrième en matière de brevets, performance dont la traduction en activités nouvelles reste insuffisante.
Vous comprendrez que je n'occulte pas les retours inquiets nés de la coupe de 330 millions d'euros dans le budget de votre ministère. Si nous sommes capables de la comprendre au regard des enjeux budgétaires, elle passe mal chez nos collègues qui ont cru à la sanctuarisation du budget correspondant.
Comment ne pas se féliciter d'avoir enfin un ministère qui remette en cause notre sacro-sainte sélection universitaire par l'échec ? Les professionnels que nous sommes, à qui l'on demande depuis des années d'améliorer les résultats en termes de réussite en première année d'université, savent que cela n'est possible que s'ils ont un droit de regard et de conseil pour décourager certains étudiants dont la probabilité de succès dans nos filières avoisine zéro.
Au-delà, beaucoup trop d'étudiants s'orientent de façon passive sans même se questionner sur l'existence de réels débouchés. Ne faudrait-il pas mettre en place, en particulier lors de la transition licence-master, une vraie communication pour inciter ces derniers à réaliser très tôt, lors de leur troisième année, une sorte d'étude de marché incluant entre autres des rencontres avec le responsable du master, des mises en contact avec les anciens, un accès aux informations sur le devenir des promotions précédentes. La question est bien de rendre nos étudiants acteurs de leur formation.
Enfin, nombre de formations sont de bonne qualité au regard de l'acquisition de connaissances mais oublient que le principal débouché reste industriel, avec des exigences de compétences spécifiques. Nous avons expérimenté dans le domaine des biotechnologies-santé la labélisation de nos maquettes d'enseignement par notre pôle de compétitivité Eurobiomed, que vous connaissez bien. Cela assure un soutien pour la formation d'un grand nombre d'acteurs industriels, mais aussi académiques, et permet d'intégrer dans nos maquettes d'enseignement les éléments de professionnalisation jugés nécessaires par les industriels, garants d'une entrée aisée dans la vie professionnelle. Pourquoi, quand cela est possible, ne pas généraliser cette approche ?

Les classes préparatoires, littéraires, scientifiques ou commerciales, intégrées dans les lycées ont fait l'objet, ces dernières années, d'une récurrente remise en question parce qu'elles ont parfois été estimées coûteuses et élitistes. Ces formations, parce qu'elles ne sont pas conditionnées à un droit d'entrée, sont pourtant un formidable moyen pour des élèves travailleurs, issus de tous les milieux, de pouvoir se présenter armés aux grands concours de notre pays. Ces classes prépas, parce qu'elles sont extrêmement exigeantes, voient sortir de leurs rangs des étudiants efficaces et cultivés, des étudiants de valeur pour les universités et les écoles qu'ils intègrent. Partagez-vous le même constat, madame la ministre, et pouvez-vous nous donner des garanties sur les moyens de ces classes ?
Élue du Nord, je prendrai l'exemple de l'Université de Valenciennes pour illustrer ma deuxième question, mais elle n'est pas la seule concernée. Cette université s'est considérablement développée et spécialisée, ces dernières années, notamment en ingénierie, sciences et technologies dans des domaines comme le transport, la logistique, la mobilité et le handicap. Elle nourrit le projet de devenir une université polytechnique pour former au mieux aux métiers d'aujourd'hui et de demain. Juridiquement, la mutation est possible, sauf sur ce point. Elle a donc demandé au ministère de pouvoir utiliser un mode expérimental de gouvernance dans le cadre de l'article L.711-4 du code de l'éducation. Il me semble que les initiatives locales au sein des universités, par exemple celle de Valenciennes, devraient être encouragées et soutenues dans la mesure où elles cherchent à s'adapter, pour le bien de leurs étudiants, aux évolutions de la société et du monde économique.

Ma première question est d'ordre budgétaire. Le Président de la République avait annoncé pendant la campagne une sanctuarisation des crédits de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'innovation, et il avait ajouté qu'il souhaitait une stratégie quinquennale claire qui mette fin à la politique de régulation budgétaire annuelle et au phénomène de rabot. Or, en 2017, les coupes budgétaires s'élèvent à 330 millions d'euros ; une fois déduits les 130 millions de réserve de précaution, il reste donc 200 millions de coupes nouvelles, soit l'équivalent du salaire annuel de 5 500 enseignants-chercheurs. Plus graves encore sont les inquiétudes pour 2018 : il faudra en effet trouver 1,2 milliard d'euros supplémentaires par rapport au budget total de 27 milliards d'euros, puisqu'il faut tout à la fois financer les mesures déjà prises à hauteur de 120 millions d'euros, comme la création en année pleine de mille postes dans votre ministère ainsi que les mesures de revalorisation des carrières et du point d'indice, mais aussi financer des mesures nouvelles à hauteur de 400 millions d'euros – qu'il s'agisse de l'accueil de 40 000 étudiants supplémentaires, du développement des licences professionnelles ou encore du glissement vieillesse technicité (GVT) – et, enfin, financer la réforme de l'entrée dans l'enseignement supérieur, qui représente 700 millions d'euros. Au total, c'est donc un montant de plus de 1 milliard d'euros. Pouvez-vous nous indiquer si vous avez obtenu des engagements en ce sens pour 2018 ?
Permettez-moi enfin de revenir sur une deuxième question que vous avez utilement abordée tout à l'heure : celle de l'échec en premier cycle, qui doit devenir un chantier prioritaire après que la question du décrochage scolaire l'a été sous la précédente législature. Je me réjouis naturellement de l'abandon du tirage au sort pour 2018. Notre collègue Pascal Deguilhem et moi-même l'avions déjà préconisé dans la filière des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), nous étonnant notamment que certains étudiants n'y sachent pas nager. Vous posez la question des prérequis, mais la véritable question à poser n'est-elle pas celle de l'orientation anticipée en lycée et de son amélioration, en particulier dans le cadre des passerelles bac-3 et bac+3 qui ont fait leurs preuves, et qui permettent de mieux préparer l'orientation des lycéens sans attendre l'échec en premier cycle ?

Les universités françaises souffrent d'une insuffisance de moyens et ne pourront plus supporter de coupes dans leurs budgets. Trop d'étudiants et d'étudiantes sont forcés de travailler en parallèle de leurs études, parfois jusqu'à en compromettre la réussite. Trop de chercheurs partent à l'étranger faute de financements de thèses sur le territoire français. Trop de salariés du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche sont précarisés. Parmi eux se trouvent les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, les titulaires de contrats doctoraux uniques, les vacataires, les enseignants-chercheurs associés et invités ou encore les titulaires de contrats à durée indéterminée. Tous apportent beaucoup mais récoltent peu le fruit de leur travail.
Je vous propose de mettre fin à la précarité des doctorants et des jeunes chercheurs par la titularisation des personnes effectuant des missions pérennes. Pour ce faire, des fonds supplémentaires sont nécessaires. Nous pourrions par exemple les mobiliser en permettant aux universités publiques d'accéder gratuitement aux articles de leurs chercheurs sans enrichir les revues et les bases de données privées, mais aussi en transformant le crédit d'impôt-recherche, dont le montant est évalué à 5,5 milliards d'euros, en une aide à la recherche et au développement à destination des PME ainsi que de l'enseignement supérieur et de la recherche publics.
Face à la réalité de la situation que je viens de décrire et compte tenu des solutions existantes, quelles sont vos intentions, madame la ministre, concernant l'emploi des doctorants et des enseignants-chercheurs à l'université ?
Comme vous l'avez dit, monsieur Roussel, il est essentiel de relancer la méritocratie républicaine et de refaire de l'enseignement supérieur un véritable ascenseur social. Nous devons tout à la fois travailler sur l'autocensure des jeunes qui renoncent même à essayer, convaincus qu'ils échoueront, et adopter les mesures d'accompagnement qui permettront à cet ascenseur social de redémarrer. Cela commence bien en amont de l'enseignement supérieur, ce à quoi je m'intéresse particulièrement avec M. Blanquer : l'université, en effet, forme les enseignants du primaire et du secondaire qui auront à accompagner cet effort. Surtout, les jeunes doivent retrouver confiance dans l'institution scolaire et universitaire et dans l'enseignement supérieur. Or, ce n'est pas en dénigrant en permanence notre enseignement que nous rétablirons la confiance. Sans perdre notre esprit critique, nous devons aussi nous réjouir de toutes les très belles choses qui se font dans nos écoles, nos collèges, nos lycées, nos grandes écoles et nos universités. Cela contribue en effet à rendre la confiance et l'espoir.
J'en viens au contexte budgétaire. En effet, une réduction de 180 millions d'euros a été décidée ; elle correspond pour 160 millions à la réserve de précaution, c'est-à-dire des crédits non affectés qui, le plus souvent, servent à éponger les coups durs, et à 20 millions qui sont prélevés sur les crédits de gestion du ministère. Autrement dit, cette réduction n'a aucune répercussion sur les programmes de recherche et les campagnes de recrutement déjà lancés, ni sur aucun autre budget dont l'exécution est déjà engagée. Certes, l'effort est important, même s'il peut sembler faible au regard du budget global de l'enseignement supérieur et de la recherche. N'oublions pas que celui-ci comprend une part importante consacrée à la masse salariale ; toute réduction des crédits de fonctionnement a donc des effets supérieurs à ce que laisse accroire la simple présentation en pourcentage.
Il était essentiel, néanmoins, que l'ensemble du Gouvernement soit solidaire de cet effort nécessaire, qui a été consenti de manière raisonnée et raisonnable. Nul ne saurait naturellement se réjouir de la réduction du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, pas davantage que celui de la culture. Il n'empêche : la réalité est que nous devions impérativement réaliser des économies, et ce sera le cas en 2017. Le budget pour 2018 est en cours de discussion et de construction. Il sera naturellement bâti sur la base des projets validés par le Premier ministre et par le Président de la République. C'est pourquoi il est capital que nous donnions du sens aux dépenses que nous allons engager au nom de l'État.
Je souhaite, Monsieur Juanico, que nous ayons les moyens d'accompagner la réussite des étudiants. En moyenne, un étudiant en première année d'université représente un coût de l'ordre de 8 000 à 10 000 euros : quand il réussit, c'est un investissement ; quand il échoue de manière récurrente, c'est une dépense inutile. Cette année, 100 000 étudiants ont utilisé le portail d'admission post-bac (APB) pour se réorienter car ils ont suivi l'an dernier une formation qui ne leur a pas convenu ou dans laquelle ils n'ont pas trouvé leur place. Ce n'est en rien de leur faute, puisque le portail APB fonctionnait déjà l'an dernier ; c'est pourquoi j'insiste pour que nous travaillions à l'orientation différemment. Quoi qu'il en soit, je vous laisse faire le calcul. À l'évidence, il faudra investir ; investir dans l'enseignement supérieur pour y faire réussir les étudiants ne pose aucun problème, mais nous ne pouvons pas nous contenter d'y injecter plus d'argent sans le réformer en profondeur pour assurer cette réussite. Encore une fois, l'investissement ne pose aucune difficulté si c'est pour faire réussir les étudiants, mais les deux objectifs doivent être poursuivis de concert ; l'argent ne suffit pas si l'on ne change rien par ailleurs. Or, cela fait des années que nous ne changeons rien et que le taux d'échec en licence ne baisse pas.
Il y va en outre de l'égalité des chances et du mérite républicain, Monsieur Reiss. Il est en effet plus ou moins facile de comprendre les informations fournies et le fonctionnement du système en fonction du milieu social : il est ainsi plus aisé de s'y retrouver lorsque les parents ou la famille ont eux-mêmes fait des études ; c'est en revanche plus difficile lorsque l'on vient d'un milieu où nul avant vous n'a fait d'études. Autrement dit, c'est aussi favoriser l'égalité des chances et valoriser le mérite républicain que de se donner les moyens de mieux informer et, surtout, d'accompagner l'orientation. Le problème est connu : l'information est abondante, omniprésente même, mais l'usage qu'on en fait dépend du milieu social de chacun. Nous devons y être particulièrement attentifs : il faut accompagner le maximum d'élèves afin qu'ils puissent utiliser l'information pour faire des choix d'orientation qui leur conviennent.
J'ajoute que ces choix d'orientation doivent relever du projet de l'étudiant lui-même ; pourtant, on constate aujourd'hui que les projets des étudiants sont souvent ceux de leurs parents. Dans une famille où personne n'a fait d'études, la réussite au bac constitue déjà un accomplissement majeur, mais les lauréats peuvent faire encore beaucoup plus et mieux s'ils le souhaitent. A contrario, dans une famille de diplômés de l'École polytechnique, il faudrait que devenir joailler n'ait rien d'un drame. Lorsque nous serons parvenus à ce résultat, alors nous aurons réellement changé les choses.
La réflexion sur l'articulation entre le bac-3 et le bac+3 est abordée dans le cadre de la concertation que nous avons lancée lundi. Comme pour toute action interministérielle, il est difficile d'envisager une mise en commun entre le secondaire et le supérieur – et il est vrai que la LOLF ne nous y aide pas. Nous y réfléchissons donc, et la concertation, sans tabous ni préjugés, produit des résultats très intéressants.
Vous avez raison, monsieur Berta : la France se classe quatrième dans le monde en termes de brevets, et elle pourrait encore faire beaucoup mieux.
La sélection par l'échec est un réel problème – nous venons d'en parler. Oui, les étudiants doivent devenir acteurs de leur formation mais, pour ce faire, nous devons être en mesure d'accompagner la vie étudiante dans son ensemble. Il ne faut pas que les étudiants viennent à l'université comme des consommateurs en quête de cours ; il faut aussi qu'ils puissent participer à la vie du campus et de l'université. De ce point de vue, les choses se passeront d'autant mieux qu'on les encouragera en valorisant leurs propositions et qu'ils participeront à la vie étudiante. C'est un élément essentiel de l'acquisition des compétences et de la professionnalisation. Les étudiants peuvent aussi mettre en valeur le fait qu'ils ont créé puis géré une épicerie solidaire pendant un an, par exemple, car c'est une action concrète. Il est très important qu'ils soient accompagnés en ce sens.
S'agissant du travail en parallèle des études, monsieur Larive, je suis très attachée à envisager comment combiner les contrats étudiants avec les bourses de sorte que les étudiants, s'ils doivent travailler, le fassent davantage dans les bibliothèques universitaires, par exemple, ou en tutorat, voire en mentorat auprès d'étudiants plus jeunes, plutôt qu'à l'extérieur de l'université. Des études montrent clairement que travailler plus de seize heures par semaine réduit de plus de moitié les chances de réussite. Le service civique, lui, aura une durée de douze à quatorze heures, par exemple. Il est possible que les étudiants travaillent dans les universités, comme cela se fait dans de très nombreux autres pays – et c'est une manière d'accompagner leur réussite. Un emploi au sein de l'université, à la bibliothèque par exemple, est bien différent d'un emploi de gardien de nuit ou dans la restauration rapide. La réussite en licence passe aussi par ces formes d'accompagnement qui permettront aux étudiants d'être plus autonomes tout en étant sur le lieu de leurs études.
La titularisation des agents à des fonctions pérennes est une disposition de la loi Sauvadet, dont les résultats pratiques ne sont pas parfaits, loin s'en faut. Ce n'est de toute façon pas une solution pour un certain nombre d'agents qui, in fine, n'ont pas souhaité en bénéficier – preuve qu'elle n'était peut-être pas si adaptée que cela. Pour mémoire, la disposition en question de la loi Sauvadet prévoyait la titularisation dans la fonction publique de toute personne ayant exercé la même mission pendant un certain nombre d'années – trois à six selon les missions.
Le partage gratuit des publications universitaires existe sous la forme d'un système de dépôt dénommé HAL, auquel toutes les universités peuvent participer. Cependant, il ne résout pas la question de l'accès à l'ensemble des publications et des données. Nous menons un combat national contre des éditeurs comme Elsevier, des « squatteurs », en quelque sorte, qui obligent à souscrire un abonnement papier et un abonnement numérique et qui, étant les seuls à le faire, exercent un quasi-monopole, d'où une hausse régulière des prix. Au-delà de la question des publications se cache celle, bien plus large, des données produites par la recherche et par l'ensemble des capteurs installées dans les villes, qui représentent une part importante de l'économie de demain.
Il est essentiel de faire travailler les universités avec les territoires et les entreprises qui s'y trouvent, et de faire en sorte qu'une partie des formations soient mises au service de l'insertion professionnelle et de l'emploi dans les territoires. N'oublions pas pour autant que les universités sont les lieux où sont délivrés les plus hauts diplômes nationaux. Si je parlais tout à l'heure de souplesse et d'ouverture, c'est donc parce qu'il faut combiner des parcours extrêmement exigeants en termes de concepts et de connaissances, qui mèneront jusqu'au doctorat, avec des parcours aux exigences non pas moindres mais différentes, qui conduiront plutôt vers l'emploi. Il est crucial de suivre ces parcours pour, ensuite, permettre le retour à l'université, non pas sous la forme d'une validation des acquis de l'expérience ou des acquis professionnels – qui, ne relevant plus de la formation initiale, est très chère et se transforme souvent en parcours du combattant face à des jurys qui retiennent ceci sans retenir cela – mais en encourageant davantage – grâce au numérique, notamment – la possibilité de se former et d'obtenir des diplômes tout au long de la vie.
Enfin, madame Descamps, je n'ai aucun problème avec les classes préparatoires, qui participent à l'accueil des bacheliers dans l'enseignement supérieur. En revanche, je suis moins convaincue que vous qu'elles s'ouvrent à tous les publics. Elles ont consenti des efforts, il est vrai, mais d'autres restent à faire. Certaines classes préparatoires le font très bien, mais d'autres – nous en connaissons tous – relèvent plutôt d'un mode d'auto-reproduction et ne sont pas complètement ouvertes. Quoi qu'il en soit, elles y travaillent et c'est important. Elles pourraient d'ailleurs y travailler, sans crainte de perdre leur identité, de manière beaucoup plus fluide et souple avec les universités ; plusieurs expériences sont menées en ce sens.
En ce qui concerne le souhait de l'Université de Valenciennes de se transformer en université polytechnique, elle entend tirer parti de l'article de loi qui autorise l'expérimentation. Or, cet article n'autorise l'expérimentation que pour la création d'un nouvel établissement. C'est pourquoi j'ai souhaité que le projet de loi de simplification comporte un article autorisant l'expérimentation pour des établissements déjà existants. Ce sera précisément le cas de l'Université de Valenciennes : plutôt que de fermer pour rouvrir, il s'agit de la transformer.

Nous sommes nombreux, madame la ministre, à être sollicités sur le terrain au sujet des problèmes du dispositif APB ; c'est donc une excellente nouvelle que vous vous soyez rapidement saisie de ce dossier.
Ma question porte sur l'augmentation du numerus clausus, c'est-à-dire le nombre d'étudiants acceptés en deuxième année d'études de médecine. Le Président de la République a réaffirmé cette promesse d'augmentation avant-hier, lors de la conférence des territoires. Comment comptez-vous la mettre en pratique et selon quel calendrier ? Une modulation systématique du nombre d'étudiants en fonction des territoires, notamment en tenant compte des déserts médicaux, est-elle à l'étude ?

Ma question a trait à l'amélioration de l'adéquation entre la formation et l'enseignement supérieur d'une part et, d'autre part, les besoins des entreprises de l'État et des futurs employeurs au sens large. Le constat que nous avons fait lors de la campagne législative, que certains collègues de La France insoumise ont récemment rappelé dans l'hémicycle, est le suivant : nous rencontrons tout à la fois de nombreuses personnes en recherche d'emploi et de nombreuses entreprises en recherche de compétences. J'ai pris note, dans un carnet de campagne, d'une vingtaine de postes qui auraient pu être pourvus dans des entreprises qui en auraient été satisfaites ; à l'échelle de ma circonscription, cela représente deux cents emplois potentiels, et encore n'est-ce qu'un échantillon minimum.
Je citerai deux exemples : il a été proposé de créer une formation courte dans le cadre d'un diplôme de BTS, avec un réel potentiel en amont comme en aval, mais la région y a opposé une fin de non-recevoir ; cette situation me semble choquante. L'éditorial du quotidien Le Monde daté d'aujourd'hui se conclut ainsi : « Trouvons, impérativement, une meilleure articulation entre droit aux études, capacités des étudiants et offre du marché du travail ». J'ai par ailleurs reçu un message de CampusFrance sur la Conférence des grandes écoles : aucune de ses six priorités ne concerne la création de nouvelles formations en adéquation avec l'entreprise au sens large.
Vous parlez de souplesse et d'ouverture ; je parlerai d'agilité. Comment accélérer la création de formations en lien avec les besoins des entreprises ? J'aimerais entendre dire que l'on peut créer de telles formations en moins d'un an – et les supprimer.

Il est tout à fait judicieux, madame la ministre, d'élargir les règles d'expérimentation car la situation actuelle est un frein qui empêche les universités existantes d'expérimenter.
Nous avons tous entendu les promesses du Président de la République concernant la sanctuarisation du budget de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Or, aujourd'hui, nous constatons qu'il n'en est rien. J'ai bien compris votre argument de la solidarité gouvernementale et du fait que l'ensemble des ministères doivent concourir à un effort global. Soit, mais le nombre de jeunes qui arrivent dans l'enseignement supérieur a augmenté de 40 000 en quelques années ! Il faut tenir compte de la pression démographique.
Vous prétendez que l'effort budgétaire de votre ministère concerne pour l'essentiel la réserve de précaution. Raisonnons globalement, à l'échelle de la mission interministérielle recherche et enseignement supérieur (MIRES) : la réduction, notamment en autorisations d'engagement, approche plutôt les 400 millions d'euros. Vous savez bien que faute de pouvoir agir sur la masse salariale, c'est-à-dire le titre II, on agira sur le titre III, donc sur des actions pour la plupart déjà engagées. Au total, à l'examen des engagements déjà pris à l'échelle de la MIRES, on constate donc que l'effort à fournir représente environ la moitié des crédits encore non engagés. À l'évidence, c'est impossible. Ma question est donc simple : ne s'agit-il pas de cavalerie budgétaire, et n'allez-vous pas devoir décider en fin d'année de reports nettement supérieurs aux reports précédents ?

Ma question porte sur Saclay, le projet universitaire et scientifique d'excellence. Ce centre universitaire majeur compte la présence de nombreuses grandes écoles – ParisTech, l'École normale supérieure de Cachan – et universités, comme Paris-Saclay. Dans quelques années, il deviendra également le premier pôle scientifique français et européen avec, entre autres, la construction du plus grand centre de recherche sur l'environnement en France. Aujourd'hui, la plateforme de Saclay est le premier pôle scientifique européen en matière de dépôts de brevets, et il concentrera à terme plus de 20 % de la recherche française, avec l'Institut national de la recherche agronomique, par exemple. Il est en outre prévu, dans le projet de candidature de Paris-Saclay pour l'Exposition universelle de 2025, la reconversion du site en un centre universitaire majeur.
Pendant le précédent quinquennat, l'ambition était de renforcer la coopération entre les universités et les centres de recherche de Saclay avec les entreprises industrielles françaises. Pouvez-vous nous confirmer cette orientation politique ? Si la France devait obtenir l'accueil de l'Exposition universelle de 2025 – je rappelle à cet égard, contrairement à ce que m'a répondu hier la ministre de la culture, parlant de « dossier lointain », que la décision de dépôt de la candidature doit être prise dans deux mois –, le site de Saclay sera reconverti en un centre universitaire majeur. Pouvez-vous d'ores et déjà esquisser les contours de votre politique en la matière ?
Avec le développement des coopérations entre grandes écoles et universités, avez-vous réfléchi à des modèles de gouvernance communs afin que ces regroupements puissent mutualiser leurs ressources et, ainsi, se hisser au plus haut niveau des grandes universités anglo-saxonnes et asiatiques ? Enfin, la reconversion du site de Saclay en un centre universitaire est aussi un projet essentiel de l'héritage de l'Exposition universelle. D'autres projets sont-ils néanmoins à l'étude, par exemple d'échanges entre les universités et des entreprises étrangères ? Comment allez-vous travailler avec le ministère de la culture à la réussite de ce projet ?
La réflexion sur la réforme du premier cycle universitaire inclut les études de santé. Des expérimentations sont déjà menées en ce sens, qui suppriment le concours de fin de première année et garantissent aux étudiants la possibilité de continuer leurs études, soit en médecine pour ceux qui le peuvent, soit vers d'autres types de formation. Vous avez raison, il serait plus simple d'ajuster le nombre de médecins formés aux besoins territoriaux. Mais la réalité est plus complexe : si nous débloquons le numerus clausus aujourd'hui, nous ne disposerons de médecins que dans dix ou douze ans. Nous devons donc réfléchir à nos besoins à cette échéance. Il ne s'agit pas d'augmenter le numerus clausus pour répondre à la situation actuelle. Nous menons un travail conjoint avec Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, et les doyens des facultés de médecine. Nous attendons également, pour conclure, les résultats des expérimentations.
La question de l'adéquation des compétences à l'emploi est complexe. Il est important de garder des diplômes nationaux, facteurs de mobilité en France et au sein de l'Union européenne. Pour autant, les entreprises ont des besoins immédiats, et non dans quatre ans, de personnels formés. C'est toute la difficulté de l'articulation entre compétences et emploi. Des progrès ont déjà été réalisés puisque nous sommes passés d'un système d'habilitation – dans lequel l'État autorise la délivrance de diplômes nationaux de manière récurrente tous les quatre ans, après examen du contenu des diplômes – à un système d'accréditation. Cela fait trois ans que plusieurs universités ont intégré ce dispositif. Dans ce nouveau cadre, l'État garantit qu'un site donné peut enseigner telle ou telle discipline car il possède une recherche de haut niveau et des enseignants chercheurs en nombre suffisant. La création rapide de nouvelles formations est ainsi simplifiée.
Nous devons soutenir ces pôles d'ingénierie de formation au sein des universités, afin d'être en mesure de savoir rapidement où peuvent s'ouvrir des formations, en fonction de besoins exprimés. L'enseignement supérieur privé procède déjà de la sorte – on le voit notamment dans le secteur du numérique. Pour autant, il faut être attentif à ce que ces formations, utiles à court terme, ne manquent pas de profondeur et de base, et empêchent la poursuite ultérieure d'études ou l'adaptation au changement. Pour y répondre, les universités s'organisent afin de disposer, d'une part, d'un socle de formation garantissant à l'étudiant d'être rapidement opérationnel dans un emploi, et, d'autre part, de formations plus longues lui permettant de reprendre des études plus riches en contenus. Cela préservera l'adaptabilité, spécificité de l'enseignement supérieur. Il convient de continuer d'apprendre à apprendre, et de ne pas se limiter à apprendre des compétences. Nous soutiendrons les initiatives qui iront dans ce sens, dès lors qu'il ne s'agit pas seulement de produire des compétences instantanées, rapidement obsolètes et inadaptées.
L'adéquation entre emploi et compétences est un sujet hautement interministériel, sur lequel nous devons travailler au plus près des pôles de compétitivité, des filières industrielles et des régions. Nous devons former les jeunes là où se trouve l'emploi et les former par le biais de l'apprentissage, ce qui leur permettra de fréquenter le monde de l'entreprise et de se familiariser avec leur futur métier. Mais si les formations se rapprochent des zones d'emploi, il conviendra de ne pas oublier de créer des logements étudiants, afin que les élèves puissent venir de partout.
Vous connaissez bien le budget de mon ministère, Monsieur Hetzel. Pourtant, c'est méconnaître le système – et je sais que ce n'est pas votre cas – que de faire le lien entre les crédits de réserve de précaution et la rentrée universitaire. Une rentrée ne se prépare pas en deux mois… Dans le cadre de la procédure complexe que nous avons dû mettre en oeuvre pour la prochaine rentrée, tout a été fait pour que les universités disposant de locaux suffisants puissent accueillir plus d'étudiants.
En début d'année 2017, les autorisations d'engagement ont été ouvertes à hauteur de 23,7 milliards d'euros. Sur ce montant, nous disposons de 160 millions d'euros de crédits de paiement non ouverts à ce jour dans aucun établissement d'enseignement supérieur. Cela signifie que personne ne comptait dépenser cet argent. Il ne s'agit pas de cavalerie mais bien d'une réserve de précaution ! Je ne dis pas qu'elle ne sert à rien, car des besoins peuvent voir le jour d'ici à la fin de l'année. Nous pouvons également avoir à répondre à une catastrophe. Si tel était le cas, nous aviserions et trouverions évidemment une solution. Mais nous ne pourrons construire des locaux dans Paris pour accueillir 40 000, ou même 10 000 étudiants supplémentaires d'ici au mois de septembre…
Or le problème est clairement concentré sur Paris cette année. C'est du reste la première fois que la première année commune aux études de santé (PACES) fait l'objet d'un tirage au sort en Île-de-France. Ailleurs sur notre territoire, ce n'est pas nouveau. Cette année, l'Île-de-France connait beaucoup de difficultés. C'est sans doute ce qui explique que l'on en parle autant. En tout cas, ce n'est pas parce que le budget a été réduit que des étudiants se trouvent sans affectation. Ceux qui affirment le contraire connaissent mal le mode de fonctionnement de l'enseignement supérieur.
Monsieur Bournazel, le projet de simplification que j'ai évoqué permettra aux acteurs de construire une gouvernance adaptée, notamment à Saclay. Sur ce site, mais également à Valenciennes ou dans d'autres universités encore, les « boites » proposées n'étaient pas adaptées. Hormis cette problématique de gouvernance, Saclay est loin d'être un échec. Ce constat peut vous surprendre, mais les industries sont là – les dépôts croissants de brevets en témoignent –, les écoles et les laboratoires ont déménagé. Il convient maintenant d'en faire un véritable campus international, disposant d'une vie étudiante et d'écoles travaillant en réseau.

Depuis mars 2011, Mayotte est le cent-unième département français. Plus de 60 % de sa population a moins de vingt ans. Le taux de chômage des moins de 35 ans, et notamment des femmes, est particulièrement élevé : 47 % d'entre eux sont au chômage, faute de qualifications. Pour autant, il y a là une véritable contradiction car l'île manque de cadres et de médecins. Les jeunes Mahorais subissent une double peine : le tirage au sort et l'isolement dès l'âge de 17 ans. Au mieux, ils poursuivent leurs études à la Réunion, mais ils peuvent également être envoyés en métropole, ce qui constitue une perte de chance certaine. L'université de Mayotte, ouverte depuis quelques années, ne dispose pas de tous les attributs d'une université de plein exercice et propose un nombre limité de places. Parallèlement, la formation primaire est massivement assurée par des contractuels, locaux ou de métropole, dont le turnover est important. Serait-il possible, madame la ministre, de renforcer, voire de développer, l'université de Dembeni, mais également de professionnaliser l'enseignement primaire afin d'assurer la réussite scolaire et l'égalité des chances des élèves mahorais ?

Je voudrais revenir sur l'échec en licence et la poursuite d'études supérieures des titulaires d'un baccalauréat professionnel. Vous l'avez évoqué dans un article récent, leur taux de réussite à l'université est de 1,6 %. Ce constat pose, disiez-vous, la question des prérequis. Mais ne pose-t-elle pas également celle de l'admission dans les filières courtes, notamment dans les sections de technicien supérieur ? La loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République prévoyait, me semble-t-il, de réserver 20 % des places dans ces filières aux bacheliers professionnels.
Pourriez-vous exposer vos pistes de réflexion sur les prérequis ? Quel est par ailleurs votre sentiment sur l'opportunité de réserver des places aux bacheliers professionnels dans les filières à bac + 2 ?

Il est très important de développer de grands pôles universitaires dans les métropoles, et de soutenir l'innovation. Le fait que votre ministère soit de plein exercice et intègre l'innovation est à cet égard une excellente nouvelle. Pour autant, alors que, entre les métropoles, de nombreux territoires connaissent des situations problématiques du fait de la fermeture d'entreprises et des pertes d'emploi qui en résultent, les infrastructures restent toujours très concentrées. Pourtant, et en exagérant un peu, une start-up n'a besoin pour se développer que d'un ordinateur et de haut débit – les annonces du Président de la République en la matière sont d'ailleurs importantes. Je crains la désertification de ces territoires situés entre les métropoles. Or nous avons la chance de pouvoir y développer des emplois. Que comptez-vous faire ? Envisagez-vous des expérimentations, en relation avec les grands pôles universitaires ?

Le parlementaire et médecin biologiste que je suis souhaite vous interpeller sur la première année commune aux études de santé. Le numerus clausus date des années 70, une époque radicalement différente où l'offre médicale était pléthorique. Ce système a fait la preuve aujourd'hui de son inefficacité et de son injustice. Nous écartons en effet des étudiants brillants et motivés, qui auraient probablement fait d'excellents professionnels de santé. Parallèlement, en fin de cursus, nous recrutons parfois des personnes à la formation inégale et maîtrisant mal le français pour certaines. Envisagez-vous de supprimer ce numerus clausus ou, à tout le moins, d'en faire un plancher, et non plus un plafond ?
Madame Ali, les problèmes des universités ultra-marines sont réels. L'université de Mayotte a été créée très récemment. Elle est effectivement rattachée à l'université de plein exercice de la Réunion. C'est un vrai sujet de préoccupation, d'autant que le taux d'échec des étudiants mahorais qui quittent Mayotte est bien supérieur à la moyenne – à hauteur de 90 % à l'issue de la première année. Il convient d'aider Mayotte à grandir. Doit-on reprendre la formation à la base ou soutenir le développement de l'université ? Je pense qu'il convient au préalable de recréer un environnement favorable – en organisant par exemple une meilleure rotation des enseignants entre Mayotte, la Réunion et la métropole – , et de développer une véritable chaine de valeur. J'y travaille avec Mme Annick Girardin, ministre des outre-mer. Nous serons attentives au rôle des universités dans l'animation de leurs territoires.
Madame Lang, cinq académies expérimentent déjà la réservation de places de brevet de technicien supérieur (BTS) pour les bacheliers professionnels, sur avis du conseil d'école. Cela a permis d'obtenir un taux de réussite de plus de 60 %. Ce résultat est encourageant puisqu'il se situe au-dessus de la moyenne nationale. L'expérience va donc être prolongée et proposée à d'autres académies. Lors de la dernière réunion des recteurs, plusieurs nouvelles académies se sont portées volontaires. C'est le principe même d'une expérimentation fructueuse : elle essaime naturellement.
De façon générale, nous devrions revenir aux principes qui ont présidé à la création des baccalauréats professionnels et technologiques, mais aussi des sections de technicien supérieur (STS) et des instituts universitaires de technologie (IUT). Aujourd'hui, quelque 85 % des étudiants titulaires d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) poursuivent leurs études, alors que le marché du travail manque de salariés de niveau bac + 2 ou + 3. Vu de loin, le taux d'insertion des titulaires d'un bac + 5 est excellent, mais, de plus près, on se rend compte que la moitié d'entre eux occupe un emploi de niveau bac + 3. Le système a clairement été dévié de sa philosophie initiale.
De même, la concertation a permis de soulever un autre sujet : par le passé, les élèves passaient leur baccalauréat professionnel en quatre ans. Aujourd'hui, ils le passent en trois ans. Le monde socio-économique est favorable à une année de formation additionnelle, pour faciliter l'employabilité de ces jeunes. Nous souhaitons réfléchir sur ce point et sans doute mettre en place une année d'étude post-baccalauréat, qui permettrait ensuite la poursuite d'études supérieures courtes ou plus générales.
Madame Hérin, nous travaillons sur les territoires. Des expérimentations sont en cours, comme la délocalisation des premières années de formation à l'université dans certains lycées. Cette solution présente de nombreux avantages. Elle permet notamment d'élargir la palette de formations dans les villes moyennes, offrant ainsi de nouvelles opportunités aux élèves et aux familles, parfois peu enclines à laisser partir leurs enfants, pour des raisons financières – appartenant souvent à la classe moyenne, elles ne bénéficient d'aucun soutien – ou d'éloignement. Ces élèves, qui préparent un BTS parce que le lycée de leur ville le leur propose, ont plus tendance que les autres à poursuivre leurs études ensuite. Ce type d'expérimentation est donc intéressant. Ce serait également une façon d'amener plus d'élèves vers le supérieur, en améliorant par ailleurs leur réussite, l'ajustement lié à l'arrivée dans l'enseignement supérieur étant alors moins difficile.
Monsieur Gaultier, nous travaillons sur l'expérience menée par exemple à Angers, où il n'y a plus de numerus clausus et où les études médicales ont été pensées comme un continuum, associé aux études des sciences de la vie. Par ce biais, des médecins, des professionnels paramédicaux, mais également d'autres professionnels de santé sont formés. Cette expérimentation doit encore être menée une année – afin de couvrir un cycle complet de licence – avant que nous puissions en faire le bilan. Mais elle semble porteuse et j'y prête une grande attention. Elle pourra constituer une piste pour les doyens des facultés de médecine et les universités dotées d'un secteur médical.

Madame la ministre, vous parliez d'expérimentations. On entend régulièrement que l'École polytechnique va être séparée de l'université Paris-Sud et que les écoles d'ingénieurs vont se répartir entre les deux. Pourriez-vous nous indiquer où en est ce projet ?
Je ne vais pas me substituer aux institutions pour vous dire ce qu'elles doivent faire. Elles ont la liberté de s'organiser. Pour autant, conserver le projet initial, qui permet aux étudiants de naviguer entre l'université et les écoles, aurait du sens. Il serait dommageable que l'université se retrouve d'un côté et les écoles de l'autre. L'École polytechnique est un peu différente des autres écoles du site, puisqu'elle dispose de vingt-deux laboratoires de recherche, dont vingt et un mixtes avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Elle ressemble donc beaucoup à une université… Les écoles ont intérêt à se trouver dans un contexte universitaire « compréhensif », pour utiliser un terme américain. La polyvalence des universités est un atout face à ces écoles mono-disciplinaires. Les premières peuvent se saisir d'un défi sociétal, d'un objet technologique et l'examiner sous tous les angles disciplinaires. Les écoles tiennent à garder la main sur la sélection et leurs droits d'inscription : soit, mais l'ensemble des acteurs doit tirer parti et profit de cet écosystème.

Madame la ministre, vous avez déjà évoqué les fusions au sein des universités. Je souhaiterais quelques précisions concernant le projet qui touche l'Université Paris-Est Créteil (UPEC) et l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM). L'objectif initial consistait à optimiser leurs moyens, mais les réactions du corps enseignant ne risquent-elles pas de remettre en cause cette optimisation ?
Ma seconde question concerne le montant des frais d'inscription dans le supérieur. Ils sont, en France, parmi les moins coûteux pour l'université, alors que les frais d'inscription des grandes écoles, surtout quand on est issu des classes moyennes, sont beaucoup plus importants – je pense à Sciences Po où ils peuvent atteindre 10 000 euros par an, voire davantage. Les tarifs ne risquent-ils pas de constituer à l'avenir une variable d'ajustement ?

Merci, madame la ministre, de nous accorder de votre temps. Le programme électoral d'Emmanuel Macron évoquait les prérequis nécessaires à l'entrée à l'université. Quelles peuvent en être les modalités afin d'assurer une certaine équité sur tout le territoire, afin d'augmenter la réussite au sein des universités et, surtout, d'aider les lycées à être plus performants dans l'orientation des jeunes ? Pour améliorer le système, ne faudrait-il pas privilégier la prise en compte non plus du taux de réussite au baccalauréat mais du taux de réorientation en fin de première année d'études supérieures et donc lancer un suivi de cohorte inter-degrés, comme cela existe déjà entre le collège et le lycée ?
Emmanuel Macron veut également renforcer les voies de l'alternance. N'y a-t-il pas là une piste intéressante pour les jeunes, en particulier pour ceux issus de la filière professionnelle ? En ce sens, le campus des métiers et des qualifications pourrait être une bonne piste.

J'évoquerai l'inquiétude des universités de petite ou moyenne taille. Le projet relatif à l'enseignement supérieur met en effet en avant une quinzaine d'universités autour des grandes métropoles et pourvues de financements importants, avec la possibilité de recruter sans passer par le conseil national des universités. Or les universités de proximité – en milieu insulaire ou en milieu reculé – craignent de devenir de simples collèges universitaires. Aussi quelles garanties entendez-vous leur apporter pour préserver certaines activités de recherche notamment liées à l'employabilité dans le territoire concerné ?

Que comptez-vous faire, madame la ministre, des filières universitaires sans débouchés, comme la sociologie ? Comment aider à la réorientation de ces jeunes diplômés qui ont souvent suivi de longues études dans des disciplines aux débouchés quasiment nuls ? Cette question est importante quand on sait le coût des études et combien le chômage des jeunes est considérable, celui des jeunes diplômés étant de plus en plus d'actualité.
La fusion des universités, monsieur Bois, est le résultat, en général, d'une longue préparation ; il n'est donc pas question de revenir sur les processus enclenchés, d'annoncer à tous ceux qui y travaillent depuis des années que tout est terminé et qu'il faut repartir en arrière. Toutefois, que ceux qui considèrent le fonctionnement de leur université comme insatisfaisant fassent leurs propositions et si l'expérience valide la « boîte administrative » qu'ils suggèrent – si j'ose m'exprimer de la sorte –, cette dernière sera entérinée. J'ai vu d'assez près plusieurs processus de fusion d'universités et je sais qu'ils ne font pas toujours l'unanimité – rien ne fait d'ailleurs jamais l'unanimité – mais dès lors qu'ils ont été adoptés par une majorité, il faut les laisser aller à leur terme car, dans la plupart des cas, il s'agit de créer ces fameuses universités « compréhensives » évoquées précédemment. Quand on fusionne une université qui enseigne le droit et la médecine avec une université qui enseigne les lettres, les langues et l'histoire, et une université qui enseigne les sciences et la technologie, que fait-on sinon créer une université couvrant toutes les disciplines ? Je n'entends donc pas du tout contrarier les projets en cours depuis des années.
Vous m'avez interrogée sur les politiques tarifaires. Je me suis exprimée sur le sujet la semaine dernière alors que les droits d'inscription n'étaient pas encore fixés pour la rentrée 2017. Je ne savais alors pas s'ils seraient maintenus en l'état ou bien augmentés de l'équivalent du taux d'inflation. Le choix a été fait de ne pas les modifier. Le programme du Président de la République ne prévoit du reste pas de hausse massive en la matière et ce sera bien le cas puisque le Gouvernement met en oeuvre ce programme. Les droits d'inscription ne serviront donc pas de variable d'ajustement. Ceux des étudiants extracommunautaires sont le seul point sur lequel on peut s'interroger même s'il n'est pas à l'ordre du jour : le sujet est complexe et mérite qu'on l'examine dans le détail.
Les modalités des prérequis, madame Charrière, font l'objet de concertations en cours. Je ne peux donc pas vous indiquer quelle forme elles prendront. Je reste néanmoins persuadée qu'il faut continuer d'assurer l'accès à l'enseignement supérieur à tout élève titulaire d'un baccalauréat, droit qu'il faut garantir par un accompagnement adéquat. Je n'affirmerai pas à un bachelier qui n'a jamais fait de biologie de sa vie qu'il ne réussira jamais des études de médecine ou des études de biologie ; je lui dirai seulement : « Compare ce que tu as à faire avec ce que tu sais faire. Si vraiment tu bosses, si tu t'en donnes les moyens, pourquoi pas ! » Il faut donc lui donner les bons outils, faute de quoi il est assuré d'aller droit dans le mur. C'est ainsi que je conçois les prérequis et l'accompagnement de la réussite.
Il faut savoir que l'enseignant-chercheur qui découvre l'hétérogénéité des étudiants dans un amphithéâtre de première année vit un moment de solitude terrible. Il se demande comment faire pour parvenir à parler à tous ces étudiants venant d'horizons si différents : certains vont fuir car ils savent déjà ce que l'enseignant va dire et d'autres vont fuir aussi mais pour la raison inverse – tant ils sont loin d'avoir le niveau exigé. C'est un énorme gâchis humain, social et financier. Les prérequis dont il est question présupposent donc qu'on dise la vérité aux étudiants.
Pour ce qui est de l'apprentissage, nous y travaillons avec Jean-Michel Blanquer et Muriel Pénicaud. L'idée est de s'appuyer sur ce qui a déjà été réalisé dans les campus des métiers et des qualifications. Il s'agit de proposer des filières à des élèves qui veulent pratiquer des métiers plus que des disciplines, par exemple des métiers de l'agriculture, du tourisme… et cela aux niveaux CAP, BEP, baccalauréat professionnel ou technique, au niveau ingénieur voire au niveau du doctorat. Il convient donc de concevoir l'apprentissage avant et après le baccalauréat, tant il est vrai que les métiers concernés exigent des connaissances théoriques à mettre ensuite en pratique. Nous allons encourager l'apprentissage au sein de l'enseignement supérieur et nous songeons à mettre en place des formations où les jeunes choisiront un grand secteur et passeront des diplômes de différents grades. Là encore, il est nécessaire de beaucoup oeuvrer avec les territoires concernés afin que ce dispositif, différent, donc, du système universitaire tel qu'il existe, soit adapté aux entreprises qui prendront les jeunes en apprentissage et aux emplois qu'ils seront susceptibles d'occuper ensuite.
Il est important, monsieur Acquaviva, qu'une université trouve, si j'ose dire, sa « signature ». Quand l'université de Corte a travaillé sur son projet, en mettant l'accent sur la mer, les incendies de forêt, la culture, l'insularité…, elle a trouvé son identité. Une université n'a pas vocation à être obligatoirement dans une métropole et en interaction avec un énorme écosystème puisqu'il est bien question d'avoir des universités partout sur le territoire, en métropole comme en outre-mer. Nous ne forcerons jamais l'université de Corte à travailler avec telle ou telle autre université. Elle travaille fort bien en réseau. C'est du reste la seule université à avoir signé un contrat tripartite avec l'État et la région : il est en effet intéressant pour certaines universités de garder des diplômes d'État tout en travaillant avec la région.
J'en viens à la question de Mme Petit : aucune filière, à mes yeux, ne sert à rien. Il ne faut pas confondre les filières universitaires qui doivent fournir des cadres, des employés et des techniciens au monde socio-économique, filières qu'on ne saurait négliger, et les lieux où, à l'université, se construit la connaissance que l'on enseigne. Or la connaissance est toujours utile. Certes, on imagine moins certaines filières, comme celle que vous avez mentionnée, déboucher directement sur un emploi. Il faut le dire aux étudiants afin d'éviter qu'ils ne s'engouffrent massivement dans telle ou telle voie sans avoir conscience de ce qui les attendra. C'est pourquoi l'orientation doit être faite par des personnels sachant vraiment ce qu'on exigera des étudiants.
Je prendrai un exemple très illustratif : on n'a jamais vu autant d'étudiants s'inscrire en licence de génétique qu'après la diffusion de je ne sais plus quelle série télévisée mettant en scène la police scientifique. Tous voulaient devenir policiers scientifiques. Fort bien, leur avais-je expliqué, nous allons commencer par étudier la génétique des bactéries, puis celle des plantes avant d'en venir à la génétique humaine – il faut en effet aller du plus simple au plus compliqué. Évidemment ces étudiants n'étaient pas au bon endroit puisque lorsqu'on entame une licence de génétique, c'est vraiment pour, ensuite, mener des études universitaires au sens classique du terme.
Les universités se transforment, car elles doivent être capables de proposer des filières caractérisées par une très haute exigence conceptuelle qui permettra de produire des connaissances elles-mêmes enseignées par la suite. De cette masse de connaissances, dans quinze, vingt ou trente ans, on fera quelque chose et peu importe, même, si l'on n'en fait rien. Parallèlement, les universités doivent réussir le pari d'accueillir un maximum d'étudiants pour leur donner un accès à l'emploi. Il faut donc très clairement assumer le fait que nous n'avons pas besoin d'avoir 2 500 étudiants inscrits dans telle ou telle filière et qu'à l'inverse, il en faudrait davantage dans d'autres filières. Il faut savoir ce que l'étudiant recherche en première intention : conceptualiser ou bien occuper un emploi immédiatement ? Définir son projet professionnel n'empêche pas celui qui veut exercer un métier tout de suite de décider, plus tard, de faire une pause pour réfléchir.

Parfois ces étudiants n'ont pas la possibilité de faire cette pause à cause de son coût. Et s'ils le peuvent, nombreux sont ceux contraints de se réorienter et donc de suivre une formation, ce qui implique un coût supplémentaire.
Vous avez raison. Mieux vaut évidemment bien s'orienter du premier coup plutôt que d'avoir à se réorienter. D'un autre côté, même si la réorientation a un coût, quand j'évoque une pause, j'entends qu'on doit pouvoir revenir faire des études : lors de la dernière édition de la compétition nationale « Ma thèse en 180 secondes », un doctorant avait soixante-treize ans ; je trouve cela fabuleux.

L'exemple que vous citiez sur la police scientifique me fait penser à l'afflux de jeunes gens dans les filières de la cuisine ou de la pâtisserie, précisément à la suite d'émissions de télévision. La prochaine fois que nous auditionnerons Mme Ernotte, nous lui demanderons éventuellement de quelle manière elle pourrait envisager d'aider les enseignants dans l'orientation des élèves. Pour redevenir sérieux, au-delà du vrai rôle joué par les médias, il convient sans doute de former les enseignants à mieux orienter les élèves depuis le secondaire vers le supérieur – ceci n'est pas inné et il faut avoir le temps de s'y consacrer. Nous pourrons y réfléchir dans les mois qui viennent.

L'arrêté du 25 mai 2016 fixe le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, et notamment des doctorats obtenus par la validation des acquis de l'expérience. Il est vrai qu'une réforme fait rarement l'unanimité et celle-ci est décriée par un certain nombre d'universitaires estimant qu'elle aboutira à des doctorats « au rabais ». Elle est également critiquée par les cadres des secteurs public et privé qui regrettent de ne pas avoir obtenu la création d'un véritable doctorat professionnel. Envisagez-vous par conséquent, madame la ministre, de repenser cette réforme et envisagez-vous la création de doctorats professionnels, qui pourraient favoriser le partage d'expérience et donc le lien entre entreprises et universités ?

Nous sommes de ceux qui défendent le culte du travail, de l'effort, de la persévérance opiniâtre qui transforme les échecs en réussites, de ceux qui défendent la recherche obstinée de l'excellence et du meilleur de soi-même. Je n'emploierai pas, comme vous l'avez fait, madame la ministre, l'expression d'ascenseur social mais celle d'escalier social, car gravir un escalier demande un effort et l'on ne saurait être excellent sans effort.
L'excellence de nos universités participe du rayonnement et de l'attractivité de notre pays. Elle permet à nos jeunes diplômés d'accéder aux meilleures formations et donc aux emplois les plus attractifs. Or l'excellence de nos universités passe par leur internationalisation. Cette ouverture au monde permet non seulement d'accueillir de futurs talents et pour les étudiants français de connaître de nouvelles cultures, mais elle permet aussi de faire venir des chercheurs étrangers en France.
Au cours des quinze dernières années, le nombre d'étudiants en mobilité internationale a doublé pour atteindre 4,3 millions, soit un rythme deux fois plus rapide que celui de l'augmentation pourtant marquée de la population étudiante mondiale. Dans un contexte concurrentiel de plus en plus fort, la France continue à attirer chaque année un grand nombre d'étudiants étrangers : ils étaient 310 000 en 2015. Pourtant, notre pays perd régulièrement des places dans les classements de pays d'accueil. Nous avons besoin non seulement d'attirer un nombre important de chercheurs, mais aussi d'attirer les meilleurs. Il y a un mois, le Président de la République a rappelé son attachement à voir des scientifiques de haut niveau venir travailler en France sur les questions liées au climat. Votre ministère a alors débloqué 30 millions d'euros pour financer l'accueil d'une cinquantaine de chercheurs.
Ma question à ce propos est double : alors qu'on connaît les conditions des chercheurs en France et le sous-financement de certains secteurs de recherche, comment cette enveloppe va-t-elle être utilisée sans faire défaut à la recherche française ? Et comment favoriser de manière plus globale l'internationalisation des universités françaises pour attirer davantage de nouveaux étudiants, de futurs chercheurs prometteurs et de scientifiques reconnus ?

On a beaucoup entendu parler, au mois de juin, des épreuves classantes nationales en médecine, deux d'entre elles ayant été annulées à la suite de dysfonctionnements. Vous avez, avec la ministre Agnès Buzyn, diligenté une mission de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, chargée d'en déterminer la cause et la manière d'y répondre.
Plus largement, je souhaite vous interroger sur le bien-être des étudiants en médecine et sur le lien éventuel entre ce dernier et la forme que prennent les épreuves classantes. Vous avez évoqué l'idée qu'on pourrait confier une réflexion sur le sujet à une personnalité. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le calendrier, la feuille de route que vous souhaitez confier à cette mission et sur la personnalité qui pourrait la diriger ?

Je reviens sur l'exemple que vous avez cité au début de votre intervention, madame la ministre, au sujet de cette famille de polytechniciens dont le petit dernier ne peut ou ne veut emprunter la même voie que ses aînés. J'ai eu la chance d'aller pour ma part en classe préparatoire et l'un de nos enseignants nous disait : « Écoutez, ce ne sera pas : soit polytechnicien, soit balayeur, car sinon il y aura trop de balayeurs. » Quels moyens déployer, selon vous, pour détecter les talents chez des jeunes qui n'ont pas forcément l'idée ou la possibilité de pousser très loin leurs études ? Est-il moins compliqué d'expliquer à un polytechnicien potentiel qu'il ne sera « que » centralien ? Bref, l'orientation correcte d'un jeune talent est-elle du seul ressort des enseignants ou bien avez-vous en tête un plus large éventail de possibilités ?
Je commencerai par la réforme du doctorat, encore aujourd'hui objet de controverse. Pour renforcer les relations entre les doctorants, les laboratoires et les entreprises, nous disposons de systèmes qui fonctionnent très bien comme les conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE). Faut-il vraiment qualifier un doctorat ? Pourquoi, en effet, parlerait-on de doctorat professionnel alors qu'un doctorat est de fait très professionnalisant ? J'ai du reste longtemps été agacée de ce qu'on évoque des formations professionnelles d'un côté et des formations-recherche de l'autre, comme si la recherche n'était pas un métier. Nous devons faire en sorte que les doctorats mènent à des métiers différents, les uns académiques, les autres relevant du monde de l'entreprise. S'il faut apporter des améliorations à la réforme du doctorat, nous nous y emploierons ; cela d'autant plus que j'ai connaissance d'autres critiques que celle que vous mentionnez. Mais je ne suis pas vraiment persuadée, j'y insiste, qu'il faille créer des doctorats professionnels, ce qui par ailleurs laisserait entendre que les autres ne seraient pas professionnels – or je suis sensible aux mots.
Madame Thill, les universités sont internationales par définition. Tous les enseignants-chercheurs, tous les chercheurs travaillent rarement seuls mais plutôt en collaboration avec leurs collègues de tous les pays. Aussi les réseaux internationaux des universités sont-ils probablement les plus riches, réseaux qu'elles peuvent d'ailleurs mettre à la disposition de l'ensemble de leurs partenaires.
La France reste attrayante pour les étudiants étrangers même si elle tend à l'être un peu moins depuis quelque temps, en partie à cause de certaines exigences : de plus en plus d'étudiants étrangers viennent non seulement pour prendre des cours mais également pour mener une vie universitaire en dehors de ces cours – un point que nous pouvons encore très nettement améliorer, la venue de davantage d'étudiants étrangers étant l'un de nos objectifs.
Je rappelle que les financements destinés à faire rentrer en France des chercheurs français ou à attirer des chercheurs étrangers dans le cadre du plan climat s'élèvent à 30 millions d'euros hors budget. Cette somme a été confiée au CNRS – ce qui me paraît normal puisqu'il s'agit d'un programme national. Pour organiser au mieux l'arrivée de ces collègues, doctorants ou étudiants, il faut identifier, au sein des universités, au sein des laboratoires, des équipes de recherche qui travaillent déjà sur le climat au sens large, c'est-à-dire sous ses aspects technologiques aussi bien que géophysiques ou encore économiques, sociaux, sociologiques ou anthropologiques. L'idée n'est pas de créer des équipes ex nihilo mais, pour les universités qui travaillent déjà sur le sujet, d'offrir un environnement attrayant pour un chercheur étranger. C'est pourquoi, pour un euro financé par les organismes et les universités de recherche, l'État investira lui-même un euro. Nous entendons accueillir ainsi une cinquantaine de chercheurs, outre des doctorants et des post-docs, dans des structures où, j'y insiste, l'on travaille déjà sur ces sujets. C'est l'équivalent, en volume financier, d'un programme de recherche européen, ce qui nous paraît un bon calibre.
Ma collègue Agnès Buzyn et moi-même sommes révoltées par ce qui s'est passé le mois dernier lors des épreuves classantes nationales. Les conditions d'études et la qualité de vie des étudiants en médecine, nous le savons, se dégradent de plus en plus pour de multiples raisons. Quelque chose de grave se passe, au sein de cette population soumise à de très fortes pressions, qui conduisent parfois à la dépression. Ajoutez donc au stress du concours l'annulation d'épreuves et l'obligation de les repasser ! Nous étions donc nous-mêmes très en colère, mais il fallait bien organiser une nouvelle épreuve, ce qui a été fait. Il n'est cependant pas question d'en rester là ; une enquête conjointe de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche a été commandée, dont les conclusions seront connues au début du mois de septembre. Nous reverrons alors les étudiants.
Par ailleurs, nous voulons effectivement confier une réflexion globale sur les conditions de vie des étudiants en médecine à une personnalité, que nous n'avons pas encore choisie. Certes, ces étudiants auront au cours de leur carrière de très lourdes responsabilités et devront gérer des situations de stress intense, mais ne les plongeons pas dans la dépression dès leurs études…
Les enseignants jouent évidemment un rôle, monsieur le député Garcia, dans la détection des talents, et il est essentiel qu'ils soient formés en ce sens. Le travail des associations est aussi tout à fait remarquable. Les internats, pour leur part, donnent satisfaction, mais ils n'interviennent qu'en aval, lorsque les talents ont déjà été repérés. Il faut vraiment chercher les talents parmi les plus jeunes ; c'est au niveau du collège qu'il faut repérer ces graines de génie et les pousser à cultiver leur potentiel, les encourager à faire des études supérieures, à s'intéresser à la connaissance. Dans mon autre vie, j'avais imaginé un système « grand frèrepetit frère » : nous demandions aux collèges de nous signaler des enfants au potentiel considérable, et nos étudiants, dont nous savions que les études seraient longues, les accompagnaient. Ils les amenaient à la faculté, leur faisaient bénéficier des places de théâtre ou autres activités offertes aux étudiants par l'université. Des étudiants peuvent aussi offrir un tel accompagnement dans le cadre de services civiques ; j'en ai rencontré récemment dont le travail est remarquable. Il s'agit aussi de libérer les talents de l'autocensure ; il faut qu'il soit naturel d'aller à l'opéra, d'entrer dans une bibliothèque, d'écouter de la musique classique, etc. Une grande part de la réussite tient effectivement à la maîtrise de codes qui ne sont pas seulement dispensés par l'école.

Je souscris, madame la ministre, à votre analyse : en matière d'enseignement supérieur, tout n'est pas que budgétaire, c'est aussi une affaire d'accompagnement, mais c'est là une mission que les adultes négligent souvent. Cette responsabilité incombe pourtant à chacun d'entre nous, qu'il s'agisse d'épauler nos propres enfants ou, pourquoi pas, d'autres. Nous pourrions imaginer une forme de tutorat simple dont bénéficieraient des jeunes parmi ceux qui sont les moins suivis par leur famille ; ils éprouvent souvent un fort sentiment de solitude, de détresse. Il y a chez les jeunes un vivier de compétences inexploité, et nous devrions pouvoir proposer une aide sans que cela prenne la forme de quelque usine à gaz.
Nous sommes régulièrement interpellés par les enseignants-chercheurs à propos de la sanctuarisation du temps consacré à la recherche. En effet, 80 % d'entre eux estiment ne pas pouvoir consacrer assez de temps à ce qui est leur mission en raison du temps perdu à la recherche de financements, à des tâches de gestion ou encore à la justification des dépenses liées aux projets de recherche. Le ministère réfléchit-il à la question avec les acteurs de la recherche ? Il faudrait sanctuariser le temps consacré à cette recherche qui doit être le coeur de l'activité de nos chercheurs.

Madame la ministre, je vous ai entendue rappeler au cours de votre exposé vos compétences en matière de recherche spatiale. Depuis plus d'un siècle, les avancées audacieuses sont la marque de fabrique des pionniers de l'air et de l'espace. L'espace est un enjeu majeur sur les plans stratégique, économique, scientifique, technique ou encore éthique. Avec le soutien du Président de la République et du Gouvernement, le Centre national d'études spatiales assume la responsabilité de programmes clés pour la recherche spatiale française : Ariane 6, le satellite de mesure du méthane atmosphérique Merlin et les projets d'exploration de Mars. Par ailleurs, le développement d'usages et d'applications issus de solutions spatiales est un enjeu majeur pour les secteurs public et marchand.
Pouvez-vous donc nous éclairer, madame la ministre, sur la feuille de route de votre ministère pour que la recherche aérospatiale française, d'une part, invente l'espace de demain et, d'autre part, s'associe au programme Make our planet great again ? Et comment développer les usages du spatial en lien avec nos entreprises et nos territoires, dans les domaines tant de l'agriculture de précision que des prévisions météorologiques, des prévisions des risques naturels ou de l'adaptation au changement climatique ?

Madame la ministre, je voulais vous demander si les baisses de crédits en 2017 auraient un impact sur le programme prioritaire de recherche sur la lutte contre le changement climatique, mais vous avez indiqué que ledit programme avait un caractère extrabudgétaire ; me voici donc rassuré. Cela étant, ne devrait-il pas être mené conjointement avec un projet pédagogique pour favoriser une éducation de nos concitoyens à la protection de notre environnement ?

Je vous remercie, madame la ministre, pour vos réponses claires et très positives. J'apprécie particulièrement que vous parliez de nos étudiants comme d'un investissement pour l'avenir – j'élargirai simplement le propos : c'est l'ensemble de notre jeunesse qui est un investissement pour l'avenir – et je salue la volonté du Gouvernement de faire de la réussite des étudiants une priorité de ce quinquennat.
Je connais votre ambition particulière pour la voie professionnelle, dont vous avez parlé. Il est effectivement indispensable de redonner ses lettres de noblesse à cette filière. Dans votre feuille de route, vous proposez la création de diplômes de qualification à bac+1, et vous avez précisé tout à l'heure que cette idée émanait du monde socio-économique, mais pouvez-vous en préciser la finalité ? S'agit-il simplement de valoriser la sortie du système éducatif et de favoriser l'embauche des étudiants qui le quittent ? Ou bien s'agit-il d'offrir aux bacheliers professionnels la possibilité de se mettre à niveau afin de poursuivre et réussir des études supérieures au-delà des seules sections de techniciens spécialisés ?

Je vous remercie, madame la ministre, pour vos propos sur la désaffection des filières scientifiques. Y remédier est une lutte au quotidien en même temps qu'un combat de longue haleine. C'est aussi l'une des priorités de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Quelles seraient les modalités d'une action complémentaire pour développer le plus possible, aux différents niveaux scolaires, la culture scientifique ?

Je me réjouis, madame la ministre, d'entendre que vous voulez refonder complètement les projets de formation et la voie professionnelle, éventuellement jusqu'au doctorat.
Vous avez aussi exprimé de l'intérêt pour la délocalisation des formations. Pour le moment, elles disparaissent plutôt des territoires ruraux au profit des zones urbanisées. Cela pose des difficultés aux entreprises de ces territoires. Rencontrant déjà des difficultés de recrutement, elles craignent de ne plus trouver de salariés qualifiés du tout si les formations professionnelles du niveau BTS disparaissent, par exemple dans le domaine de l'électricité. Une fois les jeunes partis étudier dans les grandes agglomérations, ils reviennent très difficilement travailler dans un milieu rural.
Madame la députée Mörch, le merveilleux métier de chercheur ou d'enseignant-chercheur est assez atypique : on y cherche beaucoup… de quoi travailler. Ce n'est pas banal, mais ce n'est pas en France que les chercheurs sont les plus mal lotis ; il est d'autres pays où ils cherchent d'abord… leur salaire. Il n'en est pas moins vrai que toutes ces démarches de justification sont de plus en plus lourdes. Il me paraît donc important de simplifier et de faire confiance a priori, pour vérifier ex post, mais il faut alors disposer d'éléments relativement exempts d'erreurs de gestion et de justification.
Pour progresser, il faut donc que le contrôle ex post soit possible – je parle là du contrôle financier et comptable qui s'impose, car il est parfaitement normal de rendre compte de l'usage que l'on fait de l'argent public. C'est un vrai sujet, auquel il faut travailler. Mon objectif est que nous puissions libérer du temps de recherche, mais je n'ai pas de solution miracle. Peut-être faudrait-il déjà que tout le monde utilise les mêmes logiciels de gestion ; cela éviterait par exemple de devoir en maîtriser trois différents dans un laboratoire à trois tutelles. Des réflexions et démarches de ce type ont déjà été lancées avant ma nomination, il faut aller plus loin.
Effectivement, madame la députée Rixain, Ariane 6 est le programme européen phare, d'une importance cruciale, car il nous offre un accès autonome à l'espace. Comme vous le savez, nous avons des concurrents, comme le lanceur SpaceX, réutilisable – le coût de lancement est donc deux fois moins élevé qu'avec Ariane 6. Il faut donc vraiment des tirs institutionnels européens avec Ariane 6. Ensuite, il faut soutenir l'innovation dans toutes les filières spatiales. Si nous pensons de nouvelles formes de moteur, si nous innovons sur le plan des matériaux, et pas seulement, nous retrouverons un avantage compétitif dans cet univers de plus en plus concurrentiel des lanceurs – on en annonce aussi en Chine. Continuons à soutenir fortement tous ces projets pour avancer, pour innover, pour préserver notre souveraineté en matière d'accès à l'espace. Et, comme je le disais tout à l'heure, il est aussi très important que les gens se rendent compte de tout ce que cet accès à l'espace leur apporte dans leur vie quotidienne. Son importance en matière de météorologie est à peu près comprise, mais cela vaut pour nombre d'autres domaines.
Bien sûr, le plan climat intègre cette dimension spatiale, mais n'oublions pas non plus la question des données, qui seront probablement à l'origine du prochain boom économique. Il faut inventer et innover en matière d'usages mais la quantité de données brutes acquises grâce aux programmes spatiaux vaut probablement de l'or. Il faut maintenant être capable de les traiter, d'en faire quelque chose, d'en faire un business. Cela vaut évidemment de l'or pour la recherche aussi.
L'agence spatiale européenne est un très bel outil, l'exemple même de l'une de ces très grandes infrastructures de recherche qui ne sont possibles que grâce à l'action conjointe et au financement de très nombreux pays ; seuls, nous serions aujourd'hui absolument incapables d'avoir une politique spatiale – ce serait beaucoup trop cher. La politique spatiale donne encore un peu plus de sens à l'Europe, à supposer que cela soit nécessaire.
La désaffection des filières scientifiques est fort ancienne, et, en fait d'explications, chacun avance la sienne propre. Sans doute une licence de mathématiques ou de physique fait-elle moins rêver qu'une licence de psychologie ou de sociologie, peut-être parce qu'on ne montre pas suffisamment tout ce que ces disciplines apportent, tout ce qu'elles peuvent expliquer, tous les objets de la vie quotidienne qu'elles ont rendus possibles. Je suis pour ma part persuadée qu'une part de la solution consistera à réenchanter la relation entre la société et les sciences ; ce lien s'est cassé. Aujourd'hui, la majorité des gens voient le chercheur comme un apprenti sorcier. Quand ils pensent sciences, ils pensent effets secondaires des vaccins, organismes génétiquement modifiés – uniquement des choses négatives. Par ailleurs, ils confondent vérité scientifique et croyance ; avoir une opinion, c'est bien, mais une opinion n'est pas un fait scientifique.
Peut-être cela tient-il à la gestion de l'information, l'information non hiérarchisée est tellement abondante… Je le disais tout à l'heure : il faut d'abord apprendre à hiérarchiser l'information – cela vaut même pour les enfants les plus jeunes. La désaffection tient peut-être aussi au nombre des filières d'ingénieurs, que beaucoup d'étudiants préfèrent finalement aux filières plus académiques. Au bout du compte, nous avons beaucoup de mal, dans les disciplines scientifiques, à trouver des enseignants pour le primaire et le secondaire, et les enfants ne sont pas motivés ; c'est un cercle vicieux. Il faudra y réfléchir, mais ce réel problème n'est pas spécifiquement français, c'est un fait de société européen et mondial : la désaffection pour les études scientifiques est générale.
Oui, madame la députée Dubois, il nous faut, je l'ai dit, une offre de formation supérieure la plus diversifiée possible, avec le maillage le plus serré sur l'ensemble du territoire. Cependant, tout cela a un coût très important – par exemple, toute antenne d'université, où que ce soit, requiert un minimum d'administration –, même si une utilisation judicieuse des outils numériques le réduit. Le coût n'est pas non plus le même si nous travaillons sur de tels projets avec les territoires concernés : il faut que le coût d'installation d'une antenne spécifique d'une université sur un sujet donné soit vraiment partagé avec le territoire, dans la mesure où cette antenne y stimulera l'emploi et l'économie. Si le coût est entièrement assumé par l'établissement supérieur, donc à la charge de l'État, cela devient vraiment compliqué. Il me paraît essentiel que toutes les universités aient une relation privilégiée avec leur territoire, c'est ce qui permettra de développer une formation très spécifique dans un cadre très précis : une formation autour des arômes et des parfums à Grasse, un projet sur le cinéma et le storytelling à Cannes, etc. Si tout reste à la charge de l'établissement d'enseignement supérieur, la tendance sera plutôt à la concentration, d'autant que toute antenne isolée tend à se détacher et à devenir autonome, ce qui pose notamment des problèmes de suivi. Trouvons de nouveaux modèles économiques, et ce sera possible.
Madame la députée Rilhac, les deux possibilités que vous évoquez pour le diplôme de bac+1 sont envisageables. Il est prévu que l'on puisse mettre en place des certifications particulières d'employabilité, avec les filières et les branches. Émergent également, dans le cadre des discussions et concertations sur l'accès à l'enseignement supérieur, des propositions reprenant le principe d'une année de propédeutique comme il en existait auparavant, d'une année« zéro » ou d'une année « un demi », dont l'objet consisterait à la fois en une part de remédiation et en un début d'enseignement de première année. Je ne préjuge pas de l'issue des travaux, et je ne suis pas certaine qu'un modèle unique doive s'imposer. Des universités pourront proposer des années de propédeutique, d'autres des systèmes mixtes, avec des licences en quatre ans.
Un bilan des discussions sera probablement fait à la fin du mois d'août, et des groupes de travail se réuniront au mois de septembre. Sans doute aurons-nous quelque chose d'à peu près abouti au mois d'octobre. Cela nous laissera le temps de préparer la rentrée à peu près sereinement.

Une dernière question, madame la ministre…
Votre exposé a mis en exergue les problématiques liées à l'enseignement supérieur. Celle du taux d'encadrement compte parmi les plus fondamentales, avec non pas des titularisations mais des suppressions de postes préoccupantes. Depuis 2015, la faculté de droit de Toulon, où je suis maître de conférences, a perdu huit postes à la suite de départs à la retraite – les départs ne sont jamais tous remplacés et le phénomène s'est encore renforcé à la suite de la mise en place de l'autonomie des universités. Alors que nous sont annoncés des flux démographiques importants, les heures complémentaires ne connaissent plus de limites, au détriment de la recherche, non plus que le recours à des professionnels n'appartenant pas au monde académique pour assurer des enseignements. Ma question est simple : quelles mesures envisagez-vous pour maintenir un encadrement de qualité, du point de vue tant de l'enseignement que de la recherche ? Surtout, comment réduire le nombre de ces suppressions de postes récurrentes ?
La réponse ne se trouve certainement pas du côté du ministère, madame la députée. Les politiques de recrutement sont menées par les présidents d'université, en fonction, certes, des budgets à leur disposition – j'en suis bien consciente –, mais aussi des priorités qu'ils souhaitent. Je ne me prononcerai donc pas sur les choix faits par l'université de Toulon.
Le taux d'encadrement est cependant un vrai sujet. Les universités accueillent de plus en plus d'étudiants, et le taux d'échec en première année reste considérable. Il faut donc réexaminer la question de l'accès à l'université et toute l'organisation du premier cycle. Nous devons aussi cerner les besoins des établissements et nous demander comment ils mettront la réforme en oeuvre.
Je ne me permettrai pas de m'exprimer à la place du président de l'université de Toulon, mais il est possible d'organiser de différentes façons l'offre de formation, par exemple pour éviter le gel d'emplois. Et le développement des ressources propres, celui de la formation continue, la mise en place des formations en apprentissage sont d'autres leviers d'action désormais à la disposition des présidents et conseils d'administration des universités.
La séance est levée à dix-neuf heures.
Présences en réunion
Réunion du mercredi 19 juillet 2017 à 16 heures 30
Présents. - M. Jean-Félix Acquaviva, Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, Mme Emmanuelle Anthoine, M. Gabriel Attal, Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Berta, M. Pascal Bois, M. Pierre-Yves Bournazel, Mme Céline Calvez, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Fabienne Colboc, Mme Béatrice Descamps, Mme Jacqueline Dubois, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Frédérique Dumas, Mme Nadia Essayan, M. Alexandre Freschi, M. Laurent Garcia, M. Jean-Jacques Gaultier, M. Raphaël Gérard, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, M. Régis Juanico, M. Yannick Kerlogot, Mme Anne-Christine Lang, M. Michel Larive, M. Gaël Le Bohec, Mme Constance Le Grip, Mme Brigitte Liso, Mme Josette Manin, Mme Sophie Mette, Mme Frédérique Meunier, M. Maxime Minot, Mme Sandrine Mörch, Mme Maud Petit, Mme Béatrice Piron, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Pierre-Alain Raphan, M. Frédéric Reiss, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Cédric Roussel, Mme Sabine Rubin, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Agnès Thill
Excusés. - M. Lénaïck Adam, Mme Annick Girardin, M. Franck Riester, M. Thierry Solère, M. Stéphane Testé, M. Patrick Vignal