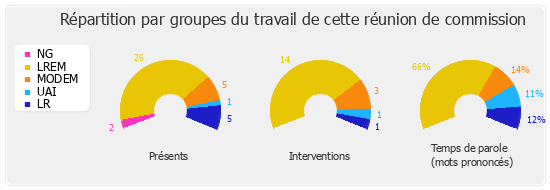Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du mardi 13 février 2018 à 17h05
Résumé de la réunion
La réunion
puis de
M. Laurent Saint-Martin,
Vice-président
La commission entend M Thomas Cazenave, délégué interministériel à la transformation publique.

Notre commission souhaitant faire le point de la transformation publique et de la modernisation numérique de l'État, questions à fort enjeu budgétaire, nous avons le plaisir d'accueillir M. Thomas Cazenave.
À l'occasion de la loi de finances pour 2018, a été créée une mission intitulée « Action et transformation publique », dotée de 700 millions d'euros d'autorisations d'engagement (AE) sur cinq ans.
Jusqu'en novembre, cette politique était portée par un secrétariat général en charge de la Modernisation de l'action publique (MAP), qui avait tenté de succéder à la Révision générale des politiques publiques (RGPP). Désormais, sous l'appellation « Action publique 2022 », l'objectif qui lui a été fixé est – notamment – de baisser de 3 points la part de la dépense publique dans le PIB d'ici à 2022. C'est un objectif ambitieux, dans la mesure où il est très difficile de réduire durablement la dépense publique dans notre pays.
J'ai demandé au délégué interministériel à la transformation publique, récemment nommé, M. Thomas Cazenave, de venir nous expliquer sa façon de travailler, la méthode suivie, et les différences qu'il peut y avoir avec les méthodes du passé. Nous entendrons ensuite M. Henri Verdier, directeur de la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État (DINSIC).
Le Gouvernement a effectivement annoncé en octobre le programme « Action publique 2022 », qui poursuit trois objectifs : premièrement, renforcer l'efficacité de l'action publique, l'efficacité et la qualité de nos services publics, deuxièmement, améliorer les conditions d'exercice des missions des agents publics, troisièmement, accompagner la baisse de la part de la dépense publique dans le PIB.
Pour construire ce programme, nous avons tiré au moins trois leçons des expériences du passé.
D'abord, nous avons voulu éviter l'écueil du paramétrique, ou du rabot, au profit d'un questionnement sur les politiques publiques, leur efficacité et leur mise en oeuvre. Voilà pourquoi nous privilégions les mesures structurelles aux mesures d'ajustement.
Ensuite, nous avons acquis la conviction qu'il fallait absolument responsabiliser les ministères dans la conduite du programme de transformation, en faisant en sorte que la réflexion ne se fasse pas exclusivement en interne et ne se replie pas, en quelque sorte, sur elle-même. Voilà pourquoi le Gouvernement a lancé un travail autour de « CAP 22 », un groupe d'experts, une commission coprésidée par Véronique Bédague-Hamilius, Frédéric Mion et Ross McInnes. Et par ailleurs, pour prévenir un « entre-soi » administratif, nous avons institué le « forum de l'action publique », pour associer à la réflexion les agents publics et les usagers.
Enfin, comme il n'était pas non plus question de réduire ce travail de réflexion à un huis clos d'experts, nous avons décidé de ménager, par un système d'allers et retours permanents, un dialogue entre les ministères et « CAP22 ». C'est cela qui forge, selon moi, l'originalité de la démarche. Le comité a été lancé en octobre 2017, et il rendra ses conclusions au Premier ministre à la fin du mois de mars 2018.
À côté de ce travail sur les grandes politiques publiques, nous avons engagé cinq chantiers interministériels qui visent à revoir le fonctionnement-même de l'action publique. Il n'y aura pas de réforme structurelle profonde tant que nous n'aurons pas, d'une certaine manière, rebâti les fondements de l'action publique. J'entends par là le cadre de gestion des ressources humaines, c'est-à-dire le contrat social entre les agents publics et l'administration ; les systèmes d'information et la transformation digitale de l'action publique ; la qualité du service public au service des usagers – en lien avec le projet de loi sur l'État au service d'une société de confiance (« ESOC ») ; enfin, l'organisation interne de la gestion budgétaire et comptable. Tel est l'armement du dispositif.
Parallèlement – et c'est un élément très structurant de la démarche – le Gouvernement a souhaité que l'on se dote d'une capacité d'investir pour transformer. Ainsi 700 millions d'euros seront dédiés à l'accompagnement des administrations et des opérateurs qui, pour réaliser des économies pérennes, ont identifié la nécessité d'investir. C'est assez inédit, parmi les programmes de transformation et de réforme de l'État ou de l'action publique.
Tel est le cadre dans lequel nous nous inscrivons.
Le premier comité interministériel à la transformation publique s'est réuni le 1er février, autour des grands chantiers transversaux.
Je l'ai déjà dit, il n'y aura pas de grande réforme structurelle dans les champs ministériels, si l'on n'a pas, auparavant, ouvert les chantiers, à commencer par celui du contrat social. En d'autres termes, la transformation publique n'aura lieu que si les agents et les managers publics ont confiance, et portent cette transformation publique. Comme il y a, de part et d'autre, de l'insatisfaction, il faudra rebâtir le contrat social pour pouvoir avancer.
De la même façon, il n'y aura pas de transformation profonde de l'action publique sans transformation digitale. C'est le deuxième enjeu du comité interministériel.
Le troisième enjeu est la restauration de la confiance entre les usagers et l'administration. Pour regagner cette confiance, l'administration doit s'engager à publier, en toute transparence, les résultats de l'ensemble des services publics et des enquêtes de satisfaction qu'elle conduit.
Voilà donc, monsieur le président, le cadre dans lequel s'inscrit Action publique 2022. Le prochain rendez-vous est fixé au mois d'avril, puisque la commission « CAP 22 » rendra son rapport fin mars. Cela permettra au Président de la République et au Premier ministre de prendre des arbitrages dans des champs de politiques publiques.

Pour transformer l'action publique, on a eu recours à de nombreuses méthodes.
Des stratégies ministérielles de réforme avaient déjà associé, à une certaine époque, des personnalités venues de l'extérieur, sur le fondement des propositions faites par les ministères eux-mêmes. Mais cela signifiait tout de même qu'on allait chercher les bonnes idées de restructuration, aussi bien en termes de productivité et de réformes structurantes, dans les administrations elles-mêmes, d'où la nomination de secrétaires généraux dans les ministères.
Puis il y a eu des temps faibles. Des audits de modernisation ont été conduits uniquement sur la base d'audits, sans chaînage avec la décision.
La RGPP a été une tentative beaucoup plus puissante, assortie d'objectifs précis : réduire les dépenses, augmenter la productivité, le plus emblématique étant le « un sur deux », c'est-à-dire le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Ce n'était pas « un sur deux » par ministère, par mission, mais « un sur deux » globalement, donc parfois « deux sur trois », voire des embauches. C'était le contraire du « coup de rabot ».
L'idée était que la décision devait être prise assez vite. Alors que notre système public avait été « sur étudié » pendant de longues années – rapports de l'Inspection des finances et des autres inspections, de la Cour des comptes, missions parlementaires, etc. – il s'agissait plutôt de décider, puis d'organiser la consultation, la concertation, l'explication au sein de la décision. Les résultats ont été assez spectaculaires, même si la crise a évidemment gêné le développement de cette RGPP.
Lui a succédé la MAP, qui a été davantage un temps d'attente que de décision.
Je voudrais insister sur cet aspect de la décision. Je l'ai dit, on a beaucoup étudié l'administration, sa manière de faire, et l'organisation des uns et des autres. On a maintenant besoin de productivité. Le numérique le permet, ce qui n'était pas le cas il y a dix ans. Les champs de productivité sont très importants. Mais je m'interroge sur les 700 millions d'euros. Peuvent-ils permettre de financer le surcoût en termes de masse salariale qu'entraînent toujours, au départ, les fusions d'administrations, les régulations, ou la mise en cohérence des règles de gestion ? Sont-ils destinés à financer uniquement des investissements d'ordre informatique ou d'autre nature ?
Ensuite, comptez-vous, ou pas, associer le Parlement à cette démarche essentielle ? Et si oui, comment ?
Pour ma part, je crois qu'il faut vider de sa substance politique – au mauvais sens du terme – toutes les démarches de réforme de l'État. On peut y mettre un contenu de gauche, du centre, un contenu de nulle part, un contenu de droite. Mais la méthode doit rester la même. J'aimerais donc que l'on évite, à chaque gouvernement, de changer de méthode, de réinventer la roue et de répéter ce qui a déjà été dit.
J'ai été secrétaire d'État à la réforme de l'État – assez invisible – sous Jacques Chirac. J'ai essayé de bien faire mon travail, comme chacun d'entre vous l'aurait fait. J'étais tout fier de moi, mais un vieux monsieur – je ne sais plus qui – est venu me voir. Il a sorti de sa serviette un journal des années 1930, où on lisait grosso modo ce que j'avais dit la veille en conférence de presse ! J'ai compris qu'il fallait faire preuve d'humilité. Le processus est long : on réformera l'État tant qu'il y aura un État, l'administration tant qu'il y aura une administration. Et on se posera toujours ces questions, tant qu'il y aura de la vie. La vérité, c'est que cela nécessite une permanence de méthodes qui deviennent, au fur et à mesure des gouvernements et des parlements qui se succéderont, « la » méthode.
La RGPP aurait pu être celle-là dans une version numéro 2, numéro 3, étendue à l'ensemble des dépenses publiques. Pourquoi pas ? Il aurait fallu la faire évoluer, et en sortir plusieurs versions. Mais de toutes les façons, à un certain moment, il faut décider. Le pire, c'est le manque de décision. J'incite donc tous les animateurs de cette politique, ou de cette autre politique de réforme de l'État, à être très proches de la décision.

Après cet acte d'humilité public et ministériel, je souhaite interroger M. le délégué interministériel sur le fonctionnement concret de ce fonds pour la transformation de l'action publique.
J'aimerais comprendre les procédures selon lesquelles les projets financés par le fonds vont être sélectionnés. C'est un peu une réponse à une partie de la question que posait le président Woerth à l'instant. Les AE ont été réparties entre quatre natures de dépenses : fonctionnement, investissement, interventions et opérations financières. Chaque dépense est dotée, pour 2018, de 50 millions d'euros. Comment cette répartition s'est-elle faite et à quoi correspond-elle ?
Ensuite, il a été indiqué que la priorité irait au projet de transformation de l'État et de ses opérateurs. Pourquoi avoir réservé cette priorité à l'État et à ses opérateurs ?
Vous jouez un rôle important, comme le président l'a rappelé à l'instant, dans la transformation publique et dans la trajectoire des finances publiques, dont la traduction est tout de même la loi de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022. Celle-ci porte, dès 2019, une inflexion forte des niveaux de dépense publique par rapport à la richesse nationale. Comment tout cela s'inscrit-il dans la trajectoire que nous avons votée, et pour une fois amendée de façon assez importante par rapport à la loi de programmation précédente ?
Enfin, compte tenu de ces enjeux de finances publiques, comment s'articulent les mesures de transformation à court terme et les mesures de transformation profonde, voire de long terme, de l'action publique que vous mettez en oeuvre ?

Ma première question porte sur le numérique. On a souvent mis en avant que la numérisation des services publics permettrait de faire des économies, de rationaliser des processus qui s'empilaient et finissaient par manquer de cohérence, et parfois de réduire le nombre des postes. Avez-vous une feuille de route pour les nouveaux usages, les nouveaux services, les nouveaux points d'accès, la médiation numérique, les nouveaux outils numériques, tout ce qui peut améliorer la qualité du service rendu, permettre son suivi et assurer la cohérence entre les différents services publics ?
Ma deuxième question porte sur les allocations simplifiées, l'allocation universelle, ou tout ce qui concerne le soutien social et l'accès aux droits des populations les plus en difficulté. Nous savons que la complexité d'accès à certains des droits que nous votons à l'Assemblée réduit les taux de recours. Vous parlez de la qualité du service public : l'accès aux droits est-il un indicateur que vous allez suivre de près ?
Ma troisième question a trait à l'organisation territoriale des services publics, sur laquelle Jean-René Cazeneuve va sans doute revenir. Les collectivités territoriales auront-elles accès au financement de la transformation de leur action ? Bénéficieront-elles d'un vrai soutien lorsqu'il s'agira de mener à bien l'optimisation au niveau local et la réorganisation de la présence de l'État ? Malgré de très nombreux points de contact, certains Français trouvent que les services publics sont trop loin de chez eux. Comment progresser en la matière ?

La transformation numérique a indéniablement des effets sur la productivité et sur la qualité de service. Cela peut se traduire, et cela se traduit déjà, par des fermetures de sites de services publics. La fermeture d'un certain nombre de trésoreries publiques, en particulier dans les territoires ruraux, en est un exemple criant.
Associée à de nouvelles formes de travail, cette transformation pourrait, à l'inverse, permettre de déconcentrer les services de l'État et, une fois que le numérique sera installé partout, amener dans les plus petites villes de province des services qui sont aujourd'hui assurés dans les métropoles ou dans les ministères. A-t-on engagé une réflexion à ce sujet ?

J'ai bien entendu quelles étaient vos trois priorités. J'ai bien entendu aussi qu'on n'allait pas faire de quantification. Mais si je me rapporte à votre troisième priorité, qui est d'accompagner la baisse des dépenses publiques, j'imagine bien que l'on va évaluer le nombre des fonctionnaires, qui sera amené à voir diminuer. D'ailleurs, j'ai bien apprécié ce qu'a dit tout à l'heure Éric Woerth, à savoir qu'il fallait faire preuve de beaucoup d'humilité vis-à-vis de ces politiques auxquelles chacun s'essaie depuis des années.
Quoi qu'il en soit, avez-vous un élément objectif à nous donner ? Correspond-il à ce qu'a annoncé Emmanuel Macron pendant la campagne, à savoir que 120 000 postes de fonctionnaires seraient supprimés ?
L'efficacité de l'action publique figurant parmi vos objectifs, il est fondamental de savoir qui fait quoi. Que feront demain les collectivités territoriales ? Que gardera l'État ? Si l'on prend quelques exemples du quotidien, notamment ce qui s'est passé pour les cartes d'identité et pour les passeports, dont la délivrance a été transférée aux communes, on s'aperçoit qu'il peut se créer un décalage entre les besoins des usagers, et l'intérêt de l'État. Nous avons donc besoin d'une réponse approfondie. Tant qu'on ne saura pas quel est le nouveau périmètre, qui fait quoi, et comment on entend rapprocher nos concitoyens de l'action publique, on n'y arrivera pas.
Le président Woerth s'est interrogé sur l'investissement de 700 millions d'euros. J'aimerais également avoir des précisions. Cette somme servira-t-elle uniquement à installer tous les équipements numériques nécessaires dans les administrations d'État et les services déconcentrés ? Et les tuyaux ? Dans le monde rural, c'est une question centrale. Prenons l'exemple des permis de construire d'un bâtiment public important : ils doivent être déposés en quatre exemplaires, ce qui représente 80 cm de haut ! Actuellement, l'État refuse de les accepter. Or, avec les tuyaux, on peut les dématérialiser : voilà un bon moyen de simplifier les relations entre les collectivités et l'État.
Enfin, vous n'avez pas repris les mots du ministre, à propos des « départs volontaires », qui devraient intervenir rapidement. Cela n'apparaissant pas parmi les trois priorités de l'État au moment où le dialogue s'engage, je voudrais savoir ce qu'il y a derrière ces mots, et où l'on en est.

J'avoue que je suis un peu étonné par la méthode. Alors qu'on nous a demandé d'organiser des réunions sur le programme « Action publique 2022 », ce que j'ai fait dans mon territoire, un texte sur le droit à l'erreur, la dématérialisation et la simplification vient d'être adopté. J'ai un peu de mal à m'y retrouver…
On nous fait travailler : j'ai ainsi participé samedi dernier à une réunion avec des représentants des collectivités, des chambres de commerce, de la chambre de métiers, de la Banque de France, etc. Allez-vous vous en servir ? Pouvons-nous apporter quelque chose, en tant que députés de terrain ? Cela nous ramène à ce que disait le président Woerth tout à l'heure. Pour ma part, je considère qu'il n'est pas utile de faire croire aux gens qu'ils peuvent avoir une quelconque influence si, finalement, leur travail n'est pas pris en compte.
Enfin, la question de la fracture numérique me taraude. Si l'on veut y mettre fin, il faudrait engager une grande réflexion, qui porterait plus particulièrement sur les servitudes d'utilité publique, les réseaux, l'ensemble des tuyaux qui vont passer dans les territoires, voire sur la mutualisation des antennes pour éviter leur multiplication entre Orange, SFR, Free, etc. Il y a des carences dans notre droit, et il serait intéressant d'y remédier.

Le numérique, la transformation de l'État, c'est un peu la tarte à la crème de l'action publique depuis vingt-cinq ans ! Dieu sait le nombre d'échecs retentissants que nous avons essuyés lorsque l'État a souhaité instiller une culture numérique dans ses transformations. Je pense notamment à des programmes informatiques qui ont coûté très cher et se sont révélés totalement inapplicables parce que les progiciels utilisés étaient généralement faits pour le secteur privé et s'adaptaient mal à la manière de fonctionner du secteur public.
Envisagez-vous donc de réfléchir à la façon dont on a conduit ce type de chantiers au cours de ces vingt-cinq dernières années, précisément pour éviter de reproduire les mêmes erreurs, qui aboutissent généralement à un beau rapport de la Cour des comptes, expliquant que cela a coûté trois fois plus cher que prévu et que les gains de productivité n'étaient pas au rendez-vous. Il faut dire que les gains de productivité sont le plus souvent absorbés par une hausse de la qualité de service rendu au public. En fin de compte, la transformation numérique dans les modes de travail ne se traduit pas de façon flagrante par une amélioration de la qualité de vie des agents.
Ma seconde question porte sur la ruralité. En matière d'administration, il y a tout de même deux France : l'une qui a accès au haut débit, l'autre pas. Dès que l'on parle de dématérialisation, notamment des services publics, on ne peut que se poser la question de l'accès au numérique. Allez-vous l'aborder différemment en fonction des zones géographiques ?
Ne serait-il pas temps de considérer l'accès au numérique comme un service public, à l'instar du téléphone ? Aujourd'hui, le numérique, c'est comme le chemin de fer autrefois, il est essentiel à la transformation publique et à la transformation de l'action de l'administration. Il nous faut donc créer une mission de service public d'accès au numérique. Tous les Français doivent pouvoir effectivement accéder aux services de cet État 100 % numérique. Cela passerait évidemment par la désignation d'un acteur chargé de porter cette politique et par la prise en charge des coûts. N'est-ce pas cela la condition première ?
Monsieur le président, le Gouvernement a entrepris ce programme et donné comme conditions de sa réussite qu'il soit rythmé par des prises de décision régulières. D'ailleurs, deux mois après son lancement, il a fait l'objet, le 1er février, d'un premier comité interministériel de la transformation publique qui a ouvert des chantiers fondamentaux.
La rénovation du cadre des ressources humaines est un de ces grands chantiers interministériels. Vous avez évoqué la mobilité, les perspectives de carrière, le dialogue social, les rémunérations. Ce sont des sujets majeurs, des leviers pour réussir la transformation publique. Voilà pourquoi le Gouvernement a souhaité commencer par les chantiers transversaux avant d'entamer les champs ministériels. Ce seront donc bien ces comités interministériels qui rythmeront ce programme, à échéances régulières – le premier le 1er février, le prochain en avril.
Vous avez aussi posé la question de la doctrine d'emploi des 700 millions d'euros du programme de transformation de l'action publique. Le choix qui a été fait est de dédier cette enveloppe à l'accompagnement des transformations susceptibles de dégager des économies et d'améliorer la qualité du service. Cette enveloppe peut tout à fait servir à financer des projets de nature informatique parce qu'ils amènent assez classiquement des gains de productivité, parce qu'ils permettent de créer de nouveaux usages, de financer des mutualisations de services ou d'accompagner la réorganisation de services. Ce programme d'investissement a donc été conçu dans une acception extrêmement large.
Pour répondre à la question de M. le rapporteur général sur la procédure, nous avons lancé le premier appel à projets le 1er février, pour une sélection qui s'opérera au printemps. Les administrations et les opérateurs ont jusqu'à la mi-mars pour faire des propositions à la commission, qui est placée sous la présidence du ministre en charge de l'action et des comptes publics, et associe des représentants de l'administration ainsi que des personnalités qualifiées. Quant au comité de pilotage, il est en voie de constitution. Les critères d'éligibilité des projets et la nature de leur contenu sont relativement ouverts, de manière à permettre le plus grand nombre d'initiatives, l'objectif étant de dégager des économies durables et d'améliorer significativement la qualité du service. En ce qui concerne le fonds, il doit être réservé dans un premier temps à l'État et à ses opérateurs pour accompagner leur transformation.
Vous m'avez également interrogé, monsieur le rapporteur général, sur l'équilibre entre les réformes conjoncturelles et les réformes structurelles. Le Gouvernement a d'abord souhaité lancer le chantier des réformes structurelles, estimant qu'il ne pouvait y avoir de transformation pérenne si l'on ne crée pas les conditions qui permettent au service public de s'adapter aux attentes des usagers et des entreprises et à un processus de réforme de l'action publique qui, au bout du compte, comme le faisait observer votre président, est un exercice permanent. Il s'agit donc d'introduire de la souplesse dans le système pour lui permettre d'être plus réactif et de se transformer le plus rapidement possible.
Madame de Montchalin, je vous rejoins sur l'idée que l'ambition numérique ne peut se limiter à la dématérialisation des procédures administratives existantes. Si nous nous sommes fixé pour objectif d'avoir dématérialisé l'ensemble des procédures d'ici la fin du quinquennat, ce qui passe à la fois par l'identification de celles restant à dématérialiser et par la mise en place – Henri Verdier y reviendra – d'une « usine » de dématérialisation à l'usage des collectivités et des opérateurs, le véritable enjeu tient surtout à la transformation profonde des métiers de l'action publique. Je suis en effet persuadé que, grâce au numérique, on pourra résoudre l'équation entre la baisse du nombre d'agents publics et l'amélioration de la qualité du service. En d'autres termes, le numérique doit nous permettre d'imaginer un service public augmenté, c'est-à-dire enrichi de nouveaux services et davantage tourné vers les citoyens et les usagers.
Dans le domaine de la santé, par exemple, la transformation digitale, via notamment une meilleure exploitation des données, permettra demain d'améliorer significativement l'efficacité du système de soins, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives.
En matière d'action sociale, vous évoquiez la question du taux de recours : demain, un meilleur croisement et une meilleure mobilisation des données permettront de diminuer significativement le taux de recours et de dégager ainsi des marges pour réinvestir le champ de l'accompagnement des bénéficiaires de l'aide sociale. La simplification de la gestion administrative, qui mobilise beaucoup d'agents publics, sera autant de gagné pour renforcer la médiation sociale, l'accompagnement et le conseil. Dans cette perspective, le numérique nous ouvre, par rapport à ce que nous aurions pu faire il y a une dizaine d'années, d'immenses perspectives de progression : on a souvent tendance à se focaliser sur l'impact de la révolution numérique sur les réseaux bancaires ou la grande distribution, en négligeant ses effets sur le secteur public, qu'il est pourtant essentiel de prendre en compte pour faire évoluer les politiques publiques.
L'allocation unique fait partie des sujets que recouvre CAP 2022. Il est un peu tôt encore pour savoir ce que seront les propositions de CAP 2022 et du Gouvernement, mais l'on peut d'ores et déjà affirmer que le numérique représente, en termes d'accès au droit, une formidable chance de garantir l'effectivité de ces droits, ce qui est l'un des critères à l'aune desquels se juge l'efficacité de l'action publique.
L'organisation territoriale des services publics fait également l'objet d'une réflexion transversale. Le chantier, piloté par le secrétaire général du ministère de l'intérieur, est ouvert, et doit aboutir, à partir de concertations entre les experts de CAP 2022 et les collectivités territoriales, dans le cadre notamment de la Conférence nationale des territoires, à faire évoluer l'organisation territoriale de nos services publics, repensée en fonction de nouvelles formes de coopération entre les acteurs. À ce titre, le projet de loi « ESOC » offre de nouvelles perspectives, grâce notamment au dispositif de l'interlocuteur unique et à l'ensemble des mesures qui doivent contribuer à gommer les frontières entre les différentes administrations.
Monsieur Cazeneuve, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question sur la transformation numérique dans les petites villes.

J'ai émis l'idée que le numérique permettrait de réinstaller dans les territoires ruraux et dans les petites villes des services aujourd'hui concentrés dans les métropoles et dans les grandes villes.
En effet ; c'est toute la question de la réorganisation et de la déconcentration du service public. Je pense que nous n'avons pas encore tiré toutes les conséquences de la révolution numérique, qui nous invite à revoir entièrement l'organisation des services publics, qu'il s'agisse des services de proximité, des administrations centrales ou des opérateurs.
Monsieur Vigier, la réflexion engagée au travers d'Action publique 2022 va nécessairement ouvrir des pistes d'économies permettant de tenir notre objectif de baisse de 3 points de la dépense publique, même s'il ne s'agit pas là de la clef d'entrée dans ce grand mouvement qui a avant tout pour ambition de dessiner l'avenir et les perspectives d'un service public réformé. La baisse de la dépense publique est néanmoins un des attendus de l'exercice, dans la mesure où nous ne manquerons pas de mettre au jour, dans certains champs des politiques publiques, des dispositifs appelant des gains de productivité, lesquels ne sauraient être effectifs que si l'amélioration de la qualité de service demeure garantie.
À cet égard, vous avez raison : le « qui fait quoi » est fondamental. CAP 2022 doit être l'occasion d'une nouvelle revue des missions, qui doit permettre de mieux clarifier les responsabilités des uns et des autres pour éliminer, le cas échéant, un certain nombre de doublons.
Le fonds de transformation de l'action publique, doté de 700 millions d'euros, est destiné à accompagner les projets de transformation et de réorganisation. Autrement dit, il n'a pas vocation à financer des dépenses d'infrastructure ou d'équipement des systèmes d'information, qui entrent dans le champ du volet numérique du Grand Plan d'investissement.
Vous avez évoqué le plan de départs volontaires ; il ne me semble pas avoir entendu dire qu'il serait massif. C'est une des pistes de réflexion explorées dans la perspective de la rénovation du contrat social. Elle participe de la volonté d'offrir aux agents publics plus de mobilité, non seulement au sein du secteur public – où le taux de mobilité est très faible – mais également hors de la fonction publique.
Monsieur Mattei, vous avez raison de souligner que les réflexions menées dans le cadre d'Action publique 2022 ne doivent pas être déconnectées du réel et en rester à des considérations théoriques. C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à des personnes extérieures à l'administration, experts, membres des commissions parlementaires, élus de terrain, représentants associatifs, chefs d'entreprise. En parallèle, nous organisons le forum de l'action publique, qui consiste en des échanges en région avec des agents des trois fonctions publiques. Le fruit de ces échanges alimentera notre réflexion sur le nouveau contrat social que nous voulons offrir aux agents publics.
Monsieur Aubert, réussir la transformation numérique de l'État et de l'action publique passe sans doute par la dématérialisation de l'ensemble des démarches administratives, mais cela implique surtout – et c'est ce qui demandera le plus de vigilance et d'efforts – de réussir la transformation des métiers et de l'organisation. Il ne s'agit pas en effet d'appliquer à l'organisation et aux procédures existantes des systèmes d'information ou des dispositifs de dématérialisation qui, sans autres changements de fond, perdraient tout leur sens et ne permettraient en aucun cas de développer de nouveaux services et de faire advenir une action publique plus moderne, plus réactive, plus innovante et plus déconcentrée, qui fasse davantage confiance à l'initiative des agents et des managers publics sur les territoires.
Cette transformation exige également de notre part une action volontariste en faveur de l'inclusion numérique, sachant que 20 % de la population n'est toujours pas à l'aise avec les outils numériques et qu'elle doit en conséquence être accompagnée. C'est l'objet du programme d'inclusion numérique conduit par le secrétaire d'État chargé du numérique, M. Mounir Mahjoubi.

Nous sommes, comme vous, convaincus que la transformation de la fonction publique doit permettre d'améliorer non seulement sa productivité et son efficacité mais également ses relations avec les usagers.
Vous avez également évoqué la transformation des métiers à laquelle vont devoir s'adapter les personnels. La nouvelle politique managériale que vous souhaitez mener va-t-elle s'accompagner d'indicateurs permettant de vérifier qu'elle s'effectue dans de bonnes conditions pour ces personnels ? Le Parlement aura-t-il accès à ces informations lui permettant d'évaluer la qualité de vie au travail des agents publics ?

Bon nombre de nos communes rurales ou de montagne subissent aujourd'hui de plein fouet la fracture numérique, et il y a encore des communes qui ne peuvent assumer leurs obligations en matière de dématérialisation des actes administratifs. Pouvez-vous nous rassurer quant au fait que le recours à de nouveaux dispositifs numériques ne se fera pas sans que la totalité du territoire bénéficie d'une couverture adaptée ?

Comment peut-on mobiliser les compétences requises pour les métiers en tension qu'a identifiés le Conseil d'analyse économique – je pense en particulier aux data analysts ou, plus largement, aux informaticiens dont manquent les trois fonctions publiques, notamment la fonction publique d'État ? Plus globalement, comment accroître la culture numérique des managers publics, dans le cadre de leur formation initiale ou continue ? Les élèves de l'ENA y acquièrent-ils, par exemple, une vraie culture numérique ?

Les chiffres de l'INSEE montrent que seuls 34 % des plus de soixante-quinze ans ont accès ou se sentent à l'aise avec les outils numériques, ce qui est extrêmement peu et nous maintient fort loin de votre estimation selon laquelle seul un cinquième de la population aurait des difficultés avec internet. On en est d'autant plus loin que l'INSEE souligne également que, plus on s'éloigne des zones urbaines, plus la fracture numérique ou, à tout le moins, le sentiment de la subir, est important. Dans ces conditions, comment accompagne-t-on les personnes qui en ont besoin, et a-t-on prévu des outils d'évaluation permettant d'identifier les antagonismes éventuels que la transformation numérique et la dématérialisation peuvent susciter ?

La publication des enquêtes de satisfaction me paraît une bonne idée pour entraîner des changements en profondeur dans les administrations : où en êtes-vous de votre réflexion à ce sujet ? Avez-vous déjà une idée de la granularité de ces enquêtes ? Porteront-elles par exemple sur le taux de réclamations ou le taux de promotions ?
Monsieur Chassaing, je suis persuadé qu'une transformation réussie de l'action publique passe par des évolutions managériales, consistant notamment à redonner du pouvoir à celles et ceux qui sont en contact avec le public. Notre conception du service public est aujourd'hui beaucoup trop normée et nos pratiques beaucoup trop uniformisées ; elles ne laissent guère de marges de manoeuvre à leurs gestionnaires pour s'adapter à leurs publics respectifs. Il est donc essentiel que le nouveau modèle de l'action publique fasse le pari de la confiance, qu'il redonne un pouvoir de décision aux managers et s'affranchisse d'un mode de fonctionnement à ce point encadré qu'au bout du compte les agents publics n'ont jamais aucun choix.
En d'autres termes, nous devons partir du principe que nous avons des managers et des agents publics de qualité, qui sont prêts à s'adapter et à faire évoluer leurs métiers si tant est qu'on leur en laisse la liberté. Cela correspond en tout cas à ce que demandent nos concitoyens. Obsédés par l'égalité de traitement, nous nous sommes toujours efforcés de calibrer au maximum l'organisation de nos services publics par voie réglementaire ou législative. Nous devons, au contraire, rendre des marges de manoeuvre aux agents, leur concéder le droit à l'erreur en interne : il n'y aura pas de confiance entre l'administration et les usagers s'il n'y a pas de confiance au sein de l'administration.
Dans cette perspective, il est important d'accompagner la transformation managériale, à travers notamment le plan de formation en cours d'élaboration. Par ailleurs, il est important que les enjeux sociaux soient exprimés et visibles, ce qui passe, par exemple, par la mise en place d'un baromètre social, qui permette de mesurer, à intervalles réguliers, l'évolution du climat sur les différents versants de la fonction publique, et d'adapter éventuellement en conséquence les dispositifs de formation.
Monsieur Gaillard, je ne suis pas le mieux placé pour vous répondre sur la fracture numérique et le débit en milieu rural, deux questions qui excèdent largement mon périmètre. Je vous renvoie à l'accord tout récent entre l'État et les grands opérateurs télécoms.
Monsieur Le Vigoureux, dans le cadre du Grand Plan d'investissement, une enveloppe de 1,5 milliard d'euros doit servir à financer l'accompagnement des agents et des managers publics. Une partie des formations existantes devront par ailleurs être réaménagées pour s'adapter aux changements à venir.
Madame El Haïry, vous m'avez fait part de vos craintes de voir l'effectivité des droits menacée par la fracture numérique. Autant je suis persuadé que le numérique offre une chance de revoir l'organisation de nos services publics, autant il n'est pas question de substituer aux agents publics des procédures numériques, mais bien de repenser l'équilibre entre tâches matérielles et processus numériques. Il faut d'autant moins opposer les unes aux autres que la dématérialisation permettra de décharger les agents des opérations de saisie et de back office pour qu'ils puissent réinvestir la relation avec l'usager et son accompagnement, le cas échéant.
Nous devrons néanmoins être extrêmement attentifs, lors de la dématérialisation des démarches, à ce que celle-ci s'accompagne systématiquement d'un dispositif d'aide à l'inclusion numérique. Dans cette optique, les maisons de service au public doivent également permettre de maintenir un maillage territorial garantissant l'effectivité des droits.
Monsieur Guerini, lors du comité interministériel du 1er février, le Gouvernement a annoncé son intention de généraliser les enquêtes de satisfaction et la publication des résultats de tous les services publics d'ici 2020. La question de la granularité est extrêmement importante, car pour être utilement exploitables ces enquêtes doivent être établies selon le maillage le plus fin possible, c'est-à-dire au niveau des établissements, de la caisse d'allocations familiales, de l'agence de Pôle emploi, de l'établissement hospitalier ou scolaire. La mesure de l'efficacité du service et de la satisfaction permettra de mettre en exergue les établissements qui fonctionnent le mieux et d'identifier inversement ceux qui nécessitent d'être accompagnés.
La définition du contenu de ces enquêtes va nécessiter quant à elle un travail extrêmement fin, avec l'ensemble des ministères concernés, car chaque administration a ses spécificités, et il ne s'agit pas de plaquer un modèle unique sur l'ensemble des missions de service public. J'ajoute enfin qu'il est primordial que les agents publics ne perçoivent pas ses enquêtes comme des outils d'évaluation négatifs, mais comme des instruments conçus pour les aider à améliorer la qualité du service.

Vous avez indiqué que l'enjeu principal de la transformation de l'action publique était de faire évoluer le management. Or je suis précisément l'un de ceux qui regrettent que ce ne soit pas l'un des grands chantiers de ce plan d'action. On peut certes soutenir qu'il s'agit d'une problématique transversale, qui participe à la fois des ressources humaines et de l'évaluation ; il me semble néanmoins que cette transformation managériale est un prérequis à l'aboutissement des autres chantiers.
Pour prendre l'exemple du secteur privé, la tendance dominante de ces dernières années a consisté à dissocier l'expertise des capacités managériales ; dans la sphère publique en revanche, l'expertise, évidemment cruciale et indispensable, reste trop souvent ce qui fonde l'évolution des carrières et les nominations dans les fonctions d'encadrement. Ne pensez-vous pas qu'il faut que les choses évoluent, et à quelles conditions ? Ne regrettez-vous pas que la réforme du management n'ait pas été érigée en fanion de ralliement du plan qui nous a été présenté il y a une quinzaine de jours ?
Je suis comme vous persuadé qu'on ne réussira la transformation de l'action publique qu'en libérant les managers publics pour qu'ils prennent l'initiative de cette transformation. Il ne s'agit donc pas de faire de cette transformation un grand plan global mais de permettre à chacun des managers publics d'initier des évolutions dans son périmètre.
Lors du comité interministériel de la transformation publique, quatre axes d'action ont été retenus. Le deuxième d'entre eux vise à instituer « plus de liberté et plus de responsabilités pour les managers publics ». La presse en a certes très peu parlé, préférant se focaliser sur le plan de départs volontaires, alors qu'il est au coeur de la transformation engagée. Le Gouvernement a ainsi rappelé qu'il entendait passer d'une culture de contrôle a posteriori à une logique de responsabilisation a priori, assise sur davantage de souplesse et de plus importantes marges de manoeuvre.
Tels sont nos objectifs et nos priorités : si on ne libère pas les managers publics de la multitude de contraintes qui pèsent sur eux, nous ne réussirons pas.
J'illustrerai mon propos par le résultat de nos premiers échanges avec les ministères. Lorsque CAP 2022 a pris connaissance des contributions et des propositions faites par chaque ministère au sujet de la réforme, force lui a été de constater que certaines d'entre elles manquaient d'ambition, alors même qu'elles avaient été élaborées par des managers publics qui sont des hauts fonctionnaires de grande qualité.
Pourquoi n'ont-ils pas fait des propositions plus ambitieuses ? Est-ce parce qu'ils sont mal formés, pas qualifiés ou pas suffisamment engagés ? Je ne le pense pas. La raison est plutôt qu'ils n'ont pas des marges de manoeuvre suffisantes dans le cadre actuel et qu'il n'existe pas d'engagements pluriannuels sur les moyens. C'est une question fondamentale à mes yeux. Elle a d'ailleurs été largement évoquée dans le cadre du comité interministériel, même si l'on en a moins parlé que d'autres sujets. Comptez sur moi pour porter haut ces couleurs : c'est impératif pour réussir.

Je souscris totalement à vos propos : le cadre et les règles jouent un rôle déterminant. Tout le monde sait, néanmoins, que certains hommes et certaines femmes sont incapables de diriger les autres, en tout cas dans l'optique moderne que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire en introduisant dans leurs équipes un niveau suffisant de dialogue, de coopération et de travail collectif. C'est vrai dans le privé comme dans l'administration, y compris à des niveaux extrêmement élevés de la hiérarchie. Les règles et les pesanteurs du secteur public n'aident pas, mais il y a in fine un problème lié au comportement et à la mentalité d'individus qui n'ont pas été formés ou qui n'ont tout simplement pas les aptitudes nécessaires.

Il me reste à vous remercier, sincèrement, pour votre transparence et pour les réponses très concrètes et très pragmatiques que vous nous avez apportées. En tant que rapporteur spécial du fonds pour la transformation de l'action publique, je serai attentif à l'utilisation des crédits de la nouvelle mission budgétaire. Nous aurons l'occasion de vous revoir régulièrement pour que vous puissiez en rendre compte devant la commission, ainsi qu'éventuellement devant la mission d'évaluation et de contrôle.
La commission procède ensuite à l'audition de M. Henri Verdier, directeur de la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État (DINSIC).
La DINSIC est un service du Premier ministre qui est désormais rattaché au secrétariat général du Gouvernement (SGG). Elle constitue en quelque sorte une direction des systèmes d'information (DSI) de l'État et, de plus en plus, une direction de la transformation numérique, qui accompagne la transformation des administrations.
Notre histoire est assez récente. La Cour des comptes l'a rappelée dans une étude assez dense sur la DINSIC, qui a fait l'objet d'une insertion de presque 25 pages dans son rapport annuel, tout juste rendu public : après de nombreuses tentatives pour créer une DSI « groupe » de l'État, une direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'État (DISIC) a été créée en 2011, à l'issue d'un vrai travail interministériel. D'abord conçue comme une structure de mutualisation, cette direction a peu à peu été dotée de fonctions d'autorité : depuis trois ans, les grands projets informatiques de l'État lui sont notamment soumis pour avis conforme. Il y a également eu le rattachement d'équipes issues du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP), qui venaient davantage de l'univers numérique : la mission Etalab, en charge de l'ouverture des données publiques et de l'action publique, avec par ailleurs une sensibilité à la question du logiciel libre, et un incubateur de projets en « méthodes agiles ». Placé dans le sillage d'Etalab, notre incubateur essaie d'introduire au sein de l'État des méthodes et des profils qui contribuent à la puissance de l'économie numérique. Le dernier épisode de notre histoire a été la division du SGMAP en deux structures, l'une dirigée par Thomas Cazenave, que vous venez d'entendre, l'autre par moi-même.
S'il fallait résumer le problème multidimensionnel qui se trouve devant nous, je dirais que l'État reste quand même désarmé quand il s'agit d'informatique. Vous le savez, on ne lance plus de grands projets sans éprouver de fortes inquiétudes dues à une tendance préoccupante au dérapage, même si ce phénomène n'est pas tellement plus prononcé que dans le secteur privé – lui aussi est capable de rater ses grands projets. Par ailleurs, notre dette technologique s'accumule. Certains pans de l'informatique de l'État restent programmés en cobol, un langage qui n'est plus enseigné, ce qui nous conduit parfois à rappeler des retraités pour réussir des opérations fiscales... Nous avons aussi du mal à développer des services vraiment fluides, permettant une bonne « expérience utilisateur » et une personnalisation adéquate. De plus, même si l'on observe également des difficultés du même type dans le privé, y compris dans les entreprises du CAC 40, nous avons du mal à concevoir les métiers d'après la révolution internet. Je pense notamment à ce que deviendront la sécurité sociale quand nous serons en permanence connectés à des appareils biométriques, l'éducation quand l'intelligence artificielle sera présente partout, et la police quand il y aura des véhicules sans chauffeur.
L'État se trouve un peu démuni sur tous ces sujets, notamment d'un point de vue culturel. Nous avons à peu près 20 000 informaticiens, mais beaucoup d'entre eux ont été déchargés depuis longtemps, hélas, de toute fonction de codage et de développement : ils se bornent à acheter et à préparer des appels d'offres grâce auxquels des fournisseurs encaissent des recettes. Nous pâtissons d'un problème général de conception et de pilotage des grands projets. Je fais ce constat après cinq années d'action publique et après avoir été entrepreneur dans l'économie numérique : j'ai créé deux start-up et un pôle de compétitivité. La révolution numérique questionne toutes les grandes organisations de manière assez violente, car elle appelle de nombreux changements qui concernent à la fois l'offre, les business models, les structures de production, le management et le fonctionnement des organisations. Toutes celles qui sont anciennes et bien structurées, qu'il s'agisse de l'État ou de General Motors, ont du mal avec la révolution numérique. Le problème n'est pas spécifique à l'État.
Afin d'y remédier, nous agissons selon trois axes principaux.
Le premier concerne les infrastructures lourdes : nous devons décider si nous en sommes les opérateurs ou si nous abandonnons des sujets de souveraineté. Le réseau interministériel de l'État (RIE), lancé par la DISIC, a été le premier exemple. Le déploiement initial du RIE, dont nous sommes l'opérateur, est désormais achevé : 14 000 bâtiments sont interconnectés grâce à lui. Nous n'avons certes pas creusé nous-mêmes les tranchées, ni posé les câbles – on a repris l'infrastructure RENATER et passé des marchés avec les opérateurs de télécoms pour poser la fibre jusqu'au dernier mètre –, mais nous assurons la supervision et l'hypervision du réseau, ainsi que le cryptage quand il existe. Selon nous, ce réseau est plus résilient qu'internet et mieux sécurisé. Il s'agit d'un service à compétence national (SCN), filiale de la DINSIC, qui compte quarante agents. Il est en charge des échanges de données entre les administrations, des communications vocales, dans de plus en plus de cas – car on peut monter en gamme une fois qu'un réseau existe –, ainsi que de la passerelle d'accès à internet et de sa sécurisation.
La question est de savoir si l'on doit mutualiser d'autres infrastructures. Il semble à peu près tranché que l'État ne renoncera pas à gérer lui-même du cloud, cette informatique en nuage. On s'engage dans une stratégie hybride : sans prétendre agir seul là où d'autres acteurs excellent, notamment les GAFA – Google, Amazon, Facebook et Apple –, il s'agit d'avoir la capacité opérationnelle de gérer un cloud pour héberger des données ultrasensibles ou même seulement un peu sensibles. Grâce à des crédits du programme d'investissements d'avenir (PIA), la DINSIC a accompagné trois ministères qui ont réussi à développer leur cloud, puisqu'ils en sont au stade du prototype fonctionnel. Il reste maintenant à déterminer si cela doit nous conduire à la naissance d'une vraie structure interministérielle et si l'on peut en faire bénéficier les collectivités territoriales.
Nous devons reprendre la maîtrise de nos infrastructures critiques, qu'il s'agisse de l'environnement de travail des agents, de la téléphonie mobile ou d'autres sujets. Les grands socles technologiques sont concernés, de même que les systèmes d'information destinés aux ressources humaines. Ces derniers représentent 20 % des dépenses informatiques de l'État et font l'objet des projets les plus compliqués et les plus souvent ratés. Certains systèmes âgés de plus de quarante ans tournent sur des machines qui ne sont plus disponibles sur le marché : en cas de panne, nous devons changer nous-mêmes les pièces.
À cela s'ajoute la nécessité de « réinternaliser » certaines compétences critiques : nous avons besoin de chefs de projet du meilleur niveau et susceptibles de faire carrière. À l'heure actuelle, on est nommé préfet ou inspecteur des finances quand on a brillamment réussi un projet informatique : en guise de remerciement, on peut se consacrer à d'autres fonctions, ce qui empêche toute capitalisation dans la durée. Nous n'avons pas de grand corps prestigieux d'informaticiens d'État : il existe au contraire quatre-vingt-dix petits corps. Nous essayons de les regrouper pour offrir plus facilement des carrières, de la mobilité, des formations et des promotions. Le but est de faire naître le corps d'ingénieurs dont nous avons besoin.
On peut résumer le deuxième étage de notre stratégie par l'expression « État plateforme ». En reprenant la main, on peut rendre l'informatique de l'État mieux maîtrisée, moins chère et moins dépendante de certains fournisseurs, un des problèmes de la révolution numérique étant qu'eux aussi l'ont ratée : un certain nombre d'acteurs qui étaient de grands prestataires informatiques dans les années 2000 ne sont pas bons aujourd'hui. Le risque est d'aboutir à des résultats ringards même si l'on reprend la main. La révolution numérique nous a appris que ce sont les plateformes qui l'emportent à la fin – Google, Amazon, Facebook, Twitter, Windows ou encore Apple : le gagnant n'est pas celui qui sait tout faire tout seul, mais celui qui met en avant ses ressources pour permettre à beaucoup d'autres acteurs d'innover en les utilisant. Nous avons donc lancé, il y a trois ou quatre ans, un grand projet très structurant qui vise à faire de l'informatique de l'État une plateforme.
Concrètement, il faut que les « briques » fondamentales de l'action publique puissent servir à toutes les administrations. C'est un gisement de productivité et d'efficacité considérable. Un identifiant permettant de se connecter à un site doit valoir pour toutes les administrations, au-delà même de l'État, et on doit cesser de demander en permanence aux entreprises de fournir leurs données fiscales de référence et leur Kbis. Nous oeuvrons ardemment pour que toutes les productions informatiques de l'ensemble des ministères soient pensées nativement sous la forme de petits modules très simples et susceptibles d'être réutilisés par tous les autres ministères. Le portail de la direction de la sécurité sociale, www.mesdroitssociaux.gouv.fr, inauguré il y a un peu plus d'un an, a ainsi été réalisé en quelques mois, pour un coût assez faible, de moins de 2 millions d'euros : on s'identifie grâce au bouton « FranceConnect », réalisé par la DINSIC, et les informations concernant l'internaute sont rapatriées, avec sa permission, depuis une douzaine d'opérateurs sociaux – Pôle emploi, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ou encore celle de l'assurance vieillesse (CNAV) ; le simulateur OpenFisca, qui reprend les règles du droit fiscal et social, peut ensuite mettre en évidence des droits non demandés jusque-là. En prélevant des « briques » dans une douzaine de systèmes, nous avons pu en créer un tout nouveau assez rapidement et pour un coût relativement peu élevé. Le principe de base peut paraître assez évident, mais il faut être conscient que l'informatique de l'État est historiquement structurée en silos très verticaux et très cloisonnés, comme dans n'importe quelle grande organisation. Jusque-là, on n'avait jamais le droit de piocher dans les autres systèmes d'information, la crainte étant que cela conduise à tout casser ou à découvrir des failles de sécurité et des erreurs dans les données. Il y a tout un travail, extrêmement important, à réaliser.
Deux éléments sont au coeur de l'État plateforme. Il y a d'abord les données : nous développons des application programming interfaces, ou interfaces de programmation d'application (API), dont la plus ancienne est l'API Entreprise, qui fournit aux administrations une quinzaine d'informations telles que le Kbis, la preuve que la personne concernée n'est pas interdite de gestion par la Banque de France et qu'elle a payé ses charges sociales. Soixante administrations utilisent cette API, qui permet de dématérialiser 15 millions de pièces par an avec un bout de code réalisé en une année par deux personnes : on se contente d'interroger intelligemment les systèmes de la direction générale des finances publiques (DGFiP), de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ou de la Banque de France. À cela s'ajoute le système d'authentification « FranceConnect », qui permet de se connecter à n'importe quel service public. 3 millions de Français s'en servent déjà pour accéder à 300 sites, et nous devrions arriver à 10 millions de personnes à la fin de l'année. C'est une serrure et une clef uniques pour tous les services publics.
Quand on rend l'informatique de l'État propice à de nouveaux usages, on doit également oeuvrer pour le plus grand partage possible avec la société civile. Cela peut en effet conduire à des externalités positives sur le plan économique. On y travaille depuis longtemps dans le cadre de l'open data, qui permet à des milliers de start-up d'utiliser des données publiques pour créer des services innovants, mais on peut le faire aussi pour d'autres sujets, comme l'identité ou le paiement. L'« État plateforme » comportera ainsi un système de paiement, PayFIP, que développe la DGFiP : c'est une sorte de PayPal réalisé par le service public et accessible à toutes les start-up qui le souhaiteront. On peut aussi travailler à des externalités positives pour des missions de service public. À titre d'exemple, la rubrique « Emploi Store » du site de Pôle emploi répertorie 311 services d'aide au retour à l'emploi, dont une quinzaine a été créée par l'administration, tous les autres étant le fait d'associations, de collectifs ou de start-up. Pôle emploi a introduit quelques règles du jeu simples, mais politiquement significatives, comme le refus de tout service faisant payer les demandeurs d'emploi. On peut ainsi accompagner et prolonger des politiques publiques en leur donnant plus d'impact. De cette manière, l'État plateforme peut servir de colonne vertébrale à la société civile et favoriser le déploiement de son énergie. Je cite souvent l'exemple des sapeurs-pompiers : 200 000 d'entre eux sont des volontaires, pour seulement quelques dizaines de milliers de professionnels. Les services d'incendie et de secours sont assurés grâce à une alliance entre des agents publics et des bénévoles qui ont un cadre dans lequel ils peuvent s'investir.
La notion d'État plateforme renvoie notamment à des questions de souveraineté. C'est un aspect qui me paraît très important. Nous entrons, en effet, dans un monde où il est quasiment impossible d'innover sans demander aux GAFA leur permission : il devient difficile de trouver dans son téléphone une application n'utilisant pas Google Maps, Facebook Connect ou PayPal. Or ces services peuvent être débranchés à tout moment si l'on ne respecte pas les conditions générales d'utilisation (CGU), qui relèvent du droit californien. Par ailleurs, chaque internaute utilisant ces services augmente un peu la valeur des entreprises concernées. C'est peut-être un engagement un peu personnel, mais je crois que la puissance publique doit être en mesure de garantir à l'économie française la possibilité d'innover sans en demander la permission à des systèmes régis par le droit californien.
Je sais bien que cette audition est publique et diffusée, mais je vais quand même vous donner l'exemple suivant. La préfecture de Savoie a conçu un magnifique service d'informations routières qui est notamment utile en cas de chute de neige, mais dont le site est tombé en panne juste avant les vacances de Noël. Le succès était tel, en effet, que l'on a dépassé 25 000 utilisations quotidiennes d'une API appartenant à Google : les développeurs du site n'avaient pas vu que les CGU prévoient un débranchement une fois ce seuil atteint. Le service est donc tombé en panne pendant les vacances d'hiver et il y a eu ensuite des discussions assez longues avec les services juridiques de Google – ne connaissant pas la Savoie, et ne sachant pas vraiment ce qu'est une préfecture, ils ne voyaient pas l'importance de réagir au quart de tour.
Une vraie question de souveraineté se pose. La DINSIC est donc devenue le développeur et l'opérateur de quelques-unes des grandes API de l'État, notamment l'API Géo, l'API Carto, l'API Entreprise et l'API Particulier, réservée aux administrations ayant le droit d'utiliser des données personnelles.
Troisième aspect, la transformation numérique représente aussi, et peut-être avant tout, une transformation organisationnelle, managériale et culturelle. Tout d'abord, il faut travailler en « méthodes agiles ». Les développeurs, qui observent les usagers, sont les acteurs qui savent si un produit va marcher. Ce n'est pas une affaire relevant de la comitologie ou d'une hiérarchie : il faut laisser les développeurs modifier le produit jusqu'à ce qu'il fonctionne bien. C'est un principe qui peut paraître simple, mais il faut avoir essayé de l'appliquer dans une vieille organisation, quelle qu'elle soit, pour en comprendre vraiment la difficulté. Outre cette question, il y a toute la culture de la data, de la transparence et de la concertation.
La DINSIC n'est pas seulement une DSI en charge du back office et un opérateur voué à faire naître l'État plateforme : elle porte aussi des transformations culturelles très importantes – avec l'open data, le Gouvernement ouvert, plus transparent, faisant davantage appel à la concertation et plus contributif, la data science, les méthodes agiles et le travail avec les écosystèmes. Nous avons notamment créé le programme « Entrepreneurs d'intérêt général » qui permet d'intégrer dans l'État, pour neuf mois, des « serial entrepreneurs », chercheurs ou créateurs de start-up, qui ont envie d'aider une administration, mais aussi de la « challenger », en y introduisant des méthodes, des manières de travailler et des outils très différents pour elle.
La DINSIC réalise aujourd'hui trois types d'interventions assez différentes, qui se sont progressivement superposées les unes aux autres, ce qui ne facilite pas toujours le pilotage et l'analyse de notre action.
Sur certains points, nous avons autorité sur le système d'information (SI) de l'État au nom du Premier ministre, en vertu d'un décret du 1er août 2014 qui a créé un SI unique, placé sous la responsabilité du Premier ministre – aucune responsabilité n'était prévue avant 1986, date à laquelle on a commencé à procéder ministère par ministère. Tous les grands projets de plus de 9 millions d'euros – le montant paraît considérable, mais cela représente tout de même trente projets par an – nous sont soumis pour avis conforme et doivent faire l'objet d'une analyse de notre part. Nous en interdisons quelques-uns et nous en améliorons beaucoup d'autres : les projets sont rarement autorisés sans modification. Nous sommes aussi responsables des référentiels généraux d'interopérabilité, de sécurité et d'accessibilité, ainsi que d'un certain nombre de normes et de bonnes pratiques au sein de l'État.
Nous pouvons par ailleurs agir en accompagnateurs, en nous portant au secours de projets qui vacillent, en mobilisant nos marchés cadres pour des projets en data science, en assurant une mise en contact avec des équipes de « méthodes agiles » ou en réalisant des projets en la matière – nous l'avons fait à cinquante reprises dans le cadre de notre incubateur. Quelle que soit l'ambition, même la plus complexe, notre conviction est que l'on peut toujours arriver en moins de six mois et pour moins de 200 000 euros à un minimum viable product, c'est-à-dire une première version minimale dont un premier usager trouve qu'elle produit un résultat préférable à l'état antérieur.
Dans le cas de la rentrée scolaire simplifiée dont le lancement vient d'être décidé par le comité interministériel de la transformation publique, je pense qu'il est possible, dès la rentrée prochaine, de ne plus demander certaines pièces aux parents et d'apporter ensuite des améliorations en vue d'aboutir à une rentrée scolaire complètement simplifiée dans un an et demi ou deux ans. Il n'est pas nécessaire de réfléchir pendant six mois à des spécifications et de dépenser 5 millions d'euros pour déployer un dispositif trois ans plus tard, en espérant simplement qu'il fonctionne.
Outre ces deux missions, nous agissons de plus en plus comme fournisseur de ressources, en particulier avec l'accès sécurisé permis par le RIE, le bouton « FranceConnect » et les données de l'API Entreprise. Notre vocation est de fournir d'autres « briques » essentielles pour le fonctionnement de l'État. Nous essayons de nous en tenir strictement à ce qui est interministériel, mais dans un sens nouveau du terme : il ne s'agit pas d'arbitrer des conflits entre ministères, mais de combler des vides entre ces derniers, en faisant ce dont personne ne s'occupait auparavant, car la mission n'était attribuée à aucun acteur.

Le terme « agile » est très évocateur et vos propos font écho au travail que nous avons réalisé sur le projet de loi « ESOC » – je pense à son article 21, qui concerne directement la notion d'API, mais aussi à toute la notion d'agilité interministérielle et interadministrations qui est présente dans le texte. Par ailleurs, votre exposé liminaire fait écho à ce que nous a dit Thomas Cazenave à propos du comité « Action publique 2022 », en particulier l'idée de faire travailler ensemble les administrations et la volonté, à laquelle je suis très sensible, de ne pas considérer l'interministériel uniquement sous l'angle d'un arbitrage, mais aussi d'un manque à combler.
Notre rapporteur général m'a demandé de vous poser plusieurs questions en son nom.
Vous avez déclaré que l'État est « démuni », et il ressort notamment de votre intervention que l'accompagnement de process constitue un véritable enjeu. Comment envisagez-vous de réaliser un tel accompagnement et d'attirer les talents, les futurs managers ? Vous avez évoqué la création d'un corps d'ingénieurs, ce qui constitue une première réponse. Néanmoins, s'il doit y avoir de plus en plus de contractuels, comment attirer dans la fonction publique ceux qui seraient intéressés par des start-up ou des PME numériques faisant preuve de dynamisme ? On doit à la fois accompagner l'existant et attirer les meilleurs de demain.
La seconde question concerne les réticences au changement ou, en tout cas, au basculement lié au numérique. La dématérialisation de la propagande électorale en donne un exemple concret qui est assez parlant : cette question a été abordée à deux reprises au Parlement, à l'occasion du projet de loi de finances pour 2015 et de celui pour 2017, mais les évolutions proposées ont été systématiquement rejetées. On observe une véritable réticence devant des changements qui paraissent sinon s'inscrire dans le sens de l'histoire, du moins constituer des avancées notables dans la dématérialisation de certains services publics. Comment pourrions-nous associer les parties prenantes en vue d'aboutir à une décision structurante dans ce domaine ? Comment éviter le blocage par l'une des parties ? Ne faut-il pas s'y prendre plus en amont ?

Ma première question porte sur le risque d'un service public à deux vitesses : outre la transformation numérique concernant les services de l'État, qu'en est-il des collectivités locales, qui assurent également des missions de service public ?
Je voudrais par ailleurs évoquer les 13 millions de Français, soit près d'un quart de nos concitoyens, qui ont des difficultés avec le numérique. Le secrétaire d'État en charge de cette politique, M. Mounir Mahjoubi, a lancé à la fin de l'année dernière une mission ministérielle « Société numérique » dont l'objectif est de préparer l'inclusion numérique. Comment vos travaux et plus généralement les efforts de modernisation de l'action publique vont-ils s'articuler avec cette mission ? Par ailleurs, savez-vous quels moyens seront alloués au parcours de médiation et de formation destiné aux personnes en situation de précarité numérique ? Ces moyens sont-ils inclus dans l'enveloppe de 700 millions d'euros évoquée tout à l'heure par M. Cazenave ?

Depuis nos territoires, nous remontent les difficultés rencontrées avec des logiciels comme Osiris – les aides européennes aux agriculteurs peuvent être versées avec deux ans de retard – ou Chorus – des personnels en mission ou des prestataires sont payés un ou deux mois après la fin de leur contrat. Dans le cadre de la nouvelle dynamique que nous évoquons aujourd'hui, serons-nous, un jour, en mesure de nous passer de ces outils et de fabriquer les nôtres ? C'est une question de souveraineté. Une volonté existe-t-elle en ce sens ? Avant que nous n'en arrivions là, à moyen terme, comment résoudre les problèmes posés par ces systèmes défaillants qui empoisonnent la vie de nos concitoyens ?

La Cour des comptes a salué l'inscription de la DINSIC dans une dynamique de baisse de la dépense publique – nous parlons de dizaines de millions d'euros. Nous y sommes particulièrement sensibles, et nous saluons ce travail.
Au-delà de la question majeure de la transformation numérique de l'État au service des usagers, j'aurais aimé vous entendre davantage sur cette transformation au service des entreprises.
Lorsque je lis certains articles ou le rapport de la Cour des comptes qui évoquent 1 million de connexions, j'ai le sentiment que votre API Entreprise fonctionne bien, mais lorsque j'en parle aux entrepreneurs de terrain, aucun ne connaît cette plateforme. Cette API doit-elle encore être développée ou devez-vous mieux communiquer pour la faire connaître ? Dans la mission que je viens de terminer pour M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, avec la direction générale des entreprises, on nous a beaucoup parlé du sujet : on a cité, par exemple, la possibilité pour une entreprise d'utiliser son seul numéro SIRET pour répondre à un marché public, mais, dans les faits, la procédure de marché public simplifié est assez peu connue et peu utilisée.
Comment faire évoluer la situation d'institutions qui ne se parlent pas alors qu'elles traitent des mêmes sujets avec chacune leurs moyens informatiques ? Je pense à l'Agence France Entrepreneur, carrefour d'informations très utilisé, qui ne permet pas de créer son entreprise – pour cela il faut se tourner vers « guichet-entreprise.fr ». Évidemment, il y a un problème d'interopérabilité. Faut-il remettre à plat l'ensemble du système, comme le pensent certains, ou plutôt imaginer des ponts technologiques entre les structures existantes ?
Comment l'État compte-t-il aujourd'hui soutenir et amplifier la démarche déjà entamée de lâcher de données publiques au service de l'écosystème entrepreneurial ? Comment pourrait-il se servir de données publiques anonymisées ? Ce pourrait être, dans une version minimale, pour faire de la prospective – soyons fous ! –, ou, dans une version maximale, pour envisager d'en vendre un certain nombre – toutes les questions doivent être posées ?
L'open data, qui n'est que l'une des dimensions de votre action, participe à la transparence de l'action publique. Vous connaissez la sensibilité de la majorité s'agissant de la confiance et de la transparence. Quelle est aujourd'hui votre vision de l'action de la DINSIC au service de la transparence de l'État ? Vous l'avez compris : au-delà des données, nous nous intéressons à ce qu'elles incarnent et ce qu'elles agrègent.
Je rappelle que la DINSIC reste une petite structure qui compte cent quarante personnes, quarante d'entre elles se consacrant au RIE. Ses homologues anglo-saxons, comme le White House Chief Technology Officer (CTO) ou le Government Digital Service (GDS), font le double ou le triple de sa taille. Nous avons en conséquence essayé d'optimiser nos ressources. Faut-il faire grossir la DINSIC ? M. Mounir Mahjoubi se pose la question, et d'ici à un an, notre stratégie pourrait être encore plus ambitieuse.
Lorsque j'interroge mes collègues des DSI ministérielles ou des opérateurs sur le plus gros problème qu'ils rencontrent, ils me répondent unanimement qu'ils n'arrivent pas à recruter. Ce problème concerne d'abord les fonctions classiques, comme celles d'administrateur système, parce que les candidats ne viennent tout simplement pas chez nous. Il concerne ensuite les profils rares et atypiques vraiment indispensables, comme les data scientists, les UX designers, parce que les règles de recrutement des contractuels dans la fonction publique rendent leur embauche trop complexe.
Les principaux obstacles ne viennent pas nécessairement du code la fonction publique. Il y a bien sûr une question d'argent – le public ne paie pas bien, moins bien, en tout cas, que le privé –, mais cette question n'est pas la plus déterminante. La DINSIC compte 60 % de contractuels dont beaucoup sont des entrepreneurs ou des profils rares et atypiques – président d'association, serial entrepreneurs... Ils sont exaspérés et poussés à nous quitter après deux ou trois ans par ce qui leur apparaît comme des mesquineries ou des vexations. Certains sont prêts à abandonner un CDI pour venir travailler trois ans pour l'État en CDD en gagnant moins : ils peuvent mal prendre que l'on discute sur 100 euros et se dire que l'on ne veut vraiment pas d'eux.
Autre exemple, qui ne relève pas des textes mais d'un usage : lors du renouvellement de leur CDD, il est remis en compétition. Cela peut ne pas être compris. Je connais un expert qui, après huit ans de bons et loyaux services pour l'État, a découvert que le CDI qu'il venait de signer comportait une période d'essai de trois mois. Il a considéré que la coupe était pleine. Tout cela ne repose pas nécessairement sur le droit, mais plus souvent sur les moeurs.

Sachant que la DINSIC est probablement l'organe public le plus attrayant pour les personnes dont les qualifications sont celles que vous décrivez, on imagine les difficultés que doivent rencontrer d'autres administrations pour les recruter.
Résoudre ce problème n'est pas facile. La fonction publique, passe par le concours qui garantit l'égalité de tous devant l'accès à l'emploi public et assure une forme de rationalité des carrières. Tout cela a de bonnes raisons d'être. Il faut donc commencer par nous assurer de disposer des écoles et des concours d'ingénieurs qui permettent de détecter et de recruter des talents.
Il faut aussi que nous changions de culture et que nous permettions aux ingénieurs et aux informaticiens de faire de hautes carrières administratives. Augustin Landier et David Thesmar qui, dans l'un de leurs ouvrages, décrivaient le numérique comme le nouveau théâtre d'opération des affrontements contemporains, se demandaient pourquoi, alors que l'on n'aurait pas jamais imaginé qu'un état-major militaire ne compte aucun soldat ayant mis les pieds sur le terrain, on pouvait constituer des états-majors d'entreprise (COMEX) sans qu'aucun membre ne vienne du monde numérique. La situation est la même pour l'État : il faut plus d'ingénieurs parmi les directeurs d'administration centrale, les sous-directeurs, ou au sein des corps d'inspection.
Nous devons toutefois prendre en compte un élément majeur. Lorsque j'ai créé ma première entreprise internet, en 1995, nous étions 200 000 internautes en France. Depuis, j'ai dû vivre sept ou huit ruptures technologiques totales. La révolution technologique se traduit par une rupture tous les trois ou quatre ans. Il y a cinq ans, il y a eu par exemple l'arrivée des big data. Si vous voulez les intégrer dans le fonctionnement de l'État, il vous faut trois ans pour former des professeurs, un an pour que la commission des titres modifie le programme des écoles de fonctionnaires, puis trois ans pour former ces derniers... Vous avez globalement besoin de dix ans pour disposer des nouvelles compétences nécessaires. Et ce n'est pas un cas unique : les ruptures seront permanentes au moins dans les vingt prochaines années. Il faut donc trouver une organisation qui permette de recruter durablement un « volant » de contractuels.
Il existe encore des administrations dans lesquelles on estime que le recrutement de contractuels marque l'échec de la fonction publique, qui n'aurait pas su former les talents dont on avait besoin. Je dis au contraire à mes collègues qu'ils doivent considérer ces recrutements comme une fierté : ils indiquent qu'ils peuvent disposer à tout moment de tous les talents dont ils ont besoin – certains proviennent des écoles de fonctionnaires, d'autres viennent d'ailleurs.
En général, ceux qui comprennent les big data tout de suite sont un peu différents : ils sont un peu plus aventureux, confiants en eux-mêmes, bizarres, ils portent des tee-shirts troués, des jeans, ils sont plus chevelus, et leur rapport à l'ordre, à la hiérarchie et aux projets n'est pas le même. Ils se sont formés seuls. Lorsqu'ils arrivent dans certains ministères, cela peut surprendre. Il faut que nous nous organisions durablement pour être en mesure d'attirer et de conserver ces talents ; ce n'est pas vraiment facile. Il s'agit sans doute aujourd'hui du talon d'Achille de la fonction publique d'État.
J'ai longtemps dit que nous avions trop externalisé. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas travailler avec l'extérieur. Les grandes entreprises de services numériques l'ont bien compris : elles ne me considèrent pas comme leur ennemi juré car elles savent que si elles n'ont pas un client intelligent, elles n'auront plus de client du tout. La dépense informatique de l'État n'est pas considérable : la DINSIC estime qu'elle s'élève à 4 milliards d'euros, partagés équitablement entre les salaires et les dépenses, sur un budget total de 400 milliards. Ce ratio de 1 % est faible si on le compare, par exemple, à celui des banques qui consacrent jusqu'à 12 ou 13 % de leurs dépenses à l'informatique. Il s'agit d'une sorte de paradoxe. La misère institutionnelle peut-être très grande – je connais des ministères dans lesquels il faut vingt minutes entre le moment où l'on allume son ordinateur et celui où l'on peut envoyer un courriel, alors qu'à côté de cette tiers-mondisation, on trouve des éléphants blancs : on lance parfois des projets fous à 300, 400, 500 millions d'euros dont on constate l'échec six ans plus tard. Ce contraste pose un problème pour le pilotage budgétaire de la dépense informatique de l'État. Il faut apprendre à « démoyenner » : la gabegie qui existe encore doit cesser, et il faut un peu mieux doter les administrations qui sont sous la ligne de flottaison. Je peux citer un ministère dont 90 % du budget informatique sert uniquement à la maintenance corrective et évolutive du même matériel vieillissant : il ne peut plus innover !
Nous devons disposer en interne d'assez de forces en termes de conception, de conduite de projet et de dialogue pour mieux nous tourner vers l'extérieur, pour bien travailler avec nos fournisseurs, pour concevoir correctement les nouveaux projets, leur trajectoire et leur « agilisation ».
Il est vrai que les vieilles méthodes qui échouent étaient rassurantes. On pouvait faire relire des spécifications à soixante-dix personnes, mettre sur pied un comité de pilotage avec tous ceux qui avaient peur que le projet échoue ou réussisse, s'appuyer sur un fournisseur qui avait présenté un cahier des charges échelonné de trois mois en trois mois et promis de livrer un résultat en six ans... Les méthodes agiles, elles, ne sont pas rassurantes. On vous annonce directement que l'on va peut-être découvrir que l'on a fait fausse route, que les gens ont besoin d'autre chose, que les médecins ne rempliront jamais de dossier médical personnalisé... Cela dit, il aurait tout de même été préférable de la savoir après six mois : nous aurions constaté que nous nous étions trompés, et nous aurions pu faire pivoter ce projet.
Il y a bien un combat culturel à mener. Il ne s'agit pas seulement de recruter davantage de contractuels, mais de faire de la place aux ingénieurs. Depuis quelques années l'État ne recrute plus d'ingénieurs des télécoms. Avec la fusion en un corps Mines Télécom, les diplômés se dirigent plus rapidement vers le privé qu'auparavant. C'est grave. La DINSIC mène en tout cas sur plusieurs fronts ce combat du recrutement.
L'accompagnement à la transformation numérique est compliqué. Je n'ai pas regardé de près le cas de la propagande électorale. Il faut aussi considérer que certaines numérisations peuvent ne pas être un progrès. À titre personnel, j'ai par exemple les plus grandes préventions contre le vote électronique. La question peut éventuellement se poser pour les Français de l'étranger par exemple lorsque l'on doit choisir entre l'absence totale d'électeurs et un vote inquiétant parce que « piratable ». En revanche, dans des conditions normales, je ne vois pas l'intérêt à voter avec une machine alors que l'isoloir existe. On gagnerait peut-être un tout petit peu de temps et d'argent, mais on perdrait la possibilité qu'offre la République à tous ses citoyens de vérifier de leurs propres yeux que le système n'est pas truqué. Même un quasi-analphabète peut opérer cette vérification sans avoir à faire confiance à des paroles d'experts.
Je constate aussi que les gens sont parfois inquiets devant l'écran. Nous avons du mal à déployer le système de marché public simplifié dont vous avez parlé, madame Gregoire. Certains interlocuteurs décochent volontairement la case qui leur propose cette option et préfèrent envoyer une version papier du dossier. Ils sont probablement inquiets de ne pas savoir ce que devient leur courriel dans le cyberespace. Ils veulent avoir un tampon de la poste qui fait foi, un recommandé pour disposer d'une trace en cas de conflit.
Une partie de la réponse pourrait venir du traitement par l'État de l'un de ses points faibles : il doit penser le design de l'expérience utilisateur – ou UX design. Il ne s'agit pas seulement de l'ergonomie de la page web mais de la conception d'un contexte rassurant avec des repères : il faut donner la certitude que l'information est officielle, prévoir l'envoi d'un accusé de réception... Nous ne savons pas encore trop concevoir une belle expérience utilisateur. Un problème de gouvernance se pose aussi, car dès qu'un projet concerne plusieurs directions – je ne parle même pas de l'interministériel –, il est découpé en tronçons et perd l'internaute. Nous devons progresser, internaliser des compétences nouvelles et améliorer la gouvernance.
Nous avons pris en compte très tôt le risque d'un service public à deux vitesses qui existe bel et bien. La DINSIC anime l'INP, instance nationale partenariale de dialogue dont les réunions mensuelles rassemblent les responsables numériques de toutes les associations de collectivités. Les échanges y sont sereins car nous parlons entre gens de l'art sans enjeu d'attribution de compétences ou de fiscalité. Nous publions ensemble le programme de développement concerté de l'administration numérique territoriale (DCANT). La notion d'« État plateforme » est directement tirée de l'essai fondateur de Tim O'Reilly intitulé Government as a Platform. Il serait pourtant plus juste de traduire « Government » par « action publique » que par « État ». Cela exprimerait aussi mieux le rôle joué par les collectivités locales qui sont aujourd'hui les premières à demander l'accessibilité pour tous de l'identité numérique, du paiement dématérialisé, ou des données de référence. Elles seront aussi les premières à bénéficier de la capacité de mener à bien des projets rapidement à moindre coût une fois que les fondations nécessaires auront été posées.
Nous nous demandons s'il faut penser d'emblée certaines infrastructures de façon nationales. Ce pourrait être le cas du cloud. Doit-il être public, garanti par l'État, ou acheté sur un marché cadre de l'État et facilement accessible par toutes les collectivités locales ? Faut-il réfléchir à une messagerie ? Nous étudions tout cela de très près. Nous veillons à ce que les divergences ne soient pas trop nombreuses.
L'inclusion numérique commence par des systèmes qui doivent être pensés pour être accessibles quel que soit le handicap. Près de 20 % de la population a un « handicap » devant l'écran : les uns ont des problèmes de vue ou d'ouïe, les autres ne savent pas lire ou sont dyslexiques. L'inclusion passe aussi par des services inclusifs. Si vous voulez prendre conscience de ce qui peut mal tourner au cours de la transformation numérique de l'action publique, je vous conseille d'aller voir Moi, Daniel Blake, le film réalisé par Ken Loach, qui a obtenu la palme d'or au festival de Cannes de 2016. Mes collègues du Government Digital Service concèdent que, si Ken Loach a la dent dure et ne les aime pas, son film ne relève pas de la fiction et ne raconte pas quelque chose de faux. Ils considèrent que Ken Loach a été méchant et qu'il a un peu caricaturé la situation, mais que les risques dont il parle existent.
Vous courrez ces risques si vous ne pensez pas la transformation de l'action publique au service des citoyens, dans un véritable dialogue, avec un vrai respect, et en prévoyant la capacité pour les agents publics de débrider le système.
Je vous raconte l'une des choses les plus tristes qui me soit arrivée depuis un an : dans le métro, j'ai entendu un jeune homme expliquer à son amie qu'il venait de demander deux formations à Pôle emploi, soutenu par son conseiller, mais que l'ordinateur n'avait pas voulu parce que les cours en question se chevauchaient pendant deux heures. Il semblait résigné, son amie aussi, manifestement son conseiller de Pôle emploi l'était également. C'est cela qui était triste : tout le monde était résigné. J'estime que, quel que soit le système informatique que vous construisez, il faut laisser la possibilité à l'agent au guichet, celui qui discute avec l'usager, de forcer le système et de permettre à un jeune de prendre deux formations même s'il doit manquer deux heures de l'une d'entre elles. Non seulement le design n'avait pas prévu cette option, mais cette impossibilité n'était même pas vécue comme inadmissible.
Ce type de lacune explique l'échec de certains de nos grands projets. L'informatique ressources humaines de l'éducation nationale est complexe parce que chaque rectorat a besoin d'adapter légèrement le système à la réalité – par exemple, des professeurs commencent à faire cours à la rentrée avant la signature de leur contrat, mais les systèmes informatiques flambant neufs ne prévoient pas que l'on puisse travailler avant cette échéance. En clair, il faut laisser du jeu pour que l'on puisse s'adapter sur le terrain.
L'inclusion numérique concerne, bien entendu, le handicap, mais elle va, selon moi, jusqu'à l'open government. De fait, en République, la voix de chaque citoyen compte, et celui-ci a le droit de demander des comptes à tout agent public de l'administration, de constater la nécessité de l'impôt et d'en suivre l'assiette, le taux et l'emploi. Dès lors, un projet d'inclusion doit comprendre, me semble-t-il, la participation du citoyen à la décision publique. Je rêve, par exemple, qu'un jour, vous décidiez que les études d'impact des projets de loi doivent être mises en ligne un mois avant le début de la discussion du texte afin que les Français puissent donner leur avis. Ce serait un progrès bien plus important, me semble-t-il, que celui qui consisterait à les associer aux débats. Nous savons comment les études d'impact sont conçues : ce n'est pas sérieux ! De même, il arrive que les attendus de certains textes soient fantasmatiques ; les citoyens devraient pouvoir vous le dire.
En tout état de cause, M. Mounir Mahjoubi a fait de l'inclusion numérique l'un des marqueurs de son action. Outre une mission interministérielle, une mission au sein de l'Agence du numérique y est consacrée. J'ignore si, dans le cadre de la transformation publique, des fonds d'investissement seront spécifiquement fléchés vers l'inclusion, mais nous saurons financer les futurs projets. Au demeurant, pour ce qui est de l'accessibilité – qui est le sujet que je connais le mieux, puisqu'il relève de la DINSIC –, le problème est que c'est un combat sans fin – et c'est pourtant le plus facile à traiter des trois sujets que j'ai évoqués. Il s'agit en effet de permettre à une personne handicapée équipée d'un appareil de lire une page web, par exemple. Il suffit donc d'assurer une interopérabilité avec des terminaux adaptés à différents handicaps. Des terminaux de ce type, il s'en invente tous les ans ! Dans le cadre de la loi pour une République numérique, nous avons donc plutôt insisté sur l'obligation pour les administrations – et nous les y aidons, grâce à des listes de bonnes pratiques – d'indiquer sur leurs sites respectifs le niveau d'accessibilité de ces derniers. Ainsi, celles qui réalisent un très mauvais score auront envie de s'améliorer.
Madame El Haïry, vous m'avez interrogé sur la souveraineté. Ce qui est triste, c'est que les deux systèmes que vous avez évoqués, nous les avons bien faits nous-mêmes. Certes, nous avons eu recours à d'innombrables développeurs venant d'entreprises de services numériques, mais nous ne les avons pas achetés clefs en main. En l'espèce, le problème réside surtout dans une conception un peu archaïque de l'informatique : on a conçu des processus très rigides, puis on a demandé aux informaticiens de les mettre dans un logiciel. À ce propos, mais je sais que c'est un voeu pieux, le législateur pourrait nous aider en veillant à ne pas laisser se multiplier des définitions différentes et contradictoires d'une même notion. À Bercy, par exemple, il existe dix-sept définitions différentes du chiffre d'affaires d'une entreprise, si bien que les informaticiens doivent coder toute une série de « sous-cas », qui se croisent les uns les autres. Établir des définitions et des données de référence, même si c'est un travail un peu ingrat, diviserait les difficultés par deux. Par ailleurs, mes ingénieurs me disent qu'à l'instar de la puissance de calcul des ordinateurs – vous connaissez la fameuse loi de Moore –, la complexité du code fiscal double tous les deux ans, à tel point qu'elle annule tous les gains de productivité permis par l'informatique. Certes, ils exagèrent un peu : je ne crois pas que cette complexité soit exponentielle. Mais il faut y penser, car les SI ressources humaines ou les SI budgétaires sont moins bons qu'il y a trente ans, précisément à cause de la complexité croissante des situations. Je pense notamment à la gestion des ressources humaines de la fonction publique, dans laquelle il existe d'innombrables primes. Dans l'armée, par exemple, vous percevez une prime différente selon que vous sautez en parachute de plus ou de moins de 1 500 mètres ; vous percevez une autre prime en fonction du nombre de sauts effectués dans le mois... Je ne suis donc pas certain que les défaillances soient dues aux développeurs ; elles sont davantage imputables à un système de règles figé. Au demeurant, Chorus a tout de même permis de diviser par deux les délais de paiement de l'État – au prix, c'est vrai, d'une grande souffrance pour les agents publics qui l'utilisent. Il est triste, je vous parle sincèrement, que l'on ne sache pas concevoir une expérience utilisateur digne de ce nom.
Par ailleurs, madame Grégoire, les entreprises n'ont pas besoin de connaître l'API Entreprise : elles doivent constater que l'administration ne leur demande plus de Kbis, ni d'attestation du règlement de leurs impôts ou de leurs charges sociales. L'an dernier, nous avons ainsi dématérialisé – c'est vérifiable en ligne : les statistiques sont transparentes – 15 millions de pièces, soit autant de photocopies et de courriers économisés pour les entreprises. Toutefois, on peut comprendre qu'elles ne s'en soient pas aperçues si ces 15 millions de pièces sont noyées dans un océan d'un milliard... Elles s'en apercevront le jour où nous serons allés au bout et où certaines démarches se feront sans qu'elles aient à fournir la moindre pièce. À ce sujet, il vous est proposé de voter une expérimentation dans le projet de loi « ESOC » ; il s'agit de design de politiques publiques. Le principe « Dites-le nous une fois » a déjà été inscrit dans la loi il y a quatre ans, mais il est quasiment inapplicable. En effet, selon ce principe – au risque de caricaturer –, une administration ne peut plus demander à l'usager une pièce si celle-ci a déjà été transmise, mais on ne dit pas où, ni sous quel format, ni qui est chargé de la vérification. L'administration peut être de bonne foi : elle ne sait pas où se trouve la pièce. Nous avons donc pris la question dans l'autre sens : puisque des API robustes ont livré 15 millions de pièces, celles-ci ne seront plus jamais demandées aux entreprises. Le texte précise même qu'elles ne seront plus tenues de les transmettre. Ce dispositif me paraît plus prometteur, car l'entreprise pourra identifier les pièces que l'administration n'est plus en droit de lui demander et, surtout, celle-ci pourra se retourner vers nous, qui lui fournirons la pièce en question.
En ce qui concerne les lâchers de données publiques, en droit pur, la question est réglée puisque la loi pour une République numérique dispose que toute donnée qui aurait été ouverte si l'on s'était adressé à la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) doit être publiée sans attendre. Cette publication se fera cependant par étapes : en 2018, l'obligation ne porte que sur les informations-clefs, puis elle sera étendue à toutes les informations en 2020. Évidemment, un travail de pédagogie et d'accompagnement est nécessaire, notamment auprès des collectivités locales ; il faudra attendre encore quelques années avant que ce soit un réflexe. Moi-même, j'ai reçu une requête CADA cette semaine, et j'ai demandé à mes équipes de l'étudier et d'évaluer les risques éventuels pour l'État.
Mais, très vite, va se poser une autre question – vous le verrez dans le « rapport Villani ». En effet, pour que la France ait une petite chance dans la compétition industrielle, il va nous falloir éduquer nos intelligences artificielles avec des données qui, en fait, ne seront jamais publiques. En effet, on ne mettra pas en ligne les ordonnances telles qu'elles apparaissent dans le système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (SNIIRAM), ni le parcours de chaque voiture : il s'agit de données personnelles à l'état pur. Or, il faudra bien trouver un moyen de leur appliquer tout de même la révolution de l'intelligence artificielle. Nous devrons donc trouver des formats de partage de données qui ne soient pas l'open data, qui soient plus contrôlés, afin de permettre l'innovation. Ces paquets de données personnelles, à forte sensibilité économique ou industrielle, doivent pouvoir être utilisées si nous ne voulons pas décrocher dans la bataille mondiale de l'intelligence artificielle.

Monsieur Verdier, vous avez déjà en partie répondu à ma question en évoquant l'existence d'une instance de concertation avec les collectivités locales. Je suis en effet préoccupé des conséquences que peut avoir la modernisation numérique de l'État à la périphérie de celui-ci. Je m'explique. Dans ma circonscription, une phase de dématérialisation, qui avait été dictée par la préfecture, s'est traduite par un accroissement de travail pour les mairies, qui devaient saisir des informations pour son compte. De même, on nous a demandé d'installer une borne informatique dans l'hôtel de ville et de mettre un agent à la disposition du public pour qu'il explique aux usagers comment accéder aux portails des différentes administrations et les utiliser. Je souhaite donc savoir comment vous prenez en compte ces reports à la périphérie de l'État et si vous avez envisagé un accompagnement de l'utilisateur jusqu'au bout de la chaîne.

Lorsqu'en tant que maire, j'ai voulu mettre en ligne un portail permettant aux parents d'inscrire leurs enfants à la cantine et de payer les factures afférentes, cela m'a pris un an ! Je suis donc allé sur le site du programme de DCANT, la boîte à outils de l'innovation publique, pour savoir comment cela se passerait si j'entreprenais cette démarche aujourd'hui. J'aurais en effet aimé que l'on me conseille, à partir des pratiques des différentes collectivités, de suivre tel modèle, qu'on m'aide à le tester et que l'on m'accompagne en cas d'échec. Il me semblerait donc utile que l'on dispose d'un catalogue des bonnes pratiques.
Par ailleurs, de quelles capacités d'initiative et de quelles marges de manoeuvre un manager public dispose-t-il pour créer de l'innovation ? Comment, dans ce cadre, valoriser la prise de risques et, le cas échéant, gérer l'échec ?

J'ajouterais deux dernières questions. Tout d'abord, la souveraineté du cloud est-elle le soft power de demain ? Quelle importance accordez-vous à la notion de propriété du cloud ? Ensuite, pourriez-vous nous dire, si vous le savez, ce qu'est devenue l'initiative que Paul Duan et Bayes Impact avaient lancée avec Pôle emploi il y a environ deux ans ? S'agit-il, selon vous, d'un bon exemple de collaboration entre de jeunes entrepreneurs très talentueux et un service public ?
Le risque d'une dématérialisation qui se déchargerait du fardeau administratif sur d'autres existe. Du reste, l'État n'est pas le seul concerné. Je m'étonne, par exemple, que le dossier unique des marchés européens, s'il simplifie bien le travail au niveau européen – puisque ce dossier sera interopérable entre pays –, aboutisse à exiger des entreprises encore plus de pièces qu'auparavant, puisqu'on a additionné les différentes procédures au lieu de se situer à leur intersection. Nous essayons d'être attentifs à ce risque. Je ne veux pas en dire trop dans le cadre d'une audition publique mais, l'an dernier, par exemple, nous avons bloqué un projet auquel, estimions-nous, les collectivités locales ne pourraient pas se greffer facilement, faute d'une API bien documentée. C'est presque une question éthique : a-t-on réglé un problème parce qu'on l'a déplacé ? Certaines entreprises sont devenues très prospères en faisant monter par leurs clients les meubles qu'elle leur vendait... La tentation de confier le travail aux utilisateurs ou de l'externaliser peut donc exister. En tout cas, là aussi, la stratégie de « plateformisation » permet d'éviter une partie de ces difficultés.
Quant au catalogue de bonnes pratiques, monsieur Labaronne, c'est une très bonne idée. Mais les collectivités locales pourraient se fédérer d'elles-mêmes, sans attendre une intervention de l'État, et partager leurs bonnes pratiques. Cela dit, nous avons publié, hier, le référentiel des logiciels libres recommandés par l'État – ils sont au nombre de 138, pour l'instant – et nous nous efforçons de publier de véritables bonnes pratiques à suivre pour éviter de rater un grand projet, par exemple, ou pour réaliser un site clair et accessible – elles sont disponibles sur le site références.modernisation.gouv.fr. Un de nos leviers d'action est, du reste, de faire redécouvrir les bonnes règles par les acteurs eux-mêmes, et de les diffuser largement. Toujours est-il que, si vous deviez, aujourd'hui, créer le site que vous avez évoqué, « France Connect » vous dispenserait de vérifier l'identité des parents. J'ajoute que, dans deux ans, un système de paiement imaginé par la DGFiP vous permettra d'encaisser les règlements sans avoir à conclure un accord avec une banque. Nous avançons aussi en libérant de la ressource pour l'action. Si j'étais taquin, j'ajouterais que si l'ensemble des communes nous fournissaient la carte scolaire, ce serait formidable : actuellement, nous ne pouvons pas la diffuser en open data, et c'est bien triste.
Qu'en est-il de la prise de risque des managers publics ? C'est une véritable question. Nous, directeurs d'administration centrale, nous sommes dans une position très inconfortable car nous pouvons être virés tous les mercredis ! Nous ne vivons donc pas dans des bulles, à l'abri de tout risque. À cet égard, j'ai été frappé, moi qui ai travaillé dans les deux mondes, des différences qui existent entre le privé et le public. Dans le privé, lorsqu'on vous confie une business unit, on vous vous demande des comptes un an plus tard et, en cas d'échec, vous dégagez. En attendant, on peut recruter qui l'on veut, choisir de faire de la prestation ou de la masse salariale, décider de faire une campagne de publicité à la télévision... Dans le public, le manager public assume des responsabilités, est capable de prendre des risques, mais il n'a pas le pouvoir adjudicateur sur ses propres marchés et ne peut pas recruter qui il veut à cause du contrôle de gestion. Au début de l'année, on lui dit : « Voilà votre masse salariale, vos prestataires, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement ». Il faudrait donc tester, me semble-t-il, un mode de fonctionnement fondé sur un contrôle a posteriori et sur une plus grande transparence, avec des managers qui auraient autant de latitude que ceux qui gèrent une business unit. Là, c'est très difficile. Il y a cinq ans, lorsque j'ai compris que je devais négocier mon effectif salarial, mon budget et mes objectifs avec trois personnes différentes, cela m'a paru un peu curieux...
En ce qui concerne le cloud, il n'est pas nécessaire de détenir ses propres data centers gigantesques pour être souverain. Il suffit, pour cela, qu'il existe une véritable réversibilité, c'est-à-dire que l'on puisse quitter un prestataire pour un autre quand on le décide. Mais la révolution du cloud réside également dans la manière de concevoir les applications numériques. En effet, il existe aujourd'hui de plus en plus de briques intelligentes – reconnaissance faciale, paiement en ligne... – nativement pensées pour le cloud. On peut ainsi utiliser trois fonctionnalités issues de trois fournisseurs distincts, les encapsuler, les remplacer... Penser l'informatique post-cloud est probablement une affaire de souveraineté, mais si, actuellement, on sait faire des clouds – les ministères de l'intérieur et de l'environnement et Bercy y sont parvenus –, on ne sait pas encore concevoir des applications nativement post-révolution du cloud.
Le travail réalisé par Bayes Impact avec Pôle emploi me semble être une très belle illustration de la stratégie de l'État plateforme. Je rappelle qu'il s'agit d'un projet d'aide au retour à l'emploi, nommé « Bob emploi », qui utilise beaucoup de données publiques et d'API de Pôle emploi ainsi qu'un algorithme conçu par mon équipe. Certains de ses utilisateurs sont très satisfaits. Certes, on s'est aperçu que, dans certains cas, ce service ne facilitait pas massivement le retour à l'emploi. Mais j'ai toujours pensé qu'il n'existait pas de martingale en la matière : contrairement à ce qu'en a dit la presse, je ne crois pas que les data sciences permettront de réduire le chômage de 15 % car, en France, celui-ci n'est pas lié uniquement à la difficulté de faire se rencontrer l'offre et la demande ; il est structurel. Mais, pour des milliers d'usagers, ce coach personnel, qui suggère chaque jour à son utilisateur trois actions, a été d'une grande aide. On attend maintenant une évaluation de ce service. Je pense que, lorsqu'ils auront un peu plus de recul, ils évalueront, en double aveugle, l'espérance du retour à l'emploi des personnes qui utilisent le service et celle des personnes qui ne l'utilisent pas. Nous avons réalisé, quant à nous, une telle évaluation avec une start-up d'État, « La bonne boîte », qui permet d'identifier les entreprises qui vont bientôt recruter afin de favoriser les candidatures spontanées : le taux de retour à l'emploi à six mois des personnes à qui Pôle emploi a donné l'adresse de ce site s'améliore de 10 %. C'est donc satisfaisant, même si cela reste faible.

Je vous remercie, monsieur le directeur, d'avoir répondu à nos questions de manière très ouverte et très détaillée et de nous avoir ainsi permis de mieux comprendre votre organisation. En outre, votre audition complète parfaitement, me semble-t-il, celle de M. Thomas Cazenave, que nous avons entendu avant vous.
Informations relatives à la commission
La commission a désigné M. Olivier Gaillard rapporteur pour avis sur le titre Ier du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n° 659).
Membres présents ou excusés
Réunion du mardi 13 février 2018 à 16 heures 45
Présents. - M. Saïd Ahamada, M. Julien Aubert, M. Jean-Noël Barrot, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Louis Bricout, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chassaing, Mme Dominique David, Mme Stella Dupont, Mme Sarah El Haïry, M. Olivier Gaillard, M. Joël Giraud, M. Romain Grau, Mme Olivia Gregoire, M. Stanislas Guerini, M. Alexandre Holroyd, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, M. Daniel Labaronne, M. Mohamed Laqhila, M. Michel Lauzzana, M. Gilles Le Gendre, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Jean-Paul Mattei, M. Patrick Mignola, Mme Amélie de Montchalin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Hervé Pellois, Mme Christine Pires Beaune, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, M. Jacques Savatier, M. Benoit Simian, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Jean-Pierre Vigier, M. Philippe Vigier, M. Éric Woerth
Excusés. - M. Éric Alauzet, Mme Émilie Cariou, M. Éric Coquerel, M. Olivier Damaisin, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, Mme Bénédicte Peyrol, M. Olivier Serva
Assistait également à la réunion. - M. Dino Cinieri
———–——